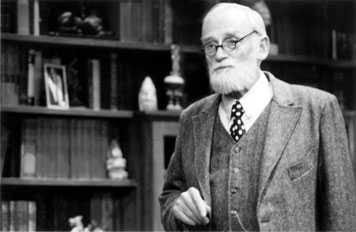Poésie de Fabio Pusterla
Poésie de Fabio Pusterla
La poésie qui me parle vraiment est aujourd’hui rarissime, mais dès que j’ai « entendu » la voix de Fabio Pusterla, dès que je suis « entré » dans ses images et sa musique, dès que j’ai « vu » les objets tels que l’éclaire la lumière de ses mots, il m’a semblé ressentir la même amplification de présence, le même sentiment de dilatation intérieure et de perception accrue que j’ai pu éprouver en forêt ou dans les grandes villes à la lecture de Pavese ou de Saba. Philippe Jaccottet, dont Pusterla a traduit plusieurs recueils, dit très justement de sa poésie que « tout, à travers sa voix ferme, sobre, admirablement maîtrisée, est toujours à la fois quotidien, proche, vrai et vaste, réel et néanmoins mystérieux », comme je l’ai ressenti si fortement tout à l’heure, rangeant mes livres et retombant dans Une voix pour le noir, premier recueil en version bilingue que j’aie lu de lui, sur ce Paysage dont je dois recopier ici chaque mot dans nos deux langues :
Ici, il pleut des jours entiers, parfois des mois.
Les pierres sont noires d’averses,
les sentiers lourds.
Sur le bord des canaux :
Têtards, ferraille sombre. Une valise
goudronnée.
Un filet d’huile coule
sur le gravier. Dessus, du ciment
Si tu grattes la terre : des déchets,
briques écaillées, dents de lapins.
On peut penser à des bruits humains,
des pas, balles de tennis. Voix éventuelles.
Tout débris est admis à condition d’être inutile.
Comme il s’agit du vide il y a de la place pour tout,
Et ce peu qu’il y a, est comme s’il n’était pas.
Même les voies sont parfaitement inertes,
les lézards immobiles, les wagons
oubliés.
Et puis le poulailler. Les choses sans histoire.
Ou dehors. Une brouette
Qui n’a pas de roues. Un puits. Un seau pourri
Sans fond. Le prénom d’un idiot :
Luigino. Plumes dans le grillage, de poule.
Trous dans le grillage. Intrigues rompues.
Ce que vous n’appelez pas cruauté.
Je suis ceci : rien.
Je veux ce que je suis, fortement.
Et les mots : maintenant personne ne mes les volera.
Ce qui se chante en italien :
Qui piove per giorni interi, talvolta per mesi.
I sassi sono neri d’acquate,
I sentieri pesanti.
Sul bordo delle rogge :
Girini, latte scure. Una valigia
Incatramata.
Un filo d’olio cola
Sulla ghiaia. Sopra, cemento.
Se gratti la terra : detriti,
mattoni scagliati, denti di coniglio.
Si possono pensare rumori umani,
passi, palle da tennis. Voci eventuali.
Ogni frantume è ammesso purché inutile.
Siccome questo è il vuoto c’èposto per tutto,
E quel poco che c’è, è come se non ci fosse.
Anche i binari sono perfettaments inerti,
Le lucertole immobili, i vagoni
Dimenticati.
E poi il pollaio.Le cose senza storia.
O fuori. Una carriola
che non ha ruote. Un pozzo. Un secchio marcio
privo di fondo. Il nome di uno scemo :
Luigino. Piume dentro la rete, di gallina.
Buchi dentro la rete. Trame rotte.
Quello che no chiamate crudeltà.
Io sono questo : niente.
Voglio quello che sono, fortemente.
E le parole : nessuno adesso me le ruberà.
Cette poésie, cette lumière noire, ce chant muet me rappelle Tarkovski.
Et cette vision de nos enfants petits :
Sommeil de Claudia et Nina
Tu disais que le jour
l’obscurité reste dans les armoires,
ou derrière les montagnes,
et ne sort que vers le soir,
quand on peut dormir
et avoir peur.
Mais c’est une nuit d’insomnie, pleine lune,
et derrière chaque fissure l’air palpite,
magnétique, je devine
presque chaque repli des bois.
Ainsi je compte vos
respirations, corps ici tout près : longue vague
qui monte lentement et descend, qui revient,
Et dessous, des abîmes, la danse des murènes.
Fabio Pusterla. Une voix pour le noir (poésie 1985-1999). Préface de Philippe Jaccottet. Traduit de l’italien par Mathilde Vischer. Editions d’En Bas, 2001.









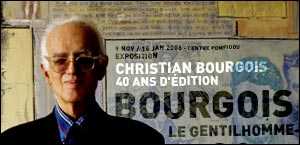









 Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p
Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p

 La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.
La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.


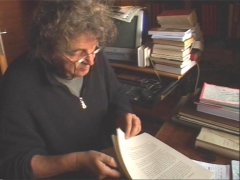

 Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale.
Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale. L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer.
L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer. Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p.
Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p. Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme.
Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme. 


 Une très humaine comédie noire
Une très humaine comédie noire


 Mon Prix Goncourt : à M. François Emmanuel, pour Regarde la vague, au Seuil ; M. Hubert Haddad, pour Palestine, chez Zulma ; M. Philippe Claudel, pour Le Rapport de Brodeck, chez Stock. Non pas ex-aequo, mais : à choix.
Mon Prix Goncourt : à M. François Emmanuel, pour Regarde la vague, au Seuil ; M. Hubert Haddad, pour Palestine, chez Zulma ; M. Philippe Claudel, pour Le Rapport de Brodeck, chez Stock. Non pas ex-aequo, mais : à choix. Mon Prix Goncourt étranger à l’unanimité: à M. Mikhaïl Chichkine, pour Le Cheveu de Vénus, chez Fayard.
Mon Prix Goncourt étranger à l’unanimité: à M. Mikhaïl Chichkine, pour Le Cheveu de Vénus, chez Fayard. Mon Prix Médicis : à M. Marius Daniel Popescu, pour La symphonie du loup, chez Corti ; M. Alain Dugrand, pour Insurgés, chez Fayard ; M. Vassilis Alexakis, pour Av. J.-C, chez Stock.
Mon Prix Médicis : à M. Marius Daniel Popescu, pour La symphonie du loup, chez Corti ; M. Alain Dugrand, pour Insurgés, chez Fayard ; M. Vassilis Alexakis, pour Av. J.-C, chez Stock. Mon Prix Femina : à Mme Marie Darrieussecq, pour Tom est mort, chez P.O.L.; Mme Linda Lê, pour In memoriam, chez Bourgois; Mme Michèle Lesbre, pour Le canapé rouge, chez Sabine Weispieser.
Mon Prix Femina : à Mme Marie Darrieussecq, pour Tom est mort, chez P.O.L.; Mme Linda Lê, pour In memoriam, chez Bourgois; Mme Michèle Lesbre, pour Le canapé rouge, chez Sabine Weispieser. Mon Prix Décembre à l’unanimité : M.Philippe Sollers, pour Un vrai roman, chez Plon.
Mon Prix Décembre à l’unanimité : M.Philippe Sollers, pour Un vrai roman, chez Plon.

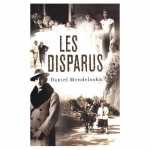 Il en va des prix littéraires parisiens comme de l’état actuel de la littérature française dans le monde : le grand air, les grandes entreprises, voire les grandes œuvres
Il en va des prix littéraires parisiens comme de l’état actuel de la littérature française dans le monde : le grand air, les grandes entreprises, voire les grandes œuvres Curieusement, les prix littéraire confondent de plus en plus les genres, où l’appellation « roman » n’a plus guère de sens. Les trois Médicis sont ainsi tous, en réalité, des « essais », même si L’année de la pensée magique de Joan Didion, publié chez Grasset
Curieusement, les prix littéraire confondent de plus en plus les genres, où l’appellation « roman » n’a plus guère de sens. Les trois Médicis sont ainsi tous, en réalité, des « essais », même si L’année de la pensée magique de Joan Didion, publié chez Grasset


 Les nus et les morts (1948) est le plus "évident" qui, sous couvert d’un roman de guerre, est une première approche de l’homme américain sous quatre aspects opposés (le général autocrate, son aide de camp gauchisant, un prolétaire anarchiste et un sergent bestial) avec lequel le tout jeune Mailer (né en 1923 dans une famille juive du New Jersey), diplômé d’Harvard et pilote dans le Pacifique, est aussitôt propulsé au premier rang de la scène littéraire.
Les nus et les morts (1948) est le plus "évident" qui, sous couvert d’un roman de guerre, est une première approche de l’homme américain sous quatre aspects opposés (le général autocrate, son aide de camp gauchisant, un prolétaire anarchiste et un sergent bestial) avec lequel le tout jeune Mailer (né en 1923 dans une famille juive du New Jersey), diplômé d’Harvard et pilote dans le Pacifique, est aussitôt propulsé au premier rang de la scène littéraire.