
Hommage à Maître Jacques prononcé à la Bibliothèque nationale, à Berne, en présence de l'écrivain et de la Présidente de la Confédération Ruth Dreifuss, à l'occasion de la remise du Fonds Jacques Chessex aux Archives littéraires suisses, en 1989.
Reconnaissance. J’aime faire sonner ce mot aujourd’hui. Reconnaissance de ce qui a été, et pour ce qui sera : ce qui a été donné et ce qui survivra. Reconnaissance de la première faille et du premier élan créateur. Reconnaissance au moment du dernier envol.
Reconnaissance alors, première, comme à tâtons, véritable exploration des territoires sensibles où tout s’est joué au commencement. À tâtons, comme dans un rêve, mais pour une ressaisie si concrète dès les premières lignes où affleure la maison de l’adolescence. Et d’emblée c’est la musique d’un poète :
« À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».
Est-ce que nous ne nous y reconnaissons pas tout de suite ? Est-ce que nous ne nous rappelons, tous, ce jardin « en petite pente » ? Est-ce qu’ils ne sont pas à nous tous, ces reflets de lac dans les chambres ? Or nous voici à l’orée d’un monde dont les images vont émerger peu à peu comme d’une camera oscura et nous relier à la vie et aux livres qui ponctuent cette vie, mais aussi à nos propres ombres et à nos propre lumières.
Tout à l’opposé de mémoires anecdotiques, l’œuvre déploie des images vivantes qui cristallisent les sensations primordiales autant que les questions essentielles : le vertige d’être, la souffrance du manque, le « sentiment aigu de l’inutilité de la vie » et, inversement, cette « force organisatrice de plaisir et de décision » qui va dresser la pyramide de l’œuvre dans le désert, et le sentiment de l’infini, enfin l’aspiration à l’allègement et à l’élévation : « Comme si j’étais capable à la fois de côtoyer le espaces les plus désolés et la clarté, le feu, le torrent, l’air ».
Tel étant le sol physique et métaphysique d’un Jacques Chessex élémentaire. Terrien. Mais esprit subtil. Style tantôt chargé, jusqu’au baroque, et tantôt fluide, voire cristallin. Poids du monde et chant du monde.
Il y a donc cette maison où l’adolescent apprend à écrire et à dessiner, à peindre, à écouter et à jouer le blues, mais sur laquelle pèse déjà le poids d’une menace.
Reconnaissance cependant du fils au père initiateur : « Dedans, l’écriture, c’était mon père, ses livres d’étymologie et d’histoire, sa bibliothèque, ses corrections d’épreuves, le latin, la toponymie, les dossiers des contes, les dictionnaires. Il était mon encyclopédie bienveillante et mon initiateur à toutes sortes de formes et de sens. Je sais que si j’écris aujourd’hui, c’est parce que j’ai imité mon père dès que j’ai eu six ou sept ans ».
Plus tard, reconnaissance aussi, dehors, à l’aîné providentiel qui encouragera le garçon dans sa singularité d’écrivain déjà perceptible : le professeur de collège et l’écrivain Jacques Mercanton.
Reconnaissance encore, à l’autre sens du terme, de la terra incognita des parents. Et combien de détails déchirants remonteront alors des fonds obscurs. Tout un monde que filtre à distance, dans L’Imparfait, le regard d’un homme désormais plus âgé que son père suicidé.
Une remarque me renvoie ici à ma perplexité de naguère : « On a pu croire, à tel de mes premiers romans, que j’avais un problème littéraire avec mon père, ou que le thème du père était chez moi tout littéraire, et que j’exploitais en homme de lettres une mythologie balisée et confortable ».
Or j’en suis venu à croire à l’entière sincérité de sa défense : « Il y a en moi un poids de douleur que rien, je le sais calmement, n’épuisera ». Et comment douter aussi bien, au regard des récits et des poèmes que Jacques Chessex a publiés depuis lors, tels L’économie du ciel, Le désir de Dieu ou Pardon mère, qu’il n’a cessé de vivre la relation au père disparu « comme une élégie interminable ».
Quelque chose a été brisé qui instaure à jamais le règne de l’imparfait, et le ressouvenir du seul mot jardin suffit à exacerber la peine : « Mots douloureux : « Papa est au jardin », « on goûtera au jardin », « les premières cerises du jardin », toujours cette cloche grêle, fêlée, au fond de la phrase. À jamais le non-réalisé, l’interrompu, le non-vécu – l’imparfait ».
L’imparfait comme temps de l’enfance, mais qui détermine aussi le premier écart et la première entreprise personnelle. Je suis seul et vous êtes tous. Telle sera la situation du solitaire qu’on regarde de travers à la pension de la respectable veuve Augustine Lequatre, dans La Tête ouverte, et telle aussi la situation du pasteur Burg et tous les avatars romanesques de l’auteur, de Carabas à Aimé Boucher.

L’imparfait. Plutôt que le temps sentimental de la mélancolie, celui d’un « vertige nauséeux » dont on doit s’arracher pour survivre.
« Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis Dieu devint parole dans un homme. Puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut « Ich hab genug », Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dansles os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de son corps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir.
« Comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais ».
°°°
Autre plongée. Car le temps de la maison sur le jardin « en petite pente » est aussi celui des premières échappées du corps à la recherche d’une certaine odeur entêtante. Dès l’enfance s’est ouvert cet autre à-pic, mais à présent c’est dans le temps que va se prolonger cette fringale d’une nourriture terrestre aux implications quasi sacrées. C’est que là aussi s’est révélé le sentiment d’une séparation initiale : « Le corps des femmes est autarcique. C’est-à-dire qu’il est un monde, ou un territoire, un lieu, une circonstance, une évidence qui se suffit à soi-même. Ainsi sa supériorité, sa nuit, sa gloire ».
L’œuvre de Jacques Chessex s’est construite, de part en part, sur une faille. Mais celle-ci n’est-elle pas notre part à tous ? D’où peut-être, aussi, le rejet que suscite cette œuvre ? Ainsi son mimétisme fait-il de l’écrivain un médium de nos exultations et de nos misères, de nos appétits multiples et de nos angoisses exorcisées par le verbe.
Car il faut dire également le courage, l’obstination et la santé de cette œuvre. Si l’imparfait subi est le temps de l’enfance, l’imparfait retourné sera celui du baroque et de la vie profuse, du mouvement et de la lumière, des ombres mais signifiant aussi la vie, du chaos vivant mais sublimé par le style.

Reconnaissance alors à Jacques Chessex pour notre langue qui est celle à la fois de Pascal et d’Agrippa d’Aubigné, de Rousseau et de Benjamin Constant, de Ramuz et de Chappaz, de Mallarmé et de Gustave Roud.
Reconnaissance aussi pour notre pays, non pas au sens d’un esthétisme du repli, mais dans la présence proche du Jorat et l’ouverture européenne qui associe Jacques Mercanton et Vladimir Nabokov, Flaubert et Cingria qu’il prolonge également, ou cet ouvert obscur très suisse « par en dessous » qui lie Robert Walser et Louis Soutter, ou Wölffli et Jean-Marc Lovay à l’enseigne de la « société des êtres » dont parle Georges Haldas.
Reconnaissance enfin pour ce que Jacques Chessex nous fait reconnaître en nous. À tout instant la même ruine nous menace, mais il y a le blues et le psaume, et le poète « plein de Dieu » qui n’en finit pas de conjurer l’imparfait : « Me suivra-t-on si j’affirme y voir une vraie résurrection de l’être à l’instant même où il croyait se perdre ? Je me défaisais dans le spectacle du non-visible et l’esprit me revient comme une gorgée neigeuse qui me soulève au-dessus de l’indistinct. Le doute, à chaque fois, cède à cette force et fait place à une joie tout de suite habitable.


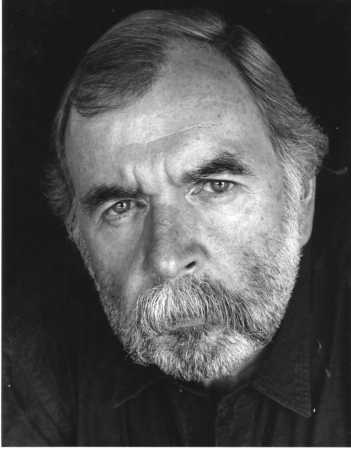
 Comme une
Comme une

 Un écrivain hanté par le sacré
Un écrivain hanté par le sacré

