Sur Les Plaisirs de la littérature, de John Cowper Powys.
C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun débile de nos jours. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’un petit délassement d’amateur au sens esthète ou d'un agité hyperfestif mais relèvent de la plus haute extatique jouissance, à la fois charnelle, intellectuelle et et spirituelle.
On connaît déjà John Cowper Powys pour sa révélatrice Autobiographie, les romans tout empreints de sensualité tellurique et de magie visionnaire que représentent Les sables de la mer, Wolf Solent et la tétralogie des Enchantements de Glastonbury, ou encore ses essais diversement inspirés sur Le sens de la culture et L’Art du bonheur. Or le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.
«Toute bonne littérature est une critique de la vie», affirme John Cowper Powys en citant Matthew Arnold, et cette position, à la fois radicale et généreuse, donne son élan à chacun de ses jugements, et sa nécessité vitale. Pour John Cowper Powys, la littérature se distingue illico des Belles Lettres au sens académique de l’expression. La littérature concentre, dans quelques livres qu’il nous faut lire et relire, la somme des rêves et des pensées que l’énigme du monde a inspiré à nos frères humains, et toutes les «illusions vitales», aussi, qui les ont aidés à souffrir un peu moins ou à endurer un peu mieux l’horrible réalité – quand celle-ci n’a pas le tour radieux de ce matin.
Rien de lettreux dans cette approche qui nous fait revivre, avec quelle gaîté communicative, les premiers émerveillements de nos lectures adolescentes, tout en ressaisissant la «substantifique moelle» de celles-ci au gré de fulgurantes synthèses. Rien non plus d’exhaustif dans ces aperçus, mais autant de propositions originales et stimulantes, autant de «germes» qu’il nous incombe de vivifier, conformément à l’idée que «toute création artistique a besoin d’être complétée par les générations futures avant de pouvoir atteindre sa véritable maturité».
Cette idée pascalienne d’une «société des êtres» qui travaillerait au même accomplissement secret du «seul véritable progrès» digne d’être considéré dans l’histoire des hommes, «c’est-à-dire l’accroissement de la bonté et de la miséricorde dans les cœurs» à quoi contribuent pêle-mêle les Ecritures et Rabelais, saint Paul et Dickens ou Walt Whitman, entre cent autres, ne ramène jamais à la valorisation d’une littérature édifiante au sens conventionnel de la morale. D’entrée de jeu, c’est bien plutôt le caractère subversif de la littérature que l’auteur met en exergue. «Une boutique de livres d’occasion est le sanctuaire où trouvent refuge les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l’humanité», relève-t-il avant de préciser que ladite boutique «fournit des armes au prophète dans sa lutte contre le prêtre, au prisonnier dans sa lutte contre la société, au pauvre dans sa lutte contre le riche, à l’individu dans sa lutte contre l’univers». Et de même trouve-t-il, dans l’Ancien Testament, «le grand arsenal révolutionnaire où l’individu peut se ravitailler en armes dans son combat contre toutes les autorités constituées», où le Christ a puisé avant de devenir celui que William Blake appelait le Suprême Anarchiste «qui envoya ses septante disciples prêcher contre la Religion et le Gouvernement».
Mais peu d’anarchistes sont aussi soucieux que Cowper Powys d’harmonie et d’équanimité. Si nous nous référons à la distinction faite par Léon Daudet entre écrivains incendiaires et sauveteurs, sans doute est-ce à la seconde catégorie qu’appartient no tre druide bienveillant. «Ce Celte tout de feu, de féerie et de magie est un bienfaiteur», écrit fort justement Gérard Joulié dont la traduction, soit dit en passant, respire la santé vigoureuse et l’élégance.
tre druide bienveillant. «Ce Celte tout de feu, de féerie et de magie est un bienfaiteur», écrit fort justement Gérard Joulié dont la traduction, soit dit en passant, respire la santé vigoureuse et l’élégance.
Rebouteux des âmes, John Cowper Powys nous communique des secrets bien plus qu’il ne nous assène des messages. Les ombres, voire l’obscénité de la littérature ne sollicitent pas moins son intérêt que ses lumières et ses grâces, et s’il répète après Goethe que «seul le sérieux confère à la vie un cachet d’éternité», nul ne pénètre mieux que lui les profondeurs de l’humour de Shakespeare ou de Rabelais.
A croire Powys, le pouvoir détonant de la Bible ne tient pas à sa doctrine spirituelle ou morale, mais «réside dans ses suprêmes contradictions émotionnelles, chacune poussée à l’extrême, et chacune représentant de manière définitive et pour tous les temps quelque aspect immuable de la vie humaine sur terre». La Bible est à ses yeux par excellence «le livre pour tous», dont la poésie éclipse toutes les gloses et dont trois motifs dominants assurent la pérennité: «la grandeur et la misère de l’homme, la terrifiante beauté de la nature, et le mystère tantôt effrayant et tantôt consolant de la Cause Première». Mais là encore, rien de trop étroitement littéraire dans les propos de ce présumé païen, dont le chapitre consacré à saint Paul nous paraît plus fondamentalement inspiré par «l’esprit du Christ» que mille exégèses autorisées.
Cet esprit du Christ qui est «le meilleur espoir de salut de notre f… civilisation», et qui se réduit en somme à l’effort séculaire d’humanisation des individus, constitue bonnement le fil rouge liant entre eux les vingt chapitres des Plaisirs de la littérature, courant d’un Rabelais dégagé des clichés graveleux aux visions christiques de Dickens et Dostoïevski, d’Homère fondant un «esprit divin de discernement» à Dante nous aidant à «sublimer notre sauvagerie humaine naturelle pour en faire le véhicule de notre vision esthétique», ou de Shakespeare, à qui l’humour ondoyant et sceptique tient lieu de philosophie, à Whitman qui suscite «une extension émotionnelle de notre moi personnel à tous les autres «moi» et à tous les objets qui l’entourent».
De la même façon, notre «moi» de lecteur, dans cette grande traversée de plein vent ou s’entrecroisent encore les sillages de Montaigne et de Melville, de Cervantès et de Proust, de Milton et de Nietzsche, se dilate sans se diluer, l’énergie absorbée par cette lecture se transformant finalement en impatience vive de remonter à chaque source et de sonder chaque secret.
John Cowper Powys. Les plaisirs de la littérature. Traduit de l’anglais par Gérard Joulié. L’Age d’Homme, 444p. Un dossier de la revue Granit a été consacré à Powys en 1973, constituant une bonne introduction à son œuvre.
Lectures buissonnières I
-
Les secrets de l’humanité
-
Polyphonies de la condition humaine
Antonio Lobo Antunes en traversée.
Il est peu d’œuvres contemporaines dont la traversée procure, autant que celle des romans de l’écrivain portugais Antonio Lobo Antunes, le sentiment de s’immerger en eau profonde et d’avancer comme en apnée dans une sorte de rêve éveillé. Un jeune drogué est en train de mourir dans un hôpital de Lisbonne. La science a déjà établi son bilan fatal tandis que la technique et la chimie le retiennent plus ou moins en vie. Or ses derniers instants constitueront l’une des sphères temporelles qui s’interpénètrent dans La mort de Carlos Gardel, où la voix du garçon se mêle à celle de son père divorcé et à de multiples autres murmures qui s’entrecroisent et s’éclairent mutuellement, pour constituer une sorte de lancinante polyphonie du manque d’amour dont chaque chapitre porte en exergue le titre d’un tango du mythique Carlos Gardel.
A première approche, force est de convenir qu’un tel livre peut dérouter, tant sa trame est serrée et comme couturée de ruptures. De fait, une page d’Antunes combine souvent plusieurs plans de réalité et plusieurs temps, plusieurs niveaux de pensée ou de parole, plusieurs systèmes de dialogues, sans que la cohérence de l’histoire en train de se raconter ne soit pourtant entamée. L’impression d’un fouillis inextricable peut cependant prévaloir faute d’attention de la part du lecteur, à qui il incombe en somme de « construire » à l’unisson de l’auteur. Déchiffrement fastidieux alors ? Pas vraiment, car si complexe que soit la phrase d’Antunes, les éléments constitutifs de ses romans sont si « concrets », si fortement lestés de substance existentielle, affective et psychologique, sensuelle et sexuelle, si « physiques » et si « métaphysiques » à la fois, si profondément en consonance avec la souffrance quotidienne de tout un chacun, mais également si sublimés par la forme et la musique de la langue que jamais on n’a le sentiment d’une complication gratuite.
La meilleure introduction à l’œuvre d’Antunes reste sans doute au demeurant, son premier livre, Le cul de Judas, dont la forme monologuée et l’éclat célinien de l’écriture ne posent aucun problème de lecture. Publié en 1979, Le cul de Judas, dont le titre évoque en portugais un trou pourri, ou l’opprobre frappant le traître, ressaisit, sous la forme d’une confession à laquelle se livre une nuit durant, dans un bar, un homme en train de séduire son interlocutrice, le voyage au cœur des ténèbres qu’a représenté, pour le jeune officier-médecin-écrivain, la guerre en Angola à laquelle il a participé vingt-sept mois durant, de 1971 à 1973. Cela étant, plus qu’un témoignage « sur » la guerre coloniale, Le cul de Judas se déploie comme une incantation, véhémente et lyrique à la fois, où le rescapé de la sale guerre exorcise le cauchemar de sa génération. On en trouve, aujourd’hui, les échos « à chaud » au fil des Lettres de la guerre qu’il a écrites à sa femme durant cette épreuve, publiées par ses filles et tout récemment parues chez Christian Bourgois.
Issu de la bourgeoisie cultivée du quartier de Benfica qu’il a maintes fois évoqué dans ses livres, petit-fils d’un Brésilien marié à une Suissesse alémanique, élevé dans un milieu de médecins et lui-même psychiatre de formation (Connaissance de l’enfer, traduit en 1988, raconte sa plongée dans l’univers des malades mentaux), Antunes s’est colleté, dans ses premiers livres, avec les grands thèmes de l’histoire portugaise récente. Les séquelles de la guerre coloniale sont ressaisies dans le « débat » de Fado Alexandrino (1983) où quatre anciens combattants de l’Afrique se retrouvent lors d’un banquet de bataillon pour une confrontation sur fond de révolution en cours. D’une tout autre tonalité, plus onirique et baroque, mais non moins mordant, Le retour des caravelles (1988) brosse un tableau mémorable des conquêtes du Cinquième Empire et de la décolonisation.
Il y a de la vision à la Garcia Marquez dans cette évocation grinçante du retour des conquérants où les figures mythiques de l’histoire portugaise des XVe et XVUe siècles croisent les dépossédés récents de la décolonisation, où caravelles et cuirassiers mouillent dans les mêmes eaux tandis que le langage du chroniqueur, revisitant à sa façon le premier des dix chants épiques des Lusiades de Camoës, multiplie les anachronismes et les allusions ironiques. Plus qu’un Garcia Marquez, cependant, Antunes investit l’intériorité de ses personnages, portant l’accent sur le désarroi des individus emportés dans la maëlstrom de l’Histoire.
Dans cette perspective, c’est avec Explication des oiseaux, datant de 1981, que la forme novatrice des romans d’Antunes a trouvé sa première cristallisation. Au fil de quatre journées à la continuité rompue par la mort annoncée du narrateur, le lecteur participe littéralement à la lente et inexorable noyade d’un brave prof d’Histoire empêtré dans ses déboires conjugaux. Au fil d’un récit baigné de lancinante mélancolie, l’on assiste alors, simultanément, à la phase finale de la vie d’un couple mal assorti (le fils de bourgeois rêveur et l’intellectuelle communiste agressive, pour simplifier), aux séances de tribunal oniriques durant lesquelles le protagoniste s’imagine jugé tantôt par les siens et tantôt par les camarades prolétaires de sa femme, ou encore à de multiples remémorations de toutes les périodes d’une vie foisonnant de personnages malmenés par l’existence.
« Toutes ces angoisses devant la cruauté de la vie ne peuvent laisser le lecteur indifférent », écrit à ce propos la traductrice et préfacière du Retour des caravelles, Michelle Giudicelli, « car, à travers ces cas particuliers, et indépendamment de la personnalité de chacun, Antonio Lobo Antunes met à nu l’humanité dans son ensemble. Pour ce faire, il s’aide de tous les moyens que le langage met à sa disposition pour créer cette écriture baroque qui lui est si particulière. Afin de rendre le récit plus présent, il n’hésite pas à bouleverser la structure habituelle des phrases, parfois interminables, à y faire alterner le style indirect et le style direct, à passer brusquement d’une narration à la troisième personne à une narration à la première personne, où le héros de l’histoire que l’on est en train de conter réagit devant nous aux événements qu’il vit en un discours intérieur dans lequel il dévoile tout ce qu’il ressent, les souvenirs qui le hantent, les images qui l’obsèdent ».
Cette narration labyrinthique, qu’on pourrait dire également organique, ce concert de voix aux développement polyphoniques, on les retrouve plus amplement déployés dans Le Traité des passions de l’Âme (1990) ou plus encore dans L’Ordre naturel des Choses (1992) dont la forme est explicitement démarquée de la Cinquième symphonie de Gustav Mahler. Par ailleurs, la technique du romancier ne laisse de faire penser à tout moment, aussi, aux procédés de montage, d’enchâssements ou de fondus de l’écriture cinématographique ; et rien, au demeurant, de mécanique ou d’artificiel dans le développement de ces romans qui paraissent au contraire couler comme de lents fleuves moirés, charriant une multitude d’images singulières qui s’incorporent naturellement à la substance du texte.
Voici « l’odeur d’alcool, de peur et d’espoir propre aux hôpitaux » qui avance et recule dans les couloir, « semblable à celle d’une mer endormie ». Voici la vieille mourante dont Antunes parle du « sommeil d’écureuil », tandis que le bruissement d’un envol lui évoque « les petites feuilles minces, innombrables, d’un dictionnaire » ou qu’un poisseux brouillard marin enveloppe la ville « dans un linceul de larmes immobiles » ou qu’une mouette sur l’eau est « couleur de paupière retournée ».
Pour autant, les ressources imagières de l’écrivain ne se bornent pas à de telles « trouvailles » mais tendent de plus en plus à tout rendre plastique, comme si telle esthétique du « tout dire » devait inscrire dans la chair de l’écriture le grand projet du jeune auteur, formulé dans Le cul de Judas, de déchiffrer « le secret de la vie et des gens » et de résoudre « la quadrature du cercle des émotions ».
D’un livre à l’autre, et notamment après La farce des damnés (1985), la propension satirique et grinçante du romancier tend s’adoucir au bénéfice d’une empathie de plus en plus proche de la compassion. Or cet aspect tchékhovien des romans d’Antonio Lobo Antunes, qui nous attache particulièrement à certains personnages désarmés, n’édulcore jamais le tableau clinique des observations de l’écrivain, à la fois moraliste et poète.
Dans L’Ordre naturel des Choses, dont le titre évoque une expression qui l’exaspérait en son enfance (sa mère lui faisant valoir que la mort est, précisément, « dans l’ordre naturel des choses »), Antunes met en scène une série de personnages qui incarnent tous un certain état de déréliction ou de déliquescence, comme il en va des protagonistes de La mort de Carlos Gardel. Il y a là un vieil homme amoureux d’une jeune fille diabétique, laquelle lui offre son lit en échange du paiement de son loyer. Sous le même toit vivent la tante de la jeune fille en train de mourir du cancer, et son père qui a travaillé dans les mines du Mozambique. A ceux-là s’ajoutent un ancien agent de la police politique de Salazar reconverti dans l’hypnotisme, un officier libéral torturé pour complot contre le dictateur (et qui parle d’outre-tombe) et son frère toujours vivant rejeté par son père et ruminant le ratage de sa vie annoncé dès son enfance… et tels personnages d’en susciter d’autres comme d’une frise d’un seul tenant se prolongeant dans le labyrinthe intime de chaque lecteur.
Telle est, aussi bien, l’étrange et profonde qualité d’absorption et de réfraction de l’œuvre d’Antonio Lobo Antunes, frère à la fois de Proust et du Simenon de la quête de « l’homme nu », mélange de sortilèges et de cruautés, de ténèbres et de lumière.
Antonio Lobo Antunes dixit
Du travail
« Le plus important est le travail. Je travaille très lentement, à la main, dix à douze heures par jour, tous les jours, et je ne vois pas pour moi d’autre solution. Je me souviens toujours de ce que Bach disait : « Si vous travaillez autant que moi, vous parviendrez au même résultat ». Ce n’est pas tant une question de modestie que d’humilité. Je suis un auteur très commode pour les éditeurs, car je ne revois jamais les épreuves, ni ne relis mes livres. Tout mon travail se fait en amont : je fais une première version, puis une deuxième, puis une troisième, puis je fais dactylographier le manuscrit que je corrige une dernière fois et basta ! »
De la lecture
« Nous avons eu la chance, avec mes six frères, d’entendre mon père nous lire à haute voix, tous les samedis soir, les auteurs français, anglais ou russes qu’il aimait. Il n’émettait jamais de jugement, nous invitant plutôt à écouter et à former notre propre opinion. J’ai beaucoup de pitié pour les gens qui ne lisent pas, car la lecture est pour moi un plaisir presque sensuel, comme la musique et la peinture. De surcroît, la lecture des plus grands vous rend plus humble. Avec Le Traité des passions de l’âme, j’ai pensé que j’avais découvert un moyen de faire avancer l’action par le dialogue qui innovait. Et puis, un jour, je me suis mis à relire Jane Austen – et tout était là ! Ernesto Sabato me disait qu’il ne fallait pas lire beaucoup mais souvent le même livre. Il y a ainsi trois livres de Faulkner que je lis et relis : Le bruit et la fureur, Go down Moses et Tandis que j’agonise. Quand les romans sont très bons, ils ont une qualité magique. Et Faulkner a sur moi un effet catalyseur : il me donne envie d’écrire ».
Du roman
« En tant que lecteur, j’aime les gros livres. J’ai besoin de m’attacher aux personnages. Et puis un roman c’est très curieux, parce qu’on ne peut pas avoir un orgasme pendant quatre cents pages, il a ses propres lois, qui rejettent tout ce qui ne lui appartient pas. J’ai en outre appris, en travaillant, que la première version contient toutes les solutions techniques à développer ensuite ».
De la composition
«J’ai d’abord une idée vague. C’est très étrange. Ce sont de petites bribes, des trucs informes qui lentement cristallisent et se combinent. Puis une idée plus précise des personnages et de l’intrigue se forme, et c’est parti. Le même problème se pose avec la fin des livres : je me souviens toujours de la formule de Freud qui disait qu’une analyse est terminée quand l’analyste et le patient sont satisfaits du résultat. C’est al même chose quand l’écrivain et le livre sont eux aussi satisfaits… »
Des influences
« Dans chaque pays on me trouve d’autres oncles et cousins. En Suède par exemple on m’a rapproché de Claude Simon, que je connais mal. En France, c’est à Céline qu’on m’a comparé. Mais si je devais me choisir des parents, je dirais : Gogol, ou Faulkner. Par certains côtés, Zola a beaucoup compté pour moi. J’aime, en outre, beaucoup Simenon et Graham Greene, quoique je n’aurais pas aimé écrire leurs livres. La puissance d’évocation de Simenon est fantastique, qui arrive à créer une atmosphère en trois mots. Il a des qualités de concision que je n’ai pas du tout… »
De la langue
« La langue française est très difficile, beaucoup plus que le portugais , langue plus ductile et plastique, enrichie par beaucoup de mots arabes, nègres, juifs, dont vous pouvez bousculer la syntaxe et le lexique. Même la conception du temps en est changée. Il n’y a pas pour les Portugais, comme dans le reste de l’Europe, une séparation nette entre présent, passé et futur, mais une sorte d’immense présent élastique. Le problème du temps est un problème majeur du roman. Je me suis demandé pendant de longues années comment je pourrais le résoudre. J’ai utilisé certaines techniques de la psychanalyse, où les champs se mélangent. D’autre part j’ai utilisé les personnages comme miroirs, pour se refléter les uns les autres. C’est comme ça que je pensais pouvoir refléter l’extrême complexité des hommes et des femmes, et le caractère souvent paradoxal de leurs émotions et de leurs sentiments ».
(Propos recueillis par JLK) -
Métèque de Sa Majesté

Hanif Kureishi, des faits à la fiction.Les drames humains qui affectent la société contemporaine sous l'effet des flux migratoires, des chocs de cultures, des ruptures entre générations, des bouleversements de l'économie ou de l'évolution brutale des moeurs, marquent assez faiblement la littérature française contemporaine, qui ronronne avec la conviction d'être toujours le centre du monde.
Par contraste, les écrivains du «domaine étranger», et notamment sur l'aire des empires déchus ou renaissants, nous paraissent beaucoup plus sérieusement à l'écoute du monde contemporain, et sans doute n'est-ce pas un hasard si ceux-là même qui ont vécu dans leur chair le déracinement et les difficultés de l'assimilation, le racisme ou la xénophobie, nourrissent leurs oeuvres de cette réalité bouillonnante.
Dans le sillage des plus célèbres rejetons de l'ancien Commonwealth en train de revivifier l'anglais à leur façon - tels l'ex-Trinidadien V.S. Naipaul ou l'ex-Bengali Salman Rushdie -, l'ex-«Paki» Hanif Kureishi, né dans le Kent (en 1948) et sorti de King's College, incarne bien cette capacité à ressaisir, par la fiction, des situations significatives de cette fin de siècle, sans jamais donner dans le simplisme démagogique ou le socio-journalisme.
Les personnages de Kureishi ressemblent assez à ceux de Tchékhov ou de Simenon, tous plus ou moins pris au piège, doucement paumés ou carrément en perdition, mais combien attachants sous le regard fraternel et gouailleur de l'écrivain. Ainsi du protagoniste d'Intimité, long récit au fil duquel un écrivain de scénarios (tiens tiens) nous détaille, une nuit durant, les mille et une bonnes raisons qui le feront plaquer, promis-juré, et pas plus tard que le matin prochain, son emmerderesse de bonne femme supportée douze ans durant, qui lui a donné deux mômes encombrants comme tout, qu'il a déjà trompée plus souvent qu'à son tour et qui se révèle néanmoins plus attachante au fur et à mesure qu'il la débine. Par aileurs s'accroît la conviction du lecteur que la séparation ne se fera pas, ou, tout au moins, que l'éventuelle échappée du protagoniste n'aboutira qu'à un plus grand empêtrement. Dans la foulée, l'on donnera volontiers son absolution à chaque personnage d'Intimité, tant Kureishi les rend aimables.
Avec une palette plus ample et plus variée, Hanif Kureishi brosse, dans les dix nouvelles rassemblées sous le titre Des Bleus à l'amour, un tableau de la société multiculturelle contemporaine qui serait assez désespérant s'il n'était traversé par le souffle d'une grande tendresse et d'une formidable vitalité, un peu comme il en allait du Snapper de Stephen Frears. Perdus dans la grande ville, voici les petits immigrés «pakis», la mère et l'enfant souffre-douleur, que persécutent Gros Billy l'ex-teddy boy et son méchant fiston. Alors la mère du gosse de gémir à bout d'argument: «Nous ne sommes pas des juifs !»... Ou voilà, dans Ta langue au fond de ma gorge, la jeune junkie rejetée par son père - un coq parvenu régnant à Lahore sur sa basse-cour -, et qui accueille, à Londres, sa demi-soeur fascinée par l'Angleterre: deux univers sont alors confrontés en miroir, aussi déglingués l'un que l'autre.
Dans la plus longue des nouvelles du recueil, intitulée Dernièrement et composée sur le modèle du Duel de Tchekhov, Kureishi décrit le monde, à la fois velléitaire, convivial, bavard et pathétique d'un groupe qui évoque les vauriens adorables des Vitelloni de Fellini, rêvant de s'arracher à leur trou et n'en trouvant jamais l'énergie. Plus obscure et folle, la nouvelle Veilleuse exprime la quête éperdue de vie palpable qu'un homme poursuit dans un rapport strictement charnel avec une inconnue. Plus obscène encore, Le Conte de l'étron figre l'absurdité cocasse de certaines situations où des bribes de convenances lient encore des gens vivant en réalité comme des sauvages.
Telle est d'ailleurs la vertu des écrivains du melting pot: qu'à la manière des enfants mal élevés mais pétris de bon naturel, ou devenus hyperlucides par humiliation (Salman Rushdie en est un autre), ils disent tout haut une vérité peut-être blessante pour Sa Majesté mais intéressante à entendre dans sa modulation vibrante d'humanité.
Devenu célèbre par le truchement du cinéma (il fut le scénariste fêté de Stephen Frears dans My beautiful laundrette et Sammy et Rosie s'envoient en l'air, et deux autres des histoires de son cru ont été adaptées à l'écran: Le Bouddha de banlieue et Mon fils le fanatique), Hanif Kureishi est d'abord et avant tout un écrivain à part entière, conteur et moraliste doux-acide. A travers le prisme de son observation, nous découvrons une réalité qui est celle-là même qui nous entoure, également, ici et maintenant. Un Kureishi saurait ressaisir, à n'en pas douter, la vie triste et joyeuse de vos voisins bosniaques ou celle de votre cousin Paul maniaque de philatélie qui succomba lors du dernier transit astral de certaine secte solaire.
Hanif Kureishi. Des bleus à l'amour. Traduit de l'angais par Géraldine Koff-d'Amico. Christian Bourgois, 326pp.
Intimité. Traduit de l'anglais par Brice Matthieussent. Christian Bourgois, 164pp. -
En lambinant vers la Perfection

Ce bon Monsieur Joubert
Les uns voient en Joubert l’huître perlière de la littérature française, qui avance tranquillement dans la vase veloutée en couvant son prochain aphorisme. D’autres se le figurent en escargot tâtonnant de la corne au milieu des gouttes de rosée. Au petit jeu des métaphores zoologiques on pourrait risquer aussi celle du ver à soie, ou suivre Amiel sur l’échelle de l’Evolution en le décrétant horticulteur à chapeau de paille. Une vue plus sophistiquée le pose en architecte du vide. Un arrêt moins révérencieux le taxera d’enc… de moucherons. Les gardiens du Temple n’ont, quant à eux, qu’une image pour le couronner : Joubert est un ange, ainsi soit-il.
On peut aimer beaucoup Joubert et trouver du vrai à toutes ces approximations, jusqu’à la plus déplaisante, sans toucher à cela seul qui nous fait revenir et revenir sans cesse, non tant à un sage, ni même à un conseiller, qu’à une incomparable lumière dans les mots, une musique pensante qui dispose à l’harmonie intérieure, et cette énergie singulière qui fait de l’esprit de finesse une sorte de puissance douce.
Encore s’agit-il de dissiper quelques malentendus. La reparution des fameux deux cents cinq carnets et autres feuillets volants, établie par André Beaunier en 1938, assortie d’un essai biographique gentiment désuet de la veuve de celui-ci, et précédée d’un excellent avant-propos de Jean-Paul Corsetti, ménage (pour beaucoup) une véritable redécouverte de l’œuvre dans son inscription chronologique. L’image figée d’un Joubert sagement assis sur sa branche dans le grand arbre des moralistes français, à équidistance de La Rochefoucauld et de Chamfort, en prend alors un coup. Vous vous figuriez un sage emperruqué alignant posément formules parfaites sur bons mots ? C’est le profil usuel des recueils thématiques «à la française », où le Joubert au miroir (« La moitié de moi se moque de l’autre », etc.) précède l’inévitable analyste du cœur et des passions (« Il faut tenir ses sentiments près de son cœur », etc.), que suit le moraliste politique (« Presque tout ce que nous appelons un abus fut un remède dans les institutions politiques », etc.) et le critique littéraire (« Voltaire, tu as trompé les hommes en les détrompant ! », etc.), le penseur domestique (« Il n’y a de bon dans l’homme que ses jeunes sentiments et ses vieilles pensées », etc.) ou le métaphysicien à loupiote (« Ferme les yeux, et tu verras », etc.), si possible en progression ascendante.
Or, à suivre Joubert, c’est en effet l’escargot qu’on retrouve d’abord en ses tâtons mous, sans une perle longtemps dans le sillage de l’huître. Avant le cap de la quarantaine, on n’aura guère de solide à se mettre sous la dent. L’horticulteur ne se risque pas à la moindre bouture. L’escargot tourne même, parfois, à la limace. On lit ainsi : « Repos aux bons, paix aux tranquilles », « L’évanouissement est une mort courte » ou encore « Le sublime est la cime du grand », pour se surprendre à bâiller la moindre. Joubert a certes fait lui-même la théorie de sa pratique et de ses manques, mais est-ce son meilleur usage que de le suivre dans la valorisation du chétif ? En ce qui me concerne, c’est pour le Joubert vigoureux et original (qu’on lise ainsi l’invraisemblable missive qu’il envoie à sa future femme pour la convaincre qu’il est son seul salut !), le maître de l’intuition et de la pointe, le merveilleux lecteur et le musicien de la langue, le penseur vif et dégagé, que je parierai plutôt, et non pour l’esthète trop délicat, moins encore pour l’âme emmitouflée du mystique en chambre. Peut me chaut que tel commentateur l’exalte en l’assimilant à quelque arachnide mallarméen patinant sur le « blanc du texte », ou que tel autre, par effet de loupe, en grossisse les grâces précieuses pour ne voir en lui qu’un elfe platonicien.
Le 8 février 1815 Joubert note : « Tourmenté par la maudite ambition de mettre tout un livre dans une page, toute une page dans une phraze et cette phraze dans un mot. C’est moi. » Or on aura noté en passant le mot « tourmenté » et le mot « maudit », comme on note à longueur d’Amiel le désir et la poursuite d’une œuvre qui ne sera jamais, en vérité, que ce qui reste dans les replis du drap du fantôme enfui – quel vrai trésor pourtant à nos yeux ! Car l’un et l’autre, auteurs « sans livres » selon l’expression de Blanchot, auront du moins grappillé ces « gouttes de lumière » qui constituent la pensée en germe et la langue à sa source.
Encore « goutte de lumière » fait-il trop bibelot, comme tant de « phrazes » du doux Joseph fleurent la bourre de bas bleu, de mots qui se « peignent à l’oreille » en vocables « où boit la pensée »… Mais en bousculant un peu le trop honnête homme engoncé dans ses couches de bonnets, comme en boxant le cher Amiel drogué de langueur, c’est bel et bien à de vives sources qu’on vient se désaltérer chez l’un et l’autre.
Plus on suit, l’âge avançant, le lambin Joubert, et plus l’huître accroît sa capacité de production, quand bien même ce ne serait pas la perle qu’on réclame d’abord à Joubert – mais une pensée qui vivifie. Emmanuel Berl disait à peu près qu’il écrivait pour savoir ce qu’il pensait, et Joubert lui fait écho en notant : « Comment il se fait que ce n’est qu’en cherchant les mots qu’on trouve les pensées ». Et de fait on va les trouver. Quitte, dans la foulée, à se recomposer pour soi-même le recueil tonique des siennes…
En 1791, le ci-devant ami de Diderot écrivait qu’ »on ne tolérera aucune intolérance» et que « l’exportation sera la peine de tous les prêtres turbulens ». En 1795, à ceux qui invoquent la nécessité des coups d’Etat, il répond que « ce qui est funeste et criminel n’est en aucun temps nécessaire ». Dès ces années il conseille de « chercher la sagesse plutôt que la vérité », car « plus à notre portée ». Mais le souci métaphysique n’en est pas moins le foyer même de sa pensée : « Dieu est le lieu où je ne me souviens pas du reste ». Où l’étonnant : « Ombre de Dieu qui nous luisez… »
De son temps il dira «ce siècle de la science opaque », d’une femme qu’«elle avait l’air d’une idée », des rois «qu’ils ne savent plus aimer», des enfants «qu’ils ont plus besoin de modèles que de critiques», de Locke qu’ »il a du trémoussement dans la phrase », de Condillac qu’il est «lac, mare ou bassin, étang ou réservoir, mais n’est pas source », de la religion qu’elle donne «aux imbéciles même leurs vertus». Il parlera de « cette girouette française dont Voltaire est le pivot», de Rousseau qui «remplit de feu» tandis que Platon «remplit de lumière», de La Fontaine comme de « l’Homère des Français »; de son ami Chateaubriand il dira « pompeux comme les roses à cent-feuilles »...
Joubert écrit que « la vertu par calcul est la vertu du vice », que « le bien vaut mieux que le mieux, que « le médiocre est l’excellent pour les médiocres », que « la bonté sans doute nous rend meilleurs que la morale », que « dans la poésie l’harmonie se fait par les clartés, comme dans la musique par les mouvements », que « l’esprit militaire est un esprit favorable à la bougrerie », qu’ « en littérature il ne faut pas faire le beau », enfin que lui, Joubert, est « comme une harpe éolienne, qui rend quelques beaux sons, mais qui n’exécute aucun air ».
On citerait à n’en plus finir: l’huître a rattrapé l’escargot depuis longtemps sur le chemin de la plage, le ver à soie file les bandelettes de la momie en ignorant qu’un papillon s’en échappera, et l’horticulteur fume sa pipe d'écume au fond du jardin.
Les quatre derniers mots inscrits sur les carnets de Joseph Joubert, datés du 22 mars 1824, deux mois avant sa mort, seront : le vrai – le beau = le juste – le saint.
Joseph Joubert, Carnets. Avant-propos de Jean-Paul Corsetti. Préfaces de Mme André Beaunier et M. André Bellesort. Gallimard, 2 vol, 1304p. -
L'aventure de lire

C’est une belle histoire que de lire, qui nous fait recevoir le monde et le partager.
On peut y voir une fuite et tout l’opposé : la découverte de ce qu’on est ici et maintenant, comme les mots de Vol à voile, de Blaise Cendrars, à l’adolescence, m’ont révélé que le voyage est d’abord l’appel à la partance d’une simple phrase. Je lisais : « le thé des caravanes existe », et le monde existait, et j’existais dans le monde. Ou je lisais : « Il y a dans l’intérieur de la Chine quelques dizaines de gros marchands, des espèces de princes nomades », et déjà j’étais parti sur ce tapis volant qu’est le livre, déjà je me trouvais dans cet état chantant que signale à mes yeux cette espèce d’aura que font les êtres quand ils diffusent, et les livres qui sont des êtres.
 Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu’une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j’entrais dans une forêt, j’étais sur la route d’Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d’adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j’avais seize ans sur les arêtes d’Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie.
Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu’une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j’entrais dans une forêt, j’étais sur la route d’Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d’adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j’avais seize ans sur les arêtes d’Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie.
Je fuyais, évidemment que je fuyais, je fuyais le cercle trop étroit de mon petit quartier de nains de jardin : un jour, j’avais commencé de lire, trouvé parmi les livres de la maison de l’employé modèle que figurait mon père, ce gros bouquin broché dépenaillé paru chez Marguerat et dont le titre, La Toile et le roc, me semblait ne vouloir rien dire et m’attirait de ce fait même, et pour la première fois, à seize ans et des poussières, je m’étais trouvé comme électrisé par la prose de ce Thomas Wolfe dont j’ignorais tout, le temps de rebondir à la vitesse des mots dans les câbles sous-marins destination New York où grouillaient le vrai monde et la vraie vie, et peu après ce fut dans la foulée de Moravagine que je m’en fus en Russie révolutionnaire.
 Je ne sentais autour de moi que prudence et qu’économie alors que les mots crépitaient en noires étincelles sur le mauvais papier du divin Livre de poche : « Vivre, c’est être différent, me révélait le monstre ravissant, je suis le pavillon acoustique de l’univers condensé dans ma ruelle. » Je lisais en marchant : « Au commencement était le rythme et le rythme s’est fait chair. » Mes camarades raillaient le papivore et moi je les narguais de la place Rouge où je venais de débarquer : « Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière ». J’allais par les allées des bibliothèques, mais bientôt m’écœuraient l’odeur de colle blanche et la poussière en suspension, et m’impatientaient les gestes lents des gardiennes du Temple à chignons serrés, aussi me carapatais-je par les chemins de traverse des grands bois de l’arrière-pays ou le long du lac aux eaux transies, à travers les prairies et sur les chemins de crête de ma préférence d’atavique coursier des hauts.
Je ne sentais autour de moi que prudence et qu’économie alors que les mots crépitaient en noires étincelles sur le mauvais papier du divin Livre de poche : « Vivre, c’est être différent, me révélait le monstre ravissant, je suis le pavillon acoustique de l’univers condensé dans ma ruelle. » Je lisais en marchant : « Au commencement était le rythme et le rythme s’est fait chair. » Mes camarades raillaient le papivore et moi je les narguais de la place Rouge où je venais de débarquer : « Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière ». J’allais par les allées des bibliothèques, mais bientôt m’écœuraient l’odeur de colle blanche et la poussière en suspension, et m’impatientaient les gestes lents des gardiennes du Temple à chignons serrés, aussi me carapatais-je par les chemins de traverse des grands bois de l’arrière-pays ou le long du lac aux eaux transies, à travers les prairies et sur les chemins de crête de ma préférence d’atavique coursier des hauts.
 Des années et des siècles d’enfance avant nos parcours d’arêtes j’avais découvert que le mot est un oiseau qui tantôt se morfond dans sa cage et tantôt envoie ses trilles au carreau de ciel bleu. Par les mots reçus en partage j’avais nommé les choses – et de les nommer m’avait investi de pouvoirs secrets dont je n’avais aucune idée mais que chaque nouveau mot étendait –, et leur ombre portée. Je prononçais le mot clairière et c’était évoquer aussitôt son enceinte de ténèbres – sans m’en douter je tenais déjà dans ma balance le poids et le chant du monde.
Des années et des siècles d’enfance avant nos parcours d’arêtes j’avais découvert que le mot est un oiseau qui tantôt se morfond dans sa cage et tantôt envoie ses trilles au carreau de ciel bleu. Par les mots reçus en partage j’avais nommé les choses – et de les nommer m’avait investi de pouvoirs secrets dont je n’avais aucune idée mais que chaque nouveau mot étendait –, et leur ombre portée. Je prononçais le mot clairière et c’était évoquer aussitôt son enceinte de ténèbres – sans m’en douter je tenais déjà dans ma balance le poids et le chant du monde.
Chaque mot définissait la chose, et la jugeait à la fois. De cela non plus on n’est guère conscient durant les années et les siècles que durent nos enfances, ni de ce que signifie le fait de déchiffrer un mot pour la première fois, puis de l’écrire. Plus tard seulement viendrait la conscience et la griserie plus ou moins vaine de tous les pouvoirs investis par le mot, mais la magie des mots relève de notre nuit des temps comme, tant d’années après, je le découvrirais dans l’insondable Kotik Letaiev d’Andréi Biély.
« Les traces des mots sont pour moi des souvenirs », nous souffle-t-il en scrutant le labyrinthe vertigineux de sa mémoire. Avant de signifier les mots étaient rumeurs de rumeurs et sensations de sensations affleurant cette mémoire d’avant la mémoire, mais comment ne pas constater l’insuffisance aussi des mots à la lecture du monde ?
 Lire serait alors vivre cent fois et de mille façons diverses, comme le conteur de partout vit cent et mille fois à psalmodier sous l’Arbre, et cent et mille fois Rembrandt à se relire au miroir et se répéter autrement, cent et mille l’aveugle murmurant ce qu’il voit à l’écoute du vent et cent autres et mille fois un chacun qui admire, s’étonne, adhère ou s’indigne, s’illusionne ou découvre qu’on l’abuse, s’immerge tout un été dans un roman-fleuve ou s’éloigne de tout écrit pour ne plus lire que dans les arbres et les étoiles, ou les plans de génie civil ou les dessins d’enfants, étant entendu que ne plus lire du tout ne se conçoit pas plus que ne plus respirer, et qu’il en va de toute page comme de toute chair.
Lire serait alors vivre cent fois et de mille façons diverses, comme le conteur de partout vit cent et mille fois à psalmodier sous l’Arbre, et cent et mille fois Rembrandt à se relire au miroir et se répéter autrement, cent et mille l’aveugle murmurant ce qu’il voit à l’écoute du vent et cent autres et mille fois un chacun qui admire, s’étonne, adhère ou s’indigne, s’illusionne ou découvre qu’on l’abuse, s’immerge tout un été dans un roman-fleuve ou s’éloigne de tout écrit pour ne plus lire que dans les arbres et les étoiles, ou les plans de génie civil ou les dessins d’enfants, étant entendu que ne plus lire du tout ne se conçoit pas plus que ne plus respirer, et qu’il en va de toute page comme de toute chair.
Bien avant Cendrars déjà je savais que l’esprit du conte est une magie et plus encore : une façon d’accommoder le monde. Seul sur l’île déserte d’un carré de peau de mouton jeté sur l’océan du gazon familial, j’ai fait vers dix ans cette même expérience du jeune Samuel Belet de Ramuz, amené aux livres par un Monsieur Loup et qui raconte non sans candeur à propos du Robinson suisse : « Je me passionnai surtout pour quand le boa mange l’âne. »
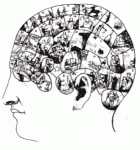 Lorsque le Livre affirme, par la voix de Jean l’évangéliste poète, que le verbe s’est fait chair, je l’entends bien ainsi : que le mot se caresse et se mange, et que toute phrase vivante se dévore, et que du mot cannibale au mot hostie on a parcouru tout le chemin d’humanité comme en substituant à la pyramide des crânes de Tamerlan celle de gros blocs taillée au ciseau fin des tombeaux égyptiens.
Lorsque le Livre affirme, par la voix de Jean l’évangéliste poète, que le verbe s’est fait chair, je l’entends bien ainsi : que le mot se caresse et se mange, et que toute phrase vivante se dévore, et que du mot cannibale au mot hostie on a parcouru tout le chemin d’humanité comme en substituant à la pyramide des crânes de Tamerlan celle de gros blocs taillée au ciseau fin des tombeaux égyptiens.
Ce chemin d’humanité serpente entre ces pages aussi, du pas tantôt hésitant et tantôt plus décidé d’un incorrigible irrégulier jamais à l’aise sous aucune discipline d’aucune école, n’ayant à produire que le Doctorat de l’Université buissonnière des littératures. Le seul fait d’entendre, par manière d’accueil à la Faculté des lettres de Lausanne, et de la voix grise du Mandarin de l’époque à longue figure blafarde de calviniste, qu’en ces lieux ne se pratiquerait jamais l’amour de la chose littéraire mais la seule Analyse Scientifique des Structures, suffit à me renvoyer aux sous-bois et aux rivages de mon industrieuse paresse, momentanément flattée aussi par l’esprit frondeur de Mai 1968. Les aphorismes obscurs et sensuels de René Char, autant que les proses transgressives de Jean Genet, les essais libertaires de Marcuse et la haute éthique érudite non alignée de Walter Benjamin me tinrent alors lieu d’enseignement vif, tandis que je m’adonnais à outrance à l’exercice plus stérile de la lecture dite par l’aisselle. Porter sous son bras tel ou tel volume vert sale des Œuvres complètes de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, serrer de la même façon Das Kapital de Marx en v.o. ou les dernières livraisons de la revue L’Homme et la société, transbahuter ainsi, de librairies en bars, sans les ouvrir mais en absorbant leur substance comme par osmose, ces sommes théoriques fut quelque temps ma façon révolutionnaire de lire, jusqu’au jour où, las de feindre et retrouvant, en d’autres lieux, le plaisir partagé d’explorer les travées de bibliothèques, je flambai tout à coup à la découverte du psalmiste libérateur que devait figurer à mes yeux Charles-Albert Cingria, dont les mots et les phrases me semblaient peints à la feuille d’or sur fond de parchemin ceint d’azur : « L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini. » En ma vieille vingtaine qui me pesait tant aux épaules, les yeux cernés par le chagrin du monde et la délectation morose, lire Cingria m’a rendu la fraîcheur.
« Il nous faut relire plus que lire », affirmait ce druide des bibliothèques que fut John Cowper Powys, et c’est dans le faisceau de regards croisés de tous mes âges et de tous les âges du lecteur que je voudrais situer Les Passions partagées, dans ce même mouvement de ressaisie qui fait noter à Samuel Belet, le personnage de Ramuz, au moment de se raconter, que « ce qui n’a pas assez été vécu est revécu », et le passé ressuscite dans un nouveau présent « car tout est confondu, la distance en allée et le temps supprimé. Il n’y a plus ni mort ni vie. Il n’y a plus que cette grande image du monde dans quoi tout est contenu ».
 « Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, écrit encore John Cowper Powys, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables, mais il ne pourra jamais “ voir Dieu ”, il ne pourra jamais vivre dans un présent qui est le fils du passé et le père de l’avenir sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature. »
« Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, écrit encore John Cowper Powys, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables, mais il ne pourra jamais “ voir Dieu ”, il ne pourra jamais vivre dans un présent qui est le fils du passé et le père de l’avenir sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature. »
Ce texte constitue un extrait de l’ouverture du livre intitulé Les passions partagées, Lectures du monde 1973-1992, paru en 2004 aux éditions Campiche. Prix Paul Budry 2005.

-
Notre ami Tchékhov
Un siècle et douze ans après sa mort, le grand écrivain russe, en médecin des corps et des âmes lucide et fraternel, ne cesse de nous parler…
Il y a 112 ans, le 2 juillet 1904, Anton Pavlovitch Tchékhov s’éteignait dans une station thermale de Forêt-Noire, à l’âge de 44 ans, vingt ans après le premier crachement de sang que la tuberculose lui arracha.
Durant la nuit du 1er juillet, Tchékhov se réveilla et pria son épouse Olga Knipper, grande comédienne de l’époque, d’appeler un médecin. Lorsque celui-ci arriva à deux heures du matin, le malade lui dit simplement «Ich sterbe», but une flûte de champagne, s’étendit sur le flanc et expira. La suite des événements, Tchékhov aurait pu la décrire avec la causticité de ses premiers écrits. De fait, c’est dans un convoi destiné au transport d’huîtres que sa dépouille fut rapatriée à Moscou, où l’accueillit une fanfare militaire qui jouait une marche funèbre. Or celle-ci n’était pas destinée à Tchekhov mais à un certain général Keller, mort en Mandchourie. Une foule immense n’en attendait pas moins, au cimetière, le cercueil de l’écrivain porté par deux étudiants...
En janvier de la même année, la dernière pièce de Tchékhov, La cerisaie, avait connu un succès phénoménal. L’interprétation de la pièce, à laquelle le metteur en scène Stanislavski avait donné des accents tragiques, déplut cependant à Tchékhov qui s’exclama: « Mais ce n’est pas un drame que j’ai écrit, c’est une comédie et même, par endroits, une véritable farce ! ». Or, le malentendu allait perdurer. L’image d’un poète des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe, survit ainsi à travers le cliché d’un « doux rêveur», alors que la véritable figure de ce fils de petits commerçants né en 1860 est celle d’un observateur implacable de la réalité.Marqué en son enfance par un père aussi religieux que violent, dont la faillite a fait de lui un soutien de famille précoce, Anton Pavlovicth fut, en tant que médecin (dès 1884) aux premières loges de la misère russe, trop lucide cependant pour croire à la révolution. Jamais dupe des idéologies, il n’en a pas moins une conscience sociale aiguë. Dès son établissement de médecin, il arrondit ses fins de mois avec des récits souvent mordants qui lui valent un vif succès. En 1890, en dépit de sa maladie, il entreprend un séjour d'un an au bagne de Sakhaline afin de porter témoignage sur le sort des déportés. Toute sa vie, d’ailleurs, Tchékhov multipliera les actions de bienfaisance, de constructions d’écoles en soins gratuits. Ses nouvelles d’abord, son théâtre ensuite, le feront reconnaitre de son vivant comme une des gloires nationales russes, à l’égal d’un Dostoïevski ou d’un Tolstoï.
Or ce qui frappe, aujourd’hui, c’est que ce peintre souvent noir de la société russe et des comportements individuels reste actuel et pertinent, notamment dans son théâtre (lire encadré). Contre toute emphase et tout héroïsme factice, Tchékhov présente la réalité comme elle, est, sans jamais l’enjoliver. « Il n’y a que le sérieux qui soit beau », écrivait-il, mais en souriant. Et le rire était sa défense contre le désespoir.
Un autre Tchékhov
Au demeurant il n'y a pas que le rire et le désespoir, chez Anton Pavlovitch, mais aussi cette joie profonde qui traverse les siècles, retrouvée dans celui de ses récits qu'il disait préférer entre tous: L'étudiant, mystique plongée en 5 pages dans la profondeur du Temps.
Au soir du Vendredi saint, revenant de chasse où il vient de tuer une bécasse, le jeune Ivan Vélikopolski s'arrête auprès de deux veuves dans leur jardin, auxquelles il raconte soudain la nuit durant laquelle Pierre trahit le Christ à trois reprises, comme annoncé. Et voici que les veuves sont bouleversées par son récit, comme si elles s'y trouvaient personnellement impliquées, et voilà que le jeune fils de diacre, étudiant à l'académie religieuse, se trouve rempli d'une joie mystérieuse alors même qu'il constate l'actualité de la nuit terrible:
"Alors la joie se mit à bouillonner dans son esprit, si fort qu'il dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Le passé, pensait-il, était lié au présent par une chaîne ininterrompue d'événements qui découlaient les uns des autres. Il lui semblait qu'il voyait les deux extrémités de cette chaîne: il en touche une et voici que l'autre frissonne
"Comme il prenait le bac pour passer la rivière, et plus tard comme il montait sur la colline en regardant son village natal et le couchant où brillait le ruban étroit d'un crépuscule froid et pourpre, il pensait que la vérité et la beauté qui dirigeaient la vie de l'homme là-bas, dans le jardin et dans la cour du grand-prêtre, s'étaient perpétuées sans s'arrêter jusqu'à ce jour, et qu'elles avaient sans doute toujours été le plus profond, le plus important dans la vie de l'homme, et sur toute la terre en général; et un sentiment de jeunesse, de santé et de force - il n'avait que vingt-deux ans - et une attente indiciblement douce du bonheur, d'un bonheur inconnu, mystérieux, s'emparaient peu à peu de lui, et la vie lui paraissait éblouissante, miraculeuse et toute emplie du sens le plus haut".
Un Cliché réducteur
L’image d’un Tchékhov poète de l’évanescence et des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe de la fin du siècle passé, continue de se perpétuer à travers le cliché du “doux rêveur”, qui vole au contraire en éclats dès qu’on prend la peine de l’approcher vraiment. Or une nouvelle occasion nous en est donnée, pour commémorer son centenaire, avec la parution d’un ouvrage à la fois passionnant et inachevé, constituant un témoignage de première main et dans lequel une véritable révélation biographique se fait jour. De dix ans le cadet de Tchékhov, Ivan Bounine, merveilleux écrivain lui-même (Prix Nobel de littérature en 1933), fut un ami particulièrement cher à Tchékhov, qu’il fréquenta de 1895 à sa mort. Le présent recueil de souvenirs, et jusque dans sa forme relevant parfois du croquis ou de la note préparatoire, fut entrepris par Bounine en 1952, un an avant sa mort, et la préfacière et traductrice, Claire Hauchard, précise qu’on ne sait trop quelle forme définitive il devait avoir. Or l’inachèvement de l’ouvrage n’enlève rien à son intérêt et moins encore à son charme, tant Ivan Bounine excelle, près d’un demi-siècle après sa mort, à rendre vivante et presque palpable la présence de Tchékhov.
Pour fixer, en moins de cent pages, ce que fut assez exactement le parcours de Tchekhov, et se faire une idée précise de la rude vie qui fut la sienne entre un père despotique, bigot et fondu en ivrognerie, des frères non moins irresponsables et le reste de sa famille dépendant de lui alors qu’il n’avait pas vingt ans, le lecteur non onformé se reportera à la Vie de Tchékhov insérée en seconde partie dans le recueil des Conseils à un écrivain, sous la plume de Natalia Ginzburg.
Quant à Bounine, c’est par petite touches qu’il complète son portrait “en mouvement” d’un Tchékhov à la fois fraternel et distant, qui ne perd pas une occasion de rire et n’a décidément rien du “geignard” que stigmatisent certains critiques. Ne se plaignant jamais de son sort, alors que la maladie lui est souvent cruelle, l’écrivain apparaît, sous le regard de Bounine, comme un homme chaleureux et d’un naturel tout simple, raillant volontiers la jobardise des gendelettres sans poser pour autant au “pur”. Le récit de ses visites au vieux Tolstoï est tordant, et Bounine, accueilli à un moment donné par la mère et la soeur de Tchékhov, éclaire également sa grande sollicitude de fils et de frère. De surcroît, c’est un véritable récit tchékhovien que Bounine à propos de ce qui fut, selon lui, le grand amour “empêché” d’Anton Pavlovitch, avec une femme mariée du nom de Lidia Alexeievna Avilova (1865-1943), nouvelliste et romancière prête à refaire sa vie avec lui et qu’il aima aussi sans se résoudre à l’arracher à sa famille - la repoussant ainsi en douceur...L’hommage de l’édition française à Tchékhov est un peu, reconnaissons-le, de bric et de broc. Le meilleur exemple en est donné par l’édition bâclée d’un recueil de récits donnés pour “inédits”, intitulé Le malheur des autres, alors même que la nouvelle éponyme a déjà été traduite par André Markowicz dans l’ensemble du Violon de Rotschild. Bref, et malgré sa traduction parfois bien lourde, l’on saura gré à Lily Denis d’enrichir tout de même, ici, l’éventail des récits de Tchékhov (il y en a 649 en tout) dont la Pléiade nous a fait connaître 250 titres, entre autres éditions. Nulle “révélation” dans ces 38 récits, si l’on songe à tant de merveilles connues, mais le génie de Tchékhov y est néanmoins omniprésent, fût-ce parfois dans un certain “tout-venant” journalistique.
Anton Tchekhov écrivit d’abord pour arrondir les fins de semaine de la famille dont il avait la charge, et seuls les cuistres lui reprocheront de ne pas toujours fignoler son style, alors qu’un souffle de vie constant traverse ses moindres récits. Ses Conseil à un écrivain, tirés de sa correspondance et présentée par Pierre Brunello, constituent un formidable recueil de malicieuse sagesse, qu’on pourrait intituler aussi “conseils à tout le monde”. Ecrire et vivre, pour Tchekhov, allait de pair, et ses propos sur “la petite vie de tous les jours” ou sur l’authenticité, sur l’intelligentsia ou l’abus de l’adjectif, trahissent autant de positions éthiques d’une exigence que Bounine eût qualifiée de “féroce”. C’est qu’à l’opposé du littérateur se payant de mots, de l’homme de lettres trônant sur son propre monument, ou de l’instituteur du peuple, Tchekhov se contentait de chercher, pour chaque sentiment ou chaque fait, le mot juste.
Ivan Bounine. Tchékhov. Traduit du russe, préfacé et annoté par Claire Hauchard. Editions du Rocher, 210p.
Anton Tchékhov. Conseils à un écrivain. Choix de textes présenté par Pierre Brunello. Traduit du russe par Marianne Gourg. Suivi de Vie d’Anton Tchékohv, par Natalia Ginzburg. Traduit de l’italien par Béatrice Vierne. Editions du Rocher, coll. Anatolia, 240p.
Anton Tchékhov. Le malheur des autres. Nouvelles choisies et traduites du russe par Lily Denis. Gallimard,Anton Tchékhov, L'étudiant, traduit du russe par André Markowicz dans le recueil indispensable réunissant dix-neuf nouvelles et intitulé Le Violon de Rotschild, paru chez Alinea e n1986 avec une préface lumineuse de Gérard Conio).
-
Lecture panoptique (2)

À propos d'une tablette iPad perdue et retrouvée. Sur les Vétilles de Christian Garcin, Avec les chiens d'Antoine Jaquier et L'autre Simenon de Patrick Roegiers. De la désinformation pratiquée dans l'Histoire de la littérature en Suisse romande. De l'esprit pharmacien des cuistres universitaires et du conformisme clinquant des perroquets médiatiques. Du roman en train de se faire, etc.
J’étais un peu triste, l’autre soir à Amsterdam, triste et furieux contre moi-même après avoir constaté que j’avais oublié, sur un banc de la Verhulststraat, ma tablette magique iPad Mac le Nomade. J’étais triste parce que s’y trouvaient une trentaine d’images de la vie captée, deux heures auparavant, dans le délire vibrionnant et soleilleux du Vondelpark où tourbillonnaient des milliers de jeunes gens en fleur de tous les âges; et furieux à l’idée d’avoir manqué d’attention durant cet espace-temps de rien du tout.
Ensuite, n’y croyant guère, je m’étais pointé le lendemain et le surlendemain au Bureau des Objets Perdus, où la même dame accorte m’avait présenté deux tablettes paumées par telle ou tel autre écervelé ; et lorsque je regagnai La Désirade j’avais plus ou moins fait mon deuil du Nomade quand un téléphone d’Amsterdam, trois jours plus tard, m’apprit, par la voix d’Aimée, diplômée à New York en technologie de la mode et coach spirituel à l ’international, férue de yoga et de développement personnel, qu’elle avait retrouvé et pris soin de ma tablette dont j’avais, entretemps, fait mettre toutes les données à la corbeille.
°°°
 À propos de corbeille, en lisant les Vétilles de ChristianGarcin, dont je me sens très proche à de multiples égards, à la fois pour la forme kaléidoscopique de ce recueil et pour la « musique » méditative qu’il y filtre, sans parler de nombreux recoupements relevant du nomadisme lecteur ou voyageur, je note ceci : « Le rêve est la corbeille sur l’écran de l’ordinateur : grâce à lui on se débarrasse de certains souvenirs, qui sinon encombreraient la mémoire ».
À propos de corbeille, en lisant les Vétilles de ChristianGarcin, dont je me sens très proche à de multiples égards, à la fois pour la forme kaléidoscopique de ce recueil et pour la « musique » méditative qu’il y filtre, sans parler de nombreux recoupements relevant du nomadisme lecteur ou voyageur, je note ceci : « Le rêve est la corbeille sur l’écran de l’ordinateur : grâce à lui on se débarrasse de certains souvenirs, qui sinon encombreraient la mémoire ».Je sais que les images heureuses du Vondelpark restent en moi, comme l’image haineuse des dealers ex-yougos du Mozartpark de Vienne, qui terrorisaient plus ou moins les ados junkies qu’il y avait là cette année-là, et que j’eusse flingués sans hésiter (je venais de lire La Force de tuer de Lars Noren), me reste présente vingt ans après.
Puis je lis ceci encore, sous la plume de Garcin, rapport au rêve. « Plongeant chaque nuit dans cette eau noire du sommeil, j’y pêche parfois sur le réveil, à l’approche de la surface, des images qui sont comme des souvenirs oubliés ».
Or les images que je pêche « sur le réveil », pour ma part, sont plutôt des souvenirs à venir, ou des messages d’une mémoire dont je n’ai aucune conscience claire et qui est, comme celle de Proust, ni du passé ni du présent mais d’un temps hors du temps que les mots font émerger, et là Garcin cite Pascal Quignard pour faire le joint : « L’écriture est au langage ce que le rêve est à la vie.
°°°
 J’ai pêché en librairie ces Vétilles de Christian Garcin, qui y parle de Cingria - et là encore nos chemins se croisent puisque,en 1995 (l’année précisément où je flinguais mentalement les dealers du MozartPark) a paru, à L’Escampette où ont été publiées les notes de Garcin, mon anthologie consacrée à Charles-Albert - , et de multiples noms, au fil du livre, noms de lieux (Vevey, l’hôtel Erechteion d’Athènes, etc,) ou noms de gens (Nabokov, Coetzee, Hohl, Gherasim Luca, etc,), mais plus encore les choses vues ou captées au passage et transcrites en quelques lignes, un peu comme chez Handke ou dans mes Lectures du monde, - se constituent en nébuleuse sensible, parfois affective ou sentimentale, ou encore éthique et politique, au fil d’un livre qu’on pourrait dire un fragment de plus du journal de bord de l’humanité dont parle John Cowper Powys.
J’ai pêché en librairie ces Vétilles de Christian Garcin, qui y parle de Cingria - et là encore nos chemins se croisent puisque,en 1995 (l’année précisément où je flinguais mentalement les dealers du MozartPark) a paru, à L’Escampette où ont été publiées les notes de Garcin, mon anthologie consacrée à Charles-Albert - , et de multiples noms, au fil du livre, noms de lieux (Vevey, l’hôtel Erechteion d’Athènes, etc,) ou noms de gens (Nabokov, Coetzee, Hohl, Gherasim Luca, etc,), mais plus encore les choses vues ou captées au passage et transcrites en quelques lignes, un peu comme chez Handke ou dans mes Lectures du monde, - se constituent en nébuleuse sensible, parfois affective ou sentimentale, ou encore éthique et politique, au fil d’un livre qu’on pourrait dire un fragment de plus du journal de bord de l’humanité dont parle John Cowper Powys.°°°
 Le même jour, à la même librairie lausannoise, j’ai acquis la nouvelle Histoire de la littérature en Suisse romande, dont les pages consacrées à ces dernières décennies me sidèrent par leur platitude et leur propension générale au blanchiment du texte, contre tout engagement réel et personnel et au dam de tout contenu non convenu.
Le même jour, à la même librairie lausannoise, j’ai acquis la nouvelle Histoire de la littérature en Suisse romande, dont les pages consacrées à ces dernières décennies me sidèrent par leur platitude et leur propension générale au blanchiment du texte, contre tout engagement réel et personnel et au dam de tout contenu non convenu. C’est là le règne de la pseudo-objectivité pseudo-scientifique, sur fond d’intense grenouillage provincial, où ces messieurs–dames distribuent leurs bons points en prétendus spécialistes autorisés. Le ton général est docte et morne, c’est le règne des cuistres de facs fondus en sociologisme littéraire et des patronnesses commises à la surveillance du littérairement correct.
Tout ce qui dépasse les cadres de ce formatage académico-mondain est scrupuleusement ramené à la norme admissible. Assez significativement en outre, les prétendus spécialistes se raccrochent, en ce qui concerne la littérature la plus vivante de ces dernières années, aux références précuites dont Wikipedia sert les raccourcis à foison.
Bref, il y a là, comme en creux, et à reconstituer dans un roman satirique, le portrait de groupe d’une poignée de caciques du pouvoir universitaire ou médiatique assez significatifs d’une mentalité culturelle suissaude à la fois sourcilleuse et confite de pleutrerie.
Mais que peut-on demander de plus à des pharmaciens, selon l’excellente typologie de Ludwig Hohl, que de rédiger de petits formulaires et de classer de petits flacons sur de petits rayons bien protégés de toute poussière ?
°°°
 Je lis ces jours Falconer de John Cheever, l’un de ses derniers romans évoquant la (sur)vie du junkie fratricide Farragut dans la prison éponyme, et je lis en parallèle Avec les chiens d’Antoine Jaquier, qui s’attache aux effets collatéraux liés à la sortie de taule d’un tueur en série pédophile rappelant évidemment « notre » sadique de Romont.
Je lis ces jours Falconer de John Cheever, l’un de ses derniers romans évoquant la (sur)vie du junkie fratricide Farragut dans la prison éponyme, et je lis en parallèle Avec les chiens d’Antoine Jaquier, qui s’attache aux effets collatéraux liés à la sortie de taule d’un tueur en série pédophile rappelant évidemment « notre » sadique de Romont. John Cheever est un grand écrivain, le meilleur nouvelliste américain du second demi-siècle, dont l’extrême porosité sensible et l’intelligence des comportements humains, en interaction avec l’évolution de la société, fondent l’observation tous azimuts et, aussi, la narration aussi férocement précise qu’ombrée de folie sur fond de tendresse. J’ai découvert John Cheever bien tardivement, et j’en aurai bientôt tout lu après avoir lu toutes les nouvelles d’Alice Munro, autre observatrice pénétrante de l’humaine engeance. Mais tant de bonheur pour tant de retard !
À côté de ces deux-là, à son deuxième livre, Antoine Jaquier pourrait faire encore petit garçon, surtout qu’il s’attaque à un très gros morceau. L’approche d’un tueur pervers, dans un roman qui n’est pas un polar, et même en modulant les point de vue alternés du père d’un des garçons assassinés et du seul

survivant des crimes de « l’ogre de Rambouillet », n’est pas une sinécure, mais Jaquier s’y est risqué et je suis très curieux de voir comment il tire son épingle de ce jeu dangereux.
En tout cas, dès les 33 premières pages, on est pris en crescendo malgré le cadre un peu sage du présent de l’indicatif et le côté factuel de la narration ; mais dès le récit du garçon réduit à l’état de chien terrorisé-fasciné par celui qui l’a kidnappé, quelque chose se passe et le roman devient prenant – mais à plus tard le« bilan »...
Ce qu’attendant je lis, aussi, L’autre Simenon de mon compère Patrick Roegiers, grand tempérament d’écrivain lui aussi , et par « le fond » et par « la forme ». Celle-ci bouillonne dès les premières pages de cette évocation de la Belgique fasciste des annés 40, à commencer par un flamboyant portrait de Léon Degrelle, tribun rexiste préparant le terrain de la collaboration, avant l’invasion allemande, en cristallisant tous les mécontentements du populo wallon d’avant guerre et dont un discours de vélodrome séduit tout à coup le frère cadet de Georges Simenon.
 Mais là encore, j’attends d’avoir achevé la lecture de ce nouveau roman de Roegiers, à paraître chez Grasset, avant de nouer la gerbe de mes notes. D’emblée cependant, l’écriture de l’ami Patrick fait florès dans sa manière franco-flamande d’expressionniste extraverti, qui ponctue sa narration de couplets rappelant les chœurs ou les ritournelles de L’Opéra de quat’sous…
Mais là encore, j’attends d’avoir achevé la lecture de ce nouveau roman de Roegiers, à paraître chez Grasset, avant de nouer la gerbe de mes notes. D’emblée cependant, l’écriture de l’ami Patrick fait florès dans sa manière franco-flamande d’expressionniste extraverti, qui ponctue sa narration de couplets rappelant les chœurs ou les ritournelles de L’Opéra de quat’sous…J’écris « l’ami Patrick » en dépit de l’aspect sporadique de nos échanges, cependant poursuivis depuis notre première rencontre, au salon du livre de Toulouse, il y a bien quelques années de ça. C’est là aussi que j’avais rencontré Lambert Schlechter, dont plusieurs des livres m’ont enchanté depuis lors et que je retrouve sur Facebook, et là encore que j’ai fait la connaissance de François Emmanuel, autre compatriote de Simenon dont j’ai tant aimé les derniers romans.
Or un soir, à Toulouse - et Daniel de Roulet présent lui aussi m’en serait témoin -, Patrick Roegiers, à une table ronde dont l’animateur avait très mal préparé ses présentations, nous surprit tous en prenant l’initiative de se présenter lui-même en les termes les plus objectivement élogieux et les plus subjectivement admiratifs !
Faconde d’Eulenspiegel ! Bluff charmant que devraient imiter aujourd’hui les artistes et les écrivains dont on aimerait que la modestie les étouffe !
À quand les grands papiers rédigés par les auteurs eux-mêmes !? Quand Jean-Michel Olivier expliquera-t-il, en pleine page du Temps, combien la parution de L’Amour nègre a marqué la littérature romande par sa thématique et sa verve langagière ?! Quand enfin JLK, génie méconnu sauf de son chien Snoopy, rappellera-t-il aux foules médusées que la publication du Viol de l’ange, roman virtuel incorporant avant la letrre, toutes les techniques actuelles de l’inter-communication simultanée, dans le récit polyphonique d’une tragédie contemporaine, fit date lui aussi ?!
Mais assez parlé de lecture et assez déliré, car il faut bien écrire un peu, tout de même, et même beaucoup.
°°°
Je reviens donc, ce matin, à mon roman en chantier intitulé La vie des gens, dont je finis de recopier à la main (écriture verte sur cahier ligné de la série Paper Blanks) le cinquième chapitre, intitulé L’Ami secret par référence à Ruysbrock l’Admirable :« Ah ! la distance est grande entre l’ami secret et l’enfant mystérieux. Le premier fait des ascensiosn vives, amoureuses et mesurées.Mais le second s’en va mourir plus haut, dans la simplicité qui ne se connaît pas ».
Ce couple « mystique » est incarné, dans mon roman, par un personnage au prénom de Jonas, fils d’un écrivain célèbre (devenu fameux par ses écrits minimalistes, puis érotiques, avant une œuvre protéiforme reflétant l’esprit dutemps puis s’en dégageant complètement dans le chef-d’œuvre pré-posthume intitulé L’Ouvroir) et dont tout le parcours fait opposition à la fausse parole.
L’idée de ce roman, en 2014, m’est venue après avoir commis une nouvelle de 30 pages intitulée Tyran , où je brossais le portrait d’un littérateur despotique non sans illustrer, aussi, le caractère profondément tyrannique de l’art et de la littératrure pour qui s’y consacre sérieusement.
La nouvelle commençait comme ça, non sans tonalité satirique : « On a prétendu que Nemrod les traitait comme des esclaves, mais c'est inexact,raconte Olga. D'ailleurs tout ce qu'on a dit de lui est plus ou moins erroné,mais elle insiste sur le plus ou moins ; et sans doute est-elle l'une des mieux placées, avec Marie, pour en juger de près. Les prétendus connaisseurs, à commencer par les bas-bleus et les cuistres des cercles médiatico-littéraires et dancingo-sportifs, l’ont taxée d'égérie. Une espèce de muse, pour user d'une expression obsolète qui la faisait sourire autant que Nemrod, même s'il y avait de ça quelque part. Pas le genre Laure de Pétrarque, vu qu’elle n’en avait plus l'âge. Pas non plus le type Béatrice de Dante, vraiment trop catho phosphorescente, ni Dulcinée du Toboso malgré le penchant certain de Nemrod à l'idéalisation littéraire de la vie dont la trivialité, n'est-ce pas, le faisait tant souffrir - du moins est-ce cequ'il prétendait dans l'un de ses numéros publicitaires où il se la jouait homme blessé avant de demander ce qu’Olga avait pensé de sa prestation.
Le grand souci de toujours de Nemrod: l'ai-je bien descendu ? Et le rôle d’Olga de le rassurer en lui mentant le plus souvent, non sans lui faire entendre qu’elle n’en pensait pas moins - ce qu'il attendait aussi d’elle, d’une certaine façon… »
Dans la foulée de cette nouvelle, le besoin de la relier à un antérieur et à une suite m’a fait désirer le roman, et le roman fut.
Le personnage de Nemrod vu par Olga m’a intéressé, mais je me demandais ce qu’il en serait sous les yeux d’un fils qui serait apparu, très vite, comme un rival potentiel. Ainsi le personnage de Jonas est-il venu au jour, qui m’a dicté ces premières lignes du roman désormais en chantier – les cuistres parlent de « campagne d’écriture », et je leur revaudrai ça dans le sixième chapitre, éminemment persifleur, du roman en question.
Donc La Vie des gens (titre provisoire) commence comme ça :
«Jonas, fils du fameux écrivain Nemrod, fut sensible dès son premier âge aux mots qui font mal. Ceux-ci lui firent découvrir, bien avant de pouvoir se défendre, ce que sont les gens.
De fait, il sentit bientôt que les gens se servaient des mots pour l’épingler : ils disaient ceci ou cela, et peut-être était-ce vrai ou pas ? À vrai dire Jonas n’en savait rien encore ; simplement il constatait que certains mots faisaient mal, et qu’il fallait s’en prémunir. Ainsi commença-t-il de résister aux gens, pour mieux les approcher ensuite et se trouver, des années plus tard, en mesure de parler des gens et de la vie des gens.
Jonas enfant endura quelque temps les mots des gens sans broncher, disons : ses premières années auprès de Marie, le plus souvent à l’insu de son père - manipulateur de mots s’il en était; puis, à l’effarement de son entourage, il devint, à dix ans qu’on dit l’âge de raison et qui lui fit venir le poil au membre, volubile, incisif et bientôt intraitable. Multipliant l’exagération paternelle (réputée et très prisée des médias) il opposa, aux pointes d’épingles des mots des gens, les couteaux aiguisés de vocables et de formules férocement choisis, prodigues en outre pour lui d’intense jouissance.
Sa première réputation, à vrai dire détestable, vient de là. Ensuite il se construisit des cabanes dans les arbres, tout en singeant Nemrod à la confusion des gens tournant autour de celui-ci. Sur quoi la vie aiguisa plus encore ses poignards, puis les lui fit rengainer sous l’influence de Rachel et, cela va sans dire, de Sam le pacifiste, père de Marie et son mentor à lui ».
Donc Jonas est un avatar de L’ami secret selon Rusybroeck, alors que l’enfant mystérieux est incarné par le jeune Américain Christopher, fils de Lady Light, promis à une destinée brève et dont la présence irradiante fait office, sur les protagonistes du roman, de révélateur.
°°°
Dans ses Vétilles, Chistian Garcin cite Cingria s’exprimant à propos du genre romanesque : « Je hais le roman qui n’a plus aucun rôle puisque les dames sont en short et qu’il n’y a plus de société ».
On ne prendra jamais les opinions de Charles Albert pour vérité gravée dans le marbre, vu qu’il le dira lui-même : « je sais bien que je dirai le contraire tout à l’heure, oui, mais tout à l’heure est tout à l’heure et ce n’est pas maintenant ».
Léautaud ne comprenait rien à Proust, Nabokov dit sur Faulkner des idioties professorales, et l’on n’imagine pas Cingria, merveilleux lecteur de Chesterton, apprécier Simenon ou Houellebecq.
À la ménagerie des lettres, on ne demandera pas au casoar de « comprendre » la hyène ni à celle-ci de frayer tranquillement avec la palombe.
On peut concevoir, ainsi, que les doctes pédants rédacteurs de l’Histoire de la littérature en Suisse romande réduisent le roman à succès de Joël Dicker à un roman « sur » la fabrication d’un best-seller, bel exemple de blanchiment d’une polyphonie romanesque aux composantes riches du double point de vue des signifiés et de l’epos narratif.
Mais les pharmaciens n’ont pas besoin de lire un livre pour en juger vu qu’ils ont la morgue assurée du dromadaire drogué au valium et la myopie de la taupe bromurisée.
°°°
En ce qui concerne mes (très) modestes écrits, les auteurs de l’ Histoire de la littérature en Suisse romande, avec le dédain digne de dignes dindons, les réduisent, au plus, au rang d’éléments anecdotiques d’un journal à digressions autobiographiques, sans un mot sérieux sur le contenu des 2000 pages publiée de mes Lectures du monde, une ligne sur les 400 pages du Viol de l’ange loué par Michel Butor et Yves Velan, la moindre citation de mes nouvelles et autres proses poétiques – mais de quoi je me mêle alors qu’on a tant à faire à blanchir le texte et le sous-texte !
Quant au roman, tout au moins comme je le vois ces jours - et que les femmes soient en shorts ou en strings stricts -, il me semble une cristallisation de la pensée qui suppose un engagement plus conséquent et plus intense que le simple exercice de la notation quotidienne. Celle-ci va pour ainsi dire de soi, sans effort de transposition, que ce soit dans le flux de la correspondance ou du journal (intime ou extime), alors que la fiction seule aménage un espace qu’on peut dire romanesque.
Les romans de Jules Renard - et cela vaut dès le récit autobiographique de Poil decarotte, mais bien plus avec L’écornifleur ou Les cloportes – instaurent un autre rapport, avec le lecteur, que son fameux Journal, si passionnant que soit celui-ci.
Paul Léautaud, en revanche, même dans Le petit ami, ne franchit jamais la ligne rouge de la fiction, ce qui n’ôte rien évidemment à sa qualité d’écrivain.
L’espace romanesque ne se borne pas à une convention de genre : c’est un lieu particulier, qui instaure une relation particulière entre l’auteur et le lecteur, à équidistance de l’un et de l’autre.
À cet égard, les « romans » d’un Philippe Sollers, dont l’espace est plus celui du récit d’autofiction ou de la chronique, comme il en va des « romans » de Céline », que du roman à proprement parler, se caractérisent en cela qu’ils ne laissent aucune autonomie à leurs personnages et que l’auteur ne cesse d’imposer sa présence au lecteur, sans truchements.
Rien de cela chez un Balzac ou un Simenon, purs romanciers s’il en est, mais il me semble que Proust représente un cas à part, dont la Recherche ouvre bel et bien un immense espace romanesque peuplé de personnages sculptés en ronde-bosse, comme il en va de ceux de Robert Musil ou de Thomas Mann.
Cela noté sans esprit dogmatique aucun, pour mieux distinguer deux types de démarches non exclusives mais dont je perçois d’autant mieux, personnellement, ce qui les distingue, que je les ai pratiquées avec un égal bonheur, tout en trouvant dans la fiction une plus grande liberté que dans mes notes journalières.
Quant aux deux figures tutélaires de mes premières passions littéraires, à savoir Charles-Albert Cingria et Stanislaw Ignacy Witkiewicz, elles sont à jamais irréductibles à aucun genre et ne peuvent donc qu’être l’objet de la plus grande suspicion des pharmaciens et autre blanchiseurs de texte et de sous-texte...
Sur quoi je retourne aux fleurs, selon la formule de Michaux : « La matin, quand on est abeille, pas d’histoire,faut aller butiner »…
Christian Garcin. Vétilles. L’Escampette, 2015.
Antoine Jaquier. Avec les chiens. L'Âge d'Homme, 2015.
Patrick Roegiers. L'autre Simenon, à paraître chez Grasset.
-
Antunes en son labyrinthe

Souvent interviewé, le grand écrivain portugais se contente volontiers, en ponctuant ses propos de sourires aussi amicaux que désabusés, de resservir les mêmes réponses aux mêmes questions. Tout autre est l'accueil qu'il a réservé à Maria Luisa Blanco, qui a pris la peine de se déplacer à Lisbonne et l'a soumis durant plusieurs jours à de longues séances d'entretiens auquel l'écrivain s'est prêté « avec la discipline d'un collégien ».
Abordant successivement son éducation stricte dans une grande famille aussi cultivée qu'affectivement glaciale, sa folle passion de lire, l'expérience bouleversante de la guerre en Angola (qui lui inspira Le cul de Judas), son premier livre (Mémoire d'éléphant), la séparation catastrophique (et peut-être nécessaire à sa liberté créatrice) d'avec sa première femme qui le soutint toujours et à laquelle il revint trop tard, entre cent autres thèmes, ces conversations sont d'un grand intérêt pour qui suit le développement d'une des œuvres littéraires les plus fascinantes de l'époque.
Inventeur d'une écriture souvent difficile (il est le premier à le relever), Antonio Lobo Antunes est le contraire d'un homme de lettres coupé de la vie, et tout ce qu'on apprend ici de la sienne, avec un entretien final chez ses (redoutables) parents, enrichit les résonances de ses livres tissés d'innombrables éléments relevant de l'autofiction.
Maria Luisa Blanco. Conversations avec Antonio Lobo Antunes. Traduit de l'espagnol par Michelle Giudicelli Editions Christian Bourgois, 298 pp.
Un nouveau roman d’Antunes est à paraître à la rentrée chez Christian Bourgeois, sous le titre de Bonsoir les choses d'ici-bas.

