
Comment, cette année-là, et ce soir-là, cette nuit-là se mêlèrent voix et visages, dans un choeur dont les échos jamais oubliés resurgissent de loin en loin.
L’alto à tignasse de feu débarquait d’un trou perdu du Wisconsin, mais Jim situait sa seconde et véritable naissance en Californie, dans une communauté de San Francisco où il avait entrepris son voyage sur la Vraie Voie, cependant il n’y avait que quelque jours qu’il s’était attaché à la soprano moldave à la voix si poignante assise à côté de lui, Milena de son prénom, fille de réfugiés roumains installés à Londres, et Milena avait suivi Jim jusque-là sans être sûre de se lancer avec lui sur la route d’Orient, d’ailleurs ils avaient eu le matin même leur première rupture d’harmonie en faisant leurs ablutions sur le bord de la Limmat, lorsque Jim lui avait confié qu’il n’était pas sûr que la Vraie Voie pouvait se faire à deux, mais à l’instant leurs voix planaient ensemble au-dessus des moires de la rivière en se mêlant à celles des autres, on eût dit qu’il n’y avait plus d’espace ni de temps divisé, le choeur évoquait une espèce de grand essaim sonore en suspens entre les flots et le firmament d’été constellé de myriades d’étoiles qui rappelaient au vieux Max ses nuits des années 40 au pénitencier militaire, Max dont le drapeau de Marcheur de la Paix enveloppait les épaules de la douce Verena - la fluette voix du patriarche et celle un peu flûtée de la jeune fille dessinaient de fines arabesques en bordure des autres -, puis le quelque chose de très archaïque et de très juvénil qui émanait du choeur fut soudain comme électrisé par le solo de cristal limpide du berger Hans Sonnenberg descendu de son alpage avec de quoi se divertir au Niederdorf et que diverses filles de bar s’étaient arraché, mais qui pour lors n’avait d’yeux que pour la Roumaine de Jim, et c’était pour elle que sa voix cherchait à présent une faille vers le ciel qu’on imagine derrière la nuit, et de fait la voix presque enfantine du grand Kerl à boucles d’oreilles et culotte de cuir, zyeux d’azur et gabarit de lutteur, s’envolait le long des flèches de la Chagallkirche en arrachant à chacun d’irrépressibles frissons, et Milena se sentait fondre au côté d’un Jim de plus en plus absent, murmurant vaguement un OM continu, Milena retrouvait dans la voix du berger des accents de ses montagnes natales dont ses oncles lui chantaient parfois les complaintes, et déjà, aux accents excessivement sentimentaux de ses jodels, les filles de bar avaient compris ce qui se passait entre ces deux-là, tout en sachant que le Hans leur reviendrait avec son rire clair et ses vrenelis, et c’était justement parce qu’il y avait de l’amour dans ce chant que les filles se sentaient pures de jalousie, et la nuit paraissait s’ouvrir à toutes ces voix déployées, Jim était déjà parti vers l’Ashram mystique qui le délivrerait de toute pesanteur et les sans-logis qu’il y avait là se sentaient eux aussi dans la peau de pèlerins au bivouac stellaire, Max se réjouissait finalement d’avoir raté le dernier tram de Zumikon et d’être tombé dans cette bande de chiens sans colliers: même si cela ne faisait pas un pli que le monde continuerait de mal tourner en dépit des essais de révolutions du printemps dernier, même si la sauvagerie se perpétuait, son idéal restait chevillé au corps du vieux disciple du Mahatma et les chants de cette nuit le faisaient se sentir un peu meilleur, comme il en allait de Tonio - serveur à la Bodega et grand lecteur de Pavese - et de tous les traîne-patins que la première rumeur avait attiré des ruelles du Niederdorf au bord de l’eau fraîche à la forte odeur de poisson vif, et ils étaient bien une trentaine vers minuit, mais maintenant la nuit avait basculé sur son axe et le chant commençait de s’espacer, des couples s’en allaient vers les bosquets du Lido, d’autres parlaient à voix basse ou prenaient congé, on se souhaitait bel été ou bonne vie, Jim avait laissé Milena se réfugier dans les bras du contre-alto Sonnenberg cependant que Tonio et Verena faisaient un feu sur la berge de la rivière, et leurs visages éclairés paraissaient plus beaux encore de surgir ainsi de l’obscurité, Jim resterait encore longtemps sur l’empieremment de la berge, les paumes ouvertes et les yeux clos, à se remplir d’énergie cosmique, Hans et Milena continueraient de murmurer à ses côtés, les filles de bar regagneraient leurs studios et des pluies d’étoiles tomberaient encore au fond du ciel que les échos de toutes les voix de ce soir-là retentiraient toujours dans la nuit...
Le sablier des étoiles
-
Sweet Sunny Sixties
-
Ceux de l'Ange
 Où l’on retrouve un groupe de jeunes poètes, à Fribourg, dans les années 70. De la fascination exercée par la belle Galia. Du vin de Samos et des révélations métaphysiques liées à la consommation de la Fleur Bleue.
Où l’on retrouve un groupe de jeunes poètes, à Fribourg, dans les années 70. De la fascination exercée par la belle Galia. Du vin de Samos et des révélations métaphysiques liées à la consommation de la Fleur Bleue.
Le jeune poète se tenait sur le quai de la gare dans son long manteau de poil de chameau bleu nuit au col duquel s’enroulait une longue écharpe de laine blanche sûrement nécessaire à se protéger du froid de Fribourg, donc ce devait être en hiver et l’on boirait plus tard des vins chauds à l’Auberge de l’Ange, mais alors j’en ignorais encore tout, et du plaisir à la catholique et des sortilèges de la Ville Basse.
Frédéric semblait sortir d’un roman tant il était réel. Sans poser il se dessinait en fines touches fluides sur un fond qui prenait aussitôt une valeur picturale de consistance antinomique, disons à la Francis Bacon, tel le pan de mur fraîchement repeint couleur de foie cru sur lequel il restait nonchalemment appuyé en détaillant toute une liste de choses que nous allions faire avant de rejoindre la Basse; et c’était un grand tour en Dodge avec Paulo que précéderait un saut à la librairie Dousse où Galia devait se trouver, puis on irait voir la soupente de Charles-Albert Cingria dans la bâtisse penchée sur le vide, on se prendrait du vin de Samos au Tunnel où sûrement se trouveraient déjà les Mexicains, le grand tour me ferait voir la ville comme en carrosse ensuite de quoi nous rejoindrions Galia et sa bande de l’Ange.
Il y avait de la féerie dans tout ce qu’annonçait Frédéric en prononçant les mots à sa drôle de façon, comme s’il les goûtait pour en vérifier la teneur. En outre son oeil pétillait d’ironie, et ce qu’il émanait de lui de suavement androgyne (ses longs blonds cheveux fins, ses lèvres de libertin, ses airs un peu canaille de salon) se trouvait mis en contraste par une espèce d’énergie rayonnante et de crudité mâle qui se concentrait naturellement dans l’érotique. Ainsi parlant encore et encore de Galia, Frédéric disait en jubilant: «L’Abbé ne se retient plus de b..., on lui voit bomber la soutane, mais il suffit à Galia d’un regard là-dessus et tout rentre dans l’ordre».
Frédéric disait vraiment: la p... ou le c..., et ce n’en était que plus obscène, à la catholique. Il disait: «C’est un défilé de séminaristes autour du c... de Galia», et je me figurais une espèce de femme fatale, mais point vraiment l’inimaginable vraie Galia de tout à l’heure.
Ou plutôt que tout à l’heure, ce serait plus tard, à cause de ce que Frédéric appelait une petite intrigue.
De fait, l’air innocent, au seuil de sa librairie, Antoine Dousse prétendait n’avoir pas vu Galia de tout le jour, qui devait pourtant se faire aider en latin contre un peu de rangement au sous-sol.
Or Frédéric n’en croyait pas un mot. «Cela ne fait pas un pli que le coquin l’aura planquée dès qu’il a vu se pointer la Dodge. Il fait tout pour la circonvenir. Il irait jusqu’à lui payer les cours qu’il lui donne. Quant à l’aide qu’il accepte d’elle au sous-sol, c’est évidemment pour en jouir un peu plus. Mais allons plutôt à Lorette !»
Et sur le chemin de Lorette, dans le vieux cuir craquant du taxi de Paulo le beatnik, en disponibilité pour une heure, Frédéric m’avait soumis à un feu de questions.
«Avais-je lu Les Corps frénétiques, me demanda-t-il après m’avoir désigné la fameuse enseigne A la Ville de Paris dont parle Charles-Albert dans Musiques de Fribourg, et comment avais-je trouvé les poèmes des Mexicains ?
De Notre-Dame de Lorette, la vision de Fribourg flottant au-dessus d’un socle de brouillard ne faisait qu’amplifier l’exaltation lyrique dans laquelle Frédéric m’avait entraîné. Sur ses falaises émergeant des nuées, la Haute aux étroites bâtisses plantées au bord du gouffre comme à Lhassa les monastères, me figurait une ville de rêve que j’allais d’ailleurs hanter, à la fin de la nuit, par le truchement de la Fleur Bleue .
En attendant j’égrenais les noms de Fribourg tandis que Frédéric me détaillait la dernière corrida de Manolete, les noms de la Tête Noire et du Sauvage, des Cordeliers, du Stalden, de la Rue d’Or.
Paulo nous avait quittés à Lorette. Nous sommes descendus jusqu’au couvent de la Maigrauge dont je désirais saluer les mânes du chien de garde évoquant, au repos, ce fameux «seau de colle de marrons renversé, avec deux yeux bien rouges», que décrit Charles-Albert et peut-être entrevoir, aussi, la nouvelle abbesse crossée.
Quittant la chapelle aux vierges invisibles, Frédéric commença de me raconter les Mexicains, Juan le poète et son frère, puis nous fûmes au Sauvage où devant un alcool à la vipère Frédéric célébra Galia, et plus tard les Mexicains, au Café du Tunnel, continuèrent de se raconter avant de ne plus parler que de Galia et de la Fleur Bleue.
Etait-ce le vin de Samos ? Etait-ce l’aura poétque émanant de Frédéric et de ses amis ? Du moins étais-je sous le charme.
Juan cependant m’avait pris la main et y lisait comme le lui avait enseigné sa mère, Juan aux longs cheveux à reflets de cercueil, Juan au doux visage de Shelley précolombien et aux rêves ruisselants de sang toltèque qui me fixait aux yeux dans la fumée de nos Gitanes: «Je vois en toi s’affronter deux puissances adverses ou complices, selon les lunaisons, tu es le Gémeau pur, en toi s’affrontent la Terre et l’Azur, je décèle à l’instant comme une confusion dans la brume des Mille Possibles, mais voici qu’une créature de rêve apparaît...»
Et pliant à sa guise les vertèbres du temps, ma subconscience entrevoyait à son tour l’avenir dans les émanations du vin des îles.
Nous devions être à l’Ange maintenant, ou plutôt non: déjà nous étions dans la soupente de Galia où nous resterions assez tard dans la nuit, assis sur des nattes; nous avions attendu quelque temps et soudain apparaissait bel et bien le Mythe en sa splendeur intemporelle et son aplomb trivial: telle étant Galia toute faite pour bouleverser de jeunes poètes avec son cou de cygne, ses yeux de biche, ses dents d’ivoire, sa peau de lune et son c... de conte de fée d’où fusait à l’instant une vesse à douceur de confidence, et Galia disait: «voici pour vous, mes amours, et pour votre peine vous allez me voir donner le tétée...»
Or ce que Juan avait lu au creux de ma paume, tout ce qui nous attendait dans l’allée des années, il me semblait le pressentir au milieu des anges enfumés que nous étions, bercés par quelque Raga, les yeux fixés sur le sein nourricier de Galia que l’enfant au père inconnu tétait en couinant de cosmique agrément; et Galia nous chasserait ensuite en ne gardant près d’elle que le suppléant momentané du paternel envolé; et Frédéric me dirait à la porte qu’on se rappellerait, qu’il m’écrirait et désirait me lire - qu’il était ravi: que nous avions passé là de bonnes heures, qu’on avait bien ri, tandis qu’avec Juan et ceux de l’Ange nous nous en allions goûter, ailleurs, à la Fleur Bleue qui livre le secret de toute vie après la vie...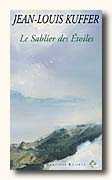 Cette fugue est extraite du recueil intitulé Le Sablier des étoiles.
Cette fugue est extraite du recueil intitulé Le Sablier des étoiles. -
Villa Sumatra

Où il est question d’un quartier de nos vacances d'enfants, dans les hauts de la ville de Lucerne. De la vision roborative des Capucins au football et du souvenir d’un facétieux oncle voyageur.
A l’arrêt des Capucins me réapparut une vigoureuse mêlée de mollets d’ivoire au football, mais déjà tout s’amenuisait dans la perspective du trolleybus qu’on eût dit pénétrant dans la reconstitution en modèle réduit du quartier de l’oncle Fabelhaft.
Rien n’y avait certes changé, pas un nouveau bâtiment n’avait surgi entre le cloître des Capucins et le Terminus dont le rond-point marquait une invisible frontière, par delà laquelle on s’engageait dans un dédale de chemins privés et de villas Mon Rêve rivalisant de décence - n’était la Villa Sumatra que je venais retrouver -, tout semblait resté en l’état, et pourtant une étrange sensation physique m’oppressait, que j’expliquai sur le moment par la double métamorphose de nos corps et de nos souvenances.
La vision des mollets nus des Capucins, cette chair tenue à l’ordinaire sous la bure et qui s’exhibait soudain au gré d’un saut ou d’une bousculade, m’avait soudain ressaisi comme une bouffée de fraîcheur qu’aussitôt j’associai à nos baignades dans le lac alpin, mais à la fois au clair-obscur surodorant de l’antre aux statues nègres et aux serpents en majesté de l’oncle Fabelhaft dont les yeux saillaient de malice à l’arrivage de ces enfants petits qu’il s’impatientait d’emmener au bout du monde après les avoir juchés sur tel palanquin ou tel rouf de steam-boat à vapeur jaune, selon nos propres souhaits d’explorer tel ou tel continent.
Alentour je ne voyais, pour l’instant, que de sages maisons locatives à vitrages pudiques, alignées de part et d’autre des trottoirs réglementaires; et quelques habitants visibles ici et là confirmaient eux aussi mon impression que tout en ces lieux s’était rétréci. Du mois pensais-je revoir sous peu la Villa Sumatra, et comment ne pas se sentir alors des ailes, comment ne pas se prendre pour une espèce de Gulliver ?
Cependant une autre chose me frappa, et c’était l’absence d’enfants dans tout le voisinage. Je n’y avais guère pensé tant que je me dirigeais, en somnambule, dans le dédale des Sans Issue et des Ayants droit seuls autorisés, mais bientôt je commençai de ressentir un manque, que devait ensuite accentuer mon incapacité de retrouver la Villa Sumatra.
Tout ce que me rappelait le seul mouvement de rechercher la demeure enchantée ne pouvait, à l’évidence, s’accommoder trop longtemps de l’affairement de ces retraités proprets, en survêtements bleu ciel ou rose fluo, qui surveillaient leur ligne et leur territoire avec la même vétilleuse vigilance. Où étaient les enfants ? Où étaient les pirates de la mer de Chine ? Où était l’oncle des oncles ?
Partout des haies avaient poussé, dans lesquelles il n’était place cependant pour le moindre nid et que n’ajourait aucune espèce de lucarne. C’étaient des murs végétaux qui défiaient toute indiscrétion et tout échange, formant un dédale du fond duquel on n’apercevait plus que des pointes de cyprès alignés ou d’impeccables toits de tuile.
Or constatant qu’il me serait impossible de retrouver, en un tel labyrinthe, la maison folle de l’oncle disparu depuis longtemps, et craignant maintenant de la découvrir pareille aux autres, je m’égarai bientôt en visant cependant le bois de chêne qu’il y avait sur la colline proche, et à la lisière duquel, à la fin d’une journée d’été, entre chien et loup, l’oncle Fabelhaft m’avait conduit pour m’en faire écouter le silence.
En d’autres temps je me fusse sûrement senti plein de mélancolie, voire de chagrin, mais c’était au contraire une joie qui me venait tout à coup en me remémorant les merveilleuses élucubrations de l’Oncle Fabelhaft; et ça ne faisait pas un pli, les enfants y auraient droit à leur tour: j’allais leur raconter la Villa Sumatra transformée en squat fabuleux au milieu du quartier suissaud, il y avait sur les murs extérieurs des tags géants qui rehaussaient la splendeur des orchidées Wunderbaria, l’esprit de l’oncle survivait sous la forme d’un tamanoir à l’oeil tendre qu’on localisait à l’odeur, quelques sans-papiers pakistanais relégués dans le cabanon du jardin figuraient les bandits de naguère, qui buvaient gravement du Coca-Cola en reluquant les jeunes adorateurs du soleil tout nus sur l’ancienne terrasse aux figuiers de Barbarie, et le soir, à la brune, quand les ombres commençaient de remuer entre les massifs ensauvagés, dans les fumées d’herbe et de cervelle bourgeoise grillée au feu de bois, le grand fourmilier se remettait à débiter de très anciennes menteries. -
Dad’s Blues

Pour Sophie et Julie.
Où il est question du classique désarroi du bon père devant l’émancipation de ses filles. Que toute mauvaise pensée est frappée d’Interdit. De la sublimation et de la demande en mariage.
Elles se la jouent Dark Lady et Sweet Heart, et je fais le père moderne: je me la coince, mais n’en ressens pas moins comme une divine mélancolie.
Tel est de fait le dur constat auquel je suis amené ces derniers temps: que je ne suis plus leur seul dieu.
Ce n’est pas seulement qu’elles regardent ailleurs, c’est qu’elles sont ailleurs, et serais-je un pur esprit ou un spectre qu’elles me porteraient plus d’attention - pur esprit dont la première ornerait sa dissertation, ou spectre bienvenu dans les rêveries policières de la seconde.
Cela commence à la première heure dans un véritable branlebas. Il fait encore nuit noire et je me trouve, comme tous les matins, penché sur mes grimoires, dans le cercle enchanté de la lampe, lorsque ma table à écrire retentit des premières trépidations.
C’est en effet à cheval que Dark Lady traverse l’appartement, l’air hagard dans sa chevelure imitation black, un peu le style Angela Davis à l’époque des Panthères mais le sabot précis et la flèche verbale prête à être décochée, en tout cas rien ne l’arrêtera sur le sentier guerrier de la salle de bains où elle sera la première à se claquemurer.
Pendant ce temps, Sweet Heart figure la belle au bois somnambule qui va et vient entre sa couche désordonnée et le frigidaire, le visage dolent et la moue suggérant que ce n’est pas encore l’heure d’ouverture des guichets.
Dans ce tumulte feutré, je me surprends à d’inconvenantes poussées de voyeurisme, ou plutôt qu’inconvenantes: dangereusement naturelles, voire un peu sauvages.
Il arrive, en famille, qu’un sein adolescent pointe à la fenêtre, ou qu’une jeune croupe se dandinant direction les lavabos vous suggère des choses au plus total oubli du fait que vous êtes le père.
Cela peut arriver en rue de la même façon, quand vous appréciez de loin la silhouette ravissante de Lolita ou de Baladine et que, tout à coup, vous reconnaissez votre enfant. Naturellement vous aimeriez vous précipiter et vous jeter aux pieds de la grâce incarnée, mais cela même ne se peut pas et vous pressentez que c’est bien ainsi. Car vous aimez cet Interdit plus que votre désir, en tout cas vous vous le répétez à chaque fois que Sweet Heart vous impose l’épreuve du Défilé (le supplice de Tantale du Mini Mini) ou que Dark Lady se met à danser au milieu du salon à la manière d’Isadora Duncan.
Bien entendu, l’Interdit ne va pas jusqu’à ne pas toucher. Je caresse donc volontiers et je l’avoue sans vergogne: je bécote. J’oserai même en faire le thème d’une campagne de propagande à l’échelon de la collectivité: bécoter plus, c’est se laisser moins troubler.
C’est aussi soulager l’angoisse de Sweet Heart, toujours lancinante en ses treize ans de nymphette aux abois, que la seule évocation d’un mollusque suffit à faire se pâmer de dégoût. Le baiser à l’américaine, dit aussi langue fourrée, fait ainsi figure à ses yeux d’odieux enlacement de limaces, et ne parlons pas des organes.
Cela ne m’empêche pas de pressentir, en Sweet Heart, une amoureuse ardente. Tant sa passion pour les éléphants que ses débordements d’affection et les longues, longues séances qu’elle passe au miroir à se faire plus jolie que jolie, me semblent autant de signes de bonnes dispositions.
Mais ne rien brusquer, ne rien chercher même à rabattre des sourcilleuses recommandations de Madame Mère du style L’Amie de la Jeune Fille...
Tout cela que Dark Lady reluque à sa façon voulue sarcastique, mais le coeur et les antennes en constant état d’alerte. Dark Lady ou la fausse dure. Calamity Jane rêvant d’un prince charmant aux yeux tendres à la Ricky Nelson. Et de fait, le western sera carabiné, mais les couchers de soleil ne sont pas pour les coyotes, et là ça peut aller jusqu’à des baisers de deux trois minutes sur fond de ciel flammé, et dans la salle on s’abandonne doucement au creux de l’épaule de son soupirant, mais pour le reste essayez pas d’en savoir plus ou je tire !
Je sais qu’en digne père je ne devrais penser qu’au statut de marchandises de mes filles. Telle nous rapportera tant, et l’autre tant; notre bien se trouvant augmenté à hauteur de tel bénéfice par rapport à l’investissement de base. Je devrais compter, au lieu de quoi je rêve. Je devrais négocier chèrement leur capital beauté et leur potentiel à tous les niveaux, alors que mon blues radoucit, jusqu’à la honte, mes velléités de père selon la Tradition.
C’est ainsi que je finirai par les céder, en ne pensant qu’à elles, l’une au cow boy de ses rêves et l’autre à quelque clone du mousquetaire Leonardo di Caprio. La seule condition sera qu’ils se présenteront au ranch pour me soumettre leur demande en bonne et due forme. Je leur ferai savoir au préalable, par leurs amoureuses, mon exigence absolue en matière de connaissance de la musique baroque et des vendanges tardives, mon souci de beauté et plus encore de bonté, et mon souhait vif de les entendre se déclarer en vers réguliers.
L’examen prendra le temps qu’il faut et ce seront autant de mois et peut-être d’années de sursis qui me seront accordés.
Surtout, le faraud sans cervelle et le joli coeur volage, le marchand d’orviétan sentimental et le séducteur illusionniste seront confondus.
La scène finale n’en sera que plus douce, plus douce et plus poignante. Déjà je nous vois bien vieux, elle et moi dans nos chaises à bascule, tandis que le grand soleil décline à l’horizon de La Désirade, à saluer encore et encore nos enfants qui s’éloignent là-bas sur leurs chevaux qu’on dirait maintenant des jouets, mais vivants, de si jolis jouets à ressorts remontés pour la vie.
-
Next stop Paradise

Du mode de locomotion le mieux approprié à l’accomplissement d’un symbolique dernier voyage. Des images longtemps enfouies qui resurgissent à la faveur de cet étrange périple au bord du ciel.
Le paradis ce serait: le paradis ce sera de rouler en Grosschen jusqu’au Vieux Quartier, en Grosschen ou en Minimax à l’abri des blindages, en Minimax ou, si tout est détruit, par la ligne souterraine du Littlebig.
Je dis Grosschen parce que je suis de nature optimiste. Optimiste mais non écervelé ou inconséquent. Je dirai plutôt: optimiste malgré tout. Capable tout à fait de me représenter le pire, et par exemple la destruction complète de tout ce qui fut, avec la conviction cependant qu’une certaine partie du Vieux Quartier sera toujours debout et la cathédrale, la cathédrale et le jardin aux volières.
La Grosschen serait idéale pour accomplir vite ce très long voyage, et d’abord pour la beauté du geste. La Grosschen bat en effet tous les records de ce point de vue.
 Voir l’immense piécette à nacelles rouler, au déclin du jour, sur une autoroute déserte ou dans une forêt à l’heure du silence, est un enchantement. Lorsqu’elle est immobile, la Grosschen évoque, à l’évidence, la Grande Roue du Prater de Vienne, mais on comprend, au moindre mouvement, qu’elle est incomparable, surtout du fait de ses possibilités infinies de remodulation, non seulement mécanique mais cinesthésique, et cela compte pour le fidèle disciple de Baudelaire que je suis.
Voir l’immense piécette à nacelles rouler, au déclin du jour, sur une autoroute déserte ou dans une forêt à l’heure du silence, est un enchantement. Lorsqu’elle est immobile, la Grosschen évoque, à l’évidence, la Grande Roue du Prater de Vienne, mais on comprend, au moindre mouvement, qu’elle est incomparable, surtout du fait de ses possibilités infinies de remodulation, non seulement mécanique mais cinesthésique, et cela compte pour le fidèle disciple de Baudelaire que je suis.
Je m’explique en deux mots: il n’y a qu’à bord de la Grosschen qu’on puisse entendre si distinctement la couleur précise de tel parfum ou détailler telle gamme de goûts à l’oeil nu.
Contrairement au Minimax, blindé et bruyant, ou au Littlebig sujet à pannes souterraines, la Grosschen marque le top du génie humain qui associe l’archaïque roue de moulin, le cerceau de nos enfances et l’accélérateur de particules dernier modèle.
Or tel est mon voeu Monsieur Dieu: qu’au moment où, la Grosschen me transporte au Vieux Quartier et que Vous me laissiez prolonger d’une vie ou deux, le temps au moins d’écouter une fois encore la Black and tan fantasy auprès des quelques vrais amis en compagnie desquels le temps n’a jamais existé.
Par avance je me réjouis de ce voyage immobile où tout me sera rendu comme à l’enfant derviche que le Barbare décapite. Tout me sera rendu parce que tout me sera dû à ce moment-là, je n’aurai pas de compte à rendre, Monsieur Dieu connaît ce langage: je n’aurai pas besoin de Lui faire un dessin.
C’est aussi bien par pur désir que je crayonne à présent ce portrait de mon amour à la nacelle. Combien d’ici je nous vois, mon amour et moi, prendre place à bord de la Grosschen. Jamais mon amour ne m’accompagnait au Luna Park, mais cette fois ce sera cette fois ou jamais, et c’est depuis le premier jour qu’il n’y a plus de jamais entre nous.
A bord de la Grosschen nous rassemblerons, dans le désordre, tous les fragments de l’Imago. Il me suffira de penser ceci et ceci sera, de désirer cela et cela sera. J’inscrirai le mot Donau dans la case de sélection sensible du computeur de bord et tout aussitôt je me retrouverai dans les gazons exquis de l’enfant Danube où nous plongions nos corps de garçons élastiques, l’été de nos quatorze ans, ignorants du dernier coup de flingue du vieil ado désespéré, ce 2 juillet 1961 devenu jour de la saint Hemingway - mais je racontais à Thomas ses chasses et ses corridas tandis qu’il tirait sur sa Chesterfield d’un air de corsaire -, la Grosschen fera son effet quand elle s’immobilisera dans le chemin privé de la typique villa de notable du Doktor sûrement enterré, et je tâcherai de reconnaître mon bel ami sous les traits du nouveau Doc à l’americaine, yes it’s me, do you remember nos bains de minuit dans le lac de Constance ? et son odeur de gosse de riche n’aura pas changé qui sonne toujours comme du Telemann dans la salle de bain matinale où nous comparons nos dotations, Kölnwasser 4711, belle prestance et cette autorité transmise du chamane de province, mais la Grosschen ne pourra s’attarder, juste une dernière sèche comme lorsque nous nous planquions dans les trouées de sangliers, tschuss Tom, see you, et ce sera reparti pour le paradis. L’agrément de la Grosschen tient à sa double maîtrise des phénomènes ondulatoires et corpusculaires. Un rêveur jeté dans l’espace sur son rocking chair tournant, qui prend connaissance dans un journal des dernières nouvelles du siècle tout en écoutant l’Andante du Quintette à cordes en ut majeur de Schubert peut figurer, dans sa double relation à l’espace (cherra-t-il, cherra-t-il pas ?) et au temps (fonce-t-il amont ou aval ?), la situation du voyageur en Grosschen et son aperception nouvelle des deux infinis.
L’agrément de la Grosschen tient à sa double maîtrise des phénomènes ondulatoires et corpusculaires. Un rêveur jeté dans l’espace sur son rocking chair tournant, qui prend connaissance dans un journal des dernières nouvelles du siècle tout en écoutant l’Andante du Quintette à cordes en ut majeur de Schubert peut figurer, dans sa double relation à l’espace (cherra-t-il, cherra-t-il pas ?) et au temps (fonce-t-il amont ou aval ?), la situation du voyageur en Grosschen et son aperception nouvelle des deux infinis.
De là-haut nous découvrons l’océan de notre mémoire, et dans la botte d’icelui: l’aiguille trotteuse de notre première montre d’enfant.
Je me souviens pour ma part que ma première montre n’avait que des chiffres peints et se mangeait, fourrée de chocolat noisette. C’est pourquoi j’aime tant voir passer les cargos de cacao dans mes rêveries antillaises, et que me trouble la nature double de l’oeil de l’écureuil.
Nous avons détesté, mon amour et moi, la pléthore des écureuils du Schubertpark de Vienne, mais combien de documents photographiques attestent l’intensité paisible des heures que nous avons passées là-bas à nous couler l’un dans l’autre, là-bas et dans la chambre du grand bouleau.
Monsieur Dieu comprend cela, qui nous entendait remuer dans le berceau de feuilles, accoudé mine de rien à son bar à liqueurs, Monsieur Dieu ressentait pleinement la félicité de ces deux corps se buvant l’un l’autre à lentes lèvres dans la pénombre ocellée de la chambre de bois comme suspendue dans la maison de feuilles, et pour Lui rendre justice je le dis: Monsieur Dieu se sentait, aux moments d’effusion, comme le pur lapin de lune quand il bondit sur le ventre du nouveau pubère visité par la sirène, premier coup de queue et quelle surprise si Madame Mère levait le drap, mais maintenant, mon amour et moi, tout se fond dans le goût d’un mot soupiré que Monsieur Dieu fait semblant de ne pas entendre, le sachant notre secret.
Je fais confiance au Grand Mécanicien capable de concevoir une merveille de la catégorie de la Grosschen. C’est à la fois le Leonardo de l’Homérie et le Niels Bohr des algorythmes polyphoniques, mais rien dans les mains rien dans les poches, et quelle ingénuité malgré son grand savoir, quelle ingénuité dans la conception du moindre détail combinant l’utile et l’agréable de la Grosschen. On ne va pas en faire le catalogue, mais quelles trouvailles que l’allume-cigare à carillon tibétain ou que l’éventail à confettis. Combien tout cela me rappelle la fête du Bois de nos enfances...
Ensuite que roulant donc vers le Vieux Quartier, se développe en effet une autre analogie visuelle qui me remplit de la musique des voltigeurs, et c’est alors l’ivresse de la fête des enfants qui me comble, et mon amour.
Elle s’y revoit comme de cette après-midi: elle a sa jolie robe blanche à rubans. Moi j’ai l’air toujours un peu patate de l’enfant timide, mais je suis fier de ma casquette de pirate et je m’inscris à la poste américaine en tâchant de ne pas me faire voir de l’instite qui décrie ce marché d’amour.
Tu paies un franc, le type aux casiers te donne un numéro que tu épingles visiblement sur ta personne, ensuite de quoi tu pars à la chasse à la femme de ta vie. Tu repaies un franc si tu en repères une pour lui laisser un billet doux que le type glisse dans le casier au numéro de l’élue, et tu attends de voir si ça mord en regardant les voltigeurs dans le méli-mélo de toutes les musiques.
De la poste américaine ne me reste que le goût doux-amer des premières petites défaites, car il va de soi que celle qui m’attire se gêne autant que moi, ou que j’en invite deux à la fois par distraction, qui ne voient pas que je les observe de derrière le stand d’un marchand de gaufres avant que de me refondre dans la foule, mais le temps que j’attends me remplit de musiques, et c’est cela aussi que par avance je remercie Monsieur Dieu de me permettre d’écouter avec elle dans le mouvement berçant de la Grosschen en route pour le Vieux Quartier.
Et là je retrouve tout comme c’était: j’ai repéré de loin le beffroi de la cathédrale et les apôtres aux couleurs passées; une arête du contrefort de la colline a résisté à la tempête de temps en sorte que toutes les hautes étroites vieilles bâtisses médiévales de nos vingt ans continuent de défier le vide; et là-bas je distingue les silhouettes pensives de mes amis dans le jardin aux volières.
Ce serait, ce sera cela le paradis: l’anneau qui nous unit facilitera tout déplacement dans les dimensions aléatoires et nous épargnera le ricanement du Mauvais et de ses légions mortifères.
Je ne me demande pas ce que nous faisons là. Il n’y a plus de pourquoi qui tienne. On a compris que le Vieux Quartier figurait le haut lieu de nos premières amours et de nos vingt ans ingénus et bêtes, mais il y a tellement plus encore dans ces murs décatis et ces velours, ces arches et ces escaliers, ces passerelles, ces latrines en plein ciel, ces alcôves, ces terrasses étagées dans le chèvrefeuille, ces chambres proches où l’on s’est aimés, et tout nous est rendu jusqu’à l’instant dernier où l’on se rappellera que c’est là que tout a commencé, mon amour, quelque part dans quelque bar.
Le paradis c’est que c’était un village. Le paradis c’est que c’était un jardin. Du haut de leur ciel peint les anges enviaient nos peines de coeur et notre lancinant mal de vivre, ou nos corps tendres, nos tendres âmes.
Il n’est point besoin de descendre de la Grosschen pour y goûter encore: tout nous est rendu dans l’instant, tous les rôles et chaque voix appropriée.
 Le paradis c’était ta voix sous les draps étoilés par nos ébats, mon amour de ce moment-là, tandis que sonnait le marteau du rétameur au chant de baryton léger, dans la cour d’à côté, le paradis c’était de s’aimer au milieu de tout ça.
Le paradis c’était ta voix sous les draps étoilés par nos ébats, mon amour de ce moment-là, tandis que sonnait le marteau du rétameur au chant de baryton léger, dans la cour d’à côté, le paradis c’était de s’aimer au milieu de tout ça.
Il y a cent personnages aux fenêtres du Vieux Quartier l’instant suivant le coup de feu signifiant que l’étudiant désespéré s’est fait sauter la tête au numéro treize, puis on en parle dans les cafés, puis on repeint les murs ensanglantés, puis c’est l’hiver, on gèle, puis le printemps revient et c’est l’été où des jeunes gens tout nus dévalent l’escalier pour en faire voir au bourgeois.
Le paradis c’était notre bohème au Vieux Quartier, me dis-je en actionnant les leviers de la Grosschen et voici que, levée toute mélancolie, la roue se remet à tourner.
Alors, et peut-être pour toujours, avec mon amour, nous nous laissons emmener.
Monsieur Dieu, laissons-lui ça, est un machiniste stylé. Il n’y a plus de temps maintenant. Tout nous a été rendu et nous nous dirigeons vers la mer.
Nous y arriverons ce soir, sûrement à l’instant du rayon vert. Nous nous trouverons, même si c’est tard, un petit hôtel pas cher comme nous les aimions bien. La nuit venue nous nous attarderons dans la véranda pour écouter l’océan. Mais cela encore d’important mon amour: ne pas oublier d’envoyer une carte aux enfants. -
Dans les nuées

Où apparaît le personnage emblématique de la mère en ses oeuvres. Des vicissitudes ménagères et des litanies qui en découlent. Des appareils symbolisant les avancées du Progrès. De la machine à tout oublier.
Elle m’apparaît en bottes au milieu des bouffées de vapeur savonneuse, mais tu repasseras pour le fantasme freudo-wagnérien, parce que c’est vraiment pas la mère à te faire imaginer des situations oedipiennes et compagnie, même si c’est vrai qu’on peut être étonné.
En tout cas elle n’arrête pas, c’est sûr. Et elle le dit: en tout cas moi je n’arrête pas.
Elle s’est levée avant tout le monde, comme tous les matins, sauf le dimanche où il y a juste le culte à dix heures, et des années après elle le répète encore volontiers aux dames de la gym du troisième âge quand elles se retrouvent au Kibo pour prendre un café croissant: moi je me suis toujours levée avant tout le monde, il a fallu tellement lutter, on n’a plus idée au jour d’aujourd’hui.
Quand elle m’apparaît dans les nuées de la chambre à lessive, ce doit être, ça ne nous rajeunit pas, un printemps du début des années cinquante, c’est ça: je ne vais pas encore à la petite école et elle me dit à tout moment de ne pas rester dans ses jambes - c’est donc bien avant Adora l’adorée puisqu’elle manipule une espèce de batte visqueuse (ça y est, aux abris: alerte à l’indice psy!) et ce sera bientôt parti pour la litanie Engelures: moi pendant des années j’ai fait toutes les lessives été comme hiver et ça vous fait des mains! et l’autre jour encore, comme elle remet le couplet, au même instant pilipili-pilipili, voilà que le portable de mon neveu le tenancier du Shylock la fait bifurquer: moi ces machines je n’y comprendrai jamais rien, et d’ailleurs dans le temps on n’aurait jamais pu se payer tout ça, et du coup elle enchaîne sur la litanie Sou Par Sou.
Moi toute la vie j’ai dû compter sou par sou, nous aura-t-elle seriné à travers les années, mais c’est tout à coup une cohorte de retraités en survêtement bleu pâle que j’entends ronchonner en surimpression: comme que comme vous n’avez pas idée, les jeunes, de ce que c’est que de compter - et ça me poursuit jusque dans un rêve où mon père me surprend au Bancomat.
Tu te figures sa tête, lui que les machines ont toujours épaté, qui les approchait plutôt timidement puis s’intéressait au mécanisme, le contraire de la plupart d’entre nous, les démontait pour comprendre et les réparait volontiers dans son coin; tu le vois tourner et retourner ma Mastercard dorée qu’il tient de ses fins doigts immortels, et je lui sens un frémissement d’ailes (très seyantes, les ailes de papa, soit dit en passant, très simples, très classes) quand il s’exclame: et c’est avec ça que tu paies, non mais tu blagues, c’est avec ça que tu paies ?
En ce qui me concerne, cependant, c’est la honte, parce que vient de m’apparaître le désastre: que nous ne sommes que le quinze et que notre compte, déjà, marque zéro, et même un zeste en dessous du niveau de la mer, mais va donc expliquer à notre angélique visiteur pourquoi la machine refuse d’allonger la monnaie...
Tu te représentes l’énormité: ça a deux salaires, à peine deux kids, et ça rame dans les chiffres rouges ! J’ai beau savoir mon paternel capable de toutes les indulgences, et surtout assez réaliste pour piger la situation (certes nous comptons moins qu’eux, mais la vie est devenue hyperchère et nous faisons ce que nous pouvons), je n’en suis pas moins gêné quelque part, et d’autant plus qu’il ignore encore que ma mère nous a fait une grosse avance pour notre résidence secondaire, du genre qu’il n’a jamais pu que rêver - tu le vois se pointer à La Désirade !
Sur ce, je n’ai même pas le temps de lui proposer de s’attarder un peu (une visite à Madame ne serait pas un luxe après les quinze ans qu’elle a tirés sans lui) que l’ange du Bancomat a disparu dans un imperceptible froissement de plumes. Mais quel dommage: on aurait eu tant d’autres choses à lui faire voir !
Faute de mieux je les revois alors ensemble, et nous les enfants, tous en admiration devant la première machine à laver qu’il est arrivé à lui payer, une Adora, et je me rappelle le baratin du vendeur aux cheveux brillantinés qui surenchérissait: et voici, pour vous servir, Adora l’adorée, l’essayer c’est l’adopter, avec elle vous irez jusqu’au siècle prochain!
Le pauvre type ne parlait pas pour lui: trois semaines après son numéro c’était l’accident à bord de sa 403 grise, même modèle que l’inspecteur Columbo, un virage à trop grande vitesse et droit sur un mur, le fameux coup du lapin.
Mais tu sais aussi ce que c’est que la vie des machines au jour d’aujourd’hui: ça raccourcit de plus en plus, même pas l’espérance de longévité d’un ménage moyen, et d’ailleurs, pour Adora, tu peux courir après les pièces de rechange.
Là-dessus j’en reviens à l’apparition bottée dans les nuées de la vie ancienne, avant leviers et manettes, au temps des déesses lavandières du quartier de nos enfances, et nous revoici dans le dédale des draps à l’étendage.
Il y a plein de voix et de litanies: moi vous allez me tuer, moi si ça continue je vais faire mes valises, moi je me demande ce que vous ferez quand je ne serai plus là ?
La chambre à lessive est un vrai hammam d’où émergent parfois des bras nus, une tête à drôle de turban, une torsade d’étoffe immaculée qui ruisselle dans les rigoles, des bras roses, des mains bleues, et de là-dedans fusent les ordres: mais ne reste donc pas dans le mouillon, ne va pas trop au soleil, ne va pas m’attraper un rhume par cette pluie, et les mains passent du froid de l’hiver des Hongrois à l’eau bouillante et ça fait des gerçures.
Moi dans le temps j’avais de ces mains crevassées, raconte-t-elle encore à ses vieilles comparses du Kibo, et chacune d’y aller de son monologue extérieur: moi mon mari pissait sur la serrure de sa Vespa pour la dégeler, moi ma belle-mère nous a rendu la vie tellement impossible qu’on avait tout arrangé pour le Canada et voilà qu’elle se fait mitrailler par le tueur fou de la Grotte, moi dans le temps je croyais encore aux oeufs à deux jaunes, et les voix s’estompent dans les nuées tandis que, parfaitement silencieuse, s’active la grande machine à tout oublier. -
Littérature
Où il est question des péripéties finales inattendues d’un congrès de gens de lettres. Que la poésie n’exclut pas le kitsch, et que le whisky peut y ajouter certain frémissement de bon aloi.
J’imagine une espèce de fable qui leur flanquerait un vertige subit et salutaire à la fois, du genre de celui qu’éprouve le plus imbu d’entre eux (vous le reconnaissez à la peau de chamois qui dépasse de sa vareuse, avec laquelle il fourbit chaque matin son petit monument) quand il découvre que son nom ne figure pas dans tel ou tel nouveau dictionnaire des lettres contemporaines, ce même vertige qu’on peut éprouver dans l’une des cinq cents librairies japonaises du quartier de Kanda, au beau milieu de la nébuleuse de Tôkyo, ou en évaluant le nombre de gens vivant à l’instant à la surface de la planète dans l’ignorance complète des noms et des oeuvres de Carlo Emilio Gadda, Juan Carlos Onetti ou Ramon Gomez de La Serna.
Je vois un clair de lune à la Musset sur le Haut Lac. A précédé ce qu’on peut dire un crépuscule divin d’arrière-été. L’eau de satin, le ciel de soie rose mauve, tout le bazar propice au jaillissement des citations à la Byron, mais voici que se disloque la compagnie des congressistes du P.E.N. rassemblés sur le pont arrière du bateau à aubes où s’est tenue la conférence de clôture de la nobélisable albanaise Bessa Djirka dont les mots incandescents se détachent encore sur le fond cendreux de tous les autres discours.
Je note sur un bout de facture: faire sentir que Bessa, à la dégaine de vieille fille salutiste, est physiquement (et donc métaphysiquement) mille fois plus présente que quiconque en ces lieux et que chacun de ses mots participe de cette extraordinaire acuité, à vrai dire insupportable à la plupart.
Il y a donc du scandale dans l’air, et je vais le ressentir avec une violence particulière lorsque je serai littéralement pris à partie, à la proue où je me suis isolé pour en fumer une, par notre diaphane poétesse Aube du Perroy flanquée de son inévitable époux légitime à fonction de factotum.
Je ne les ai pas entendus venir mais soudain ils sont là, elle dans sa tunique de vestale du Temple et lui tout empressé petit groom lunetteux; et c’est alors que je suis censé graver dans le marbre la sentence fameuse, lâchée d’une voix blanche:
- Malgré tout la Poësie restera...
C’est adressé à l’Univers dont je ne suis qu’un infime brimborion, mais ça vise aussi le «frère en littérature» (sa dernière dédicace) dont Aube attend qu’il partage le courroux qu’a visiblement suscité chez elle la conférence de la Balkanique.
Je comprends à vrai dire le désarroi de celle que la dame patronnesse de la critique académique locale appelle «notre Emily Dickinson», à qui les propos de la conférencière ont dû paraître iconoclastes au possible. La façon de Bessa de fustiger tout idéalisme lyrique, la violence avec laquelle elle s’en est prise aux idolâtres valéryens de la Forme et autres versificateurs en chambre, enfin sa longue médiation finale sur les illusions de la littérature: tout cela ne pouvait manquer de déranger l’élégant parterre de nos gens de lettres.
Comme je reste impassible, Aube se figure peut-être que je n’ai pas bien reçu son S.O.S. alors que mes radars sont braqués sur elle et que je reçois 5 sur 5 les ondes qui signifient sa blessure d’amour-propre, sa détresse de vieille petite fille dont on a ébréché la poupée de porcelaine, et son juste courroux de croisée d’une cause qui voit son étendard souillé par une infidèle.
Je me suis moqué plus souvent qu’à mon tour des poses d’Aube du Perroy, mais à présent je la vois comme à nu, comme à la douche d’un asile, toute menue fretin livrée aux pluies acides. Je la vois comme je nous vois à l’instant, et c’est encore l’effet des paroles de Bessa: l’Helvétie est un autre radeau de la Méduse et nous dérivons, enfin dépouillés de nos vanités, sous la conflagration silencieuse des astres.
Mais tout cela relève de la fiction, car Aube reste bel et bien, en ce moment, toute figée dans sa réprobation vertueuse, n’attendant que mon assentiment. Quoi que je lui dise, aussi bien, qui ne viendrait la conforter, serait taxé de malséance; et de même en va-t-il des autres mandarins chuchotant ici et là dans la nuit d’été. Non mais vous l’avez entendue ? Mais cette mal élevée que nous recevons avec les pompes! Mais cette espèce de nihiliste!
Je laisse cependant Aube à sa fureur et je pars à la recherche de Bessa que je trouve bientôt seule au bar de seconde classe, devant une bouteille de Chivas déjà plus qu’à moitié vide, et j’en recommande une autre en me présentant comme le nouvel Homère encore inconnu, le Dante lacustre et le Shakespeare potentiel du canton, ce qui la fait sourire et m’accorder une petite place à côté de ses vieilles osses.
Là je me donne le beau rôle, c’est entendu: je fais celui qui serait l’unique à avoir déchiffré la juste parole de la conférencière, quand tous les autres n’y auraient compris que pouic. Mais c’est pour la fable: pour simplifier, juste pour ce qui suit, parce que c’est surtout ce qui suit qui compte - j’imagine en effet une sorte de féerie enfantine à laquelle le scotch va donner sa crâne tournure.
Cela commence au dernier coup de minuit, lorsque la pucendron de Gyrokäster se transforme soudain en belle de nuit. Je lui propose d’abord le tour des chapelles, et Djirka me répond: va pour l’inspection. Donc nous nous mettons en route, je fais le Virgile et nous tanguons de cercle en cercle, de la table des romancières intimistes à celle des prosateurs postmodernes, avec des salamalecs à tous les chefs et cheffes de file, le dramaturge qui monte et l’ enfant terrible qui stagne, les ambitieux et les désabusés, les joyciens et les célinomanes, les vieilles haridelles et les jeunes paons.
Puis nous avisons le chemin de lune, et là-dessus nous allons bras deci bras deça, faisant soudain pencher bas l’Helvétie sous le poids des plumassiers tous accourus à tribord et sidérés à la vision de ces deux-là marchant sur les flots.
Je sais bien que l’image a du plomb dans l’aile, surtout que ça murmure de moins en moins discrètement à l’entour du bar où dame Djirka qui-nous-a-bien-déçus-ce-soir, et ce pauvre K., sont en train d’entacher gravement la dignité du P.E.N.- Club.
Mais c’est alors que l’autre miracle advient, quand Bessa commence de vaticiner à voix haute. Alors là ça change carrément de registre. Là ça devient Bouche d’Or et les enfants sages. Là resurgit tout à coup la poésie vieille comme le monde et toutes et tous vont se rapprocher bientôt mine de rien pour écouter The Voice.
On se fichait pas mal, n’est-ce pas, de ce que Bessa pouvait avoir vécu ou pas jusque-là, n’était la décorative mention de sa dissidence. De ce qu’elle avait réellement enduré, de ses années de proscription ou de cachot, des humiliations publiques, des trahisons de supposés amis, de tout ce qui avait été son lot ordinaire durant toute sa vie jamais alignée: on n’avait à peu près rien à cirer. Et qui connaissait le moindre de ses poèmes ? Qui savait, sur l’Helvétie, plus que quelques formules publicitaires à propos de la fameuse invitée ?
Mais à présent tout prenait chair, tout prenait verbe et chair. Toute menue fretin dans la sorte de sac que figurait sa robe, Bessa s’était mise à psalmodier dans notre langue et tout à coup le temps s’ouvrait comme une conque vaste aux échos de toutes les voix de tous les âges et de partout. Et la pauvre Aube du Perroy, bien soupçonneuse encore, s’était approchée à son tour en se demandant ce que chantait cette sauvage enivrée, puis elle avait demandé de qui étaient ces vers, puis elle avait eu un frisson en reconnaissant quelque chose qu’elle-même aurait peut-être pu chanter, et voici qu’Aube fermait les yeux et qu’une mer de visages aux yeux clos ondulait sous la brise des mots.
La fable serait incomplète si je ne précisais qu’elle m’est venue le matin même où j’ai reçu l’invitation à participer au congrès du P.E.N.- Club qui devait se tenir au Plaza de Montreux et dont le thème serait L’Avenir de la Littérature. De sa plus belle écriture, la secrétaire du comité suisse, Aube Du Perroy, notait qu’elle comptait beaucoup sur ma présence, ayant fort apprécié ma dernière chronique sur la réédition de ses Poésies 1952-1994. Or à l’instant même, l’arrivée de Bessa Djirka, la jeune requérante d’asile de Gyrokastër à qui ma compagne enseigne le français depuis quelques temps, fut le déclencheur qui me fit jeter l’invitation au panier en envoyant au diable tout ce qui ressemble de près ou de loin aux gens de lettres.
-
Dad’s Blues

Où il est question du classique désarroi du bon père devant l’émancipation de ses filles. Que toute mauvaise pensée est frappée d’Interdit. De la sublimation et de la demande en mariage.
Elles se la jouent Dark Lady et Sweet Heart, et je fais le père moderne: je me la coince, mais n’en ressens pas moins comme une divine mélancolie.
Tel est de fait le dur constat auquel je suis amené ces derniers temps: que je ne suis plus leur seul dieu.
Ce n’est pas seulement qu’elles regardent ailleurs, c’est qu’elles sont ailleurs, et serais-je un pur esprit ou un spectre qu’elles me porteraient plus d’attention - pur esprit dont la première ornerait sa dissertation, ou spectre bienvenu dans les rêveries policières de la seconde.
Cela commence à la première heure dans un véritable branlebas. Il fait encore nuit noire et je me trouve, comme tous les matins, penché sur mes grimoires, dans le cercle enchanté de la lampe, lorsque ma table à écrire retentit des premières trépidations.
C’est en effet à cheval que Dark Lady traverse l’appartement, l’air hagard dans sa chevelure imitation black, un peu le style Angela Davis à l’époque des Panthères mais le sabot précis et la flèche verbale prête à être décochée, en tout cas rien ne l’arrêtera sur le sentier guerrier de la salle de bains où elle sera la première à se claquemurer.
Pendant ce temps, Sweet Heart figure la belle au bois somnambule qui va et vient entre sa couche désordonnée et le frigidaire, le visage dolent et la moue suggérant que ce n’est pas encore l’heure d’ouverture des guichets.
Dans ce tumulte feutré, je me surprends à d’inconvenantes poussées de voyeurisme, ou plutôt qu’inconvenantes: dangereusement naturelles, voire un peu sauvages.
Il arrive, en famille, qu’un sein adolescent pointe à la fenêtre, ou qu’une jeune croupe se dandinant direction les lavabos vous suggère des choses au plus total oubli du fait que vous êtes le père.
Cela peut arriver en rue de la même façon, quand vous appréciez de loin la silhouette ravissante de Lolita ou de Baladine et que, tout à coup, vous reconnaissez votre enfant. Naturellement vous aimeriez vous précipiter et vous jeter aux pieds de la grâce incarnée, mais cela même ne se peut pas et vous pressentez que c’est bien ainsi. Car vous aimez cet Interdit plus que votre désir, en tout cas vous vous le répétez à chaque fois que Sweet Heart vous impose l’épreuve du Défilé (le supplice de Tantale du Mini Mini) ou que Dark Lady se met à danser au milieu du salon à la manière d’Isadora Duncan.
Bien entendu, l’Interdit ne va pas jusqu’à ne pas toucher. Je caresse donc volontiers et je l’avoue sans vergogne: je bécote. J’oserai même en faire le thème d’une campagne de propagande à l’échelon de la collectivité: bécoter plus, c’est se laisser moins troubler.
C’est aussi soulager l’angoisse de Sweet Heart, toujours lancinante en ses treize ans de nymphette aux abois, que la seule évocation d’un mollusque suffit à faire se pâmer de dégoût. Le baiser à l’américaine, dit aussi langue fourrée, fait ainsi figure à ses yeux d’odieux enlacement de limaces, et ne parlons pas des organes.
Cela ne m’empêche pas de pressentir, en Sweet Heart, une amoureuse ardente. Tant sa passion pour les éléphants que ses débordements d’affection et les longues, longues séances qu’elle passe au miroir à se faire plus jolie que jolie, me semblent autant de signes de bonnes dispositions.
Mais ne rien brusquer, ne rien chercher même à rabattre des sourcilleuses recommandations de Madame Mère du style L’Amie de la Jeune Fille...
Tout cela que Dark Lady reluque à sa façon voulue sarcastique, mais le coeur et les antennes en constant état d’alerte. Dark Lady ou la fausse dure. Calamity Jane rêvant d’un prince charmant aux yeux tendres à la Ricky Nelson. Et de fait, le western sera carabiné, mais les couchers de soleil ne sont pas pour les coyotes, et là ça peut aller jusqu’à des baisers de deux trois minutes sur fond de ciel flammé, et dans la salle on s’abandonne doucement au creux de l’épaule de son soupirant, mais pour le reste essayez pas d’en savoir plus ou je tire !
Je sais qu’en digne père je ne devrais penser qu’au statut de marchandises de mes filles. Telle nous rapportera tant, et l’autre tant; notre bien se trouvant augmenté à hauteur de tel bénéfice par rapport à l’investissement de base. Je devrais compter, au lieu de quoi je rêve. Je devrais négocier chèrement leur capital beauté et leur potentiel à tous les niveaux, alors que mon blues radoucit, jusqu’à la honte, mes velléités de père selon la Tradition.
C’est ainsi que je finirai par les céder, en ne pensant qu’à elles, l’une au cow boy de ses rêves et l’autre à quelque clone du mousquetaire Leonardo di Caprio. La seule condition sera qu’ils se présenteront au ranch pour me soumettre leur demande en bonne et due forme. Je leur ferai savoir au préalable, par leurs amoureuses, mon exigence absolue en matière de connaissance de la musique baroque et des vendanges tardives, mon souci de beauté et plus encore de bonté, et mon souhait vif de les entendre se déclarer en vers réguliers.
L’examen prendra le temps qu’il faut et ce seront autant de mois et peut-être d’années de sursis qui me seront accordés.
Surtout, le faraud sans cervelle et le joli coeur volage, le marchand d’orviétan sentimental et le séducteur illusionniste seront confondus.
La scène finale n’en sera que plus douce, plus douce et plus poignante. Déjà je nous vois bien vieux, elle et moi dans nos chaises à bascule, tandis que le grand soleil décline à l’horizon de La Désirade, à saluer encore et encore nos enfants qui s’éloignent là-bas sur leurs chevaux qu’on dirait maintenant des jouets, mais vivants, de si jolis jouets à ressorts remontés pour la vie.
-
Les abeilles de Byzance
Où il est question d’un artiste photographié par les journaux dans le cortège de la Gay Pride. De sa vision transfigurée. Que le génie reste méconnu en ce bas monde et que l’enfance est une société secrète.
en pensant à Olivier Charles

Sur la photo de la Gay Pride, Angelin, c’est l’oiseau de funérailles qui se tient à l’écart, là-bas, seul comme personne, tout en noir sur le fond ondoyant des gars presque nus et des filles en pétales, la gueule apparemment verrouillées et le regard invisible derrière les verres plombés de ses lunettes d’architaupe.
Toujours sa façon de donner le change. Comme une tour impénétrable, et dedans se déchaînent cependant les forces et les énergies. Rien d’étonnant alors qu’il ait daté Les abeilles de Byzance du même jour entre deux et trois heures de l’après-midi (la tranche horaire de la photo) alors qu’il semblait complètement absent de tout et plus qu’indifférent: ailleurs.
Quoi de moins engageant que cette face de clergyman à l’enterrement de Dieu ? Et pourtant l’observateur attentif nuance rien qu’à détailler la tenue de l’olibrius. C’est que dans tout ce noir flambe un rouge de boucherie et le bleu des nuits blanches, et c’est surtout que la matière du costar d’Angelin signale une espèce dê dandysme qui lui donne, même ivre mort ou shooté, la dignité équivoque du baron Corvo à la messe, et l’oeil le plus exercé décèlerait comme une malice enfantine dans un certain pli oblique de son vague sourire, signifiant qu’il communique avec ce qu’il appelle tantôt The Great In ou The Big Out pour égarer les poulpiquets de la critique établie.
Chacun, de ceux qui ont vu Les Abeilles de Byzance, comprend illico de quoi il retourne, mais quiconque se casserait la gueule à l’expliquer, ou plus exactement risquerait de se faire casser la gueule par Angelin, comme cet imbécile de chroniqueur du Quotidien bonnement jeté dans l’escalier métallique du loft du maître voyou.
Que dire d’une foule en rut ? A vrai dire Angelin paraît, sur la photo, rester de glace au spectacle de la Gay Pride dont il est plus que sûr qu’il vomit l’esprit grégaire et la collante convivialité, ce côté scout du cul en mal de reconnaissance, alors qu’il se veut lui-même du parti des uniques, et pourtant c’est de cette viande qu’ont surgi tout à coup les abeilles.
Tout à coup, sans crier gare, en noirs essaims dorés surgis des clochers des entrejambes: à toute boule comme des meules de feu fusant du fond du ciel en fusion. Dès le premier char les abeilles ont vrombi en escadrilles, tantôt groupées style Les Stukas attaquent et tantôt disloquées en giclures sonores sous les coupoles du ciel cisalpin fleurant le kérosène et le pollen des jardins suspendus, et de tout ce branlebas qu’Angelin seul a perçu procède donc l’immense toile que chacun prend en pleines tripes comme une baffe sensorielle et métapsychique sans pouvoir n’en rien dire plus que la tortue de mer jouissant tout à coup d’échapper àééé la pesanteur en basculant dans la flotte océane.
Seule la Sagouine, une fois, a dit quelque chose à propos de travaux antérieurs en beuglant, dans un cocktail, que les choses d’Angelin relevaient de la divine Feuille de Rose, et tout le monde, à rire, en a fait trembler sa burette de champagne alors qu’il n’y avait pas de quoi, du moins était-ce le sentiment d’Angelin lui-même qu’il n’y avait pas de quoi rire, et probablement cela explique-t-il que Les Abeilles de Byzance soient dédiées à la mémoire de la Sagouine, défuntée il y a quelque temps de sa chère vieille cyrrhose.
A présent le souvenir de la Sagouine ne laisse de conforter Angelin dans sa conviction qu’un être un peu sensé, par les temps qui courent, ne peut être qu’une créature déclassée aux dehors de monstre de foire ou de cinglé, et telle était aussi bien la Sagouine à la dégaine de poivrote aux nippes de gitane flapie et aux sorties apparemmnent loufoques, dont Angelin et quelques lecteurs de la Vie ouvrière, où elle donnait sa chronique hebdomadaire, appréciaient cependant les fulgurances intuitives et la savoureuse sapience absolument démodée.
«Angelin peint le Désir et la Douleur à l’état d’extrême incandescence, avait écrit la Sagouine au lendemain de la rétrospective de l’Espace Off, son oeil cloué au front d’une locomotive folle nous arrive tout droit de Tolède via la boucherie féerie du Russe Chaïm et de l’Anglais babylonien aux papes cannibales, mais la vision finale nous ramène Da Capo à cette vieille fripouille de Diego, leur maître à tous», et tant l’outrance cryptée de la vieille folle que les observations détaillées qui suivaient lui rappelaient maintenant les quelques bonnes et belles cuites qu’ils avaient partagées, notamment au jour de ses cinquante ans, l’année de la comète, lorsque la Sagouine s’était pointé au loft en compagnie d’un superbe gig brésilien qu’elle tenait en laisse et lui offrit pour qu’il en tirât quelque décharge de haut voltage pictural.
Tout cela se trouve comme précipité dans la vision des Abeilles de Byzance, dernier avatar de l’épouvante de cette fin de siècle plus que sublimée par le peintre: rendue à sa pure Beauté panique.
Ce n’est pas, chacun l’a compris, qu’Angelin dore la pilule, car les abeilles disent à la fois la gloire et la mort de Jo, son ami unique de la vie ici-bas et au ciel céleste, et la grâce et la déchéance de la mère d’Angelin au mouroir, disent par conséquent le lait de toutes les tendresses et les retombées de cendre humaine des camps de la mort, disent les montagnes à l’aube et les pyramides de crânes, disent l’alpha et l’oméga de cette existence de rien du tout et de l’éternité symbolique, disent la viande et le fruit, disent la bête et les fleurs - enfin chacun pige tout et fait silence.
Le noir multiple dont est vêtu Angelin sur la photo de la Gay Pride 98 signifie à la fois qu’il pourrait se flinguer ce dimanche de solitude absolue, dans ce petit pays amorti, et qu’il ne le fera pas car il a encore à faire.
Qu’il n’y a à faire que faire: c’est la conviction dernière d’Angelin. Mélanger ses couleurs est une putain de béatitude. Passer des nuits à genoux dans le chaos d’alcool et de chiffons sales de votre dépotoir aux vitres maculées pour n’en extraire qu’une ombre de l’or de la boue de Rembrandt vous fait rebondir sur vos pattes de derrière, et ce soir y a plein d’étoiles, y a plein d’amis défuntés qui vous zyeutent par les hublots du grand paquebot aux abeilles...Peinture d'Olivier Charles
