
Par-dessus les murs (13)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.








Dans son nouveau roman très singulier, Un galgo ne vaut pas une cartouche, Jean-François Fournier, qui fait rimer truculence et désespérance, s’improvise Tour Operator, accompagné d’une adorable levrette, d’une virée dans l’espace-temps d’un vieux continent sous perfusion gastro-érotico-artistique. Loin de Bruxelles, pour notre bonheur !

« L’Europe à laquelle je rêve est celle des cultures et pas du tout celle des États-nations, des technocrates ou de l’argent », me disait Denis de Rougemont il y a cinquante ans de ça, lorsque, dans son grand jardin de la campagne genevoise, il m’avait reçu afin de répondre à mes questions sur le terrorisme européen de l’époque.
Amorçant alors son grand virage écolo, celui qu’un André Malraux considérait comme l’un de ses contemporains les plus intelligents, m’avait impressionné par la compréhension qu’il manifestait à l’endroit des extrémistes italiens ou allemands, qui ne manqua de scandaliser certains lecteurs du journal Construire qui m’envoyait, le fameux « hebdomadaire du capital à but social social » dont Charlotte Hug avait fait, à l’enseigne de la Migros, une publication culturelle de premier ordre et de très grande diffusion.
Or je n’aurai cessé de penser à la réflexion du grand auteur de L’Amour et l’Occidentou de Penser avec les mains, entre tant d’autres ouvrages, en lisant le nouveau roman de Jean-François Fournier illustrant les multiples aspects, flamboyants ou désespérés, de la culture européenne en son noyau génial, contrastant pour le moins – ou plus exactement pour le pire - avec ce qu’en ont fait les ploutocrates de la technocratie globale.
L’éditeur Olivier Morattel a-t-il raison de parler crânement d’un « grand roman européen » à propos d’Un galgo ne vaut pas une cartouche, si l’on se rappelle les chefs-d’œuvre de Thomas Mann ou de Robert Musil ? Disons que, plus modestement, cette suite de variations sur quelques thèmes fondamentaux apparaît bel et bien comme un roman interrogeant les tenants du génie créateur à l’occidentale , ainsi qu’une célébration fervente de l’art et de la littérature, et que telle est certes sa «grandeur», à distinguer de la platitude et de la camelote surfaite au goût du jour…
Le grand saut
Le premier saut, physique et métaphysique, marquant le passage du réel à la fiction, ou la liaison plus ou moins dangereuse entre désir incarné et fantasme, se trouve figuré, dans la filiation d’un Hemingway ou d’un Montherlant, par la corrida imaginaire mise en scène par un écrivain allemand au double prénom germanique (Ludwig ou Ernst) dans une pension crade de Barcelone où bohèmes et catins voisinent, et tout de suite le verbe net et chatoyant du connaisseur s’arrache au magma dégoûtant du quotidien avec les termes précis et fleuris de l’art tauromachique qui voient el presidente (surnom donné au plumitif teuton par le patron de la pension) se réapproprier les mouvements des chicuelinas et autres novilladaspréludant à l’estocade du novillero, et que je te balance de l’arrucina ou de la muleta pour faire vrai, et l’on a beau savoir que la scène de ‘écrivain en « habit de lumière » devant son écran relève du selfie : on y croit, de même qu’on est prêt à croire qu’il est prêt à écrire son « grand roman taurin » même s’il bute sur le mur de la réalité lamentable d’un comité de lecture qui refuse, à Munich (en Bavière, jawohl, fameuse pour sa bière), son dernier manuscrit qu’il tient, lui, pour un chef-d’œuvre ; et là ça fait si mal qu’un autre saut va s’imposer…
Auparavant, cependant, à part le show de la parodie de corrida, le lecteur (et la lectrice par inclusion) aura commencé de « taster » des agréments variés de la boisson (un Vega sicilia ne se refuse pas entre deux cigares, même au titre de citation brève, avant les nomenclatures plus détaillées) et de la chair explosive d’une dame passant par là, après que sera apparue la levrette baptisée Canela par Ludwig (à cause de la rousseur du bout de ses oreilles), nébuleuse merveille blanche que l’artiste peintre d’à côté, un certain Rainer, adoptera après le vol plané final de l’écrivain. Enfin, tout ça ne se raconte pas : c’est à lire, c’est à lire qu’il vous faut !

Donc un écrivain fasciné par la tauromachie, puis un peintre jouant lui aussi sur le mélange des sens et des sangs, qui de Barcelone nous emmène à Vienne (avec d’autres vins dans la foulée, d’autres références courant de Goya à Schiele, d’autres citations d’Ovide ou de Thomas Bernhard) et s’éclate au poker où il perd Canela, puis un saxophoniste « extra » qu’on retrouve à Prague avec la levrette s’adaptant à tous les fauteuils et sofas de ce monde où il fait bon flemmer, puis une victime d’inceste (il en faut forcément dans un roman d’aujourd’hui) qui exorcise le monstrueux souvenir par l’art et le journalisme, puis un nègre nègre – un vrai nègre littéraire noir qui se dit lui-même « nègre nègre » sans complexe, tant il est vrai que le roman de Jean-François Fournier, auteur complexe assurément, n’en est pas moins un roman-gigogne sans complexe.
Cependant la lectrice (et le lecteur par inclusion) se demande si tout ça, littéralement truffé de clichés culturels voire sociétaux apparents, n’est pas en somme téléphoné ? Ce Fournier n’est-il pas qu’un snob provincial affublant ses personnages de fringues marquées, Chanel à celle-ci et Pucci Gucci à celui-là ? Et ne touche-t-il pas de pots de vin de certaines caves qu’il flatte même indirectement ? À ces objections j’ose répondre avant lui et en russe affirmatif : niet. Car c’est à l’auteur d’Un galgo ne vaut pas une cartouche qu’il incombe de répondre, à lui et à Canela.
Les trois chapitres finaux de ce roman à dégaine de poupée russe, à savoir Suicide blonde, Love supreme et Ali, avant l’épilogue où s’exprime Canela en langage humain, ressortissent bel et bien au grand roman européen sporadique des poètes en vers ou en prose dont un Peter Altenberg, dûment cité, est un bon exemple à la fois méconnu et significatif. L’Europe est là, personnelle et mal coiffée, comme elle est là chez Handke ou Charles-Albert Cingria – il me semble que Fournier lui vrille un clin d’œil -, Robert Walser ou, au cinéma, Daniel Schmid et Fredi M. Murer, ces conteurs de la forêt des émotions vives, Rainer Werner Fassbinder le mauvais garçon tout cuir au cœur de tendron ou Cesare Pavese à qui la difficulté de vivre tenait lieu de métier.
Une mélancolie qui a du chien
L’Auteur d’Un galgo ne vaut pas une cartouche s’avance d’abord masqué, même s’il se signale illico par son style, il donne en somme dans le mariage pour tous littéraire dont les personnages seront tous (et toutes, car les femmes y joueront un rôle crucial) des anges, à commencer par la douce Canela surgie aux abords d’un claque de Barcelone, et c’est par la voix d’un de ses avatars qu’un maître d’écriture avéré, qui vient de proférer d’utiles vérités sur la lecture (pages 109 et 110), conclut que « le monde n’est pas suffisant pour nous et ne doit jamais le devenir ».
De fait, un monde où l’on abuse des enfants, un monde où l’on croit laver son honneur en punissant son chien point assez performant à la chasse au lapin, un monde où l’on répond à la terreur d’État par le massacre des innocents, un monde fait à l’image d’un Dieu méchant ne nous suffit pas, les gars. « Tu sais, dit le maître au disciple, la lecture est une incroyable petite musiqu qui ne fait pas seulement résonner de smots, un stylem les aidées d’un auteur, voire les idées tout court. Elle instille aussi dans ton cerveau un parfum indescriptible et unsaisissable, quelque chose que j’ai mis très longtemps à appeler par son nom, le bonheur ». Et le même à propos de l’écriture : « Comment accepter d’écire sans atteindre sans atteindre la perfection ? J’ai envie de tuer les mauvais auteurs. Moi-même je ne me pardonne rien : il n’est pas rare que j’éprouve une pulsion suicidaire en relisant mes propres textes ».
Le type se nomme (peut-être) Pierre-François Tournier (Michel est au jardin, dira-t-on comme la femme de Marcel Aymé le lendemain de la mort de celui-ci), c’est peut-être un grand écrivain de théâtre ou de cinéma au vu de sa dégaine (costume de lin blanc et panama, mais un clic et tu te retrouves sur YouTube où t’attend le démoniaco-angélique Michael Hutchence en plein « live » de Suicide blonde, quelques années avant qu’on le retrouve pendu tout nu comme un galgo et cuité d’alcool et de substances connues de ceux auxquels le monde ne suffit pas.
Le monde selon le Valaisan Fournier (et tout Valaisan est un peu un Sicilien virtuel de la vieille Europe) n’est pas une apologie kitsch de la défonce suicidaire, même si le thème de l’autodestruction est inscrit sur le tableau magnétique de la cuisine du plus beau de ses personnages de l’occurrence, une Dominique qui a sa sainte et sa rue à Paris, où elle en finira d’ailleurs : « Donner sa vie à ce qui n’existe pas », ou encore : « Faire périr tout ce qui est en moi ».
On ne fera pas de sur-interprétation en voyant, chez Canela, une cousine du Lévrier de la Commedia de Dante, grand mystère de la théopoésie, ni non plus un emblème européen de transport poétique rappelant celui de la compagnie d’autobus Greyhound connue de tous les fans de littérature américaine (Fournier en est) en cavale sur le terrain. Et pourtant, s’il y a du dandy à la Thomas de Quincey chez l’Auteur en question qui a sûrement lu De l’assassinat considéré comme un des beaux arts, l’auberge espagnole de son dernier roman, grand ouverte sur le monde qui n’existe pas de la poésie, est aussi le miroir proustien qui lit en chacun de nous et nous fait dire ce qui nous manque pour notre bonheur…
Jean-François Fournier, Un Galgo ne vaut pas une cartouche. Olivier Morattel éditeur (France), 167p. 2023












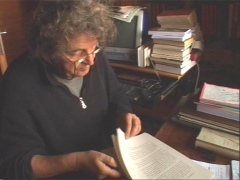

 En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent plus de 136 lettres échangées, que l'intervention de Tsahal à Gaza interrompit finalement...
En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent plus de 136 lettres échangées, que l'intervention de Tsahal à Gaza interrompit finalement...
Les livres de demain seront -ils écrits par des robots ? Faut-il se réjouir ou déplorer l’entrée en littérature de ChatGPT, entre autres outils numériques ? Et si le défi de l’intelligence artificielle n’avait rien de si nouveau ni de quoi nous faire paniquer, au contraire ? Quelques esquisses de réponses au fil de nos lectures et autres expériences vécues ou rêvées…
Les passionnés de littérature que vous êtes, lectrices et lecteurs de tous âges, sans parler des auteurs et autrices de divers genres, plus encore impliqués que vous autres, ont-ils des raisons de craindre les avancées de l’intelligence artificielle en matière de création littéraire au motif que celle-ci y perdrait son âme ? Plus précisément, les nouveaux outils numériques tels que ChatGPT vont-ils servir ou desservir la sainte cause des lettres en facilitant son usage ou en le nivelant par le bas ?
Telles sont les questions que je me suis posées ces jours en lisant simultanément quatre livres très différents les uns des autres mais à la fois apparentés par l’engagement et la singularité de leurs auteurs, à savoir plus précisément les Œuvres de Philippe Jaccottet (1925-2022) réunies sur papier bible à l’enseigne prestigieuse de La Pléiade, le dernier roman de l’auteur américain Bret Easton Ellis, Les Éclats, dont les 600 pages constituent une reprise quasi proustienne des thèmes de ses premiers livres, le petit recueil de récits autobiographiques de Bruno Pellegrino (intitulé sobrement Tortues) qui explore lui aussi les recoins de la mémoire avec une fraîcheur de touche mêlant ironie et tendresse, et le premier opus du nouveau Wunderbube de la littérature alémanique, au nom déjà mythique de Kim de l’Horizon qui, avec son « livre de sang » (Blutbuch), nous balance sa livre de chair aux singulières dérives verbales – bonne chance au traducteur !
Le noyau de la question...
C’est par mon filleul Léo, diplômé de shiatsu travaillant occasionnellement les méridiens de mes énergies, que j’en suis venu récemment à ces cogitations après qu’il m’eut raconté ses « échanges » avec ChatGPT : le premier pour lui demander de lui rédiger quelque formule publicitaire utile à son cabinet de praticien, le second pour lui réclamer la composition d’un haïku à la manière de l’immortel Bashô, ce que la machine réalisa en un rien de temps…
Or ladite « machine », capable de bricoler ainsi une pub ou un haïku - genre poétique minimaliste et très formalisé dans son code -, serait-elle capable de concevoir des poèmes plus amples et complexes tels ceux d’un Philippe Jaccottet, ou de restituer la beauté et la « musique » des proses du même auteur ? Une autre expérience nous en dit un peu plus à ce propos: celle que rapporte notre confrère Jean-Noël Cuénod à propos d’un poème de Louis Aragon, dont ChatGPT a modulé une version à sa façon. Avec ce résultat éloquent : d’un côté, l’élan lyrique d’un poème de guerre, qui dit en images fortes la double approche d’un résistant animé par une foi religieuse, et celle de son camarade athée, et c’est un chant aux fidélités variées que solidarise une cause commune. De l’autre, la même situation réduite à une sorte de commentaire binaire édifiant, dénué du moindre souffle et de la moindre chair. D’un côté, la poésie ressentie de l’intérieur, et de l’autre, du « voulu poétique » de catéchisme ou de dissertation…
Or ce qui est valable pour un poème l’est assurément, aussi, pour la prose. La versification, régulière ou « libre », ne suffit pas à caractériser ce qu’on appelle la poésie, qui ruisselle bonnement dans la prose d’un Marcel Proust ou d’un Louis-Ferdinand Céline, d’un Jean Genet ou d’une Virginia Woolf.
L’important est évidemment ailleurs, que scelle le génie ou la simple «touche» personnelle d’un auteur, ce qui fait le ton ou la patte de Colette, la musique de Verlaine ou la prodigieuse intelligence plastique de Baudelaire, la voyance sensuelle et spirituelle de Rimbaud ou le lyrisme tellurique d’un Charles-Albert Cingria qui n'a jamais commis, sauf erreur, le moindre vers.
Or, pour en revenir aux vers, justement, demandez-donc à ChatGPT de restituer le charme, la finesse d’observation, l’accent, la musicalité de poèmes aussi simples et «modestes» apparemment que ceux du Petit village de Ramuz, seul recueil de vers de cet immense poète en prose, et vous verrez le résultat…
ChatGPT peut compiler des milliers de données à la vitesse de la lumière, mais inventer un seul vers inouï, improviser un seul écart de pure fantaisie, susciter un seul moment de pure émotion lui reste inaccessible à ce qu’il semble, en tout cas pour le moment…
De l’art et de la technique…
Il en va de la distinction, faite depuis que l’intelligence humaine se trouve à l’exercice, entre l’art et la technique. En littérature, nous distinguons ainsi les vrais « créateurs » et les « faiseurs », ceux qui « inventent » et ceux qui « fabriquent », et c’est valable pour tous les genres littéraires, me disais-je en lisant ces jours Les Éclats de Bret Easton Ellis, dont la matière (la frange juvénile de la société américaine la plus déliquescente) est ressaisie et travaillée avec une attention hypersensible et une capacité de transmutation verbale des sentiments le plus délicats, sur fond de semi-barbarie morale, qui apparente l’auteur aux meilleurs écrivains-témoins.
Et qu’en dirait ChatGPT ? Il ne verrait sans doute, des composantes de ce récit autobiographique dont la part d’ombre évoque les feuilletons aux inévitables serial killers, que les stéréotypes de la narration – laquelle devient un nouveau poncif actuel au titre du storytelling -, alors que ce vaste travail de mémoire ressortit bel et bien à la plus noble littérature que John Cowper Powys disait le journal de bord de l’humanité…
« ChatGPT n’est pas plus intelligent qu’une tondeuse à gazon. Il fait ce qu’on lui demande de faire selon ses capacités », écrit plaisamment un autre de nos confrères, Jean Blaise Rochat (cf. La Nation du 7 avril dernier) dans un article consacré aux limites de l’intelligence artificielle. «Pour des raisons ontologiques, un logiciel, quelque puissant qu’il soit, ne dépassera jamais l’informaticien qui l’a conçu . De même que nous pouvons imiter par divers artifices une aile de libellule, nous ne sommes par les créateurs de la libellule. Nous ne pouvons donner une âme à un animal». Or telle est la valeur ajoutée de l’art, que la technique ne suffit à produire : ce supplément d’âme…
Ce que les robots nous apprennent par défaut…
Bruno Pellegrino est une aile de libellule, tout de même que Kim de l’Horizon, premier auteur non binaire de notre connaissance. Bruno (né le 19 aout 1988 à Poliez-Pittet) est entré en littérature avec une dissertation consacrée à Marcel Proust (décédé le 18 novembre 1922) si brillante qu’elle lui a valu son premier prix littéraire, suivi de plusieurs autres. D’une façon parente, Kim de L’Horizon (dont le nom est une fiction et le lieu de naissance une exoplanète) a vu son premier livre, Blutbuch, gratifié de la plus prestigieuse récompense littéraire de l’Allemagne réunifiée, à la réception duquel il s’est rasé publiquement la tête en signe de solidarité avec les femmes iraniennes. Aussi loin de Jaccottet que peut l’être Bret Easton Ellis, et pourtant…
Si l’on se réfère au «monde d’avant» quitté volontairement par notre ami Roland Jaccard à la veille de ses 80 ans, Kim de L’Horizon pourrait sembler du « monde d’après », du moins selon les codes binaires dont il/elle s’est affranchi (e), alors que Bruno Pellegrino fait plutôt figure de chenille de transition à la manière de Lewis Carroll. Ce qui est sûr est que ces deux jeunes auteurs suisses (leur passeport numérisé font foi) se distinguent des robots par leur fantaisie et le tracé gracieux de leur début de carrière, l’un dans la filiation occulte de Gustave Roud (qu’il a visité personnellement post mortem dans un petit livre de ferveur aimante, alors qu’on se rappelle que le poète fut le premier mentor de Philippe Jaccottet), l’autre plutôt tourné vers le futur sorcier où les Mensch (on ne dit plus Mann ou Female) parleront la même langue fourrée de Nutella inclusif, comme l’eût apprécié son référent Michel Foucault dans sa vision utopique des corps glorifiés…
Dans la foulée, en attendant la version française de Blutbuch (promise à l’automne prochain), amusez-vous à en traduire le texte au moyen du traductoriel Deepl : le salade que vous en obtiendrez aura sûrement le goût mélangé de bircher au Xanax et de pudding vegan…
Entre autres rencontres angéliques, Bruno Pellegrino évoque, dans Tortues, celle d’un taxidermiste bourrant l’animal voué à défier la fuite du temps au moyen de tout et n’importe quoi. Immortelle tortue farcie : telle est la littérature échappant, pour l’instant, à l’imagination artificielle, comme l’avait prévu d’ailleurs Isaac Asimov le gardien des lois de la robotique.
Mais laissons donc nos amis Philippe et Bret, Bruno et Kim, jouer encore et encore, au fond du jardin d’Alice, à leur jeu du n’importe quoi, illustrant cette réflexion de cet autre enfant amateur de féeries littéraires qu’était Julien Green, dans son Journal du 15 juillet 1956: « Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes »...
Philippe Jaccottet. Oeuvres. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade
1626p. 2014.
Bret Easton Ellis. Les Éclats. Robert Laffont, 601p. 2023.
Bruno Pellegrino, Tortues. Zoé, 141p. 2023.
Kim De l'Horizon. Blutbuch. Dumont Buchverlag, 334p. 2022.

Sous les plumes respectives de Gérard Joulié et Roland Jaccard, deux génies poético-philosophiques de la première moitié du XXe siècle, G.K. Chesterton et Ludwig Wittgenstein, revivent en beauté par l’analyse fine et le verbe incarné. La même indépendance d’esprit et la même douce folie traverse en outre Chesterton ou la quête excentrique du centre et L’enquête de Wittgenstein.

Les accointances angéliques du dieu Hasard qui, comme chacune et chacun sait, n’existe pas, ont vu paraître ces derniers temps deux opuscules consacrés aux extraordinaires figures qu’incarnèrent, à peu près à la même époque, et sur le sol de la même terre anglaise de toutes les extravagances, Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) et Ludwig Wittgenstein (1889-1951).
Présentant un aussi fort contraste, au physique, que les comiques américains Laurel et Hardy, ou que l’autre inénarrable couple imaginé par Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, sans oublier le long maigre et le bon gros qui amusèrent notre enfance sous les noms de Londubec et Poutillon, les deux personnages ne différaient pas moins, en apparence du moins, tant par leurs caractères personnels que par leur mode de vie, leurs idées et les familles d’esprit auxquels ils se rattachaient, leurs positions en matière politique et philosophique ou religieuses, et pourtant...
Pourtant la lecture parallèle des deux grands petits livres, au même style élégant et fluide, que leur consacrent Gérard Joulié et Roland Jaccard, font apparaître d’indéniables similitudes, au plus haut niveau de l’indépendance intellectuelle et de l’aspiration spirituelle de deux génies partageant le même tempérament rebelle et la même propension à piétiner ce que nous appelons aujourd’hui le politiquement correct, dans un commun souci qu’on peut dire «religieux», ou plus exactement mystique.
La qualification de «réactionnaires» leur conviendrait assez aujourd’hui à divers égards, si ce n’est qu’elle ne veut plus rien dire, sinon l’exécution sommaire des justiciers autoproclamée, et le plus souvent anonymes, de la meute sociale, pas plus que la qualification de «rebelle» ne rime a quoi que ce soit dans un monde où tout un chacun (et chacune) prétend «vivre dangereusement» en multipliant les simulacres de «prises de risques»...
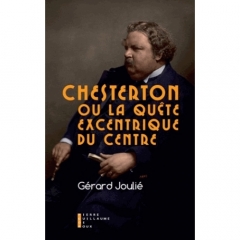 La sainte verve endiablée d’un ferrailleur débonnaire
La sainte verve endiablée d’un ferrailleur débonnaire
Chesterton, dont l’énorme derrière cédait la place à trois dames quand il se levait dans l’omnibus, avait le sens du beau et du bien, de la merveille partout présente dans la trompeuse grisaille du monde et du mystère entier de notre existence hors d’une vérité révélée qu’il reconnaissait en paladin chrétien converti au catholicisme; il affirmait «qu’il vaudrait la peine de jeûner quarante jours pour entendre chanter un merle» et, sans exagérer, qu’il vaudra la peine, ce prochain printemps, de « passer par le feu pour voir une primevère ».
Cela n’en faisait pas un chantre de la nature «positivant» béatement pour ne pas voir le Mal courant dans le monde : au contraire c’était un chevalier batailleur tout dévoué à la cause du Bien et du Vrai, sans sacrifier pour autant aux bons sentiments qui n’engagent à rien, ni moins encore discréditer les bonnes choses de la vie.
«Quand presque tous les intellectuels de son temps (et du nôtre, la chanson est la même seulement amplifiée) se mobilisent pour défendre les causes humanitaire, écrit Gérard Joulié, Chesterton dit et redit l’héroïsme des existences ordinaires, le charme de la vie domestique, le tragique des odes, les vertus de l’humilité (car tout comme l’orgueil, elle a aussi les siennes) et du patriotisme, et la puissance de la littérature populaire».
À ce propos, l’inventeur du roman policier «théologique», avec son impayable Père Brown résolvant toutes ses énigmes au moyen de son seul bon sens, était porté autant au fantastique des contes qu’à la stylisation héraldique des légendes. « Chesterton est tout spontané, son tempérament l’emporte et le domine. Imagination aussi opulente qu’ingénieuse, sensibilité brûlante, puissance du tempérament, verve magnifique de l’esprit, et tout cela nullement livré à soi-même, mais gouverné, dompté, poussé d’un mouvement rectiligne jusqu’aux fins sévères de la discussion et de la démonstration par l’intellect le plus tranquille et le plus fort, tels sont les outils de ce fougueux polémiste ».
Polémiste ? Oui, notamment contre ces grands esprits libéraux de son temps que furent le chantre de l’Empire Rudyard Kipling, le scientiste H.G. Wells et le socialiste George Bernard Shaw. Gérard Joulié montre très bien aussi ce qui le rapproche et le distingue d’Oscar Wilde le dandy, et pourquoi Charles-Albert Cingria le mystique byzantin en appréciait à la fois l’humour et la folle poésie, ou encore l’énigmatique paradoxe du «cauchemar» romanesque d’Un nommé Jeudi où l’on découvre que le policier et le criminel sont le même homme…
« Il y a des époques où être sage c’est être fou, et Chesterton était ce fou-là », écrit Joulié moult preuves à l’appui (détaillant brièvement diverses œuvres du « fou » en question) et précisant justement que « le combat de Chesterton n’est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de méchanceté qui bataillent dans les cieux» et que sa rébellion est «l’insurrection de la campagne et de la terre contre la ville et le béton, celle du sang contre l’argent et de la main contre la machine».
L’antimodernisme fringant de Chesterton «lui vaudrait peut-être aujourd’hui une inculpation auprès du Tribunal international de La Haye», persifle encore Gérard Joulié, en concluant qu’«un réactionnaire est toujours un rebelle, un progressiste est toujours un conservateur : il conserve la direction du progrès et va dans le sens du courant»…
Mais encore ? Ceci : «Chesterton, au début du XXe siècle, se définit comme un démocrate anticapitaliste, antilibéral, antiparlementaire, antisocialiste et antimoderniste, dans la mesure où il prévoyait que le progrès technique, scientifique quantifiable, chiffrable, capitalisable et commercialisable allait dévaster la terre et la rendre inhabitable». Surtout, G.K. Chesterton fut un bonhomme poète et prophète qui avait l’élégance humoristique de l’espérance…
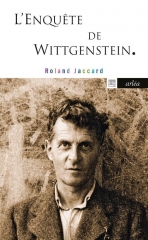 Le logicien qui croyait au diable plus qu’aux philosophes
Le logicien qui croyait au diable plus qu’aux philosophes
Si l’œuvre de Chesterton foisonne de paradoxes, c’est plutôt dans la vie de Ludwig Wittgenstein que ceux-ci ont de quoi nous stupéfier, bien explicités dans leurs tenants et aboutissants dans L’Enquête de Wittgenstein de Roland Jaccard, admirable approche d’un homme complexe, imbuvable à certains égards, ou disons plutôt «impossible» - et par exemple en hurlant à ses étudiants de Cambridge de «parler en silence» - et rappelant parfois la quête de perfection d’une Simon Weil prenant sur elle de travailler en usine, etc.
La formule de Wittgenstein, devenue cliché de salon ou de café philosophique, selon laquelle «ce qu’on ne peut dire, il faut le taire», fait sourire quand on pense aux 5868 livres et articles signalés par Ray Monk dans sa biographie et, au fil de celle.ci, à tout ce que dit Wittgenstein de lui-même dans son journal qu’on dirait parfois celui d’un très jeune homme se flagellant pour des riens comme un Amiel après la moindre »petite secousse ».
La pieuse congrégation des adorateurs du Maître n’a pas manqué de rugir lorsque tel auteur a colporté certaines rumeurs sur les écarts «sauvages» du grand logicien dans les mauvais lieux viennois ou anglais, alors que lui-même ne s’est jamais caché de ses préférences sexuelles en dépit d’un essai de mariage mal barré.
Quant à Roland Jaccard, loin de ces tortillements hypocrites du monde académique, il ne cède pas pour autant à un voyeurisme anecdotique ni à l’indélicatesse devant une vie marquée par de vraies tragédies familiales (trois des frères de Ludwig se sont suicidés) et maintes péripéties terribles, au terme desquelles, se laissant mourir de son cancer sans traitement, Wittgenstein affirmera avoir vécu «une vie merveilleuse».
Ni un « salaud » ni un saint, mais…
Ludwig Wittgenstein se traitait volontiers de « salaud » ou de « porc », avec une conscience du péché et une propension à la confession rappelant plus saint Augustin et Rousseau - deux auteurs qui l’ont passionné -, que le déballage psychologique encouragé par les psychologues et les analyste freudiens, alors même que ses débuts dans la vie a été marqué par l’écrasante figure d’un père despotique à côté duquel celui de Kafka fait pâle figure…
Roland Jaccard, à moitié Viennois par sa mère, détaille en connaisseur les liens profonds de Wittgenstein avec l’univers de la Vienne du début du XXe siècle, avec ces « monstres » fascinants que furent un Otto Weininger - jeune philosophe juif antisémite, homosexuel et misogyne, auteur du génial Sexe et caractère et suicidé à 23 ans, un Karl Kraus et son héroïque combat contre le pourrissement du langage par les idéologies, ou d’un Sigmund Freud, notamment. De la même façon, même elliptique, il montre la relation du jeune prodige avec Bertrand Russell, ponte majeur de la logique qui l’accueillit à Cambridge comme un (presque) fils en pointant aussitôt le « cinglé » avant de reprendre ses distances, alors que l’ « enquête » fondamentale évoquée par Roland Jaccard se situe ailleurs que dans la société philosophique locale ou les hauts sphères de la logique mondiale, à la recherche d’une vérité en constante rupture d’équilibre, devenant « expert dans l’art de résister aux jeux truqué du langage».
Paradoxe ? Ô combien, quand ce contempteur de la « racaille » paysanne » s’engage comme humble instituteur en Basse-Autriche, où il traite cependant ses élèves comme des bêtes à dresser avant de se traîner par terre pour s’en excuser. Intello claquemuré dans une solitude farouche ? Mais il s’engage au front où il multiplie les actes de courage. Ou le voici nettoyant à genoux, comme les novices de sainte Thérèse au couvent d’Avila, le plancher du logis qu’il partage avec un disciple-amant. Snob de trop bonne famille ? Mais il renonce aux millions de son héritage sans le distribuer aux pauvres (cela les pourrirait, pense-t-il) mais en fait profiter quelques écrivains dans la dèche. Réactionnaire dans son refus du progrès ? Mais obsédé par l’idée de s’améliorer lui-même. Incapable d’aimer ? Mais vivant des passions intenses et compliquées. Enfin, Disciple de Schopenhauer, il frôlera le suicide à diverses reprises et l’idée d’enfanter lui fait horreur, alors que Chesterton rêvait d’une maison jamais assez pleine de mioches, etc.
 Quand les amis se retrouvent à La Perle…
Quand les amis se retrouvent à La Perle…
L’épatante illustration de cette modeste chronique, signée Matthias Rihs, évoque la rencontre posthume de Gilbert Keith Chesterton et de Ludwig Wittgenstein dans le patio du petit hôtel La Perle, rue des Canettes, où Roland Jaccard vient jouer aux échecs tous les dimanches avec ses amis. La sculpture de la danseuse à la jambe leste satisfait doublement au goût de Roland et de mon vieil ami Gérard dont la carrière érotique a débuté à l’âge de 13 ans avec les petites Bretonnes offrant leurs charmes aux lycéens dans les parages de la gare Montparnasse.
À part son étincelant hommage à Chesterton, qui fait suite à une kyrielle de traductions de l’anglais parues à L’Âge d’Homme (de John Cowper Powys à Ivy Compton Burnett en passant par Gore Vidal, Samuel Johnson et trente-six autres), l’ami le plus réactionnaire qu’il m’ai été donné de rencontrer, est aussi l’auteur, sous le pseudonyme de Sylvoisal (contraction de lys et Valois…) de nombreux ouvrages où la poésie et la pensée danse, et plus particulièrement dans La Forêt silencieuse,merveilleux inventaire de la beauté et de la bonté de la vie constitué d’une seule phase…
Jouxtant le patio de La Perle, l’image de notre ami Matthias figure mes amis Roland et Gérard en train de boire un coup au bar. Réacs ou rebelles ? L’un et l’autre ont le même sourire défiant toute conclusion, vu que « ce qui ne peut se dire, il faut le taire » en laissant le troupeau braire…
Gérard Joulié, Chesterton ou la quête excentrique du centre. Editions Pierre-Guillaume de Roux, 155p, 2018.
La Forêt silencieuse. Le Cadratin, 267p. 2017
Roland Jaccard, L’Enquête de Wittgenstein. Arléa, 109p. 2019.