
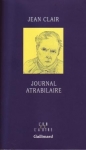
Journal atrabilaire de Jean Clair
« Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes », écrivait Julien Green dans son Journal, que Jean Clair cite à la fin d’une année (septembre 2004-2005) du sien.
Qui connaît Jean Clair, auteur de mémorables Considérations sur l’état des beaux-arts. Critique de la modernité (Gallimard 1983, 89 et 2005), entre trente autres livres où les artistes (de Bonnard à Balthus ou de Duchamp à Music) et leurs œuvre ne cessent de nourrir une réflexion de franc-tireur pétri d’humanité autant que de joyeuse sapience, se doute que le n’importe quoi dont il émaille cette année n’a rien à voir avec le foutoir des temps qui courent, où tout-y-va. Non : ce qu’il dit est vital. Pour la santé d’abord.
De fait c’est avec reconnaissance que le non-fumeur que je suis sans effort lit ces bonnes lignes, se jurant du même coup de se racheter demain un paquet de Lucky Strike :
« La phobie du tabac semble le stade ultime de cette désodorisation générale de l’Occident, voulue par la petite bourgeoisie du XIXe siècle, qui fait que nous sommes allergiques à toutes les fragrances, des plus fortes au plus subtiles. Mais aimer les odeurs, c’est aimer la vie pour accepter la mort, c’est respirer ce qui est décomposition, exhalaison, vaporisation des sucs pour goûter le plaisir violent de l’éphémère, qui nous habitue à mourir.
Mais nous repoussons la mort avec horreur.
Nous mourrons inodores, non pas pourtant en odeur de sainteté, puisque nous n’aurons pas vécu ».
Et d’illustrer ensuite les tabagies et les bamboches des Hollandais du Siècle d’or. Puis de rappeler, par contraste véhément, quel hygiéniste fut Adolf Hitler, ne fumant ni ne buvant mais prônant le totalitarisme médical. Ah ça, oui, demain, un pacson de Lucky’s !
Dans le même élan de verve, Jean Clair célèbre le chieur de livres, le Cagalibri statufié à Venise en la personne du patriote homme de lettres Nicolo Tommaseo, en lequel le peuple voit un homme qui « pousse » sa pensée sans réussir à la faire sortir, à l’instar du penseur de Rodin : « Tous deux, mélancoliques, trahissent le lien, connu depuis Galien, entre humeur noire, intellectualité et désordre intestinaux. Le cagalibri sert d’ailleurs le plus souvent de perchoir à un pigeon, qui couvre sans effort quant à lui son noble chef de fiente ». Et Jean Clair d’associer, à cette figure, celle du Dieu le père de l’ancienne imagerie, servant de perchoir à l’Esprit Saint.
Encore un livre-mulet : une des ces boîtes magiques dont chaque page nous fait multiplier les échappées. De l’armoire aux confitures de son enfance à Manhattan en été, des milliers de wagons observés à Auschwitz en 1915 par Stefan Zweig aux murs du quartier marseillais du panier où une main inconnue a graffité : « les filles, c’est comme de la chaucette, tu troues et tu gaïtes », Jean Clair saisit le n’importe quoi de la vie et en fait son miel.
Et pro domo cela encore : « Si lire le journal est la prière de l’homme moderne, écrire un journal est un acte de foi d’un ordre supérieur. On ne se contente pas de se mettre à l’écoute des autres pour se couler paresseusement dans le flot de l’Histoire. On se met à l’écoute attentive de soi pour s’en écarter, nager à contre-courant. On parie que la vie d’un individu, si banale et monotone, si pauvre soit-elle, touche, par sa simplicité même, à l’éternité.
Discipline que cette approche de la pensée du quotidien, quand il s’agit non d’en être traversé, mais de la saisir et de la formuler, de lui conférer une forme rigoureuse et si possible durable. Le Zibaldone de Leopardi est à cet égard le chef-d’œuvre absolu du genre. Mais qui a encore assez de courage, ou de mélancolie, pour s’astreindre à cet effort sans but ? »
Jean Clair. Journal atrabilaire. Gallimard, coll. L’Un et l’Autre, 223p.


 Anne-Marie Jaton au débotté
Anne-Marie Jaton au débotté r. On se sent ainsi tout proche de Charles Alavoine, respectable médecin qui a tué sa maîtresse après avoir été dominé par les femmes. »
r. On se sent ainsi tout proche de Charles Alavoine, respectable médecin qui a tué sa maîtresse après avoir été dominé par les femmes. » qui réside peut-être simplement dans l’existence de grenouilles grandes comme le petit doigt de la main...»
qui réside peut-être simplement dans l’existence de grenouilles grandes comme le petit doigt de la main...» écrit que « nous sommes des êtres fragiles et terrifiants, faibles et effrayants »…
écrit que « nous sommes des êtres fragiles et terrifiants, faibles et effrayants »…

 Maos de Morgan Sportès
Maos de Morgan Sportès Morgan Sportès. Maos. Grasset, 406p.
Morgan Sportès. Maos. Grasset, 406p.




 On pourrait conclure au gadget sur un premier regard, et pourtant cet ouvrage de vulgarisation gagne plutôt à la lecture attentive, qui révèle une sorte de bédé éclatée, avec textes explicatifs et autres montages photographiques rappelant les collages surréalistes, dont la visée déclarée est une introduction à la révolution freudienne mêlant éléments biographiques, approche des œuvres et concepts-clé.
On pourrait conclure au gadget sur un premier regard, et pourtant cet ouvrage de vulgarisation gagne plutôt à la lecture attentive, qui révèle une sorte de bédé éclatée, avec textes explicatifs et autres montages photographiques rappelant les collages surréalistes, dont la visée déclarée est une introduction à la révolution freudienne mêlant éléments biographiques, approche des œuvres et concepts-clé.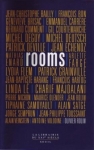 Les chambres d’hôtels sont riches de virtualités poétiques ou romanesques, comme l’a illustré la Suite à l’hôtel Crystal d’Olivier Rolin, jouant à la fois sur les lieux et les genres, et dont le présent recueil, sur une idée de Jorge Semprun, constitue la prolongation à plusieurs voix et sur les tons les plus divers. A l’invite de Rolin, vingt-huit auteurs que réunit juste son estime, auxquels s’ajoute un anonyme, évoquent ainsi autant de chambres d’une nuit ou d’un séjour, constituent autant de récits.
Les chambres d’hôtels sont riches de virtualités poétiques ou romanesques, comme l’a illustré la Suite à l’hôtel Crystal d’Olivier Rolin, jouant à la fois sur les lieux et les genres, et dont le présent recueil, sur une idée de Jorge Semprun, constitue la prolongation à plusieurs voix et sur les tons les plus divers. A l’invite de Rolin, vingt-huit auteurs que réunit juste son estime, auxquels s’ajoute un anonyme, évoquent ainsi autant de chambres d’une nuit ou d’un séjour, constituent autant de récits.
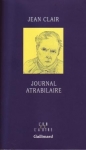














 En lisant Asiles de fous
En lisant Asiles de fous t mal, puis elle écrit : « Je ne connais pas les langues, aucune langue, de mes père, mère, ancêtres, je ne reconnais ni terre ni arbre, aucun sol ne fut le mien comme on dit je viens de là, il n’y a pas de sol où j’éprouverais la nostalgie brutale de l’enfance, pas de sol où écrire qui je suis, je ne sais pas de quelle sève je me suis nourrie, le mot natal n’existe pas, ni le mot exil, un mot pourtant que je crois connaître mais c’est faux, je ne connais pas de musique des commencements, de chansons, de berceuses, quand mes enfants étaient petits , je le berçais dans une langue inventée »…
t mal, puis elle écrit : « Je ne connais pas les langues, aucune langue, de mes père, mère, ancêtres, je ne reconnais ni terre ni arbre, aucun sol ne fut le mien comme on dit je viens de là, il n’y a pas de sol où j’éprouverais la nostalgie brutale de l’enfance, pas de sol où écrire qui je suis, je ne sais pas de quelle sève je me suis nourrie, le mot natal n’existe pas, ni le mot exil, un mot pourtant que je crois connaître mais c’est faux, je ne connais pas de musique des commencements, de chansons, de berceuses, quand mes enfants étaient petits , je le berçais dans une langue inventée »… conque pour connaître « le monstre », lui qui l'avait côtoyé en son adolescence, au collège de Linz ? Telles sont les questions qui se posent assez insidieusement à la lecture de ce (remarquable) petit livre, en lequel il faut voir une variation romanesque bien plus qu'un début de mise en accusation.
conque pour connaître « le monstre », lui qui l'avait côtoyé en son adolescence, au collège de Linz ? Telles sont les questions qui se posent assez insidieusement à la lecture de ce (remarquable) petit livre, en lequel il faut voir une variation romanesque bien plus qu'un début de mise en accusation.