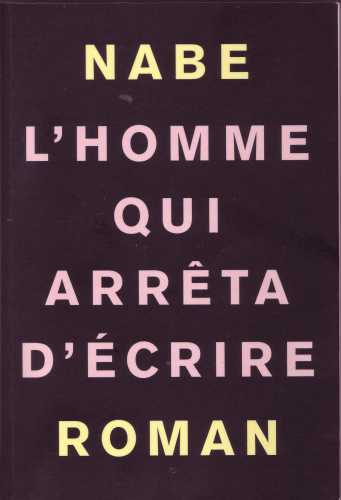Lecture de L'Homme qui arrêta d'écrire, de Marc-Edouard Nabe, en 7 épisodes (1).
C’est un peu à reculons que j’ai commencé de lire le dernier livre de Marc-Edouard Nabe, L’homme qui arrêta d’écrire, que Bernard de Fallois, me parlant avec enthousiasme d’un Satiricon parisien, m’a envoyé sous sa forme imprimée de pavé de 700 pages. Comme je l’ai dit à notre grand proustien, j’ai été des premiers nabophiles après la sortie d’Au régal des vermines et, surtout, de Zigzags, qui reste à mes yeux l’un de ses meilleurs livres, mais la suite de son œuvre m’a paru souvent inégale, avec de grands bonheurs d’écriture et des paquets de pages fameuses dans son Journal, sur une posture de fond qui m’a parfois exaspéré par sa morgue prétentieuse et son affectation d’écrivain «maudit», en cela proche des autres maudits autoproclamés à la Sollers, Dantec et autres Houellebecq. Bien entendu, je n'ai jamais souscrit à la foutaise réduisant Nabe à la dimension d'un petit facho alors que c'est, au pire, un anarchiste dandy hypercultivé et de puissant tempérament littéraire - une espèce d'arrière-petit-fils de Bloy mâtiné de célinisme christo-zizanique et jazzy...
°°°
Or, dès les premières pages de L’Homme qui arrêta d’écrire, il m’a semblé retrouver quelque chose du sale gamin pur et dur que j’aime bien chez Nabe, sous les dehors d’un semblant de vieux birbe désabusé, « jeté » par son éditeur et décidant par conséquent d’arrêter les frais pour commencer fissa de décrire, assez merveilleusement, la matinée de l’écrivain qui a cessé d’écrire et se trouve donc en parfaite disponibilité, ne sachant pas trop quoi faire et le faisant en toute liberté neuve : par exemple d’aller boire un jus au café d’à côté, un et même deux s’il vous plaît.
On le comprend vite au fil de cette première déambulation : le Nabe nouveau va se la jouer Huron, et bientôt il va se trouver un guide en la personne d’un jeune branché, dans un grand magasin de fringues, qui va l’aider à « dépouiller le vieil homme » et se re-saper de manière plus au goût du jour. Le garçon se prénomme Jean-Phi et pratique les nouvelles technologies en parfait enfant du siècle, blogueur et positif à outrance. Il a d’ailleurs, peu après leur rencontre, rencard avec une jeune internaute qu’il a draguée sur Meetic et qu’ils vont retrouver aux Tuileries. La mousmée, dyslexique, fait l’objet de plaisanteries verbales pas vraiment drôles, et l’intérêt fléchit un peu jusqu’à l’entrée du trio dans un hôtel voisin où se donne une performance sexuelle qui a cela de particulier que toutes les images vidéo-pornos qui s’y étalent le sont au dam des spectateurs interdits de la moindre jouissance par de vigilants vigiles. Telle est, de fait l'a-sexualité nouvelle.
L’observation se corse donc dans le bon sens et dépasse le commentaire un peu lénifiant de l’auteur, pour s’aiguiser ensuite, un jour plus tard, dans la visite d’un mégastore « concept » où Jean-Phi retrouve l’ex-écrivain, bonnement bluffé par ce souk de la branchitude où se vendent tous les gadgets imaginables de l’inimaginable futilité de l’International Shopping. On ne s’étonne pas de croiser Elton John au passage, et le passage sur le Supe-Lapin numérisé Nabaztag vaut aussi son pesant de pesos.
Question dinar, le festival se poursuit ensuite chez Sotheby’s où Jean-Phi a un petit « deal » à conclure avec un exemplaire authentique, pas moins, du premier jet du Voyage de Céline, tandis que la vente culmine avec la mise aux enchères d’un exemplaire des Fleurs du mal dédicacé par le crénom de Charles à Delacroix, qui monte-qui-monte à plus de 600.000 euros…
On touche alors à la page 100, et ça décolle « grave », avec un usage bienvenu du volapück contemporain et une suite d’observations carabinées sur l’esprit du temps qui recoupent, mais dans l’espace à 3D du roman, celles d’un Philippe Muray.
Bref, on se réjouit, à ce point, que Marc-Edouard Nabe ait cessé d’écrire, avant d’en redemander puisque son abstinence va se déployer sur 700 pages…
(À suivre)



 La situation pourrait être amusante, d’un Nabe en cessation d’écrire aux mains duquel son nouvel ami, le blogueur Jean-Phi, a filé la garde de sa toute petite fille Isaure dont il pousse le pousse-pousse dans la presse des écrivains afflués au Train bleu (brasserie chicos de la gare de Lyon comme chacun sait) pour un cocktail visant à marquer l’attribution d’un prix à la « meilleure langue » de France et environs, mais l’auteur s’essouffle autant qu’il trépigne en s’efforçant de se faire rire lui-même. On devrait pouffer et s’esclaffer à voir ainsi épinglés et égratignés les personnages les plus connus de la foire aux vanités littéraires parisiennes, des éminents critiques dont un Frédéric Ferney est déclaré le plus raté (on suppute qu’il na pas assez goûté le génie de MEN) aux auteurs plus ou moins homos ou homonymes (les Besson Pascal et Patrick), mais la sauce est aussi aigre que frelatée par la vanité blessée, on est décidément bien loin de Thackeray et loin aussi du délectable Scoop d’Evelyn Waugh, loin une fois encore des grands imprécateurs de gauche et de droite que furent un Bloy ou un Tailhade et autres Vallès.
La situation pourrait être amusante, d’un Nabe en cessation d’écrire aux mains duquel son nouvel ami, le blogueur Jean-Phi, a filé la garde de sa toute petite fille Isaure dont il pousse le pousse-pousse dans la presse des écrivains afflués au Train bleu (brasserie chicos de la gare de Lyon comme chacun sait) pour un cocktail visant à marquer l’attribution d’un prix à la « meilleure langue » de France et environs, mais l’auteur s’essouffle autant qu’il trépigne en s’efforçant de se faire rire lui-même. On devrait pouffer et s’esclaffer à voir ainsi épinglés et égratignés les personnages les plus connus de la foire aux vanités littéraires parisiennes, des éminents critiques dont un Frédéric Ferney est déclaré le plus raté (on suppute qu’il na pas assez goûté le génie de MEN) aux auteurs plus ou moins homos ou homonymes (les Besson Pascal et Patrick), mais la sauce est aussi aigre que frelatée par la vanité blessée, on est décidément bien loin de Thackeray et loin aussi du délectable Scoop d’Evelyn Waugh, loin une fois encore des grands imprécateurs de gauche et de droite que furent un Bloy ou un Tailhade et autres Vallès. Lecture de L'Homme qui arrêta d'écrire, en 7 épisodes (5).
Lecture de L'Homme qui arrêta d'écrire, en 7 épisodes (5).  Dans l’un de ses percutants essais, Philippe Muray en appelle à un
Dans l’un de ses percutants essais, Philippe Muray en appelle à un

 De fait, la poésie est le dernier mot de L’Homme qui arrêta d’écrire, et je sais gré à Bernard de Fallois, grand proustien et vieux complice de Georges Simenon, grand amateur de cirque et probable connaisseur aussi du rayon des Farces et attrapes, de m’avoir envoyé, de cet étonnant pavé « numérique », la version reliée à couverture noire et lettres roses et jaunes, en s’impatientant de partager son enthousiasme de jeune homme de quatre-vingt ans pour le livre du présumé infréquentable cinquantenaire, qui est aussi un beau livre d’amitié, de ferveur artistique et d’amour.
De fait, la poésie est le dernier mot de L’Homme qui arrêta d’écrire, et je sais gré à Bernard de Fallois, grand proustien et vieux complice de Georges Simenon, grand amateur de cirque et probable connaisseur aussi du rayon des Farces et attrapes, de m’avoir envoyé, de cet étonnant pavé « numérique », la version reliée à couverture noire et lettres roses et jaunes, en s’impatientant de partager son enthousiasme de jeune homme de quatre-vingt ans pour le livre du présumé infréquentable cinquantenaire, qui est aussi un beau livre d’amitié, de ferveur artistique et d’amour.