
Que se passe-t-il ? Et comment le dire ? Que nous arrive-t-il ? Qu’est-ce que le monde actuel ? Comment le décrire ? Que faire ?
 Telles sont les questions de toujours qui se reposent aujourd’hui aux écrivains de tous âges et de partout. D’un début de siècle à l’autre, le Que faire ? lancé en 1902 par Lénine se charge cependant d’un nouveau sens après la faillite des idéologies totalitaires et des utopies tous azimuts, alors que tout semble se relativiser dans l’universel micmac. Ainsi tel petit livre tout récent, du plus jeune de nos écrivains, Sébastien Meyer, vingt ans et des poussières, relance-t-il la question avec la candeur impatiente d’un enfant du siècle : « Que nous reste-t-il ? Que reste-t-il à faire qui n’ait déjà échoué ? »
Telles sont les questions de toujours qui se reposent aujourd’hui aux écrivains de tous âges et de partout. D’un début de siècle à l’autre, le Que faire ? lancé en 1902 par Lénine se charge cependant d’un nouveau sens après la faillite des idéologies totalitaires et des utopies tous azimuts, alors que tout semble se relativiser dans l’universel micmac. Ainsi tel petit livre tout récent, du plus jeune de nos écrivains, Sébastien Meyer, vingt ans et des poussières, relance-t-il la question avec la candeur impatiente d’un enfant du siècle : « Que nous reste-t-il ? Que reste-t-il à faire qui n’ait déjà échoué ? »
Lui répondrons-nous, comme tant de désabusés, que tout a déjà été fait, dit et écrit, et que plus rien n’est à attendre désormais ? Et pourquoi lui accorderions-nous la moindre attention ? Y aurait-il donc encore quoi que ce soit à découvrir ?
Ya t-il encore des Amériques à découvrir ?
C’est la question qui me revient avec la déferlante de chaque nouvelle rentrée littéraire, et cet automne 2010 l’aura relancée avec une ironie particulière puisque les traductions de l’américain y foisonnent en effet et que Prix Nobel de littérature est revenu au Péruvien Mario Varga Llosa. Mais les Amériques que nous rêvons encore de découvrir se bornent-elles à la littérature du Nouveau-Monde ? Sûrement pas !
 C’est ainsi que, ce matin d’été indien, l’une de mes découvertes porte le nom de Douna Loup, dont le premier roman, L’Embrasure, m’a ramené au seuil de mes Amériques, quand à seize ans j’ai commencé de lire, trouvé par hasard dans la bibliothèque familiale, ce gros bouquin dépenaillé, paru chez l’éditeur lausannois Marguerat et dont le titre, La Toile et le Roc, me semblait ne vouloir rien dire et m’attirait pour cela même, aussitôt captivé par la prose de ce Thomas Wolfe dont j’ignorais tout, et rebondissant bientôt à la vitesse des mots destination New York où grouillaient de toute évidence le vrai monde et la vraie vie.
C’est ainsi que, ce matin d’été indien, l’une de mes découvertes porte le nom de Douna Loup, dont le premier roman, L’Embrasure, m’a ramené au seuil de mes Amériques, quand à seize ans j’ai commencé de lire, trouvé par hasard dans la bibliothèque familiale, ce gros bouquin dépenaillé, paru chez l’éditeur lausannois Marguerat et dont le titre, La Toile et le Roc, me semblait ne vouloir rien dire et m’attirait pour cela même, aussitôt captivé par la prose de ce Thomas Wolfe dont j’ignorais tout, et rebondissant bientôt à la vitesse des mots destination New York où grouillaient de toute évidence le vrai monde et la vraie vie.
Douna Loup m’a tout de suite rappelé en outre, fût-ce à sa petite échelle de débutante, les Amériques de Céline et de La Bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic, les Amériques de Paul Morand et d’Agota Kristof, avec ses mots précis et inattendus , ses mots enfilés sur des cordes tendues ou des lianes souples, ses mots et ses phrases qui vont direct au corps et au cœur et à l’esprit et à l’âme puisqu’il y a à n’en pas douter une âme derrière les mots ou au bout des mots, avec autant de mystère.
La forêt du chasseur de Douna Loup m’a tout de suite rappelé la forêt de La Bouche pleine de terre, surtout quand le chasseur découvre celui qui s’est laissé mourir sous les arbres par goût de l’absolu.
Or cette forêt où s’enfuir se retrouve dans le petit livre de Sébastien Meyer dont le protagoniste aspire à « poursuivre le rêve d’une existence intense et vibrante jusqu’à l’agonie, jusqu’à l’épuisement total, jusqu’à l’anéantissement absolu ».
 Et la même forêt magique nous attend aussi au cœur des ténèbres incandescentes de Naissance d’un pont, dernier roman paru de Maylis de Kerengal, peut-être le plus beau livre français de cette année, dont la ville à la fois hyper-réelle et mythique , au bord du fleuve et au seuil de la forêt, dans le désordre organisé des hommes et sous le ciel immense, brasse le goût et le dégoût des hommes entre l’immanence et l’absolu.
Et la même forêt magique nous attend aussi au cœur des ténèbres incandescentes de Naissance d’un pont, dernier roman paru de Maylis de Kerengal, peut-être le plus beau livre français de cette année, dont la ville à la fois hyper-réelle et mythique , au bord du fleuve et au seuil de la forêt, dans le désordre organisé des hommes et sous le ciel immense, brasse le goût et le dégoût des hommes entre l’immanence et l’absolu.
Mes Amériques sont en effet liées à ce goût de l’absolu qui brasse les saveurs et le dégoût du monde, et c’est ce goût des choses rendu par les mots que vivifie immédiatement l’écriture inouïe (au sens propre de jamais entendue) de Douna Loup et de Maylis de Kerangal , ce goût des mots qui ont du fruit et de la bête dans ce monde où tout a un nom précis, jusqu’au mystère.
°°°
 Vous commencez de lire Aline de Ramuz - ce serait votre Amérique de naguère -, vous vous lancez à dix-huit ans et des poussières dans ce premier roman d’un tout jeune homme aussi, et vous vous le rappellez comme de ce matin : c’est ça, c’est là, c’est comme ça, la vie, la beauté et la cruauté de la vie sont comme ça, la vie de cette jeunote de peu qui s’amourache du fils du notable du coin, lequel la saute, l’engrosse et l’abandonne, la poussant finalement au suicide - c’est l’histoire de toujours et de partout, comme Roméo et Juliette à Vérone ou au village, tout ce qu’on apprend en rêvant d’Amérique pour buter sur la réalité qui est, en somme, le grand sujet de L’Embrasure et de Naissance d’un pont, la beauté et la cruauté de la vie et peut-être l’amour là-dedans qui se faufile comme la biche au bois.
Vous commencez de lire Aline de Ramuz - ce serait votre Amérique de naguère -, vous vous lancez à dix-huit ans et des poussières dans ce premier roman d’un tout jeune homme aussi, et vous vous le rappellez comme de ce matin : c’est ça, c’est là, c’est comme ça, la vie, la beauté et la cruauté de la vie sont comme ça, la vie de cette jeunote de peu qui s’amourache du fils du notable du coin, lequel la saute, l’engrosse et l’abandonne, la poussant finalement au suicide - c’est l’histoire de toujours et de partout, comme Roméo et Juliette à Vérone ou au village, tout ce qu’on apprend en rêvant d’Amérique pour buter sur la réalité qui est, en somme, le grand sujet de L’Embrasure et de Naissance d’un pont, la beauté et la cruauté de la vie et peut-être l’amour là-dedans qui se faufile comme la biche au bois.
 Trois sacrées bonnes dames nous ont beaucoup appris de la réalité, je veux dire : ces bonnes dames d’Amérique qui ont pour nom Flannery O’Connor, Patricia Highsmith et Annie Dillard, toutes trois réalistes à mort et suivant, chacune à sa façon, les voies impénétrables de la poésie : par le frénétique et joyeux exorcisme du mal dont la sainte et diabolique Flannery s’était fait la sarcastique spécialiste, par l’attention panique et médiumnique à la médiocrité quotidienne de la « poétesse de l’angoisse » que fut Patricia Hisghmith, selon le mot de Graham Greene, ou par la pénétration spirituelle et religieuse de tous les paradoxes de la nature animale, humaine ou cosmique telle que l’exerce la pensée inspirée d’Annie Dillard.
Trois sacrées bonnes dames nous ont beaucoup appris de la réalité, je veux dire : ces bonnes dames d’Amérique qui ont pour nom Flannery O’Connor, Patricia Highsmith et Annie Dillard, toutes trois réalistes à mort et suivant, chacune à sa façon, les voies impénétrables de la poésie : par le frénétique et joyeux exorcisme du mal dont la sainte et diabolique Flannery s’était fait la sarcastique spécialiste, par l’attention panique et médiumnique à la médiocrité quotidienne de la « poétesse de l’angoisse » que fut Patricia Hisghmith, selon le mot de Graham Greene, ou par la pénétration spirituelle et religieuse de tous les paradoxes de la nature animale, humaine ou cosmique telle que l’exerce la pensée inspirée d’Annie Dillard.
Notre besoin d’Amériques est un besoin vital de poésie qui est aujourd’hui nié par les bruyants, les distraits, les inattentifs que nous sommes tous plus ou moins. Cette poésie est immédiatement perceptible dans toutes les nouvelles de Flannery O’Connor, dans Les braves gens ne courent pas les rues ou dans Mon mal vient de plus loin, comme elle l’est dans l’épopée quasi légendaire des Vivants d’Annie Dillard, dont les pionniers réapparaissent dans Naissance d’un pont, dans les milliers de pages de Thomas Wolfe évoquant à la fois l’Ancien Testament et préfigurant la Trilogie américaine de Philip Roth, ou dans celles de Paul Morand dressant New York devant nous, dans la transe musicale du Voyage au bout de la nuit ou dans la fuite éperdue du désespéré de La bouche pleine de terre dont la sombre fable renvoie à celles de Faulkner.
 Tout communique sur la planète Littérature : tout n’est certes pas égal mais on peut s’imaginer qu’un seul livre se tisse par tous, qui raconte notre histoire commune, ainsi que l’exprimait John Cowper Powys : « Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables mais il ne pourra jamais voir Dieu, il ne pourra jamais vivre dans un présent, qui est le fils du passé et le père de l’avenir, sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature.
Tout communique sur la planète Littérature : tout n’est certes pas égal mais on peut s’imaginer qu’un seul livre se tisse par tous, qui raconte notre histoire commune, ainsi que l’exprimait John Cowper Powys : « Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables mais il ne pourra jamais voir Dieu, il ne pourra jamais vivre dans un présent, qui est le fils du passé et le père de l’avenir, sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature.
°°°
Le toujours incontournable Ramuz, rejetant toute idée d’une littérature nationale découlant d’une idéologie identitaire exclusive et fermée sur elle-même, n’en revendiquait pas moins, à la fin de la méditation fondatrice de Raison d’être, datant de 1914, la légitimité d’une littérature où l’ici et le maintenant ne fussent pas bornés par des frontières et autres drapeaux. « Mais qu’il existe, une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans leur inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part, si on veut, entre Cully et Saint-Saphorin, - que ce peu de chose voie le jour et nous nous sentirons absous. »
 Or il me plaît, en ce matin d’été indien, de marquer un fort contraste de générations et de mentalités en reliant ce « beau rivage » de Ramuz à l’actuel bourg lacustre de Cully où se passent, précisément, les épatantes nouvelles de Tam-tam d’Eden d’Antonin Moeri, à vrai dire fort peu soucieux de s’en tenir au « peu de chose » poétique de Ramuz, pour traiter une matière en somme «mondialisée», comme le fait aussi Jean-Michel Olivier dans L’Amour nègre. De fait, c’est bien loin de ce qu’on a appelé « l’âme romande », dont Ramuz a été le supérieur parangon avec Gustave Roud, que ces auteurs évoluent désormais, ces deux-là brillant particulièrement dans l’observation « panique » de la société contemporaine telle que la pratiquent un Bret Easton Ellis, dont L’Amour nègre s’inspire assez clairement, ou un Michel Houellebecq, duquel Antonin Moeri est également proche.
Or il me plaît, en ce matin d’été indien, de marquer un fort contraste de générations et de mentalités en reliant ce « beau rivage » de Ramuz à l’actuel bourg lacustre de Cully où se passent, précisément, les épatantes nouvelles de Tam-tam d’Eden d’Antonin Moeri, à vrai dire fort peu soucieux de s’en tenir au « peu de chose » poétique de Ramuz, pour traiter une matière en somme «mondialisée», comme le fait aussi Jean-Michel Olivier dans L’Amour nègre. De fait, c’est bien loin de ce qu’on a appelé « l’âme romande », dont Ramuz a été le supérieur parangon avec Gustave Roud, que ces auteurs évoluent désormais, ces deux-là brillant particulièrement dans l’observation « panique » de la société contemporaine telle que la pratiquent un Bret Easton Ellis, dont L’Amour nègre s’inspire assez clairement, ou un Michel Houellebecq, duquel Antonin Moeri est également proche.
Que se passe-t-il autour de nous ? Quelle mutation se prépare - quelle régression ou quelle avancée dont la littérature établie, notamment française, ne dit à peu près rien ? Mais aussi, qu’attendre des graves Cassandre qui concluent à la nullité de tout ce qui s’écrit aujourd’hui, tirant derrière eux l’échelle sacrée ?
Après avoir lu Naissance d’un pont de Maylis de Karanval et L’Embrasure de Douna Loup, comme en lisant Tam-tam d'Eden d’Antonin Moeri et L’Amour nègre de Jean-Michel Olivier, après avoir lu La carte et le territoire de Michel Houellebecq, je me suis dit ce jours, et je me le répète ce matin d’été indien : qu’il nous reste décidément des Amériques à découvrir – un vif besoin d’Amériques.
Ce texte constitue l'ouverture-manifeste de la prochaine livraison du journal littéraire Le Passe-Muraille. No 85, novembre 2010. Consultez notre site et abonnez-vous: http://www.revuelepassemuraille.ch/
Image: Philip Seelen





 Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »
Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »











 Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles.
Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles.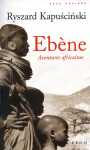 Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)
Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)





 Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent
Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent 

 Un inédit de Philippe Testa
Un inédit de Philippe Testa
 La solitude et la mort
La solitude et la mort
 Relire Céline: d'un voyage l’autre
Relire Céline: d'un voyage l’autre BRET EASTON ELLIS
BRET EASTON ELLIS
 Pour en savoir plus, abonnez-vous au Passe-Muraille ou commandez sa dernière livraison.
Pour en savoir plus, abonnez-vous au Passe-Muraille ou commandez sa dernière livraison.