
Aspects de Tom Ripley
On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers inquiétant se plaisant en eaux glauques, mais le personnage est beaucoup plus que cela : un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait ou calmé, même au clavecin.
Il faut lire la série des romans dans l’ordre de leur composition pour bien voir d’où vient Tom Ripley, survivant comme par malentendu à la disparition accidentelle de ses parents. C’est un peu la version thriller de L’homme sans qualités, dont l’écriture apparemment plate de Patricia Highsmith ne tisse pas moins un arrière-monde aux réelles profondeurs. Ripley l’informe rêve d’art et y accède par tous les biais, y compris le faux (l’invention de  Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit…
Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit…
Ripley est un humilié qui se rachète en douce, comme il peut, un pas après l’autre. C’est un peu par malentendu qu’il commet son premier meurtre, parce qu’un jeune homme l’a vexé, et pour tout le reste qui justifiait cet énervement du moment : tout ce que symbolisait ce fils de pute d’enfant gâté. Ensuite, le premier pas étant franchi (on croit savoir que le meurtre transforme l’homme en meurtrier) et que ce nouvel état suppose de nouvelles lois, Ripley va jouer avec celles-ci, parfois pour la bonne cause, selon l’expression consacrée, comme dans Ripley s’amuse, peut-être le meilleur de la série, qui a inspiré deux beaux films et deux interprétations (Bruno Ganz et John Malkovitch) dont la meilleure n’est pas celle de L’ami américain, il me semble, mais celle du troublant Malkovitch.
En lisant ces jours Sur les pas de Ripley, je retrouve cette atmosphère de voluptueuse angoisse si particulière, propre à l’auteur, qui m’évoque le besoin de se faire peur des enfants pelotonnés dans leur nid de souris. Il y avait de ça chez la vieille gamine, qui refusait en outre l’ordre des gens dits normaux commettant toutes les saloperies sans froisser rien de leur costume de gens au-dessus de tout soupçon.
Un jour que je lui demandais ce qui motivait selon elle les crimes, Patricia Highsmith m’a répondu que c’était cela presque toujours : d’avoir été humilié, de se sentir rejeté du bon camp, de n’être pas admis au vernissage…
Ce dont Ripley tire, sans trop le vouloir, tout à son instinct d’animal dénaturé, le parti qu’on sait. Puisqu’on ne l’invite pas, c’est lui qui s’invitera…
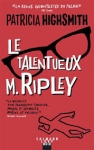



 Michael Connelly. Echo Park. Traduit de l’américain (toujours excellemment) par Robert Pépin. Seuil Policiers, 361p.
Michael Connelly. Echo Park. Traduit de l’américain (toujours excellemment) par Robert Pépin. Seuil Policiers, 361p.
 nous raconter le dernier roman traduit, Purple Cane Road, que je me suis procuré dare-dare pas plus tard qu’hier et dont j’ai lu déjà les trente premières pages.
nous raconter le dernier roman traduit, Purple Cane Road, que je me suis procuré dare-dare pas plus tard qu’hier et dont j’ai lu déjà les trente premières pages.