
Ou comment faire avec

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.



C’est entendu: la vie est formidable, se dit-on tous les matins au saut du lit en ouvrant ses fenêtres, même si celles-ci donnent sur une arrière-cour ou un champ de mines ou de ruines. On a besoin de ça: positiver à mort, sans quoi ce serait à désespérer ou à vous faire prendre la fuite fissa, comme c’est le cas de la jeune Alissa, la protagoniste de L'implacable brutalité du réveil, dans un quartier plutôt cool de Los Angeles, que submerge l’angoisse et l’envie de se défiler après la naissance de la petite Una, de même que Romain, fils aîné charmant d’une famille recomposée plutôt bien sous tous rapports, grand absent si présent dans Une famille,n’en finit pas de se tuer d’alcool depuis son adolescence.
Pascale Kramer est un écrivain (je le dis au masculin alors que sa tripe féminine me semble essentielle) dont la qualité de perception (ses antennes vibratiles) n’a d’égale que ses qualités d’expression – son écriture hyper-précise et ramassant tout le «réel» à la fois en phrases claires mais concentrées, et sa façon de parler du «quotidien» et des relations humaines est unique, même si, au top de la littérature contemporaine, on pourrait comparer son type d’observation à celui de deux Américaines relevant du même réalisme à la fois hard et soft, à savoir Laura Kasischke (56 ans pile comme Pascale) et Alice Munro leur aînée magnifique.


Mais qu’arrive-t-il donc aux gens? Pourquoi sont-ils comme ils sont et pas comme nous? Ou si nous sommes comme eux pourquoi ne les comprenons-nous si mal? Et merde: pourquoi ne nous comprenons pas mieux quand nous devrions nous trouver si normaux? Dans L’implacable brutalité du réveil, devant Una que tous trouvent tellement choute quelques semaines après sa venue au monde, voilà ce que se dit sa jeune mère dans son nouvel appartement dont elle n’arrive pas à se faire à la drôle d’odeur persistante: «Alissa ne pouvait concevoir qu’ils n’éprouvent pas cette douleur, insistante comme un chagrin, qu’ils puissent être légers et comblés devant cette vie entre leurs mains, cette inguérissable fragilité, avide, perdue, souffreteuse, incompréhensible». Et cette ingrate, limite hystérique, d’en rajouter encore: «Leur bonheur était tellement injuste, Alissa n’en revenait pas de ne même pas pouvoir leur faire partager sa peur».
Quand à la peur de Romain, dans Une famille, on n’en connaîtra que les causes supposées et les effets collatéraux, par ce qu’en disent ceux qui l’entourent: son beau-père d’abord, le raisonnable Olivier désormais retraité qui avait gagné son amitié en son enfance, sa mère Danielle qui ne se résoudra jamais à l’abandonner à sa déchéance, sa sœur cadette Mathilde dont il a trahi l’affection complice par trop de mensonges souriants, son frère Edouard qui croit le protéger, enfin son autre sœur Lou qui vient d’enfanter pour la deuxième fois au dam de sa petite aînée Marie crevant de désarroi jaloux. Mais la peur de quoi quand on est aussi bien entouré que Romain? Pourquoi cet irrépressible besoin de se détruire alors qu’il «a tout», comme Alissa «a tout» avec son gentil Richard qui la cajole et son adorable baby? Mais qu’ont-ils donc à se plaindre, ces enfants gâtés, alors que les Syriens en bavent et que Jim, de retour d’une putain de guerre américaine, se traîne sur ses prothèses en feignant la bonne humeur?
Pascale Kramer a toujours appuyé où «ça fait mal». Par complaisance morbide ou pour flatter le lecteur toujours curieux de flairer le malheur des autres? Je n’en sais rien. Pourquoi Barbara Cartland a-t-elle écrit tant de romans à l’eau de rose au milieu de ses petits chiens manucurés, et pourquoi Patricia Highsmith se plaît-elle elle au contraire à appuyer «où ça fait mal»? Pourquoi les personnages de Simenon, qui «ont tout» comme Monsieur Monde, prennent-ils soudain la fuite pour se retrouver sous les Tropiques ou à la rue? On n’en sait rien: mystère. Mais ce qui est sûr, c’est que les romans «durs» de Simenon ou les terribles nouvelles de Patricia Highsmith, comme les récits d’Alice Munro, de Laura Kasischke ou de Pascale Kramer, nous en disent plus sur l’humain, donc sur nous-mêmes, que toutes les romances destinées à dorer la pilule, passer le temps ou pagayer dans le vide - beaux mensonges pour croisières dansantes, avec cellule de soutien psychologique pour pallier toute «fêlure».
Or un écrivain, et le meilleur (voir Proust et Céline) est souvent le plus fêlé, se distinguant du spécialiste en réparations psychologiques ou sociales par sa façon de «prendre sur lui» et d’en faire quelque chose qui nous touche, autant que nous touche le sort d’Alissa et de Romain ou de tous les autres personnages de Pascale Kramer souffrant plus ou moins et se plaisant plus ou moins sur notre Terre «qui est parfois si jolie», comme disait l’autre…
La lucidité est une chose, mais dire la lumière qui émane des êtres et des choses est une autre affaire, et c’est précisément l’affaire des artistes et des écrivains qui ne se contentent pas de copie/coller le réel mais qui y ajoutent de la musique ou de la peinture, des mots qui chantent ou qui font chialer; plus de sens à ce qui semblait n’en pas avoir et plus de bonté dans un monde où les violents paraissent plus que jamais l’emporter.
Depuis Les vivants surtout (2000), mais avant déjà, Pascale Kramer n’a cessé de regarder ses semblables, nos prochains comme le disent les paroissiens, avec autant de lucidité que de tendresse souvent tendue, et ses histoires de famille nous ramènent à tout coup aux nôtres comme si, tout à coup, nous voyons chacun de nos proches sous le même verre grossissant, tantôt pour nous effrayer et tantôt pout nous radoucir...
Enfin plus que cela: la romancière en a fait un tissage verbal d’une beauté croissante, sans la moindre fioriture artificielle, à l’unisson de la beauté du monde et de la bonté des gens, qui dépasse la brutalité du réveil par la qualité de l’éveil…





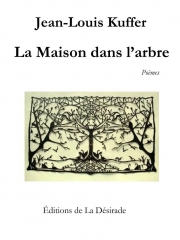


 (Le Temps accordé. Lectures du monde 2024)
(Le Temps accordé. Lectures du monde 2024)





 Publie.net accueille les listes de JLK. François Bon présente l'ouvrage.
Publie.net accueille les listes de JLK. François Bon présente l'ouvrage.

Le Printemps des poètes ! Quelle plus belle enseigne pour illustrer la vitalité de la poésie et la fraternité de celles et ceux qui l’aiment ? Or à la veille de sa prochaine édition (du 9 au 25 mars 2024), une polémique absurde, mais révélatrice de quel malentendu, agite ces jours le marigot politico-littéraire parisien qui voit en l’écrivain Sylvain Tesson, appelé à présider la manifestation, un personnage idéologiquement suspect, « icône réactionnaire » dont le portrait partial qu’on en fait prouve qu’on n'en a rien lu. Au lieu d’un débat légitime sur les rapports de la poésie avec la société, ou sur l’engagement politique des poètes: une mêlée de basse jactance sectaire relayée par les médias et les réseaux sociaux érigés en nouvelle instance de censure.
JEAN-LOUIS KUFFER
Le sieur Arthur Rimbaud, auquel Sylvain Tesson a consacré un généreux hommage « estival », aurait-il accepté, de son vivant, l’invitation d’être intronisé Prince des poètes ou mieux: Président de la confrérie des Vrais Poètes autoproclamés ?
Il est fort probable qu’à dix-sept ans il s’en fût réjoui en applaudissant des deux pieds, lui qui se fit un plaisir fouzraque de se faire détester des poètes parisien après avoir conchié les accroupis et vilipendé les assis et les rassis tout semblables à nos actuels « poéticiens » feignant de ne jurer que par lui.
Arthur Rimbaud, après la farce du Panthéon - pour citer une polémique antérieure -, dirigeant le Printemps des Poètes de la France binaire: quoi de plus allègrement bouffon, de plus inclusif dans le concept poétiquement printanier .
Ou l’« icône » devient cliché de langue de bois…
La figure du sacré que représentait naguère l’icône, devenue la représentation des plus viles idolâtries, annonce l’effondrement sémantique d’une notion gobée et régurgitée tous les jours par les vilipendeurs de la langue que sont devenus les techniciens de surface médiatiques et la meute mimétique des followers de tout acabit. Ainsi a-t-on fantasmé un Sylvain Tesson « icône de l’extrême-droite » comme on l’a fait de Rimbaud icône de la révolte adolescente ou de la mouvance gay en poésie, entre autres imbécillités réductrices.
Mais qu’est-ce donc que la poésie, et le sait-elle elle-même ? Qui aura jamais dit ce qu’elle dit de l’universel, que son chant investit depuis la nuit des temps, en termes qui ne soient pas trop vagues alors qu’elle est le contraire du vague et de l’imprécis, même lorsqu’elle divague apparemment ou semble délirer – quel discours, plus qu’en musique, remplacera-t-il jamais le chant ?
En contraste absolu avec ce qu’on peut dire le chant humain de toujours et de partout, qu’il soit d’imploration ou de déploration, hymne à la vie ou thrène de grand deuil, cantique des cantiques ou fulmination de l’éternel Job levant le poing au ciel, élégie de la nuit ou des jours sereins ; à l’opposé de ce qu’on peut dire l’émotion, laquelle suggère la réalité d’une ressemblance humaine qui échappe à toute explication ou justification utilitaire - et contre ce qu’on peut appeler la poésie au sens le plus accueillant et le plus profond, le discours dézinguant Sylvain Tesson, franc-tireur des grands espaces qui n’a jamais brigué le titre de prince des poètes ni de meilleur écrivain français que d’aucuns lui prêtent, aura saisi l'amateur sincère de poésie par la platitude et la médiocrité malveillante de ses formulations relevant de la jactance alignée et de la délation de mauvaise foi relayée à foison sur les réseaux sociaux bernés par la rumeur et la rhétorique sournoise du « pas de fumée sans feu »...
Lisez donc le texte misérable de la fameuse pétition et visez les auteurs attroupés si satisfaits d'eux-mêmes: cela des défenseurs de poésie, des esprits libres et des cœurs sensibles ?
À vrai dire, autant le fiel visant Sylvain Tesson que le miel dégoulinant sur la seule poésie poétique qui soit apparemment recevable sur visa politiquement correct, excluent tout débat éventuel sur la question d’une poie réellement engagée comme l’ont été celles d’un Nazim Hikmet ou d’un Ossip Mandelstam.
Fausse parole et vérités multiples
Je me rappelai les mises en garde du fameux essai d’Armand Robin intitulé La fausse parole, visant essentiellement le langage avarié de la propagande, justement figuré par l’expression « langue de bois », en lisant (ou relisant) ces jours, purs de toute idéologie partisane, La panthère des neiges, les nouvelles d’Une vie à coucher dehors, Les chemins noirs en leur traversée de la France profonde, Un été avec Rimbaud et le tout récent Avec les fées, célébration du merveilleux celtique à l’immédiat succès combien suspect n'est-ce pas ? Et combien suspecte, aussi bien, cette panthère aussi insaisissable qu’une femme de rêve, à le fois hyper-réelle et fuyante (comme l’amoureuse perdue que l’auteur évoque en sa quête), fascinante et cruelle comme toute la nature environnante ou la culture essaie de se ressourcer.
Quoi de passionnant dans ces marches au désert, ces immensités ou l’on se les gèle, ces apparitions de yacks fantômes ou de chèvres bleues que survolent des aigles sans scrupules humanitaires - quoi de glorieux dans ces errances aux chemins noirs de France obscure où le soûlographe d’un soir à gueule cassée par une guerre contre lui-même poursuit sa chasse aux fées loin des estrades ? Un écervelé, sur Facebook, croit y voir du « fascisme culturel », mais chacun en jugera sans ses lunettes en bois…
Prends garde à la beauté des choses, pourrait-on dire à la façon du délicieux Paul-Jean Toulet qui savait la merveille autant que son ombre, comme les compères Tesson et Munier (le photographe animalier qui l’a invité au bout de nulle part), avec deux autres bons compagnon de route, apprennent à chaque instant à mieux lire le livre du monde en son inépuisable poésie…
Quand le Dr Michaux calme le jeu en souriant…
Au lendemain de la mort du poète Henri Michaux, massivement méconnu du grand public, le journal Libération (!) publia, comme par défi (ferveur sincère ou sursaut narcissique de caste branchée ?), pas moins de douze pages d’hommage qui eussent probablement ravi l’intéressé de son vivant malgré sa légendaire défiance envers toute publicité.
Or c’est au farouche et génial explorateur d’ Ecuador et de la Grande Garabagne, étonnant voyageur-voyant avant la lettre, qu’il faudrait revenir aujourd’hui pour élever de quelques crans le « débat », même inexistant en l’occurrence, en exhumant deux textes de 1936 initialement parus en espagnol (un congrès du PEN-Club avait suscité la première de ces conférences) et respectivement intitulé L’Avenir de la poésie et Recherche dans la poésie contemporaine.
« Le poète n’est pas un excellent homme qui prépare à son gré des mets parfaits pour le genre humain », déclare Henri Michaux en évoquant la suite de recommandations solennelles qui ont été faites avant lui par les congressistes distingués, « le poète n’est pas un homme qui médite cette préparation, la suit avec attention et rigueur, pour livrer ensuite le produit fini à la consommation pour le plus grand bien de tous », et l’observation vaut aujourd’hui pour tous ceux qui voient en la poésie un accessoire du développement personnel ou du combat politique : « La bonne poésie est rare dans les patronages comme dans les salles de réunion politiques ». Et d’ajouter dans la nuance, à propos des « cas » de Paul Eluard et de Louis Aragon: « Si un homme devient fougueusement communiste, il ne s’ensuit pas que le poète en lui, que ses profondeurs poétiques en soient atteintes. Exemple : Paul Eluard, marxiste acharné, mais dont les poèmes sont ce que vous savez, de rêve , et du genre le plus délicat ». Et sur Aragon : « Un homme autrefois bourgeois mécontent, et grand poète, devenu militant communiste, dévoué à la cause comme personne, mais médiocre poète, ses poèmes de combat ont perdu toute vertu poétique ».
Tout serait à citer dans cette réflexion anti-dogmatique, qui inclut dans sa pensée l’humour et le sens commun. « En poésie, continue Michaux qui compare la fonction de sa corporation à celle d’un médecin virtuel, il vaut mieux avoir senti le frisson à propos d’une goutte d’eau qui tombe à terre et le communiquer, ce frisson, que d’exposer le meilleur programme d’entraide sociale». Est-ce dire que la poésie n’ait à s’occuper que de gouttes d’eau insignifiantes ? Pas du tout, et cela nous ramène au réalisme poétique de Rimbaud autant qu’aux veilles contemplatives de Sylvain Tesson en pleine nature : « Cette goutte d’eau fera dans le lecteur plus de spiritualité que les plus grands encouragements à avoir le cœur haut et plus d’humanité que toutes les strophes humanitaires. C’est cela la TRANSFIGURATION POETIQUE. Le poète montre son humanité par ses façons à lui, qui sont souvent de l’inhumanité (celle-ci apparente et momentanée). Même antisocial , ou asocial, il peut être social. »
Et de citer trois individus bien plus suspects, idéologiquement, que l’anodin Sylvain Tesson : « N’ayant pas sur l’art des vues d’instituteurs, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, personnages bien peu recommandables de leur temps, pourquoi représentent-ils, cependant, tant de choses pour nous et sont-ils en quelque sorte des bienfaiteurs ».
Au passage, - et plus loin cela rejaillira dans un double salamalec à son ami Jules Supervielle et à Paul Eluard -, l’on aura relevé le ton aimable et bienveillant du conférencier qui, dans le second texte, montrera avec autant de nuances amusées l’intérêt et les limites du surréalisme aboutissant parfois à un grand n’importe quoi dont nous voyons aujourd’hui les resucées. André Breton avant Jack Lang, postulait une sorte de généralisation du génie poétique faisant de chacun un petit Rimbaud ou une Rimbaldine à la Chloé Delaume visitée par la grâce. Or lisez, misère, la pauvre Delaume citée partout comme l’égérie de la fameuse pétition…
Le mérite majeur de Sylvain Tesson, s’agissant de Rimbaud, consiste à le citer, et c’est un bonheur estival qui fait oublier les printemps institués. De la même façon, avec un élan généreux qui exprime l’essence même de l’indéfinissable poésie dont ne nous parviennent, comme l’exprimait Gustave Roud, que des éclats du paradis, Henri Michaux cite ces vers mémorables d’Eluard à la fin du poème intitulé L’Amour la poésie : « Il fallait bien qu’un visage /réponde à tous les noms du monde », et ces premiers vers de Supervielle dans Les chevaux du temps : « Quand les chevaux du temps s’arrêtent à ma porte /j’hésite un peu toujours à les regarder boire /puisque c’est de mon sang qu’ils étanchent leur soif », etc.
Sylvain Tesson. Un été avec Rimbaud. Equateurs / Humensis – France inter, 2021.
Une vie à dormir dehors. Prix Goncourt de la nouvelle. Gallimard 2009. Folio.
La Panthère des neiges, Prix Renaudot. Gallimard, 2019.
Sur les chemins noirs. Gallimard, 2019, Folio 2023.
Avec les fées. Equateurs, 2023.
Henri Michaux. Œuvres complètes I. Bibliothèque de la Pléiade, 1998.

Chaque fois qu’ils se mettent à crier je sors dehors voir si j’y suis. C’est la meilleure tactique, avec un cigarillo, pour conserver un peu de bonne humeur sur cette terre qui est, parfois, si jolie – disait ma sœur.
Pendant ce temps, dedans, c’est la guerre. Pour ou contre la femme ou la cigarette, à fond contre les margelles trop étroites ou pour le développement durable des canaux d’évacuation de la Fantaisie : maudite Fantaisie, disent-elles, maudite Fantaisie disent-ils – la Fantaisie étant pour les uns et les autres l’ennemie à abattre avec le sérieux des papes, avec ou sans filtre.
À la fin, s’ils ne se sont pas tous assassinés, l’un d’entre eux décrochera le Grand Nobel et les autres pourront se vanter d’avoir partagé des masses de choses avec lui, au dam de la Fantaisie.
C’est tout le mal que je leur souhaite, moi qui pars en fumée.
Image: Philip Seelen.