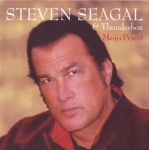Balades en jazz à travers une passion. Miles vient de paraitre
« Rien ne vaut l’enfance, une fois qu’on a été dispensé de jeunesse », écrit Alain Gerber pour qui l’enfance de l’art s’oppose pour ainsi dire à celle du premier âge, et dont la seconde naissance date de décembre 1958, lorsqu’un de ses profs de Belfort lui révéla soudain le jazz.
 «Tout ce que l’enfance fait mine de vous promettre, mais vous refuse avec acharnement – par exemple la bienheureuse ignorance, l’irresponsabilité et son corollaire, le goût du merveilleux», précise-t-il, « tout cela et davantage, le jazz me l’a offert en même temps que je me délivrais d’un coup de mes illusions passées ».
«Tout ce que l’enfance fait mine de vous promettre, mais vous refuse avec acharnement – par exemple la bienheureuse ignorance, l’irresponsabilité et son corollaire, le goût du merveilleux», précise-t-il, « tout cela et davantage, le jazz me l’a offert en même temps que je me délivrais d’un coup de mes illusions passées ».
A cette découverte, et surtout à l’aura mythologique de sa jeunesse de Vitellone belfortin, Alain Gerber a consacré ses deux premiers livres, d’un lyrisme rappelant celui de l’immense Thomas Wolfe (à ne pas confondre avec le Tom Wolfe du Bûcher des vanités), La couleur orange et Le Buffet de la gare. L’on y découvre notamment que le jazz fut pour le garçon, bien plus qu’une passion « parmi d’autres », l’expression la plus pure de toute une Amérique rêvée où les écrivains, de Faulkner à Hemingway, Scott Fitzgerald ou Ring Lardner, faisaient figure de personnages vivants autant que de révélateurs d’un « nulle part » plus habitable que l’ordinaire des jours.
« J’ai découvert au mois de décembre 1958, grace à Henri Baudin, The Man I Love de Miles Davis, Thelonius Monk, Milt Jackson, Percy Heath et Kenny Clarke, comme un chant tombé des étoiles, une eau lustrale versée sur moi du plus haut de la plus haute sphère, écrit Alain Gerber, qu’on sait l’un des plus grands connaisseurs français de la Chose. Pourtant ce n’est pas en spécialiste qu’il compose ces Balades en jazz : plutôt en amateur, au sens de celui qui aime. « J’ai tenté de faire croire le contraire (non sans un certain succès parfois, au oint d’en avoir tiré l’essentiel de ma subsistance) mais je n’ai jamais rien compris à cette musique, ou si peu ». Il dit avoir écouté The Man I Love des centaines de fois, sans en venir à bout. Autant dire qu’il parle du jazz comme d’un incompréhensible amour, dont le blues serait l’une des expressions les plus caractéristiques à cet égard, le blues qui « parle en images à ceux qui n’en comprennent pas les paroles ».
 Qu’on en se figure pas pour autant une passion pure entretenue les yeux au ciel, car le jazz a tantôt un « charme de gouttière » et tantôt une volubilité hugolienne (comme certaines pages de Gerber d’ailleurs, notamment quand il évoque le Chat qui pêche o ù il rencontre Stan Getz, son dieu tombé de son piédestal, pour un petit concert privé qui le marque à vie), tantôt se mue en confidence lancinante avec Chet Baker, qui vit sa dérive mortelle loin de nous et nous rejoint de sa double voix: « J’écoutais cette musique refaire le monde à son image, marcher toute seule quand la ville dort, marcher derrières les bruits de ses pas, traverser en dehors des clous, mêler son haleine au brouillard, ramasser les mégots de la nuit ».
Qu’on en se figure pas pour autant une passion pure entretenue les yeux au ciel, car le jazz a tantôt un « charme de gouttière » et tantôt une volubilité hugolienne (comme certaines pages de Gerber d’ailleurs, notamment quand il évoque le Chat qui pêche o ù il rencontre Stan Getz, son dieu tombé de son piédestal, pour un petit concert privé qui le marque à vie), tantôt se mue en confidence lancinante avec Chet Baker, qui vit sa dérive mortelle loin de nous et nous rejoint de sa double voix: « J’écoutais cette musique refaire le monde à son image, marcher toute seule quand la ville dort, marcher derrières les bruits de ses pas, traverser en dehors des clous, mêler son haleine au brouillard, ramasser les mégots de la nuit ».
Qu’il évoque New York ou les projections cinématographiques du jazz (plus que le Bird de Clint Eastwood, Honkytonk Man, où le jazz parle comme par allusion, au deuxième degré), les figures de Duke Ellington ou de Martial Solal, Louis Armstrong qui est un roman à lui seul (Alain Gerber l’a d’ailleurs écrit), du Paris jazzy de Henri Crolla, de John Lewis « minimaliste prodigue » ou de Kenny Clarke, parfait escort drummer qui « déteste les solos de tambour » mais habite le secret des dieux, Alain Gerber est essentiellement lui-même dans ces Balades en jazz, essentiellement écrivain, poète à sa façon de sanglier des Vosges, du genre vieux môme qui emportera ses jouets dans sa tombe vu que la mort, c’est connu, à un vieux faible pour le jazz.
Alain Gerber. Balades en jazz. Folio Senso (Inédit), avec une quinzaine de photos du meilleur choix, 141p.
Alain Gerber vient de publier un nouveau roman consacre a Miles Davis, sous le titre de Miles, chez Fayard.





 Yesterday comes, d'Ilene Barnes
Yesterday comes, d'Ilene Barnes

 Tracy Chapman au Montreux Jazz Festival. Après les électrochocs d’Eels, la chanteuse a fait oublier la touffeur du Miles Hall pris d’assaut par 2000 fans.
Tracy Chapman au Montreux Jazz Festival. Après les électrochocs d’Eels, la chanteuse a fait oublier la touffeur du Miles Hall pris d’assaut par 2000 fans. Le miel poivré de Holly Williams
Le miel poivré de Holly Williams