
Tzvetan Todorov vient de mourir à Paris, à l'âge de 78 ans. Je l'avais rencontré en 2005, à la parution des Aventuriers de l'absolu. Entretien pour honorer sa mémoire.
C’est un livre immédiatement captivant que le dernier ouvrage paru de Tzvetan Todorov, intitulé Les aventuriers de l’absolu et consacré à trois écrivains qu’il aborde, plutôt que par leurs œuvres respectives : par le biais plus intime de leur engagement existentiel.
La recherche de la beauté, dans le sens où l’entendaient un Dostoïevski ou un Baudelaire, liée à une quête artistique ou spirituelle, et aboutissant à un certain accomplissement de la personne, caractérise à divers égards ces pèlerins de l’absolu que furent Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke et la poétesse russe Marina Tsvetaeva. Sous un autre point de vue, ils se rejoignent également dans la représentation dualiste qu’ils se font de l’art et de la vie, comme si l’absolutisme artistique était foncièrement incompatible avec les nuances de celle-ci en son infinie relativité…
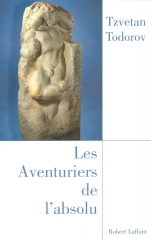
- Quelle a été la genèse de ce livre ?
- L’idée romantique qu’il y a une opposition entre l’œuvre de l’artiste et la vie reste très présente aujourd’hui. C’est une tentation que j’ai connue moi aussi, de croire que l’art est incompatible avec le quotidien. Lorsque j’étais étudiant en Bulgarie, j’étais attiré par la figure de l’artiste, de l’auteur ou de l’acteur, et j’ai d’ailleurs pensé, tout jeune que je deviendrais moi aussi écrivain, si possible génial. Puis je me suis aperçu que je serais plus doué pour l’essai que pour la fiction. La notion d’absolu, dans mon pays natal, se bornait alors aux idéaux du communisme, dont je me suis distancié dès ma treizième année, lorsque je suis entré dans le lycée russophone réservé à l’élite communiste, précisément. Un écrivain russe m’a fasciné durant ces années, et c’est le poète Alexandre Blok, dont l’oeuvre et la vie, les amours tumultueuses et ses relations difficiles avec la révolution en marche illustraient déjà cette figure du poète déchiré entre son idéal et la vie ordinaire.
- Quels critères vous ont-ils fait choisir Wilde, Rilke et Tsvetaeva ?
- Il s’agit de trois individus qui, sans être Français, se sont exprimés en langue française et ont été liés, plus ou moins, les uns avec les autres. Leurs postures respectives illustrent trois façons de pratiquer le culte du beau. Dans le cas de Wilde, ce qui m’intéresse est qu’il a été le chantre par excellence de l’esthétisme et que c’est dans la négation de celui-ci qu’il a atteint une vraie grandeur, notamment avec ses dernières lettres si poignantes, dont celle, écrite en prison, qu’on a intitulée De profundis. Sans être un très grand écrivain, Wilde exprime à la fin de sa vie des vues qu’on retrouvera chez Nietzsche. En ce qui concerne Rilke, je me demande si sa correspondance ne va pas rester comme un sommet de son œuvre, à la fois parce que c’est là qu’il va vers les autres tout en atteignant une concentration de présence et d’expression sans pareilles. Il y a dans ses lettres l’une des plus belles explosions verbales du sentiment amoureux, qui contredit à l’évidence sa théorie selon laquelle la vie ne mérite que d’être piétinée.
Quant à Marina Tsvetaeva, elle m’était naturellement plus proche du fait de ses origines slaves et parce que je la lisais en russe. Je l’ai approchée « au jour le jour » en établissant l’édition de Vivre dans le feu, après avoir fréquenté sa poésie des années durant. De ces trois auteurs, elle est naturellement la plus difficile à vivre, au point que ses amis les plus proches, comme un Mark Slonim, avaient parfois de la peine à se protéger de ses excès en même temps qu’ils s’efforçaient de la protéger d’elle-même. Avec sa détestation de la vie quotidienne, elle est évidemment celle des trois dont je me sens le plus éloigné…
- Est-ce à dire que la vie ordinaire vous importe plus que l’art ?
- Je ne suis pas en train de dénigrer l’idéal artiste de Tsvetaeva, mais je voudrais plaider pour une continuité liant la création artistique et le train-train de la vie quotidienne. Vous vous rappelez la position de Mallarmé dénonçant « l’universel reportage » et prônant une littérature purifiée de tout contact avec la réalité, toute vouée à la perfection formelle. Or je crains qu’en France Mallarmé ait vaincu. C’est vrai pour les écrivains, qui ont succombé à cette fascination formaliste, autant que pour les universitaires et la critique au sens large.
- Dans les années 60-70, vous passiez pourtant plutôt pour le critique des formes par excellence, surtout attaché aux structures du texte…
- Lorsque je suis arrivé à Paris, en 1963, c’est en effet la tendance inverse qui prévalait, donnant toute l’importance à la vie de l’auteur ou au contenu du texte, au détriment de ce qui le constituait. J’avais le sentiment d’un déséquilibre, que nous nous sommes efforcés de pallier, notamment dans la revue Poétique. Mais ni moi ni mon ami Gérard Genette n’avons voulu ce glissement vers le rejet du sens que j’ai tâché de corriger par un article, à un moment donné, qui s’intitulait La vérité poétique… et qui n’a jamais paru. D’où mon retrait de la revue, en 1979.
- Vos livres auront marqué, par la suite, une évolution nette…
- L’évolution de mes livres, à partir de La conquête de l’Amérique, en 1982, et ensuite avec Une tragédie française, notamment, s’est faite par étapes successives, en fonction d’une quête de sens qui devait me conduire, à travers l’histoire des idées et la ressaisie du choc des cultures que j’avais moi-même vécu, à préciser une conception du monde et une sorte de nouvel humanisme. Ayant échappé à la paranoïa de la société totalitaire, constatant un jour que je ne me retournais plus pour voir si j’étais écouté, libre de penser et d’exprimer ce que je pense, je me suis donné pour règle de penser ma vie en conséquence et de vivre ma pensée. Ceci dit, je ne me définis pas vraiment comme un écrivain. Je suis du côté de l’Histoire et des faits, non de la fiction, et le rapport que j’entretiens avec la langue est donc celui d’un essayiste écrivant.

- Dans quelle mesure le travail de votre compagne, Nancy Huston, a –t-il influencé ou été influencé par le vôtre ?
- Il est certain que notre vie commune, et donc nos travaux respectifs, ont été marqués par un grand partage de plus de vingt ans et des enrichissements réciproques. Il m’est pourtant difficile de dire ce qui, dans mon évolution, vient d’elle. Ceci tout de même, je crois : le souci de m’adresser à une audience moins spécialisée : disons au lecteur en général. J’admire énormément la conduite de Nancy en tant qu’écrivain, qui aspire à l’évidence à un absolu sans sacrifier pour autant les choses de la vie. Pour ma part, je me sens également « du côté de la vie », de plus en plus attentif aux nuances de celle-ci, à sa richesse, à sa variété, à sa fragilité et à son unicité.
 La part tragique d'Oscar Wilde.
La part tragique d'Oscar Wilde.
L’approche d’Oscar Wilde en son oeuvre et plus encore en sa vie est particulièrement appropriée, à l’évidence, pour distinguer les valeurs respectives d’un esthétisme de façade et d’une autre forme de beauté atteinte au tréfonds de l’humiliation, dont le bouleversant De profundis, écrit par Wilde en prison, illustre la tragique profondeur. D'emblée, Tzvetan Todorov s’interroge sur la stérilité littéraire dans laquelle est tombée l’écrivain après sa libération, en montrant à la fois, à travers ses écrits intimes et sa correspondance, comment l’homme blessé, déchu, vilipendé par tous et abandonné de ses anciens laudateurs (dont un Gide qui n’accepte de le revoir que pour lui faire la leçon), accède à une autre sorte de beauté et de grandeur, invisible de tous mais non moins réelle, comparable à la beauté et à la grandeur du dernier Rimbaud en ses lettres.
Sans misérabilisme, mais avec une attention fraternelle qui nous rapproche de ce qu’on pourrait dire le Wilde « essentiel », cuit au feu de la douleur, Tzvetan Todorov échappe à la fois au piège consistant à célébrer Wilde le magnifique et à considérer sa déchéance comme une anecdote corsée ajoutant à son aura, ou à déplorer sa mort littéraire sans considérer trop sérieusement ce qu'il a atteint au bout de sa nuit.
 Rilke ou la force fragile
Rilke ou la force fragile
Il est peu d’êtres qui, autant que Rainer Maria Rilke, donnent, et simultanément, l’impression d’une telle fragilité et d’une telle détermination, d’une telle évanescence et d’une telle concentration, d’une telle propenson à la fuite et d’une telle présence. L’être qui avait le plus besoin d’être aimé est à la fois celui qui esquive toute relation durable, comme si l’amour ne pouvait jamais réellement s’incarner, jamais composer avec ce qu’on appelle le quotidien. Comme Clara, épouse momentanée et amie d’une vie, artiste elle aussi et aussi peu faite pour s’occuper de leur enfant, Rilke pourrait sembler le parangon de l’égocentrisme artiste, et d’ailleurs il est le premier à se taxer de monstre, mais on aurait tort de réduire ses arrangements avec la matérielle, où mécènes et riches protectrices se succèdent de lieu en lieu, à une sorte d’élégant parasitisme dans lequel il se dorlote et se pourlèche. Cette manière d’exil, loin de la vie ordinaire, qu’il a choisi et qui lui rend pénible la seule présence même de ses amies, ou du moindre chien, le rend à vrai dire malheureux, autant que la solitude qu’il revendique et qui le déprime, mais tel est l’absolu auquel il a bel et bien résolu de consacrer sa vie, et « la création exclut la vie ».
La vie n’en rattrape pas moins Rilke, et pas plus que chez Wilde la beauté ne se confine dans les sublimités épurées de son œuvre. Certes le poète est l’un des plus grands du XXe siècle, mais le propos de Tzvetan Todorov ne vise pas une célébration convenue de plus : c’est ainsi dans les contradictions douloureuses, le mieux exprimées dans la correspondace du poète, qu’il va chercher un autre aspect de la grandeur émouvante de Rilke.
D’aucuns lui ont reproché, comme plus tôt à Tchekhov ou à Philippe Jaccottet plus tard, de se détourner du monde actuel pour se confiner dans sa tour d’ivoire. En passant, Todorov rappelle que ses élans « politiques », pour la Guerre rassemblant les énergies en 1914, la Révolution russe en 1917 où le Duce dont le fascine l’action dans l’Italie des années 30, en disent assez sur sa candeur en la matière. Or lui chercher noise à ce propos semble décidément mal venu...
Ses liens avec la réalité ne sont pas moins réels et puissants, comme ceux qui attachent Cézanne au monde et aux objets qu’il transforme. Le pur cristal de l’œuvre poétique de Rilke semble justifier aussi bien son exil, mais le mérite de Tzvetan Todorov est d’éclairer une partie moins « pure » de son œuvre: ses lettres surabondantes et combien éclairantes sur le drame personnel qu’il vit bel et bien. « Et le paradoxe est là, conclut Todorov : ces lettres, qui pour une grande part disent son incapacité de créer et sa douleur de vivre, sont une œuvre pleinement réussie, à travers laquelle vie et création cessent de s’opposer pour, enfin, se nourrir et se protéger l’une l‘autre ».
 Marina Tsvetaeva ou l’incandescence
Marina Tsvetaeva ou l’incandescence
La destinée tragique de la poétesse russe Marina Tsveateva, qui mit fin à ses jours (en 1941) après une vie où sa quête d’un absolu à la fois poétique et existentiel se trouva en butte à autant de désillusions que d'avanies, constitue le troisième volet du triptyque fondant la belle réflexion de Tzvetan Todorov sur les enseignements que nous pouvons tirer, plus que des œuvres respectives de trois grands écrivains : de la façon dont ils accomplirent leur quête d’absolu à travers les pires tribulations, dont nous pouvons retrouver les traces dans leurs écrits les plus personnels, à savoir leur correspondance.
La publication récente de la monumentale correspondance de Tsvetaeva et Pasternak peut être, après lecture du chapitre aussi émouvant qu’éclairant que Todorov consacre à la poétesse russe, une illustration particulière d’un des déchirements majeurs qu’elle vécut, entre ce qu’elle attendait de l’amour et ce que la vie lui en donna en réalité. Ses relations successives avec Rilke, qu’elle « rencontre » épistolairement par l’entremise de Pasternak, et qui la tient à distance alors qu’elle s’exalte à l’idée d’une possible « fusion », puis avec Pasternak, dont la rencontre effective est une terrible déconvenue, relancent chaque fois le même schéma, nettement plus trivial avec quelques autres jeunes « élus », de la révélation subite non moins que sublime, essentiellement nourrie par l’imagination de la poétesse, qui aime son amour plus que l’individu encensé, et d'un progressif refroidissement, jusqu'au rejet agressif.
A égale distance de l’esthétisme de Wilde et de l’angélisme de Rilke, Tsvetaeva eût aimé concilier l’art et la vie sans sacrifier les êtres qui lui étaient le plus chers, à commencer par Sergueï Efron, son mari passé des Blancs aux Rouges et qui finit, comme sa fille Alia, dans les camps staliniens, alors que son fils chéri tomberait au front avant sa vingtième année. De son exil parisien, où son génie intempestif rebutait à la fois l’émigration anticommuniste et les sympathisants de la Révolution, à son retour en Union soviétique préludant à ses terribles dernières années, Tsvetaeva aura vécu un martyre accentué par son intransigeance absolue, dont ses relations familiales explosives témoignent autant que sa lettre au camarade Beria…
« Personne n’a besoin de moi ; personne n’a besoin de mon feu, qui n’est pas fait pour faire cuire la bouillie », écrivait Marina Tsvetaeva dans une de ses lettres si poignantes de détresse, mais tel n’est pas l’avis de Tzvetan Todorov, dont la quatrième partie du livre, Vivre avec l’absolu, montre précisément en quoi nous avons besoin de tels êtres de feu, dont l’œuvre résiste à la corruption du temps et dont la vie aussi, les errances voire les erreurs, ont beaucoup à nous apprendre.
 Sur La littérature en péril
Sur La littérature en péril
Tzvetan Todorov est un grand lettré que sa nature puissante et douce à la fois ne pousse pas aux vociférations pamphlétaires, et pourtant son livre intitulé La littérature en péril, mène un combat très ferme aux arguments à la fois nuancés et clairs, ouvrant un vrai débat sur la littérature contemporaine, et plus précisément son enseignement et sa transmission, loin des polémiques parisiennes éruptives qui renvoient les uns et les autres dos à dos sans déboucher sur rien.
Que dit Tzvetan Todorov d’important ? En premier lieu: que la découverte de soi et du monde vivifiée (notamment) par la littérature, la lecture et le débat se transforme aujourd’hui en discours de spécialistes « sur » la littérature et plus encore : sur la critique, et plus encore : sur certaines approches critiques réduisant la littérature à tel ou tel objet ou segment d’objet. Ainsi les élèves d’aujourd’hui apprennent-ils « le dogme selon lequel la littérature est sans rapport avec le reste du monde et étudient les seules relations des éléments de l’œuvre entre eux ».
Cette approche est-elle à proscrire ? Nullement, sauf à constater qu’elle devient, sous prétexte de scientificité, la seule et l’arme d’un nouveau dogmatisme scolastique qui fait obstacle au libre accès des textes ou en réduit la portée, quand elle ne les châtre pas.
« La connaissance de la littérature n’est pas une fin en soi, mais une des voies royales conduisant à l’accomplissement de chacun. Le chemin dans lequel est engagé aujourd’hui l’enseignement littéraire, qui tourne le dos à cet horizon (« cette semaine on a étudié la métonymie, la semaine prochaine on passe à la personnification ») risque, lui, de nous conduire dans une impasse – sans parler de ce qu’il pourra difficilement aboutir à un amour de la littérature ».
Voici lâchée l’obscène formule : « l’amour de la littérature ». Horreur horrificque, qui s’oppose absolument aux « perspectives d’étude » qu’annonce le Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale, cité par Todorov qui a siégé lui-même au Conseil national des programmes: « L’étude des textes contribue à former la réflexion sur : l’histoire littéraire et culturelle, les genres et les registres, l’élaboration de la signification et la singularité des textes, l’argumentation et les effets de chaque discours sur les destinataires ». Ainsi les études littéraires ont-elles « pour but premier de nous faire connaître les outils dont elles se servent », ajoute Todorov : « Lire des poèmes et des romans ne conduit pas à réfléchir sur la condition humaine, sur l’individu et la société, l’amour et la haine, la joie et le désespoir, mais sur des notions critiques, traditionnelles ou modernes. A l’école, on n’apprend pas de quoi parlent les œuvres mais de quoi parlent les critiques. »
Tel est la première observation de Tzvetan Todorov dans La littérature en péril, qui commence très loyalement par expliciter sa trajectoire personnelle, du structuralisme « dur » de ses débuts, à l’enseigne duquel il a donné ses premiers travaux de spécialiste du formalisme russe, notamment, dans les années 60 et le compagnonnage de Barthes ou de Genette, jusqu’au moment, au milieu des années 70, où son goût pour les méthodes de l’analyse littéraire, s’est atténué au profit d’une vision beaucoup plus large des textes et du rapport à ceux-ci, qui l’on conduit à ces grands livres à valeur anthropologique que sont La conquête de l’Amérique, Face à l’extrême ou, tout récemment, Les Aventuriers de l’absolu.
Il y a beaucoup d’autres observations dans La littérature en péril, et beaucoup d’autres choses à en dire. J’y reviendrai en feuilleton dans ces carnets. Dans l’immédiat, je cite cette phrase qui paraîtra d’un « plouc humaniste » aux gardiens du temple doctrinaire et me semble, à moi, l’émanation même d’une passion à partager : « Si je me demande aujourd’hui pourquoi j’aime la littérature, la réponse qui me vient spontanément à l’esprit est : parce qu’elle m’aide à vivre. Je ne lui demande plus tant, comme dans l’adolescence, de m’épargner les blessures que je pourrais subir lors des rencontres avec des personnes réelles; plutôt que d’évincer les expériences vécues, elle me fait découvrir des mondes qui se placent en continuité avec elles et me permet de mieux les comprendre. Je ne crois pas être le seul à la voir ainsi. Plus dense, plus éloquente que la vie quotidienne mais non radicalement différente, la littérature élargit notre univers, nous incite à imaginer d’autres manières de la concevoir et de l’organiser. Nous sommes tous faits de ce que nous donnent les autres êtres humains : nos parents d’abord, ceux qui nous entourent ensuite ; la littérature ouvre à l’infini cette possibilité d’interaction avec les autres et nous enrichit donc infiniment. Elle nous procure des sensations irremplaçables qui font que le monde réel devient plus chargé de sens et plus beau. Loin d’être un simple agrément, une distraction réservée aux personnes éduquées, elle permet à chacun de mieux répondre à sa vocation d’être humain ».
Tzvetan Todorov. Les aventuriers de l’absolu. Editions Robert Laffont, 277p.
Lumières ! Editions Robert Laffont,
A lire aussi : l’autobiographie intellectuelle que constitue Devoirs et délices, paru en 2002 aux éditions du Seuil.
Et aussi : Marina Tsvetaeva, vivre dans le feu. Laffont, 2005.
Tzvetan Todorov. La littérature en péril. Flammarion, 94p.



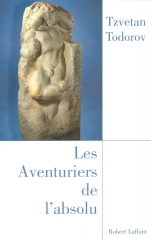

 La part tragique d'Oscar Wilde.
La part tragique d'Oscar Wilde. Rilke ou la force fragile
Rilke ou la force fragile Marina Tsvetaeva ou l’incandescence
Marina Tsvetaeva ou l’incandescence Sur La littérature en péril
Sur La littérature en péril 





 EDITORIAL
EDITORIAL


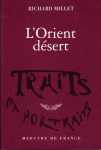





 Génocide platonique ?
Génocide platonique ?





