En lisant Faits, II, de Marcel Cohen
On se dit, tant il y a de choses, qu’il n’y a plus rien. On est saturé. On croule sous les livres. Trop de tout, et les voix s’y perdent, on n’entend plus rien qu’un vague brouaha. Plus de voix: autant dire plus rien
Et puis, comme toujours quand on allait renoncer, comme toujours il y a ce dernier recours, comme ce matin, sans crier gare, il y a cette voix, cette voix inconnue, cette voix aussitôt reconnue comme amie, cette voix que j’entends avant l’aube en lisant ces quelques pages de Faits, II de Marcel Cohen.
Je ne savais pas, jusque-là, qui était Marcel Cohen. Rien lu de lui. Pas même Le grand Paon-de-nuit. Grave lacune. Mais en le lisant je l’ai reconnue, cette voix amie. J’ai reconnu la voix que j’entends lorsque je reprends En ce moment précis de Dino Buzzati, lorsque je lis les essais nimbés de nuit de Pietro Citati ou lorsque je lis Max Dorra ou Annie Dillard, à chaque fois aussi que je lis un autre Marcel…
Marcel Cohen, dans Faits, II, parle de ces faits qui nous révèlent, l'humanité, et qui sont donc des débuts de fables. C’est par exemple ce château en Espagne dont une jeune femme a rêvé et qu’elle n’en finit pas de retaper en dépit de mille difficultés, et c’est notre vie. Ou ce sont ces mots recueillis d’un vieil homme qui vivait en bordure des voies de triage de Drancy, dont la femme dormait mal à cause des cris. Ou c’est ce que raconte un commandant au long cours qui peine à reprendre la mer. Ou c’est l’évocation du refuge de Clara Haskil dans la chambre 88 de l’hôtel Lutetia, précisément dans celle-ci où elle ignore que des cris ont été arrachés et pas une autre. Ou c’est cet enfant malmené par son père, dans la rue, qui se laisse traîner et que nous voyons se laisser tomber et retomber comme si on l’emmenait à l’abattoir, mais nous ne savons pas s’il feint ou s’il endure plus qu’on ne saurait dire – simplement le fait est là…
On lit quelques pages des Faits, II de Marcel Cohen, puis on en a pour une journée à songer. Une voix nous accompagnera tout le jour: cette voix inconnue mais amie. Disons un peu pompeusement : la voix de la question humaine, la voix de la bonté, la voix de la douleur ou de l’étonnement, la voix qui sourd de la nuit et du brouhaha – la voix de l’humanité…
 Marcel Cohen. Faits, II. Gallimard, 308p.
Marcel Cohen. Faits, II. Gallimard, 308p.
Carnets de JLK - Page 191
-
Une voix inconnue, cette voix amie
-
Ange et démon
Un roman russe, d'Emmanuel Carrère
Un écrivain a-t-il des droits spéciaux sur les siens ? Un secret de famille qu’il viole en fait-il un salaud ? Jusqu’où lui est-il permis d’exposer ceux qu’il aime au regard de tous ? Telles sont les questions que pose Un roman russe d’Emmanuel Carrère, lequel a choisi, malgré la prière instante de sa mère, de parler de la destinée tragique, et peut-être infamante, du père de celle-ci. La mère en question n’étant autre qu’Hélène Carrère d’Encausse, fameuse historienne de la Russie et actuelle secrétaire perpétuelle de l’Académie française, la transgression du secret revêt une signification particulière, sachant aussi que la grande dame a renoncé à une carrière politique de haut niveau du fait même des soupçons portés sur la fin de son père, vraisemblablement liquidé par des épurateurs en 1944, pour faits (non avérés) de collaboration.
Malgré les suppliques de sa mère, lui faisant valoir une double libération, pour elle autant que pour lui, et la condition de sa liberté d’écrivain, Emmanuel Carrère a donc choisi de « casser le morceau » sur les tribulations de son grand-père maternel, Georges Zourabichvili, en lequel il découvrira un sombre reflet de sa propre personnalité.
A vrai dire, les détails relatifs aux faits et gestes du père de sa mère, émigré russe mal adapté à la société française qui vécut le plus souvent loin de sa femme et de ses enfants, restent ténus. L’essentiel du portrait de cet intellectuel cultivé, naguère brillant mais incapable de s’accomplir, se dégage de lettres que le frère de sa mère remet à Emmanuel, à l’insu de celle-là. Il y apparaît comme un « homme du souterrain » à la Dostoïevski, cultivant la haine de soi. S’il trouve un emploi auprès de l’occupant allemand du fait de ses connaissances linguistiques, rien ne prouve qu’il fut collabo et pas plutôt victime de la délation pour de plus sordides motifs. Mais le doute ronge plus que la certitude.
La fiction dépassée par le réel
Un cliché réduit le « roman russe » à des embrouilles passionnelles sado-masochistes dont les « possédés » de Dostoïevski seraient un modèle. Or il y a de ça chez Emmanuel Carrère, dont on se rappelle la fascination qui l’a retenu, sept ans durant, sur L’Adversaire, chronique hyper-réaliste consacrée au mythomane assassin Jean-Claude Romand qui massacra toute sa famille après avoir vécu une double vie de prétendu grand médecin, dix-huit ans durant.
De la démoniaque affaire de Romand, qui l’a exténué, Carrère va rebondir ici dans une triple intrigue vécue dont son grand-père et sa jeune amante française Sophie seront les protagonistes, après un premier épisode russe non moins réel qui le voit, à l’occasion d’un reportage (dont est issu un film remarquable), approcher le dernier prisonnier vivant de la IIe Guerre mondiale, un vieil Hongrois perdu dans un asile psychiatrique de Kotelnitch.
« Je suis pour le réel, rien que le réel », écrit Emmanuel Carrère, dont le roman est truffé d’effets de réel, précisément, comme celui qui consiste à soumettre son amie à un jeu érotique pervers par le truchement d’une nouvelle publiée dans Le Monde. Mais ledit réel est parfois un romancier plus tordu que l’auteur d’Un roman russe, et notamment en Russie où une autre tragédie sanglante va précéder la fin misérable de sa relation passionnelle avec Sophie.
« Est-ce que j’ai tenté le diable ? Est-ce que c’est mon destin de le tenter, quoi que je fasse ? » se demande l’écrivain confronté aux conséquences bien réelles de ses dangereuses fictions. Nul doute, mais son excuse est alors de s’exposer lui-même jusqu’au bout, et d’expliciter enfin, dans une déchirante lettre finale à sa mère, le motif de sa transgression. « Tu t’es interdit de souffrir mais tu as interdit aussi qu’on souffre autour de toi », lui écrit-il ainsi. « Tu ne nous a pas niés, non, tu nous as aimés, tu as fait tout ce que tu as pu pour nous protéger, mais tu nous as dénié le droit de souffrir et notre souffrance t’entoure au point qu’il fallait bien qu’un jour quelqu’un la prenne en charge et lui donne voix »…
Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L. , 356p.
Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 20 mars 2007.
-
Notes au vol
Le conditionnel de notre enfance, c'était la clef des mondes. On serait sur une île. Toi, tu ferais les Indigènes et moi je serais Surcouf. J'arriverais de la mer, je débarquerais de ma caravelle et, sabre au clair, je te décimerais: “En garde. moricaud !”
Des mots, des images, des inscriptions qui bruisseraient dans l'air de la page comme les feuilles vibrantes d'un grand arbre à la fenêtre du soir. Tantôt un murmure, un chant, une mélodie, et tantôt une pensée qui s'envole soudain - mais d'où vient le souffle qui l'emporte Dieu sait où ?
C'est à leur capacité de pardon que je reconnais ceux que j'aime: toute rancoeur dissipée dès lors que nous reconnaissons le partage de nos fautes, et baste, ne nous quittons jamais que réconciliés.
A jamais lié au don de joie: le don des larmes.
Après qu'on a refermé le dictionnaire, les mots continuent de chuchoter. César fait la cour à césarienne, la diva feint d'ignorer la divette qui s'en soucie comme de colin-tampon, se sachant plus proche que l'autre de dividende et de divinité; et là-bas, dans les allées d'hiver, snow-boot snobe socque: “Mes snow-boots que j'avais pris par précaution contre la neige”. (Marcel Proust).Dessin d'Aloyse. Musée de l'art brut, Lausanne.
-
Le souffle de la vie
A La Désirade, ce 3 septembre 2006. – Minuit n’aura pas passé, ce jour d’achever Les bonnes dames, petit roman tendre et grave qui fait en somme le pendant, sur le grand âge, au Pain de coucou évoquant nos enfances et surtout la genèse d’une vision poétique, sans que j’entreprenne ici la transcription de mes carnets 2000-2006, représentant plus de mille pages dactylographiées et desquelles je vais garder la substantifique moelle quotidienne, à peu près une trentaine de pages par année, pour y ajouter les moments significatifs de mes lectures du monde, livres et rencontres, voyages, etc. Après la publication, en 2000, de L’Ambassade du papillon, reprenant mes carnets de 1993-1999 sans insertion aucune, l’original de mes notes se trouvant juste élagué, et celle des Passions partagées, en 2004, remontant trente ans auparavant (1973-1992), où j’ai développé une forme plus complexe, nécessitée par le chaos personnel de mes notes de jeunesse, la part faite à mes lectures étant alors beaucoup plus importante, je vais poursuivre assez naturellement dans ce volume, que j’intitule Le souffle de la vie, parce que c’est cela en effet qu’il m’importe de faire sentir dans ces pages, l’alternance de notes prises au jour le jour, arrimant la lecture aux faits saillants ou menus de mon actualité, et la reprise plus ou moins développée de mes lectures, dans une forme encore renouvelée par rapport aux deux premiers volumes, où l’écriture très rapide, liée à la pratique du blog, amènera quelque chose il me semble. Ce qui est sûr, c’est que mon écriture, dans ces carnets, poursuit un mouvement intime de plus en plus naturel, proche de celui du Rozanov des Feuilles tombées, consistant à capter les moindres bribes, soupirs, exclamations, chutes et rechutes, remontées, nuits et jours de notre vraie vie, qui est parfois le contraire de ce que pompeusement, littérairement on appelle La Vraie Vie.
-
Voir la musique
CHOSTAKOVITCH. – Je me demande comment écouter cette musique, et comment en dire quoi que ce soit ? Certaines musiques font parties de nous et en parler revient à parler de nous. J’entends en ce qui me concerne : le Bach de mes douze ans, claironnant sur le premier pick-up familial à l’enseigne de la collection Disco-Club, comme la machine à coudre Singer de ma grand-mère dans sa véranda donnant sur le parc aux volières - le Bach et le Mozart et le Beethoven, trio de base de la famille de base en pays protestant, avant le déboulé de la horde barbare dans les carrées adolescentes, Stones en tête.
Jusque-là Chostakovitch m’évoquait essentiellement du cinéma, style Russie de Parajdanov à la fonte des neiges ou Stalingrad en plein braoum, à l’exception de la 5e Symphonie dans laquelle j’étais entré au Japon durant la tournée de l’OSR de 1997 que j'avais suivie, mais c’est un univers insoupçonné que je découvre aujourd’hui : comme une partie de cosmos que soudain éclairent des projecteurs de guerre. Le ciel est donc encore plus réel qu’on ne croyait. C’est une sculpture dédaléenne en n dimensions dans laquelle on voyage comme un drone en retrouvant des formes inimaginées mais qui existaient pourtant en nous, sur quoi tout est à reconstruire : ça demande un effort. Alors au boulot, tovarichtch, ferme les yeux et tâche de voir de toutes tes oreilles…Olivier Charles. Soleil cosmique. Huile sur toile, 1978.
-
Dominique aux champs
Lettres de jeunesse de Dominique de Roux; un grand style à sa source.
Il y a des phrases qui respirent, qui pulsent et qui exultent, qui bondissent et retombent à tout coup sur la bonne patte, des phrases qui vivent et rebondissent de trouvaille en trouvaille, et c’est cela tout de suite qu’on se dit à la lecture des phrases de ce gamin de dix-huit ans qui écrit à sa tante Gabrielle de Lestapis en juin 1953 de Paris: « L’ombre froide du printemps, des éclaircie de bruit, de vent est partie. Et le ciel parisien est redevenu fidèle à son habitude ironique ». Le môme va passer bientôt son bac et il écrit en tâchant de s’en persuader : « Il faut travailler sinon par goût, au moins par désespoir pudique, tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s’amuser ». Mais bientôt il devra se justifier sans conviction après les « traumatismes post-opératoires du bachot » qu’il a loupé : « Je commence à croire que le bac est devenu, de nos temps, l’injuste privilège de bien des tristes sires ».
Dominique de Roux à dix-huit ans était un écrivain au style quasiment coulé dans l’or fin vibrant et fluide. Ses lettres à sa tante, les premières réunies dans ce recueil (1953-1977), sont d’une extraordinaire sûreté de plume, mêlant la grâce et le naturel, la tendresse pour sa destinataire et la rosserie pour leur entourage, enfin une capacité d’invention verbale, une puissance d’évocation bonnement saisissantes, à peu près à jet continu.
Dans le registre bucolique - car on découvre en effet un contemplatif amoureux de la campagne -, le jeune fils de famille (frère d’une floppée de garçons dont plusieurs mourront aussi tôt que lui) est d’un romantisme sans mièvrerie : « Je suis arrivé en Charente le soir même et je suis arrivé à la maison à pas lents par la vieille route, tout seul. Une bicyclette même m’aurait importuné. Je sentais venir une minute de génie : je veux dire de pleine conscience. Je sentais avec allègement qu’il ne ferait pas d’orage en montant ce vieux chemin entre les ronces, ces roses de village. Je me dégageais de ma manière, je me purifiais. Je regardais les alouettes. Un merle s’envola. J’ai cherché les tourterelles invisibles. Tout à coup, elles sont parties de l’arbre où je les entendais sans les voir. Voyez-vous, je n’aime que la campagne… »
Et plus loin, en août 53 : «Et je rêve dans cette campagne où les rayons du soleil automnal semblent s’attarder à plaisir sous un ciel déjà verdâtre, où des nuages flottent comme des continents en voyage. Depuis août, toujours le même ciel d’un bleu de blouse paysanne et qui déverse un flot de soleil et les prés qui étaient admirables, verts et doux à l’œil, bien couchés en long et en large, ces prés où pâturent des centaines de vaches qui n’ont pour limites que les bois, sont devenus vert de gri. Les « vacanciers » du bord de la Charente portent ventre ou poitrine en bandoulière, avec le charme infini et mystérieux qui tient dans la régularité et la symétrie de ces ostensoirs robustes, à l’air désoeuvré et nostalgique, ceux-là qui ne rêvent qu’Ambre solaire et ne savent pas goûter les ténèbres vertes dans les soirs humides de la belle saison. »
Plus loin encore : «Depuis, il a plu. Les arbres immobiles, anxieux, se sont agités bientôt de joie et leurs feuilles se sont bientôt offertes à la pluie comme des langues. Le temps a mal au cœur, mais c’est si agréable de voir la terre boire et de sentir ces effluves qui remontent des feuilles mouillées et du bois mort ».
Ce n’est qu’un tout début. C’est Dominique aux champs. Ensuite il y aura Londres. Ensuite il y aura l’Algérie. Ensuite il y aura des femmes et de grands projets littéraires, les débuts de L’Herne, Bernanos et Pound, ensuite il y aura la vie.
Je n’en suis qu’à la page 50 et déjà j’ai le sentiment d’avoir découvert un tout autre homme que celui que je connaissais un peu pour l’avoir rencontré, un peu plus pour l’avoir beaucoup lu, mais dont Jean-Luc Barré, qui a établi et préfacé ce recueil épistolaire, a mille fois raison de souligner le caractère éminemment secret, et par conséquent l’importance capitale de ces lettres en tant que « mémoires intérieurs… »
Dominique de Roux. Il faut partir. Correspondances inédites 1953- 1977.
Préface de Jean-Luc Barré. Fayard, 415p.
Dominique de Roux en 1970. -
Le point de vue du chat
Des chats et des hommes, de Patricia Highsmith
Lorsqu’on lui demandait de se situer par rapport à l’assassin et à sa victime, Patricia Highsmith prenait plutôt le parti du chat, c’est à savoir qu’elle invoquait un sens commun certes épris de justice mais plus encore soucieux des égards que chacun doit à un être vivant, qu’il soit roi de Birmanie ou chat siamois. C’était aussi, en somme, le point de vue de l’écrivain non sentimental mais capable des sentiments les plus délicats.
Dans Un truc rapporté par le chat, la première des nouvelles réunies dans ce recueil orné de quelques portraits de chats crayonnés par la romancière, une question morale est posée implicitement sous le regard d’un chat taiseux mais qui n’en songe pas moins peut-être (sait-on ?), laquelle consiste à démêler s’il faut absolument dénoncer le meurtrier, qui s’est lui-même désigné, d’un sale con, alors que les circonstances incitent à penser que l’élimination du fâcheux pourrait rester justement impunie. La conclusion de la nouvelle chiffonnera les vertueux, qui pensent qu’une vie est une vie et qu’un meurtre est un meurtre, mais le chat n’a fait que fournir l’indice et il se tamponne les coussinets de ce qu’il adviendra du meurtrier-justicier, du genre sympa.
La deuxième nouvelle implique plus directement le chat Ming, amoureux de sa maîtresse qui a le tort de l’être aussi d’un sinistre bipède prénommé Teddie. Ici, c’est le chat qui fait justice, et personne ne lui donnera tort.
Or faut-il donner tort, précisément, à l’éditeur de ficeler cet ensemble un peu bancal de deux nouvelles déjà parues en recueils (La proie du chat et Le rat de Venise, épuisés dit-on, mais pourquoi ne pas les rééditer ?), d’une nouvelle inédite en français qui sent tout de même le fond de tiroir (Le nichoir était vide), de trois poèmes qui n’en sont pas vraiment en dépit d’une ou deux fulgurances et d’un essai intitulé De l’art de vivre avec les chats qui marque bien, quoique sans originalité folle, ce qui distingue le chat du chien et de la machine à coudre ? Non, l’éditeur a raison : il fallait publier ce petit livre paru en allemand, à l’enseigne de la grande maison Diogenes de Zurich, qui détient les droits mondiaux de dame Patty, sous le titre de Katzen. Il ne faut pas que la France soit trop à la traîne de la Suisse allemande dans la défense de Patricia Highsmith, en attendant la parution de la grande biographie annoncée de celle-ci où l’on apprendra quelle chatte chaude était cette souris d'encre recuite d’ambre de scotch…
Patricia Highsmith. Des chats et des hommes. Traduit de l’anglais par Ronald Blunden, Calmann-Lévy,135p.
-
Les gens d'en face
 De ma fenêtre sur la rue, à l’Hôtel Bonaparte, je regardais les gens d’en face comme d’une loge de théâtre, en me rappelant le début de La fenêtre des Rouet, de Simenon, avec la vieille fille dont les séances de voyeurisme me sont comme l’évocation mimétique de l’observation du romancier lui-même.
De ma fenêtre sur la rue, à l’Hôtel Bonaparte, je regardais les gens d’en face comme d’une loge de théâtre, en me rappelant le début de La fenêtre des Rouet, de Simenon, avec la vieille fille dont les séances de voyeurisme me sont comme l’évocation mimétique de l’observation du romancier lui-même.
Savoir qui soupire à l’instant dans la chambre voisine, deviner ce que les gens d’en face se disent dans cette pièce aux murs mauves du plafond de laquelle pend une suspension à décoration de guipure (elle a l’air de la mère, lui du fils), imaginer ce qui se trame derrière les rideaux gris d’à-côté ne laissant voir que des ombres, et de l’autre à quel samedi soir se prépare cette femme encore jeune qui va et vient depuis une heure d’une pièce de derrière qui doit être sa salle de bain à la chambre éclairée donnant sur la rue - savoir tout ça... -
Nancy Huston grand angle

Défense de la « littérature-monde »
Son dernier roman, Lignes de faille, a enflammé le public et la critique: Prix Femina 2006, une quinzaine de traductions, plus de 220.000 exemplaires vendus à ce jour. Son œuvre illustre la « littérature-monde », dont elle a signé récemment le manifeste réunissant 44 écrivains de langue française.
Pour une littérature française plus ouverte au monde et plus nourrie de l’expérience commune; contre le parisianisme nombriliste et la survivance, dans la francophonie institutionnelle, d’un paternalisme relevant de l’ancien impérialisme français: telles sont, entre autres, les axes d’un manifeste lancé par Michel Le Bris, fondateur du festival Etonnants voyageurs, et Jean Rouaud, publié dans Le Monde des Livres du 15 mars dernier et signé par 44 écrivains de renom, au nombre desquels J.M.G. Le Clézio, Tahar Ben Jelloun, Edouard Glissant, Amin Maalouf et Nancy Huston.
- Qu’est-ce pour vous, Nancy, que la littérature-monde en langue française ?
- Lorsque Michel Le Bris m’a contactée pour que je m’exprime à ce propos dans un recueil-manifeste à paraître chez Gallimard, j’ai répondu de façon assez agressive en affirmant que je ne me sentais guère portée à faire, en français, l’éloge de la langue française, n’étant pas secrétaire perpétuelle de l’Académie française. De manière provocatrice, j’ai intitulé cela Pardon my french, en utilisant une expression qui, en anglais, signifie que vous allez proférer une grossièreté. Je disais ensuite que je n’aspirais aucunement à faire partie d’une francophonie littéraire et que j’en avais marre des étiquettes, que ce qui m’intéressait était la communication dans toutes les langues, de la circulation des émotions et des idées. Or Michel Le bris m’a rappelée pour me dire que j’enfonçais une porte ouverte puisque c’était son point de départ, et il m’a envoyé sa contribution qui représentait le manifeste en plus développé: un grand et beau texte qui m’a soufflée.Il y était dit, notamment, que tous les écrivains français n’aspirent pas à faire partie du cénacle parisien. Au contraire: que certains trouvent que les choses les plus intéressantes en langue française viennent souvent d’ailleurs ou d’origines mixtes. Par ma vie personnelle et par mes goûts littéraires, je me suis toujours sentie proche des gens qui ne sont pas enracinés mais divisés et qui ont plus d’un point de vue sur le monde. Je n’ai rien contre les littératures enracinées, mais je me sens plus proche des écrivains divisés ou « pulvérisés », comme un Romain Gary. Même un Sartre, qui prônait l’auto-engendrement, était fondamentalement enraciné, n’était-ce que par son ignorance des langues étrangères. Chaque fois que j’ai été en position de défendre la francophonie, je me sentais mal à l’aise. Je ne conçois pas que le fait d’être francophone ou francophile intervienne dans ma qualité d’écrivain. Au Canada, je suis une anglophone, et en France je ne suis pas une francophone. Je comprends certes le réflexe de défenses des francophones canadiens par rapport à l’océan anglophone qui les entoure, mais je garde la conscience du caractère mouvant de notre rapport à la langue et à l’identité, et par ailleurs j’ai toujours été opposée à toute forme de nationalisme agressif; les gens qui sont fiers d’eux et roulent les mécaniques me mettent mal à l’aise, mais je comprends que la francophonie au Québec doive être inscrite dans les lois. Cela n’est pas qu’une affaire de langue, mais d’histoire, de politique et de mode - de culture au sens large.
- Le Secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, a réagi violement à ce manifeste, en accusant ses auteurs de se faire les fossoyeurs de la francophonie. Comment réagissez-vous ?
- Il ne s’agit pas du tout de s’attaquer à la notion de francophonie, mais à la relégation de celle-ci dans les marges. Pour Michel Le Bris et Jean Rouaud, il s’agit de faire prendre conscience, aux écrivains français actuels, qu’ils font partie d’un ensemble beaucoup plus vaste et vivace. La littérature française n’est pas appelée à intégrer, ou non, les écrivains d’horizons divers, mais il faut au contraire qu’elle s’ouvre à l’étendue de la langue française dans le monde. Lorsque j’ai donné la deuxième version remaniée de mon texte pour le fameux recueil, je l’ai intitulé Traduttore non è tradittore, en faisant l’éloge de la traduction. Je fais partie des écrivains qui se traduisent eux-mêmes, autant qu’ils en traduisent d’autres. J’ai traduit divers livres vers l’anglais et d’autres dans l’autre sens et pense que la littérature est faite de ces échanges. En tant que femme, on semble encore plus porté à me mettre une étiquette. Lorsque j’ai eu le prix Femina, d’aucuns ont chanté cocorico pour la francophonie. Un michel Tremblay s'est félicité au nom du Québec. Ainsi de suite. Je ne prétends aucunement incarner « le monde », mais j’aimerais qu’on admette que la diversité de langue ou d’identité soit considéré comme un « plus », et non comme une façon de s’immiscer avec opportunisme dans telle ou telle culture. En ce qui me concerne, que ce soit en France ou au Canada, le fait que je pratique les deux langues et que je me traduise moi-même fait que je ne suis jamais du « bon côté ». L’autre chose que j’ai essayé de dire dans mon intervention, c’est qu’on a la nationalité des ceux qui nous aiment. Je me sens ainsi participer de la littérature francophone dans la mesure où, avec des livres traduits dans une vingtaine de langues, je suis beaucoup plus appréciée au Québec, en France, en Belgique ou en Suisse qu’aux Etat-Unis. Depuis 25 ans que je vais dans les groupes, les prisons, les écoles, je me suis immergée dans la culture française. Les Français pensent parfois qu’avec mon nom je suis une romancière célèbre aux Etats-Unis, ce qui n’est pas du tout le cas. Or il me semble qu’il est encore plus difficile, pour une femme, de faire admettre cette multiplicité.
- Qu’en est-il de votre propre rapport, intime, avec l’écriture en langue française ?
- Je choisis la langue en fonction de celle que parlent mes personnages, puis je me traduis. Lignes de faille est entièrement écrit en anglais, mais il n’a pas encore paru en anglais. Le premier chapitre n’a pas paru assez « politiquement correct » à mon éditeur de Toronto pour être accepté tel quel, et nous avons approché vainement une vingtaine d’éditeurs américains. Après le Femina, l'éditeur canadien s'est cependant décidé. Ce qui m’étonne, c’est que le regard de Sol, dans ce premier chapitre, n’est qu’un des aspects de l’image multiple que je donne de la réalité américaine. C’est en ce sens que je me sens appartenir à la culture française et à l'Europe des Lumières.
- Quel regard portez-vous sur la littérature française contemporaine ?
- J’en ai beaucoup parlé, déjà dans Professeurs de désespoir. Le nihilisme n’est pas, évidemment la seule tendance de la littérature française actuelle, mais on la voit très présente lorsqu’un Arnaud Cathrine, que j’apprécie beaucoup par ailleurs, est porté aux nues pour son décevant dernier roman, La disparition de Richard Taylor. Le consensus critique prône en effet la détestation des familles, la solitude orgueilleuse, le constat que la vie n’a pas de sens, que tous les liens humains sont des compromis. Par ailleurs, je suis peu attirée par l’autofiction. En gros, mon sentiment intime est que les écrivains français actuels ne se fatiguent pas, surtout la jeune génération. Ils se donnent de petites tâches et les remplissent bien, mais personne ne semble avoir le courage de se lancer dans une entreprise d’envergure, une vaste fresque qui demanderait un effort sur la durée, impliquant non pas de parler de la solitude mais de vivre dans la solitude. Cela dit je ne lis pas tout, mais ce n’est sans doute pas un hasard si un jeune écrivain comme Yann Apperry, l’auteur franco-américain de Farrago, m'épate par l'inventivité romanesque qu'il déploie, comme m'enthousiasme celle de Jonathan Safran Foer, dont la formidable liberté n’a guère d’égale en France. Aussi, je me sens beaucoup plus proche d’une Zadie Smith que d’une Christine Angot. Par ailleurs, mon identité mouvante ne m’empêche pas d’apprécier énormément une Toni Morrison, bien enracinée pour sa part. Enfin, vous savez, on se rend compte en voyageant que l’approche de la littérature est une chose très relative. Ainsi, me trouvant il y a quelque temps à Durban, je me suis rendu compte que mes petites histoires occidentales et européennes, dans Lignes de faille, intéressaient beaucoup moins les femmes africaines que mes positions d’essayiste sur la condition féminine…
Nancy Huston en dix dates
1953 - Née à Calgary, en Alberta (Canada anglais). Abandonnée par sa mère, l’adolescente suit son père aux Etats-Unis.
1973 - S’installe à Paris, où elle finit ses études, notamment auprès de Roland Barthes. Y rencontre le sémiologue et essayiste bulgare Tzvetan Todorov, dont elle partage la vie.
1979 – Premier essai: Jouer au papa et à l’amant. « Autant je ne regrette en rien mon engagement féministe, autant je suis critique à l'égard de mon gauchisme. »
1981 - Premier roman, Les variations Goldberg. Nancy Huston est également musicienne, pratiquant la flûte et le piano.
1993 – Prix du Gouverneur général (Canada) pour Cantique des plaines.
1996 – Prix Goncourt des lycéens et Prix du Livre Inter pour Instrument des ténèbres.
1999 - L’empreinte de l’ange obtient le Grand prix des lectrices d’Elle. Un choix de ses essais est réuni dans Désirs et réalités (1978-1994). Docteur honoris causa de l’université de Montréal.
2004 - Professeurs de désespoir, essai-pamphlet contre les chantres littéraires du négativisme.
2006 - Son roman Lignes de faille, grand succès de librairie, obtient le prix Femina. Une quinzaine de traductions en cours.
Une version raccourcie de cet entretien, réalisé à paris le 30 mars, a été publié dans l’édition de 24Heures du 3 avril 2007. -
Par delà le désespoir

Un jour comme celui-ci, de Peter Stamm
On pense à divers grands « types » littéraires en lisant Un jour comme celui-ci, dernier roman traduit de l’auteur alémanique Peter Stamm, qui a pourtant sa tonalité propre et sa qualité réellement unique.
Le protagoniste, prof d’allemand dans la banlieue parisienne depuis dix-huit ans, fait d’abord un peu penser à la fois au Meursault de L'étranger et au Roquentin de La nausée, entre autres anti-héros indifférents et proches du nihilisme, mais non moins attachants par leur seule présence. En l’occurrence, plus que cet Andreas fumeur et flâneur, qui passe d’une maîtresse à l’autre sans s’attacher à aucune, c’est son entourage, le climat dans lequel il baigne, et plus encore l’air de Paris qui retiennent le lecteur dans les moroses premières pages, avant que sa vie ne se transforme soudain, qui évoquera alors un autre désespéré de la littérature contemporaine, en la personne de Fritz Zorn.
Sous le regard délicat de Peter Stamm, dont l’écriture est admirablement poreuse, ce n’est pas à la révolte qu’aboutit la subite révélation du mal qui le menace de mort, mais à une sorte de conversion intérieure qui l’ouvre progressivement au monde et à un amour moins mesquin que ses passades, dans un mélange de mélancolie et de sensualité tendre qui est le propre de l’auteur.
Andreas se réveille un peu comme Ivan Illitch, dans la géniale nouvelle de Tolstoï, ou comme le protagoniste de Vivre, le film non moins bouleversant de Kurosawa, dont la vie bascule lorsqu’on lui apprend qu’il n’a plus que quelques semaines à vivre. Dans le cas d’Andreas, le sursaut ne sera pas d’ordre éthique, comme chez Kurosawa, ni d’ordre socio-philosophique, comme chez Tolstoï, mais il n’en irradie pas moins une sorte de lumière et de musique qui enveloppe la deuxième partie de ce roman d’une atmosphère à la fois mélancolique et tonifiante. Que la vie est belle et combien on l’a mal reçue et mal aimée, semble murmurer Andreas, qui ne change pas fondamentalement en apparence mais se bat à sa façon contre sa salope de maladie et qu’on sent se réconcilier peu à peu, avec autrui tant qu’avec lui-même. Tout cela que Peter Stamm filtre à fine touches, tout en sensibilité et en stoïcisme sensuel, jusqu’à cette dernière page rappelant le bonheur d’un certain Sisyphe où la caresse du vent parfumée sur le front de Meursault…
Peter Stamm. Un jour comme celui-ci. Traduit de l’allemand par Nicole Roethel. Christian Bourgeois, 208p.
-
Vers la littérature-monde


 Jonathan Littell, Nancy Huston et Alain Mabanckou
Jonathan Littell, Nancy Huston et Alain Mabanckou
vivifient la littérature de langue française
L’attribution de quatre prix littéraires des plus prestigieux, cet automne, à l’Américain Jonathan Littell (Prix Goncourt et Grand Prix du roman de l’Académie française), à la Canadienne-Française Nancy Huston (Prix Femina) et au Congolais-Français Alain Mabanckou (Prix Renaudot), fait figure d’événement significatif dans une France littéraire en perte de vitesse. Ainsi que l’auteur des Bienveillantes le relevait lui-même dans un entretien exclusif accordé au Monde (en date du jeudi 17 novembre dernier), les ténors de la littérature mondiale actuelle ne sont pas français mais le plus souvent issus de pays ou de grands chocs suscitent des œuvres fortes. C’est Amos Oz l’Israélien ou Orhan Pamuk le Turc, les Sud-Africains Nadine Gordimer ou J.M. Coetzee consacrés par le Nobel, Philip Roth et John Updike ou Joyce Carol Oates entre vingt autres Américains passionnants, le Nigérien Wole Soyinka ou le Portugais Antonio Lobo Antunes, et nous en passons. Cela ne signifie pas pour autant que la France littéraire actuelle soit sans intérêt, loin de là : les écrivains de qualité y foisonnent, mais les voix de portée « universelle » n’y sont plus, comparables à l’extraordinaire pléiade de la première moitié du XXe siècle, de Proust à Bernanos en passant par Céline, Gide, Malraux, Camus et tant d’autres.
Or, en dépit d’un indéniable creux de vague (y a –t-il aujourd’hui un seul grand écrivain français vivant de moins de 80 ans ?), le milieu littéraire français continue de pontifier comme si Paris restait le centre du monde et l’étalon du goût et de la qualité.
Il est cependant émouvant, et même admirable, qu’à une époque où toute une société littéraire française tend à disparaître, avec ce qu’elle avait de peut-être désuet mais aussi de fidèlement respectueux, le roman d’un jeune Américain soit couronné par deux académies. Est-ce à dire que Jonathan Littell renouvelle notre langue ? Nullement. En revanche, c’est bien dans notre langue que le jeune écrivain produit Les Bienveilllantes, cette œuvre puissante et dérangeante qui exorcise la double régression des crimes collectifs du XXe siècle et de l’éternel inceste, en invoquant les sources de la tragédie grecque. S’il ne réinvente pas notre langue, Littell la tire vers l’universel et sans doute cela fera-t-il voyager son livre autour du monde. D’une façon analogue, ce n’est pas l’originalité d’un style qui vaut la reconnaissance à Nancy Huston mais la même haute ambition de retracer quelques destinées individuelles à travers le même XXe siècle. Enfin, la source de l’Afrique ancestrale irrigue l’imaginaire et la langue d’Alain Mabanckou, avec une vitalité que trop souvent Paris sous-estime, comme il en va de tant d’œuvres francophones.
Lors du Festival de littérature francophone qui se tint ce printemps à l’enseigne du Salon du livre de Paris, Bernard Pivot s’est félicité, en présence d’Alain Mabanckou qu’il a défendu dès ses débuts, de l’enrichissement de la littérature française par ses « périphéries ». Reste à constater que lesdites « périphéries » pourraient bien devenir centrales, au dam d’écrivains français de France qui continuent de se considérer comme le nombril de la République des lettres. Ainsi, au frileux frisson d’horreur qui secoue l’académicien ex-avant-gardiste Alain Robbe-Grillet lorsque Tahar Ben Jelloun se risque à lui demander s’il se tient lui-même pour francophone, s’oppose l’ouverture au monde, la générosité et le sérieux d’écrivains « multiculturels » qui revivifient la littérature en train de se faire.Cette chronque a paru dans l'édition de 24Heures du 25 novembre 2006.
A suivre ces tout prochains jours: un entretien avec Nancy Huston sur le thème de la littérature-monde, réalisé le 30 mars 2007 à Paris
-
Théâtre sous le drap
La Chambre, de Philippe Bonilo. Premier roman, fine merveille...
«Sais-tu quelle est ma grande terreur?», lui demande-t-elle.
Et lui de répéter sans point d’interrogation: «Ta grande terreur».
Alors elle: «Pas tant de vieillir que d’être amenée en avançant dans l’âge, même si je m’améliore, même si je me rapproche de ton idéal de femme, à trahir celle que je suis aujourd’hui, heureuse, à toi. Je déteste cette femme accomplie que je serai demain, car tu la préféreras à moi, et que tu auras de bons motifs pour qu’il en soit ainsi.»
Et lui: «Je t’aimerai toujours».
Alors elle: «Ce n’est pas une consolation, tu me suivrais jusqu’à la mort, comme le petit chien perdu que tu es».
Il est le plus avancé en âge, elle presque une femme enfant dont il aimerait pourtant des enfants, mais elle veut tout et rien que le présent à présent: «Si tu m’aimes, tu peux, mon préféré, mon choisi, me rendre éternelle, ne t’endors jamais, regarde-moi toujours, ne t’éloigne de moi pas plus loin que de la longueur de ton bras, écoute-moi respirer, contemple-moi, veille sur mon sommeil, ne m’abandonne pas à mes démons, parle-moi, parle-moi sans cesse, fais-moi jouir chaque fois que tu me prends et plusieurs fois à la suite, comme tout à l’heure, mon bel étalon, c’est mon dû, je veux de beaux orgasmes».
Ils sont deux dans la chambre, lui et elle. Leur parole alternée dit tout comme au théâtre de sous le drap, dans une lumière douce, à la fois obscène et chaste. Ils jouent à se découvrir en se racontant ce qu’ils faisaient tel jour de leur enfance, ils jouent à se faire peur pour se conforter dans l’évidence qu’ils s’aiment plus qu’ils ne se le figurent, ils sont alternativement le faible et le fort, l’enfance et la vieillesse, ils ne cessent de parler et c’est une musique, c’est le silence des peaux et des regards, c’est le babil des lèvres et des paupières.
Lui: «Tu es plus désirable que jamais, tout éclairée de l’intérieur».
Elle: «Sommes-nous d’après toi en train de faire l’amour?»
Lui. «En bavardant de la sorte?»
Elle: «Oui.»
Lui: «Oui.»
Elle: «Alors pourquoi tu te tais?»
Lui: «Je pense à toi».
Elle: «Ne me pense pas, regarde-moi, prends-moi comme je suis, quand tu penses à moi, j’ai comme une absence, je cris que tu m’ignores».
Lui: «Jamais je n’ai vu personne avant toi».
Elle sans point d’interrogation: «Pas même ton visage dans la glace».
Lui: «Pas même».
Alors elle: «Tu as tort, tu es beau, j’aime me regarder dans la glace, ça m’excite comme si je voyais quelqu’un d’autre, tu trouves que je suis trop sexuelle, c’est beau un corps nu, se dire que c’est le sien, c’0est encore pire, tu sais pourquoi, monsieur je sais tout?»
Lui: «Demande-le au pape, il te répondra»…
Il y en a comme ça 66 pages, d’une eau limpide et vive qui traverse une intimité partagée pendant une vie entière, car la jeune femme enfant est à la fin une femme mûre qui a enfanté et par la chair et par l’imagination de tout ce qu’il est possible d’imaginer entre deux amants éternels piégés dans la chambre du Temps.
C’est le premier livre de Philippe Bonilo. C’est un chant d’amour dont l’immanence radieuse, mais incarnée donc cernée de vertiges et voilée de mélancolie, est ressaisie poétiquement par l’architecture même du dialogue. Cela existe dans l’instant donné et dans le Temps déployé. C'est une fine merveille qui vaut toutes les têtes de gondoles du moment…
Philippe Bonilo. La Chambre. Arléa. 66p.
-
Fantaisies de Stendhal

Les Privilèges, ou ce que God en accordera...
« Mon souverain plaisir serait de me changer en un long Allemand blond et me promener ainsi dans Paris », écrivait Henri Beyle dans son journal, mais le premier des vingt-trois articles réunis sous le titre de Privilèges, qu’il jeta sur le papier d’un jet le 18 avril 1840 à Rome, deux ans avant la crise d’apoplexie qui le terrassa, est plus immédiatement explicite dans sa requête à God : « Jamais de douleur sérieuse, jusqu’à une vieillesse fort avancée ; alors, non douleur, mais mort par apoplexie, au lit, pendant le sommeil, sans aucune douleur morale ou physique. » On constate post mortem que God fut bon prince en matière de conclusion, mais la suite de ces requêtes sera plus inattendue, voire délirante, au point d’y faire voir à certains du rimbaldisme avant la lettre, alors que Jean Starobinski y décèle un texte faustien.
S’il ne lésine pas sur l’utopie, Stendhal aimerait que les privilèges accordés par God fussent discret : « Les miracles suivants ne seront aperçus ni soupçonnés par personne ». Dès l’article 3, l’amoureux quelque peu défaillant qu’il est devenu se montre à la fois précis et nuancé en attendant le viagra : « La mentula, comme le doigt indicateur pour la dureté et pour le mouvement, cela à volonté. La forme, deux pouces de plus que l’article, même grosseur. Mais plaisir par la mentula, seulement deux fois la semaine ». La suite est plus originale : « Vingt fois par an le privilégié pourra se changer en l’être qu’il voudra, pourvu que cet être existe. Cent fois par an, il saura pour vingt-quatre heures la langue qu’il voudra ». Là ça devient le rêve : parler tous les trois jours le tahitien ou le télougou, le malayam ou le sumérien…
Les vœux de Stendhal ne sont pas que physiques et moraux, puisque « tous les jours, à deux heures du matin, le privilégié trouvera dans sa poche un napoléon d’or, plus la valeur de quarante francs en monnaie courante, d’argent du pays où il se trouve ». De surcroît, le privilège du privilégié rebondira parfois sur autrui ou sur l’animal : « L’animal monté par la privilégié ou tirant le véhicule qui le porte ne sera jamais malade, ne tombera jamais ». Inversement, une certaine bague et une certaine formule permettra au privilégié de se débarrasser, à six mètres à la ronde, des puces et des morpions, rats et raseurs, comme il pourra changer un chien en une femme belle ou laide, selon l’humeur ou l’usage.
Ces folles requêtes se parent, ici et là, d’une aura mélancolique, comme celle de l’article 20 : « Le privilégié ne sera jamais plus malheureux qu’il ne l’a été du 1er août 1839 au 1er avril 1840 ». On se rappelle que ces Privilèges furent rédigés le 10 avril 1840…
Il faut citer aussi tout l’article 21 pour évaluer le départ et les nuances de ces requêtes : « Vingt fois par an, le privilégié pourra deviner la pensée de toutes les personnes qui sont autour de lui à vingt pas de distance. Cent vingt fois par an, il pourra voir ce que fait actuellement la personne qu’il voudra ; il y a exception complète pour la femme qu’il aimera le mieux. Il y a encore exception pour les actions sales et dégoûtantes ».
On est tout rassuré. A cela près que le privilégié réclame aussi le droit de tuer un peu, de temps en temps (dix êtres humains par an, mais aucun auquel il aurait parlé), mais s’il peut prendre la vie il ne saurait dérober aucun objet : ses membres le lui refuseraient. Ainsi de suite…
Tel stendhalien (Victor Del Litto) voyait en ces Privilèges « un texte d’une importance capitale », mais en quoi donc ? Je me le demande. Il y a là, sûrement, une curiosité littéraire tout à fait étonnante, qu’on peut prendre comme un jeu ou comme une suite de rêveries à connotations confidentielles ou compulsives. « L’imagination surpuissante terrasse la désenchantement du monde, sa mesquinerie réduite », écrit Antoine de Baecque dans sa préface un brin ronflante qu’un autre stendhalien plus goguenard de ma connaissance, Paul Léautaud, eût probablement taxé de « littérature »…
Stendhal. Les Privilèges. Préface d’Antoine de Baecque. Rivages poche, Petite Bibliothèque, 61p. -
Mille pages de trop

Microfictions de Régis Jauffret, ou le réel fantasmé
Dans La littérature en péril, Tzvetan Todorov stigmatise la triple tendance marquée, dans le roman français contemporain, au formalisme tournant à vide, au nihilisme et au solipsisme. J’ai regretté, pour ma part, que l’essayiste n’ait pas illustré son propos par des exemples, mais on peut admettre, aussi, que le caractère surplombant et général de son propos suffise à l’amorce d’un débat qui se fera « sur pièces », comme y engage par exemple la lecture du dernier « roman » de Régis Jauffret, fort bien accueilli par le milieu médiatico-littéraire parisien et qui me semble, à moi, la parfaite illustration d’une littérature creuse, coupée du réel et modulant le solipsisme de l’auteur à proportion inverse de son intention affichée
L’idée du dernier livre de Régis Jauffret était pourtant intéressante, consistant à déployer une sorte de chronique kaléidoscopique qui modulerait tous les états de l’humanité sous forme de brefs récits sans liens apparents mais tenus ensemble par le pari fou de l’auteur de parler au nom de tout un chacun : « Je suis tout le monde ». Or dès le premier exergue, «Je est tout le monde et n’importe qui», cette nuance du « n’importe qui » annonce bel et bien la catastrophe, liée au fait qu’aux yeux de Jaufret «n’importe qui» est interchangeable, à commencer par ce type qui découvre un jour qu’il est Arthur Monin et qui s’évertue, dès lors, à le devenir, c’est-à-dire forcément rien.
Si c’est être forcément rien que de naître Arthur Monin, tous les «forcément» en découlent, qui relèvent non pas de l’observation de la vie mais d’un décret initial de l’auteur concluant à la nullité non seulement de tous les Arthur Monin mais de tous les profs et de tous les flics - forcément tarés et tortionnaires comme ce prof qui déteste ses élèves et baise sa collègue aux chiottes et ce flic américain dont le père est forcément du Ku Klux Klan et la mère forcément black battue -, de tous les pères et de tous les grands-pères, tel ce papy gentil qui recueille sa petite-fille maltraitée avec des attentions rares pour mieux se branler sur sa couette…
Ce n’est pas la noirceur de cet univers, bien entendu, qui me dérange et m’ennuie, mais le caractère absolument artificiel de cette noirceur. La noirceur est partie du monde, qu’on trouve à tous les coins de rue de la grande ville Littérature, chez James Ellroy ou chez Robin Cook, chez Patricia Highsmith ou chez James Lee Burke, mais tous ces auteurs disent la noirceur parce qu’ils en souffrent et la suent parce qu’ils la sentent, tandis que Régis Jaufret ne fait que noircir le réel pour se faire peur sans communiquer rien d’aucun sentiment de la réalité. Microfictions se veut un arpentage du monde et de ses milles horreurs et douleurs. Il n’est que le dégueuloir d’un littérateur dont le dégoût de la vie et des gens ne communique que le plus morne ennui. Bien entendu, ce livre a l’air de parler du réel, ainsi que le fantasment ceux qui restent claquemurés chez eux et se penchent à la fenêtre pour voir, là-bas, le miséreux ou la malvivante, et comme Régis Jauffret a l’air d’un écrivain (il l’a été et pas des moindres, dans ses premiers livres), et que son livre paraît dans le saint des saints de l'édition française, qui oserait dire que Microfictions n’est pas le top du top ?
Dans un entretien récent du Figaro sur l’état de la littérature française, Richard Millet, directeur de collection chez Gallimard, l'a d’ailleurs proclamé: que Régis Jauffret est des rares auteurs français dignes d'estime. Ceci en même temps, rappelons-le, que le même Millet (excellent homme de lettres lui aussi) déclarait qu’un Philip Roth écrit mal !
Eh bien, cher Tzvetan, voici très exactement où nous en sommes: à célébrer un livre pléthorique qui ne dit rien du réel (et par réel il va de soi qu’on entend tout le réel, qui englobe le dit du réel et tous les imaginaires connectés) et à stigmatiser le « mal écrire » d’un romancier dont tout l’effort depuis quarante ans a été de travailler sa réalité au corps et à la lettre en étendant de plus en plus le spectre de sa perception, de son petit moi masturbateur à ses couples puis à tous les milieux et tous les cercles concentriques de l’histoire réelle ou rêvée de l’Amérique contemporaine. Chers littérateurs du Quartier latin: comme vous écrivez bien, et combien vous nous rasez…
Régis Jauffret passe, depuis ses premiers livres, pour un écrivain à l’écoute des vies ordinaires, mais je vois de plus en plus, pour ma part, dans sa vision de la réalité, la seule projection systématique d’une maussaderie dépressive qui réduit ses personnages à des schémas, voire à des clichés. C’était déjà bien pénible dans Asile de fous, où la haine des familles perdait toute vraisemblance faute de nuances et de détails, et ce l’est plus encore dans ces Microfictions qui manquent également de nuances et de détails, mais aussi de vraie compassion et de vraie curiosité pour la vie des gens. Ceux-ci sont systématiquement moches, violents, abjects, ou au contraire victimisés par toutes les formes de pouvoir, mais jamais surprenants, jamais émouvants, jamais une chose et son contraire, jamais sentis réellement de l’intérieur, jamais vraiment libres ni vraiment vibrants de leur voix propre - les éléments contrapuntiques du dialogue étant eux-mêmes signes d'impersonnalité mortifère. Cela donne donc un livre surabondant en apparence et d’une étonnante pauvreté de réelles observations et de réelles émotions, pauvre en outre en sensations physique, pauvre en plaisir d'écriture – un livre écrit avec la tête qui ne pulse donc ni ne bande ni ne pue ni ne diffuse aucun parfum. Mille pages de trop ?
Régis Jauffret. Microfictions. Gallimard, 1027p. -
Grâce et tremblement

Heisei de Béatrice Rateboeuf
C’est au fond d’une tasse de porcelaine contenant son thé au lait du matin, et à la surface de laquelle elle a cru voir flotter un cheveu, lequel a peut-être coulé ensuite (« les cheveux coulent donc ? » se demande-elle aussi bien) puisqu’elle ne le voit plus, là au fond qu’elle découvre la calligraphie japonaise signifiant heisei, c’est à savoir calme, paix, sérénité, et ensuite on voit des mésanges et un début de jardin zen fait de lentilles et de cailloux jouxtant un pied de giroflée, il est question de pins nains et de feuilles miniatures, et tout aussitôt cette évocation rappelle à celle qui écrit que vers la fin d’une guerre « à bout de carburant, les villageois japonais récoltaient des quantités de racines de pin afin d’en extraire, dans la vapeur des cabanes dressées au bord des torrents, un mystérieux élément destiné à fabriquer une huile pour moteurs d’avion ». Dans la foulée on lit ce qui suit qui se précipite. « La vie d’un homme pèse le poids d’une plume », répétaient les gradés en électrisant à coups de formules bushido et de saké les pilotes sommairement entraînés, des kamikazes de 18 ans qui, à bord des vieux Zeke de Mitsubishi, se décrocheraient d’un point d’altitude et chuteraient vers la cible avec l’abandon d’un pétale qui tombe ».Puis on revient au bord du jardin zen aux mésanges : «Les aiguilles frappent à la vitre, les piafs picorent tout en appelant les autres, dès qu’ils sont cinq ou six ils se volent dans les plumes. Si sans lever les yeux je me déplace pour remplir à nouveau la théière, ils restent, si je fais un seul geste en les regardant ils s’enfuient. Homme ou animal, nous savons toujours si notre regard en a croisé un autre, même le temps d’une seconde, même dans la pénombre, même de loin. Mais à 9000 mètres d’altitude, les équipage des B-29 américains n’ont rien vu du visage des civils tournés vers le bleu limpide d’une matin de guerre ». Et le pilote de s’extasier : « Il faisait un temps de rêve ». On connaît la suite. Ou plutôt non : on sait les dates et le nombre des calcinés et des irradiés, mais le souvenir s’est perdu depuis longtemps, et plus précisément celui du nom de code de la nouvelle de ce 16 juillet 1945 : « Naissance bébé réussie ».
Béatrice Rateboeuf pratique une espèce d’écriture sacrée, en cela que le mystère de la présence s’y confond indissolublement avec l’évidence du pire, qui fait des quelque cinquante pages de ce petit livre une sorte de cristal physique et métaphysique à la fois, d’une forme étrangement aléatoire et surexacte dans la distribution musicale de ses séquences, de son rythme et de sa découpe verbale.
Il neige et des masseurs aveugles traversent le jour en même temps que reviennent des noms et des images, Little Boy est une bombe et les syllabes crues de Nagasaki claquent plus facilement que celles d’Hiroshima - mais allez, on ne fait que passer, juste une trace en passant sur son Mac : « Sur la blancheur de plume des pelouses, une cigogne en pièces détachées, ailes noires et long bec orange, s’anime au ralenti syncopé d’une paire de baguettes vermillon ».
Béatrice Rateboeuf. Heisei. Inventaire/Invention, 55p.
www.inventaire-invention.com -
Fécondations réciproques
Recherche du sauf, à propos de la Vita Nova.
L’absolu de l’Amour qui se dit avant de se chanter et de décrire ce qu’il chante et ce qu’il dit, entre palpitation de palpitant et sublimation spirituelle carabinée, module cette recherche d’une langue, au double sens du terme, que représente la Vita Nova de Dante, dont Mehdi Belhaj Kacem propose une nouvelle version que le postfacier de la traduction, Jean-Pierre Ferrini, dit une «version pop», alors que les libertés prises ne relèvent en rien d’aucune démagogie au goût du jour, dans l’esprit d’actualisation portant à faux de certains livres de la Bible réécrits ou de certains chapitres de la dernière traduction collective de l’Ulysse de Joyce.
N’étant pas du tout spécialiste patenté du dolce stil nuovo, mais connaissant un peu la musique de Dante et sa théologie amoureuse, je me contente d’apprécier les beautés et l’intelligence poétique de cette Vita Nova qui chante et ratiocine, alternativement, en rendant bien l’espèce d’hystérie physique, tremblante et même tourneboulante, qui anime le jeune homme pantelant d’amour et plus encore d’imagination de l’amour.
 Or ce que je trouve aussi très bien dans cette transcription, c’est le souci savant qu’il y a là-dedans, chez Mehdi Belhaj Kacem, d’expliciter le sens du beau, dans une langue proche, en même temps qu’on sent l’autre langue encore vive, et le chant aussi trouve ici sa propre beauté, redoublée. Dès la première image onirique, d’une Béatrice entrevue en rêve en train de mastiquer un cœur de chair qu’on imagine bien rouge et bien élastique, l’aspect physique du poème, et d’autres incidences carrément physiologiques, entrent en balance avec les torsions et distorsions psychologiques, mentales et spirituelles du poète tout affairé à sublimer et à élever, de degré en degré, une relation amoureuse jamais avérée ni moins encore consommée, probablement à sens unique, pour en faire un soleil universel d’Amour mimant son Supermodèle divin. De la téléologie théologique de tout ça, je dois avouer que je me bats un peu l’œil, mais la quête de beauté qu’il y a là me botte en revanche, pour parler en « lingua volgare ».
Or ce que je trouve aussi très bien dans cette transcription, c’est le souci savant qu’il y a là-dedans, chez Mehdi Belhaj Kacem, d’expliciter le sens du beau, dans une langue proche, en même temps qu’on sent l’autre langue encore vive, et le chant aussi trouve ici sa propre beauté, redoublée. Dès la première image onirique, d’une Béatrice entrevue en rêve en train de mastiquer un cœur de chair qu’on imagine bien rouge et bien élastique, l’aspect physique du poème, et d’autres incidences carrément physiologiques, entrent en balance avec les torsions et distorsions psychologiques, mentales et spirituelles du poète tout affairé à sublimer et à élever, de degré en degré, une relation amoureuse jamais avérée ni moins encore consommée, probablement à sens unique, pour en faire un soleil universel d’Amour mimant son Supermodèle divin. De la téléologie théologique de tout ça, je dois avouer que je me bats un peu l’œil, mais la quête de beauté qu’il y a là me botte en revanche, pour parler en « lingua volgare ».« Le souci esthétique est éthique », écrit Abdelwahab Meddeb dans un magnifique article intitulé Le sauf dans le dévasté. « Je dirais même que c’est l’esthétique qui conditionne l’éthique. C’est une des leçons que j’extrais de ma connaissance de l’islam. Disant cela, je n’ai aucun dessein à visée platonicienne, où le beau et le bien convergent avec le bon, comme le suggère pourtant la langue arabe qui, avec le mot hasan, agglomère les trois sens en un seul vocable. Dans la dévastation qui abîme notre monde et le mène au désastre, qui menace notre habiter en ce monde, face à une telle catastrophe, l’entretien, la sauvegarde, l’enrichissement de la beauté contribuent à préserver la part du sauf qui demeure dans la planète. Les actes liés à la beauté se constituent en eux-mêmes comme les emblèmes du sauf. La participation au maintien et à l’affermissement du beau mobilise les garde-fous qui ont pour vocation de nous prémunir contre l’emprise de la technique, de lui assigner des limites et des frontières, de prévenir ceux qui la manipulent de sa capacité destructrice jusque dans ses bienfaits et dans le confort qu’elle apporte aux humains ».
Et Meddeb d’ajouter ceci qui se rapporte exactement au travail de Mehdi Belhaj Kacem sur Dante : « Aussi notre souci esthétique n’est-il ni celui du dandy ni celui de qui prône le beau pour le beau, comme du purement gratuit. J’affirme que ce souci esthétique instaure une éthique aristocratique, en ce sens qu’elle ne prend rien du monde pour l’abîmer, le déformer, le défigurer, mais que, dans l’entretien de sa propre personne, elle donne à ce monde de quoi l’étoffer et l’améliorer ».
On ne saurait alors mieux faire que de citer le jeune Dante murmurant ce matin, sur fond de neige printanière, « comment Béatrice éveille l’Amour »...« 1.Après avoir traité d’Amour dans la rime transcrite plus haut, me vint la volonté de vouloir dire aussi, en l’honneur de cette très-gentille, des paroles par lesquelles je montrerais comment se ranime cet amour pour elle ; et comme il se ranime non seulement lä où il est dormant, mais lâ même où il n’est pas en puissance, et où, par une opération tenant du miracle, elle le fait venir.
Et alors je dis ce sonnet, lequel commence par Ma dame porte Amour.2. Ma dame porte Amour dans les yeux,
par quoi se fait gentillesse ce qu’elle voit ;
tout homme se retourne sur elle où qu’elle passe,
et à celui qu’elle salue fait trembler le cœur,
si bien qu’il baisse le visage, tout pâlissant
et soupire de ses défauts en geignant :
face à elle, prennent escampette Ire et Superbe.
Aidez-moi, dames, à lui faire honneur.3. Chaque douceur, chaque humble pensée,
naissent au cœur de qui l’écoute parler,
si bien qu’est loué qui la vit en premier.4. Ce qu’elle paraît, quand elle sourit même un peu,
ne se peut dire ni tenir en mémoire,
tant c’est nouveau Miracle, noble et gentil. »
Dante. Vita Nova. Nouvelle traduction de Mehdi Belhaj Kacem. Gallimard, 140p.Abdelwahab Meddeb. Contre-prêches. Seuil, 503p.
-
Un humaniste sauvage

Mehdi Belhaj Kacem traduit la Vita Nova de Dante
Il est bel et bon qu’une surabondante neige, un peu molle et même lourde, c’est-à-dire printanière comme le veut ce jour, et que le soleil de dimanche fera se dissoudre dans les primevères, donne un fond blanc à l’apparition d’une petite robe rouge portée par une dame de neuf ans prénommée Béatrice et dont à la fin de sa neuvième année à lui Dante s’enamoura au point d’écrire plus tard : « A ce point, je dis en vérité que l’esprit de la vie, lequel demeure dans la plus secrète chambre du cœur, commença à vibrer si fortement qu’il fit sentir d’horribles pulsations au plus infime de mon corps, et tremblant il dit ces paroles ; « Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur michi ! », ce qui signifie en français de France et environs: « Voici un Dieu plus fort que moi, qui vient pour être mon maître ».
Cette exclamation de l’esprit de la vie palpitant dans la chambre du cœur d’un adolescent probablement vierge, fait écho à une phrase qui me revient de Mehdi Belhaj Kacem, disant « je ne veux pas me faire reconnaître, mais faire reconnaître quelque chose ».
Or « faire reconnaître » en traduction nouvelle, et selon un nouveau découpage imité de la version italienne de Guglielmo Gorni, dans une langue limpide et fourmillant d’inventions hardies, La Vita Nova de Dante, est un de ces actes de passeurs qui valent bien mille prétendues « créations », avec cela de surcroît que le passeur de l’occurrence fait bel et bien œuvre créatrice.
La Vita Nova est à la fois l’un des premiers récits autobiographiques de la littérature occidentale en langue vulgaire, un chant d’amour d’un sublime érotisme verbal, ponctué de parties versifiées et enrichi de son propre commentaire, qui en fait donc un poème et la story du « fait divers » dont il est issu et la glose pour ainsi dire nabokovienne de la chose, laquelle aboutit, au douzième degré et probablement à mes seuls yeux, à une histoire à la Feu pâle, l'élément polar et la satire de la cuistrerie en moins...
Je le pressens à l’instant : que cette Vita Nova ne va pas me quitter ces prochains jours, dont je rendrai compte ici de la lecture pour contribuer un peu à « faire reconnaître quelque chose », tout en me rappelant nos lectures de La Divine Comédie, à dix-huit ans, au « printemps de la vie », n’est-ce pas…
Mais il faut d’abord citer la postface de cette nouvelle traduction, signée Jean-Pierre Ferrini, qui trouve une belle formule pour qualifier la démarche de Mehdi Belhaj Kacem, d’un « humaniste sauvage ».
Evoquant d’abord « l’exemplaire corné, déchiré, sali que Mehdi Belhaj Kacem a utilisé pour traduire la Vita Nuova (le postfacier utilise Nuova plutôt que Nova), il écrit ensuite ceci qui n’est pas du folklore de faiseur: « En traduisant Dante, assis sur la banquette d’un train, dans une voiture, sur le coin de la table d’un bistrot désert d’une petite ville de province, dans le rue ou sur une plage de Tunisie, Mehdi Belhaj Kacem redonne toute sa noblesse à la « pensée du dehors » ou à la figure du « paria ».
On se fiche pas mal, évidemment, de savoir si MBK écrit en charentaises plutôt qu’en baskets, au coin d’un feu bourgeois ou sur une margelle de puits berbère, mais ce qui frappe est le sérieux de son entreprise, perceptible à l’immédiate découpe des mots, du sens et des sons. « Il s’agit, explique-t-il, de reproduire à l’intérieur du texte l’équilibre de l’original, à savoir l’écart entre le haut style aristocratico-courtois et le côté gouaille et langue vulgaire, cet argot presque de petite gouape pasolinienne ».
Est-ce dire que MBK nous propose une version rap ou hip-hop de la Vita Nova ? Pas à première vue. A première « écoute » son texte ruisselle et scintille comme il convient à la poésie de l’Alighieri, me rappelant en outre une nuit où un ami me lisait une prose de MBK dont il me jurait que c’était un nouveau Bossuet version beur…
Quant à savoir si Dante y retrouve ses petits aux yeux des puristes, il faudra le printemps, toujours favorable aux étripées philologiques, pour le démêler…
Dante, Vita Nova. Nouvelle traduction de Mehdi Belhaj Kacem. Gallimard, L’Arbalète, 140p. -
Un amour de père
Le père adopté de Didier van Cauwelaert
Il est au monde d’heureuses natures, et tel est sans doute Didier van Cauwelaert, longtemps considéré comme le gendre idéal par ces dames après avoir prétendu, dans sa cour de récréation, n’être autre que le fils naturel du roi Baudoin de Belgique, auquel il est d’ailleurs possible que s’apparentent ses ancêtres plus ou moins comtes ou barons.
C’est cependant à un démocrate avéré préférant le surnom de « Vanco» à sa particule, avocat au civil et romancier manqué côté jardin secret, que son fils Didier, qui a réalisé son rêve littéraire (une œuvre très prisée du public et très primée, notamment par le Goncourt 1994) rend ici un éclatant hommage. De toute évidence, René van Cauwelaert fut un type formidable, qui « mourut » une première fois lorsque son fils avait sept ans, ayant déclaré à sa femme, au su de l’enfant, qu’il se tirerait une balle dans la tête plutôt que de faire subir sa déchéance de vieille peau aux siens. Ce même jour, le garçon décidait de devenir écrivain, et cinq ans plus tard, il « adoptait » solennellement son père, à vie cette fois, qui n’avait cessé par ailleurs, au contraire de sa mère plus sourcilleusement critique, de se poser en premier « fan » inconditionnel de son romancier de fils.
« Je sais par expérience que l’invention précède souvent la vie », écrit le romancier, « et j’ai toujours eu à cœur de percevoir et transmettre ce que la réalité présentait de plus inimaginable ». Or le fils va trouver, dans les cahiers que lui transmet son père, la matière merveilleuse d’une galerie de portraits de famille qu’il prolonge ici à la mémoire de René.
Affectueux et drôle, affabulateur passé maître dans le mentir vrai, Didier raconte aussi la belle histoire d’amour de René et de sa Paule, grande bringue adorable qui vivra douloureusement, dans son coin, la perte d’un tel amour de jules…
Didier van Cauvelaert. Le père adopté. Albin Michel, 280p. -
La passion du réel

Un roman russe d'Emmanuel Carrère, entre perversité et candeur
« Je suis pour le réel, rien que le réel », écrit Emmanuel Carrère dans Un roman russe, où le réel de la fiction nourri par la vie ne cesse d’interférer, voir d’agir sur celle-ci, avec une suite de chocs frontaux, de dérapages, de coïncidences et de rebondissements qui font de ce livre tour à tour exaspérant et émouvant, odieux et attachant autant que son auteur, cruel dans son honnêteté comme ont pu l’être les récits d’un Hervé Guibert, où l’auteur lui-même s’expose autant qu’il expose ses proches, un vrai roman d’époque jouant sur les interférences du réel et du virtuel, des images publiques et privées, du « tout dire » provocateur et de l’exorcisme espéré qui ne débouche finalement que sur un nouveau manque.
Tzvetan Todorov reproche aux auteurs français contemporains leur tendance au solipsisme et, du même coup, leur incapacité de rendre compte de la réalité commune. Or Emmanuel Carrère lui donne à la fois raison et tort, en cela que son délire narcissique sur fond de détresse enfantine, loin de se borner à une auto-contemplation stérile, le lance dans une construction romanesque qui fait de la fiction ce « cercle magique » dont parlait Henry James, où son histoire personnelle à dormir debout devient un véritable roman, scandé par une écriture vigoureuse et subtilement architecturé, qui parle aussi de la société qui est la nôtre et de l'histoire contemporaine.
D’un point de vue superficiel, en se fondant notamment sur le numéro médiatique de Carrère interrogé sur les estrades, l’on serait tenté de conclure à l’esbroufe et au cynisme exhibitionniste d’un fantoche de la République des lettres exploitant un « coup » fumant, comme lors de l'affaire de la fameuse nouvelle érotique publiée par Le Monde, qui devient ici l’un des pivots de sa relation avec la jeune Sophie.
Or s’il y a de la forfanterie ostentatoire chez le fils à maman jouant les tueurs-vampires, fût-ce jusqu’au ridicule trop facilement raillé naguère par Sollers, quelque chose de réellement sérieux, je crois, qui touche même au tragique, se joue dans ce livre jusqu’au-boutiste où l’on constate que l’effort de « tout dire », même s’il n’évente pas vraiment le secret (du grand-père, en l’occurrence, déclaré monstre sans qu’on en soit sûr du tout, et qui acquiert dans la foulée un véritable statut de personnage de roman), pousse chacun à se dévoiler sans qu’il soit pour autant question de voyeurisme gratuit ou mondain.
Qui est finalement cet Emmanuel Carrère qui parle de sa « bite » comme d’un personnage public ou évoque le visage de son amie Sophie comme une « chatte » visible de tous ? Ces termes d’époque, cette brutalité avec laquelle on expose sa digne mère, cette apparente muflerie ne laissent de masquer, pour qui lit attentivement, une frise de personnages bien plus fragiles et perdus qu’il n’y paraît, dont le roman détaille les tribulations, malgré la façade et la consigne, héroïquement tenue par Madame Mère, de ne rien montrer de sa souffrance et de faire comme si personne ne souffrait. La lettre que le fils adresse finalement à sa mère dépasse, à cet égard, tout effet littéraire et justifie peut-être les pires excès de l’écrivain : dire que nous souffrons est-il une telle honte, et dire que nous aimons ?
Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L. 356p.
-
Jonasz à la source
Chanson française
Au tournant de la soixantaine, dont il a franchi le cap en janvier dernier, Michel Jonasz entame un hommage qu’il aimerait tripler, « si Dieu le veut », à ses trois sources d’inspiration musicale : ici à la chanson française, plus tard au blues et enfin à la musique tzigane.
En souvenir de ses premières émotions d’adolescence, au début des années 6o, avant le rock du Golf Drouot et les groupes de son quartier de Drancy, le sexa bluesy « attaque» avec Les copains d’abord de Brassens, sur un rythme chaloupé de bossa nova dont la sensualité ne devrait pas déplaire à tonton Georges, même si ce n’est pas avec celui-ci que Jonasz est le plus en phase, plus proche en revanche de l’emphase lyrique de Léo Ferré, dans La mémoire et la mer ou Avec le temps, et plus encore avec le Nougaro jazzy d’Armstrong.
Au nombre des meilleurs moments de ce parcours en douze étapes, on ne s’étonnera pas, à côté d’une bien tendre interprétation de La chanson des vieux amants de Jacques Brel, de trouver Michel Jonasz le plus à l’aise chez… lui-même, avec Léo et Chanson française.
Au demeurant, le climat musical sobre qu’il donne au Fernand de Brel, la touche toute personnelle apportée aux Feuilles mortes de Prévert et Kosma, ou à La foule, clin d’œil affectueux à la môme Piaf, participent également d’un geste de reconnaissance appréciable.
Michel Jonasz. Chanson française. MJM. -
L’école du vrai
Sur Le marin de Dublin, de Hugo Hamilton
Trois premiers romans traduits nous ont révélé, déjà, le très grand talent de l’Irlandais Hugo Hamilton, de Berlin sous la Baltique à Sang impur (Prix Femina étranger 2004) en passant par le polar Déjanté. Or nous retrouvons, dans Le marin de Dublin, le jeune protagoniste de Sang impur, tiraillé entre une mère d’origine allemande et un père despote et nationaliste, bien décidé à s’affranchir de cette double tutelle : « Cet été, je vais m’enfuir et gagner mon innocence. Adieu le passé, la guerre et le ressentiment… »
Comme de bien entendu, se libérer de l’héritage parental n’est pas si facile, et d’autant moins que les parents du narrateur sont diablement attachants, qu’il s’agisse de la mère qui délivre ses enfants de leurs cauchemars en les leur faisant dessiner la nuit, ou du père construisant son premier pick-up pour n’écouter que du folklore gaélique, avant que son fils y fasse tourner en douce les Beatles.
C’est cependant à la dure, auprès des gens de mer, que le jeune Hugo va conquérir sa liberté, via l’Angleterre honnie par son paternel et l’Allemagne de ses ancêtres maternels. Tout cela porté par une poésie et une chaleur humaine irradiante, qui fait de ce beau roman une sorte de poème de l’apprentissage.
Hugo Hamilton. Le marin de Dublin. Traduit de l’anglais (Irlande) par Katia Holmes. Phébus, 301p.
-
Une transgression libératrice
 Un Roman russe d’Emmanuel Carrère.
Un Roman russe d’Emmanuel Carrère.
Immergé ces jours dans la frénésie de la phrase dostoïevskienne, après avoir repris la lecture de Crime et châtiment dans la traduction radicale d’André Markowicz (radicale en cela qu’elle prend littéralement la langue à sa racine), je me suis rappelé le reproche que j’avais fait à L’Adversaire d’Emmanuel Carrère à sa parution: de n’être pas, justement, assez abandonné à la frénésie intérieure de son sujet - autant dire de n’être pas assez russe…
Or voici que, me lançant dans Un roman russe, qui part en flèche dans un récit immédiatement captivant et surtout rythmé par une écriture à la fois plus physique et plus intimement tenue et teigneuse que dans L’Adversaire, je trouve illico cet engagement existentiel et ce défi d’un « tout dire » qui va chercher précisément, ici, le secret qui fait mal, au risque de faire mal à celle qui tenait précisément à la préservation de « son » secret – à savoir la mère de l’auteur.
On sait qui est Emmanuel Carrère et sa brillantissime académicienne de mère, mais on voudrait l’oublier en l’occurrence. On l’oublie en tout cas au début d’un récit-reportage qui nous amène très loin du Tout-Paris, au fin fond de la Russie actuelle, dans un asile psychiatrique que l’auteur compare à la terrible Salle No 6 décrite par Tchekhov, où un malheureux soldat hongrois capturé par les Soviétiques a passé les dernières années de sa vie avant d’être découvert et ramené en Hongrie comme un «héros» alors qu’il n’aspirait qu’à une vie retirée à la Walser après qu’on lui eut coupé la jambe et qu’on l’eût déclaré mort dans son pays…
Cette histoire triste parle de la Russie d’aujourd’hui et d’un homme perdu, mais c’est d’un autre paumé de l’Histoire que l’écrivain, revenu en France avec son équipe de filmeurs, va tenter de retrouver la trace, en la personne de son grand-père maternel, raté cultivé qu’attiraient les thèses fascistes et qui disparut en 1944, l’année même où le jeune Andras Toma fut fait prisonnier sous l’uniforme de la Wehrmacht - mais cela n’a aucun rapport n’est-ce pas ? n’était ce relent de Russie au cœur de Carrère, qui passe par son enfance et celle de sa mère et fouette son écriture d’un knout revigorant. (Lecture à suivre…)
Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L. 356p. -
Un amour sans retour

Tous les enfants sauf un, lumineux essai de Philippe Forest
Après les deux romans d’émotion et d’implication que furent L’Enfant éternel, premier exorcisme déchirant, et Toute la nuit, tentative de rapport clinique achoppant au scandale de la mort d’un enfant, Philippe Forest revient « encore » à cet événement que fut, pour lui et sa jeune femme Hélène, la perte de la petite Pauline, trois ans, il y a dix ans de ça.
Un de ses amis a beau le lui avoir rappelé: qu’en d’autres lieux, d’autres cultures, d’autres temps, pareil drame n’eût été que péripétie, lui citant Montaigne qui ne se rappelait pas, dit-on, le nombre exact de ses enfants, tant il en avait perdus…
Or ce nouveau livre, cet essai plus précisément, n’a rien de ressassant ni de complaisant dans la déploration. Si Philippe Forest est trop sévère avec lui-même en écrivant qu’il a « mal dit » et « mal fait » avec ses romans, on comprend bien ce qu’il veut dire aujourd’hui qu’il constate que rien n’a changé par le truchement de ces livres, si tant est qu’ils n’aient pas entretenu certain malentendu.
« Quelle leçon de vie », lui aura-t-on seriné en croyant bien faire, alors que tout a été « appris » autrement qu’on croit ou qu’on dit sans avoir vécu la chose dans sa chair ; et c’est de cet apprentissage, de cet approfondissement de la connaissance de la douleur, du repérage de ce qui a été vraiment ressenti loin des consolations convenues, qu’il s’agit dans Tous les enfants sauf un.
Au coeur du livre, un chapitre capital stigmatise tout ce qui est dit et fait aujourd’hui autour du « travail de deuil », que Philippe Forest remet en cause en dénonçant ce qui est trop souvent une opération d’évacuation de l’objet de la souffrance, pour ne pas dire une technique de l’oubli et du rebondissement. Alors même qu’on valorise à l’extrême ce « travail de deuil », l’entourant de moult coachings et autres cellules de soutien psychologique, sur un ton d’autant plus emphatique et sentimental que le deuil touche à l’« enfance innocente», le processus lui-même est un leurre selon Forest, qui aboutit à la substitution de l’ « objet » aimé par telle ou telle « raison d’espérer ». Cas de figure idéal : le petit ange avait une petite sœur : vivez donc pour elle !
Or, aux « travaux forcés du deuil », qui évacuent la réalité de la mort comme on évacue la réalité de la maladie tant que faire se peut, dans notre société de bien portants et bien produisants, Philippe Forest oppose une alternative qu’il a construite pour lui-même à partir de la lecture du Rameau d’or de Frazer, à l’imitation des primitifs, introduisant la notion de sacrifice dans la relation des (sur)vivants et de leurs défunts. Et de citer aussi l’ Erotique du deuil au temps de la mort sèche de Jean Allouch: « Envisager le deuil en termes de travail revient à considérer que les objets du désir sont interchangeables, qu’ils sont comme les fétiches indifférents à l’aide desquels, les substituant les uns aux autres, l’individu recouvre le vide insupportable qui se creuse devant lui. Mais le concevoir comme sacrifice – comme y invite Allouch – consiste à considérer ce trou et à comprendre que c’est depuis sa profondeur incomblable que se lève la féerie d’une vision fidèle à la vérité ».
Féerie et vérité : tels sont aussi bien les deux pôles entre lesquels ce livre de pensée incarnée, ce livre de titubant amour, ce livre d'intuition affective et d'intelligence acérée ne cesse d’osciller. Dès les premières pages le double constat est tombé, sur « l’extraordinaire immobilité du chagrin » et « l’effarement inaltérée devant la vérité ».
L’évacuation de la maladie et de la mort revient, dans la société occidentale contemporaine, à l’évacuation du vivant. Le malade inquiète tant qu'il ne se décide pas pour la vie ou la mort, et l'handicapé fait tache. Du sidéen ou du cancéreux, on invoquera même la faute d'un air entendu... A ce propos, de très fortes pages sont consacrées par Philippe Forest aux mythes liés au cancer, trop souvent assimilé à une défaillance de la vitalité, sinon à un suicide différé. Combien ainsi un Fritz Zorn, endossant, avec la société mauvaise, la Faute dont son cancer était en somme le symptôme punitif, a-t-il fasciné avec son Mars relevant, en réalité, de la « vengeance » et de la littérature…
Pauline avait un nom, tandis que Fritz Zorn ne dit jamais qu’il a un frère, que celui-ci aussi avait un nom et point de cancer. Du côté de la vie, et boiteuse, et salope, Philippe Forest rend son nom à sa fille et à sa femme Hélène, pour les ramener dans ce lieu où l'amour porte lui aussi nom et visage. Tous les enfants sauf un est également une belle méditation sur la mélancolie de l’hôpital englobant soignants et patients, sur le sadisme et la sainteté cohabitant dans le ghetto de l’hôpital qui est aussi un refuge (et l’auteur rend hommage à l’hôpital français), sur la sidération de la douleur et l’impossible retour à ce que la mort salope nous arrache, une dernière évocation de ce qui fut avec Pauline et sans elle jusqu'à la folie errante, alors que le nom de l'enfant perdu se trouve enfin prononcé par delà le sacrifice symbolique.
Philippe Forest. Tous les enfants sauf un. Gallimard, 174p. -
Le poème du sang contaminé

Le rêve du village des Ding de Yan Lianke
C’est un roman terrible et cependant magnifique, dans sa forme sublimée par la poésie, que Le rêve du village des Ding de Yan Lianke, qui a valu à son auteur, célèbre dans son pays, de se voir frappé d’interdiction de parole et de déplacement à l’étranger. Sa faute est en effet d’avoir levé le voile sur un drame survenu dans sa province natale du Henan, en un symbolique « village du Sida » dont les habitants, contaminés par le virus lors de ventes de sang autorisées par les autorités, sont morts les uns après les autres. Or le roman ne s’en tient pas aux dimensions d’une chronique-reportage visant à dénoncer un fléau dévastateur marquant le développement aveugle de la Chine contemporaine : c’est également une fable à valeur universelle rappelant La peste d’Albert Camus en plus foisonnant et en plus lyrique.
L’histoire est racontée par un garçon de douze ans, ou plus exactement par son fantôme, puisque Qiang est mort empoisonné par une tomate, subissant la vengeance des villageois contre son père responsable d’avoir organisé la grande collecte de sang dans les années 90, dix ans plus tôt. Ainsi le sang a-t-il coulé pour pallier la misère, construire de nouvelles maisons, financer de beaux mariages ou goudronner des routes… A cette fièvre répondra celle de ce mal mystérieux sur lequel les autorités jetteront longtemps un voile alors qu’il se répand aujourd’hui à très large échelle ainsi que l’a confirmé récemment le rapport annuel de l’Onusida.
Comme il l’explique en postface, Yan Lianke a pratiquement « sué le sang » pour aller au bout de cette chronique douloureuse, qui l’a engagé dans un combat pour la vérité « L’histoire récente est une page blanche. Il faut que les générations futures sachent ce qui se passe, ce qui arrive à notre peuple. C’est la responsabilité des intellectuels mais la plupart des écrivains chinois se dérobent, évitent toute réflexion approfondie sur la société soit par soumission au gouvernement, soit pour faire de l’argent, beaucoup d’argent... ».
Cette quête de la richesse à tout prix, c’est aussi elle qui causera la perte des habitants du village des Ding. Une nouvelle utopie, l'argent, a remplacé l'utopie usée du communisme : « Nous sommes passés de l’utopie communiste à l’utopie capitaliste, les habitants de ce village, pourquoi vendent-ils leur sang ? C’est pour devenir riches, pour réaliser ce même rêve. Alors l’explosion du sida à grande échelle aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose de simple, c’est une catastrophe globale à laquelle est confrontée toute l’humanité : à l’origine, c’est parce que nous voulons tous être plus riches, toute l’humanité est victime de cette utopie, et nous nous précipitons vers des catastrophes, comme celle du Sida ».
Après l’interdiction de Servir le peuple en 2004, satire iconoclaste des années rouges, Yan Lianke donne, avec Le rêve du village des Ding, une chronique dont la poésie devait « détourner » l’attention des censeurs. Or son roman n’est est que plus percutant, qui a au contraire redoublé la vindicte de ceux-ci. Dire la vérité et l’exprimer en beauté, c’est décidément trop...
Yan Lianke. Le rêve du village des Ding. Traduit du chinois par Claude Payen. Postface de l’auteur. Editions Philipe Picquier, 328p. -
Que la lecture est irremplaçable

A propos de Perla de Frédéric Brun et de Fracas de Pascale Kramer.
Je viens de lire ce matin gris un petit livre en une heure, le premier d’un auteur du nom de Frédéric Brun, paru sous le titre de Perla, et, resongeant aux arguties de Pierre Bayard sur la non-lecture, je me dis que malgré tout rien ne vaut la lecture et complète, d’un livre, et que parler de celui-ci sans l’avoir lu serait une absurdité. Je me faisais la même réflexion hier à propos d’un autre livre, de mon amie Pascale Kramer, intitulé Fracas et dont pas une miette ne doit être perdue sous peine de passer à côté. Que maintes gens passent à côté de Perla ou de Fracas ne m’inquiète pas autrement, je suis bien conscient qu’on peut vivre et survivre sans avoir lu Fracas ou Perla, mais ce n’est qu’en lisant ces livres d’un bout à l’autre qu’on peut se parler à soi-même d’eux en connaissance de cause, en démêler les qualités et les éventuels défauts, surtout s’en incorporer la substance puisque substance il y a - étant entendu que les livres sans substance, on les laisse tomber après deux trois pages et voilà tout.
Perla est un livre de deuil, comme on dit, un livre de larmes et limpide, comme nettoyé par la douleur et l’effort de la surmonter en écrivant, un livre clair et lumineux. Frédéric Brun a rêvé qu’il brûlait son manuscrit après être revenu à Auschwitz, soixante ans après que sa mère Perla y a séjourné quelques mois, déportée dans le dernier convoi parti de Drancy, en juillet 1944. Frédéric Brun n’a pas détruit son manuscrit en réalité et nous lui en savons gré car son récit, vital sans doute pour lui, mérite aussi d’être lu et « vécu » par chacun. C’est l’histoire d’un homme qui va devenir père au moment où sa mère, Perla, disparaît après des années à la fois brillantes (elle s’est refaite une belle situation, comme on dit, au retour des camps) et régulièrement marquées par la dépression. Tandis que le fœtus de son enfant grandit dans le ventre de Manon, Frédéric évoque, en alternance, les faits liés à la Shoah, dont sa mère lui a très peu parlé mais qu’il documente avec tous les livres qui en témoignent, et les motifs de l’apprentissage existentiel qu’il découvre dans les Bildungsromanen des romantiques allemands. D’aucuns hausseront les épaules et diront sans lire : lu et relu, vu et revu. Or précisément, la vraie lecture de vrais livres ne relève jamais du « déjà vu ». Cela tient à des riens, dont un Pierre Bayard ne dit rien : cela tient à la voix de l’auteur, à la forme de ses phrases, à la musique de celles-ci, à ce qui fait l’unicité de chaque personne, que l’art exprime corps et âme. Parler en ville de Perla ne nous donnera aucun prestige, mais lire ce livre est un cadeau qu’on se fait. Pareil pour Fracas, en plus fouillé, complexe, tordu et captivant, pour autant qu’on lise sans en perdre une miette. Pascale Kramer est une romancière tout à fait originale, dont la substance de l'écriture, si poreuse, est unique. Il ne se passe apparemment presque rien dans Fracas, qui se donne sans dialogue « extérieur ». Or ce livre hypertendu bruisse de voix et les événements minuscules s'y bousculent. Il s’agit d’une famille franco-américaine qui se retrouve dans une maison perdue, au bord d’un canyon californien ravagé par une tempête, avec la menace latente d’un bloc de rocher en suspension au-dessus de son toit. Au déchaînement récent des éléments fait pendant la sourde tempête intérieure qui tourmente les membres adultes de la famille (mais les mômes aussi s’agitent alentour) après un accident dont vient d’être victime la jeune Cindy, probable maîtresse du père, mais celui-ci et sa femme, à cran, font tout pour verrouiller ce secret.
Pareil pour Fracas, en plus fouillé, complexe, tordu et captivant, pour autant qu’on lise sans en perdre une miette. Pascale Kramer est une romancière tout à fait originale, dont la substance de l'écriture, si poreuse, est unique. Il ne se passe apparemment presque rien dans Fracas, qui se donne sans dialogue « extérieur ». Or ce livre hypertendu bruisse de voix et les événements minuscules s'y bousculent. Il s’agit d’une famille franco-américaine qui se retrouve dans une maison perdue, au bord d’un canyon californien ravagé par une tempête, avec la menace latente d’un bloc de rocher en suspension au-dessus de son toit. Au déchaînement récent des éléments fait pendant la sourde tempête intérieure qui tourmente les membres adultes de la famille (mais les mômes aussi s’agitent alentour) après un accident dont vient d’être victime la jeune Cindy, probable maîtresse du père, mais celui-ci et sa femme, à cran, font tout pour verrouiller ce secret.
Lu et relu, vu et revu ? Sans doute, s’il n’était question que du « sujet », mais quel est-il en réalité ? Et qui a jamais observé comme ça, forgé de telles métaphores et trouvé de tels adjectifs, dit tant de choses sur ce qui ne se dit pas à l’ordinaire ? Une telle lecture ne m’est pas plus vitale, dans l’absolu, que celle de Don Quichotte, que je n’ai jamais lu en entier (ça viendra) ou de La Divine Comédie, dont je n’ai jamais lu en entier Le Paradis, mais ces jours Fracas, comme Tumulte de François Bon, lu en parallèle, ou Perla, m’ont apporté des choses que la non-lecture ne m'apportera jamais. C’est affaire, une fois encore, de voix plus que de savoir, de peau et de regard, de ce je ne sais quoi qui fait que chaque vrai livre a un bout de vérité unique in the world à nous transmettre…
Frédéric Brun. Perla. Stock, 2007.
Pascale Kramer. Fracas. Mercure de France, 2007. -
Magicien de la désillusion
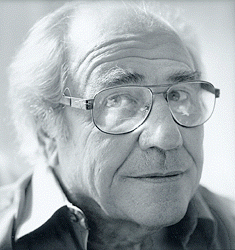
Hommage à Jean Baudrillard
Avec l’auteur de Cool Memories disparaît un observateur aigu, souvent paradoxal, voire incompris, de la société « déréalisée ».
C’est une grande figure de l’intelligentsia française qui vient de disparaître en la personne du sociologue Jean Baudrillard, décédé mardi à Paris à l’âge de 77 ans. Célèbre à la fois pour son travail d’analyste de la société moderne et post-moderne, qui a nourri une cinquantaine d’ouvrages, et pour ses interventions sur la scène médiatique, où ses déclarations rompaient souvent avec le discours convenu, Baudrillard avait déployé ses pensées les plus personnelles et originales dans un monumental journal à facettes et fragments paru, entre 1987 et 2005, sous le titre de Cool Memories.
Né en 1929 à Reims, Jean Baudrillard, germaniste de formation (il avait traduit Marx, Brecht et Peter Weiss), avait participé au groupe de la revue Utopie et publié, en 1968, un premier essai qui fit date intitulé Le Système des objets, où il mettait notamment en évidence le fait que, dans la société de consommation, l’inessentiel de l’objet (sa forme ou son aspect) prime sur sa fonction essentielle. Toute l’œuvre de Baudrillard, par la suite, se développera dans une réflexion multiple sur la « déréalisation » progressive de l’univers social où le simulacre et le virtuel se substituent peu à peu au réel. Proche de Roland Barthes dans son approche des « signes » et autres « mythologies » contemporaines, Jean Baudrillard se plaisait à décrypter des phénomènes selon lui significatifs, tels que les commémorations à n’en plus finir, les grandes actions humanitaires (qu’il n’hésita pas à appeler « tsunactions ») et autres démonstrations lénifiantes ne visant qu’à solidifier un « axe du bien » à caractère « totalitaire ». Jouant souvent sur le paradoxe, jusqu’à la provocation, en poussant la logique propre à l’époque actuelle, jusqu’à l’excès révélateur, il soutenait que la saturation de l’image, dans le monde contemporain, aboutit à un brouillage de la représentation, de même que « notre hystérie autour de la pédophilie est telle que nous ne comprenons plus vraiment ce qu'est l'enfance », avant de conclure que « l’enfant n’existe plus ». De la même façon, il avait soulevé un tollé en affirmant que la guerre du Golfe n’avait pas eu lieu…
Ayant rompu avec le marxisme, comme en témoigne Le miroir de la production (1973), Jean Baudrillard s’était éloigné des analyses fondées sur l’économie pour s’intéresser de plus en plus, dans le sillage du sociologue canadien Marshall MacLuhan, fondateur du concept de « village planétaire», à la détermination des relations sociales par les formes de communication. Ainsi, dans L’échange symbolique et la mort, avait-il développé une réflexion sur la substitution progressive, de l’objet par sa copie et du réel par le virtuel.
Souvent mal compris dans un univers médiatique et politique pratiquant la pensée bipolaire, Jean Baudrillard, bravant les modes (il fustigea l’art contemporain) et le manichéisme intellectuel (il osa célébrer le génie de Joseph de Maistre et affirmait que "la lâcheté intellectuelle » était devenue « la véritable discipline olympique de notre temps"), s’exprimait le plus librement dans les fragments de ses Cool Memories, véritable laboratoire de pensée et d’écriture – ce « satrape » institué du Collège de Pataphysique étant après tout (ou avant) un écrivain… -
Simenon à la russe
Un sombre drame
Ce roman « paysan » est sans doute l’un des plus sombres de la série que Simenon appelait les « romans de l’homme », dont la trame policière s’efface à peu près complètement derrière le drame humain, auquel s’ajoute certes, ici, le dénouement le plus dramatique.
Cela se passe dans l’âpre campagne de Vendée, par un automne pourri où le ciel rampe. Pendant que deux femmes, Joséphine Roy et sa fille Lucile, rangent des pommes dans le grenier de la ferme cossue dite du Gros-Noyer, un homme se fait renverser et abandonner sur la route proche, dans les poches duquel on découvre une grosse somme.
Qui est-il ? Que venait-il faire au Gros-Noyer ? Et de quelles relations embrouillées, de quels secrets de famille, de quels mensonges cet inconnu frappé d’amnésie va-t-il devenir le révélateur ? Parallèlement à l’enquête officielle (où le gendarme du titre ne joue qu’un rôle secondaire), le dévoilement progressif de l’énigme nous fait pénétrer dans un univers qui évoque Dostoïevski.
Par delà le déterminisme social et psychologique qui pèse sur les personnages, ceux-ci semblent en effet possédés par des forces qui les dépassent et les séparent. Aura-t-on jamais vu des parents aussi étrangers les uns aux autres ? En osmose avec ce monde de la terre, Simenon donne ici de son meilleur, comme dans L’Homme qui regardait passer les trains repris dans la même collection.
Georges Simenon. Le rapport du gendarme. Folio policier, 185pp.
-
Dantec est-il infréquentable ?
L’écrivain « culte » mérite-t-il une Fatwa, comme l'a demandé le magazine Technikart après la publication d’ American Black Box ?
Maurice G. Dantec, le plus controversé des romanciers français avec Michel Houellebecq, a publié récemment le troisième tome de son monumental journal, sous le titre d’ American Black Box, recouvrant les années 2002-2006 et se voulant la «boîte noire » du crash annoncé d’une « civilisation qui ne croit plus en elle-même », menacée par un « néo-totalitarisme planétaire ». Somme des lectures et des réflexions géo-politiques ou philosophico-théologiques de l’écrivain « exilé » à Montréal, ce livre refusé successivement par les éditions Gallimard et Flammarion, qui craignaient (notamment) les contrecoups de son anti-islamisme virulent, a paru chez Albin Michel dans la foulée de deux énormes romans, Cosmos incorporated et Grande Jonction, marquant à la fois le sommet momentané d’une œuvre saisissante et le début de l’empêtrement de l’auteur dans une sorte de prophétisme halluciné à base de catholicisme ultra (Dantec s’est converti) et de rejet virulent de l’Europe pourrie (ramassis de Zéropéens) et de la France moisie, en attendant à la fois le Grand Djihad anti-Occidental et une Nouvelle Chrétienté, voire une Nouvelle Croisade, un nouvel Armageddon liguant les forces de l’Amérique de Bush et d’Israël, entre autres « visions ».
A en croire Dantec, le monde actuel serait un vaste Camp, héritage du XXe siècle qui fut essentiellement « le siècle des camps ». Depuis septembre 2001 se déchaînerait la 4e Guerre mondiale qu’il a d’ailleurs vue se pointer : « En trois livres, j’ai dit la guerre qui venait, j’ai dit le monde qui s’achevait, j’ai dit le choc qui ouvrirait l’abîme ». S’il convient que « ce n’est pas être contre les PERSONNES de confession musulmane que de ne pas être en accord avec le Coran », il n’en affirme pas moins que, « bientôt l’islamisme conquérant trouvera son véritable Hitler, c’est-à-dire un mélange de prophète religieux charismatique et de leader politique-publicitaire, soit l’Antéchrist tout simplement ». Or il n’y a pas que l’islam a représenter l’Antéchrist aux yeux du rocker transformé en catholique errant: « Mahomet, plus Luther, plus Hitler, plus Lénine, le Quadriparti antichristique qui cloue l’Occident par ses quatre orifices est désormais installé pour des siècles ». Et de fustiger les « talibanlieusards » tout en priant « pour que des musulmans libres aient la bonne idée de s’unir un jour contre ce qui conduit leur civilisation au chaos et à la ruine » ; et de stigmatiser l’ « œcuménisme panthéiste baba cool des épiscopats modernes » en appelant de ses vœux un nouvel Occident chrétien fondé sur les forces de l’OTAN et « la réouverture imminente du Saint Tribunal de l’Inquisition et le rallumage de ses bûchers » ; et de vouer Chirac aux gémonies pour ne pas s’être engagé en Irak, en prévoyant (on est en 2003) que les Américains vont créer à Bagdad la première République fédérale arabe, modèle s’il en sera…
Les 600 pages d’American Black Box ne s’en tiennent pas, heureusement, à l’énoncé des positions politico-philosophiques de l’auteur, qui déverse pêle-mêle le produit de lectures très poussées (plus précisément à hautes doses de Risperdal, neuroleptique utilisé dans le traitement de certaines psychoses et de la schizophrénie…) en matière de patristique, les échos de querelles nettement plus triviales voire parisiennes, des aphorismes dont certains sont parfois lumineux (« La beauté est ce qui dans ce monde n’est pas de ce monde », ou « Quand on est nombre on est ombre ») mais parfois aussi d’une pesante platitude (« Les pires envieux sont ceux qui vous envient pour la vérité»), des engouements intellectuels successifs qui en disent long sur une quête d’autant plus incertaine qu’elle se veut péremptoire dans ses affirmations, et nombre de développements aussi, souvent les plus intéressants voire les plus émouvants, sur une trajectoire personnelle chaotique qui fut celle également d’une partie de sa génération, nourrie de situationnisme et d’électro-punk, de SF et de substances diverses…
Et l’écrivain là dedans ? Il y est certes aussi, mais souvent épars, relâché quant à l’expression, sentencieux, parfois même assommant, profus et confus. Les poèmes qu’il égrène au fil de ces pages ne relèvent en rien de la réelle poésie qui fulgure dans ses romans, et si telle page endiablée relève de sa bonne verve (« Allez, zoukez, zoukez les zombies de la plage Inifinity Beach»…), l’ American Black Box fait plutôt figure de « foutoir » d’urgence, assez au-dessous des deux premiers volumes du Théâtre des Opérations.
Ce qui pèche, surtout, c’est que le Dantec d’American Black Box est essentiellement idéologue, alors que c’est le conteur, le poète au sens large, le fou visionnaire et fictionnaire de Villa Vortex et de Cosmos Incorporated et d’une partie de Grande Jonction qui en font, indéniablement, l’un des romanciers français les plus singuliers du moment.
Autant dire que si ce livre déçoit et si, plus généralement, l’évolution de Dantec a de quoi inquiéter, ce n’est pas tant à cause de ses « positions » et autres provocations visant le « politiquement correct », qu’au risque de le voir sacrifier son indéniable génie créateur à un catéchisme doctrinaire. On a vu cela chez Philip K. Dick, fondu en ésotérisme vaseux, comme on la vu chez Gogol, finalement liquéfié de religiosité ou encore avec un Alexandre Zinoviev, contempteur génial de l’idéologie qui sombra finalement dans la paranoïa…
Quant au gros titre de la revue « branchée» Technikart qui, dans sa livraison de février 2007, posait la question Dantec mérite-t-il une Fatwa ?, on le mettra au compte d’un goût du scandale équivoque - agression médiatique irresponsable à laquelle l’écrivain prête évidemment le flanc…
Maurice G. Dantec. American Black Box. Albin Michel, 690p.
Ces « maudits » qu’on fabrique
Qui sont les auteurs infréquentables ? Antisémites ? Fascistes ? Réactionnaires chrétiens ? Esprits réfractaires au « politiquement correct » ? Telles sont les questions que pose, incidemment, la lecture de la livraison hors-série de La Presse littéraire, dirigée par Joseph Vebret, intitulée Les écrivains infréquentable et rassemblant, sous une vingtaine de signatures, une palette d’auteurs dont aucun ne semble « à fusiller » même platoniquement, sauf Brasillach qui le fut bel et bien.
Si les « maudits » avérés que sont le super-fasciste Rebatet, Céline l’antisémite ou Matzneff le pédophile, ne figurent pas dans le choix (partiel et forcément aléatoire) de Juan Asensio, ordonnateur et présentateur du numéro, la qualité de franc-tireur pourrait être ce qui associe un Dominique de Roux (avec quatre lettres inédites flamboyantes), et l’essayiste Philippe Muray, récemment disparu, le philosophe allemand Carl Schmitt et l’essayiste espagnol Nicola Gomez d’Avila (un vrai réac, ah ça !), l’imprécateur catholique Léon Bloy et son « disciple » Dantec, notamment.
A la question de savoir ce qui rend un écrivain « infréquentable », Juan Asensio répond par quelques approximations intéressantes liées à l’affirmation par ceux-là d’une position de droite ou d’une foi déclarée, pour se demander finalement si la liberté d’esprit, voire l’opprobre des censeurs ne sont pas les critères d’exclusion décisifs, en fonction de normes variables. Ainsi Corneille sera-t-il jugé « macho facho » par des profs « évolués », alors que les médias grilleront Renaud Camus pour un seul « dérapage », aussi peu criminel à nos yeux que celui qui valut sa fatwa à Salman Rushdie. Quant à Paul Léautaud ou Witold Gombrowicz, originaux s’il en est mais encore moins « fusillables » que les autres, ils rappellent ici que la vraie littérature n’est jamais infréquentable que pour ceux qui n’ont de cesse de la mettre au pas…
La Presse littéraire. Hors série no3. Spécial Ecrivains infréquentables. Mars/Avril/Mai 2007.Ces deux articles, en version raccourcie pour ce qui est du premier, sont à paraître dans l'édition de 24Heures du 6 mars 2007.
-
Sur les infréquentables
Réponse à Juan Asensio.
Un écrivain peut-il tout dire ? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective ? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect ? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure ? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables ?
Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais fou de l’écriture, auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme ; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase qui chantait. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le trait
 é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...
é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...
En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz ? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite ? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable ?
 Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.
Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.
Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à les fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.
Plus je vais et plus la littérature me semble le lieu de la relation et non de la séparation, de la continuité et non de la rupture, de la fécondité et non du repli sur soi. Je comprends qu’on la trouve aujourd’hui menacée et vilipendée, mais je vois aussi qu’on la comprend mal. J’essaie de comprendre ce que dit Juan Asensio dans L’infréquentable est le révolutionnaire le plus abouti, et je vois que des notions séparatrices, pour ne pas dire sectaires, contredisent absolument une exigence de liberté qui accorde ou dénie la qualité en fonction de jugements restreignant précisément ladite liberté. Ainsi célèbre-t-on le style, en référence au « grammairien par excellence » que serait Dieu, pour mieux rejeter un Julien Gracq ou un Francis Ponge, stylistes manquant en somme à la foi si je comprends bien, moi qui trouve pourtant chez Ponge et Gracq bien plus de pages vivantes et vibrantes que chez un Renaud Camus, dont la seul qualité est probablement de penser un peu, parfois, à contre-courant - sans style aucun hélas, à mon goût tout au moins.Mais penser mal est-il, au fait, une qualité suffisante à faire un écrivain ? Juan Asensio s’interroge sur ce qui fait le propre d’un infréquentable, sans parvenir vraiment à se convaincre de ses approximations successives, et c’est tant mieux. On ne voit pas bien ce qu’est « le révolutionnaire le plus abouti », pas plus que ce qui distingue celui qui assume ses positions (de droite évidemment) ou sa foi (catholique résolument) équivaut à un brevet d’infréquentabilité, ni moins encore la qualité de « logocrate » chère à George Steiner, qui ne connaît aucune frontière idéologique. Est-ce l’ « échec social des antimodernes » qui les valorise alors ? Quelle dérision ce serait, que de considérer qu’une réussite sociale fasse ainsi illusion. D’un glissement l’autre, Juan Asensio finit donc par établir que l’infréquentable serait « d’abord et avant tout un homme libre », ou bien encore « celui qui dérange les Assis », à moins que, der des ders, l’infréquentable ne soit « qu’une notion sans consistance autre que celle que veulent à tout prix lui donner les censeurs, un non-lieu où sont prudemment relégués celles et ceux qui ont osé et osent affronter les minables catégories érigées par la bouche anonyme de « l’universel reportage ».
Il y a du vrai dans tout cela, mais beaucoup de rhétorique aussi, à base d’idéologie. La littérature excède ces limites. Or il est intéressant, à lire attentivement les textes (très inégaux eux-mêmes) réunis sous le fronton de ces Ecrivains infréquentables, combien se mêlent les goûts et les idées, les partis pris et les conclusions hâtives, la liberté de jugement et les âneries à œillères. La vraie critique littéraire demande de l’humilité et de la précision, de l’amour et des citations. On en trouve heureusement, par exemple dans le texte de Sarah Vajda consacré à Corneille, ou dans les introductions à Dominique de Roux, Léautaud ou Nicolas Gomez Davila, entre autres. Mais ce que je préfère dans cette revue, c’est que l’oreille de la liberté pointe bel et bien un peu partout, avec des éclats de littérature. Une ou deux lettres de Dominique de Roux et c’est parti. Ensuite, infréquentables ou pas, reste à voir sur pièces. Car cela seul est intéressant : le détail et non la catégorie. Le détail, pour aller voir ailleurs, c’est In memoriam de Paul Léautaud, notes griffonnées au chevet du père agonisant, c’est relire Corneille et s’en amuser en se foutant des nouvelles conventions le classant républicain pro-Bush. C’est lire Gombrowicz dans son Journal et le Gombrowicz de Dominique de Roux, c’est relire Bernanos qui est au purgatoire plus qu’au placard des infréquentables, c’est lire Post Mortem ou Ma confession de Caraco, c’est lire Ponge et Michaux aussi volontiers que Suarès ou Darien, c’est lire Giorgio Agamben qui lit Carl Schmitt qui lit Dostoïevski ou Bloy, c’est lire Bloy contre Zola et Jules Renard contre Bloy.
Vous avez raison finalement, Juan Asensio : les infréquentables ne le sont que par délation médiocre. Nul écrivain de qualité, nul penseur de valeur n’est infréquentable. Mais les médiocres se fréquentent, et ça fait du monde place de Grève… -
Léautaud à vue de chien
Le point de vue de Fellow. Et la (superbe) réponse d'Ygor Yanka.
Je m’étonne au plus haut point, à vrai dire, que nos amis les hommes puissent classer un être de la qualité de Monsieur Léautaud au nombre des infréquentables. En tant que simple chien, et chien lecteur qui plus est, ce qui légitime doublement mon témoignage, je tiens à rappeler ce qu’un jour, inspiré par une sensibilité que ne partagent pas tous les gens d’Eglise, l’abbé M. n’hésita pas à dire à notre place : à savoir que, le jour où Monsieur Léautaud se présenterait à la porte du Paradis, où l’on verrait le prudent saint Pierre hésiter, peut-être même renauder à l’idée de recevoir ce qui semblait un bien mauvais coucheur, un tel concert d’acclamations de tous les chiens et les chats qu’il avait sauvés sur terre de la faim, de l’abandon ou des mauvais traitements, s’élèverait, qui ferait alors le Seigneur lui-même se déranger pour l’y accueillir.
Je sais bien que c’est une façon de parler, car Monsieur Léautaud n’avait guère de penchant mystique ou religieux. Le vague, le faux mystère et les simagrées lui faisaient horreur, et le seul mot d’ « âme » lui tirait des ricanements à la Voltaire ponctués de véhéments coups de canne. Pourtant il restait en lui cette zone hypersensible de l’éternel enfant abandonné, nostalgique à jamais de la moindre tendresse maternelle, et le cœur bronzé par la dureté de son père, auquel le spectacle de la cruauté frappant tout innocent, et l’animal le premier qui ne peut se défendre, était intolérable.
Monsieur Léautaud préférait la compagnie des animaux aux hommes, mais c’était pour être plus tranquillement seul. Monsieur Léautaud n’était pas pour autant le misanthrope affreux et sale qu’on a dit parfois : c’était un homme au contraire d’une rare élégance, sinon de tournure vestimentaire (encore avait-il une façon unique de porter ses nippes) au moins d’esprit et de langage. Ainsi avait-il la vulgarité de parole en horreur, alors qu’un beau vers mélancolique de Verlaine ou de Jammes suffisait à lui arracher des larmes.
Monsieur Léautaud ne supportait ni les faisans ni les tartuffes, et le sentimentalisme étalé lui faisait horreur, autant dire qu'il eût trouvé de quoi vitupérer par les temps qui courent, mais ce n’était pas moins une âme sensible, je dis bien une âme, et sensible aussi bien…JLK, Portrait de Fellow, 5 décembre 2006.
Cette note de Fellow a été suscitée par la présence de Paul Léautaud dans le choix d'Ecrivains infréquentables sélectionnés et présentés par Juan Asensio dans la revue de Joseph Vebret, La Presse littéraire. L'article consacré à Léautaud, excellent au demeurant, est signé Ygor Yanka. Celui-ci a fait, à notre ami Fellow, une réponse magnifique, dans un texte encore meilleur que celui de la revue. A découvrir sur le blog d'Ygor: http://opusxvii.hautetfort.com/



















