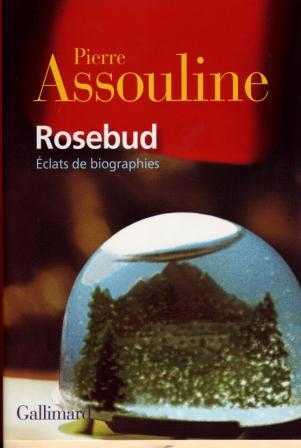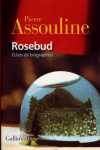De Truman Capote à Jonathan Littell
La scène la plus forte, et la plus émouvante aussi, du film récent consacré à Truman Capote, est celle où l’on voit l’écrivain obtenir enfin, après des années de présence et d’écoute, l’aveu de Perry Smith, l’un des deux tueurs, sur ce qui se passa réellement, d’instant en instant, durant la nuit où lui et son acolyte massacrèrent quatre innocents pour les dépouiller de moins de 50 dollars.
Perry Smith, métis de mère indienne, est celui des deux tueurs qui avait la plus riche sensibilité et le moins de raisons de tuer les Clutter. Or c’est bien lui qui les a égorgés et fusillés, comme il le détaille à Truman, après avoir décidé de les laisser tranquilles tandis que son acolyte, le très primaire et très écervelé Richard, cherchait partout les 10.000 dollars supposés planqués dans la ferme de Clutter. Et ce que Perry précise, c’est que c’est le regard du père, en lequel il a identifié un homme gentil plus que le riche fermier qu’on lui avait décrit, ce regard d’honnête homme appelant la pitié, ce regard qu’il n’a jamais vu à son propre père, qui l’a soudain affolé et l’a fait basculer dans la panique et la folie meurtrière.
Cette confrontation avec l’insoutenable regard de l’innocence, Max Aue, protagoniste des Bienveillantes de Jonathan Littell, l’a observée et vécue personnellement au fil des « actions » auxquelles il a participé, où il a vu des pères de famille, des jeunes gens cultivés et délicats autant que lui, des officiers et des soldats ordinaires « péter les plombs » et devenir des brutes sanguinaires en voyant simplement cela: ces hommes nus et ces femmes sans défense, cette jeune fille que Max exécute soudain ou ces enfants qu’on éventre pour ne plus endurer leurs pleurs…
Reprocher à Jonathan Littell de se complaire dans ces scènes me semble aussi injuste et vain que tous les reproches adressés à Truman Capote, invoquant le penchant de celui-ci pour Perry Smith ou le rôle qu’il a joué dans les recours et les sursis préludant à l'exécution des deux tueurs. Capote en a –t-il pincé pour Perry Smith, qui était beau et avait eu une enfance de misère rappelant à Truman la sienne ? C’est plausible mais ne compte guère à côté de l’extraordinaire effort de recomposition que représente De sang froid, étant entendu que l’écrivain a écouté tous les acteurs et scruté tous les détails de tout le décor. De la même façon, Jonathan Littell a ressaisi sa matière documentaire avec une prodigieuse minutie et un souci de faire parler les faits qui rappelle le « roman-vérité » selon Truman Capote. Littell n’est pas pour autant « le nouveau Capote », pas plus que son livre ne s’apparente aux Maudits de Visconti ou à La guerre et le paix de Tolstoï.
Son livre se suffit à lui-même, dont il ne faut parler, une fois pour toutes, qu’après l’avoir vraiment lu: telle étant aussi bien la lecture-vérité…
Carnets de JLK - Page 194
-
Un regard insoutenable
-
Coups de coeur
Les choix de 3 libraires
Maryjane Rouge
Librairie Payot, Lausanne
 Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.
Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.
«Ce thriller politique est mon coup de cœur ! Très intéressant par son aperçu de la nouvelle réalité sud-africaine, après la fin de l’apartheid, où l’on voit qu’il y a encore beaucoup à faire en matière d’égalité raciale et de justice, il est en outre superbement écrit. Le protagoniste, surnommé P’tit, est en réalité un immense gaillard qui fait figure de héros malgré son passé de tueur des services spéciaux. Au moment où il a décidé d’assagir, amoureux et en charge du gosse de son amie, voilà qu’on l’appelle au secours, et c’est reparti… »
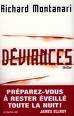 Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.
Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.
«Tous les ingrédients du polar noir haletant se retrouvent dans cette histoire de serial killer à délire mystique, dont la première victime est une adolescente retrouvée mutilée et en posture de prière. Cela se passe à Philadelphie, où un flic un peu rétamé et bordeline enquête avec la jeune Jessica, laquelle assure « un max ». Très bien construit et d’une écriture non moins convenable, ce roman intéresse à la fois par son aperçu des dérives violentes de la religion et par ses personnages, réellement attachants. »
 Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.
Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.
«Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas l’enquêteur favori de l’auteur que nous retrouvons ici, mais un jeune inspecteur angoissé par le cancer qu’on vient de déceler chez lui. A cette mauvaise nouvelle s’ajoute celle de l’assassinat d’un ancien collègue, sur lequel il va enquêter pour se trouver bientôt plongé dans le milieu glauque des anciens nazis et de leurs émules actuels, avec un deuxième crime corsant encore l’affaire. Mêlant suspense et investigation sur un thème de société, Henning Mankell nous captive une fois de plus… »
Claude Amstutz
Librairie Payot, Nyon.
 Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.
Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.
«Le double intérêt de ce livre tient aux contrées qu’il évoque, des Indes aux Marquises ou de Turquie en Bretagne, entre beaucoup d’autres, et aux écrivains qui « accompagnent » l’auteur dans ses pérégrinations, tels Rimbaud ou Cendrars, Loti ou Segalen. Cette double bourlingue nous fait croiser le sillage des mutins du Bounty autant que Paul Gauguin en ses îles, au fil d’un récit littéraire agréable de lecture et très bien écrit, où la réalité est souvent ressaisie par le petit bout de la lorgnette ».
 Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.
Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.
« Ces chroniques ont valeur de fresque d’époque, qui recouvrent la deuxième partie du XXe siècle et sont marquée par le ton très personnel et la « patte » de ce marginal mélancolique qu’était l’auteur d’Un singe en hiver. A ce propos, il revient ici sur les reproches qu’on lui a faits d’exalter l’alcoolisme, avec des nuances aussi malicieuses que justifiées. L’amitié (pour Marcel Aymé, Roger Nimier ou René Fallet) va de pair avec la liberté d’esprit, comme lorsqu’il s’en prend à la haine des « justiciers » de l’épuration. »
 Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.
Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.
« Il vaut la peine de redécouvrir ce roman datant des années 50 dont les observations vives, voire féroces, contrastent avec son écriture un tantinet fleur bleue. Il y est question des tribulations d’une veuve qui ouvre une librairie dans la province anglaise, suscitant la réprobation croissante des gardiens de la conformité vertueuse, et notamment lorsque éclate le scandale lié à la publication du Lolita de Nabokov. Comme on dit que son chien a la peste pour le noyer, tout est bon pour couler la librairie en question… »
Nicolas Sandmeier
Librairie du Midi, Oron-la-Ville
 Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.
Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.
« On retrouve ici les deux vieux frangins du précédent Chant des plaines dans leur ferme perdue du Colorado, après l’épisode qui les a vus accueillir une jeune fille-mère, laquelle est repartie vivre de son côté. La mort d’un des frères est l’événement central de cette suite, qui verra réapparaître la jeune fille auprès du frère survivant. Par ailleurs, l’auteur brosse un tableau plein de relief de la société provinciale, en s’intéressant surtout aux plus démunis dont il détaille de beaux portraits. »
 Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.
Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.
« Le protagoniste de ce roman est un traîne-patins qui se fait virer de la multinationale moscovite où il travaille, dont le boss le récupère aussitôt pour qu’il s’occupe de son jeune fils trop sage, qu’il aimerait encanailler. Le rapport entre le tuteur et son pupille sera marquant pour celui-là plus encore que pour celui-ci, jusqu’à ce que se pointe une femme évoquant Audrey Hepburn. Sur fond de nouvelle société russe, l’auteur de La soif entraîne ses personnages dans de nouvelles virées très arrosées… »
 Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.
Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.
« Après son premier roman à succès, Les soldats de Salamine, Javier Cercas endosse ici son propre rôle en se rappelant un séjour qu’il a fait, dans sa vingtaine, aux Etats-Unis où il a été marqué par la rencontre d’un certain Rodney, ancien du Vietnam qui l’influence notamment par les étonnantes considérations qu’il développe sur la création littéraire, avant de disparaître soudain. Revenu en Espagne, le jeune auteur, auquel son succès donne la « grosse tête », va retrouver par hasard son mentor et en nourrir une réflexion lucide sur sa vie ».
-
Poète de l'instant
Hommage à Pierre-Alain Tâche. Une exposition et un nouveau livre marquent 40 ans de poésie.
« Le poète est un jeune homme aux cheveux blancs, il est myope avec de gros yeux et il y a toujours quelqu’un qui vient de marcher sur ses lunettes », notait Roland Dubillard dans ses carnets, et cette image nous est revenue en lisant Roussan de Pierre-Alain Tâche, qui vient de paraître en même temps qu’un bel hommage est rendu au poète lausannois au palais de Rumine.
On nous objectera que rien, au premier regard, ne rapproche le jeune poète de Dubillard et le digne Pierre-Alain Tâche, figure éminente de la poésie romande qu’on pourrait dire le double héritier de Gustave Roud et de Philippe Jaccottet, dont le personnage de notable bien établi, magistrat en retraite, n’a guère du bohème à lunette fendues.
Or à y regarder de plus près, sans fard social, c’est bel et bien le poète frais émoulu que nous retrouvons dans ce que nous préférons des fusées lyriques de ce Pierre-Alain Tâche qui, il y a quarante ans de ça, avec Greffes puis La boîte à fumée, incarnait le jeune poète à nos yeux adolescents. Depuis lors, l’écrivain régulier a produit son œuvre, riche aujourd’hui d’une trentaine de titres. Or sa poésie, à travers son évolution vers moins de fioritures précieuse et plus de simplicité, a conservé cette fraîcheur du verbe à sa source (laquelle a des cheveux d’écume blanche et des éclats de lunettes en miettes) qui se joue des âges.
D’un recueil à l’autre, Pierre-Alain Tâche a cartographié, bien au-delà de nos régions, une géographie poétique qui sait ressaisir le génie du lieu (autant que Charles-Albert Cingria, Michel Butor ou Jacques Réda) et magnifier l’instant vécu. De notre Cité lausannoise à l’île d’Orta ou, dans Roussan, des bleus salés-sableux de Vindilis (Belle-Île-en-Mer) à tel jardin perdu d’une enfance ou à telle maison close de Semur-en-Auxois, le poète nous lave le regard au fil de mots comme rénovés. Francis Ponge disait qu’il prenait les objets du monde pour les réparer dans son atelier. Tâche s’y emploie lui aussi, avec une sorte d’enjouement amoureux et de gravité légère. Tantôt limpide et tantôt baroque, ludique ou pensive, musique et peinture en contrepoints subtils, la poésie de Pierre-Alain Tache est éloge serein. D’aucuns lui reprocheront d’ignorer l’effondrement des tours de Manhattan. C’est que son horloge est réglée sur le temps des forêts qui repoussent, dont les allées résonnent comme celles de cathédrales…
Pierre-Alain Tâche. Roussan. Empreintes, 109p.
Lausanne. Palais de Rumine. Pierre-Alain Tâche, une poétique de l’instant. Exposition, jusqu’au 31 mars 2007. -
Pépères sur la route

Eric Clapton et JJ Cale réunis
Quand un nonchalant vieillissant de la guitare-broderie rencontre un maxi-relax de la guitare-dentelle, cela ne peut donner dans la frénésie, mais ce n’est pas vraiment ce qu’on attend de la rencontre des deux légendes du blues-rock réunies ici en studio, au son aussi « cool » que le bitume de la route d’Escondido (Californie) un après-midi de soleil mâchant son chewing-gum. On savait l’admiration de Clapton pour l’auteur de Cocaïne et d’After Midnight, qu’il a dignement défendus naguère, et c’est lui-même qui a pris l’initiative de cette rencontre au sommet… de moyenne hauteur. Du moins les deux « pattes », et les deux voix au même moelleux, se mêlent-elles agréablement au fil de ces quatorze compositions, dont JJ Cale signe la plupart.
Cela part avec un Danger sans risque, et la suite genre country-folk, avec Heads in Georgia et cinq ou six autres titres, reste fort sage et même lisse, avec de beaux moments tout de même (le solo frémissant d’Albert Lee sur Dead End Road, avec Taj Mahal à l’harmonica) pour rejoindre (dès Hard to Thrill) un blues-rock plus fusionnel qui trouve sa meilleure expression à la toute fin, avec Ride The River, d’un lyrisme country chaleureux où les deux voix et la paire de six cordes flambent doucement et sûrement, scellant une rencontre plus « historique » qu’inoubliable…
J.J. Cale et Eric Clapton. The Road to Escondido. Warner Music -
L’aura de la lecture
En lisant Rosebud de Pierre Assouline (1)
Il est certains livres dans lesquels on se trouve tout de suite bien, et c’est ce que je me suis dit après avoir lu le premier chapitre de Rosebud de Pierre Assouline, dont le sous-titre, Eclats de biographies, annonce la forme fragmentaire et la réfraction des travaux du biographe. Tout de suite j’y ai trouvé cette espèce d’aura intime qui signale à mes yeux le cercle magique dont parlait Henry James à propos de la fiction, et qu’on retrouve, hors du temps et des lieux, dans l’extrême présent ou l’extrême présence d’un livre, d’une pièce de musique, d’un tableau ou d’un film, et souvent par la grâce d’un détail cristallisant dans la mémoire à la façon de l’image dans le tapis. Or justement c’est sur un tel détail que s’ouvre Rosebud : sur la boule de cristal contenant un paysage de neige qui fait rêver Citizen Kane, le vieil homme surpuissant qui se rappelle la luge de son enfance. D’Orson Welles au petit pan de mur jaune de Vermeer évoqué dans la Recherche du temps perdu ou au lustre de Baudelaire, en passant par divers autres détails qu’il dit les « refuges des merveilles de la vie », jusqu’au bar de la rue Delambre dont il aime à retrouver l’ambiance jazzy, à l’enseigne précisément du Rosebud, Pierre Assouline entreprend une sorte de rêverie «d’après objet », comme le « d’après nature » du peintre, qui prolonge ou reprend ses interrogations de biographe, en quête des « ombres de vérité » et du « détail juste » propre à chaque auteur.
J’avais commencé de lire Rosebud le soir même d’une journée mélancolique durant la matinée de laquelle j’avais déballé, de ses cartons, la bibliothèque de la mère défunte de ma bonne amie, dont les livres étalés racontaient l’histoire, à commencer par ce gros volume tout cassé, plein de coupures de presse que notre chère K. avait scrupuleusement découpées et insérées dans la biographie de Simenon par Assouline, précisément, dont je trouvai, le même jour dans mon courrier, le Rosebud aimablement dédicacé.
Immédiatement touché par le ton et les images de Rosebud, et très intéressé aussi par les figures évoquées au fil du livre (Kipling, Celan, Bonnard, notamment) j’ai proposé à Pierre Assouline de nous rencontrer pour en parler, et quelques jours plus tard un rendez-vous était fixé, que je fus contraint d’annuler pour cause imprévue; sur quoi j’égarai Rosebud. Pendant une semaine: plus moyen de le retrouver et donc plus moyen de l’annoter comme je le fais de toutes mes lectures. Or je savais qu’il n’était pas sorti de nos murs, mais plus moyen de mettre la main dessus. Ainsi l’ai-je racheté, pour en reprendre la lecture en commençant par le dernier chapitre, consacré à Bonnard.
Pierre Assouline dit avoir de la peine à conclure Rosebud, comme Bonnard peinait à ne pas ajouter une touche de lumière à ses tableaux, jamais vraiment achevés. « Une fin ouverte caractérise la roman moderne », note Assouline au début du chapitre, me rappelant aussitôt les réflexions de Jean-Yves Tadié sur Le roman au XXe siècle, que je suis toujours en train de lire, en même temps que je lis tout le temps Proust. Et que signifie cette « ouverture », de L'Homme sans qualités de Musil à la Lectrice à la table jaune de Matisse ? Aveu d’impuissance ouvert à l’exaltation esthétique du non-fini chère aux minimalistes à bout de souffle, ou réplique à la « tyrannie du fini » ? Le silence de Bonnard me semble une bonne réponse à cette question, à moduler d’objet en objet, « d’après nature » comme aurait dit Cézanne laissant le blanc affleurer comme un autre ciel… Je sais que je retrouverai mon premier exemplaire de Rosebud, probablement égaré dans les strates de la bibliothèque de notre vieille dame aimée. En revanche jamais je ne retrouverai le Rosebud de Vladimir Nabokov, ce petit Argus bleu dans sa pochette de papier transparent que le grand écrivain, en reconnaissance de ses soins, offrit à mon ami médecin R., qui me le donna à son tour pour me remercier de tous les livres que je lui avait fait découvrir. Le petit papillon s'est perdu au fil de mes déménagements; il a dû s'envoler alors que je déballai ma bibliothèque, une fois ou l'autre, mais son souvenir me restera tant que je vivrai et que vivra en moi le souvenir de mon ami de jeunesse tombé dans la face Nord du Mont Dolent, il y a tant d'années déjà...
Je sais que je retrouverai mon premier exemplaire de Rosebud, probablement égaré dans les strates de la bibliothèque de notre vieille dame aimée. En revanche jamais je ne retrouverai le Rosebud de Vladimir Nabokov, ce petit Argus bleu dans sa pochette de papier transparent que le grand écrivain, en reconnaissance de ses soins, offrit à mon ami médecin R., qui me le donna à son tour pour me remercier de tous les livres que je lui avait fait découvrir. Le petit papillon s'est perdu au fil de mes déménagements; il a dû s'envoler alors que je déballai ma bibliothèque, une fois ou l'autre, mais son souvenir me restera tant que je vivrai et que vivra en moi le souvenir de mon ami de jeunesse tombé dans la face Nord du Mont Dolent, il y a tant d'années déjà...Pierre Assouline. Rosebud. Gallimard, 219p.
Jean-Yves Tadié. Le roman au XXe siècle. Belfond, repris dans Pocket Agora.
Vient de paraître: Jean-Yves Tadié, De Proust à Dumas. Gallimard, 394p.
-
Actualité de Cendrars
Dernières parutions
L'actualité de Cendrars est relancée ces jours par la publication de quatre livres marquant, du même coup, la fin de la réédition des Oeuvres annotées par Claude Leroy, chez Denoël. Avec les volumes 13, 14 et 15 de cette série s'achève ainsi une édition assortie d'un appareil critique léger. Le dernier volume, reprenant les fameux entretiens de Cendrars avec Michel Manoll, Blaise Cendrars vous parle... illustre parfaitement le travail de mise en perspective de Claude Leroy, qui détaille par exemple les circonstances dans lesquelles ont été réalisés ces entretiens et l'énorme travail de refonte accompli par Cendrars pour le passage de l'oral à l'écrit.
Autre transcription passionnante relevant du même genre: Celle de Qui êtes-vous ?, émission de radio qui rassemble ici, autour de Cendrars, divers interlocuteurs (dont les écrivains Emmanuel Berl et Maurice Clavel) qui s'affairent à pousser le poète dans ses derniers retranchements, d'où il échappe le plus souvent avec des prodiges de malice affabulatrice ou de mauvaise fois. Un certain Dr Martin, jouant les psychanalystes, parvient cependant à le transporter, soudain, sur le terrain de l'absolue sincérité, et tout l'entretien s'en trouve éclairé d'une autre lumière. La pauvre Berl ne semble pas bien comprendre à quelle sorte de vérité se réfère Cendrars, alors que les propos de celui-ci tissent une véritable profession de foi poétique sur fond, quelque peu inattendu, de pessimisme philosophique nourri de Schopenhauer.
Le continent Cendrars n'a cessé, ces dernières années, de se trouver cartographié par moult diligents chercheurs tous plus ou moins liés au Fonds Cendrars des Archives littéraires suissses. Ces travaux ont nourri, comme elle le révèle d'entrée de jeu, la nouvelle édition de la grande biographie de son père dont Miriam Cendrars avait publié une première mouture en 1984. Monumentale, cette biographie entremêle le récit d'une vie et les innombrables écrits procédant de celle-ci ou la réinventant, d'une manière incessamment créatrice. Fils d'un inventeur raté qui s'inventait déjà tout un monde dans ses palabres de bistrot, le jeune Sauser devenu Cendrars a passé par une multitude d'avatars souvent peu connus, parfois peu glorieux, mais dont l'ensemble constitue bel et bien une légende de la littérature du XXe siècle.
Deux affabulations du poète, rapportées par Claude Roy
"Blaise Cendrars, quand je le rencontrai, était un vieil homme. Manchot, boucané, la trogne d’un adjudant de la Coloniale qui aurait eu du génie dix minutes avant Apollinaire. La prose du Transsibérien, les Pâques à New-York : mon cœur bat toujours en lisant ces poèmes.
Un grand malheur avait frappé Cendrars : la mort de son fils. Un peu de hargne aussi l’avait atteint, comme un peu de mal-mûri gâte une vieille pomme rouge : Cendrars était, tout compte fait, un célèbre méconnu. Il consolait sa grande peine, et ses petits ressentiments, en fabulant à sa machine à écrire. Un de ses livres d’alors s’intitule Histoires vraies. C’est hâbler dès le titre. Cendrars galopait au large du réel.
Un jour, j’avais été lui rendre visite à Aix-en-Provence. Pendant tout le déjeuner il m’avait parlé du célèbre tableau du Maître de l’Annonciation d’Aix. Je n’avais pas de chance. La toile était justement en voyage. Elle avait quitté l’église de la Madeleine, envoyée il ne savait où pour une de ces expositions temporaires qui font voir du pays aux chefs-d’œuvre. Mais ça ne faisait rien : Cendrars avait exactement le tableau dans l’œil. Il le connaissait comme sa poche. Il l’avait étudié pendant des mois et des mois. Il avait même fait à son sujet des découvertes capitales. Il avait acquis la certitude que l’auteur de cette Annonciation était un de ces satanistes déguisés en peintres pieux qui abondaient au XVè siècle.
Ils camouflaient sous une orthodoxie apparente leurs blasphèmes et leurs défis. La preuve, c’est que le bouquet qui, dans l’Annonciation d’Aix se trouve aux pieds de la Vierge est composé sournoisement de toutes les fleurs chères à Satan, et aux treize mille démons, Séddim, Schirim, Bélial, Belzébuth et leur cohorte sulfureuse.
Le peintre avait rassemblé dans un pot de cuivre la flore de l’enfer : le chardon stérile, la racine de houx, la mandragore, l’iris noir, toutes les fleurs du jardin du mal. Cendrars était intarissable sur ses découvertes. Il les étayait d’une scintillante érudition où les traités de démonologie, les Pères de l’Eglise, les descriptions des théologiens de l’Eglise syriaque, l’Histoire de la Magie en France du bon Garchet et les traités persans d’astrologie venaient à la rescousse.
Après le déjeuner, nous allâmes en flânant jusqu’au Musée, et dans la seconde salle, je tombai sur la toile de l’Annonciation d’Aix. Elle y était accrochée temporairement, parce qu’on faisait des travaux dans l’église de la Madeleine. Je me précipitai sur le bouquet dont Cendrars m’avait entretenu pendant une bonne partie du déjeuner. Pour découvrir que le peintre avait représenté avec autant d’amour que de minutie, non pas les végétaux vénéneux que m’avait décrits le poète, mais (plus innocemment) deux lys blancs, une campanule bleue et une rose rouge.
« Regardez, Cendrars ! » M’écriai-je.
Il se pencha, examina avec un œil stupéfait le bouquet que je lui désignai, se releva avec une expression souveraine d’indignation :
« Ah les salauds !s’écria-t-il : ils ont fait des repeints ! »
L’année suivante, après une journée à Aix en compagnie de Cendrars, il m’emmena boire à la fin de l’après-midi le verre des adieux dans un petit bar du cours Mirabeau. Il ne pouvait m’accompagner jusqu’à la gare, où j’allais prendre le train, mais avait décidé de faire un bout de chemin avec moi.
« Vous avez vu, me dit-il, le patron de ce petit bar devant lequel nous venons de passer ? C’est Charlot, un vieil ami à moi. Ah si nous avions eu le temps, j’aurais aimé que vous bavardiez avec lui ! C’est un personnage étonnant. Il est bistrot, mais il a en même temps la passion de l’archéologie, des vieilles pierres, de l’histoire. Pendant l’occupation, c’est lui qui a organisé l’évasion des résistants de la prison d’Aix. »
« Quelle évasion ? » demandai-je.
« Oh ! tous les journaux en ont parlé. On a même décoré Charlot après la Libération . Il était peut-être le seul aixois à connaître l’existence du souterrain creusé au Moyen Age, un souterrain qui réunissait le Palais de Justice à la place où avaient lieu les exécutions capitales. Charlot a réussi de sa cellule à en trouver le tracé, à creuser au bon endroit pendant des nuits avec ses camarades, et finalement à y faire passer douze personnes avec lui, qui attendaient d’être fusillées par les Allemands. Une nuit, ils ont filé et les Allemands ne les ont jamais rattrapés. »
Je quittai Cendrars, arrivai à la gare, pour m’apercevoir que j’avais raté mon train. Schéhérazade ne donne pas la vertu d’exactitude à ceux qui l’écoutent. J’avais deux heures à tuer en attendant le prochain départ, et je décidai de retourner bavarder avec le nommé Charlot.
Il fut très aimable. Dommage : il n’avait jamais été en prison sous l’occupation. Il n’y avait malheureusement eu aucune évasion de la prison ni du Palais de Justice. Personne n’avait entendu parler du fameux souterrain qui réunissait la Conciergerie à la place des exécutions capitales.
Mais quoi ? Quel mal y avait-il là ? Cendrars avait été heureux deux heures. Je l’avais été avec lui..."
Propos rapportés par Claude Roy in Somme toute, anatomie du mensonge. Paris Gallimard.1976. Page 215-217.
Photo de Robert Doisneau: Blaise Cendrars et les Gitans d'Aix-en-Provence.
Cette citation de Claude Roy a été retrouvée par Bona Mangangu, citée sur son blog (cf liens ci-contre). -
Quel esthétisme nazi ?
Sur la prétendue complaisance de Jonathan Littell
D’aucuns, entre autres comparaisons aventurées, ont rapproché Les Bienveillantes des Damnés de Luchino Visconti, et voici qu’un jugement se répand selon lequel Jonathan Littell contribuerait, avec son roman, à une esthétisation du nazisme tel qu’un autre film, Portier de nuit de Liliana Cavani, l’a indéniablement inscrit dans notre mémoire visuelle.
Je viens pour ma part de revoir Les Damnés, film admirable au demeurant et qui joue, à l’évidence, sur la fascination esthétique qu’ont pu exercer la dramaturgie et les images du nazisme. La scène fameuse de la Nuit des longs couteaux, d’un érotisme à la fois glamour et glauque qui finit dans le mélange du foutre et du sang, reste emblématique à cet égard, autant que les figures du SS blond Aschbach et de l’androgyne Helmut Berger. Pour autant, cette esthétisation évidente du paganisme noir du nazisme ne se réduit pas à une apologie qu’en ferait Visconti, mais c’est là un autre débat.
Ce qui est sûr à mes yeux, c’est que l’esthétique du film n’a strictement rien à voir, mais rien, avec celle des Bienveillantes, dont pas une page ne marque la moindre exaltation lyrique des figures du nazisme. Or un autre rapprochement me semble bien plus pertinent que celui-là, et c’est celui qu’il faut faire avec Pompes funèbres de Jean Genet, qui est ni plus ni moins que l’apothéose de la représentation érotico-poétique du nazisme en littérature. Du début à la fin de Pompes funèbres, d’une écriture somptueuse qui n’a rien à voir avec celle de Littell (lequel a d’ailleurs traduit Genet, sauf erreur), l’on pourrait dire que tout bande pour les figures idolâtres essentiellement phalliques du nazisme. Le texte bande, si l’on peut dire, pour le drapeau et la moto, les bottes et les casques, ainsi de suite. Qu’ils soient Boches enculeurs ou miliciens enculés (pardon pour ces termes mais Genet ne fait pas dans l’euphémisme verbal plus que Littell), les personnages de Genet participent d’un cérémonial érotique et guerrier dont les emblèmes du nazisme exaltent une fascination constante, vouée à l’exaltation de la trahison et à la mort. Mais rien, absolument rien de cela ne se retrouve dans Les Bienveillantes. Max Aue lui-même - qui n’est pas Littell faut-il le rappeler ? – ne « bande » jamais pour aucun de ces emblèmes esthétiques. D’ailleurs ce n’est guère un visuel de culture. Son goût le plus intime est essentiellement littéraire et musical, du côté de Bach et de Couperin, Rameau ou Monteverdi. A Wagner, dont l’esthétique est évidemment plus proche des pompes nazies que celle du Cantor, seul Rebatet le fasciste, indiscutablement fasciné par la brute barbare, fait allusion en passant.
Dans les grandes largeurs, enfin, rien ne permet formellement d’établir la fascination du romancier lui-même pour l’esthétisme nazi, ni moins encore de prétendre que son livre en est imprégné.
L’érotisme de Max Aue n’est jamais esthétisé : il est ce qu’il est, vertigineusement pulsionnel et visqueux. Aucun des personnages du roman n’est stylisé de manière flatteuse ou équivoque. Aucune des scènes du roman ne relève de la mise en scène d’un Visconti ou du trouble panique d’un Genet. Les Bienveillantes ne procèdent pas par fascination, au sens où l’on trouverait une beauté diabolique à l’horreur, mais par sidération. S’il y a de la beauté éparse dans le roman, elle n’est jamais liée au nazisme lui-même ou à ses figures. C’est une vision lointaine et fugace des crêtes du Caucase, le sourire d’un vieux Juif accueillant la mort en toute sérénité, ou les gestes d’une femme qui nous rappelle que la compassion existe jusque dans ces enfers. Littell ne vise jamais à édulcorer ceux-ci. Ce roman n’acclimate en aucun cas le nazisme mais nous traverse comme le pire cauchemar qui soit. Le sentiment dominant qui émane des Bienveillantes est une tristesse indicible… -
Avec vue sur la mer

Je m’en suis tenu, maman, à ta règle de ne pas s’en laisser conter. J’ai résolu, en me rappelant ce que tu m’as appris, de ne suivre que mon instinct, sans m’occuper de ce que les autres pensaient ou disaient. Je ne me suis pas laissé piétiner, et c’est à cause de ça que nous nous sommes trouvés finalement elle et moi, je te parle de Marie-Ange.
Mon projet c’était d’assumer, comme ils disaient. J’avais été ébranlé par le départ de Vera. Je ne m’étais pas rappelé tes préventions à son égard. Je m’étais dit que peut-être elle avait raison - que c’était moi qui déraillais. J’ai donc hésité, puis je me suis ressaisi.
Elle m’a dit que j’étais un taré. Elle m’a dit: tu dois être un pervers, oui c’est cela tu es un pervers, tu me fais gerber. Elle a dit ça. Elle voulait me faire mal. Elle ne supportait pas l’idée que j’aie mes propres goûts. C’était comme en musique: elle n’admettait pas que j’apprécie Frankie Laine et Dolly Parton. Elle aurait voulu que je m’en remette entièrement à elle: elle prétendait que la country était barjo et qu’elle, Vera, ne pouvait simplement pas tolérer qu’on joue de la country ou du folk sous son toit. Par rapport à mon goût particulier, elle m’a dit que j’étais un vicieux, mais là je me suis défendu en lui rappelant que c’était elle qui m’avait conseillé de me libérer quand on s’était rencontrés, puis que c’était elle qui me l’avait fait la première fois.
A part ça, même si ma tendance n’était pas tellement revendiquée alors en tant que telle, j’avais pour moi toute le nouveau trend de l’époque. Partout, à ce moment-là, tout le monde ne faisait que répéter: vivez votre fantasme, affirmez votre désir, affichez votre différence. Tout le monde s’assumait en long et en large. Il n’y en avait partout que pour la différence et c’est ce qui m’a poussé à sortir du bois à mon tour.
Mais là-dessus, pour y parvenir, il est vrai qu’il m’aura fallu du temps et du cran. C’est qu’il faut dire, et là vraiment je ne vais rien te cacher, que ma différence à moi était un peu spéciale.
La réaction de Vera m’avait mis sur mes gardes. Alors même que c’était elle qui m’avait fait flasher là-dessus, je m’étais aperçu que ce jeu amoureux que j’avais redécouvert en sa compagnie, et qui me semblait tout ce qu’il y a d’innocent, ne lui était apparu comme ça que le temps d’une séance alors qu’il deviendrait, d’après ce qu’elle disait, un vice ou une perversion à se répéter.
Quant à moi, je ne voyais pas du tout les choses ainsi. J’avais découvert un truc hyperfort et je m’y tenais. J’avais retrouvé une sensation géniale et je ne vois pas pourquoi j’aurais culpabilisé. D’une certaine manière, aussi, je t’avais retrouvée. Peut-être que je n’aurais pas osé te le dire comme ça, quand tu étais encore là. Peut-être que ça t’aurait choquée, comme quand je t’ai avoué que j’avais bu un verre de notre urine avec Timothée, autour de nos sept ans, mais à présent je te dois cette vérité, c’est une question entre nous, maman, puisque ces moments-là me restent aussi comme mes plus anciens souvenirs de toi, je crois bien.
Je me les suis rappelés surtout à l’odeur. Tout n’était plus alors qu’une affaire de sensation, mais c’est sacrément important: les psychologues le répètent tant et plus. En tout cas moi ça restait le lien le plus fort entre nous.
Tout de suite, quand Vera me l’a fait, je me suis retrouvé tant d’années en arrière, dans une lumière qui devait être celle de la salle de bain aux vitres dépolies de la maison des Oiseaux, je me suis rappelé le dur et le doux de la planche à langer que tu avais installée en travers de la baignoire à pieds de fonte, je me suis rappelé la petite flamme bleutée de la veilleuse du chauffage à gaz que je distinguais d’en dessous et je me suis rappelé des sons lointains qui devaient être ceux de la vie dans le quartier, je me suis rappelé l’odeur de la grosse commission, comme tu l’appelais avec une sorte de reconnaissance, comme si ça te prouvait que j’existais, et peu après je me suis rappelé l’odeur de la crème Nivea qu’on pourrait simplement dire l’odeur de propre en ordre et de sécurité que j’associe aussi à ta présence à chaque fois que j’avais transpiré au cours de mes chères maladies d’enfant et que tu me changeais avant de m’apporter ma tisane, je me suis rappelé tout ça mais je n’en ai pas parlé à Vera, et je me le suis parfois reproché, mais c’était avant de rencontrer Marie-Ange.
Ensuite, par l’imagination, ça a été encore plus géant. Au fur et à mesure que je revivais cette première séance, je retrouvais d’autres sensations et d’autres détails qui me rappelaient notre vie tout au début aux Oiseaux.
Et c’est ça, peut-être, c’est sûrement ça qui a fait paniquer Vera, avec cette intuition que vous avez toutes.
Elle a dû se dire, probablement, que ce que je lui demandais de me faire, là, nous ramenait à autre chose qu’à notre histoire.
Ce qui est certain c’est que c’est à cause de ça que cela s’est gâté entre nous et qu’elle m’a jeté, mais c’est aussi vrai qu’après m’être posé des questions j’en ai eu marre de tout prendre sur moi et que j’ai décidé, avec l’aide de Jean-Yves, d’assumer mon fantasme.
J’avais alors plus de trente ans, mais je me sentais un peu flottant à quelque part. Je n’estimais pas avoir encore trouvé la voie particulière dont tu disais que j’étais digne - toi qui me rêvais plus ou moins soliste dans un orchestre de danse parce que tu m’avais payé des leçons de piano toutes ces années et que ma façon de jouer du Richard Clayderman te semblait fantastique -, mais je sentais que je devais faire quelque chose qui tranche avec la routine de l’agence où je travaillais en intérimaire.
Déjà, d’avoir rompu avec Vera m’a fait du bien, contrairement à ce que j’avais craint. Plus j’y pensais et plus je me disais que cette femme m’aurait empêché de respirer à la longue. Notre collage durait depuis plus de trois ans, avec deux ou trois crises qui t’avaient plutôt réjouie, puis ça a été ton attaque foudroyante qui m’a tellement secoué que je me suis rendu compte que sans Vera je me serais effondré, mais j’avais aussi remarqué, durant cette période où je commençais mon travail de deuil, comme l’appelait Jean-Yves, que Vera était hyperdure et combien aussi, matériellement parlant, elle se montrait calculatrice.
Jean-Yves m’a aidé à me faire à la solitude, c’est lui qui a commencé à me donner à lire des trucs en psycho, il m’a écouté et je lui en ai raconté de plus en plus, un jour que je lui ai dit ma terreur de voir papa débarquer dans son cabinet j’ai fondu en larmes comme un môme et il m’a pris dans ses bras, après quoi les vannes se sont ouvertes et je lui ai tout déballé, toutes nos années, toutes les fois où papa se pointait et finissait par te menacer, d’une séance à l’autre je descendais le courant selon son expression et puis j’ai commencé de le remonter et c’est tout à la fin que j’ai cassé le morceau, un jour j’allais tellement mal qu’il m’a dit que j’avais besoin de quelqu’un et qu’il m’a posé la main sur la cuisse, mais moi je me suis retiré tout de suite en me veillant de ne pas le blesser, il ne l’a d’ailleurs pas du tout mal pris, il m’a même dit que c’était mieux comme ça et c’est alors qu’en toute confiance je lui avoué mon fantasme.
Quand Jean-Yves m’a dit qu’on allait travailler ce sujet-là, je me suis dit, surtout après le coup de la main sur la cuisse, que je devais une fière chandelle à ce type et d’autant plus qu’il avait lui-même une vie à problèmes à ce qu’il semblait.
Pourtant j’étais encore bien loin, à l’époque, d’envisager un coming out que Jean-Yves lui-même ne me conseillait pas. Ensuite de quoi, et ça aussi m’a salement secoué, mais peut-être aussi libéré d’une certaine façon, Jean-Yves a disparu sans crier gare. Comme nous avions espacé les séances, il se passait parfois deux ou trois semaines sans que nous ne nous rencontrions, puis il m’a parlé d’un autre poste qu’il pourrait peut-être décrocher au sud de la France, et finalement c’est par une lettre un peu distante, sur un ton qui m’a plutôt déçu, qu’il m’a expliqué que nous ne nous reverrions pas et que je pouvais continuer la thérapie avec Glenda, après quoi ses adieux étaient plus affectueux et il me laissait son adresse, mais jamais je ne lui ai récrit et d’ailleurs je n’avais plus tellement besoin d’une aide de ce côté, je venais de vendre les Oiseaux, j’avais de quoi survivre quelques années sans travailler, puis j’ai eu envie de revoir du monde et j’ai passé d’un job à l’autre par l’agence et je me suis mis à chercher une partenaire qui me comprendait sans même que j’aie forcément besoin de lui confier mon secret.
Plus précisément, lorsque j’ai commencé de fréquenter les minorités, un sentiment compliqué, joint à ma timidité naturelle, m’empêcha de me livrer.
Un samedi matin que ces groupes défilaient dans les rues du centre ville, je leur avais emboîté le pas, je m’étais mis à manifester avec eux en faveur de la différence, puis un type qui distribuait des tracts m’en a filé quelques-uns à remettre aux passants, et le soir je me suis retrouvé à ce qu’ils appelaient une prise de parole dans le cadre du Collectif Fusion.
Je dois te le dire alors sans détour: tout de suite ça m’a plu. Tout de suite, ces filles et ces garçons qui disaient ce qu’ils vivaient sans tricher, ça m’a vraiment superplu. Je me suis dit: là, Roland, tu vas pouvoir t’assumer.
Cela se passait dans un loft: moi je n’avais rien contre a priori, tu sais, malgré le joli cadre dans lequel nous avons vécu aux Oiseaux. J’étais sûrement le plus vieux du groupe, mais je m’étais fait un look western, j’avais les cheveux longs et je m’étais mis au banjo. On était tous assis à des étages différents, il y avait de la musique qui tournait toute seule et des filles aux pieds nus distribuaient des tasses de thé de menthe. Ensuite de quoi s’est déroulée la prise de parole.
Il y avait un garçon aux cheveux décolorés et aux lèvres noires (je ne te mens pas), appuyé contre un type baraqué en veste de cuir, qui racontait ce qu’il avait enduré en milieu ouvrier, et j’étais touché de voir que tous avaient le même air concerné en l’écoutant.
Il y avait une fille chauve à la voix rauque qui racontait l’abus qu’elle avait subi: elle disait que tout venait de là, mais qu’en somme elle ne le regrettait pas vu qu’elle préférait être comme ça que pareille aux blaireaux, et tout à coup je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment plusieurs façons d’être différent.
Enfin, après deux ou trois autres, un certain Brahim a expliqué ce que ça représentait de voir dans le regard de l’autre le mot bougnoule, et je me suis alors demandé si je pourrais, avec ma différence, être aussi bien accepté que lui et les autres.
En tout cas je n’étais plus tellement à l’aise. J’étais content de m’être rapproché de ces gens que je pouvais écouter et auxquels je montrais ma propre compréhension, mais je les ai observés aussi et j’ai vu comment cela se passait entre eux, et j’ai noté que, très vite, les uns et les autres se rapprochaient ou s’éloignaient au contraire les uns des autres, s’attiraient ou se rejetaient carrément.
Bientôt, en plus, certains ont voulu savoir où je me situais, intrigués qu’ils étaient par mon allure et mes silences. Sans faire trop de mystère je me disais plutôt en recherche et déviais la conversation en promettant de m’expliquer lorsque je m’y sentirais disposé. Comme je ne répondais aux avances ni des uns ni des autres, et que je répandais autour de moi ce fluide que la première tu as identifié chez moi, chacun des camarades se figurait que ma différence s’apparentait plus ou moins à la sienne et que de toute façon je finirais bien par m’exprimer.
Mais comment passer à l’acte ? Comment m’expliquer sans me faire exclure comme je l’avais été par Vera ? Comment leur dire ma différence ?
Toi tu l’aurais compris, ça ne faisait pas un pli, que j’aimais plus que tout être langé, que j’aimais faire dans mes couches et que rien ne me plaisait autant que d’être torché et changé: tu aurais accepté mon fantasme qui, d’une certaine manière, me rapprochait de toi par delà les années; surtout tu aurais apprécié la probité avec laquelle j’étais résolu à l’exposer et à la défendre - mais comment la leur faire accepter si moi-même je m’en gênais encore ?
Eh bien, mon intuition ne m’a pas trompé, puisqu’à la première prise de parole où, enfin, je m’exprimai dans un groupe de conscience du Collectif Fusion, je remarquai aussitôt comme un courant de réprobation passer, ainsi que je l’avais éprouvé avec Vera. Dès que les gens eurent compris de quelle nature était ma différence, je constatai qu’ils se regardaient, puis ils commencèrent de murmurer et il fallut que Régis rappelle que dans le groupe on respectait l’outing de chacun pour que cela se calme.
Depuis ce soir-là, pourtant, j’ai remarqué qu’un fossé s’était creusé entre nous.
Après mon intervention, déjà, les gens m’ont tous plus ou moins évité à la fin de la séance et l’ami de Régis, me prenant à part, m’a parlé de psycho-réparation sur ce même ton de bienveillance accablée qui avait été celui de Vera.
C’est ainsi que je m’éloignai du Collectif Fusion et que, malgré le soutien passé de Jean-Yves et la possibilité de recourir à sa collègue, j’entrai peu après, en dépression.
Je n’ai pas besoin de te faire un dessin: tu as connu cela des années durant. Même si ce n’est qu’aujourd’hui que je commence d’imaginer ta propre dérive, je n’en reviens pas encore de l’avoir supportée moi-même: ça a vraiment été la totale, mais j’ai toujours pensé que tu reçois ce que tu donnes et c’est exactement ce que nous nous disons à présent que nous sommes installés aux Mésanges, Marie-Ange et moi.
Bref, des mois ont passé, et l’internement, les médics et tout ça, mais une fois encore j’avais mon idée et, dès que je m’en suis tiré, je n’ai plus pensé qu’à vivre mon obsession jusqu’au bout non sans avoir remis mes compteurs à zéro.
J’avais d’abord cru, stupide que j’étais, ce que disaient les gens, puis j’avais vu ce qu’ils faisaient; et maintenant je me rappellais que tu m’avais toujours dit de ne jamais me fier qu’à ce que les gens font, et là je peux dire que tu avais raison: j’ai vu que ce qu’ils font n’a rien à voir avec ce qu’ils disent mais je me suis obstiné et désormais, avec Marie-Ange, nous n’avons plus à rendre de compte à personne.
Si je me suis assumé finalement en pratiquant publiquement mon coming out, et si j’ai rencontré Marie-Ange par la même occasion, je ne regrette pas d’y être arrivé par un moyen qui t’aurait déplu de ton vivant, toi qui voyais en l’exhibition la pire calamité de l’époque. J’ai bien mis quelque temps à te l’avouer, mais je ne saurais m’y soustraire. Toi-même me disais que jamais je ne pourrais rien te cacher, même après, et c’est pourquoi je n’ai jamais douté que je finirais par te l’avouer.
C’est pourtant vrai, maman: je me suis exhibé, nous nous sommes exhibés Marie-Ange et moi, nous nous sommes pliés tous deux à la règle du jeu de l’émission télévisée Fantasmes fous, consistant à jouer sur le plateau, en présence de l’animateur et de la psy, la scène de son goût assumé, et probablement cela t’aurait-il contrariée de me voir ainsi langé par Marie-Ange devant des millions de téléspectateurs, comme de me voir ensuite téter Marie-Ange pour accomplir sa propre fantaisie.
Souvent je me suis pris à t’imaginer au milieu du public de ce soir-là. Or, qu’aurais-tu vraiment pensé de tout ça ? Je ne sais pas: je n’en suis pas sûr mais je te demande de le comprendre où tu es à présent.
Ce qu’il y a de sûr, c’est que c’est bel et bien pour m’être assumé que j’ai rencontré Marie-Ange et que c’est notre différence revendiquée qui nous a permis de participer, ensemble, à la finale de Fantasmes fous, au Lavandou, où nous avons gagné Les Mésanges.
Nous avons choisi le nom de notre pavillon avec vue sur la mer en mémoire du quartier des Oiseaux où nous avons passé tant d’années, ce qui nous fait, toi et moi, nous retrouver d’une autre façon encore.
Te souviens-tu, à ce propos, de ce que tu m’avais raconté du premier poste de télévision du quartier ? Les enfants, vous aviez été invités chez des voisins qui avaient les moyens afin d’y voir un épisode de Lassie chien fidèle que tu m’as raconté vingt ans après.
Or, il y a déjà sept ans que nous nous sommes rencontrés, moi et Marie-Ange. Si questions rapports nous en sommes encore au top, nos fameux fantasmes fous nous ont bientôt lassés, et nous savons à présent que nous ne pourrons avoir d’enfant. Un temps, j’ai pensé que nous pourrions prendre un Lassie en mémoire de toi, mais Marie-Ange m’a fait remarquer que le collie laissait trop de poils dans la maison, et tu sais que ce que femme veut...
Ce que je regrette un peu aujourd’hui, c’est que l’extension du lotissement fait que nous ne voyons plus la mer depuis le printemps dernier. Mais rassure-toi: nous sommes très occupés tous les deux par la petite boutique de produits bios que le père de Marie-Ange nous a permis d’ouvrir au Lavandou, et nous avons choisi de renoncer à la télévision pour être encore plus près de la nature, ce qui doit te faire plaisir. Enfin, la maxinouvelle que tu attends sûrement, c’est que je me suis remis au pianola. Où tu es, d’ailleurs, tu dois te réjouir de mes progrès...
Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le maître des couleurs, paru en 2001 aux éditions Bernard Campiche.
-
Désordre mode d’emploi
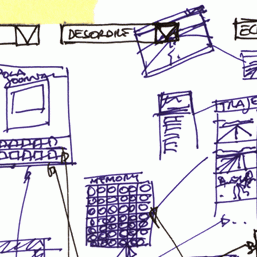
Le labyrinthe de Philippe de Jonckheere, émule de Perec
Connaissez-vous Philippe de Jonckheere ? Vous êtes-vous déjà perdu dans le désordre ? Vous tarde-t-il de refaire la bascule dans le terrier d’Alice ? Alors moteur : vous cliquez illico sur www.desordre.net et belle partance dans un nouveau labyrinthe empruntant à la fois aux folles maisons et aux dédales verbaux de Georges Perec, aux jeux de miroirs ou de marelles de Julio Cortazar ou aux gyroscopies de Michel Butor, entre autres, et je m’en tiens à l’aspect littéraire de ce site arborescent que je viens à peine d’aborder ce matin même. Or il y a là-dedans, comme aux puces et dans les brocantes, comme dans telle vieille boîte à outils de père-grand ou telle boîte à ouvrage de mère-grand, mais à la postmoderne, il y a là-dedans un fabuleux bric-à-brac parfois un peu bricole branchi-brancha mais aussi, et notamment dans les bloc-notes du captain Nemo de cette espèce de Nautilus internautique, une vraie recherche formelle et quantité de moments qui relèvent d’une poésie expérimentale immédiate qu’il nous faut aujourd’hui… Pour être juste, sans savoir encore exactement qui fait quoi, je précise que desordre.net est co-signé par Philippe de Jonckheere et Julien Kirch. Ce qui est sûr en attendant, c’est qu’il en sera question souvent dans ces carnets… -
Ramuz côté court
ŒUVRES COMPLETES Deux nouveaux volumes de Nouvelles et morceaux (plus de 1000 pages) enrichissent l’édition universitaire du grand écrivain
C.F. Ramuz, qui publia quelque 170 nouvelles et autre « morceaux » de son vivant, fut-il pour autant un maître du genre au même titre que Tchekhov ou Maupassant, Pirandello ou Hemingway ? Les lecteurs familiers de son œuvre se rappellent, assurément, l’histoire bouleversante du Cheval du sceautier, relatant l’agonie d’un animal-esclave avec la même émotion et la même puissance allégorique qu’on trouve chez Tolstoï sur le même thème, ou la fascinante errance de L’homme perdu dans le brouillard, sur les hauts du col de Jaman, qui devient l’image même de l’égarement de l’homme dans le cosmos.
Ramuz, pourtant, se disait lui-même mal à l’aise dans le genre strict de la nouvelle, dont le rebutaient les « difficultés de composition » et ne correspondant guère à sa nature « contraire à la pure narration ». Plus que d’« histoires » développant un motif au fil d’une rigoureuse intrigue, ses « nouvelles et morceaux » relèvent souvent, ainsi, du portrait, du tableau « d’après nature », de l’évocation ou de la prose poétique. La production de ces textes plus ou moins courts (on verra que les éditeurs y incorporent Le village dans la montagne, comptant plus de cent pages et relevant du « reportage » ethno-littéraire, à la manière de La steppe de Tchekhov) ne l’occupa pas moins tout au long de sa vie et représentent aujourd’hui, dans l’édition critique de Slatkine (La Pléiade s’en tenant à une édition semi-critique), cinq tomes dodus incorporant cinquante inédits jugés significatifs et un appareil de notes pléthorique.
10 centimes la ligne…
Dans la longue et (parfois trop) savante introduction du premier tome de ces Nouvelles et morceaux (1904-1908), Céline Cerny et Rudolf Mahrer expliquent le triple intérêt de ces compositions pour le jeune écrivain révélé en 1905 par Aline : financier, « publicitaire » et expérimental. Tôt résolu à faire carrière d’écrivain de sa seule plume, Ramuz composera, en marge de la composition de ses romans, des nouvelles ou morceaux destinés à une publication rétribuée dans les quotidiens et revues de l’époque, essentiellement en Suisse romande. «Si tu peux avoir le Journal de Genève c’est très bien, on dit que ça paie » lui souffle un ami après ses débuts à La Semaine littéraire, où sa première nouvelle publiée, inspirée par une légende, paraît en 1904 sous le titre de La langue de l’abbesse. L’hebdomadaire est alors un pilier de la vie littéraire romande, campé sur de solides principes moraux et patriotiques et dirigé par Louis Debarge, une des « vieilles lunes » régnantes (c’est ainsi que Ramuz appelle ses premiers commanditaires). N’empêche : le jeune prodige sera vite reconnu et n’aura pas à faire trop de concessions, mais la revue genevoise paie moyennement : 10 centimes la ligne. Le Journal de Genève, dont le directeur cherche à damer le pion à la Gazette de Lausanne en s’alliant les meilleures plumes romandes, lui proposera de meilleures conditions : 30 francs par texte, si possible court. A Neuchâtel, Philipe Godet, autre « vieille lune » qui fera le meilleur accueil à ses romans, lui commande également des textes pour Au foyer romand , mais c’est dans la très littéraire Voile latine que l’écrivain donnera ce qu’il estime (à juste titre) la meilleure nouvelle de ses débuts, Le Tout-vieux, autre bel exemple de l’art bref du romancier-poète.
Excès de jargon
A qui s’adressent les Oeuvres complètes de la présente édition ? Aux seuls spécialistes, ou à l’ensemble du public ? La question se pose surtout à la lecture des Introductions de ces deux nouveaux tomes.
Si la « stratégie » de Ramuz pour survivre et se faire reconnaître est expliquée de manière claire et vivante, et si les grandes lignes de son « programme » poétique, visant à se dégager du régionalisme pour aller « du particulier à l’essentiel » tout en fondant une nouvelle langue sont nettement tracées, les préfaciers du premier tome (et plus encore Vincent Verselle, dans le second) n’échappent pas, hélas, à l’usage d’un jargon technique relevant du charabia pour un lecteur moyen. Ramuz lui-même eût-il été ravi d’apprendre, à propos de la multiplication des « et » au début des paragraphes du Village dans le montagne, que « la récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité » ? N’y a-t-il pas là un signe d’impolitesse et de cuistrerie à l’égard du public non initié ?
Au moins, ne pouvait-on y échapper dans ces introductions supposées donner envie de lire ? Assurément intéressante, même indispensable, pour l’étudiant, le prof de lettres, le critique littéraire ou le lecteur lettré, cette édition critique pèche cependant, ici, par élitisme. Le tir pourra-t-il être rectifié ?
C.F. Ramuz. Œuvres complètes, volumes V et VI. Nouvelles et morceaux, tome 1 (1904-1908) et tome 2 (1908-1911). Editions Slatkine. 525 et 515pp.Portrait de Ramuz,en 1936: photographie de Gustave Roud.
-
Littell Big Goncourt
Consécration méritée de Jonathan Littell, pour Les Bienveillantes.C’est à Jonathan Littell qu’a été décerné le prix Goncourt 2006 pour Les Bienveillantes (Gallimard), roman considéré comme l’événement de la rentrée littéraire, vendu à plus de 250.000 exemplaires et déjà récompensé par le Grand Prix du roman de l’Académie française. Atypiques sur la scène littéraire française actuelle, l’auteur et son ouvrage rappellent l’apparition d’André Schwartz-Bart avec Le dernier des justes, Goncourt 1969. De fait, avant d’être un voyage au bout de la nuit du nazisme accompli par un officier SS d’une lucidité monstrueuse, Les Bienveillantes est un acte humain qui échappe à la littérature, témoignant de l’immense effort d’un jeune Juif américain (39 ans) pour éclairer l’une des périodes les plus déshonorantes de l’histoire de l’humanité. Sans être, du tout, un roman de plus « sur » la Shoah, Les Bienveillantes est une fresque romanesque de 900 pages truffée de personnages incarnés et de situations « pour mémoire ». De l’intérieur, le livre ressaisit la dérive d’un homme intelligent et hypersensible, cultivé, certes très névrosé mais pas plus que tant d’autres, qui se laisse entraîner dans l’industrie de l’extermination par soumission à l’idéologie de la race supérieure.
Un auteur « de terrain »
Des années durant, après avoir accumulé, sur tous les fronts de l’aide humanitaire, une expérience des situations-limites qui le distingue du littérateur ordinaire, Jonathan Littell a réuni une documentation monumentale sur les opérations parallèles de la Wehrmacht et des unités SS (la conquête militaire pour l’une, l’extermination pour les autres) sur les fronts de l’Ukraine et du Caucase, jusqu’à l’enfer de Stalingrad, les camps de la mort et l’effondrement du Reich. Les Bienveillantes n’est pas pour autant qu’un récit documentaire: c’est un vrai roman oscillant entre hyperréalisme et baroque onirique, grands débats et fantasmes morbides, où le lecteur se trouve interrogé, bousculé, parfois choqué à chaque page. Un grand livre
Un grand livre L’attribution du prix Goncourt 2006 à un roman qui a déjà été vendu à plus de 250.000 exemplaires, et qu’a récemment couronné le Grand Prix du Roman de l’Académie française, est-elle justifiée ? Ne peut-on penser, comme lorsque L’Amant de Marguerite Duras fut « goncourtisé », alors qu’il caracolait en tête des listes de ventes, que les jurés du Goncourt auront fait preuve d’opportunisme en « récupérant » le succès phénoménal d’un auteur se disant par ailleurs indifférent aux vanités littéraires ?
Peu importe à vrai dire, puisque Les Bienveillantes est un grand livre. Dans la liste des ouvrages consacrés par le Goncourt depuis 1903, le roman de Littell fait certes figure de « monstre », peut-être moins « pur » ou « parfait », littérairement parlant, qu’A l’ombre des jeunes filles en fleurs de Proust, La condition humaine de Malraux ou Le roi des Aulnes de Tournier, mais incarnant l’honneur de la littérature avec autant de force que ceux-là. Le public l’a reconnu, et c’est déjà prodigieux, s’agissant d’un livre si exigeant. Peut-être Jonathan Littell retournera-t-il à l’action humanitaire après cela ? Qu’importe là encore, puisqu’il laisse, avec Les Bienveillantes, un livre qui fera date dans la mémoire des hommes.
Cet article a pru dans l'édition de 24Heures du 7 novembre 2006.
-
Claude Lanzmann "scie" Les Bienveillantes


La Shoah est-elle une chasse gardée ?
Elle est bien vilaine, bien inélégante vraiment, la façon de Claude Lanzmann de dénigrer Les bienveillantes de Jonathan Littell, comme si le succès de ce livre devait l’inquiéter…
En lisant l’extrait de ses propos recueillis par Marie-France Etchegoin dans la dernière livraison du Nouvel Observateur (« Une documentation impeccable mais… »), m’est revenu le souvenir du Professeur Schwartzenberg téléphonant un soir à une jeune confrère écrivain-médecin (Christian Lehmann) qui avait osé s’exprimer à la TV sur le cancer pour lui lancer : « Le cancer à la TV, c’est moi ! »
Claude Lanzmann déclare notamment, dans le Nouvel Obs’ , qu’il n’y a en somme que deux personnes au monde qui peuvent comprendre Les Bienveillantes : lui et Raul Hilberg, l’auteur de La destruction des juifs d’Europe. S’il reconnaît le travail monumental de Jonathan Littell, Lanzmann insinue, en se contredisant lourdement d’ailleurs, que ce livre n’est pas vraiment « incarné », tout en récusant le droit du romancier à peindre un personnage couturé de complexes et de perversions. Comme si les diarrhées de Max Aue, ses phobies et ses goûts sexuels risquaient de distraire l’attention du lecteur ! A en croire Lanzmann, ce livre serait trop difficile à lire, et surtout, surtout, le fait qu’il soit lu par tant de gens (plus de 120.000 lecteurs après trois semaines…) risque également d'aboutir à une mauvaise lecture… Passons sur les détails : si la mauvaise foi de Lanzmann est moins crasse et futile que celle d’un Angelo Rinaldi, elle est plus attristante pour ceux qui, comme Jonathan Littell lui-même, qui a été bien plus loyal à son égard en reconnaissant sa dette envers le film, ont été marqués par Shoah.
Est-ce à dire que Les Bienveillantes soit le chef-d’œuvre absolu qu’il s’agit de célébrer à genoux sans oser la moindre critique ? Nullement. Il est vrai que ce livre exige un grand effort de lecture. Vrai aussi que le protagoniste n’est pas un compagnon de route des plus gais. Vrai surtout que cette plongée progressive dans le Mal est une épreuve à la fois nerveuse et physique, mais qui me semble absolument pure de toute complaisance et de toute fascination.
Or c’est là que Claude Lanzmann est le plus injuste envers Jonathan Littell : en laissant croire que le romancier est fasciné par son personnage et qu’il se délecte de son abjection. C’est bas. C’est très bas, Monsieur Lanzmann, et les lecteurs de bonne foi apprécireont…
Les Bienveillantes, au demeurant, ne traite pas que de la Shoah. Contrairement à ce que d’aucuns ont déjà conclu sans l’entrouvrir, ce n’est pas une « lamentation juive » de plus (j’emprunte l’odieuse expression à ceux qui la ressassent de plus en plus ouvertement) mais c’est un très grand livre sur le consentement universel au Mal. Ce que vit Max Aue en se soumettant à son idéologie de mort ne concerne pas, cela va sans dire, que le nazisme, même si l’industrie des sieurs Eichmann & Co aura touché à des sommets d’organisation et d’efficacité dans l'extermination – ce que Jonathan Littell montre de l’extérieur et de l’intérieur. Il est vrai, par ailleurs, qu’on aura trop vite comparé le jeune romancier à Léon Tolstoï ou à Vassili Grossman, et que la masse du livre ne « bouge » pas du tout de la même façon que celle de La Guerre et La Paix ou que Vie et destin. Vrai aussi qu'il n'a pas leur amplitude artistique. Mais lui-même est le premier à récuser ces comparaisons hâtives, voire publicitaires, disons: médiatiques.Alors quoi ? Alors rien : lisez Les Bienveillantes, foutez-vous de la rumeur et jugez par vous-même. Pour ma part, je n’ai rien lu cettte rentrée de plus sérieux, de plus bouleversant, de plus réellement nécessaire que ce livre, comme on a pu le dire, et là encore la comparaison a ses limites, de L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne.
-
Littérature
Où il est question des péripéties finales inattendues d’un congrès de gens de lettres. Que la poésie n’exclut pas le kitsch, et que le whisky peut y ajouter certain frémissement de bon aloi.
J’imagine une espèce de fable qui leur flanquerait un vertige subit et salutaire à la fois, du genre de celui qu’éprouve le plus imbu d’entre eux (vous le reconnaissez à la peau de chamois qui dépasse de sa vareuse, avec laquelle il fourbit chaque matin son petit monument) quand il découvre que son nom ne figure pas dans tel ou tel nouveau dictionnaire des lettres contemporaines, ce même vertige qu’on peut éprouver dans l’une des cinq cents librairies japonaises du quartier de Kanda, au beau milieu de la nébuleuse de Tôkyo, ou en évaluant le nombre de gens vivant à l’instant à la surface de la planète dans l’ignorance complète des noms et des oeuvres de Carlo Emilio Gadda, Juan Carlos Onetti ou Ramon Gomez de La Serna.
Je vois un clair de lune à la Musset sur le Haut Lac. A précédé ce qu’on peut dire un crépuscule divin d’arrière-été. L’eau de satin, le ciel de soie rose mauve, tout le bazar propice au jaillissement des citations à la Byron, mais voici que se disloque la compagnie des congressistes du P.E.N. rassemblés sur le pont arrière du bateau à aubes où s’est tenue la conférence de clôture de la nobélisable albanaise Bessa Djirka dont les mots incandescents se détachent encore sur le fond cendreux de tous les autres discours.
Je note sur un bout de facture: faire sentir que Bessa, à la dégaine de vieille fille salutiste, est physiquement (et donc métaphysiquement) mille fois plus présente que quiconque en ces lieux et que chacun de ses mots participe de cette extraordinaire acuité, à vrai dire insupportable à la plupart.
Il y a donc du scandale dans l’air, et je vais le ressentir avec une violence particulière lorsque je serai littéralement pris à partie, à la proue où je me suis isolé pour en fumer une, par notre diaphane poétesse Aube du Perroy flanquée de son inévitable époux légitime à fonction de factotum.
Je ne les ai pas entendus venir mais soudain ils sont là, elle dans sa tunique de vestale du Temple et lui tout empressé petit groom lunetteux; et c’est alors que je suis censé graver dans le marbre la sentence fameuse, lâchée d’une voix blanche:
- Malgré tout la Poësie restera...
C’est adressé à l’Univers dont je ne suis qu’un infime brimborion, mais ça vise aussi le «frère en littérature» (sa dernière dédicace) dont Aube attend qu’il partage le courroux qu’a visiblement suscité chez elle la conférence de la Balkanique.
Je comprends à vrai dire le désarroi de celle que la dame patronnesse de la critique académique locale appelle «notre Emily Dickinson», à qui les propos de la conférencière ont dû paraître iconoclastes au possible. La façon de Bessa de fustiger tout idéalisme lyrique, la violence avec laquelle elle s’en est prise aux idolâtres valéryens de la Forme et autres versificateurs en chambre, enfin sa longue médiation finale sur les illusions de la littérature: tout cela ne pouvait manquer de déranger l’élégant parterre de nos gens de lettres.
Comme je reste impassible, Aube se figure peut-être que je n’ai pas bien reçu son S.O.S. alors que mes radars sont braqués sur elle et que je reçois 5 sur 5 les ondes qui signifient sa blessure d’amour-propre, sa détresse de vieille petite fille dont on a ébréché la poupée de porcelaine, et son juste courroux de croisée d’une cause qui voit son étendard souillé par une infidèle.
Je me suis moqué plus souvent qu’à mon tour des poses d’Aube du Perroy, mais à présent je la vois comme à nu, comme à la douche d’un asile, toute menue fretin livrée aux pluies acides. Je la vois comme je nous vois à l’instant, et c’est encore l’effet des paroles de Bessa: l’Helvétie est un autre radeau de la Méduse et nous dérivons, enfin dépouillés de nos vanités, sous la conflagration silencieuse des astres.
Mais tout cela relève de la fiction, car Aube reste bel et bien, en ce moment, toute figée dans sa réprobation vertueuse, n’attendant que mon assentiment. Quoi que je lui dise, aussi bien, qui ne viendrait la conforter, serait taxé de malséance; et de même en va-t-il des autres mandarins chuchotant ici et là dans la nuit d’été. Non mais vous l’avez entendue ? Mais cette mal élevée que nous recevons avec les pompes! Mais cette espèce de nihiliste!
Je laisse cependant Aube à sa fureur et je pars à la recherche de Bessa que je trouve bientôt seule au bar de seconde classe, devant une bouteille de Chivas déjà plus qu’à moitié vide, et j’en recommande une autre en me présentant comme le nouvel Homère encore inconnu, le Dante lacustre et le Shakespeare potentiel du canton, ce qui la fait sourire et m’accorder une petite place à côté de ses vieilles osses.
Là je me donne le beau rôle, c’est entendu: je fais celui qui serait l’unique à avoir déchiffré la juste parole de la conférencière, quand tous les autres n’y auraient compris que pouic. Mais c’est pour la fable: pour simplifier, juste pour ce qui suit, parce que c’est surtout ce qui suit qui compte - j’imagine en effet une sorte de féerie enfantine à laquelle le scotch va donner sa crâne tournure.
Cela commence au dernier coup de minuit, lorsque la pucendron de Gyrokäster se transforme soudain en belle de nuit. Je lui propose d’abord le tour des chapelles, et Djirka me répond: va pour l’inspection. Donc nous nous mettons en route, je fais le Virgile et nous tanguons de cercle en cercle, de la table des romancières intimistes à celle des prosateurs postmodernes, avec des salamalecs à tous les chefs et cheffes de file, le dramaturge qui monte et l’ enfant terrible qui stagne, les ambitieux et les désabusés, les joyciens et les célinomanes, les vieilles haridelles et les jeunes paons.
Puis nous avisons le chemin de lune, et là-dessus nous allons bras deci bras deça, faisant soudain pencher bas l’Helvétie sous le poids des plumassiers tous accourus à tribord et sidérés à la vision de ces deux-là marchant sur les flots.
Je sais bien que l’image a du plomb dans l’aile, surtout que ça murmure de moins en moins discrètement à l’entour du bar où dame Djirka qui-nous-a-bien-déçus-ce-soir, et ce pauvre K., sont en train d’entacher gravement la dignité du P.E.N.- Club.
Mais c’est alors que l’autre miracle advient, quand Bessa commence de vaticiner à voix haute. Alors là ça change carrément de registre. Là ça devient Bouche d’Or et les enfants sages. Là resurgit tout à coup la poésie vieille comme le monde et toutes et tous vont se rapprocher bientôt mine de rien pour écouter The Voice.
On se fichait pas mal, n’est-ce pas, de ce que Bessa pouvait avoir vécu ou pas jusque-là, n’était la décorative mention de sa dissidence. De ce qu’elle avait réellement enduré, de ses années de proscription ou de cachot, des humiliations publiques, des trahisons de supposés amis, de tout ce qui avait été son lot ordinaire durant toute sa vie jamais alignée: on n’avait à peu près rien à cirer. Et qui connaissait le moindre de ses poèmes ? Qui savait, sur l’Helvétie, plus que quelques formules publicitaires à propos de la fameuse invitée ?
Mais à présent tout prenait chair, tout prenait verbe et chair. Toute menue fretin dans la sorte de sac que figurait sa robe, Bessa s’était mise à psalmodier dans notre langue et tout à coup le temps s’ouvrait comme une conque vaste aux échos de toutes les voix de tous les âges et de partout. Et la pauvre Aube du Perroy, bien soupçonneuse encore, s’était approchée à son tour en se demandant ce que chantait cette sauvage enivrée, puis elle avait demandé de qui étaient ces vers, puis elle avait eu un frisson en reconnaissant quelque chose qu’elle-même aurait peut-être pu chanter, et voici qu’Aube fermait les yeux et qu’une mer de visages aux yeux clos ondulait sous la brise des mots.
La fable serait incomplète si je ne précisais qu’elle m’est venue le matin même où j’ai reçu l’invitation à participer au congrès du P.E.N.- Club qui devait se tenir au Plaza de Montreux et dont le thème serait L’Avenir de la Littérature. De sa plus belle écriture, la secrétaire du comité suisse, Aube Du Perroy, notait qu’elle comptait beaucoup sur ma présence, ayant fort apprécié ma dernière chronique sur la réédition de ses Poésies 1952-1994. Or à l’instant même, l’arrivée de Bessa Djirka, la jeune requérante d’asile de Gyrokastër à qui ma compagne enseigne le français depuis quelques temps, fut le déclencheur qui me fit jeter l’invitation au panier en envoyant au diable tout ce qui ressemble de près ou de loin aux gens de lettres.
-
La grâce d’une écriture
Connaissez-vous Hervé Chesnais ? Moi non plus, jusque tout à l’heure, quand je suis tombé, dans le labyrinthe de desordre.net, sur une sorte de petit roman d’amour-catastrophe à fines touches me rappelant Fou de Vincent d’Hervé Guibert, tant par la grâce de son écriture que par la force des images et des objets narratifs de celle-ci, d’une fine et belle concentration.
Cela commence comme ça :
1/
Parce que l’absence n’admet pas de demi-mesure, que le souvenir ne pèse pas le poids : la grâce du col de ta chemise jamais plié net, le jean toujours en train de tomber plus bas, la perspective émouvante de ton passage, tout ça ne vaut qu’au présent.
2/
Parce que tu avais toujours faim.
3/
Parce que le manque n’est pas blessure, qu’il n’est pas de frontière au manque, on n’en pourrait pas dessiner les contours, parce que le manque n’est jamais fini, le manque est invisible, sans cicatrice à la surface, sans lèvres de chair jointoyées, sans suture sur le lisse des peaux.
4/
Parce que tu t’es brossé les dents avant de m’embrasser.
5/
Parce que les machines qui nous meuvent nous interdisent la stupeur mélancolique, nous garantissent notre lot quotidien de stimuli, d’anecdotes.
6/
Parce qu’à ton passage, quelque chose est advenu, que nous avons connu ensemble des illusions d’épiphanies.
7/
Parce que ton départ m’a laissé interdit, altéré, parce que j’ai cru mourir de ta mort, que je n’en suis pas mort, ta mort m’a traversé comme le caillou l’eau, et comme l’eau je me suis refermé, et comme l’eau nulle trace de ton passage, nul indice que je me sois refermé sur toi, que je t’aie gardé dans le secret de mon ventre. Ensuite il y a 93 autres fragments de cette eau, puisque l’ensemble s’intitule 100 Raisons.
Ensuite il y a 93 autres fragments de cette eau, puisque l’ensemble s’intitule 100 Raisons.
De fil en aiguille, curieux d’en savoir plus sur ce Chesnais Hervé, j’ai appris qu’il était d'origine bretonne et normande, né en 1963, et découvert, sur le site remue.net, une autre série de petites proses intitulées Tentative d’équilibre dont je capture illico celle-ci :
La gloire de mon père
Dans l’armoire de mon enfance – marqueterie rustique- un fusil mitrailleur dont je trouvais les balles en volant des bonbons ; c’était le temps de mes dents saines et de mon père aux cheveux roux.
Il aimait parler en arabe aux colporteurs de ces pays ; que disait-il ? – Les mots que je sais aujourd’hui, qui enchantaient les exilés. Ils repartaient pauvres, ravis, mais moi j’avais tremblé pour eux qu’il ne ressorte son fusil, pas les mots d’adieux ni d’usage, le fusil. Les balles ailées; les balles.
Les photos je les avais vues. Cadavres de bergers exécutés ; mon père assassin qui se targuait de preuves. Avant après, vivants puis morts, abattus là les mains liées dans la montagne qui était leur. Et je trouvais des balles en cherchant des bonbons. Et j’avais peur pour les vendeurs berbères, tant ils ressemblaient aux cadavres, aux trophées de mon père. Ah mais ceci encore : que, dans un contrepoint heureux, les textes de 100 Raisons sont accompagnés de vignettes d’artiste signées Emmanuelle Anquetil, d’une poésie elliptique qui s’apparie parfaitement à celle d’Hervé Chesnais. Dernière piste enfin: le site d'Hervé Chesnais himself, à l'enseigne de La position du scribe.
Ah mais ceci encore : que, dans un contrepoint heureux, les textes de 100 Raisons sont accompagnés de vignettes d’artiste signées Emmanuelle Anquetil, d’une poésie elliptique qui s’apparie parfaitement à celle d’Hervé Chesnais. Dernière piste enfin: le site d'Hervé Chesnais himself, à l'enseigne de La position du scribe. -
Ecrire comme en 1926

Sur une remarque de Yann Moix
A en croire le romancier Yann Moix, Jonathan Littell écrirait « comme en 1926 ». Or je repensais à ce propos, typique d’une certain provincialisme actuel « dans le temps », en lisant Les exilés de Montparnasse de Jean-Paul Caracalla, excellente chronique parisienne des années 20-40 où l’on voit revivre la fabuleuse pléiade d’artistes et d’écrivains se retrouvant alors entre Coupole, Dôme et autres lieux mythiques de l’époque. Dans la foulée, car il n’y est pas question que d’anecdotes « bohèmes », l’auteur détaille l’extraordinaire créativité littéraire et artistique de ces années, et la fécondité des rencontres de créateurs venus d’Amérique (le taux de change favorable y aide, mais c’est un détail) ou de Russie, de toute l’Europe enfin.
En 1926, on ne lit pas encore Yann Moix mais on lit Pound et Joyce, Gertrud Stein (genre avant-garde confidentielle) ou Scott Fitzgerald (genre culte avant la lettre), Cocteau et Cendrars, tant d’autres. On se gardera d’idéaliser ces années-là, mais les réduire à de la vieille guenille relève de ce que T.S. Eliot, autre génie de ce temps-là, taxait de « provincialisme dans le temps ».
Comme il y a un provincialisme dans l’espace, qui nous fait croire que tel canton (qui peut être le canton de Saint Germain-des-prés, cela va sans dire) est le centre du monde et tout juger en fonction de cette position, il y a un provincialisme dans le temps qui ramène tout à l’époque que nous vivons sans considération du passé proche ou plus lointain.
L’idée d’un progrès linéaire des arts ou de la littérature flatte évidement ce provincialisme, à l’enseigne de la table rase, assurément nécessaire pour chaque créateur, nécessaire mais insuffisante. L’écrivain maudit Lucien Rebatet me le disait un jour : après qu’on a lu Ulysse de Joyce, que faire ? Lui-même a écrit Les deux étendards, grand roman composé les fers aux pieds dans l’antichambre des condamnés à mort, dont la forme pourrait être dite « classique » par rapport à Ulysse, mais qui n’en a pas pour autant perdu de son intérêt aujourd’hui encore. C’est vrai que, dans une logique linéaire, Finnegan’s wake devrait marquer le terme de la littérature, dont Guignol’s Band de Céline est un autre exemple. Mais quoi ? Après ceux-là, Guyotat écrit Eden,Eden, Eden et Philippe Sollers écrit Paradis. Or Paradis de Sollers marque-il la moindre avancée par rapport à ceux-là ? Mon avis serait plutôt que la pseudo-modernité de Paradis ne survivra pas en 2026, tandis qu’on lira encore La guerre du goût ou Une vie divine, ouvrages « classiques » s’il en est…Jean-Paul Caracalla. Les exilés de Montparnase (1920-1940). Gallimard, 291p.
-
Jonathan Littell controversé

Suite au débat sur Les Bienveillantes
Pour nourrir un double débat historique et littéraire, Libération a publié, le lendemain de l’attribution du Prix Goncourt à Jonathan Littell, trois interventions assez nuancées mais dont les principaux arguments négatifs, à mes yeux, relèvent tout de même du procès d’intention. Une fois de plus, comme avec Claude Lanzmann et Peter Schöttler, on a l’impression que ses détracteurs cherchent noises au roman pour des raisons qui ont peu à voir avec son contenu ou sa forme.
Cette impression est dominante dans les propos de l’agrégé et docteur en histoire Christian Ingrao, qui estime « parfaitement légitime que la fiction s'empare d'un sujet pareil » avant de reprocher à Littell de «rater l'émotion nazie, moteur du passage à l'acte. » Pour étayer cette affirmation, l’historien fait part de son expérience personnelle : « J'ai fait ma thèse exactement sur le même sujet, ces intellectuels nazis du service de renseignements SS, qui ont pris les armes, ont tué des femmes, des enfants. Ce qui fait passer ces hommes à l'acte, c'est l'angoisse et la haine. C'est aussi la ferveur, l'utopie, dans laquelle l'extermination des Juifs est la condition sine qua non pour la germanisation des territoires occupés : ils pensent : "C'est eux ou nous" ; ils pensent aussi : "Il faut les tuer pour créer notre rêve." Cette ferveur, qu'on sent dans les moments d'effondrement des stratégies de défense, au cours des instructions et des procès des responsables nazis, on ne la voit malheureusement jamais dans Les Bienveillantes . »
Avons-nous vraiment lu le même livre ? On peut se le demander en se rappelant la profusion de situations détaillées, dans les premières deux cents pages du livre, qui impliquent le passage à l’acte de tous ces officiers et ces soldats observés par Max Aue, oscillant précisément entre l’angoisse et la haine, le suicide parfois ou les crises d’hystérie meurtrière. La foi en la supériorité du Volk allemand et l’utopie du nouveau monde à construire contre l’URSS sont deux éléments fondamentaux qui reviennent sans cesse dans les propos de Max Aue et de ses interlocuteurs. Le « eux ou nous » est également l’excuse récurrente. Dire qu’on ne voit jamais cela dans Les Bienveillantes est proprement incroyable, à moins d’avoir survolé le livre en « spécialiste » trop sûr de son fait. Or ledit spécialiste y va tout de même de son satisfecit magistral : « Jonathan Littell a vraiment très bien travaillé, même s'il y a des sources qu'il n'a pas consultées. Il a réussi la vie intime de son personnage, pas l'émotion collective. » Faux : même si Max Aue n’est évidemment pas l'incarnation de la collectivité militaire ou civile (!), il produit d’innombrables observations sur les souffrances des victimes, les engouements des chefs de guerre et de leurs cadres, ainsi de suite. Cela avec plus de curiosité lucide que de compassion : mais c’est la logique même du personnage, nihiliste froid.Deux objections mieux fondées
Après d’autres considérations, Christian Ingrao fait deux remarques qui me semblent en revanche beaucoup mieux fondées : «Le personnage traverse toute la guerre, voit tout, et ce n'est pas possible. » De fait, il y a là un problème de vraisemblance romanesque, et c’est la limite du passage au roman de la masse documentaire réunie par Littell. Ce que l’auteur voulait « traiter » supposait que son personnage, comme Julien Sorel, galope d’Ukraine au Caucase et de Stalingrad à Parus via Berlin, et c’est vrai que ça fait beaucoup. L’auteur l’a cependant dit une fois : plus qu’un personnage de roman, Max Aue est à ses yeux une figure. Pour ma part, je réserverais mes plus fortes réserves à la complexion psychologique du protagoniste, dont la pathologie me paraît parfois « téléphonée ». N’empêche : il existe, et la matière qu’il brasse est tellement riche et intéressante qu'on le passe à l’auteur…
Autre remarque justifiée de l’historien enfin : « On sent aussi parfois, au détour de certaines phrases, des articles scientifiques moins bien digérés que les sources consultées ». Oui, c'est vrai, sur ces 900 pages il y a quelques tunnels...L’ère du bourreau ?
Denis Peschanski, lui aussi historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, se montre moins sévère à l’égard des Bienveillantes et s’interroge, surtout, sur les raisons du succès de ce livre. Fascination morbide ou élargissement de l’intérêt des victimes aux bourreaux ?
«Comme lecteur, je trouve que c'est un bon livre, bien écrit. Comme historien, ce qui me semble étonnant, c'est de voir des collègues s'exprimer sur le rapport à la vérité, alors qu'il s'agit d'abord de littérature, et on ne fait pas de littérature avec les bons sentiments. Comme historien toujours, deux choses m'intéressent. D'abord, je constate qu'il y a eu un gros effort de préparation du dossier avant la phase d'écriture du roman. Ensuite, je m'interroge sur la signification de ce succès, qui a commencé bien avant l'attribution du prix de l'Académie française et du Goncourt. S'agit-il du temps long d'une fascination récurrente pour la barbarie ? S'agit-il du temps long d'une passion française pour la Seconde Guerre mondiale ? Ou bien ce livre et son succès sont-ils révélateurs d'un changement de registre mémoriel ?
«Pour aller au plus simple, au lendemain de la guerre, c'était le moment du résistant ; dans les années 80, on est passé dans l'ère de la victime. Et depuis deux ou trois ans on voit d'un côté une concurrence des victimes, avec une multiplication des porteurs de mémoire au nom de la victimisation, et, de l'autre, une certaine saturation de l'opinion. Ce qui fait qu'on peut se demander si le succès de cet ouvrage, au-delà de tout jugement sur sa qualité littéraire, n'ouvre pas un autre registre mémoriel. Entre-t-on dans l'ère du bourreau ? Assiste-t-on à une diversification des genres : on parle de la victime, mais aussi du bourreau, du spectateur ? Ou bien est-ce une clôture sur une autre figure, la figure du bourreau ?
«L'enjeu est important, mais je ne peux pas donner de jugement définitif sur ce point. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu qu'on ait beaucoup à gagner en sacralisant certains événements et en interdisant certaines formes d'expression sur ces événements, en l'occurrence la Shoah.»Littérature, littérature…
Quant à Bruno Blanckeman, professeur de littérature, c’est sur le plan de la forme et de l’écriture qu’il attaque Les Bienveillantes en déclarant d’emblée que « ce roman est très académique ». Et de comparer, sans ciller le roman de Jonathan Littell à Dans la foule de Laurent Mauvignier, qu’il donne pour novateur alors que Les Bienveillantes relèveraient du néoclassicisme.
Cela est-il bien sérieux ? Quels sens peut-il y avoir de comparer une fresque romanesque de 900 pages et un roman tout à fait estimable et original, certes, mais dont l’enjeu éthique, historique et philosophique n’est en rien comparable avec celui des Bienveillantes.
Il est vrai que l’écriture de Littell ne procède pas d’une recherche stylistique particulière, au sens de la « petite musique » personnelle d’un Céline ou d’un Proust, voire d’un Mauvignier… Mais à quoi rime ce terme de « néoclassique » ? Classique peut-être, au sens le plus trivial d’une phrase claire. Mais allez-y voir de plus près, cher prof : avez-vous détaillé cette économie du dialogue, avez-vous observé les glissements progressifs du réel au fantasmagorique, au point qu’on ne sait si certaines scènes (à Antibes, à Stalingrad) relèvent de la réalité ou du délire, n’avez-vous pas remarqué les changements de registres, de l’expressionnisme au baroque, selon les chapitres. Néoclassique vraiment ? Académique vraiment ? Or tout ce qui ne procède pas, au sens des académies précisément, d'une nouveauté propre à émoustiller le lettreux, devrait être relégué dans cette catégorie désuète.
En fait, ce qu’on voudrait établir, comme un Yann Moix de façon plus péremptoire, qui affirme que Littell écrit « comme en 1926 », c’est que Les Bienveillantes est un livre à la forme dépassée, pour mieux l’évacuer. Or parler d’innovation formelle, à propos d’un tel livre, me paraît une sorte d’obscénité, et d'autant plus que ce livre innove bel et bien à sa façon, comme tout ouvrage de véritable écrivain. Traducteur de Jean Genet et de Maurice Blanchot, excellent connaisseur de la littérature française, Jonathan Littell pourrait n’être qu’un « écrivant » transposant, dans l’espace d’un roman, l’immense documentation qu’il a accumulée. C’est Audiberti qui distinguait l’ « écrivant », faisant un usage strictement régulier de sa langue, parfois admirable d’ailleurs (combien d’historiens ou de philosophes surclassent ainsi tant de littérateurs) et l’ « écrivain » exerçant, sur les mots, une façon de droit de cuissage et de recréation. Or dès les premières pages des Bienveillantes, Max Aue (et donc Littell lui tenant la main) devient plus qu’écrivant-chroniqueur : écrivain. Par sa puissance d’évocation, par l’imagination spatiale qu’il déploie si souvent dans les scènes qu’il reconstruit, par ses plongées oniriques et son érotisme noir, son intelligence et son savoir, sa porosité psychologique fantastique, d'autres qualités et d'autres défauts, c'est entendu, Les Bienveillantes est un livre supérieur auquel il ne faut pas comparer n’importe quoi. S’agit-il d’en faire un culte hébété ? Nullement. Mais avant que d’en parler, lisons-le vraiment…
-
De la vraie magie
En lisant Le Magicien de Cesar Aira
Il est notoire qu’un Abracadabra suffit à faire un bon livre, et c’est à la fois ce que conclut le Magicien au terme de sa quête fébrile d’une réalité qui serait moins illusoire que son don, et ce que se dit le lecteur de ce merveilleux roman de Cesar Aira, qui allie la grâce poétique et la densité philosophique dans une fiction à valeur de fable ironique.
Le Magicien d’Aira a été gratifié, par les dieux, d’un pouvoir sans limite, qui ne ressortit pas pour autant à la sorcellerie. C’est comme ça, justement décidé par la fiction : le Magicien pourrait tout faire sur une scène et sans le moindre truc ni le moindre attirail (nul besoin pour lui des machines compliquées d’un David Copperfield, qu’il tient pour un faiseur tocard), et ses aptitudes à recycler tous les numéros connus sans aucune artifice (ce que le public ignore) lui ont déjà valu une reconnaissance internationale, sans que le titre de plus grand magicien du monde ne lui soit accordé, auquel il aurait droit. C’est qu’il s’est toujours retenu de faire tout ce qu’il pourrait, craignant de trop attirer l’attention. Or la cinquantaine approchant, voici qu’il a résolu de surmonter sa modestie égotiste au cours d’un congrès de magie rassemblant la fine fleur mondiale à Panama, où il fera vraiment montre de son art échappant à toute logique connue. Solitaire et parfait artiste, il se refuse à l’épate spectaculaire et réfléchit longtemps, en attendant l’heure de son numéro (que nul ne peut lui préciser), à ce qu’il pourrait bien faire de réellement sublime sans donner dans le mauvais goût. Après maintes ruminations et tergiversations, le Magicien se retrouve dans sa chambre d’hôtel où il va régler un délicieux ballet d’objets de toilettes bientôt doués de la capacité de voler et de parler, qui vont se livrer sous ses yeux à un grave débat à la manière des dissidents soviétiques... Le même soir, dans le cocktail astreignant où il retrouve le jeune guide panaméen qui l’a piloté l’après-midi, et qui menace de lui déclarer son amour, le Magicien procède à son premier acte de magie agressive, propulsant aussi bien le jeune homme dans les banlieues de l’Univers d’où il pourra contempler l’infiniment Petit et l’infiniment Grand au milieu de ses peluches.
Que faire ? se demandait Lénine en se rongeant les ongles, et le Magicien s’en inquiète à son tour tout en découvrant, au fil de sa quête, le sens de celle-ci dont le lecteur démêlera les paradoxes et les éventuelles vérités. Or un Abracadabra ne suffit pas à lire un bon livre, même aussi magique que Le Magicien. Mais quel délice c’est d’en prendre le temps d’un après-midi…
Cesar Aira. Le Magicien. Traduit de l’espagnol (Argentine) par Michel lafon. Bourgois, 149p.
« S’il n’avait jamais osé utiliser la magie, c’était à cause des altérations qu’elle risquait de causer dans le tissu de l’Univers ».
«Quelle humanité heureuse ! Mais, si c’était le cas, en quoi sa magie à lui était-elle unique ? Ils étaient tous magiciens, sans le savoir ! Tout était possible, à condition de ne pas se demander a priori ce que c’étaut. Ce pouvait être n’importe quoi. La vie, tout simplement ». -
Les Bienveillantes hors de prix
Retour sur Allemandes II
Le Prix Goncourt ou le Prix Renaudot vont-ils s’ajouter aujourd'hui, sur le palmarès de Jonathan Littell, au Grand Prix du roman de l’Académie Française ? A vrai dire la question me semble sans importance, même un peu déplacée à propos des Bienveillantes. La nature de ce livre échappe, de fait, à la logique des prix et même de la vie littéraire, ressortissant à un grand acte humain bien plus qu’à une performance d’écrivain, tout extraordinaire que soit celle-ci. J’y songeais en relisant les dernières pages (261 à 312) de la seconde partie des deux chapitres intitulés Allemandes, dans lesquelles on trouve un concentré saisissant de la puissance illustrative de ce roman au cours d’une scène bouleversante, un débat sur la race aux conséquences humaines immédiates qui fait aussi apparaître la rivalité féroce entre la Wehrmacht et la SS, et l’imbrication de l’idéologique et de la vérité des faits, sur fond de catastrophe militaire (les Allemands sont encerclés à Stalingrad) et de lente descente aux enfers éthiques et psychiques du protagoniste.
Tandis que la Wehrmacht porte l’offensive sur Grozny, Max Aue est confronté à un vieillard qui s’est présenté spontanément comme Juif aux Allemands et prétend avoir le souvenir, que lui a soufflé un ange, du lieu où il va être enterré. C’est une véritable apparition que ce vieux savant, qui s’exprime en grec classique pour se faire comprendre du SS lettré, à qui il explique ses origines composites de savant chassé du Daghestan par les Russes. En somme prié de lui donner la mort, par un homme qui représente une culture ancestrale et se comporte avec une majesté évoquant un autre monde, Max s’en va au lieu prévu en compagnie d’un soldat voué à l’exécution. Cela se passe en face de la chaîne du Caucase que Max voit pour la première fois, d'une beauté lui rappelant les harmonies de Bach, dans un endroit qui semble idéal au vieillard pour y être enterré. Sa dignité lui interdit pourtant de creuser sa propre tombe. Ainsi est-ce le soldat, puis Max lui-même, qui vont le faire sous les yeux de l’exigeant personnage, lequel réclame une tombe aussi confortable que le ventre de sa mère. Or c’est en souriant que le vieux Juif meurt sous la balle de l’Allemand, que Max Aue considère en tremblant avant d’ordonner à son sbire d’enfouir le corps.
Et que fait Max après cela ? Il se rend aux bains, desquels il sort revigoré. Et quand il rejoint au casino un officier médecin qui le trouve « en pleine forme », c’est pour remarquer qu’il se sent « renaître » après une « journée curieuse ». Or chaque fois que Max se dit renaître, nous devons comprendre qu’il fait un pas de plus dans le consentement à sa mort spirituelle. Cela requiert, de la part du lecteur, une grande attention et un grand effort de compréhension, car jamais l’auteur ne lui tend la perche. Dans la foulée, un épisode également significatif, et non moins incarné que le précédent, relate les menées d’un officier persuadé que Max entretient, avec le jeune linguiste Voss, des relations indignes d’un SS. Comme il l’a insulté devant témoins, Max le provoque en duel (on est sur les lieux de la mort de Lermontov, soit dit en passant), mais son projet est éventé et immédiatement interdit, lui inspirant la réflexion que « toute action pure » lui sera refusée. Un peu plus tard, une discussion stupéfiante se tiendra entre le jeune linguiste et Max, au cours de laquelle le très brillant Voss lui fera valoir que les dogmes racistes du nazisme ne valent pas un clou du point de vue scientifique. Ces propos pourraient lui valoir une exécution immédiate, mais Max respecte le savoir du jeune homme en admettant que son propre racisme relève de la foi plus que de la science.
En romancier, Littell fait revivre tous ce qu’il a découvert par ses études extrêmement poussées, entre autre sur les opérations « scientifiques » conduites en marge de la conquête militaire. A ce propos, il faut lire le récit de la conférence (pp.300-310) durant laquelle le sort de milliers de montagnards prétendus juifs par les uns et non-juifs par d’autres, sera décidé, réunissant des gradés de la Wehrmacht (soucieux de ménager les peuples qu’ils vont soumettre) et leurs homologues de la SS (jaloux de leur nettoyage racial) ainsi que des experts venus de Berlin, dont une linguiste teigneuse figurant la science idéologisée la plus brutale. Dans la foulée, la haine provoquée par Max chez l’officier qui l’accuse d’homosexualité, et qui a dû s’excuser, avant que Max l’humilie plus encore au cours de la conférence en prenant le parti de la clémence, finalement victorieux - cette haine aboutit à la mutation de Max Aue à Stalingrad, préludant à cent nouvelles pages admirables.
On a parlé de Vassili Grossman à propos des Bienveillantes, et c’est vrai qu’il y a du souffle de Vie et destin dans l’évocation du Kessel (chaudron) de Stalingrad encerclé par les Russes, avec un sens de l'espace impressionnant et des scènes insoutenables. Mais on pourrait parler, aussi, d’un certain fantastique à la Boulgakov dans le long délire de Max consécutif à sa blessure à la tête, d’une force expressive et d’une beauté qui fait doucement sourire quand le pauvre Yann Moix reproche à Jonathan Littell d’écrire « comme en 1926 ».
Jonathan Littell n’est pas, comme le fut Céline, un fondateur de langue. Fera-t-il œuvre littéraire après Les Bienveillantes ? Ce n’est même pas sûr. Mais serait-il l’homme de ce seul livre qu’il aurait droit, me semble-t-il, à une reconnaissance spéciale de ses frères humains. Après les vaguelettes annuelles du Goncourt & Co, il sera très intéressant de voir l’accueil que lui réserveront les lecteurs allemands (il a dit que cela lui importait particulièrement) et ceux du monde entier, étant entendu que ce livre a valeur universelle. -
Mort à table
 Dernière révérence à Bernard Frank
Dernière révérence à Bernard Frank
Je me demande souvent pourquoi je continue d’acheter Le Nouvel Observateur depuis près de quarante ans, chaque semaine ou presque, alors que tant des aspects de cet hebdo de la gauche caviar m’y agace, parfois même m’y horripile, mais j’y reviens malgré tout pour quelques plumes de style, et la première était celle de Bernard Frank dont j’aimais le ton et le rythme des chroniques, quoi qu’il racontât, parfois presque rien, mais toujours au fil d’une espèce de soliloque nonchalant et vif à la fois, un peu snob ou superficiel les jours « sans », et qui ouvrait cependant à tout coup, dans la masse et la presse du tout-venant, la parenthèse de propos fleurant bon Paris et la France et la conversation telle que la société littéraire française l’a modulée comme nulle part ailleurs, des salons aux cafés.
Je reviens sans cesse au Journal littéraire de Léautaud, dont une ou deux pages, même de celles où il n’y écrit que des observations de tous les jours, suffisent à m’aérer et me tonifier, et c’est un peu de ça qu’on trouvait dans les chroniques (je ne suis jamais arrivé au bout d’aucun de ses romans) de Bernard Frank, à plus forte raison dans les recueils de ses chroniques. Son Pense bête fait ainsi écho aux morceaux réunis de Passe-temps de Léautaud. Plus que Léautaud, cependant, dont il n’avait pas en revanche la pureté de ligne, Bernard Frank était attentif à l’actualité littéraire, ou à l'actualité tout court, dont il parlait en toute liberté, se fichant de plaire ou de détoner.
L’ensemble de ses livres a été récompensé, en 1981, par le prix Roger Nimier, ce qui semble aller de soi pour l’inventeur du groupe improbable des « hussards » qu’on pourrait dire de la droite littéraire anarchisante ou bohème, avec Nimier précisément, Blondin ou Laurent, dans la filiation de Drieu ou de Chardonne.
Bernard Frank écrivait ses chroniques à la main, dans une manière qui n’était pas désuète pour autant, qu’on pourrait dire de la ligne claire. On lira cette semaine son dernier envoi dans le Nouvel Obs, après quoi l’on reviendra à sa géographie parisienne des Rue de ma vie, nourrie par une trentaine de déménagements, à Mon siècle ou En soixantaine, à La panoplie littéraire ou à Solde où se distille le mieux son talent de gourmet des lettres mort au restaurant à l’âge-limite des lecteurs de Tintin… -
La chute de l’oiseau Styron
Le grand romancier américain, auteur de La proie des flammes et du Choix de Sophie, n’est plus. C’est un des derniers monstres sacrés de la littérature américaine de l’après-guerre qui vient de s’éteindre en la personne de William Styron, mort hier dans sa maison du Massachussets, à l’âge de 81 ans. Héritier direct de Faulkner, en moins génial du point de vue de la langue mais avec de formidables ressources de conteur et de romancier-moraliste sondant le tréfonds de l’âme humaine, Styron avait acquis une renommée mondiale avec deux grandes symphonies romanesques : Les confessions de Nat Turner (1967, prix Pulitzer), évoquant, dans une fresque, la vie d’un esclave noir en Virginie (entre 1800 et 1831) et l’insurrection qu’il déclencha, suivie de lourdes conséquences ; et Le choix de Sophie (1979), où un jeune journaliste du Sud rencontre, après la guerre, une Polonaise rescapée des camps de la mort. Rappelons aussi que Styron était entré en littérature avec deux livres d’une âpre intensité : Un lit de ténèbres (1951) et La proie des flammes (1960).
« Tous mes romans expriment le conflit opposant notre besoin fondamental de liberté et de dignité aux puissances de l’oppression, quelle qu’elles soient », m'avait déclaré William Styron en 1994, à la parution d’Un matin en Virginie, trois récits plus personnels et émouvants (avec une poignante évocation de la mort de sa mère) qui avaient fait suite à Face aux ténèbres, terrible récit de la dépression qu’avait subie l’écrivain, me confiant enfin ce vœu d’après sa mort: « J’aimerais renaître sous la forme d’un de ces grands oiseaux de mer qui me faisaient rêver lorsque j’étais jeune »…
Dits de William Styron:
- Que représente l'enfance à vos yeux ?
- Pour beaucoup de gens, c'est l'âge d'une sorte d'idyllique innocence qu'on ne peut retrouver, mais qui diffuse toujours une précieuse douceur. Nous savons pourtant que l'enfance n'est pas qu'innocence, et que les ombres du mal y rôdent aussi. Pour un écrivain, au demeurant, c'est un terreau d'une grande richesse.
- Que pensez-vous de la résurgence actuelle des fondamentalismes, tant aux Etats-Unis que dans les pays musulmans ?
- Je pense que c'est un des phénomènes les plus damgereux qui se manifestent à l'heure actuelle. La démocratie, aux Etats-Unis, limite encore l'extension du mal, mais certains des leaders du fondamentalisme américain ont la même mentalité que les ayatollah, et je suis sûr qu'ils seraient prêts à tuer s'ils en avaient le pouvoir.
-Qu'estimez-vous le thème essentiel de votre oeuvre ?
- En exergue au Choix de Sophie, j'ai cité ces mots du Lazare de Malraux, qui résument en somme ce que je crois avoir accompli, sans projet préalable d'aileurs: "Je cherche, écrit malraux, la région cruciale de l'âme, où le mal absolu s'oppose à la fraternité".
(Extrait d'un entretien à Paris, en 1994)
-
Le suicide du perdant radical

Un essai de Hans Magnus Enzensberger
Y a-t-il un lien entre celui qui, « pétant les plombs », mitraille une classe d’école ou un groupe quelconque, avant de retourner son arme contre lui-même, et le kamikaze se faisant exploser au nom de l’islamisme ? Tous deux sont en effet des avatars de l’homme du ressentiment que son sentiment d’échec et sa haine de soi, son orgueil blessé ou son humiliation remâchée, longtemps couvés, poussent soudain à une explosion de violence qui le vengera, l’auréolera un instant de gloire médiatique ou lui vaudra (croit-il) le paradis. Au fil d’une analyse claire et percutante, le poète et essayiste allemand Hans Magnus Enzensberger définit ce qu’il appelle le « perdant radical », notamment dans ses occurrences politiques, d’Hitler à Ben Laden. Distinct du raté se consolant dans la compulsion, de la victime qui peut faire valoir ses droits et réclamer compensation, ou du vaincu se résignant plus ou moins, le perdant radical s’isole et se fait invisible tout en cultivant sa rancœur obsessionnelle et en attendant son heure. La rubrique des faits divers en dénombre tous les jours, qui ont soudain explosé, parfois sous le plus anodin prétexte. L’amélioration des conditions de vie ne semble pas résorber le phénomène, au contraire elle l’exacerbe, et notamment sous l’effet de l’exhibition à jet continu des images médiatisées de la fortune et du bonheur, qui fait que « le potentiel de déception des hommes a augmenté à chaque étape du progrès ».
« Ce qui occupe l’esprit du perdant de manière obsessionnelle », note Enzensberger, « c’est la comparaison avec les autres, qui a tout instant se révèle à son désavantage ». Et de reprendre, de préférence au concept freudien de pulsion de mort, « le constat déjà ancien qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles l’homme préfère une fin dans l’effroi qu’un effroi sans fin – que celui-ci soit réel ou imaginaire. »
Passant de la sphère privée à la dimension collective de cette folie destructrice, Enzensberger en vient évidemment à l’exemple du Führer cristallisant l’humiliation des Allemands après le traité de Versailles et se lançant dans une entreprise mégalomane et suicidaire proportionnée à son fanatisme, finissant dans l’extermination et l’auto-immolation.
Toutes tendances confondues, les factions réunissant des perdants radicaux dans la foulée des chefs de guerre sont légion par les temps qui courent, mais un seul mouvement violent a fédéré les perdants radicaux à l’échelle de la planète, et c’est l’islamisme.
De modèle européen à l’origine, le terrorisme est la plus dangereuse réponse, pour les musulmans eux-mêmes, à l’orgueil blessé procédant de l’immobilisme séculaire des sociétés arabes, dont l’autocritique s’amorce, mais si difficilement. A ce propos, Enzensberger cite un rapport établi à la demande des Nations unies par des chercheurs arabes en 2002-2004, sous la direction du sociologue égyptien Nader Fergan, qui aboutit à des constats à la fois connus et peu commentés dans les médias. On y admet ainsi que les Etats arabes se retrouvent à la dernière place de toutes les régions du monde en matière de liberté politique. Que, même en tenant compte des énormes revenus du pétrole, les pays arabes arrivent en avant-dernière position en matière d’économie. Ou, entre autres exemples, que le nombre total de livres traduits à partir d’autres langues depuis douze siècles (le califat d’Al-mamoun en 813-833) correspond au nombre actuel de traductions faites en Espagne au cours d’une seule année ! Enfin qu’une femme arabe sur deux ne sait ni lire ni écrire…
Evoquant ensuite les raisons de l’immobilisme du monde musulman, que d’aucuns imputent aux agresseurs extérieurs ou à la colonisation, alors que d’autres civilisations (Inde, Chine ou Corée) se sont développées malgré les mêmes tribulations, Enzensberger en vient aux conséquences actuelles des déficits de connaissance et d’inventions accumulés, produisant un décalage croissant, encore accentué aujourd’hui par l’exode des cerveaux de pays incapables de se réformer. Et d’illustrer la blessure narcissique qui procède de cet affaiblissement et la fuite en avant que manifestent les prédicateurs de la haine réclamant pour eux seuls la liberté d’outrager ceux qui ne pensent pas comme eux, sans tolérer aucune critique. Bien entendu, s’empresse de relever Enzensberger, « tous les musulmans ne sont pas des Arabes, tous les Arabes ne sont pas des perdants, tous les perdants ne sont pas radicaux… »
Pourtant c’est bel et bien les perdants radicaux (qu’on évalue à 7 millions de djihadistes armés à l’échelle mondiale), et dont il faut préciser que peu sont issus de milieux fondamentalistes ( !) qui constituent le grand danger visant, non tant l’Occident que les régions du monde au nom desquelles agit l’islamisme.
«Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants ne seront pas seuls à en souffrir, écrit Enzensberger. Des peuples entiers devront, à cause des actes de leurs représentants autoproclamés, et contre toute justice, payer un prix énorme. L’idée que la terreur pourrait améliorer leurs perspectives d’avenir, qui sont déjà suffisamment sombres, est absurde. L’histoire ne fournit aucun exemple d’une société en déclin qui en tordant le cou à son potentiel productif aurait pu survivre de manière durable. Le projet des perdants radicaux consiste, comme en ce moment en Irak ou en Afghanistan, à organiser le suicide de toute une civilisation ».
Hans Magnus Enzensberger. Le perdant radical. Essai sur les hommes de la terreur. Traduit de l’allemand par Daniel Mirsky. Gallimard, 56p. -
La fondue de Louis le Mol

Une criante injustice a poursuivi, dans les royaumes de ce monde, les sujets désignés de naissance au port obligatoire de la couronne, lors même qu' ils n'aspiraient peut-être qu' à se livrer aux activités placides du commun des pêcheurs à la ligne. Moins chanceux qu'un prince Charles adonné sans trop de contrariétés à l'aquarelle à notre époque où la mode de couper les têtes a passé, Louis Capet incarna du moins le roi malgré lui, auquel seule sa fin tragique a donné quelque relief, un cran au-dessous de sa royale moitié. Mais à propos, que serait devenu Louis XVI s' il n'avait été si brutalement « raccourci »? Comment ce retraité-né aurait-il fini ses jours ?
C'est à ces questions, entre autres, que Jean-L uc Benoziglio, romancier valaisan de souche, Parisien d'adoption et demeuré très Helvète dans l'esprit (c'est à savoir démocrate d'E urope polymorphe ouverte à l'érudition joyeuse) et même assez Vaudois sur les bords (au sens de l'autodérision débonnaire et de la latinité lémanique), s' est attaché à répondre avec toute la sagacité, l'humour et l'écriture à ellipses scintillantes qu' on lui connaît.
Dès son apparition sur le débarcadère de Saint-Saphorien où, l'air d'une pyramide coiffé du « pyramidion » d'une perruque et le regard vaguement effaré du myope déplacé, le cidevant Louis Capet, fautivement appelé Papet (!) par le syndic Chavannes qui l'accueille en présence du bailli von Pfyffer et de son représentant local von Villiger (des futurs cigares ?), présente toutes les apparences d'un notoire passionné de serrurerie qui, des embrouilles de la politique, et surtout de la politique d'asile réglée par ces Messieurs de Berne, n'a ostensiblement « rien à souder », pour user d'une expression qui serait plutôt, à vrai dire, celle du sieur Jaccoud, pilier de bistrot hâbleur à la Pomme de Pin voisine … Bien plus important pour Capet au moment de son arrivée chez les Vaudois: il a la dent. Faim de roi foi de moi. Quand c'est qu' on en casse une ?
S'il a jamais joué un rôle dans l'H istoire, ce Capet relégué dans la maison d'un certain Guichard massacré à Nancy en 1791 avec d'autres Suisses (ce qu' il ignore et dont il n'aurait probablement cure) ne se soucie que d'obtenir, de Leurs Excellences, une carabine pour chasser un peu et un confesseur papiste qui lui sont refusés d'un sec « Knif » (« Kommt nicht in Frage », hors de question) apposé sur sa requête écrite, à laquelle il ne sera même pas répondu mais que le narrateur, historien à ses heures, retrouve aux Archives bernoises.
L'air de n'y pas toucher, ledit historien se fait d'ailleurs un malin plaisir (partagé par le lecteur) de ramener Lafayette à celui qui voudrait l'oublier, et Necker aussi venant lui faire un rapport économique carabiné, et Constant de Rebecque pour une litanie de regrets a posteriori, ou cet ex-révolutionnaire se rappelant qu'un roi même déchu peut signer une recommandation utile …
Guère intéressé par ces visiteurs de marque, Capet ne se montre pas plus sensible à la qualité du petit blanc local (auquel il préfère le kirsch et la bière …) et l'essai de stimuler sa bonne humeur par une fondue se solde par un vrai fiasco ., au terme d'une véritable « scène à faire » ...
Finalement, le seul personnage avec lequel notre royal taiseux entretient un semblant de relation est la jeune Aline (futur personnage de Ramuz ?), fille du pêcheur du coin s' occupant de son ménage comme une « vraie fée du foyer » et qu' il gratifiera d'une crise de monarchique dépit au moment où elle lui apprendra qu' elle va frotti-frotter ailleurs.
Au demeurant, ce n'est pas tant la figure de Louis Capet qui nous intéresse que les multiples notations latérales dont il est le prétexte, qu' il s' agisse du pouvoir qu' il représente malgré tout, des traits de caractère récurrents des Suisses en général et des Vaudois en particulier, ou des Français en relation avec nos « pittoresques » ténèbres extérieures, dont le romancier truffe son tableau sans trop peser. « Le Suisse se lève tôt mais se réveille tard », cueille-t-on au passage entre une vacherie sur l'expansionnisme des libérateurs républicains et l'annonce de la chute de Louis Capet dans un escalier vaudois, le 31 janvier 1798, autant dire hier ...
Jean-L uc Benoziglio. Louis Capet suite et fin. Seuil, 183 pp. -
Le temps retrouvé du conte

Michel Layaz tend à retrouver la magie des verts paradis
Le désenchantement du monde, la perte du sens du sacré et de tout lien social ou familial, la dilution des rites dans la sauce hyperfestive et les célébrations artificielles tissent la toile de fond des temps que nous vivons en Occident matérialiste, où l’esprit du conte se dilue dans la platitude du quotidien ou des best-sellers pleins de vide.
Or un mouvement s’observe, en littérature, de retour à la magie narrative, fût-elle parodique, dont un Antoine Volodine est peut-être le meilleur exemple en France, auquel on pense un peu en lisant, dans une forme littéraire moins accomplie et originale, le dernier roman du Lausannois Michel Layaz intitulé Il est bon que personne ne nous voie.
Conçu en deux parties, dont la première est cousue de fragments de monologues du narrateur (à chaque fois séparés par des points de suspension évocateurs) enregistrés sur un petit magnétophone bleu, où il évoque son âge tendre d’adolescent, et la seconde rédigée dans un cahier marron par le même personnage octogénaire vivotant un « dernier amour » avec sa soignante, en l’asile de vieillards où il sent la vie le quitter, ce nouveau roman de Layaz reprend les thèmes, fantasmes et autres figures obsessionnelles des ouvrages précédents de l’auteur, au fil d’une espèce de conte surréalisant, à lire sans en attendre la moindre assise « réaliste », malgré l’ancrage local dans notre bonne ville avec son bon lac, ni la moindre vraisemblance psychologique. S’il fait écho aux Larmes de ma mère (qui vient d’être réédité en collection de poche, soit dit en passant) pour le noyau familial qu’il évoque, autant qu’à la petite société recomposée de La complainte de l’idiot, semblant d’abord un peu niais et un peu gratuit, gagne en sens et en consistance pour peu qu’on le rapporte à son effort de ressaisir, par l’évocation fantaisiste et la naïveté rejouée, la magie de l’adolescence.
Avec Raton son compère, qui dit « tare pour barre » et vit à sa façon l’innocence du jeu, notamment au football, Walter son aîné et mentor hantant un chalet-« cathédrale » qu’il partage avec sa tante Giulietta, autre âme candide; et Charlotte surtout, la fille en fleur, sauvageonne et fée-sorcière qui exalte sa fantaisie imaginative et lui révèle les magies de la nature et du sexe, le jeune-vieux conteur retrace un parcours initiatique marqué par un premier amour « vert », auquel fait pendant celui de Lucie-Lucifer en ses derniers jours. « C’est à quinze ans que les gens devraient entrer à l’asile de vieillards », note-t-il plaisamment alors qu’il dit toucher à « l’âge de l’infini » commun, dit-on, aux enfants et aux poètes…
Michel Layaz, Il est bon que personne ne nous voie. Zoé, 185p.
-
Quatuor des origines
En lisant Lignes de faille de Nancy Huston
I. Sol, 2004
On revient du côté de la vie, captée dans toutes ses nuances avec une empathie constante, en se plongeant dans le nouveau roman de Nancy Huston, intitulé Lignes de faille et constituant, par le truchement de quatre voix (Sol l’enfant « prodige », Randall son père, Sadie la mère de celui-ci et Kristina la mère de celle-ci), une remontée du cours du temps, de 2004 à 1944, lancée par le soliloque d’un enfant d’aujourd’hui, né coiffé de parents qu’il estime aussi formidables qu’il l’est-lui-même, avec la bénédiction du Très-Haut et du président Bush Bis.
Solomon, qu’on appelle Sol, ou Solly quand on le chérit et le pourrit autant que Tess sa mère, est à six ans le fils préféré de Dieu et de Google, qui sait déjà tout (par exemple comment les chiens enculent les femmes sur internet, ou que son arrière-grand-mère est lesbienne) et pourtant il reste un petit garçon à beaucoup d’égards, notamment quand il est question du grain de beauté à la tempe qui inquiète tant sa mère que celle-ci a programmé une opération. Cette Tess est intéressante, qui incarne la mère américaine « concernée » par excellence, passant d’un cours sur les relations parents-enfants à un séminaire sur l’estime de soi, entre méditation et réprimandes à son conjoint Randall, dont les jurons et les complaisances (il ne condamne pas immédiatement le scandale d’Abou Ghraïb, qui à elle lui fait si mal) ne sauraient « passer », qu’elle s’affaire à contrer d’une voix toute douce.
Cela se passe en Californie, la boîte du père est engagée dans l’effort de guerre en Irak par ses recherches sur les robots guerriers, ce qui super-excite son fils en mal d’héroïsme, mais on sent bientôt le centre de gravité du roman se déplacer avec l’apparition de deux personnages aussi imposants que dérangeants pour le trio « waspy », à savoir la mère Sadie, débarquée d’Israël au lendemain de la petite opération du gosse, qui n’a pas l’air d’être curative soit dit en passant, infligeant chaque matin au garçon ses deux heures de lecture de l’Ancien Testament au dam de la mère protestant de son protetantisme. La mère de la mère de la mère de Solly n’est pas moins gratinée, qui vit à New York avec une amie après le suicide de son conjoint, et dont on sait qu’elle a passé par « les camps » ou un truc comme ça.
On retrouve, dès les 129 pages du soliloque de Sol, la porosité totale de Nancy Huston, et son mélange de sarcasme et de compassion, de vivacité et de mélancolie, à la hauteur «chorale » de Dolce agonia.II. Randall, 1982.
C’est une étrange émotion qu’on éprouve en découvrant, avec ce qu’on sait déjà du père de Sol, ce Randall à la fois sympathique et un peu flottant, en butte au moralisme bigot de sa jeune femme, quel enfant il fut lui-même, puisque la suite du roman le fait parler à son tour, en sa sixième année, petit garçon un peu bousculé par les incessantes querelles opposant son père, dramaturge new yorkais plutôt bohême, juif mais indifférent à la religion, et la redoutable Sadie, sa femme convertie au judaïsme et, comme souvent les convertis, poussant le zèle à outrance.
Plus exactement, il y a de l’hystérie en Sadie, qui devient pour ainsi dire une spécialiste du Mal, donnant des conférences sur la Shoah et poussant ses nouvelles recherches du côté des « fontaines de vie » des nazis, ces élevages d’enfants volés en Ukraine, en Pologne et dans les pays baltes, pour être casés dans des familles allemandes et drillés selon les meilleurs principes aryens. Son intérêt n’est d’ailleurs pas fortuit, puisqu’elle découvre que sa mère, la chanteuse Erra que son fils et son conjoint adorent, a précisément connu ce sort avant d’être déportée.
Sous le regard du petit Randall, qui devient ici comme un frère ou un double enfantin du petit Sol, le lecteur assiste ainsi à un début de guerre entre une goy sioniste par raccroc, qui se met à hurler dès qu’on n’est pas d’accord avec elle, et un brave type surtout soucieux de bon temps en compagnie de son fiston. Les recherches de Sadie la poussant à emmener sa famille en Israël, le trio se retrouve à Haïfa où le chemin de l’écolier Randall va croiser celui d’une fille un peu plus âgée, prénommée Nouzha, qui lui apprendra l’histoire de son point de vue de Palestinienne alors même que la haine se déchaîne entre leurs communautés, pour culminer avec le massacre de Sabra et Chatila.
Autant dire que cette lecture, aujourd’hui, prend un relief tout particulier, et pourtant cet aspect, évidemment important, n’est pas essentiel dans le roman, qui me rappelle soudain le grand roman des origines d’Amos Oz, Une histoire d’amour et de ténèbres, et tous ces livres nous confrontant à nos sources mêlées.
On est ainsi parti, avec le premier soliloque du « winner » américain, de l’Empire arrogant de Bush, et nous voici remonter à l’époque du Sharon chef de guerre, en attendant que Sadie, fille d’une créature du nazisme, poursuive le récit. Or le roman de Nancy Huston nous touche d’abord par les voix qui s’y expriment, du côté du plus intime de l’individu.III. Sadie, 1962.
Le lecture de Lignes de faille évoque le sentiment qu’on peut éprouver en découvrant la photographie d’une personne que nous connaissons lorsqu’elle était enfant. Après avoir rencontré Sadie grand-mère et impotente, en 2004, au fil du premier monologue de Sol, et l’avoir retrouvée dans le personnage hyperactif de la mère de Randall, c’est ainsi en petite fille, âgée de 6 ans comme les deux premiers narrateurs, que nous la voyons réapparaître en 1962 à Toronto, entre une grand-mère autoritaire et conventionnelle, une prof de piano tyrannique et un père-grand psychiatre et prodigue de mauvaises plaisanteries. Mal aimée, complexée, triste d’être le plus souvent séparée de sa mère artiste (le père Mortimer, du genre beatnik, a disparu peu après sa naissance), Sadie entretient une espèce d’horreur d’elle-même que stimule un personnage imaginaire qu’elle surnomme l’Ennemi. Folle de joie lorsque sa mère, qui l’a casée chez ses parents faute de moyens, la reprend chez elle, Sadie séduit aussitôt Peter, l’ami-imprésario de sa mère, qui lui trouve une maturité rare et fera un bon père de substitution quand, la carrière de Kristina décollant, le trio se retrouve ensemble à New York. C’est alors, cependant, qu’après divers indices qui l’ont intriguée, Sadie va entrevoir une part secrète de la vie de sa mère, lorsque débarque un étranger blond et roulant les r et qui demande à voir Erra. D’un récit à l’autre, le puzzle se reconstitue ainsi, dont les parties, à fines touches diachroniques, évoquent autant d’époques et de drames, modulés à chaque fois par une voix d’enfant.Kristina 1944-1945
L’autobiographie à paraître de Günter Grass s’intitule En pelant les oignons, et c’est au même dévoilement progressif et douloureux que fait penser Lignes de faille de Nancy Huston, dont le dernier chapitre se passe précisément en 1944 (alors que Grass avait juste 17 ans) dans l’ Allemagne de la défaite en proie à la terreur et au chaos.
On connaît déjà l’extravagante Erra, qu’on a vu au diverses étapes de sa vie d’artiste et de femme libre, et qu’on retrouve ici sous le nom de Kristina qui lui a été donné lorsque, à une année, volée en Ukraine par les nazis, elle a été confiée à une famille allemande qu’elle croit la sienne. Il y a là le brave grand-père qui la choie et semble la préférer à sa sœur Greta, plus conventionnelle et jalouse, sa mère qui l’aime fort elle aussi, un frère Lothar aux armées et le père, instituteur, également sous l’uniforme.
D’emblée, le récit de Kristina tourbillonne, immédiatement marqué par son tempérament sensible et généreux d’artiste-néée. L’évocation de la vie plus ou moins insouciante qui va son cours dans cette famille d’Allemands ordinaires, tandis que le ciel rougeoie des proches villes incendiées par les bombardements des Alliés, est marquée par un crescendo dramatique que ponctueront la mort du frère et, dans un accès de colère, la révélation faite à Kristina par sa sœur qu’elle n’est pas un enfant de la famille mais qu’elle a été adoptés. Peu après, un garçon de dix ans, d’abord muet et impénétrable, sera recueilli à son tour dans la famille, qui révélera bientôt à Kristina sa vraie destinée d’enfant volé.
Ainsi s’achève ce roman des origines qui, de l’Amérique des « gagneurs » ne doutant de rien, en remontant les générations et en multipliant les points de vue, déploie une frise de portraits en mouvements d’une vibrante humanité, dont l’insertion dans l’histoire multiplie les résonances et les observations, notamment à propos des enfants « germanisés » de force. L’idée de donner la parole, successivement, à quatre enfants de six ans, pourrait sembler une « contrainte » artificielle, voire « téléphonée », mais il n’en est rien, au contraire : ce parti pris donne à la fois sa forme et son ton à cet ample et beau livre plein du souffle, de la rage et des interrogations, de la compassion, de l’humour et de l’intelligence sensible de Nancy Huston.
Nancy Huston. Lignes de faille. Actes Sud, 484p.
En librairie le 24 août.
Photo: Horst Tappe -
Sur la ligne de crête
Prix Femina à Nancy Huston, et Médicis à Sorj Chalandon.
C’est à Lignes de faille de Nancy Huston qu’a été décerné hier le prix Femina, dont les débats ont été marqués par l’exclusion de Madeleine Chapsal des rangs du jury. (cf. encadré). Malgré cette bisbille parisienne, c’est l’un des plus beaux romans parus cet automne qu’ont distingués les dames du Femina, et sans doute l’un des ouvrages les plus ambitieux de la romancière française d’origine canadienne. En quatre longues séquences à rebrousse-temps, entre 2004 et 1944, quatre enfants de six ans y évoquent leur petite histoire personnelle et familiale enchâssée dans les tribulations du siècle. Brassant de grands thèmes dans une sorte de coulée symphonique, Nancy Huston rend admirablement le ton de chaque époque en animant des personnages de chair et d’émotion.
Quant au Médicis, ordinairement considéré comme le plus « littéraire » du quarteron de tête des prix automnaux, c’est au journaliste Sorj Chalandon qu’il a été décerné, pour Une promesse. Après Le petit Bonzi, un premier roman à caractère autobiographique, le grand reporter de Libération, prix Albert Londres en 1988, s’est attaché à l’évocation de l’énigmatique claustration d’un vieux couple du tréfonds de la province française, autour du secret duquel se développent la rumeur et le questionnement du voisinage.
Comme chaque année, les pistes de lecture proposées par les volets « étrangers » des deux prix méritent l’attention. Ainsi le jury du Femina a-t-il distingué une autre romancière en la personne de l’Irlandaise Nuala O’Faolain, pour L’histoire de Chicago May, parue chez Sabine Wespieser, petit éditeur souvent remarqué par ses découvertes. En l’occurrence, c’est une épopée canaille qui se déploie dans ce roman évoquant les frasques d’une aventurière de haut vol sur fond d’Irlande misérable. De son côté, le jury du Médicis a couronné l’écrivain roumain Norman Manea, pour Le retour du hooligan : une vie, paru au Seuil. L’occasion de découvrir un écrivain puissant retraçant, dans ce livre, une destinée marquée par les persécutions successives du nazisme et du communisme, avant son exil aux Etats-Unis et l’ultime déception qui l’attendait en Roumanie « libérée ».
Enfin, Jean-Bernard Pontalis a reçu le prix Médicis de l’essai pour Frère du précédent, paru chez Gallimard, alors que les jurés du Médicis décernaient le Femina de l’essai à Claude Arnaud pour Qui dit je en nous, publié par Grasset. Pour ce qui est des prix les plus convoités, le Goncourt et le Renaudot, leurs lauréats seront désignés le lundi 7 novembre prochain.
 Tous pourris ?
Tous pourris ?Après le coup d’envoi de la saison des prix littéraires parisiens donné la semaine dernière avec l’attribution du Grand Prix du roman de l’Académie française au livre-événement de la saison, Les Bienveillantes de Jonathan Littell, paru chez Gallimard, la deuxième volée des prix fait apparaître, une fois de plus, l’omniprésence des grandes maisons (Galligrasseuil…) dans le palmarès. Belle exception avec le Femina à Nancy Huston, publiée chez Actes Sud (comme Laurent Gaudé, lauréat du Goncourt en 2004), mais cette consécration n’en a pas moins été marquée par un coup d’éclat significatif du jury féminin qui n’a pas aimé, mais pas du tout, que Madeleine Chapsal, révèle, dans son Journal d'hier et d'aujourd'hui, les dessous de l'attribution du prix 2005 et, plus précisément, les rapports supposés entre certains éditeurs et membres du jury. Ces propos ont été jugés "diffamatoires" par la majorité des dames du Femina, qui lui ont proposé de démissionner, avant de l'exclure. "Par solidarité", Régine Deforges a aussitôt annoncé sa démission du jury Femina. Mais où est le vice, où la vertu ?
Les « révélations » de Madeleine Chapsal pouvaient-elles aider à « moraliser» le système des prix littéraires parisiens ? On peut en douter à en juger par les résultats des polémiques et esclandres qui se poursuivent depuis… le début du XXe siècle. Or donc, tout est-il pourri au royaume des prix ? Le Femina à Nancy Huston (notamment) incite une fois de plus à la nuance…
-
La noce à Gogol

Le Mariage de Nicolas Gogol raconte l'histoire d'un notable russe presque trop vieux pour se marier mais qui en rêve sans cesser d'hésiter, et d'une fille de marchand prête à fermer les yeux sur la dégaine de son prétendant, pourvu qu'il soit noble.
C'est parce que cela se fait et pour échapper à la «dégoûtation» du célibat que Podkoliossine se fait tailler un noir habit de noce. Or la difficulté de l'entreprise le taraude, qui exige des bottes bien cirées; et comment épargner alors ses cors aux pieds? Lancinante question. Le premier dialogue du maître, trônant sur son canapé de fonctionnaire gradé (l'équivalent d'un colonel, mais sans épaulettes) et de son fidèle valet Stepan, est un régal immédiat: du pur Gogol ahuri et déjanté, ensuite relancé par l'arrivée de la marieuse Fiokla, vieille teigne que les hésitations de son client impatientent. Survient pourtant celui qui mènera le jeu: l'entreprenant Kotchkariov, mal marié lui-même par Fiokla et la chassant pour amener directement son ami chez Agafia, où se pointent cinq autres prétendants. Le défilé est cocasse, du jeune employé Omelette visant surtout la dot de sa future, à l'officier d'infanterie en retraite Anouchkine dont la promise doit parler français, en passant par le lieutenant de marine Jevakine, rangé des voilures mais resté coquin, ou enfin Starikov le marchand à jolie barbiche que la belle snobe au dam de sa tante qui pense qu'on doit se marier «dans son milieu».
En fin de course, et grâce à son ami entremetteur, Podkoliossine sera préféré aux autres pour sa délicatesse et sa modestie, mais c'est par la fenêtre qu'il s'enfuira in extremis, trop effrayé par la réalisation de son rêve. Sa valse-hésitation panique constitue le motif central de cette comédie à la fois caustique et tendre, brassant divers thèmes (le conformisme, la solitude, le vieillissement, la vanité sociale, etc.) et déroulant une épatante frise de personnages. Dans une traduction bien en bouche de Marc Semenoff, à quelques termes près (notamment un «salaud» excessif dans la bouche de Kotchkariov), la pièce n'a pas pris une ride en dépit de l'évolution des mœurs.
Il y a un style Kléber-Méleau, dont la réalisation de ce Mariage est l'un des plus beaux exemples. D'une clarté classique dans sa mise en scène et un décor tournant de Roland Deville dont la perfection artisanale caractérise aussi la maison, la réalisation vaut surtout par la lecture et l'interprétation, en pleine pâte et sans chichis esthétiques ou référentiels. Philippe Mentha est d'une parfaite justesse en Podkoliossine «oblomovien», à la fois sincère et sensible, raisonnable et pleutre. Son contraire viril, Kotchkariov, est magnifiquement campé lui aussi par Nicolas Rinuy, et Virginie Meisterhans n'est pas moins convaincante en jeune femme paniquant elle aussi à l'idée de rester seule et qui découvre que la noblesse peut être ailleurs que dans les titres.
Pour compléter une galerie de portraits sans défaut, Fabienne Guelpa donne un relief truculent à Fiokla; Lise Ramu est une tante-chaperon pleine de rude sagesse paysanne; Thierry Jorand excelle dans la figure massive et concupiscente de l'employé Omelette, autant que François Silvant en Anoutckhine style guindé dindon ou que Samy Benjamin en Jevakine à mollets de pintade et penchants lubriques; sans oublier enfin, plus russes que nature, Jean Bruno l'irrésistible serviteur et Michel Fidanza le marchand Starikov sorti des boutiques de Mirgorod. Autant dire: l'heureux hyménée d'un texte savoureux et d'une interprétation à l'avenant…
Lausanne-Renens. Théâtre Kléber-Méleau, jusqu'au 19 novembre. Durée du spectacle: 2h15. Ma-me-je, 19h. Ve-sa, 20h30. Di, 17h30. Relâche lundi. Réservations: 021 625 84 29 -
Sous les bombes

Supplément aux Bienveillantes : Une femme à Berlin
Que se passait-il à Berlin du printemps à l’été 1945, pendant que Max Aue, le protagoniste des Bienveillantes, trucidait l’un de ses amants dans les wc d’un hôtel avant d’aller pincer le nez du Führer en son bunker ?
Le récit des bombardements de Berlin, dans Les Bienveillantes, est certes déjà très impressionnant, mais c’est une sorte de zoom, sur l’immeuble défoncé d’un quartier du centre, qu’accomplit le formidable témoignage anonyme qui vient de paraître et recoupe, par ailleurs, les constats établis par W.G. Sebald dans Une destruction.
Entre le 20 avril et le 22 juin 1945, une jeune femme, employée d’édition jusque-là, et qui a pas mal roulé sa bosse en tant que reporter (notamment en Russie), commence à décrire sèchement tout ce qu’elle observe autour d’elle et dans les ruines de la ville où, bientôt, les Russes vont déferler, précédés par une rumeur épouvantable faisant état de viols en série. De page en page se déploie une chronique hallucinante rappelant la « maison des morts » de Dostoïevski, riche d’innombrables détails tragiques ou cocasses. Observatrice implacable, l’anonyme trace des portraits carabinée de ceux qu’elle côtoie dans les souterrains ou aux files d’attente (la faim est l’autre obsession, avec la peur des bombes), avant la terrifiante suite de tribulations vécus par les femmes, des vieillardes aux adolescentes.
Sebald l’a dit après d’autres : de tels témoignages sont restés tabous en Allemagne jusque assez récemment, étant entendu que le peuple allemand, et jusqu’à la dernière des femmes et au dernier des enfants, méritaient le châtiment suprême. L’auteur anonyme l’a d’ailleurs confié à l’écrivain C.W. Ceram en 1947 : « Aucune victime n’a le droit de porter sa souffrance comme une couronne d’épines. Moi, en tout cas, j’avais le sentiment que ce qui m’arrivait là réglait un compte ».
Ce sentiment coïncide, d’ailleurs, avec les premières révélations avérées touchant à l’extermination massive, que la jeune femme découvre avec horreur en juin 1945 alors que la vie commence juste à reprendre ses droits : « Notre triste sort d’Allemands a un arrière-goût de nausée, de maladie et de folie, il n’est comparable à aucun autre phénomène historique »…
Anonyme. Une femme à Berlin. Journal, 20 avril-22 juin 1945. Présentation de Hans Magnus Enzensberger. Postface de C.W. Ceram (alias Kurt W.Marek). Traduit de l’allemand par Françoise Wuilmart. Gallimard, coll. Témoins, 259p. -
Rosebud's Memory
Dans Rosebud, Pierre Assouline scrute la part secrète de quelques vies (Citizen Kane, Kipling, Cartier-Bresson, Celan, Jean Moulin, Picasso, Bonnard) pour en tirer un livre très riche de résonances.
Le nom de Rosebud, soupiré par Citizen Kane à l’instant de sa mort, et signifiant « bouton de rose », est lié à l’image d’une « boule à neige » tombant de la main du mourant, symbole fracassé d’une enfance perdue. L’ultime vision d’une luge de bois ensevelie sous la neige suffit à l’amorce d’une remémoration comparable à celle de Proust retrouvant un monde dans la saveur d’une petite madeleine. De la même façon, il arrive qu’un simple objet, une odeur, le son d’une voix nous évoquent tel personnage, telle époque, tel fragment d’histoire que nous nous efforçons d’arracher aux brumes de la mémoire, comme pour conjurer notre propre disparition. Or c’est précisément à cette démarche que se livre Pierre Assouline dans cet essai très personnel où le biographe engage un peu plus de sa personne dans une sorte de conversation sur la vie et ses aléas, l’art et ses enjeux, le siècle et ses tribulations, l’amour et la mort, dont chaque épisode cristalliserait en «rosebud».
Une Rolls figure alors l’impériale situation d’un Kipling, nationaliste impatient d’envoyer son fils à la guerre, lequel y crève en effet et jette le malheureux paternel sur les routes de France en quête de la moindre trace de son « héros ». Et l’auteur d’exhumer cette phrase d’un roman français de l’époque pour dire ce que vit alors Kipling : «Il pénétra dans ces régions illimitées de la douleur, où l’imbécile et l’homme de génie ne se distinguent pas ». Ou c’est la canne-siège de son ami le photographe Cartier-Bresson, qui l’entraine au musée et lui fait voir ce que Goya a vu du tréfonds de la souffrance humaine : «Regarde bien, il n’y a que Goya qui ait vraiment compris la vie, la mort… »
Une montre arrêtée sera le rosebud de Paul Celan, le grand poète foudroyé par un désespoir qu’Assouline évoque dans l’un de ses plus beaux chapitres, et c’est une écharpe au cou de Jean Moulin qui l’amène à dévoiler les stigmates d’une tentative de suicide coïncidant avec le premier acte de révolte du futur résistant.
Les objets de curiosité d’Assouline sont multiples, du mariage de Lady Diana auquel il assiste en anglophile ironique, à cet antre parisien qui fut à la fois l’atelier de Picasso et le lieu de réunion des peintres du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac. A tout coup, cependant, plus que l’anecdote, c’est la relation du détail à l’ensemble qui déclenche la réflexion ou la rêverie de l’écrivain, incluant sa propre expérience sensible et sollicitant celle du lecteur, jusque dans le pur bonheur partagé des toiles d’un Bonnard taiseux incapable jamais de les finir - étant entendu que le « bouton de rose » de la beauté reste à jamais inatteignable…
Pierre Assouline. Rosebud. Gallimard, 299p.
 « L’essentiel est dans les détails »
« L’essentiel est dans les détails »
- Quel a été le déclencheur de ce livre ?
- Le point de départ, c'est le goût du détail qui me poursuit depuis longtemps. Là-dessus s'est greffé il y a quelques années un flash sur la photo de Jean Moulin, des réminiscences sur certains tabous le concernant, l'envie secrète de tout raconter à travers son écharpe. J'ai laissé mûrir. Jusqu'au jour où un autre flash m'a poussé plus avant : la lecture d'une brève dans Libération, faisant état de la découverte de vieux carnets de guerre inédits dans un tiroir de l'éditeur de Kipling... Vous connaissez la suite. Cela s'est fait naturellement. Et difficilement. En fait, cela m'a pris deux fois plus de temps que prévu car pour chaque détail, j'ai mené une enquête aussi approfondie que si je devais écrire toute une biographie. Et c'est la condensation du matériau qui me permet de parvenir à en tirer un jus si dense.
- Le biographe se découvre ici lui-même. L’aviez-vous prémédité ?
- Je savais que des éléments personnels se grefferaient sur le texte en cours d'écriture. Je me suis laissé emporter comme toujours. Ce n'était pas prémédité, je n'y suis presque pour rien. Impossible d'en écrire plus ou moins. Ce fut agréable de pouvoir écrire des chapitres indépendants les uns des autres. On y entre et on en sort comme et quand on veut. Mais l'aspect Mon coeur mis à nu ne se vit pas toujours facilement pour quelqu'un qui a plutôt l'habitude de s'effacer devant ses héros.
- Ces destinées si différentes ont-elle un point commun ? Et qu’aimeriez-vous transmettre par vos livres ?
- Le fil rouge ? La disparition, l'absence, le suicide, la mort. Le tout à travers une réflexion sur la biographie et l'art du biographe. Ce que je trouve m'apprend ce que je cherche : c'est donc en lisant les lettres de lecteurs que j'apprends ce que je voulais transmettre. L'essentiel des êtres que nous croisons, que nous rencontrons, que nous aimons parfois est dans les détails, les petits riens qui forment le tout d'une vie...
Ancien directeur de la rédaction de Lire, chroniqueur au Nouvel Observateur et au Monde 2, biographe (de Simenon, Gallimard, Hergé, Jean Jardin, Albert Londres, etc.) et romancier (Lutetia, a obtenu le prix Maison de la Presse 2005), Pierre Assouline, a 53 ans, est à la fois écrivain et passeur-lecteur, notamment sur son blog littéraire de La République des livres.
Cet article a paru dans l’édition de 24Heures du 28 novembre 2006. -
Cartier-Bresson devant Goya
En lisant Rosebud de Pierre Assouline (3)

« Il pourrait devenir aveugle, une vision veille en lui », écrit Pierre Assouline à propos de Cartier-Bresson qu’il accompagne ici en ami et en initié des choses de l’art et de la littérature, c'est à savoir de la vie filtrée, d’une acuité et d’une justesse rares dans la constante mise en relation du détail et de l’ensemble, du moment partagé et de la longue durée revécue ou pressentie.
Il est question dans ce chapitre d’un photographe qui dessine « ce qu’il voit » dans un musée de Budapest, assis sur une canne-siège qui définit assez exactement sa position de passant à stations telle que la capte son ami le biographe, lequel rappelle dans la foulée qu’on dirait que Cartier-Bresson réinvestit le mot de Goethe selon lequel « ce que l’on n’a pas dessiné on ne l’a tout simplement pas vu ». Et tandis que le vieil homme regarde un petit tableau de Goya (« Toute la douleur du monde se déploie là sous nos yeux à travers le regard du sourd. Au premier plan des femmes se font massacrer à bout portant. »), Assouline « dessine » le photographe ou plutôt le photographie, sûr que l’une de ses images a capté « le souffle d’une âme », et racontant cela dans ce chapitre en restituant par les mots cette image que nous ne verrons pas plus que les photographies prises par Cartier-Bresson les jours où son appareil ne contenait pas de film, « cosa mentale »… Or voici l’homme que voit l’homme : « Il ne remarque rien tant il est bouleversé. Ses beaux yeux bleus embués sont à cinquante centimètres à peine de la toile. Il la fixe et répète : « Il a tout compris, Goya, tout vu, tout dit »… Et plus loin cela encore : « De son regard panoramique à 180 degrés, Henri voit tout. Il sent tout, devine tout mais ne dit rien. C’est à peine si un murmure s’échappe encore de ses lèvres : « Regarde bien, il n’y a que Goya qui ait vraiment compris la vie, la mort… »
Et Pierre Assouline d’ajouter : « Seul un artiste peut nous faire toucher de l’œil cette région obscure de l’âme où l’animal est tapi dans l’homme. Là où les philosophes échouent à expliquer la barbarie en lui, il ressuscite son fonds bestial. L’art n’est pas l’ornement, peu l’ont dit aussi fort que Goya dès ses cartons de tapisserie. Henri est bouleversé de le sentir si souvent au bord du gouffre où le précipite l’angoisse absolue. Seule la compassion du peintre pour les spectres d’humanité que son pinceau jette sur la toile peut conjurer son pessimisme »…
Et c’est vrai qu’il y a, dans l’art le plus désespéré de Goya, comme une prière d’espoir et comme une preuve d’humanité vibrante et sourdement jubilante qu’on retrouve dans les thrènes picturaux de Zoran Music ou les poèmes de Paul Celan que, justement, Pierre Assouline évoque dans le chapitre suivant de Rosebud…

Ci-dessus: dessin de Cartier-BressonGoya, détail du Tres de mayo et gravure des Désastres de la guerre
-
La Rolls de Kipling
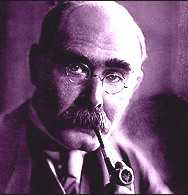
En lisant Rosebud de Pierre Assouline (2)
Nous sommes tous un peu fils de Kipling, les garçons. Tous nous avons un peu de Mowgli, un peu de Kim, un peu du fils de Kipling en nous, ce pauvre John à qui était destiné le poème universellement connu grâce auquel nous savons désormais comment devenir un homme, mes frères, If…
Un vrai père, et de sa nation, que Pierre Assouline fait errer à bord de sa Rolls Duchess après la disparition de son fils de dix-huit ans, probablement à la bataille de Loos, fin septembre 1915, mais jamais il n’en sera sûr, même s’il parvient à faire graver le nom de John Kipling sur une pierre tombale au lieu du seul « known unto God ».
Notre époque d’égalitarisme et de ressentiment voudrait ignorer la douleur des riches, et d’autant plus qu’il s’agit ici d’un réac colonialiste, fauteur de guerre et y poussant son John bigleux et mal fichu qui se pique de n’avoir jamais lu les livres du paternel. Kipling lui-même ne se lâchera pas d’un bouton de col : dignité virile oblige, mais sa détresse n’en est pas moindre, qui va se traduire par ses mots éparpillés sur des stèles en terre de France : « Ses Epitaphes de guerre resteront gravées dans les marbres. Son fils y est partout, dans les lignes, entre les lignes, derrière les lignes ». En quelques mots personnels poignants, Pierre Assouline fait écho à la peine de Kipling en évoquant celle de son propre père brisé par la mort de son fils aîné. Frères humains devant l'arbre arraché. Alors la Rolls, la gloire, l’Empire, les principes, les boutons, tout ça se trouve balayé tandis que ne restent dans le vent du bord de mer que les mots de My Boy Jack :
Avez-vous des nouvelles de mon fils Jack ?
Pas à cette marée.
Quand croyez-vous qu’il reviendra ?
Pas avec ce vent qui souffle, et pas à cette marée…
Eclats de biographie : une trentaine de pages et c’est un portrait de l'homme nu à fines touches qui se dessine, un style et une attitude devant la vie, des éclats de lecture qui renvoient à l’œuvre et à un roman oublié des frères Jean et Jérôme Tharaud, Dingley l’illustre écrivain, dont la scène capitale préfigure ce que Kipling, modèle du roman, vivra quelques années plus tard. Ainsi les auteurs évoquent-ils la douleur de Dingley, retour des combats du Transvaal qu’il a exaltés, devant la mort de son jeune fils tombé malade en son absence : « Il pénétra dans ces régions illimitées de la douleur, où l’imbécile et l’homme de génie ne se distinguent pas ».