
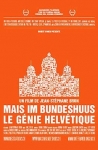

Le Génie helvétique de Jean-Stéphane Bron
Démocratie mode d'emploi: tel pourrait être le sous-titre de Maïs im Bundeshuus (qu'on pourrait traduire par « Du foin au Palais fédéral »), intitulé Le génie helvétique en notre langue et qui nous fait pénétrer dans les coulisses du saint des saints de la politique helvétique à l'occasion de la préparation, par une commission parlementaire, d'une loi sur le génie génétique, dite Gen-Lex.
D'un projet qui pourrait sembler austère, voire rébarbatif, le jeune réalisateur lausannois Jean-Stéphane Bron, assisté d'Adrian Blaser, a tiré un film extrêmement vivant et intéressant, confirmant très largement les promesses de deux premières réalisations remarquées, Connu de nos services et La bonne conduite, déjà vus par plus d'un million de (télé) spectateurs du monde entier.
— Quel parcours, Jean-Stéphane Bron, vous a-t-il mené à la réalisation ?
— Dès la fin de mon adolescence, j'ai été un rat de cinémathèque, et mon bac en poche, ayant appris qu'il y avait en Italie une école accessible sans examen dirigée par Ermano Olmi, auteur de L'arbre aux sabots — un film qui m'a beaucoup marqué —, je me suis pointé à Bassano, où j'ai suivi une série de stages très formateurs du point de vue de la « lecture » des films. L'approche était plutôt esthétique et philosophique, car nous ne touchions pas de caméra. Ensuite, j'ai passé à la pratique à l'ECAL, sous la direction d'Yves Yersin qui avait pour principe, comme dans une école de métiers, de nous initier à tous les aspects techniques de la réalisation. C'est ainsi que je faisais l'électricien sur le plateau du Petit prince a dit, de Christine Pascal, lorsque j'ai rencontré Claude Muret. C'est après que ce grand militant lausannois a reçu le paquet de ses fiches, que j'ai décidé de consacrer un film vidéo à ce sujet, en 1997.
— Ce qui frappe, dans Connu de vos services, comme dans Le génie helvétique, c'est votre approche équitable et bienveillante des gens, qu'ils soient militants ou policiers, politiciens de gauche ou de droite ...
— Le souci d'aller vers les gens, de partir du naturel et de le tirer vers une certaine dramaturgie fait partie de mes principes de base. Je crois que je fais partie d'une génération aussi consciente des problèmes sociaux ou politiques que la précédente, mais qui réagit différemment. Nous sommes réconciliés avec le pays, ce qui ne signifie pas alignés-couverts ! La réflexion qui m'est venue en travaillant à Connu de nos services, c'est: tout de même, cette incroyable masse de fiches pour un militant qui n'a pas reçu une baffe dans un commissariat... Je n'ai pas l'impression d'avoir de message à délivrer, alors que j'ai en revanche des choses à montrer.
— Comment l'idée de Génie helvétique vous est-elle venue ?
— D'un premier constat: qu'aucun film n'avait jamais été fait dans le Palais fédéral, et d'une curiosité: comment ça marche ? J'avais envie de tirer parti de l'incroyable accessibilité des « miliciens » de la politique suisse et de répondre à cette autre question: qu'est-ce que le consensus produit de singulier ? Après une première approche des lieux, je me suis dit que c'était beaucoup trop compliqué. Puis, je me suis demandé comment il serait possible de réduire la distance. C'est pourquoi j'ai choisi cinq personnages représentatifs de toutes les tendances, que j'ai « élus » au feeling. Il fallait que tous aient la même chance à la base. Je savais qu'il y aurait un préjugé idéologique immédiat à l'encontre de tel UDC ou de tel représentant de l'industrie, et je ne voulais pas de ce genre de simplification. D'ailleurs, le débat, complexe à souhait, sur le génie génétique, défiait toute simplification.
— Comment avez-vous travaillé ?
— En petite équipe de trois, pour la première partie qui relève de l' « exposition » des faits, des enjeux, des débats, des alliances et revirements. Puis, pour la partie plus « théâtrale » du plénum, avec six caméras en mouvement dans l'assemblée. Mon atout majeur, par rapport à une équipe de télévision, c'est que je pouvais travailler avec le temps, et c'est d'ailleurs un autre de mes principes. Une complicité s'est donc tissée avec mes « acteurs » que j'ai fini par tous tutoyer, sauf Jacques Neirynck, d'octobre 2001 à juillet 2002. Le défi représenté par la situation elle-même, avec l'interdiction qui m'était faite d'entrer dans la salle des débats, tenait à réaliser un film entier sur le principe du hors-champ, à part les séquences finales. Encore heureux que, dans ce Palais fédéral baigné par une pénombre assez sinistre, le couloir de nos rencontres ait été éclairé par des verrières zénithales.
— Vos « acteurs » ont-ils vu le film achevé, et comment ont-ils réagi ?
— Ils l'ont visionné ensemble et, à part les réactions classiques du genre « untel joue mieux que moi ... », entre autres coquetteries, ils ont tous admis que c'est en effet « comme ça que ça se passe »...
Au théâtre du réel
On pourrait voir Le génie helvétique comme une pièce de théâtre en deux actes, dont le premier s'intitulerait « Confidences derrière la porte » et le second « Pour la galerie ». Cependant, même si les cinq parlementaires assumant ici les premiers rôles représentent de véritables personnages, avec leurs traits bien marqués, leur discours typé, leurs tics particuliers et leur charme commun, c'est dans la matière et le mouvement imprévisible de la vie que les saisit Jean-Stéphane Bron, sans oublier un instant le propos de son film, lié aux enjeux de la procédure politique, laquelle nous renvoie à la case « réel ».

La description de la « comédie » politique marque une véritable progression dramatique, correspondant à l'enchaînement des exposés, débats, manœuvres et votes successifs. Les diverses positions, de la gauche à la droite, sont immédiatement incarnées, de Maya la jeune paysanne écolo à Randegger le radical zurichois « roulant » pour l'industrie, en passant par Sepp l'UDC agriculteur, très partagé entre les principes de son parti et sa sensibilité terrienne, ou le professeur Neirynck, humaniste PDC plutôt favorable à la recherche scientifique, mais non sans nuances.

Entre sourires roués et «vannes » lancées au passage, regards qui en disent long et conciliabules en catimini, nous voyons se faire et se défaire les alliances, avec un crescendo montant jusqu'au vote à couteaux tirés, préludant au débat final en assemblée plénière où, à grands effets de manches, les uns et les autres montent au créneau, tel le radical Claude Frey réduisant à rien le travail de la commission: « C'est n'importe quoi !»
Omniprésents, l'œil et l'oreille ultrasensibles du témoin extérieur enregistrent tout de ce jeu démocratique plein d'aléas, à la fois cordial et tendu, avec ses composantes humaines (les protagonistes sont également approchés dans leur jardin privé) et ses règles plus froides, ses ruses, sa bonne et sa mauvaise foi bien partagées. Plus que du reportage, c'est ici du cinéma-confidence et du cinéma-vérité, réordonné par un montage aussi vivant que signifiant.
Cinéma et politique en Suisse
« Travailler à la manière ascétique de Richard Dindo me semble intenable aujourd'hui », remarque Jean-Stéphane Bron, tout en rendant hommage au maître dont il a vu tous les films, à commencer par L'Exécution du traître à la patrie Ernst S. , remontant à 1977 et faisant date dans l'histoire du cinéma helvétique, autant que les Reportages en Suisse de Niklaus Meienberg.
"Plus que la position critique de Dindo ou de Meienberg, c'est plutôt la manière, très idéologisée dans les années 60-70, dans la mouvance marxiste, qui paraît aujourd'hui dépassée, comme aussi le rapport avec le public.
« Notre génération a intégré la télévision, remarque encore Bron, et nous devons aller plus vers le public. »
Cela étant, la position du réalisateur du Génie helvétique ne marque pas pour autant une rupture par rapport au cinéma en phase avec la réalité sociale ou politique du pays. Il n'est que de rappeler les films réalisés par Henry Brandt à l'enseigne de l'Exposition nationale, en 1964, ou, à la même époque, le reportage social consacré par Alain Tanner aux Apprentis, pour relier son travail à celui de ses prédécesseurs.
Autre exemple plus récent et plus proche à citer: celui du réalisateur lausannois quinquagénaire Frédéric Gonseth, issu lui aussi des milieux d'extrême-gauche, et dont le travail pourrait illustrer l'évolution d'un cinéma qu'on pourrait dire de « dénonciation », à une façon moins dogmatique de témoigner, plus en phase avec la complexité humaine. La plus belle preuve en est, après son très poignant reportage sur les séquelles du stalinisme en Ukraine et le sort tragique des prisonniers de guerre soviétiques, le documentaire intitulé Mission en enfer où l'on découvre une page occultée de notre histoire, impliquant la Croix-Rouge et nos plus hautes autorités politiques, qui laissèrent des centaines de médecins et d'infirmières tomber dans le piège de l'armée allemande.
Reste à recentrer le débat sur la question de fond: savoir si l'affranchissement des carcans idéologiques va de pair avec une ressaisie réellement créatrice et novatrice de la réalité humaine, par-delà tout ancrage suisse — avec la fiction en point de mire
Le nouveau film de Jean-Stéphane Bron, Mon frère se marie, marquant son passage à la fiction, avec Jean-Luc Bideau (grand retour d'un acteur ici magnifique) et Aurore Clément (formidable elle aussi dans cette histoire de famille à la fois comique et très émouvante), sera projeté sur la Piazza Grande de Locarno le 8 août 2006.





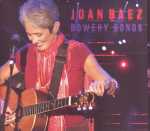




 Notes avant parution
Notes avant parution émoires de porc-épic. Seuil, 229p. Après Verre cassé , l’auteur congolais le plus en vue du moment à Paris poursuit une œuvre alternant la pleine pâte du roman et les pointes de la réflexion. Il réinvestit ici l’esprit du conte à la manière africaine.
émoires de porc-épic. Seuil, 229p. Après Verre cassé , l’auteur congolais le plus en vue du moment à Paris poursuit une œuvre alternant la pleine pâte du roman et les pointes de la réflexion. Il réinvestit ici l’esprit du conte à la manière africaine.






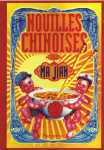


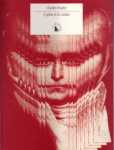
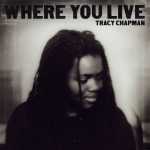
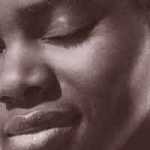 Tracy Chapman au Montreux Jazz Festival. Après les électrochocs d’Eels, la chanteuse a fait oublier la touffeur du Miles Hall pris d’assaut par 2000 fans.
Tracy Chapman au Montreux Jazz Festival. Après les électrochocs d’Eels, la chanteuse a fait oublier la touffeur du Miles Hall pris d’assaut par 2000 fans.
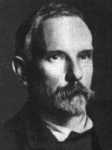 L’auteur démasqué (23)
L’auteur démasqué (23)
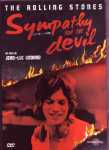 C’est un film intéressant à de multiples égards que One+One dans la présente version « autorisée » par Jean-Luc Godard, assortie de plusieurs entretiens explicatifs éclairants sur sa genèse, notamment avec Jean Douchet et Christophe Conte, ainsi qu’un making of de Richard Mordaunt.
C’est un film intéressant à de multiples égards que One+One dans la présente version « autorisée » par Jean-Luc Godard, assortie de plusieurs entretiens explicatifs éclairants sur sa genèse, notamment avec Jean Douchet et Christophe Conte, ainsi qu’un making of de Richard Mordaunt.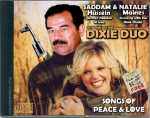



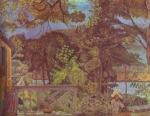



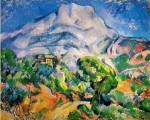 Une lettre de Rainer Maria Rilke
Une lettre de Rainer Maria Rilke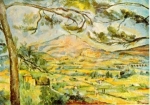

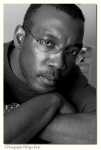
 Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent
Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent