
C’est un très grand artisan de la mise en scène théâtrale contemporaine qui vient de s’éteindre en la personne de Benno Besson, une vingtaine d’année après qu’il eut ramené les scènes romandes à l’heure européenne. Dès sa première réalisation, à La Comédie de Genève, de L’oiseau vert d’après Gozzi, les prédictions de ceux qui voyaient d’un mauvais œil le retour au pays de cet émule de Brecht le rouge, concluant déjà au complot gauchiste et à l’art doctrinaire, se trouvèrent balayées par un spectacle flamboyant et festif, relevant d’un théâtre pour tous aux très hautes exigences artistiques. A l’opposé de l’art édifiant et gris que proposaient les brechtiens français de l’époque et quelques épigones romands, Benno Besson fut le premier à rappeler qu’un art vraiment populaire passe par le plaisir partagé, la sensualité autant que le sens critique ou poétique. A égale distance des tenants souvent complaisants d’un théâtre de pur divertissement jouant sur le vedettariat, des sectes avant-gardistes confinées dans leurs théories, entre autres « déconstructeurs » de textes et de formes, il proposait l’alternative d’un théâtre aussi travaillé que généreux, au service de textes fondateurs à redécouvrir. D’une relecture de Hamlet à telle pochade de René Morax, en passant par la mémorable découverte du Mangeront-ils ? de Victor Hugo ou son extraordinaire recréation du Cercle de craie caucasien, Benno Besson servait son art plus qu’il ne s’en servait pour briller. Rien de l’illusionniste à effets chez ce « grand classique », selon l’expression de René Gonzalez, qui avait la malice de relever que si Molière disposait d’un Lully, lui-même ne trouvait pas plus mal de s’acoquiner avec les Poubelles Boys…
Vaudois de souche, ce terrien bourru n’avait rien abdiqué de ses idéaux de jeunesse, fidèle pour l’essentiel à l’idée qu’il se faisait de la dignité humaine, révolté à vie contre l’injustice et l’imbécillité, toujours fervent à redécouvrir la sagesse et la beauté dans un texte, la saveur de fruit mûr d’un mot, la musique de la langue filée à travers les siècles.
Benno Besson n’est plus, maître-compagnon d’un art non moins éphémère, mais l’âme du théâtre a été revivifiée en nous grâce à lui, comme son souvenir nous restera jusqu’au dernier tomber de rideau…
René Gonzalez, directeur du Théâtre de Vidy :
« Il a fait de la vie des autres un chef-d’œuvre »
La tristesse est grande au théâtre au bord de l’eau où Benno Besson, après l’aventure de La Comédie, avait trouvé une maison d’accueil grande ouverte et un défenseur inconditionnel en la personne de René Gonzalez. Sur la porte de celui-ci figure d’ailleurs une réflexion empruntée à Besson : «Le théâtre est quelque chose d’indispensable s’il ne sert pas la vanité ».
L’humilité des grands, Benno Besson l’avait manifestée par un dernier cadeau à Vidy, en montant Les quatre doigts et le pouce de René Morax avec autant de soin que s’il se fût agi d’un classique à la Racine. « Benno tutoyait les dieux », raconte René Gonzalez, comme il tutoyait le dernier des servants du théâtre. On n’a pas idée de ce qu’a été son enseignement pour les techniciens autant que pour les comédiens et tous les clampins que nous sommes. C’était un maître artisan. Maître, il ne l’était pas par l’affirmation hautaine d’un pouvoir, mais tous l’auraient reconnu spontanément parce qu’il était à l’évidence le maître-compagnon, compagnon du devoir mais aussi compagnon du plaisir. Des hommes de métier de cette valeur, que certains ont mis des années à reconnaître après l’avoir flingué, et je dirai plus simplement : des hommes de cette qualité, car la qualité humaine primait chez lui, nous n’en croisons pas souvent. Ce que je relèverai alors, c’est qu’il a fait de la vie des autres un chef-d’œuvre ».
Les spectateurs de Vidy se rappelleront toujours, à cet égard, la représentation du Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, par le truchement duquel Benno Besson fit de ces heures partagées un inoubliable chef-d’œuvre…

Anne Cuneo, écrivain.
«Benno Besson a changé ma vie sur le plan artistique. La seconde partie de ma carrière d’écrivain, tant pour le théâtre que dans mes romans, a été réellement transformée par ce qu’il m’a appris : il y a un avant et après Besson. J’ai commencé par assister à son travail, sur la réalisation de Hamlet, avec l’idée d’en faire un texte. Il ne l’a pas aimé, faute de ce qu’il appelait l’immersion. Il me reprochait de ne pas « entendre » ce que j’écrivais. Ensuite c’est lui qui m’a invité en Finlande à l’assister pour la reprise du même de la même pièce de Shakespeare, et ce fut l’occasion d’une relation plus amicale avec cet homme qui ne me semblait vivre vraiment qu’au théâtre. Au fil des mois, il m’a également ouvert beaucoup de nouveaux horizons, avec des réflexions pénétrantes, par exemple sur la période élisabéthaine ou la transformation de la société bourgeoise. Cet apport sans pareil, je le raconte dans Benno Besson et Hamlet, le récit central d’un livre récent. Mais c’est à la transformation même de mon écriture que se mesure ce qu’il m’a donné ».
Jacques Roman, comédien.
« Benno Besson, c’était l’énergie incarnée, et communicative. Il lui fallait toujours un quart d’heure pour se mettre en train, et ensuite plus rien ne l’arrêtait. Il faut rappeler une chose essentielle: sa formation de philologue. La langue était donc au cœur du travail, le texte était le matériau de base, mais pas le texte figé : le texte à la naissance des mots, les mots qu’il nous incombait de recréer pour ainsi dire. Il voulait entendre toutes les notes. Parfois, le travail sur une réplique pouvait durer des heures. C’était d’ailleurs un travail très physique, jamais à la table, tout de suite en scène. Il nous faisait répéter sur des sols mouvants, en perpétuelle recherche d’équilibre et vite. Son maître-mot était: «Penser vite ! Sentir vite ! ». Son recours au masque devait lui aussi servir le texte, au détriment de la grimace vaniteuse, ce qui faisait souffrir certains comédiens soucieux de leur ego. On pouvait être rebuté, en outre, par son hyper-autoritarisme, ou contester certaines de ses options, mais le caractère absolu de son engagement le justifiait. »
Ces articles ont paru dans l'édition de 24 Heures du 24 février.











 Une lecture intégrale des Chants de Maldoror
Une lecture intégrale des Chants de Maldoror 













 me moi, tel l’escargot du futur, avec son ordinateur sur le dos. «Une telle peste ne m’aura pas dans son lazaret », note-t-il au terme du travail de « fusion rhapsodique » qu’il a accompli dans La patience du brûlé (La pazienza dell’arrostito) sur la base de carnets annotés à la main au fil de cinq ans de déambulations par les routes d’Italie et les livres, de 1983 à 1987.
me moi, tel l’escargot du futur, avec son ordinateur sur le dos. «Une telle peste ne m’aura pas dans son lazaret », note-t-il au terme du travail de « fusion rhapsodique » qu’il a accompli dans La patience du brûlé (La pazienza dell’arrostito) sur la base de carnets annotés à la main au fil de cinq ans de déambulations par les routes d’Italie et les livres, de 1983 à 1987.



 que rien d’intéressant ne s’écrit dans ce pays, un reproche plus fondé a souvent été fait, à la littérature romande, de manquer d’attention au monde extérieur et de se cantonner dans un certain nombrilisme spiritualisant, dans la double tradition de l’individualisme protestant et du romantisme panthéiste hérité de Rousseau. Ce qu’on appelait naguère l’« âme romande», les yeux au ciel, a cependant du plomb dans l’aile, tant l’éclatement des frontières et la transformation des mentalités et des mœurs ont marqué le climat social et moral dans lequel nous baignons, et les preuves de rupture ne cessent de se multiplier, comme l’illustrent les deux derniers livres d’Yves Laplace et Frédéric Pajak, tous deux d’ailleurs assez décentrés par rapport à la culture romande, encore que…
que rien d’intéressant ne s’écrit dans ce pays, un reproche plus fondé a souvent été fait, à la littérature romande, de manquer d’attention au monde extérieur et de se cantonner dans un certain nombrilisme spiritualisant, dans la double tradition de l’individualisme protestant et du romantisme panthéiste hérité de Rousseau. Ce qu’on appelait naguère l’« âme romande», les yeux au ciel, a cependant du plomb dans l’aile, tant l’éclatement des frontières et la transformation des mentalités et des mœurs ont marqué le climat social et moral dans lequel nous baignons, et les preuves de rupture ne cessent de se multiplier, comme l’illustrent les deux derniers livres d’Yves Laplace et Frédéric Pajak, tous deux d’ailleurs assez décentrés par rapport à la culture romande, encore que…


 Quatre d’entre elles (2)
Quatre d’entre elles (2)
 Quatre d’entre elles (1)
Quatre d’entre elles (1)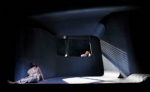 Eloge de la faiblesse à la scène
Eloge de la faiblesse à la scène 






