De Houellebecq en Dantzig
A La Désirade, ce mercredi 7 septembre. – Je reviens « à moi ». Après sept jours passés à la lecture de La possibilité d’une île, je reviens « à moi » ce qui signifie : à ma propre perception de la réalité. Je suis certes content d’avoir lu le livre de Michel Houellebecq à fond, parce qu’il le mérite, mais si j’estime ce livre important pour l’époque, et que je reconnais qu’il m’a captivé, j’éprouve à présent le besoin de revenir à ma façon naturelle d’aimer et, revenant « à moi », je reviens au vrai partage d’une passion que m’offre, si généreusement, le Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig dont j’ai relu ce matin les rubriques consacrées au mots Âme, Amour et Amers grincheux.
et Amers grincheux.
C’est un peu comme au jardin zoologique . On regarde un moment l’ornithorynque. Il est intéressant. Vraiment un drôle de cocktail, cet Arcimboldo animal, puis on retourne à l’otarie faisant la folle dans la cascade ou au lion pensif à plat ventre dans sa crinière de philosophe du XIXe finissant.
. On regarde un moment l’ornithorynque. Il est intéressant. Vraiment un drôle de cocktail, cet Arcimboldo animal, puis on retourne à l’otarie faisant la folle dans la cascade ou au lion pensif à plat ventre dans sa crinière de philosophe du XIXe finissant.
Houellebecq radote à propos de Nabokov, comme Nabokov a radoté à propos de Faulkner ou de Dostoïevski, mais c’est la loi du jardin zoologique : le lamantin ne saurait même concevoir l’oiseau de paradis, ni celui-ci se figurer la possibilité d’un gnou sur une île flottante, tandis que nous passons d’une cage à l’autre, Charles Dantzig et ses amis, en devisant tranquillement.
Voici ce que dit Dantzig du mot Âme dont les poètes font leur bonnet même en été : « Âme est un mot simple, dont on ne se méfie pas à cause de sa simplicité, au contraire des célèbres mots en « ismes » dont le monde se méfie à cause de ce tatouage à la cheville qui siffle : « Attention, notion ! »
Et ceci encore de si juste : « Âme révèle souvent l’orgueil insensé d’écrivains qui se proclament humbles, comme Villiers de l’Isle-Adam qui écrit : « Je n’écris que pour les personnes atteintes d’âme » (Fragments divers). Et cela encore : « Certains écrivains emploient ces mots comme les femmes qui vont au marché avec tous leurs bijoux ».
Ensuite Dantzig , à propos d’Amers et grincheux, multiplie les constats d’une fusillante pertinence. « La moitié de la gloire de Baudelaire vient, non de ses grands vers, mais de ce qu’il n’est jamais content. L’amertume plaît aux auteurs, en ce qu’elle réfute leur responsabilité, aux lecteurs en ce qu’elle justifie leurs rancoeurs. » Ensuite à Cioran qu’il appelle « l’amer en chef », il reproche d’employer la langue française « avec un vocabulaire d’étudiant en sociologie » qui abuse des points de suspension, ce qui fait de lui « un moraliste distendu ». Et de conclure : « Un moraliste devrait assumer sa posture de tueur méprisant : une phrase, une balle, on rengaine ». Ainsi s’exprime Charles Dantzig .
Et cela qu’on dirait du Vialatte : « Selon les grincheux, nous vivons en décadence. Comme si la décadence n’était pas là depuis le premier jour de la vie. Chassé du paradis, Adam errait en grommelant : « Tout fout le camp ». Avant c’était mieux. Après ce sera mieux. Pauvre présent ! pauvre présent toujours injurié, présent qui est nous, présent qui n’arrive jamais à se débarrasser du chewing-gum du passé, et devant qui on agite en permanence le papier brillant de l’avenir, pauvre présent, tu trouve les moyen d’admirer ceux qui t’injurient ! »
Sur Amour aussi notre compagnon de route excelle. Je ne cite pas tout mais ceci doit l’être : « L’amour est un espoir. De là sa nuance de bassesse. Seulement, c’est un espoir envers soi-même, de pouvoir être assez bien pour plaire, etc. De là sa nuance de hauteur. Une des conséquences positives de l’amour est la vanité. Tous les efforts qu’on fait pour attirer l’attention de l’autre et qui nous améliorent… » On voit qu’on est loin de la philosophie de Marc Levy.
Et cela : « Bien sûr, il n’y a que l’amour, et ce livre même n’est qu’un grand imprimé d’amour destiné à en créer, mais je crois qu’il ne faut pas trop le dire. Les forces de la haine en profiteraient pour enrôler dans leurs troupes les esprits irrités par l’air béat que, disent-elles, l’amour donne ».
On le constate dès qu’on entre dans Le passé, grand roman d’amour de l'Argentin Alan Pauls (Bourgois, 2005) dont j'ai entrepris la lecture cette nuit et qui vibre d'électricité passionnelle dès ses premiers chapitres rappelant Proust - et très vite il faut se faire à la béatitude des jeunes amants sous peine de retourner à la cage de l’amer Michel…
Quant à Dantzig il remet ça : « Les femmes deviennent amoureuses espérant introduire du romanesque dans leur vie. Ayant constaté que cela a surtout introduit des emmerdements, elles lisent des romans ». Et cela enfin : « L’amour est le seul sujet sur lequel on puisse écrire n’importe quoi, car l’amour est n’importe quoi. C’est une qualité ».
Charles Dantzig est à la fois l’un des gardiens du jardin zoologique et l’interprète de tous les animaux dont l’un de ses préférés est la Fontaine, il me semble. A propos d’Amour, encore, il relève que La Fontaine écrit que « son mari l’aimait d’amour folle ». Ce qui lui fait conclure : « C’est charmant, frais, pimpant, un air de flûte, reste des temps médiévaux qui croyaient aux fées. « Un jeune fol s’éprit d’amour folle… » Et c’est le début d’un conte".
 pan de sa vie auquel le temps lui manquait d’accorder la moindre attention (sa femme justement, ses enfants, tout ça…), pourrait relever du lieu commun d’époque, comme il en prolifère dans les romans actuels. L’inhumanité croissante du monde qu’on appelle néo-libéral, la fuite en avant de ces hommes-creux réduits à leur fonction sociale, déjà typés au début du XXe siècle par Dostoïevski ou Kafka, appelle évidemment la réaction et la critique, mais encore faut-il que celles-ci s’étoffent à proportion de la complexité humaine, étant entendu que le pur pantin social n’existe pas et ne présente aucun intérêt pour le romancier.
pan de sa vie auquel le temps lui manquait d’accorder la moindre attention (sa femme justement, ses enfants, tout ça…), pourrait relever du lieu commun d’époque, comme il en prolifère dans les romans actuels. L’inhumanité croissante du monde qu’on appelle néo-libéral, la fuite en avant de ces hommes-creux réduits à leur fonction sociale, déjà typés au début du XXe siècle par Dostoïevski ou Kafka, appelle évidemment la réaction et la critique, mais encore faut-il que celles-ci s’étoffent à proportion de la complexité humaine, étant entendu que le pur pantin social n’existe pas et ne présente aucun intérêt pour le romancier.

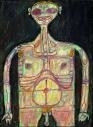 Lecture de La possibilité d'une île (4)
Lecture de La possibilité d'une île (4) Lecture de La possibilité d'une île (3)
Lecture de La possibilité d'une île (3)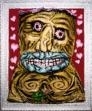




 s élémentaires, d’une prose peut-être moins immédiatement « originale » que celle d’Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus loin et avec plus d’énergie.
s élémentaires, d’une prose peut-être moins immédiatement « originale » que celle d’Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus loin et avec plus d’énergie.
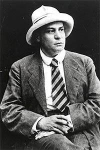


 oge de l’adverbe, l’influence de l’âge sur la lecture ou la crétinerie mesquine du Journal inutile de Morand, sur près de 1000 pages, notre langue est à la fête sous la plume libre et très aimante d’un merveilleux grappilleur.
oge de l’adverbe, l’influence de l’âge sur la lecture ou la crétinerie mesquine du Journal inutile de Morand, sur près de 1000 pages, notre langue est à la fête sous la plume libre et très aimante d’un merveilleux grappilleur.

 En lisant Asiles de fous
En lisant Asiles de fous t mal, puis elle écrit : « Je ne connais pas les langues, aucune langue, de mes père, mère, ancêtres, je ne reconnais ni terre ni arbre, aucun sol ne fut le mien comme on dit je viens de là, il n’y a pas de sol où j’éprouverais la nostalgie brutale de l’enfance, pas de sol où écrire qui je suis, je ne sais pas de quelle sève je me suis nourrie, le mot natal n’existe pas, ni le mot exil, un mot pourtant que je crois connaître mais c’est faux, je ne connais pas de musique des commencements, de chansons, de berceuses, quand mes enfants étaient petits , je le berçais dans une langue inventée »…
t mal, puis elle écrit : « Je ne connais pas les langues, aucune langue, de mes père, mère, ancêtres, je ne reconnais ni terre ni arbre, aucun sol ne fut le mien comme on dit je viens de là, il n’y a pas de sol où j’éprouverais la nostalgie brutale de l’enfance, pas de sol où écrire qui je suis, je ne sais pas de quelle sève je me suis nourrie, le mot natal n’existe pas, ni le mot exil, un mot pourtant que je crois connaître mais c’est faux, je ne connais pas de musique des commencements, de chansons, de berceuses, quand mes enfants étaient petits , je le berçais dans une langue inventée »…


 e, ce 25 août (soir)
e, ce 25 août (soir)

 A La Désirade, ce mercredi 24 août
A La Désirade, ce mercredi 24 août En lisant L'Adieu au nord de Pascale Kramer
En lisant L'Adieu au nord de Pascale Kramer A La Désirade, ce 21 août 2005
A La Désirade, ce 21 août 2005

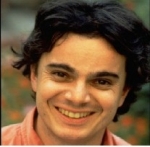


 Autre détail: j’ai relevé ce matin, sur le rapport quotidien des visites de ce blog, que j’avais reçu 2071 coups d’œil durant cette première quinzaine d’août, et là encore je me suis dit : gare à l’illusion : un clic et tout ça s’évapore comme neige de baleine au soleil assassin…
Autre détail: j’ai relevé ce matin, sur le rapport quotidien des visites de ce blog, que j’avais reçu 2071 coups d’œil durant cette première quinzaine d’août, et là encore je me suis dit : gare à l’illusion : un clic et tout ça s’évapore comme neige de baleine au soleil assassin…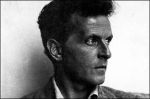 conque pour connaître « le monstre », lui qui l'avait côtoyé en son adolescence, au collège de Linz ? Telles sont les questions qui se posent assez insidieusement à la lecture de ce (remarquable) petit livre, en lequel il faut voir une variation romanesque bien plus qu'un début de mise en accusation.
conque pour connaître « le monstre », lui qui l'avait côtoyé en son adolescence, au collège de Linz ? Telles sont les questions qui se posent assez insidieusement à la lecture de ce (remarquable) petit livre, en lequel il faut voir une variation romanesque bien plus qu'un début de mise en accusation.
