
Il est de bon ton, par les temps qui courent, de dauber sur les idées et les images qui ont cimenté, à un moment donné, l'identité de la Suisse, notamment en exaltant, au XIX e siècle, les valeurs de la tradition alpestre comme patrimoine commun aux campagnes et aux villes. Malgré toutes les « prises de conscience » et autres démythifications, reste une histoire qui nous est propre, et surtout un héritage culturel qui ne se réduit pas à des clichés. Une nouvelle preuve nous en est donnée par un superbe ouvrage que vient de publier Françoise Jaunin, irremplaçable vestale de la chronique artistique de 24 heures, dont l'érudition jamais pédante, les curiosités historico-sociologiques et le goût avéré s' associent heureusement dans cette traversée de cinq siècles de peinture (elle s' en est tenue à ce médium sous la menace de son éditeur, malgré sa démangeaison fébrile d'évoquer telle « installation » sur les hauts gazons ou telle vidéo sondant les entrailles utérines de la Jungfrau …) illustrés par cinquante reproductions d'œuvres majeures, connues ou à découvrir. Sous la jaquette dévolue au flamboyant Hodler (une exposition récente à Genève en a illustré la fascinante trajectoire, jusqu' aux confins de l'abstraction), voici défiler Caspar Wolf et un Calame sublime évoquant le romantique allemand Caspar David Friedrich, un autre paysage saisissant de Böcklin et une vision symboliste de Segantini, de fortes visions « métaphysiques » de Turner et de Cuno Amiet ou d'Albert Trachsel, de Luigi Rossi, des fusions expressionnistes signées Jawlensky, Kirchner ou Kokoschka, entre autres auteurs contemporains plus cérébraux, de Maya Andersson à Daniel Spoerri, ou de Rolf Iseli à Markus Raetz.

Ainsi que le rappelle justement Françoise Jaunin, les Suisses n'ont pas découvert les beautés prestigieuses de la montagne à l'époque des Confédérés. Longtemps, les monts chaotiques ne furent le berceau que de démons menaçants, bombardant les alpages comme le rappelle la quille du Diable des Alpes vaudoises. A l'époque où Madame de Sévigné, lorgnant à sa fenêtre les aimables rochers de la Drôme, rêvait d'un peintre qui pût représenter les « épouvantables beautés » de la montagne, c'étaient les Anglais qui fourbissaient leurs pinceaux et non les Suisses.
Les Anglais et l'Europe cultivée du XVIIII e, intégrant la Suisse dans le classique Grand Tour, puis un poème best-seller international datant de 1729 (Les Alpes d'Albrecht von Haller, traduit dans toutes les langues européennes), un autre livre culte signé Rousseau et publié en 1761 sous le titre de La Nouvelle Héloïse, enfin les travaux du naturaliste genevois Horace Bénédict de Saussure préludant à la conquête du Mont-Blanc en 1787, furent quelques étapes décisives de la glorification internationale des Alpes, dont la peinture, puis la photographie ont tiré tous les partis, du cliché industriel au chef-d'œuvre.
Pour justifier le titre de son livre en lequel les fâcheux seuls verront une touche nationaliste, Françoise Jaunin souligne « qu' aucun pays n'a associé aussi étroitement le spectacle de sa nature avec l'image de sa patrie ». Et d'enchaîner avec ce constat qui ne saurait évidemment borner la culture helvétique dans le champ clos des représentations alpestres, pas plus que la culture nord-américaine ne se limite au Far West: « Les temps ont eu beau changer, le monde se transformer, les perceptions de la montagne varier au gré des mutations de la société et des modifications du paysage, les symboles se déplacer ou changer de nature et de sens, rien n'y fait. Pas davantage que l'ébranlement des mythes, leur remise en question ou leur caricature. Célébrées ou parodiées, instrumentalisées par les discours utopistes, antimodernistes, patriotiques ou écologiques, revisitées par les regards, les traitements stylistiques et les technologies propres à chaque époque, les Alpes ont traversé toute l'histoire de l'art depuis le XVII e siècle avec une constance inébranlable. »
Mais regardez plutôt à la fenêtre: elles sont là, elles sont belles, elle s' en foutent — elles défient toute peinture …
Françoise Jaunin, Les Alpes suisses. 500 ans de peinture . Ed. Mondo, 107 pp.
En étrange pays
-
Rasez les Alpes, qu'on les brosse
-
L’âme sœur

Le chef-d’œuvre « japonais » de Fredi M. Murer. (Re)déclaré plus grand film de l'histoire du cinéma helvétique par l'Académie du film suisse. À revoir et revoir sans doute.L’Ame sœur de Fredi M. Murer, disponible sur DVD, a été dit « le meilleur film de l’histoire du cinéma suisse », ce qui est fort possible même si son confinement dans le « cinéma suisse » me semble, pour ma part, insuffisant. Je le placerais plus volontiers, quant à moi, au nombre des chefs-d’œuvre du 7e art de l’après-guerre, toutes catégories confondues, et je me disais l’autre soir, en le revoyant, que c’était une sorte de film japonais que cet ouvrage enté sur un thème – l’inceste - de la tragédie grecque, et traité avec une radicalité absolue, du point de vue de la forme, image et verbe fondus en pure unité.
Or rencontrant Fredi M. Murer la semaine dernière dans son antre zurichois de la mythique Spiegelgasse, pour évoquer Vitus, son nouveau film, et lui parlant de cet aspect « japonais » de Höhenfeuer (titre original de L’âme sœur), le réalisateur m’a répondu en riant que son film avait bel et bien été perçu comme tel au Japon même, où il a rencontré un succès considérable, avant d’évoquer sa parenté avec La légende de Narayama d’Imamura…
L’âme sœur est un grand film d’amour tragique, liant un adolescent muet et sa sœur aînée dans une famille de paysans de montagne vivant entre traditions archaïques et modernité perlée. Rien de pittoresque dans les Alpes de Murer, qui a interdit toute figuration style carte postale à son chef op’ Pio Corradi, et rien de régionaliste dans cette famille d’Helvètes alors même qu’ils s’expriment en dialecte uranais à couper au couteau. La fatalité illustrée – la pauvreté et l’endogamie – n’y a rien de dogmatique ou de littéraire non plus, mais s’incarne littéralement à la fois dans la nature sauvage et le naturel des protagonistes, dont le plus jeune reste proche des grands fonds et va retrouver à un moment donné les rituels d’une sorte de chamanisme des hautes terres.
A cela s’ajoute un trait omniprésent dans le cinéma de Murer, à part la patte d’un grand peintre sur pellicule : une immense tendresse qui enveloppe tous les personnages, sans exception, portée jusqu’au sublime dans les dernières scènes du film où le garçon devenu père incestueux, qui a retourné l’arme de son padre padrone furieux contre celui-ci, ensevelit ses parents (la mère a été foudroyée par la mort de son conjoint) dans la neige de cet outrepart utopique d’un rêve éveillé où il est le seul à ignorer que la vie ne sera jamais possible…
Fredi M. Murer. L’âme sœur. DVD Impuls. En Bonus, interview du réalisateur.
Extrait du Storyboard de Fredi M.Murer
-
La passion selon Soutter

Louis Soutter, maudit et génial.Il n’a pas besoin de faire de la beauté convulsive un programme esthétique: il la vit au milieu de ses forêts qui sont des temples et de ses enfants qui sont des anges et de ses catins qui sont des saintes sous le regard de Notre Seigneur crucifié. Frère en esprit de Rouault mais sans doctrine, frère aussi de Van Gogh et de Soutine, c’est un peintre sans peinture, un dessinateur usant de la plume du bureau de poste voisin, on pourrait dire que c’est au commencement l’artiste surdoué qui échappe à l'académisme virtuose par un génie que soulève le feu sacré. Bref: tout ce qui se dit de lui est insuffisant: Louis Soutter est La Poésie incarnée en sa chair blessée.

Sur Louis Soutter on ne devrait donner que des renseignements de police. Né en 1871 à Morges, au bord du lac Léman. Fils de pharmacien. Voisinage darbyste hyper-puritain. Parent de Le Corbusier par sa mère - Corbu qui le soutiendra généreusement, conscient de son génie. Rate ses études d’ingénieur. Se hasarde en architecture, en vain, puis étudie le violon auprès d’Eugène Ysaie, à Bruxelles. A 24 ans abandonne la musique et se lance dans la peinture. A Paris suit les cours du soir de l’Académie Colarossi. Virtuosité classique, sans plus. En 1897 épouse Madge Fursman après s’être installé aux Etats-Unis, où il enseigne la peinture à Colorado Springs. Divorce en 1903. Décline physiquement et psychiquement. En 1907, violoniste à l’orchestre du théâtre de Genève et à l’Orchestre symphonique de Lausanne. Passe pour excentrique et de plus en plus. Refuse la nourriture et claque son argent et celui de ses amis. Sous tutelle dès 1915. Admis en 1923 dans la maison de retraite de Ballaigues, sur les crêtes du Jura vaudois, d’où il s’échappe le plus souvent pour d’interminables errances. Le postier de Ballaigues lui interdit l’usage de l’encrier public, dont il use pour ses dessins. Milliers de dessins à l’encre, tenus pour rien par ses proches, sauf quelques-uns, artistes ou écrivains... Tous autres détails biographiques et critiques à recueillir dans les deux grands ouvrages de Michel Thévoz : Louis Soutter ou l’écriture du désir (L’Age d’Homme, 1974) et Louis Soutter, catalogue de l’œuvre (L’Age d’Homme, 1976).



Mais que dire à part ça ? Que Louis Soutter incarme, avec Robert Walser, l’impatience sacrée de l’artiste au pays des nains de jardin et des tea-rooms, des bureaux alignés ou des maisons de paroisse à conseils sourcilleux. Soutter danse au bord des gouffres et se fait tancer par le directeur de l’Institution pour abus d’usage de papier quadrillé. Soutter rejoint Baudelaire au bordel couplé à la grande église sur le parvis de laquelle mendie un Christ en loques, et c’est tout ça qu’il peint de ses doigts de vieil ange agité…


-
Rêver à la Suisse

Henri Calet au temps des privations. Invite à la (re)découverte...
On sait, ou on ne sait pas, en tout cas on le découvre en ouvrant le petit livre savoureux d’Henri Calet portant ce titre : que Rêver à la Suisse signifie, au sens figuré cité en exergue, ne penser à rien. Un Suisse pourrait s’en vexer : il aurait tort. Lorsqu’un publiciste provocateur a lancé le slogan La Suisse n’existe pas, il exploitait une assez médiocre démagogie en vogue, notamment, dans certains milieux de haute intelligentsia et de haute politique culturelle helvétique, sous-entendant en somme que nous sommes tellement tout qu’il nous manque juste d’être tenus pour rien. Ce rien n’a rien à voir avec le rien de Calet, qui ne dit certes pas tout de la Suisse mais donne envie d’y goûter, comme à un idéal carré de chocolat.
 La première édition de Rêver à la Suisse, préfacée par Jean Paulhan, date de 1948, et l’on sent encore un peu la guerre dans la Suisse protégée que décrit Calet par le tout menu. Ainsi relève-t-il l’inscription figurant dans telle vitrine d’une prestigieuse confiserie de la place de Montreux, selon laquelle la Maison ne pourra livrer sa production d’Amandino pour cause persistante de restrictions.
La première édition de Rêver à la Suisse, préfacée par Jean Paulhan, date de 1948, et l’on sent encore un peu la guerre dans la Suisse protégée que décrit Calet par le tout menu. Ainsi relève-t-il l’inscription figurant dans telle vitrine d’une prestigieuse confiserie de la place de Montreux, selon laquelle la Maison ne pourra livrer sa production d’Amandino pour cause persistante de restrictions.
Henri Calet se moquait-il de la Suisse en relevant ce détail qu’on pourrait trouver un summum de luxe futile, au cœur d’une Europe en ruines ? Et se moque-t-il de la Suisse en s’arrêtant à d’autres détails ténus tels que la forme et l’appareillage des urinoirs ou le fonctionnement de tel vertigineux funiculaire à crémaillère ? Je ne le crois pas du tout. On n’apprend certes à peu près rien de ce pays en lisant Rêver à la Suisse, mais on en sent en revanche le climat : on y est et tout est dit. Ne penser à rien en rêvant à la Suisse est au reste la meilleure disposition pour redécouvrir ce pays qui en contient plus que quiconque n'oserait en rêver sur le territoire d'un timbre-poste, et l'on verra que ce n'est pas rien...
Jean Paulhan. Rêver à la Suisse. Préface de Jean Paulhan. Réédition Pierre Horay, 1984.Images: les emblèmes de la Suisse chevillés à nos semelles: le lion de Lucerne et Guillaume Tell; le funiculaire de Territet
-
Hoï !

Supplément au Guide du Routard à propos d’Appenzell, du salut que s’adressent ses gens, de ses peintres et de ses verts toscans
Si les Tchèques de Prague se saluent d’un sonore ahoj !, comme on l’a vu dans L’As de pique de Milos Forman, en Appenzell c’est simplement hoï ! qu’on se lance en se croisant ; et lorsque vous êtes avec quelqu’un qui connaît tout le monde, ce qui est banal puisque tout le monde se connaît en Appenzell, la chose devient assez comique, voire burlesque.
J’étais hier soir avec Toni, natif des lieux et connaissant donc tout le monde, qui m’emmenait au pas de charge aux quatre coins de son bourg pour m’en raconter l’essentiel, et tous les trois pas : hoï, hoï, hoï, à se croire dans un film japonais…
Or de cela, le Guide du Routard ne pipe mot. Ni du fait qu’il y a des peintres en Appenzell. Ni rien à propos des joyeux compères du jass en Appenzell.
Je m’étais installé à l’Auberge du Pigeon (zur Taube), sur le conseil du Routard, excellente maison en effet tout en haut de la Hirschengasse (la rue du Cerf), lorsque j’avisai, à la vitrine de la boutique voisine, au bas d’une immense maison de bois vert pâle, une toile qui me disait quelque chose, et tout aussitôt la signature confirma mon sentiment : Carl Liner.

 Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.
Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.  L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.
L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.
De fait, c'est ce paysage de Carl Liner qui m’a fait entrer chez Toni, dans la maison vert pâle, où j’ai découvert ensuite une véritable caverne d’Ali-Baba à la manière helvétique.
Toni a lui aussi la folie de peindre. Or dès que j’eus mis le nez dans son antre, il m’a ouvert ses portefeuilles où, tout de suite, j’ai flairé la papatte. Toni est à la fois un naïf et un peintre d’instinct, qui touche parfois à la forme pure et à la beauté dans certaines peintures fulgurantes. Sans relever tout à fait de l’art brut, comme Adolf Wölffli qui fut encagé pendant des années dans ces régions proches, l’art de Toni ressemble à sa maison : c’est le capharnaüm helvète dans toute sa gloire, avec mille tableaux de lui et de cent autres, une collection de baromètres géants et d’accordéons, un extraordinaire buffet du XVIIe hérité de son grand-père qui vaut le quart de sa maison, laquelle compte vingt-cinq pièces dans lesquelles il a entassé des kyrielles de Vierges et de Jésus de bois, un tuba géant et un tire-pipes miniature, des épées et des fusils, enfin un monde d’images et d’objets que prolonge le monde de sa conversation d’homme libre et farouche, dont la culture est vécue et plus vivante que celle de tant de gardiens du nouveau temple.
La passion de peindre lui a sauvé la vie, m’explique Toni qui ne se sent lui-même qu’en travaillant sans se soucier de plaire ou de déplaire. S’il est content d’avoir vendu, la veille, le superbe Liner de sa vitrine à un client connaisseur, et s’il est lucide sur la situation de l’artiste dans la société pompe-à-fric de notre drôle d’époque, le lascar n’est pas aigri ni fatigué à aucun égard, qui affiche une espèce de foi candide en la capacité créatrice de l’homme.
Toni sait très bien distinguer la bonne peinture du kitsch pour touristes, qu’il ne juge pas pour autant. Or on le constate, dans cette région qui a un riche passé de peinture populaire et dont l’artisanat reflète aussi le goût raffiné: que la beauté semble reconnue des gens mieux qu’ailleurs, que ce soit par la nature ou par les œuvres. Aussi, ces gens qu’on dit les plus arriérés de la Suisse, en matière politique, me sont apparus bien plus ouverts et originaux que ne le prétendent les lieux communs repris par le Routard. Race de nains de jardins repliés sur eux-mêmes : allez donc y voir…

 Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir…
Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir… -
Le chevrier voyageur humaniste
 Un chroniqueur qui préfigure Rousseau, Cendrars et Bouvier: Thomas Platter.
Un chroniqueur qui préfigure Rousseau, Cendrars et Bouvier: Thomas Platter.
Les mémoires de Thomas Platter (1499-1582) racontent l’histoire d’un petit pâtre pauvre des hauts gazons valaisans, qui traversa toute l’Europe du XVIe siècle, fuyant la peste et les bandits pour grappiller un peu de savoir, et qui finit par s’établir à Bâle où il devint un humaniste érudit, imprimeur et professeur.
Racontée sur le tard (Platter dit le Vieux avait passé la septantaine), cette saga d’un présumé descendant de géants (son grand-père aurait procréé jusqu’à l’âge de cent ans…) n’en a pas moins une épatante fraîcheur de ton, mélange d’ingénuité et de cocasserie, tout en constituant un merveilleux « reportage » sur l’Europe de l’époque. L’historien Emmanuel LeRoy Ladurie a rendu hommage à Platter et à ses fils, grands personnages eux aussi de la Renaissance protestante, après les portraits incisifs qu’en a tracés Alfred Berchtold dans Bâle et l’Europe. Mais par-delà l’histoire, c’est également une source vive de la littérature suisse, entité parfois discutée, qu’on trouve dans Ma vie, pétrie de bon naturel et d’indépendance d’esprit, terrienne dans l’âme mais avide de savoirs et d’autres horizons, à l’opposé de la Suisse mortifère et satisfaite dont on dit complaisamment qu’elle « n’existe pas ». Platter est un conteur-voyageur savoureux comme le seront un Cendrars ou un Cingria, ou un Nicolas Bouvier qui en a fait le père fondateur de la Suisse nomade. La partie de ses mémoires évoquant ses épiques errances d’écolier maraudeur, ici poursuivi par un précepteur-maquereau exploitant ses gamins, là convoqué par une vieille Allemande refusant de « mourir tranquille » avant d’avoir vu un Suisse, est un pur régal. Plein de détails inoubliables (la découverte des premières tuiles ou des premières oies…) et d’échos de l’époque (Marignan), ce récit annonce les observations de la « nouvelle histoire » autant que le ton moderne des étonnants voyageurs.Thomas Platter. Ma vie. L'Age d'Home, collection Poche suisse, 1982.
-
Abécédaire passionnel

Dès ces prochains jours nous ouvrirons, avec mon ami l'imagier Philip Seelen, un nouveau blog dont les images et les mots, en multiples rubriques, s'attacheront à la défense et à l'illustration de la Suisse des cultures multilingues, petite Europe dans l'Europe. Nous en ouvrons ici l'abécédaire de repérage, auquel chaque lecteur est invité à proposer de nouveaux mots
 En étrange pays, de A à Z
En étrange pays, de A à ZAbsinthe / Aletsch / Aline / Altdorf / Aloyse / Amiel / Ansermet / Aurigeno / Bahnhostrasse / Bakounine / Ballenberg / Bergier / Besson (Benno) / Betty Bossi / Birchermüesli / Blocher/ Böcklin / Bögli / Botta / Bouvier / Budry / Carnaval / Cendrars / Cenovis / Ceresole / CERN/ Cervin / CFF / Chillon / Cingria / Chappaz / Chessex / Cuisses-Dames / Dada / Davos / Dimitri / Dindo / Doyen Bridel / Dürrenmatt / Duttweiler / Eigerwand / Erasme / Erni / Ernst S. / Federer / FipFop / Franches Montagnes / Frisch /Geiger (Hermann) / Gilliard / Général Guisan / Génie helvétique (Le) / Giacometti / Gianadda / Gilles / Godard / Goetheanum / Gothard & Gothard / Gotthelf / Grounding / Grütli / Guillaume Tell / Grock / Güllen / Haldas / Heidi / Hesse / Hingis / Hirschhorn (Thomas) / Hodler / Honegger / Hornuss / Humbert-Droz / Keller / Journaux / Joyce / Jung / Klee / Koblet / Küng (Hans) / Kudelski / Lavater / Lénine / Palais fédéral / Le Parfait / Pipilotti / Landsgemeinde / Longines / Lötschental / Pestalozzi / Maggi / Maison d’Ailleurs / Monte Verita / Morgenstraich / Morisod / Murer (Fredi) / Muzot / Nains de jardin / Nessi (Alberto) / Nabokov / Nestlé / Niederdorf / NPCK / NZZ / Odéon / Opel & Ospel / Orelli & Orelli / Parachutes dorés / Piazza Grande / Pilet-Golaz / Pont du Diable / Ramuz / Rilke / Ritz / Rivaz / Römerholz / Rote Fabrik / Saurer / Schmid (Daniel) / Segantini / Sils-Maria / Soglio / Soutter / Sugus / Stress / Suter (Martin) / Tinguely / Tissot / Töpffer / Tuor (Leo) / Walser / Winkelried / Wölffli / Ziegler / Zoccoli / Zorn / Zouc.

-
La Suisse à la retirette

Dans la collection Découvertes de Gallimard, François Walter propose d’aller «au-delà du paysage» de notre pays. Un aperçu critique intéressant mais qui reste incroyablement hors-sol, sans Federer, Freysinger, Alinghi, Blocher, Bouvier, le Montreux Jazz Festival, le nouveau cinéma suisse, etc.
À en croire François Walter, professeur d’histoire à l’Université de Genève, la Suisse, souvent réduite par les étrangers à quelques clichés simplistes, n’aurait pas son pareil pour entretenir elle-même les mythes et les images qui lui permettent de se «vendre» tout en consolidant sa prospérité. Le joli petit ouvrage très illustré qu’il vient de publier aux éditions Gallimard, dans la collection Découvertes, entend montrer une Suisse bien plus complexe, et intéressante, en démythifiant son histoire et en exposant ses contradictions persistantes.
- Est-ce vous qui avez eu l’idée de ce livre ?
- Pas exactement. Sans doute, la Suisse me passionne, dont j’enseigne l’histoire à l’Université de Genève et à laquelle j’ai déjà consacré cinq volumes. Or c’est sur la base de ce travail que la directrice de la collection Découvertes, Elisabeth de Farcy, m’a proposé de présenter notre pays qui reste un peu mystérieux et compliqué aux yeux des Français.
- La forme de la collection a-t-elle été une contrainte ?
- Certainement, car je suis habitué à rédiger de longs textes selon mon goût. Ici, il fallait faire court et écrire en fonction de modules rigides. Le travail sur les colonnes explicatives marginales, ou les légendes des images, a donné lieu à maintes négociations. Les éditeurs étaient très demandeurs de mythes suisses dont j’aurais préféré me garder. C’est ainsi que la couverture avec le Cervin, qui ressemble terriblement aux affiches de l’UDC, les images-clichés de l’ouverture exaltant la Suisse touristique, ou l’insistance sur le personnage de Guillaume Tell, répondent à une demande.
- Vous avez insisté, à propos de votre précédent ouvrage, sur l’importance des « acteurs » de l’Histoire, alors que vous évoquez à peine Pestalozzi ou Dunant, et ne dites pas un mot de Christoph Blocher. Est-ce un choix ?
- L’éditeur m’a fait ce reproche en effet, et c’est pourquoi j’ai réintroduit quelques figures, comme celle de Necker. Mais je crois que ma réserve correspond à une certaine « pudeur » très suisse. Et puis, je voulais éviter de parler de personnages actuels qu’on aura peut-être oubliés dans dix ans. Par ailleurs, l’UDC apparaît à plusieurs reprises.
- Est-ce la même « pudeur » qui vous fait ignorer, en matière culturelle, un Nicolas Bouvier, alors que vous enseignez à Genève ? Et Denis de Rougemont ? Et Georges Haldas ? Et l’architecte Bernard Tschumi ?
- J’avais cité Bouvier dans une version antérieure, mais le texte a dû être coupé. Je comprends ce que ces omissions peuvent avoir de frustrant pour quelqu’un qui s’intéresse à la culture, mais j’avoue n’être pas très à l’aise dans ce domaine. J’ai d’ailleurs rajouté la double page sur le Salon du Livre de Genève, et la mention des fondations Paul Klee et Gianadda à la demande de l’éditeur.
- Mais comment ignorer l’écrivain Martin Suter qui vend des millions d’exemplaires dans une vingtaine de langues, ou le jeune cinéaste Jean-Stéphane Bron qui a documenté la politique suisse dans Le Génie helvétique ?
- Je comprends aussi cette objection. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai ajouté des textes critiques comme ceux de Peter Bichsel, Hugo Loetscher, Fritz Zorn ou Jean Starobinski dans les documents relatifs au « modèle suisse ». Je reconnais cependant quelque chose d’ambivalent dans la Suisse que je présente. D’une part, je défends l’image très positive d’un pays qui s’est développé dans un environnement difficile, et j’insiste sur sa réussite économique en évitant de sombrer dans l’auto-flagellation, mais je tiens aussi à montrer le caractère très « construit » des mythes qui, non sans schizophrénie, confortent des positions qui vont tantôt vers l’ouverture mais aussi, souvent, vers le repli frileux…
François Walter. La Suisse. Au-delà du paysage. Gallimard, coll. Découvertes, 127p.
La Suisse d’un prof qui freine à la montée…
Vingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…
La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».
Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.
S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !
 Le déni de la Suisse créative
Le déni de la Suisse créativeVingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…
La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».
Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.
S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !
Par défaut...
Début d'inventaire des créateurs suisses et autres produits du génie helvétique qui n'existent pas aux yeux de l'historien en sa tour d'ivoire: Benjamin Constant, Zep, Georges Haldas, Carl Gustav Jung, Robert Walser, Amiel, Albert Einstein, Louis Soutter, Grock, Zouc, le Cénovis, Bernard Tschumi, Daniel Schmid, Gottfried Duttweiler l'inventeur de la Migros, Nicolas Hayek l'inventeur de la Swatch, la Cinémathèque suisse, Michel Soutter, L'Ame soeur de Fredi M.Murer, les cubes Knorr, Roger Federer, Grounding de Michael Steiner, le Musée de l'art brut, la lutte à la culotte et le hornuss, les Festivals de Locarno, Paléo, Lucerne, Montreux, les recettes de Betty Bossi, etc, etc, etc.
Images: Guillaume Tell vu par Ferdinand Hodler et le Cervin vu par Oscar Kokoschka.
-
La face cachée du propre-en-ordre

Rencontre avec Martin Suter
Il n’a fallu que trois romans à Martin Suter pour conquérir un très vaste public et l’estime de la critique internationale. Or, plus qu’un phénomène de mode, cet engouement nous semble découler de cette évidence: que les livres de Martin Suter sont intéressants. Comme John Le Carré dans son dernier roman incriminant les menées de l’industrie pharmaceutique en Afrique, ou à l’instar d’une Patricia Highsmith scrutant les désarrois de l’individu dans la société contemporaine, Martin Suter raconte, avec maestria, des histoires concernant chacun. Intéressants, ses livres le sont aussi pour l’image incisive qu’ils donnent de la réalité contemporaine, et plus précisément d’une Suisse dont les flatteuses apparences cachent les mêmes turpitudes que partout. Enfin le caractère très prenant de ces trois romans tient aussi à l’intérêt manifesté, par l’écrivain, pour les situations-limites vécues par ses personnages, que ce soit (avec Small World) dans le labyrinthe psychique de la maladie d’Alzheimer ou, avec Un Ami parfait, au bord des failles vertigineuses de la mémoire perdue par accident.
Ecrivain tardif, puisqu’il n’a publié son premier roman qu’à la veille de la cinquantaine, Martin Suter a tracé sa voie à l’écart des balises académiques. De grands voyages, une activité alimentaire de rédacteur publicitaire haut de gamme, l’apprentissage de la narration via la scénario (il a signé ceux de plusieurs films de son ami Daniel Schmid), des reportages pour le magazine Geo, des chroniques caustiques sur l’univers de l’économie et de la finance marquent son ancrage dans le monde. Nomade organisé, le Zurichois transite régulièrement entre Ibiza, le Guatemala et notre pays, qu’il voit avec la juste distance de l’observateur en mouvement. Deux grandes admirations, pour les écrivains Dürrenmatt et Glauser, le moraliste visionnaire et l’anar du polar, orientent sa propre position décentrée. De son travail de romancier, Martin Suter parle avec la modestie de l’artisan scrupuleux.
«Mon premier souci est de raconter une histoire qui captive le lecteur. Pour cela, je dois savoir où je vais. Après deux premiers essais de romans loupés, j’ai appris à construire mon ouvrage, dont je dois connaître précisément les grandes lignes et la fin avant de m’y atteler, quitte à prendre des libertés en cours de route. A l’origine de L’Ami parfait, il y a le thème déclencheur de la mémoire perdue. Au thème de la mémoire est lié celui de l’identité, qui ne peut se constituer que sur la base des sréseaux de souvenirs. Où cela se corse, c’est que mon personnage ne se rappelle plus qu’il a commencé de mal tourner pendant cette période justement que sa mémoire a gommée. Essayez de vous rappeler un lendemain de terrible cuite, quand vous reprenez vos esprits et que vous découvrez que vous avez fait ceci ou cela de pas très reluisant... comme s’il s’agissait d’un autre vous-même. Dans le cas de mon protagniste, c’est cinquante jours de sa vie qui refont surface, et c’est Mister Hyde qui apparaît au docteur Jekyll...»
Dans le soin qu’il apporte à la construction de ses romans, Martin Suter inclut une investigation précise,qu’on pourrait dire balzacienne, sur les milieux qu’il explore (la haute finance dans La face cachée de la lune, le journalisme dans Un Ami parfait) ou les aspects techniques et scientifiques des thèmes qu’il traite.
«Il est évident que, pour être crédible, le romancier doit se fonder sur des données exactes. En matière de neurologie, j’avais déjà lu pas mal de littérature, dont les ouvrages du fameux Oliver Sacks, mais j’ai également consulté des neurologues en activité. C’est par eux que, par exemple, j’ai découvert le détail intéressant de la mémoire émergeant par «îlots». Pour l’affaire des aliments contaminés, ce que je raconte est également plausible, même si j’affabule en l’occurrence».
Si Martin Suter n’a rien d’un l’écrivain «engagé» au sens traditionnel de l’auteur «à message» signant des manifestes, ses livres n’en ont pas moins une réelle dimension critique visant les «magouilles» d’une société apparemment au-dessus de tout soupçon.
«Je crois qu’un roman qui achoppe au monde réel a forcément une dimension politique. Même si ce n’est pas explicite, le thème de la quête de mémoire recoupe celui du passé de la Suisse. Je suis quelqu’un que révoltent l’injustice et tout abus de pouvoir, quel qu’il soit. Du point de vue moral, et même si le dénouement de mon roman n’a rien de très moral, je m’intéresse à ces zones-limites le long desquelles n’importe lequel d’entre nous peut basculer à tout moment, d’un côté ou de l’autre...»
Un étranger dans le miroir
Un sentiment d’étrangeté, débouchant sur des vertiges à la fois physiques et psychiques, ne cesse de troubler le lecteur engagé dans le parcours labyrinthique d’Un Ami parfait, sur les pas du beau et brillant Fabio qu’attendent de terribles révélations sur lui-même. Rescapé d’une probable agression qui lui a valu un traumatisme crânien, le jeune journaliste revient à la vie normale avec un énorme trou de mémoire portant sur deux mois durant lesquels, il s’en rend bientôt compte, des choses décisives lui sont arrivées. Sa mémoire intacte lui rappelle l’amour qu’il vouait à Dorina, mais celle-ci ne veut plus entendre parler de lui, alors que Marlene lui apprend qu’ils vivent ensemble malgré le rejet qu’elle lui inspire maintenant. Enquêtant plus avant, Fabio découvre qu’il a démissionné de son journal, où il a été remplacé, et que son meilleur ami, Lucas, vit maintenant avec Norina. Or, l’impression que Lucas l’a trahi se confirme lorsqu’il se rend compte que son compère et collègue a repris une enquête sur un «gros coup» dont il ne se rappelle rien mais qu’il devait mener au moment de son accident. Pourtant c’est une surprise bien plus amère qui l’attend en fin de course, et une leçon, à la fois tragique et salutaire, qui rendra du moins un sens nouveau à sa vie.
Sous l’aspect d’un thriller psychologique admirablement mené, Un Ami parfait entremêle les thèmes du double négatif et de la fidélité bafouée, de la corruption sociale et de la rédemption par l’amitié et l’amour Des personnages bien dessinés et la remise en question sous-jaçente d’une société frivole et cynique lestent ce roman d’une gravité jamais trop pesante.
Martin Suter. Un Ami parfait. Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni. Christian Bourgois, 372p. -
Le Routard est sympa…
Sa présentation de la Suisse est à recommander, avec les bémols d'usage...
C’est entendu : d’aucuns, après Houellebecq, trouvent le Routard un peu barjo et par trop bobo, avec tous les défauts de notre génération de babas cools, et pourtant j’en défendrai pour ma part les qualités, allez, parce que comme notre génération il est curieux, il est généreux, et à le pratiquer comme je l’ai fait pendant un mois en Suisse que, tout de même, je crois un peu connaître déjà, je lui tire mon chapeau, au Routard, je lui tire ma révérence dans les grandes largeurs, pour la très large palette et la précision, la richesse, la justesse, l’originalité souvent de ses informations.
J’écris cette note dans un hôtel tout de bois vêtu de la petite ville d’Appenzell, sur le conseil précis du Routard. Ce midi, je suis allé déguster des röstis aux fraises àl'auberge zur Sonne, à Winterthour, sur les mêmes indications du Routard, et j’ai découvert ensuite, à Saint-Gall, divers lieux que j’ignorais, bien repérés et bien décrits par le même Routard. C’est le Routard qui ma mis sur la piste du backpacker de Sent en Basse-Engadine, véritable découverte que je lui dois, et j’ai noté maintes curiosités naturelles ou culturelles qu’il signale, comme la cave à jazz jouxtant le Violon de Bâle, superbe vieil hôtel aménagé dans un ancien couvent d’abord reconverti en prison...
Pour Appenzell, je mettrai tout de même un bémol à la description du Routard, qui en fait une espèce de village-exposition à nains de jardins et kitsch pour touristes, parangon de LA Suisse profonde, plus cliché tu meurs. Or ce n’est pas que ça. Car le cliché ne va pas sans clins d’yeux, dans un pays qui a plus d’humour que beaucoup ne le croient. L’incroyable paysage de hauts plateaux montueux, d’un vert irlandais mais à vrai dire incomparable, est à la fois le summum de la carte postale et un lieu où vivent des gens qui, contrairement à ce que dit le Routard, ne font pas que poser pour les visiteurs de passage. Les incroyables maisons peintes ne sont pas que du folklore ripoliné pour la galerie mais la survivance d'une culture paysanne que documente l'incroyable musée. Bien entendu, le mauvais goût est ici pareil à celui qui ravage les sites de Provence ou de Toscane, mais le pays n’en vit pas moins, avec le désarroi de ses paysans et le spleen de ses ados à jeans pendouillant comme partout, quitte à se ressembler pour la photo... -
Contre le style TipTop

Ce qui menace l’Europe
On croit que la vieille Europe est menacée par le plombier polonais ou par le Turc à relents mahométans, mais on a tort : on ne voit pas le vrai danger découlant d’une progressive acclimatation mondiale de la propension suisse au TipTop propre-en-ordre qui indique que l’Opel/Honda/Toyota/Peugeot est lavée et polie à la peau de chamois, que la vaisselle et la lessive et les vitres et toutes les surfaces visibles d’alentour sont propres et nettes, enfin que tout est nickel et sous contrôle.
Il y a là quelque chose de terrible qu’on aurait tort de prendre pour une seule tare suisse, dont on se débarrassera en confinant ce pays hors de l’Europe. Non : la situation est plus grave. Preuve en est que je l’ai observée d’abord en Allemagne, à Rothenburg ob der Taube, sur la route dite romantique. J’entrai alors dans un hôtel et qu’y vis-je : l’abomination propre-en-ordre, sans qu’on pût imaginer une collusion entre la Suisse et la Souabe active. Le TipTop au stade terminal.
Mais qui alors a contaminé l’Allemagne ? Hélas la conjoncture devient alarmante, puisque l’Europe entière, de Malmö à Agrigente et de Zagreb à Albufeira, se trouve enivrée par le désir d’encaustique et de karaoké… A savoir, après le TipTop: sa conclusion festive.
Je prends ces notes pessimistes au bord d’une admirable rivière suisse, la Kander, qui n’est en rien contaminée par ce nouveau conformisme européen de l’ordre et de la propreté. Je suis descendu tout à l’heure dans un Lodge de Kandersteg, ancien palace réaménagé selon la simple éthique et la frugale esthétique de l’homme des bois, dérogeant évidemment aux normes débilitantes du tourisme conventionnel et donc européen, mais réalisant le summum du confort : un seul employé jamais là y règle l’organisation de 33 chambres donnant toutes sur la nature et le ciel, et la piscine intérieure est accessible à toute heure. Le prix est dérisoire. La qualité du savon incomparable. On croit que la civilisation se perd. On se goure. Je fournis les renseignements sur l'établissement aux gens qui en sont dignes... -
Backpackers on the Roof

L’étape de Sent, chez Jonas
Les routards ont fait des petits avec les Backpackers, qui n’ont rien pour autant d’une nouvelle secte baba-cool, mais se recrutent autant parmi les jeunes en veine de balades point trop ruineuses que chez les familles à moyens moyens. L’appellation recouvre, en Suisse, quelque vingt-cinq adresses qui vont de la Baracca d’Aurigeno, lieu cher à Patricia Highsmith, au bord de la Maggia, au Riviera Lodge de Vevey, en passant par le Mountain Hostel de Grindelwald et l’Old Lodge de Wengen. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le réseau n’est pas réservé aux descendants américains des hippies, et la meilleure preuve en est la clientèle majoritairement helvéto-européenne du Swissroof de Sent, en Basse-Engadine, tenue par deux compères dont le très souriant Obwaldien Jonas.
L’étape vaut le détour et plus encore : le séjour. Mais passer rien qu’un jour et une nuit chez Jonas, dans une chambre donnant sur toutes la haute vallée de l’Inn, au cœur d’un village immédiatement attachant, aux belles maisons couvertes de sgraffite et aux charmants palazzi, aux ruelles pavées de têtes-de-chat et aux gens immédiatement accueillants, m’a paru une telle grâce que je me suis promis d’y revenir sous peu par temps plus clément. Il y a certes d’autres pensions et auberges à Sent, mais le Backpacker Swissroof allie les charmes d’une vieille maison grisonne, avec ses chambres de vieux bois et ses balcons à vue lointaine (du château de Tarasp aux hauteurs de Guarda, autre merveille plus léchée et touristique) à une ambiance familière, où chacun peut faire sa cuisine si ça lui chante. Pour une chambre et le petit-dèje copieux de Jonas, il m’en a coûté 65 francs suisses (40euros), avec sanitaires sur l’étage et literie minimale, le vrai luxe à mon goût. On peut trouver plus confortable dans la même maison, ou préférer les dortoirs carrément bon marché, avec la nuitée dès 25 francs. De là, été comme hiver, des quantités de balades et d’exercices plus ou moins sportifs (dont la descente en trottinette des hauts du domaine skiable…) sont possibles, et cette randonnée où je me suis déjà promis d’égarer un Sollers qu’on va revêtir de Knickebockers seyants et munir d’un Alpenstock. Sollers au Val Sinestra, ça c’est le scoop ou je ne suis qu’un rot de lagopède…
Renseignements indispensables : www.backpacker.ch et surtout : http : // www.swissroof.ch -
La Russie passe par la Suisse

SALON DU LIVRE La grande nation restaurée présente sa production à Palexpo-Geneva, du 2 au 6 mai, reflétant une réalité en mutation, et quelques-uns de ses auteurs. Dont Mikhaïl Chichkine, auteur de La Suisse russe, passionnante chronique à la mémoire de nos chers hôtes villégiateurs, révolutionnaires ou exilés…
Deux tombes majestueuses voisinent au cimetière de Clarens, où reposent Vera et Vladimir Nabokov, l’un des écrivains les plus géniaux du XXe siècle, et, d’autre part, le grand peintre Oskar Kokoschka. A un coup d’aile de pigeon de là : le château de Chillon fut le lieu de pèlerinage de moult Russes cultivés, où Gogol grava son nom. Dans un parc de Montreux, la statue pensive de Stravinsky rappelle sa collaboration avec Ramuz pour L’Histoire du soldat, dont il écrivit la musique à Lausanne. Or c’est à Lausanne, aussi, où séjournèrent le compositeur Scriabine, le philosophe Léon Chestov et le chorégraphe Diaghilev, entre autres, que parurent deux livres majeurs de l’époque soviétique : Vie et destin de Vassili Grossman, chef-d’œuvre échappé aux pattes du KGB et publié à L’Age d’Homme, comme Les Hauteurs béantes d’Alexandre Zinoviev, retourné en Russie où il est mort l’an dernier.
 « Les rives des lacs alpins fourmillent d’ombre russes », écrit Mikhaïl Chichkine dans l’introduction de La Suisse russe, formidable ouvrage qui vient de paraître en traduction, évoquant, avec autant de chaleur érudite que de piquant, plus d’un siècle de relations vives (de pâmoisons devant la nature en bâillements d’ennui) entre les Russes et notre pays.
« Les rives des lacs alpins fourmillent d’ombre russes », écrit Mikhaïl Chichkine dans l’introduction de La Suisse russe, formidable ouvrage qui vient de paraître en traduction, évoquant, avec autant de chaleur érudite que de piquant, plus d’un siècle de relations vives (de pâmoisons devant la nature en bâillements d’ennui) entre les Russes et notre pays.
Des voyageurs romantiques de la fin du XIXe siècle à l’exil médiatisé de Soljenitsyne, en passant par le transit des révolutionnaires (le terroriste Netchaïev, le prince anarchiste Bakounine et Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine), la Suisse a vu passer – même s’ils restaient souvent en cercles fermés – les plus illustres auteurs russes, de Dostoïevski, claquant l’argent de son pauvre ménage au casino de Saxon-les-Bains, au jeune Tolstoï ou au théosophe Andrèi Biély, entre cent autres qui ne virent pas tous, comme un Nabokov, la copie du profil de Pouchkine dans le nez du Matterhorn…
Mikhaïl Chichkine, qui se définit comme « un écrivain russe résidant à l’étranger », établi à Zurich depuis 1995 mais également reconnu dans son pays (lauréat du Booker russe, notamment), fait partie de la délégation d’une quinzaine d’auteurs présents au Salon du livre, aux côtés de quelques écrivains déjà connus des lecteurs francophones, tels Andréi Guélassimov, auteur de La soif et de L’année du mensonge, publiés chez Actes-Sud, Olga Slavnitkova, présente chez Gallimard avec L’homme immortel, ou encore Valéri Popov dont l’attachant Troisième souffle a paru chez Fayard en 2005.
Si les récits de voyageurs russes en Suisse réduisent souvent notre pays à des clichés éculés, l’inverse est avéré, ainsi que le remarquait récemment, dans un entretien avec RIA Novosti, la romancière Olga Stolnikova, déplorant que « toute information véridique sur la Russie ne puisse être que négative». Cela étant, nous pourrions objecter que la vérité de la littérature ne consiste pas forcément à « positiver » et que les meilleures preuves en sont données par deux ouvrages récents, toniques en dépit des dures réalités qu’ils reflètent : les extraordinaires Carnets de guerre de Vassili Grossman, et, passionnante satire de science-fiction politico-historique dont les outrances « pornographiques » lui ont valu un procès et l’opprobre des jeunesses poutinienne : Le Lard bleu de Vladimir Sorokine, enfant terrible de la nouvelle littérature russe dont la réflexion grinçante qu’il propose sur l’utilisation des écrivains par le Pouvoir est aussi à l’honneur de la littérature russe…
Mikhaïl Chichkine. La Suisse russe. Traduit du russe par Marilyne Fellous. Fayard, 516p.
Vassili Grossman. Carnets de guerre ; de Moscou à Berlin, 1941-1945. Calmann-Lévy, 390p.
Vladimir Sorokine. Le lard bleu. Traduit du russe par Bernard Kreise. L’Olivier, 417p.
Cet article a parudans l’édition de 24 Heures du 1er mai 2007 -
Politique-friction



Le Génie helvétique de Jean-Stéphane Bron
Démocratie mode d'emploi: tel pourrait être le sous-titre de Maïs im Bundeshuus (qu'on pourrait traduire par « Du foin au Palais fédéral »), intitulé Le génie helvétique en notre langue et qui nous fait pénétrer dans les coulisses du saint des saints de la politique helvétique à l'occasion de la préparation, par une commission parlementaire, d'une loi sur le génie génétique, dite Gen-Lex.
D'un projet qui pourrait sembler austère, voire rébarbatif, le jeune réalisateur lausannois Jean-Stéphane Bron, assisté d'Adrian Blaser, a tiré un film extrêmement vivant et intéressant, confirmant très largement les promesses de deux premières réalisations remarquées, Connu de nos services et La bonne conduite, déjà vus par plus d'un million de (télé) spectateurs du monde entier.
— Quel parcours, Jean-Stéphane Bron, vous a-t-il mené à la réalisation ?
— Dès la fin de mon adolescence, j'ai été un rat de cinémathèque, et mon bac en poche, ayant appris qu'il y avait en Italie une école accessible sans examen dirigée par Ermano Olmi, auteur de L'arbre aux sabots — un film qui m'a beaucoup marqué —, je me suis pointé à Bassano, où j'ai suivi une série de stages très formateurs du point de vue de la « lecture » des films. L'approche était plutôt esthétique et philosophique, car nous ne touchions pas de caméra. Ensuite, j'ai passé à la pratique à l'ECAL, sous la direction d'Yves Yersin qui avait pour principe, comme dans une école de métiers, de nous initier à tous les aspects techniques de la réalisation. C'est ainsi que je faisais l'électricien sur le plateau du Petit prince a dit, de Christine Pascal, lorsque j'ai rencontré Claude Muret. C'est après que ce grand militant lausannois a reçu le paquet de ses fiches, que j'ai décidé de consacrer un film vidéo à ce sujet, en 1997.
— Ce qui frappe, dans Connu de vos services, comme dans Le génie helvétique, c'est votre approche équitable et bienveillante des gens, qu'ils soient militants ou policiers, politiciens de gauche ou de droite ...
— Le souci d'aller vers les gens, de partir du naturel et de le tirer vers une certaine dramaturgie fait partie de mes principes de base. Je crois que je fais partie d'une génération aussi consciente des problèmes sociaux ou politiques que la précédente, mais qui réagit différemment. Nous sommes réconciliés avec le pays, ce qui ne signifie pas alignés-couverts ! La réflexion qui m'est venue en travaillant à Connu de nos services, c'est: tout de même, cette incroyable masse de fiches pour un militant qui n'a pas reçu une baffe dans un commissariat... Je n'ai pas l'impression d'avoir de message à délivrer, alors que j'ai en revanche des choses à montrer.
— Comment l'idée de Génie helvétique vous est-elle venue ?
— D'un premier constat: qu'aucun film n'avait jamais été fait dans le Palais fédéral, et d'une curiosité: comment ça marche ? J'avais envie de tirer parti de l'incroyable accessibilité des « miliciens » de la politique suisse et de répondre à cette autre question: qu'est-ce que le consensus produit de singulier ? Après une première approche des lieux, je me suis dit que c'était beaucoup trop compliqué. Puis, je me suis demandé comment il serait possible de réduire la distance. C'est pourquoi j'ai choisi cinq personnages représentatifs de toutes les tendances, que j'ai « élus » au feeling. Il fallait que tous aient la même chance à la base. Je savais qu'il y aurait un préjugé idéologique immédiat à l'encontre de tel UDC ou de tel représentant de l'industrie, et je ne voulais pas de ce genre de simplification. D'ailleurs, le débat, complexe à souhait, sur le génie génétique, défiait toute simplification.
— Comment avez-vous travaillé ?
— En petite équipe de trois, pour la première partie qui relève de l' « exposition » des faits, des enjeux, des débats, des alliances et revirements. Puis, pour la partie plus « théâtrale » du plénum, avec six caméras en mouvement dans l'assemblée. Mon atout majeur, par rapport à une équipe de télévision, c'est que je pouvais travailler avec le temps, et c'est d'ailleurs un autre de mes principes. Une complicité s'est donc tissée avec mes « acteurs » que j'ai fini par tous tutoyer, sauf Jacques Neirynck, d'octobre 2001 à juillet 2002. Le défi représenté par la situation elle-même, avec l'interdiction qui m'était faite d'entrer dans la salle des débats, tenait à réaliser un film entier sur le principe du hors-champ, à part les séquences finales. Encore heureux que, dans ce Palais fédéral baigné par une pénombre assez sinistre, le couloir de nos rencontres ait été éclairé par des verrières zénithales.
— Vos « acteurs » ont-ils vu le film achevé, et comment ont-ils réagi ?
— Ils l'ont visionné ensemble et, à part les réactions classiques du genre « untel joue mieux que moi ... », entre autres coquetteries, ils ont tous admis que c'est en effet « comme ça que ça se passe »...
Au théâtre du réel
On pourrait voir Le génie helvétique comme une pièce de théâtre en deux actes, dont le premier s'intitulerait « Confidences derrière la porte » et le second « Pour la galerie ». Cependant, même si les cinq parlementaires assumant ici les premiers rôles représentent de véritables personnages, avec leurs traits bien marqués, leur discours typé, leurs tics particuliers et leur charme commun, c'est dans la matière et le mouvement imprévisible de la vie que les saisit Jean-Stéphane Bron, sans oublier un instant le propos de son film, lié aux enjeux de la procédure politique, laquelle nous renvoie à la case « réel ».

La description de la « comédie » politique marque une véritable progression dramatique, correspondant à l'enchaînement des exposés, débats, manœuvres et votes successifs. Les diverses positions, de la gauche à la droite, sont immédiatement incarnées, de Maya la jeune paysanne écolo à Randegger le radical zurichois « roulant » pour l'industrie, en passant par Sepp l'UDC agriculteur, très partagé entre les principes de son parti et sa sensibilité terrienne, ou le professeur Neirynck, humaniste PDC plutôt favorable à la recherche scientifique, mais non sans nuances.

Entre sourires roués et «vannes » lancées au passage, regards qui en disent long et conciliabules en catimini, nous voyons se faire et se défaire les alliances, avec un crescendo montant jusqu'au vote à couteaux tirés, préludant au débat final en assemblée plénière où, à grands effets de manches, les uns et les autres montent au créneau, tel le radical Claude Frey réduisant à rien le travail de la commission: « C'est n'importe quoi !»
Omniprésents, l'œil et l'oreille ultrasensibles du témoin extérieur enregistrent tout de ce jeu démocratique plein d'aléas, à la fois cordial et tendu, avec ses composantes humaines (les protagonistes sont également approchés dans leur jardin privé) et ses règles plus froides, ses ruses, sa bonne et sa mauvaise foi bien partagées. Plus que du reportage, c'est ici du cinéma-confidence et du cinéma-vérité, réordonné par un montage aussi vivant que signifiant.
Cinéma et politique en Suisse
« Travailler à la manière ascétique de Richard Dindo me semble intenable aujourd'hui », remarque Jean-Stéphane Bron, tout en rendant hommage au maître dont il a vu tous les films, à commencer par L'Exécution du traître à la patrie Ernst S. , remontant à 1977 et faisant date dans l'histoire du cinéma helvétique, autant que les Reportages en Suisse de Niklaus Meienberg.
"Plus que la position critique de Dindo ou de Meienberg, c'est plutôt la manière, très idéologisée dans les années 60-70, dans la mouvance marxiste, qui paraît aujourd'hui dépassée, comme aussi le rapport avec le public.
« Notre génération a intégré la télévision, remarque encore Bron, et nous devons aller plus vers le public. »
Cela étant, la position du réalisateur du Génie helvétique ne marque pas pour autant une rupture par rapport au cinéma en phase avec la réalité sociale ou politique du pays. Il n'est que de rappeler les films réalisés par Henry Brandt à l'enseigne de l'Exposition nationale, en 1964, ou, à la même époque, le reportage social consacré par Alain Tanner aux Apprentis, pour relier son travail à celui de ses prédécesseurs.
Autre exemple plus récent et plus proche à citer: celui du réalisateur lausannois quinquagénaire Frédéric Gonseth, issu lui aussi des milieux d'extrême-gauche, et dont le travail pourrait illustrer l'évolution d'un cinéma qu'on pourrait dire de « dénonciation », à une façon moins dogmatique de témoigner, plus en phase avec la complexité humaine. La plus belle preuve en est, après son très poignant reportage sur les séquelles du stalinisme en Ukraine et le sort tragique des prisonniers de guerre soviétiques, le documentaire intitulé Mission en enfer où l'on découvre une page occultée de notre histoire, impliquant la Croix-Rouge et nos plus hautes autorités politiques, qui laissèrent des centaines de médecins et d'infirmières tomber dans le piège de l'armée allemande.
Reste à recentrer le débat sur la question de fond: savoir si l'affranchissement des carcans idéologiques va de pair avec une ressaisie réellement créatrice et novatrice de la réalité humaine, par-delà tout ancrage suisse — avec la fiction en point de mireLe nouveau film de Jean-Stéphane Bron, Mon frère se marie, marquant son passage à la fiction, avec Jean-Luc Bideau (grand retour d'un acteur ici magnifique) et Aurore Clément (formidable elle aussi dans cette histoire de famille à la fois comique et très émouvante), sera projeté sur la Piazza Grande de Locarno le 8 août 2006.
-
Du crime propre en ordre
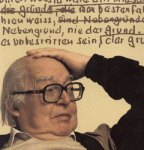
A propos de La panne de Dürrenmatt
J’ai souvent éprouvé la sensation d’étouffer dans ces quartiers qu’on pourrait dire typiques de la classe moyenne occidentale, aux maisons familiales sagement alignées et aux jardins soigneusement entretenus, où il me semblait que rien ne pourrait jamais arriver tout en me réjouissant à chaque fois que se révélait un nouveau drame derrière les haies de thuyas, et c’est exactement ce mélange d’oppressante quiétude et de jubilation mauvaise que distille La panne de Friedrich Dürrenmatt, où je retrouve aussi la quintessence du sentiment ambigu de parfaite innocence et de culpabilité latente marquant chaque citoyen de notre incomparable pays.
Alfredo Traps, que la panne de sa Studebaker immobilise un soir dans un bled du plateau suisse, est un exemplaire assez représentatif du Suisse moyen marié et père de famille, qui n’a rien à se reprocher en dépit de quelques accrocs. Ainsi montre-t-il de l’embarras lorsque, ce soir-là, convié à participer au jeu de rôles qu’organise le retraité qui lui a offert l’hospitalité - un ancien juge trompant son ennui, avec ses compères jadis procureur et avocat, en rejouant quotidiennement un procès -, il est prié de faire l’accusé et de présenter son crime à l’aimable compagnie.
Quelques aveux de rien du tout, à propos d’une liaison sans lendemain avec la femme de son patron, dont la mort par crise cardiaque l’a bien arrangé dans son ascension sociale, suffiront cependant à donner au procureur la matière d’un réquisitoire carabiné où l’innocent présumé se découvrira les mobiles inavoués et surtout les talents d’un assassin retors, auteur du crime parfait puisque provoquant la mort de son patron sans y toucher, tiptop les mains propres en Suisse irréprochable.
Il est peu d’écrivains de ce pays qui aient saisi, avec tant de pénétration et tant d’humour grinçant, la tournure et la tonalité de la mentalité suisse, mélange de bonne et de mauvaise foi, de respect des conventions et d’opportunisme occasionnel, d’honnêteté et de rouerie, de puritanisme et de sensualité terrienne. Surtout il rend le climat d’une certaine Suisse moyenne avec une merveilleuse aptitude à jouer des clichés sans tomber pour autant dans le confort intellectuel. La Panne est à la fois le procès de notre bonne conscience et celui de l’arbitraire judiciaire, mais c’est aussi une plongée au coeur de la tragédie humaine. Dürrenmatt lui-même prétend que le tragique n’a plus cours dans notre monde sans Dieu, sans Justice immanente et sans Fatum, mais il n’en montre pas moins ici que l’animal humain, même sous le costume chic d’un agent général représentant un supertextile Swiss Made, reste toujours et encore une possible créature tragique. -
Sauvageons de Suisse profonde
Le Meilleur film suisse 2006

Soleure, ce jeudi 19 janvier. – C’est une belle petite ville que Soleure où il fait bon, dans les vieux bistrots de bois ciré fleurant l’Europe cultivée autant que la bohème artiste et le populo à cigares, discuter des derniers films de la cinématographie helvétique qu’on y projette à journée faite une semaine durant.
La Suisse est ce pays d’extrême-Europe, au fonds populaire, et même sauvage, à peu près méconnu par les temps qui courent, réduite qu’elle se trouve aux clichés du banquier à face blême, ou pire: du fonctionnaire vétilleux, ou pire encore : de l’intellectuel responsable convaincu que l’art et le commerce sont incompatibles. Ce fut le débat tournant à vide lancé par les médias à ces 41es Journées de Soleure, constituant les Etats généraux annuels du cinéma suisse, mais il a suffi de quatre chenapans fuguant à travers les monts de Heidi et les vaux de Guillaume Tell, dans la foulée de Bakounine et de Max und Moritz, sur un ton picaresque oscillant entre Mark Twain et Harry Potter, pour déplacer la discussion sur le terrain d’un cinéma renouant, contre toute attente, avec l’esprit du conte.
My Name ist Eugen, du jeune réalisateur Michael Steiner, entièrement parlé en dialecte alémanique, est devenu un film « culte » en quelques mois, drainant plus d’un demi million de spectateurs suisses allemands, et voici que les pros l'ont élu Meilleur film de fiction de l'année. Ce n’est sûrement pas un chef-d’œuvre du 7e art mais c’est une merveille de fraîcheur, d’humour et de fantaisie, mêlant tous les joyeux poncifs du kitsch helvétique dans un tourbillon d’images et de musiques complètement déjanté, dont l'arrière-goût de nostalgie m’a rappelé Radio Days de Woody Allen, mais avec une frénésie juvénile étourdissante.
Je me fiche bien, pour ma part, de ce qu’on a appelé l’helvétisme, à propos d’une idéologie qui a fait date, mais j’ai toujours pensé que les clichés contenaient une part de vérité et pouvaient être revivifiés, et c’est toute une Suisse profonde de nos enfances que j’ai retrouvée dans ce film à la fois lyrique et gouailleur, tendre et anarchisant - nos enfances de plusieurs siècles, jusqu’à ces bandes d’escholiers pieds nus qui sillonnaient l’Europe de la Renaissance en quête de maîtres de latin ou d’hébreu, qui filent aujourd’hui en skateboard et s’envoient par SMS les mêmes serments de fidélité à la vie à la mort…
-
Ecrivains en vitrine

Le Centre Culturel Suisse à Paris n’existe pas
«La Suisse n’existe pas » était l’un des slogans de la politique culturelle branchée à l’époque de l’Exposition de Séville, et Madame et Monsieur Barjo, qui l’inspiraient, ont remis ça lors de la Foire de Francfort de 1995, illustrant l'effort désormais exemplaire de «ceux qui freinent à la montée» avant de se trouver un rejeton en la personne de Michel Ritter, actuel directeur du Centre Culturel Suisse de Paris, sis en plein Marais, rue des Francs-Bourgeois.
La dernière trouvaille de ce bon M. Ritter, à l’occasion des vingt ans du Centre qu’il pilote depuis trois ans avec son team, est de proposer aux artistes et écrivains (et écrivaines) qui ont marqué la vie culturelle helvétique de ces dernières décennies, de les enfermer une heure durant dans une vitrine afin de les présenter aux visiteurs de son Culture Shop. A préciser que cet « événement », que dis-je cette « performance », cette « installation » se prépare actuellement sous le sceau de la plus solennelle confidentialité, pour « conserver entier l’effet de surprise ». Mais comment ne pas se réjouir anticipativement d'une initiative aussi originale et lui donner la plus large publicité ?
Pour illustrer la générosité de nos instances culturelles à l’égard des artistes et écrivains (et écrivaines) du beau pays de Heidi, et justifier la peine (dure est la vie d'artiste) que représente leur mise en vitrine durant un temps même relativement bref (quoique infini dans son déploiement symbolique), le rejeton de Madame et Monsieur Barjo « offre » à ses invités le voyage à Paris, leur hébergement et les repas (TVA inclue) pris aux heures réglementaires durant leur séjour.
Les esprits chagrins relèveront peut-être que le même Michel Ritter, qui a mis récemment sur pied à Poussepin ce qu’il n'a pas hésité à appeler un « Salon du Livre », où étaient également « invités » des éditeurs et des auteurs, s'est borné à leur « offrir » 500 francs suisses pour une semaine de séjour. Alors quoi, deux poids deux mesures selon qu'on est en vitrine ou pas ? Mesquinerie que tout ça: quand on est ressortissant d'un des pays les plus riches du monde, on ne compte pas...
A propos des vitrines de Michel Ritter, une autrice de nos amis (que dis-je une auteuse, une autoresse) a proposé à son invitant de placer une petite lumière rouge au-dessus de chaque personnalité exposée, comme dans les quartiers les plus performants d’Amsterdam. On ignore encore si chaque vitrine disposera d’un rideau propre à masquer certains events particulièrement créateurs...Ce qui est sûr en attendant, c'est qu'après la tenue du fameux Salon du Livre en les murs de Poussepin, divers témoignages l’attestent formellement : le Centre culturel suisse à Paris n’existe pas
-
Le mariole de la tribu
Dans L’original, Yves Laplace campe un type de sexeur cynique qui « ba
 ise » le monde
ise » le monde
Le nouveau désordre mondial exalte, de toute évidence, une espèce inédite de relativisme “absolu”, si l’on ose dire, qui pousse d’aucuns à conclure que plus rien n’a d’importance et que seule la jouissance immédiate se justifie encore. Cette forme de carpe diem n’est guère originale, et pourtant, sur fond de bien-être généralisé et d’entropie existentielle, dans un monde où les “personnages”, et les vices autant que les vertus, se trouvent de plus en plus nivelés en dépit de leur sur-représentation sous forme d’”icônes”, la figure du Don Juan à la sauce actuelle, “sexeur” se targuant de “braver les tabous”, peut encore apparaître comme un symbole de liberté. Du moins cette idée oriente-t-elle le propos de L’Original, dernier ouvrage d’Yves Laplace à caractère explicitement autobiographique, qui fait alterner les dits de Bernard, rapportés par son “énervant” cadet, et le récit de celui-ci portant sur ses débuts en écriture.
Bernard Seigneur, présenté ici comme l’”original”, incarne à vrai dire une espèce assez souvent représentée dans les marges de la famille moyenne ou carrément populaire de notre pays. On sait, depuis Cendrars., l’importance des oncles dans les familles. A la vie régulière (et plate) des pères s’oppose le rêve aventureux des oncles. Il n’y a pas de père chercheur d’or, tandis que l’oncle peut trafiquer de l’ivoire, et le cousin bénéficie du même préjugé favorable. Dans le cas de L’original, le protagoniste tient à la fois du “bon type” et du “mauvais sujet”, mélange de jeune rebelle autostoppeur objecteur de conscience et de débrouillard tous azimuts consacrant ses paies d’infirmier au tourisme sexuel multinational avant la lettre. Son cousin Bernard révéla le football au futur arbitre Yves Laplace: on comprend donc la reconnaissance de celui-ci, sans le suivre pour autant dans la fascination qui le fait célébrer son aîné comme le parangon de l’homme libre.
Bernard, dit la Bernouille, se voudrait le représentant le plus à la coule de la tribu des Tanneurs. Marié quatre fois en moins d’un quart d’heure, il se targue d’avoir possédé plus de mille femmes sous toutes les latitudes. Passons sur ses goûts particuliers à la Houellebecq (il ne lui est de plus grande jouissance que d’éjaculer sur le visage de sa muse...), pour nous arrêter sur sa vision “métaphysique” du sexe. Bernard Seigneur considère ainsi que l’amour tient essentiellement à se “vidanger dans le vide”. Logiquement alors, la procréation lui semble une saloperie avérée. Comme un Cioran, il voit en la paternité un “crime”. N’est-ce pas d’un chic total ?
Lui qui n’a “aucune foi en la vie”, reconnaît cependant que certaines dames avortent plus volontiers que d’autres: “Les meufs ne sont pas toujours d’égoïstes femelles. Elles se plient si tu poses l’exigence et si tu abrèges l’explication”. On a les élégances qu’on peut...
Nihiliste soi-disant éclairé pour qui “la femme est un repas”, il dit, “ne pas connaître “d’être plus libre parmi les humains que l’aliéné dans sa chambre capitonnée”. Faut-il lui souhaiter, et à l’auteur, une bonne petite séance d’électrochocs ? Lui qui considère la femme occidentale comme “analphabète de son corps” et se demande s’il est un “plus grand désastre que d’être promu cadre chez Swissair”, dit aussi, en passant, qu’il a “toujours rêvé de la Femme sans la trouver” et qu’il n’a “aucune foi en la vie”.
Pourtant il semble se croire plus vivant que les autres, comme le lecteur, abusé par la vivacité du texte, pourrait le conclure à première approche. Mais au regard plus attentif, ce Bernard “sonne” froid, pur mec brandissant son sceptre phallique. Et finalement, méritait-il tant d’attention de le part de son cousin ? Le feuilleton est déclaré “à suivre”. Est-il sûr que ce soit une bonne idée ?
Yves Laplace. L’original. Stock, 227p.






