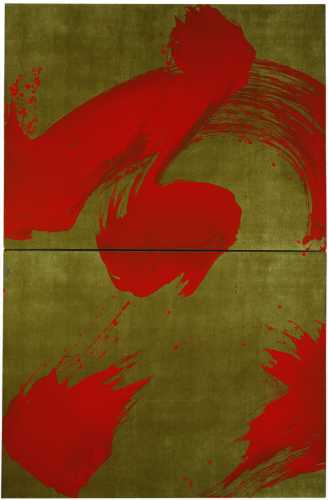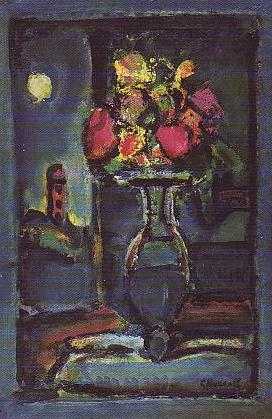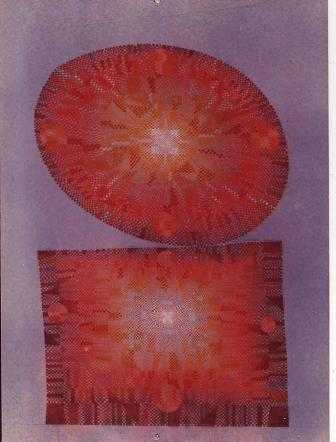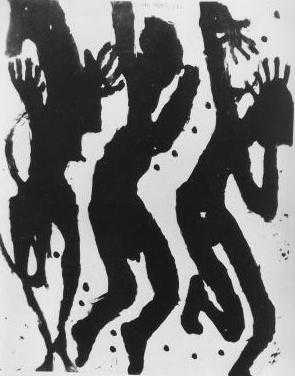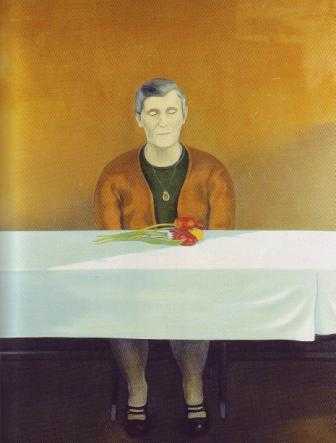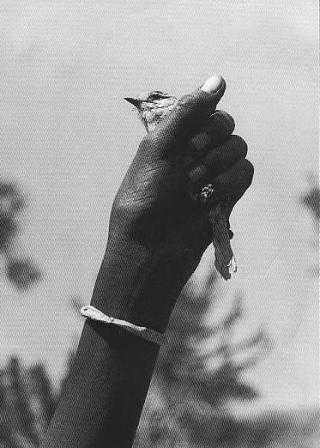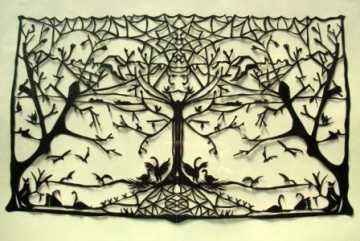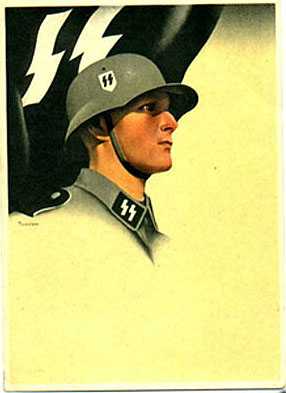Notes à la volée
Notes à la volée
L’œil qui voyage est nettoyé. C’est une fenêtre bien ouverte à la table de l’azur où se disposent les objets. Et ce matin il y a des fanfares dans les rues de La Nouvelle-Orléans. Dès tôt les heures cela jazzait selon la tradition. De beaux nègres arrivaient du bayou. Pour la première fois j’ai vu le Mississippi en lente procession d’eau polluée mais son nom demeurait et j’ai béni tous les rêves qu’il a charriés et le sang des esclaves. Tout me purifiait par le seul nom baptismal du blues.
Sur un mur en lettres immenses il est écrit : THE CHURCH THAT BINGO BUILD. Et plus loin : INVEST YOUR MONEY IN GOD. Entre les deux inscriptions se tient une créature décharnée aux orbites creuses et aux bras tuméfiés de cent stigmates bleu et noir, dont le caddie contient tout le bien.
Beaucoup de gens qui courent. Beaucoup de hangars à l’abandon et de cadavres de voitures. Beaucoup de gens qui parlent tout seuls.
Je me retrouve, dans les rues historiques du Carré français aux maisons multicolores à galeries, un peu comme à Séville ou à Nancy, à cela près que les matinaux s’y traînent plus qu’ils ne se baladent, et que les traces de l’alcool blanc dont les fioles jonchent les trottoirs exhalent la même misère que la vision des sinistres antres qui remplacent ici les cafés du matin à la nuit, dans lesquels on descend généralement mais pas comme dans une cave : dans une cul de basse-fosse à défonce.
Or je me suis rappelé ce que me disait l’autre jour le type à casquette verte : que les pauvres ici ont conservé leur âme au contraire de tant de nantis ; puis, m’étant égaré dans le quartier noir où, à un moment donné, à un détour du chemin de terre battue bordé de cahutes, m’est apparu ce vieillard édenté trônant sur un canapé de rebut, j’ai salué Sa Majesté de ma plus belle révérence.
Carnets de JLK - Page 196
-
Blues à La Nouvelle Orléans
-
Notes pour un roman

Notes liminaires
1. Un roman est d’abord une espèce de sentiment vague, auquel sont associées quelques images. Avec cette intention initiale de ma part cette fois : de raconter ou se faire raconter trois vieilles dames. Une dame serait un récit, deux dames une nouvelle ou une pièce de théâtre, mais trois vieilles dames font un roman. Voilà : ce sera donc le roman de trois vieilles dames. Trois vieilles dames de notre époque, qui sont nées toutes trois pendant la Grande Guerre (1915,1916, 1917) et ont traversé le XXe siècle, chacune à sa façon. Je vois déjà le roman de terre, de grand air, de tribulations et de bonté que cela peut donner, où se mêleront l’histoire du siècle (Marieke la Hollandaise), l’évolution du petit pays enrichi (Clara la gardienne du foyer) et la géographie du monde (Lena la trotteuse). Tout dès cet instant : lectures, observations, gamberge, tout va se déverser dans cet entonnoir. La traversée du XXe siècle en filigrane. Un roman d’humour et d’amour.
2. Les premières images sont celles d’un jardin public où les deux premières dames (Marieke et Clara) se rencontrent par hasard, sous un tulipier. Il y aurait le bateau blanc à aubes de la Compagnie Générale de Navigation que Marieke prendrait le plus souvent possible pour aller de l’autre côté. Je vois les hautes marches d’escalier descendant sous terre d’un tombeau de la Vallée des Rois. Des tea-rooms l’après-midi. Je vois aussi l’appartement de la célibataire (Lena la voyageuse) donnant sur une pelouse décente. Et le quartier de la veuve. Donc l’une (Clara) sera veuve et l’autre (Lena) célibataire. Et la troisième (Marieke) aussi est veuve. Deux seules ont des enfants. Un fils a tenté de se suicider. Deux filles ont épousé respectivement un Espagnol et un géomètre, notamment.
3. Le titre m’est venu soudain comme une évidence, oui c’est cela : Les bonnes dames.
4. Le territoire de chacune des trois bonnes dames est assez nettement défini, comme les caractérisent certains objets et autres accessoires. La maison, type de la villa familiale subventionnée des années 50, est le royaume de Clara, la maison et le jardin qui l’entourent. Marieke, pour sa part, m’évoque plutôt un pigeon dans son colombier, qui doit aller et venir. Quant à Lena, son aire est moins marquée. Elle vit surtout dans la relation. Elle a peu d’espace privé. Ou alors : net. Il y a en elle de la secouriste. Le service a occupé sa vie. Clara porte un petit sac à dos, Marieke une espèce de sacoche de cuir à franges indiennes. Aucune des trois ne fume. Marieke, la plus limitée question matérielle, se paie parfois un schnaps, histoire de se rappeler l’époque du Lac Bleu où, pendant la guerre, elle a trouvé son premier refuge.
5. M’importent les lumières. M’importent les objets éclairés. M’importent les tonalités respectives de chaque voix. Marieke toujours un peu ronchonneuse, malcontente du Gouvernement, au sens universel. Clara volontiers sentencieuse et plaintive pour se faire plaindre, mais solide au poste. Lena pleine de malice, cachant sa peine depuis une vie.
6. Importante également : la façon de chacune d’apparaître et de s’esquiver, comme au théâtre. Clara et Marieke sont immédiatement là, tandis que Lena apparaît d’abord par défaut, dans ce qu’elles racontent d’elle, alors qu’elle séjourne au Bouthan chez son amie Rosa. Importants les dialogues. Comme rapportés en discours indirect mais très vifs. Lena se parle à elle-même en riant sous cape. Rien ne perle cependant de sa douce folie dans son comportement de voyageuse humanitaire juste originale.
7. La construction serait comme d’un montage de cinéma, un peu à la manière du Monde désert de Pierre Jean Jouve, très claire et très elliptique, très à la pointe, sans jamais peser ni trop développer, mais avec de soudaine ruptures de ton, dans le drame ou le cocasse, le tragique ou le salace. Concentrer en 200 pages le contenu latent de 600.
8. Marieke. Mon Indienne. Ma femme du vent. Ma vieille écolo férue d’art et vouant un culte posthume à son frère peintre, emporté par la gangrène l’année de la mort de Staline. Enfuie d’Amsterdam en pleine guerre pour un motif secret. Débarquée en Suisse allemande où elle a rencontré le lieutenant Verrières, petit-fils de psychiatre (ami de Jung) et fils de colonel pro-nazi, originaires de Neuchâtel. Grands bourgeois ruinés en Argentine dans les années 30. Son lieutenant culturiste et sous la coupe de sa mère, une de Rougemont typique de la dominatrice d’aristocratie provinciale. Que Marieke, fils de leader socialiste hollandais, subira pour mieux défendre ses chiots, comme elle appelle ses enfants. Marieke ne parlera guère d’elle-même à Clara, mais son discours intérieur fait partie du portrait. Le lecteur en saura tout sans que rien ne passe la barrière de ses (fausses) dents. Marieke est tissée d’Histoire (avec une grande hache) et d’histoires. Elle a rempli l’enfance des jumelles (donc il y a des jumelles dans ce roman) de ses récits et autres affabulations à en plus finir.
Le grand regret de Marieke est de ne pas avoir eu l’occasion d’étudier. Elle a toujours été attirée par la philosophie. Elle lit toujours Sénèque, tout en enrageant de tout oublier à mesure. Clara lui reproche de couper les cheveux en quatre et se flatte d’avoir, elle, les pieds sur terre. « Moi, au moins, j’ai les pieds sur terre », dit Clara.
9. Clara, elle, est tissée de généalogie et de géographie. C’est la Femme au Foyer dont le jardin s’étend désormais au monde entier. Du vivant de son conjoint, elle a déjà « fait » l’Autriche et l’Espagne, l’Italie en camping dans les années 50-60 et la Grèce en croisière Hotelplan, puis l’Argentine (en visite chez l’une de ses filles) et le Mexique, mais elle rêve encore de la Vallée des Rois. Elle aime les balades en forêt et les randos à flanc de montagne. Quand on lui dit que le Zanskar est super, elle rétorque que le Lötschental est aussi très bien. Elle se vexe si l’on insinue qu’il y a mieux que la Suisse, mais les voyages ont aiguisé sa fibre socialiste. Elle a écrit récemment au ministre des finances pour lui dire ses doléances à propos de la situation des vieilles personnes et du quart monde en ce pays de nantis parachutes dorés. Elle collectionne les chèques de voyage.
10. Lena, sœur benjamine de Clara, est plutôt sciences naturelles et service social, à la dévotion de la Vraie Jeune Fille de partout. A ce titre, elle a enseigné dans le monde entier, longtemps en Australie puis à Salt Lake City, chez les Amish et au Donegal, avant de se retirer dans son canton primitif où elle tient l’orgue paroissial et classe son herbier, soixante ans de cueillette sous toutes les latitudes.
11. Brocante des trois personnages. Marieke ou la mule des pulls (pour Clara : des nids à poussière). Mais elle leur fait raconter des histoires. Les serre dans une malle et les sort de temps à autre, notamment pour les jumelles. Lena ne garde aucune relique, sauf un cahier rempli de micronotes et son herbier. Ne conserve qu’une paroi de livres. Dans un tiroir fleurant l’eucalyptus : un argus de Tasmanie dans un sachet de papier, et la petite photographie écornée d’un indigène des Samoa presque nu qu’on ne retrouvera même pas après sa mort car elle la brûlera avant la fin du roman. Clara vit avec les portraits des siens alignés sur une paroi. Divers objets décoratifs ramenés des quatre coins du monde. Son conjoint faisait du macramé et de la peinture sur bois. L’un de ses fils a la manie de lui offrir des cannes. Toutes finissent dans le même cagibi.
12. Esquisse de la première séquence intitulée Au Denantou, du nom du jardin public jouxtant le petit port lacustre, tout au bas de notre ville.
Au Denantou
Ce qui serait super, avaient-elle pensé, serait de se revoir au lieu même où elle s’étaient retrouvées la dernière fois par hasard, dans le grand jardin du bord du lac, au Denantou, et Marieke tint à préciser: sur ce banc d’où l’on a la meilleure vue de l’autre côté, et Clara conclut à sa façon, avec un allant qui l’étonnait elle-même: d’accord, nous nous retrouvons sur notre banc, le même jour dans une semaine, à une heure de l’après-midi, sauf s’il pleut.
A l’instant elles venaient de s’apercevoir de part et d’autre de l’allée. C’étaient deux très vieilles dames qui auraient aimé se faire de loin des signes folâtres de petites filles se réjouissant de se retrouver un après-midi de congé, mais elles s’en tenaient pour l’instant à leurs rôles aux contrastes marqués depuis des années au fil des très épisodiques rencontres de leurs tribus appariées, la philosophe et la marcheuse, se bornant à des constats de leur âge: il fait un temps extra, on est à l’heure, etc.
Marieke se dit in petto: elle a vraiment l’air de se maintenir, la p’tite Clara, elle ne se laisse pas aller, etc.
Et Clara: c’est décidément une originale avec sa jupe d’indienne, et pourtant elle est à l’heure, etc.
Elles restent un bon moment debout dans la lumière nette de lendemain de pluie de ce 14 juin de l’an 2000, à quelques pas de la vendangeuse de pierre dont Marieke célébrait l’autre jour les rondeurs opulentes, et c’est encore Marieke qui retient Clara sur place, l’impatientant à la fin avec ses congratulations:
- Non mais laissez-moi vous regarder : c’est qu’on vous donnerait vingt ans de moins ! Nom de bleu la Forme !
Et Marieke ne lâche pas le bras de Clara, qui n’a jamais trop apprécié les attouchements, sauf de la part de feu son conjoint, d’ailleurs peu porté là-dessus. Aussi lance-t-elle, pour faire diversion, tout en visant leur banc du regard:
- Vous savez que c’est aujourd’hui l’anniversaire de notre premier rendez-vous, il y a plus de soixante ans de ça, le 14 juin 1939, ça sentait déjà la guerre; et voilà qu’il y a juste vingt ans, en mars dernier, que Paul-Louis m’a été repris. Enfin je vous l’ai déjà seriné, je me répète : je m’excuse. On ne se rend pas compte ce que le temps passe tellement c’est long, et puis ça me fait du bien de vous parler... Il en aura fallu des années pour qu’on arrive enfin à trouver le contact… Jamais ne n’aurais pensé… Mais ne restons donc pas plantées...
Alors on les voit bras-dessus bras-dessous, comme deux soeurs ou des camarades longtemps séparées, qui se dirigent vers l’ombre claire, sous le tulipier là-bas, en ne cessant de parler avec animation.
Clara continue de se lamenter un peu malgré les protestations de cette fofolle de Marieke qui prétend que la vie est un miracle de chaque instant. C’est plus fort qu’elle : il faut que ça sorte. Le jour de leurs retrouvailles, tant d’années après le mariage de Loulou et Pascal, leurs enfants respectifs, elle a dit à Marieke que c’était la première fois qu’elle confiait à quelqu’un tout ce qui la chicanait - même à son amie Constance elle n’aurait pas osé. Peut-être, a-t-elle pensé ensuite, que cet abandon tardif lui est venu du fait que Marieke, pour la première fois, lui parlait directement à elle et sans qu’il fût question de leurs enfants, tout à coup, cra cra, elle lui a dit qu’elle pouvait vider son sac.
Clara a dit alors à Marieke tout ce qui lui pesait, et d’abord d’être si seule, malgré ses enfants et leurs propres enfants ou peut-être bien : à cause d’eux. C’est vrai qu’après tout ceux qui n’ont personne peuvent s’y faire : ils n’ont personne, tandis que les enfants vous les attendez. Et les enfants se font attendre.
« Mais c’est la loi de la vie », avait objecté Marieke. « Les enfants doivent couper. Je dirai même : il faut qu’ils nous bousculent, c’est aussi bien pour eux que pour nous ».
Et Clara : « Quand même vous exagérez, Marieke, les enfants restent les enfants » - «Allez, ma p’tite Clara, vous vous faites du mal à vous accrocher comme ça. Lâchez-leur les baskets et ils viendront sans se faire prier s’ils tiennent à vous. Sinon ça vous fait une belle jambe… »
Or Clara en convient à l’instant, après qu’elles se sont raconté leur semaine:
- Voui, vous aviez peut-être raison pour les enfants, je suis sûrement trop impatiente, mais tout a tellement changé depuis le temps où nous allions voir nos parents tous les dimanches après le culte.
- Tous les dimanches après le culte ! Vous vous rendez compte ? Vous les voyez là-bas, sur leurs rollers, vous les imaginez tous les dimanches après le culte ? C’était notre monde, tous les dimanches, et maintenant il n’y a plus de dimanche, p’tite tête, ou alors c’est tous les jours dimanche. Mais basta : on va se mettre en retard, l’Italie n’attendra pas…
13. Le retour au roman se fait sentir par un afflux de rêves et ce murmure d’avant l’aube qui représente à mes yeux la voix même du roman, tissée d’une voix filtrée par mon subconscient et de toutes les voix. Dans le murmure de ce matin il y avait donc cette voix et ce souvenir-sensation lié à la guêpe de mon enfance, dont la piqûre au fond de la gorge a failli m’étouffer. Sans la Porsche rouge du bon docteur Croisier : j’étouffais. Le souvenir m’en est revenu à partir de la phrase surgie comme ça à fleur de sommeil: « Ce fut une année de guêpes », et cette image d’une pièce bleue remplie de guêpes et du débat me concernant : il n’a pas droit à l’insecticide, vu qu’on ne sait pas de quel subterfuge il est capable. Je me sentais en effet toléré dans cette maison, mais non sans défiance. J’étais en somme le corps étranger, comme la guêpe était le corps prisonnier de ma gorge, qui se débattait, piquait et piquait encore et crevait dans ce gouffre obscur, glissant et fleurant bon le sirop d’une gorge d’enfant.14. J’envisage une construction semblable au découpage séquentiel du cinéma, en tout cas pour avancer, en me rappelant le risque de la trop sage juxtaposition style Nos frères farouches ou L’œil clair. Eviter l’album à vignettes. Le montage doit rester soumis au tempo de l’écriture. C’est l’obscur jaillissant qui a le dernier mot de la structure. Celle-ci n’est qu’un système de loupiotes, utile dans une narration de ce type. Dans Le viol de l’ange, la structure ternaire et le jeu numérologique n’étaient même pas des béquilles : plutôt des signes ironiques que je m’adressais en brassant ce magma chaotique qu’On me dictait tous les matins.
15. Clara ou le besoin de s’activer – mais on sent en elle un vide et une agitation intérieure qui expliquent en partie l’importance de son dossier dermatologique. Elle est impatiente à proportion du vide qu’elle sent en elle. Elle frotte et brique à proportion des saletés qu’elle a découvertes tout près d’elle et dont seul son compagnon défunt pourrait la consoler. Elle se dit : je suis seule à porter ma croix. Un lourd secret lié à l’un de ses fils. Clara la claire, et l’obscure. Marieke : la pénombreuse. Lena : l’allumée. Clara est l’active et la soucieuse, constamment active et soucieuse de mieux faire alors que tous lui conseillent le lâcher-prise. Mais c’est plus fort qu’elle : même au cours de yoga des aînés elle reste obnubilée par ceci ou cela qu’elle a négligé de faire ce matin. Or cette hyper-activité est évidemment compulsive, mais il n’y a pas que ça.
16. Toutes trois sont d’une génération qui a les pieds sur terre (selon l’expression de Clara), qui fait face et sublime. Ou plutôt que de génération, c’est d’une société qu’il s’agit : de l’Europe d’entre-deux-guerres.
17. Les séquences de la première partie, toutes concentrées sur le 14 juin 1999, se distribuent comme suit : 1) Au Denantou. 2) Sur l’Italie. 3) Le souk de Brahim. 4) Place de la République. 5) Vieillir. 6) Les nudistes. 7) La femme du vent. 8) Château d’Ouchy. 9) Le fiston. 10) Ceux de la 6. 11) Dernières nouvelles de Juanito (Scrabble). 12) Au théâtre. 13) Spectateurs. 14) Une belle journée (Clara). 15) Murmures de Marieke. 16) Claus en Oncle Vania. 17) De la jeunesse. 18) Confidences d’un DJ. 19) Portraits de famille. 20) Insomnie. 21) Le cahier jaune. 22) Au bar du théâtre. 23) Mère et fils. 24) Une belle journée (Marieke). 25) Le vieux Simon. 26) Un dernier verre. 27) En pensée avec Lena. 28) Le mur. 29) Ce que savent les maisons. 30) Téléphonie occulte. 31) Ce que disent les rues. 32) Triple dose. 33) Le sommeil de Marieke.18. De Marieke qui a le plus vécu on n’en apprendra qu’une infime partie, l’important étant ce qu’elle a filtré et d’où vient son savoir humain. Pourtant il m’importe de noter quelques détails, qui apparaîtront dans le roman ou non. Et d’abord que Marieke débarque d’Amsterdam au sortir de la guerre, avec une première vie derrière, deux enfants avortés et un premier blindage de méfiance à l’égard des hommes. Surtout elle rêve de Sud. Son idée est le Midi, si possible la Provence, mais elle manque de tout à ce moment-là. Par Lausanne dont elle découvre une première fois la rive du lac, elle gagne la Suisse dite primitive via Lucerne où un jeune marchand de casseroles auquel elle a proposé des timbres de collection (sa fortune présente) dans le train, l’accueille dans la ferme familiale où elle passe la nuit. Elle se rappellera toujours le fumier tressé, les oreillers remplis de noyaux de cerises et la pièce de cinq francs que lui a remise Frau Hilfiger au moment de leurs adieux. Le même jour elle arrive au bord du lac d’Ägeri où se trouve la pension pour enfants de nantis du Docteur Jawohl (c’est ainsi qu’elle le surnomme aussitôt) où elle est supposée faire le ménage, et dont le climat austère à l’excès la glace. Seul le Docteur l’amuse et la soutiendra dans les jours à venir. Le travail harassant qu’elle abat du matin au soir donne pleine satisfaction, d’autant que, le soir, elle s’attarde longuement auprès des enfants, ce qui lui gagne l’attention et l’affection du Dr Jawohl, pédiatre et pédagogue qui ne jure que par Pestalozzi. Le seul répit que trouve Marieke consiste en la rédaction quotidienne de ses impressions, qu’elle consigne dans ses lettres à son frère artiste Anton et à son amie Hella. Le désir de quitter ces lieux froids la tenaille après quelques semaines et le chef de la police locale, rencontré à l’auberge, promet de lui faciliter son transfert en Suisse française, où elle arrive avec quelques francs en poche. Une dame Miauton la recueille quelques jours, qui place les jeunes filles au pair et lui trouve un poste de sommelière dans un café de l’arrière-pays. C’est là qu’elle rencontrera le lieutenant Verrières, dont elle rabat le caquet de grande gueule avec autant de vigueur qu’elle repousse les avances des clients du café. Là encore, elle séduit le maître de maison habitué à voir ses serveuses passer d’un homme à l’autre, et son fichu caractère épate le lieutenant. De ses lettres à Anton de ces semaines, il ressort qu’elle s’impatiente de quitter ce trou de province aux philistins bornés. Le lieutenant Verrières assiège sa forteresse et lui propose de partager sa vie, mais elle gagne alors le Tessin avec ses économies de quelques mois. Cependant il pleut au Tessin, et quelque chose la fait revenir au lieutenant Verrières, qui lui semble réellement épris et décidé à se ranger des cavalcades. Après quoi Marieke se fiance, se marie, enfante à deux reprises et vit cinquante ans de plus. De tout cela n’apparaissant que des bribes dans ses rares récits à Clara et Lena, qui la cuisinent le plus souvent en vain, lui prêtant une vie de bohème ou dieu sait quoi. Elles en sauront beaucoup plus en revanche sur les tribulations de son fils, le plasticien anarchiste bien connu pour ses interventions subversives dans les milieux de l’art et de la politique…
19. La Suisse dans laquelle débarque Marieke est un pays en noir et blanc. Les hommes sont encore aux frontières (dans leurs têtes) et l’on y trouve de nombreux internés, dont les Polonais, les Français et les tuberculeux. Clara est déjà mère de deux enfants et, avec Andreas, pense à construire. Il y a des subventions pour le baby boom. Les parents de Clara les aideront. Clara est décidée à lutter, comme elle le rappellera jusqu’à la fin. Sa bicyclette ne dispose que d’une vitesse.
20. Les séquences de la deuxième partie, dont la majeure partie touche au voyage en Egypte des trois bonnes dames, au printemps 2000, se distribuent comme suit : 1) L’Offre Spéciale. 2) A la Croix-Fédérale . 3) Préparatifs. 4) Vol Swissair K7306. 5) Herr Doktor Fröhlich. 6. Le monde vu d’avion. 7) Le vent du soir. 8) Hôtel Osiris. 9) L’homme en morceaux. 10) Les felouquiers. Rêverie au bord du Nil. 11. Good night, sleep well. Souvenir de Grossvater au Royal du Caire. 12) Trois femmes dans la rue. 13) La bande de Saïd. 14) Négociation I. 15) Le taxi de Saïd. 16) Vallée des Rois. 17) Saïd. 18) La maison de Saïd. 19) Clair de lune. 20) Négociation II. 21) Continental Breakfast. 22) La chute. Première défaillance de Clara. 23) L’Américain. 24) Au souk. 25) Mélancolie. 26) Chez Omar. 27. Nos voyages et nos rivages. 28) Diapositives. 29) L’amour du Sud. 30) Très mauvaise nouvelle. 31) La gisante. 32) La Barque de la Nuit. 33) A la cafétéria.
21. Plus je vais et plus je me dis que le roman est pour moi la meilleure mise à distance, dans le plus juste rapport, enfin le roman : j’entends la fiction et la narration, la transposition même légère de ce qui a été vécu et de ce qu’on tend à partager le mieux possible. La lecture quotidienne de Proust, et ces jours plus précisément les démêlés de Charlus et de Morel évoqués au fil du voyage du Narrateur en petit train normand, me fait percevoir chaque jour un peu mieux cette bonne distance et ce juste rapport. Le romancier y est un peu comme un montreur d’ombres, à la fois tout proche et se faisant oublier par la magie du jeu, cela me rappelle à la fois le regard latéral d’Alfred Hitchcock et le dédoublement de Philip Roth en Zuckerman, la projection à distance variable de Boualem Sansal dans Le serment des barbares ou Dis-moi le paradis, enfin toutes ces modulations qui font du roman, ou disons plus généralement de la fiction, le filtre de la réalité et l’instrument d’une meilleure connaissance de celle-ci.
22. La troisième partie des Bonnes dames ne sera faite que de discours indirects et sous toutes les formes de la communication à distance, à l’exception d’une seule rencontre de Marieke et Lena à Sils-Maria et Soglio. Après la mort de Clara, Lena a recueilli un Cahier jaune dans lequel sa sœur a consigné ses douleurs secrètes depuis le début de la maladie de Paul-Louis, son conjoint. Des éléments de ce cahier fonderont la présence de Clara dans la troisième partie du roman, Lena ayant confié quelque temps ce journal intime à Marieke. Les douleurs de Clara font ressurgir celles de Marieke, informulées jusque-là.
23. Le roman s’inscrit dans la mémoire par le truchement d’objets, usuels ou symboliques. Ce peut être un sac à main ou ne certaine façon de renifler. L’idéal serait de pouvoir identifier le personnage à la seule mention de l’objet. Le cliché en la matière : l’imper de l’inspecteur Columbo et sa façon de lever une main lorsqu’il feint de se rappeler soudain quelque chose.
24. Dès qu’Elizabeth Costello apparaît dans L’homme au ralenti, le dernier roman de J.M. Coetzee, quelque chose se passe. Costello est à la fois le deus ex machina et la figure de l’intrus, la mère du récit et la vie, ou la mort, du protagoniste qui se sent lui-même un pantin manipulé, sans cesser de jouer sa partie pour autant. Et tout devient tout de suite plus réel dès qu’elle est là, cette peste.
25. Le souk d’Ousmane Boubacar le Sénégalais se compose, à part les babioles à touristes, statuettes pur Dogon fabriqués à Taiwan, de Senteurs, Saveurs & autres Sentences qu’il a lui-même recopiées dans les livres. Clara est fort impressionnée au premier chef, puis elle se détend au vu de la jovialité du personnage, qui la fait parler de sa sœur Lena, naguère très active aux Missions.
26. Ce qui sauve Clara est son humour. Cela lui reste d’une certaine Suisse terrienne et populaire. Elle a le sens du grotesque aussi, et le goût du cocasse. Elle ne sera jamais supérieure ou suffisante, jamais niaise non plus.
27. Clara se rend compte du fait qu’elle n’a jamais adressé la parole à aucun Noir, et qu’en somme il reste en elle une certaine peur à cet égard. Or ce qui la stupéfie est de constater que la personne d’Ousmane lui fait oublier complètement la couleur de sa peau.
28. Clara et Marieke se sont rencontrées par hasard, mais plus elles y pensent, chacune de son côté, plus elles conviennent qu’elles y étaient disposées à ce moment précis et que la vie les a, en quelque sorte, confiées l’une à l’autre.
29. La vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité, ou disons plus précisément : pas livrée comme ça, jamais énoncée sans modulation préalable ou sans nécessité narrative. Plus exactement alors : un corps incarné en vérité ou une musique qui sonnerait vrai dans la moindre de ses parties.
30. Le thème des retrouvailles, comme celui de la rencontre, est à mes yeux un ressort important.
31. Ce qui intéresse le romancier chez les bonnes dames, c’est leur simplicité et leur dédain des chichis et des formes, des convenances et des conventions, chez Marieke surtout, non sans nuances pour autant que fait ressortir l’extravagance de la Comtesse. Laquelle se permet ce que personne ne se permet, du seul fait de son âge et de ses désillusions dûment théâtralisées – la Comtesse qui s’est ruinée et refaite au casino d’Evian, la Comtesse aux sept maris qui recommande à Loulou de bien s’occuper de son Jules parce qu’un Jules on n’en a qu’un dans la vie, etc.
32. Loulou, fille de Marieke, est donc la mère des jumelles Dolly et Molly, surnoms de Délie et Mélie.33. Le côté de Marieke est le côté bohème, tandis que le côté de Clara est celui de la Suisse propre en ordre que toutes deux, au demeurant, raillent de concert.
34. Marieke persifle volontiers la Suisse tiptop, mais Clara ne le prend pas pour elle-même, d’ailleurs il n’y a pas de raison, son conjoint et elle ayant toujours abhorré le style nain de jardin. Le nom de leur maison, Petite Maison, est un signe de malice, lié à un certain secret amoureux entre eux deux.
35. Le Sénégalais a été successivement armailli dans les Préalpes vaudoises, pêcheur de corail avec le fils de Marieke et jardinier de la commune d’Abondance où il peaufine sa thèse sur Leopold Sedar Senghor le Poète Président.
36. Tout doit s’étoffer et se colorer de manière plus fruitée et savoureuse à tous les sens des sens. Aller pour cela sur les lieux. Chercher les mots dans les rues et sur les arbres. Mieux regarder les choses et les gens.
37. Diatribes de Marieke, dont le discours s‘enfle et s’enflamme comme s’enflait et s’enflammait le discours du citoyen Rousseau cheminant par les monts et les vaux.
38. Comme en peinture, il y a ce que dit la nature, et ce que dit la toile.
39. Le travail de ce roman est essentiellement une affaire de rythme. Il ne s’y passe à peu près rien, si ce n’est trois fois trois p’tits tours et s’en vont les bonnes dames, autour du lac, autour de Louksor et du Nil, puis autour d’une tombe fraîche, après la mort de Clara. Cependant l’impression doit être que tout pulse et que tout vibre et vibrionne comme dans une volière.
40. « Je n’ai plus toute ma tête », se plaint Marieke, à laquelle Clara fait valoir qu’elle devrait se réjouir de couper à l’Alzheimer. Clara console toujours les autres, à la manière de Pollyana, en leur faisant valoir un malheur bien pire que le leur, le Sahel ou le Rwanda…
41. Travailler par couches successives, comme en peinture. Je ne sais rien d’elles à la base, ou plus exactement : ce que je sais d’elles apparaît dans le seul mouvement d’émergence et de cristallisation du texte, de la phrase vivante qui représente à tout coup un segment du corps vivant du texte.
42. Les temps multiples de la narration marquent, entre autres, la constante variation des points de vue de la Narration. Plus que d’un Narrateur, je parlerais en effet pour ce roman de La Narration, comme une instance poreuse aux pouvoirs à la fois diffus et super-précis…
43. La philosophie de Clara est donc globalement celle de Pollyana, qui consiste à se réjouir, à chaque fois qu’on prend une tuile, de ne pas en prendre deux, et ainsi de suite. Ce qui ne va pas sans exaspérer Marieke, laquelle n’est pas du genre à se résigner non plus qu’à se voiler la face devant l’horreur de la réalité. Un débat vif peut donc s’ensuivre.
44. La figure du Nain Suissaud, qui a fait la célébrité controversée de l’Apache (dit aussi le tagueur insaisissable, fils chéri de Marieke poursuivi pour ses tags contestataires et ses actions critiques de toutes espèces), est un personnage référentiel dans le discours des bonnes dames, à la fois sujet de dispute (Clara ne peut donner raison à un anarchiste fauteur de déprédations) et de discussions complices.45. Le signe que le roman se fait, c’est qu’on y pense tout le temps.
46. Il y a quelque chose de Basquiat dans les tags de l’Apache, mais en plus élaboré, en moins faussement brut, en plus parodique aussi. L’Apache est un authentique artiste virtuel, qui pense en matériaux et en formats divers, sans réaliser jamais hors de ses seuls carnets.
47. « Je suis le dernier des Mohicans », pourrait dire l’Apache. Un jour un mécène de l’industrie automobile et de la culture lui a proposé de le mettre sous contrat. Comme ce qu’il en a été de toutes les propositions des plus fameuses galeries, Tim a poliment décliné.
48. « Nous ne sommes pas une famille mais un clan, du genre tartare, ou une tribu, style apache ou cheyenne, enfin un petit groupe de gens qui se tiennent les coudes... » (Marieke dixit)
49. Attention à traiter tous les personnages d’une même encre, avec la même légèreté passante, sans peser. Rien là-dedans de la satire, en dépit de multiples aspects critiques et caustiques. Rien du roman psychologique non plus, malgré la psychologie très différenciée de chaque personnage. Pas un roman poétique non plus, quoique la poésie y soit. Surtout alors : un roman allant, un récit qui va de l’avant, une phrase qui roule.
50. Le dévoilement de chaque personnage se fait avec le temps. Rien ne doit être livré prématurément, sans nécessité narrative formelle. C’est une logique sous-jacente à observer très rigoureusement. Tim et Loulou, ou les jumelles, Lena ou Pablo, et tous les autres, vont faire leurs trois p’tits tours au fil du récit, chacun son quart d’heure de célébrité, trois p’tits tours et puis s’en iront – d’ellipse en éclipse.
51. Dès lors que le roman devient un plaisir, c’est qu’il est en train de prendre, à partir de quoi tout coule plus ou moins de source, tout devenant à la fois plus léger et plus juste - tout prenant véritablement consistance et forme. Alors on sent qu’on pourrait écrire du matin au soir, mais non : on va plutôt prendre son temps, qui est celui-là même du roman.
52. Au premier canevas se substituent peu à peu de nouveaux développements et autres variantes, procédant de la logique organique du roman, qui pousse où il veut. Le meilleur exemple en est l’apparition du Capitaine sur sa périssoire, qui annonce le thème de la Barque égyptienne des morts.
53. Clara se raccroche aux formules morales, dans la pure tradition protestante qu’illustre sa famille par alliance. God is my copilot pourrait en être un exemple, tiré des sermons du pasteur Amédée, lequel lui est toujours de bon conseil, genre Compagnon de Taizé. Dans le trolleybus No 6 elle a l’impression de vivre la métaphore de la vie. Nous montons parce que le véhicule est en contact avec le Courant - ce genre de choses. Elle incarne un certain pragmatisme chrétien assez typique, qui procède par trucs & recettes, mais avec des ouverture possibles, et des ruptures de tonus lui ouvrant des gouffres, liés à sa solitude.
54. Le passage à l’imparfait agit comme un zoom arrière, équivalent d’une mise à distance mentale.55. Attention aux rimes intérieures. C’est vraiment la cheville à éviter, la ponctuation non désirée de la narration.
56. J’ai finalement modifié le rapport de Marieke et Clara, qui se connaissaient bien avant de se retrouver, par le truchement de leurs familles alliées. Sans tirer la narration du côté de l’autofiction, il m’importe de la recentrer par rapport à un sentiment personnel intense de leurs rapports et de leurs positions généalogiques respectives. Elles sont liées par les jumelles et par les parents des jumelles, leurs enfants respectifs. Plus intéressant : le fait qu’elles se redécouvrent « par hasard », alors qu’elles sont parentes. Situation typique d’aujourd’hui, relevant de la recomposition filiale.
57. Dans le même esprit, j’ai simplifié la figure du fils de Marieke, Adalbert dit l’Apache par les médias. N’apparaîtra que par réfraction, comme celui avec lequel on ne cesse de se chamailler tout en l’aimant fort. Le frère de Loulou a passé par la taule : cela du moins est important pour Marieke, qui parle la nuit au Capitaine.
58. Après avoir bouclé le récit de la virée en Savoie lacustre, je me suis aperçu que le soleil tombait beaucoup trop tôt pour un 14 juin. Toute la suite en a été faussée, de sorte qu’il faisait déjà nuit à six heures alors que la nuit ne tombe à cette saison que vers dix heures. Ajustement nécessaire, avec l’interversion de deux chapitres…
59. Ce que dit Alain Cavalier à propos du passage d’un plan à l’autre, au cinéma, est aussi valable, d’une certaine façon, pour le passage d’un paragraphe à l’autre dans ce type de récit elliptique qui saute une idée sur deux.
60. Ce qui me semble caractériser les bonnes dames, à l’égard du monde actuel, est leur foncière timidité.
61. J’ai finalement renoncé à la « construction » du personnage de l’Apache, décidément trop artificielle. Ce sera simplement le fils aîné et aimé, avec lequel Marieke ne cesse de se chamailler et dont ne sait que deux ou trois choses, à commencer par le fait qu’il a fait de la taule.
62. Clara peut recourir à la messagerie du Mac que lui a installé Joselito, dit le Petit, et communiquer ainsi avec Lena qui se trouve en Alberta jusqu’à la fin de la première partie, mais le meilleur moyen de communiquer entre elles est encore la transmission de pensées que leur ménage le romancier dans la dernière séquence de la première partie, intitulée Les voix de la nuit.
63. Les bonnes dames sont ainsi mises en réseau de manière occulte, si l’on peut dire, avant de se retrouver en trio pour la virée en Egypte de la deuxième partie.
64. La dernière séquence de la première partie se distingue en cela qu’elle illustre les virtualités du roman, qui va plus vite que le téléphone et le mail. On communique immédiatement d’auteur à lecteur. Le thème en était déjà très présent dans Le viol de l’ange, repris ici sur un ton plus débonnaire.
65. Mes bonnes dames m’aident à réfléchir et à m’expliquer diverses choses de la vie et des âges, ou sur les thèmes qui m’intéressent en l’occurrence, du tabou et de la permission, de l’adoption et de l’amitié, etc.
66. Elles sont à l’âge où l’on peut dire à peu près ce qu’on veut, sans barrière. Elles n’ont plus de raison de se censurer. Rappel de la Comtesse. Pour autant elles ne se permettent pas n’importe quoi, gardant une certaine tenue.
67. L’histoire qu’on se raconte n’est jamais celle qui se raconte au fil des mots. Il y a une part d’aléatoire dans le roman qui est aussi (et peut-être surtout) celle du subconscient. Où tout cela va-t-il ? C’est ce que tu ne découvres qu’en écrivant.
68. Lena est habitée par une indéfectible confiance en la bonne volonté. Elle croit que le monde est à réparer et qu’il faut s’y mettre tous les jours. Elle n’aime pas les grands mots ni les notions trop abstraites, pas plus que Clara. Mais elle n’en a pas moins sa philosophie de la vie.
69. Le narrateur est partout, sous la forme d’un « je » flottant.70.La dernière séquence de la première partie, intitulée Les voix de la nuit, contient en germe la deuxième et la troisième partie du roman, l’Egypte et tout ce qui touche à la fois à la mort et à ce qui se devine par delà les eaux sombres.
71. Marieke retrouve, entre deux sommeils, les notions égyptiennes qu’elle tient d’un opuscule que lui a filé son fils, à propos de la pesée de l’âme et du jugement qui s’ensuit. Au soir le dieu Aton, vieilli par la journée, conduit vers l’Ouest la barque du soleil, pendant que Nout la déesse du ciel fait voûte au-dessus des dormeuses. Le soleil va passer par les douze portes du monde souterrain, mis a l’épreuve du grand serpent Apophis, symbole du néant de toute chose. Marieke se rappelle que les Egyptiens associent la beauté au sacrement de chaque chose et de chaque être. Ils se représentent qu’à l’instant de la mort le cœur du défunt est pesé sur une balance dont le second plateau porte une plume tirée de la chevelure de la déesse Maât, déesse de la vérité. Marieke a conscience du fait que le cœur du défunt doit s’alléger jusqu’à l’équilibre de la balance, pour couper à la dévoreuse d’ame à figure de crocodile.
-
Dantec rocker mystique
Avec Grande Jonction, son nouveau « monstre » épico-théologique sur fond d’Apocalypse et de folles inventions de SF pop, le romancier poursuit une fresque fascinante en dépit de ses pesanteurs.
Maurice G. Dantec, « exilé » au Canada depuis quelques années par rejet véhément de la vieille Europe et du milieu médiatico-littéraire parisien par trop « politiquement correct » à son goût, est un « auteur culte » assez proche d’un Michel Houellebecq, par ses détestations et provocations, son fonds de culture rock et son goût pour les conjectures de la science fiction. Dans ses deux derniers romans, Cosmos incorporated (Albin Michel, 2005) et Grande Jonction qui en constitue la suite directe, Dantec, nouveau baptisé à dégaine de cyborg, affirme son originalité en brossant une fresque catastrophiste, située à la fin du XXIe siècle, toute nourrie de ses lectures des Père de la tradition catholique, et autres grands auteurs mystique, de Basile de Césarée (pour son traité sur le Saint-Esprit) à Jean Cassien (pour son traité de l’Incarnation), en passant par Duns Scot ou Joseph de Maistre, notamment. La méditation sur le Mal qui s’y développe, incriminant une humanité décervelée et dénaturée où l’individu libre et unique serait remplacé par une morne sous-humanité esclave de faux prophètes flatteurs, va de pair avec l’exaltation de la Musique (le Très Saint Rock’N’Roll, dont le livre est plein des échos de la Légende Dorée, mais pas seulement) et de l’Amour, au sens où l’entendait un certain Dante... Or comment tout cela tient-il ensemble et debout ? Essentiellement par l’indéniable génie de conteur-visionnaire de Maurice G. Dantec, dont le souffle, et d’extraordinaires intuitions, font passer de trop lourdes pages érudites ou de non moins fastidieuses évocations de combats pour la Juste Cause.
Il y a du western manichéen et de la bande dessinée dans Grande Jonction, mais les observations et réflexions du romancier, rejoignant celles des contre-utopistes du XXe siècle, de Kafka à Orwell, s’incarnent bel et bien malgré le caractère souvent stéréotypé de ses personnages.
Au premier rang de ceux-ci, qui pourrait être ridiculement kitsch, genre New Age, mais s’impose néanmoins comme un héros de roman de chevalerie, voici l’adolescent Link de Nova, l’enfant mystérieux venu au jour à la fin de Cosmos incorporated et qui a le pouvoir de « guérir » les machines et, bientôt, d’enrayer la nouvelle peste menaçant l’humanité de cette fin du XXIe siècle, laquelle s’en prend à ce qui constitue l’unicité de l’espèce : le langage humain.
Ce Mal, qu’on appelle La Chose, vampirise littéralement les individus survivant après moult catastrophes, dont le Grand Djihad et les guerres dévastatrices qui en ont découlé. Pis encore : c’est à toute forme d’écrit que va s’en prendre plus tard La Chose, effaçant toute mémoire de la surface de la planète. Or Link de Nova et ses amis néo-chrétiens vont accueillir, dans ces ultimes régions protégées de la Heavy Metal Valley (sur les anciennes terres mohawk), une Sainte Bibliothèque envoyée du Vatican, ultérieurement ratiboisé par les nouveaux barbares, qui symbolise l’ultime héritage des résistants et leur arme de reconstruction massive....
A résumer ainsi près de 800 pages, la chose pourrait sembler caricaturale, voire débile. Or s’il est vrai que Dantec agace parfois par certains débats fleurant la dissertation, et si le récit pâtit parfois d’un ton sentencieux ou d’un lyrisme pompier, Grande Jonction saisit en revanche par la beauté de ses évocations et sa façon à la fois naïve et pénétrante de moduler ses thèmes, emportant finalement le morceau par sa défense de l’imagination et de la fiction, dans le mouvement même de la création.
Maurice G. Dantec. Grande Jonction. Albin Michel, 774p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 12 septembre 2006.
-
Notes panoptiques, 2003
Dans le train, j’observe le manège d’un père et de ses deux enfants. Sans doute un père divorcé qui les a eu “sur le dos” ce début de week-end et les ramène à leur mère, ou peut-être est-il allé les chercher à Berne et les ramène-t-il àFribourg ce soir pour les subir ce soir et les ramener demain ? Ce qui est sûr est qu’il n’a pas l’air content, le regard verrouillé et l’air de s’ennuyer ferme, repoussant la petite visiblement très en manque de lui, tandis que le garçon n’en finit pas d’aller et de venir d’un compartiment à l’autre sans tenir compte de ses reproches. Triste vision.
Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.
Jedem Tierchen sein Plaisirchen. Le populaire dit simplement: prendre son pied. Mais sa vie durant Amiel en fera tout un plat. Quant à moi je verrais plutôt la chose en stoïcien. Déjouer l’obsession par une bonne séance, etc.
A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent en Spam sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter.
Me rappelle que, vers l’âge de 17 ans, je me suis soudain affranchi de la foi chrétienne, au chagrin de ma mère. Mais sa façon de me dire sa peine m’aurait plutôt poussé à en rajouter, comme si je devais résister à un chantage. Le même problème avec la mère américaine. Mais pourquoi ce rejet de ma part à ce moment-là, et pourquoi le retour plus tard à la religion avec le besoin d’une forme plus rigide, telle que l’offre le catholicisme ? Mon virage à droite était-il plus fondé et réel que le retour ultérieur à la gauche ?
Grunberger cite cette croyance selon lequel le Dieu le plus ancien était un être d’une méchanceté sans bornes. A ce propos, revenir à l’Histoire du méchant Dieu de Pierre Gripari. Pour ma part la conviction que Dieu n’aura jamais été que la projection des hantises, des peurs et des besoins, puis des aspirations de la misérable et divine humanité. Celle-ci en est en effet devenue plus divine à certains égards, et plus misérable que jamais.
L’Eternel a brouillé les cartes du langage pour faire pièce à la volonté de puissance unanime des hommes.
L’image de la vierge ne m’a jamais inspiré. Qui plus est immaculée de conception. Autrement dit: la femme niée jusqu’à l’état d’ectoplasme. Et je me demande aujourd’hui: qui croit vraiment réellement, sincèrement à cela ? Sûrement pas moi. Autant dire que je reste protestant à cet égard. Aucun goût pour le Saint Esprit non plus, ou plus exactement: plus du tout aujourd’hui. Le nom de Dieu m’apparaît plutôt comme un chiffre, à la manière juive, par conséquent imprononçable.
Le nom de fanatique vient, étymologiquement, de l’expression: serviteur du temple.
Le judaïsme est fondé sur le principe de réalité, auquel s’oppose le christianisme et l’islam. Plus qu’une religion le judaïsme est une morale. Règne et pivot de la Loi. Le judaïsme est oedipien-pragmatique, tandis que le christianisme vise à la sublimation et à la pureté. Pas d’au-delà juif: pas de ciel. L’interprétation divergente du mythe édénique est significative à cet égard. Pour les juifs, l’Arbre de la connaissance symbolise le privilège exclusif de Dieu, alors que le péché originel des chrétiens est d’ordre pulsionnel. Le serpent assimilé à un symbole phallique. (en lisant Grunberger)
Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Bela Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Cingria ou par un Rozanov
Les souvenirs d’Anne Atik sur Beckett, intitulés Comment c’était, me surprennent et me passionnent. On y découvre un homme extrêmement attentif à la poésie, et dans toutes les langues, doublé d’un être attachant, bon et généreux. Egalement emballé par la relecture de La panne, dont le climat restitue merveilleusement le ton de la Suisse moyenne. Et ce ne sont que deux livres parmi la foison de mes lectures de ces jours, où les essais de Mallarmé voisinent avec les Remarques mêlées de Wittgenstein et le pavé de Béla Grunberger sur le narcissisme.
Ne pas se laisser gagner par la morosité ambiante. Jamais. La lecture de Comment c’était, évoquant la vie de Beckett, m’est ces jours précieuse. Présence constante de la poésie dans cette vie, et son manque dans la mienne. Pas assez acharné à défendre et à illustrer le chant du monde. Cela que je dois relancer dans Les passions partagées et sans discontinuer. Cela qui m’a toujours tenu ensemble et ramené à la joie.
Pas mal de délire russe et d’époque (sur l’Eglise et la Révolution) dans les Feuilles tombées de Rozanov, mais l’essentiel qui m’importe est ailleurs: dans l’intimité et dans la beauté de l’aveu. Or je vois mieux à présent ce qu’il y a, là-dedans, de péniblement idéologique, et ce qui s’en dégage en chant d’amour, et notamment grâce à la présence de celle qu’il appelle “maman” ou “l’amie”, et que moi j’appelle “ma bonne amie”.
amie.
Je me disais ce matin que j’aurais besoin d’un exergue pour Les Passions partagées, sur quoi je prends un livre au hasard, En vivant en écrivant d’Annie Dillard, je l’ouvre et voici la première phrase que je lis: “Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond ?” Et cet après-midi, après avoir dormi (très fatigué que j’étais par les deux bouteilles de Corbières d’hier soir), j’ai repris Comment c’était, le livre d’Anne Atik évoquant le souvenir de Samuel Beckett et j’ai pensé que l’exclamation initiale de Fin de partie, “Encore une journée divine !”, ferait également un exergue possible (il m’en faudra trois) pour Les passions partagées.
Le sentiment que l’Eternel est injuste est très présent dans l’Ancien Testament. “Le chemin du Seigneur n’est pas équitable”, dit Ezéchiel (18, 25). Et ceci de parlant: “Les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui ont les dents rongées”.
L’idée de la rétribution concerne la nation (Israël, peuple élu) dans l’Ancien Testament et devient ensuite un enjeu personnel. Pari de Pascal, etc.
Toute conversation sur Dieu sonne de travers à mes oreilles. Comme si l’on parlait toujours d’autre chose. Je pourrais dire avec Flaubert que ceux qui veulent prouver Dieu me sont aussi étrangers que ceux qui le nient.
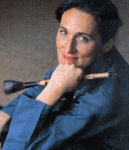 Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. “je sens que je serais capable de traverser un mur”, dit-il ainsi à son maître. Et lui: “Alors vas-y”. Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hybris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: “Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition”. Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.
Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. “je sens que je serais capable de traverser un mur”, dit-il ainsi à son maître. Et lui: “Alors vas-y”. Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hybris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: “Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition”. Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.
Peinture: Fabienne Verdier. -
Ce matin au Paradis
De la mort à l’enfance
A La Désirade, ce vendredi 15 septembre. – Lendemain d'Hier. Lendemain de Fête. Elle voulait qu’on fête après l’avoir pleurée. Lendemain de pleurs et de vin. Lendemain d’Amis réunis autour du cercueil couvert des foulards de toutes nos causes. Lendemain de chansons et de poèmes. Lendemain de feu, de cendres et d’accolades. Lendemain de reconnaissance: on se sent léger, triste et gai, tout égaré de mélancolie et si présent, ce matin au paradis.
On lit ce matin Etranger au paradis, de Philippe Lafitte. Cela commence par la course des flagelles à l’Ovule, et juste après on est allongé dans une chambre qui semble d’un hôtel plus que d’un hôpital, aux fenêtres de laquelle un horizon de tours et de tours s’étend à perte de vue dans la lumière crépusculaire: «Vous vous dites que cette ville immense ressemble à une Voie lactée électronique. A un cosmos tombé du ciel.»
Et déjà tout a été vécu: «On naît, on a à peine le temps de s’y faire et déjà quelqu’un frappe à la porte…»
Déjà se pressent les souvenirs. Et c’est une vie, une enfance au bord de la Seine, près d’une prison dont les détenus martèlent leur gamelle en tam-tam lointain auquel répond le tam-tam du gosse sur le balcon, c’est l’éveil du sentiment et des mots, l’éveil des sensations et les premiers pas de l’Explorateur: «Vous êtes là sur des portiques, des vélos, des grillages, des murets et des jardins publics. Au milieu de la vie. Dans l’œil du cyclone.»…
C’est le matin au paradis tout gris de la mélancolie, et ce livre dit cela. Chaque phrase est belle et juste, sévère et nette, douce et tendre: «Petite Couette agite ses cheveux blonds noués par des élastiques roses et le monde est merveilleux».
Tout à l’heure on va retrouver la vie et la ville. Tout à l’heure on sera dans ce lit d’hôpital ou d’hôtel qui flotte sur l’Océan des souvenirs: «De l’autre côté de la baie, face à la mer de Chine, la ville plongée dans le noir scintille de lumières jaunes. Allongé sur le flanc, vous êtes devenu ce vieillard qui regarde au loin l’eau s’agiter comme de l’encre.»
Lecture à suivre…
Philippe Lafitte. Etranger au Paradis. Buchet/Chastel, 201p. -
Le rêve du collectioneur
L’humour et l’imagination fantaisiste ne font pas florès dans les écrits actuels, aussi est-ce sans se faire prier qu’on gambade dans la foulée de Baptiste Flamini, charmant escroc qui s’est spécialisé dans le domaine haut en couleurs des collections et des collectionneurs qui les collectionnent. « Trouver des choses un peu spéciales pour des gens encore plus spéciaux », tel est son fonds de commerce, dont la première illustration est certes des plus spéciales, puisque le Grand Médium Voyant Ali lui demande de lui procurer une touffe historique de poils pubiens du King, alias Elvis Presley… On pense un peu à Marcel Aymé, un peu à Pierre Gripari, un peu au Stefano Benni du Bar sous la mer, un peu aussi aux bric-à-brac de Prévert ou de Gomez de La Serna en lisant ce premier roman de Bernard Foglino, qui va de trouvailles en menteries avec un art de conteur carabiné, sans toujours faire dans la dentelle surfine il est vrai… Mais rien n’est à jeter : telle est d’ailleurs la devise de Baptiste, qui sait que l’objet cherché par le collectionneur est essentiellement lié à la poursuite d’un rêve. Bouquins de nos enfances, films de notre jeunesse, albums décatis, vieilles pompes (godasse ou Studebaker), souvenirs souvenirs, saveurs de mémoire : tel est le Théâtre des rêves.
Bernard Foglino. Le théâtre des rêves. Buchet /Chastel, 271p.
-
Confessions d'un extravagant

Arthur Cravan ressuscité
« Si la fuite est mon état premier, la Suisse fut mon pays natal », écrit le vieil Arthur Cravan, tenu pour l’un des inspirateurs du mouvement Dada et qu’on croyait disparu dans les eaux du golfe du Mexique à la fin de l’automne 1918, alors qu’il entreprenait la traversée de l’Atlantique à la petite cuiller. Mon chef-d’œuvre aura été ce grand art de la disparition », note Cravan au début de ces confessions amorcées torse nu en 1966 dans la ville de Rousseau, alors qu’il affiche une dégaine de « colosse, mais empâté et ralenti » presque octogénaire. « Je n’écris pas pour l’argent », précise encore celui qui avoue s’être « fait boxeur par facilité physique, poète par prétention et anarchiste par fantaisie », réalisant ici le « projet scientifique » de devenir « le meilleur spécialiste » de lui-même. Ainsi commence-t-on par apprendre sa qualité de neveu d’Oscar Wilde et sa date précise de naissance, sous son vrai nom de Fabien Avenarius Lloyd, à Lausanne en 1887. D’emblée, on l’aura subodoré, le ton de ce roman revisitant l’époque des avant-gardes artistiques et littéraires du début du XXe siècle, dans le voisinage du critique Fénéon, de l’iconoclaste Marcel Duchamp ou de Picabia, entre autres muses de la bohème, est à l’érudition gouailleuse et à l’irrévérence, l’objet captant les reflets insolites du sujet.
Philippe Dagen. Arthur Cravan n’est pas mort noyé. Grasset, 298p.
-
Elégie
Devant la mort qui vient
Combien nos mots semblent vains
quand l’heure est venue,
et l’heure est là : tu t’en es allée déjà.
Tu reposes devant nous, nous t’entourons
mais tu n’es plus nulle part
que partout, à jamais,
dans nos entrailles,
on ne sait où.
Celui que tu as lavé petit
vient de te laver.
Celle que tu as bercée
te berce de ses larmes
dont la vague afflue
au désert de l'absence.
Et quel autre mot dira
Cela ? -
Kertsez et l’autre monstre

Si la notoriété mondiale d'Imre Kertsez, Prix Nobel de littérature 2002, est liée au témoignage bouleversant qu'il a donné, dans Etre sans destin, sur la déportation qu'il a subie en son adolescence à Buchenwald, en 1944, l'écrivain hongrois eut également à subir l'autre monstre totalitaire du XXe siècle, de manière moins brutale il est vrai, mais non moins insidieuse. Roman kafkaïen dont la forme même, littéralement saturée de parenthèses, figure l'enfermement du protagoniste, comme si chaque phrase avait besoin d'une justification, Le Refus raconte à la fois les tracasseries à n'en plus finir d'un écrivain en butte à la censure communiste, l'humiliation du déporté de retour des camps nazis qui a dû subir le déni avant de voir son manuscrit (Etre sans destin, précisément) écarté pour les motifs les plus douteux, et l'antisémitisme perdurant dans la société hongroise d'après la Deuxième Guerre mondiale. Roman du non-consentement, Le refus constitue, avec Etre sans destin et Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, le troisième élément d'un triptyque à lire comme tel.
Imre Kertesz. Le refus. Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai, en collaboration avec Charles Zaremba. Actes Sud, collection Babel, 350 pp. -
Un peu plus à l’Est…
L’Est de Claudio Magris le Danubien a longtemps été celui de ce qu’on appelait l’ « autre Europe », par une forme de discrimination qui l’agaçait et contre laquelle il a beaucoup fait en illustrant le caractère profondément européen, justement, de sa chère Mitteleuropa.
Rappelant en préambule quel préjugé négatif a longtemps marqué le « perfide Orient », l’écrivain voyageur affirme d’emblée le caractère « autre », du véritable Orient qu’il va évoquer cette fois en trois temps (en Iran, au Vietnam et en Chine), en récusant du même coup une notion qui lui semble rebattue non moins qu’abusive : du choc des civilisations.
Qu’il approche la culture et les gens d’Iran (en automne 2004), ou qu’il voyage à la rencontre des habitants du Vietnam et de Chine (en hiver 2003) en cherchant la ressemblance humaine et le génie propre à chacun, Claudio Magris montre bien que ce qui s’entrechoque sont les éléments régressifs des sociétés et non les civilisations, et que l’incompréhension, la non-reconnaissance réciproque ou le besoin d’affirmer son hybris ne relèvent pas du déterminisme ou de la fatalité.
A fines touches, de rencontres en lectures, de tout près ou avec le recul, Claudio Magris nous montre une fois de plus de quelle lecture du monde attentive procède le voyage et quelle empathie il requiert.
Claudio Magris. Trois Orients. Rivages poche, 119p. -
Dantec électrorock

Lecture de Grande Jonction (7)On est reparti dans une envolée épico-poétique fascinante au-delà de la 600e page de cette Grande Jonction parfois fastidieuse, m’a-t-il semblé, avec de vrais « tunnels » où le romancier s'enferre, et qui rebondit ici dans une nouvelle suite d’illuminations narratives dont la première rejoint les représentations du «dernier des hommes» du début du XXe siècle, selon Nietzsche ou Dostoïevski et son Chigalev, le nivellisme généralisé dans L’inassouvissement de Witkiewicz ou l’homme formaté du 1984 d’Orwell, tout s’acheminant aussi bien vers la constitution d’une seule « grande marque déposée, monomodèle, monosérielle », scellant une « indifférenciation générale de toute l’humanité ».
Parallèlement à la collision frontale du Grand Blizzard et du Vent de Sable, avatars physique et climatique d’une catastrophe d’ordre ontologique et métaphysique, c’est de fait à l’apparition d’un « néomonde» gris, univers de boue figurant quel morne paradis, qu’on assiste alors qu’une nouvelle atteinte de La Chose, qui s’en est prise déjà à ce qui constitue l’individu, en attaquant son langage, travaille désormais à l’effacement de tout texte écrit à la surface du globe afin de préparer un nouveau mode de communication indifférencié évoquant le cerveau intégré de la fourmilière, pour reprendre une vieille métaphore contre-utopique.
Or on en revient précisément, ici, en pleine contre-utopie flamboyante, avec les forces régressives de l’Anome, personnalisées par le pseudo-pape Cybion Ier et ses évêques bidons, qui entendent s’approprier le mouvement de dévolution comme n’importe quelle secte vulgaire, à quoi s’opposent les chevaliers de la Juste Cause, dans la foulée du jeune Link de Nova, guitariste « élu » aux pouvoirs guérisseurs, flanqué de ses alliés néo-chrétiens Youri et Campbell, qui demandent crânement le baptême dans la foulée, du Professeur spécialiste en nombres transfinis et de quelques autres initiés de divers grades.
Alors que le Non-Être, essence du mal comme chacun sait, prépare l'avènement du Règne du Faux, Link de Nova, guitare Gibson Les Paul en bandoulière, prêt à faire « chanter le corps électrique de la planète entière » et à l’irradier de la Lumière de son Halo, assume son rôle de Chef d’Orchestre du Camp: grande jonction (il y en a une quantité d'autres qui nourrissent ce titre) entre la Musique et La Foi, sous le signe de Sainte Electricité. Hosanna.
A la grande offensive mortifère visant les textes de la Bibliothèque rescapée, et donc la mémoire vive de l’humanité, s’oppose en outre le combat de Youri, qui a compris que « l’amour était en lui-même l’infini de tous les infinis propice à l'accomplissement de toute individuation », dont la belle Judith sera la Béatrice « dantesque », tandis qu’il incombe au père de Link, Djordjevic l’homme du livre, de produire pour sa part le manuscrit qui empêchera la destruction de ladite Bibliothèque.
Or tout cela, au fil de pages qui retrouvent le souffle et la fulgurance des meilleurs chapitres de Cosmos incorporated, relève d’une réflexion-narration superbement imagée et maîtrisée, dans un espace romanesque de visionnaire à la fois délirant et hyper-contrôlé dont on se réjouit, soit dit en passant de lire American Black Box, la suite du Théâtre des opérations, son journal dont le 3e tome est annoncé pour le début de 2007…
-
Varia 2004, III
En y resongeant avec un peu de recul, je me dis que les oeuvres d’un Joyce ou d’un Michaux relèvent toutes deux, à mes yeux, d’expériences-limites dont l’usage que je puis en faire est lui aussi limité, alors que certaines oeuvres moins géniales me sont beaucoup plus nécessaires et utiles. Ce qui me manque tout de même chez les deux monstres, c’est l’émotion et le naturel. Tous deux ont un peu la stature du mage alchimiste. Il y a certes des tas de choses à grappiller chez l’un et chez l’autre, mais la finalité de chacune de ces oeuvres me semble essentiellement esthétique, alors que je demande à la littérature une autre qualité d’émotion et quelque chose de plus encore que je ne trouve chez aucun des deux.
Très intéressé tout de suite par la nouvelle fresque historico-poétique de Yachar Kemal, dont j’ai lu les cinquante première pages d’une traite avec l’impression physique de me replonger dans une épopée à la Tsernianski, en plus moderne de tournure et de ton. Il y est question d’une île à la fois paradisiaque et maudite, vidée de ses habitants grecs à l’exception d’un seul, et dans laquelle débarque un jeune officier ottoman fringant comme tout. On pense évidemment à Chypre mais de loin, comme c’est de loin qu’on pense aussi à une fable, la réalité du roman s’imposant pour elle-même. C’est vif et passionnant à jet continu, les personnage sont magnifiquement campés et les arrière-plans historiques et politiques donnent toute sa dimension à cette saga.
En recevant de nouveaux paquets des livres de la rentrée, chacun me fait l’effet d’un quidam perdu dans une foule et qui chercherait à attirer mon attention en s’écriant: « Et moi ! Et moi ! Et moi ! » Du coup, cela me fait penser à une nouvelle possible qui pourrait s’intituler Succès d’un jour et qui raconterait cette course à la gloire fugace, à la fois apitoyante et dérisoire, où les noms chassent les noms, les titres les titres.
Un père de famille, dans son chalet de la Lenk, abat son épouse et ses deux petites filles avant de retourner son arme contre lui. L’événement, inattendu dans ce bled alpin sans histoires, a traumatisé l’entourage du couple, bien connu et apprécié. Une cellule de soutien psychologique a été mise sur pied. En remplacement pour deux heures dans un établissement secondaire, un jeune homme de vingt-cinq ans a semé le trouble dans une classe de jeunes filles en parlant sexe et en regrettant de ne pouvoir montrer le sien à ces demoiselles. Diverses mères en ont été bouleversées. Une cellule de soutien psychologique a été mise sur pied.
Reparti dans une aventure de Hiéronymus Bosch, l’enquêteur fameux de Michael Connelly, dont le chemin recoupe celui du non moins fameux poète (voir les épisodes précédents…) Ce qui me plaît là-dedans tient surtout au décor et à l’approche du Mal. L’homme fait le mal parce qu’il aime ça. Ou plus justement je dirai: parce que c’est plus fort que lui. Il jouit sous l’effet d’une force mauvaise. Il recherche une jouissance dont la perversité est l’une des substances constitutives du roman noir.
Repris ce matin la lecture des Conversations avec Antonio Lobo Antunes, qui parle de l’Exhortation aux crocodiles comme de son meilleur livre. Très intéressant éclairage sur la vie de cet écrivain à la fois intègre et lancé dans ce qui me semble tout de même une certaine impasse de langage, tout à fait dans la filiation du de Joyce, et souvent à la limite de l’intelligibilité. Un poète faulknérien en somme. Parle bien de Lorca et de l’essence de la poésie, cristal du verbe. Or, comme pour compenser l’absence chez lui de cette grâce concise, le voici lancé dans un fleuve de prose qui risque souvent de submerger le lecteur.
Me sens proche de Varlin ce matin. Besoin d’objets solides. Impatient de sortir tout ce qu’il y a en moi, en faisant violence à certaine finesse excessive. Pas assez devant la chose. Pas assez physiquement engagé. Trop de choses diverses à la fois. Mais aussi: ma façon à moi de tout embrasser, et ça ne va pas s’arranger.
Deux camps distincts: ceux qui sont généreux, et les autres.
Autre critère: les sérieux et les pas sérieux. A ne confondre sous aucun prétexte avec les qui se prennent au sérieux et les vrais sérieux.
Travaille à un paysage qui tarde à sortir. Mais à un moment donné la peinture prend corps. Devient matière en fusion. Couleur et forme commandent alors, et plus question du motif, ou disons plus précisément: de loin, de mémoire.
Le deuxième roman de Christophe Dufossé, intitulé La diffamation, me semble intéressant, dont me saisit aussitôt la présence latente d’une menace et d’un malaise existentiel diffus, un peu à la manière de Patricia Highsmith. Aussitôt je me dis in petto: voilà un gars sérieux. Le récit de la narratrice, une intello quadra épouse d’un commercial et mère d’un ado surdoué, me rappelle aussi bien, en moins sombre, Le journal d’Edith.
Le Matin de ce matin consacre une page à une vieille dame, à Genève, qui a coupé les ailes à un petit martinet qu’elle a recueilli, pour l’empêcher de la quitter. Touchant en dépit de la cruauté du geste. La femme de chambre a cafté. Les institutions animalières s’indignent.
Un monde sans femme est une horreur, j’entends: sans ma bonne amie, qui incarne à mes yeux le contraire de l’emmerdeuse, genre chienne de garde ou chiffon à poussière. De la même façon, les vieilles grâces de mon roman incarneront toute la tendresse et l’humour seules capables de nous faire supporter la vie en ce bas monde.
En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assasin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait». Je relève la phrase: « Les gens se pourlèchent de ce genre de chose ».
Plutôt que de « crime parfait», s’agissant de Ripley, je dirais: meurtre utilitaire et presque indifférent, pour ne pas avoir d’ennui. Quelque chose de ni chaud ni froid chez Ripley. Monstre fin.
Je me sens très fatigué. Dispersé et las. Toute la journée à la rédaction. Je gagne ma vie, comme on dit. Pas de quoi se plaindre au demeurant. Payé pour faire ce que j’aime, supposant quelques servitudes par mois. Et comme je le disais ce soir à notre ami Saïd: ne voudrais pour rien au monde vivre de subventions ou de bourses, sauf d’une Mécène qui m’entretiendrait avec assez de générosité pour que nous puissions voyager sans cesse et voir un tas de pays et de gens… (En ville, ce vendredi 30 juillet).
C’est presque par hasard que j’ai vu, ce soir à la télévision, un court métrage d’un certain Benjamin Kampf qui m’a fait très forte impression. Sous le titre d’Exit, cela raconte les derniers instants de deux vieillards décidés à en finir ensemble avec la vie. Enfin décidés: on comprend que c’est la femme, dominant son jules, qui l’a convaincu de la suivre dans la tombe alors qu’elle-même, cancéreuse, est condamnée. En présence de l’envoyée de l’agence Exit, alors que la vieille a demandé à son conjoint de leur mettre « leur » disque, sur la musique suave (genre thé dansant suisse allemand) duquel elle l’invite à danser une dernière fois, l’homme se cabre soudain et change d’avis, disant qu’il a encore de la vie à vivre. Du coup, la vieille, vexée et fâchée, avale son verre de substance létale et s’en va s’allonger comme prévu, bientôt suivie par son époux culpabilisés — et les voilà gisant enfin tendrement l’un auprès de l’autre. Dix minutes sans une faille, dans un genre à la fois réaliste et poétique qui m’a rappelé les nouvelles si bonnes et si cruelles d’un William Trevor.
Je relève ceci de tout à fait étonnant dans Ripley et les ombres, qui me touche particulièrement ces jours. C’est un extrait du journal du peintre Derwatt, mort en Grèce et dont une bande d’escrocs, dont Tom Ripley, exploite le génie par le truchement d’un faussaire: «Il n’y a pas de dépression pour l’artiste, hormis celle qui est provoquée par un retour au Moi. Il met une majuscule à Moi. Ce Moi est un verre grossissant, timide, prétentieux, égocentrique, qu’on ne devrait jamais regarder et dont on ne devrait jamais se servir non plus pour regarder quelque chose. De temps en temps il fait des apparitions fugitives, et c’est vraiment horrible: ça arrive entre deux étoiles, pendant les vacances… Des vacance, on ne devrait jamais en prendre». Voilà ce que j’appelle du sérieux. Et cela continue: «Cette dépression se manifeste d’abord par un malaise général, mais aussi par des questions futiles, telles que: pourquoi suis-je sur terre? Ou bien par cette exclamation: comment j’ai raté ma vie! Et par une découverte encore pire, que j’aurais dû faire il y a bien longtemps: je ne peux même pas m’appuyer sur les gens qui sont censés m’aimer au moment où j’ai besoin d’eux. Ce besoin, on ne l’éprouve pas quand le travail marche bien. Je ne dois pas me montrer à eux dans cet état de faiblesse. Je sais qu’on me le relancera, qu’on me le relancerait à la figure plus tard, comme une béquille que j’aurais dû brûler dès ce soir. Que le souvenir de ces nuits sombres ne revive qu’en moi»… Cette bonne femme est décidément un médium.
A un moment donné, dans Ripley et ses ombres, il est question de Tom comme de la « source mystique du mal », et tout est dit je crois.
Au fond Céline ne me plait qu’à moitié. Tandis que Rabelais me plait entièrement. Il y a chez Céline un fond de dureté qu’on pourrait dire du grand mariole. Rien de cela chez Rabelais.
Il y a quelque chose qui me touche directement, droit au système nerveux, chez Edna O’Brien, qui tient à une force, une puissance accumulée touchant à la fois aux sens (au sexe) et aux sentiments, tels qu’on les trouve rarement réunis à cet état de densité et de tension.
Tom Ripley est une sorte d’homme sans qualités à la sauce américaine: sans conscience et sans désir, juste animé par une espèce d’instinct d’adaptation et de conservation, avec une touche esthète qui lui fait apprécier les belles et bonnes choses. Devenu tueur par inadvertance, ou peu s’en faut, il a continué de se défendre en supprimant les obstacles matériels ou humains qui l’empêchent de vivre tranquillement. Je n’avais pas saisi, jusque-là, sa nature complexe, simplement faute d’être allé à la source du personnage, dans Mr. Ripley. C’est là, seulement, qu’on découvre l’origine de ses complexes et de son ressentiment, là qu’on voit que sa vision du monde distante et cynique découle de la carence, dans sa vie d’enfant et d’adolescent, de toute espèce d’amour. C’est en somme un nouvel avatar de l’homme sans qualités et de l’homme du ressentiment, qui s’arrange comme il peut avec l’adversité. Il a commencé de tuer à regret. Puis il a continué quand on l’embêtait…
A tout ce que dit Alexandre Vinet de l’assèchement cérébral des philosophes de profession, je souscris. Mais Vinet voudrait moraliser la littérature, et là je ne le suis plus. Son côté vieille fille, qui prétend que seuls les esprits vulgaires veulent « toucher, palper », alors que ce sont eux, les Ramuz, les Cendrars ou les Cingria, qui marqueront le renouveau de la littérature en Suisse romande.
Me sens de plus en plus libre et, en même temps, de plus en plus lié à ma bonne amie, vraiment le coeur du coeur de ma vie.
Je souris gentiment en lisant L’original d’Yves Laplace, qui ne jurait jadis que par Roland Barthes et les chichis de la modernité (sus au personnage de roman et à toute notion d’histoire, sus à tout investissement personnel) alors qu’il recycle maintenant sa famille dans ses livres, tel ce cousin drogué de sexe qui fut son idole d’enfant et devient le locuteur principal de ce nouveau livre. Laplace rejoint ainsi les écrivains qui m’intéressent à cet égard, tel un Philip Roth qui a toujours joué avec les ressources de l’autofiction tout en restant essentiellement romancier.
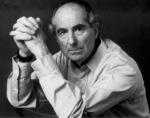 Pas mal de plaisir, et plus encore d’intérêt à la lecture de La bête qui meurt de Philip Roth, même si ce n’est pas de son meilleur tonneau — disons une longue et bonne nouvelle, où il est question des derniers feux érotiques d’un sexagénaire. Finesse de l’observation, intelligence des situations, sérieux du propos mais jamais pédant: c’est l’écrivain actuel qui me semble le plus intéressant, et je ne vois guère à l’heure qu’il est, en France, un seul auteur pour l’égaler. Ce n’est pas un génie (genre Dostoïevski) ni un fondateur de style non plus (tel un Faulkner) mais c’est une sorte de chroniqueur balzacien de la seconde moitié du XXe siècle qui a le mérite d’aborder les grands thèmes sociaux, politiques et psychologiques de notre temps par le truchement de personnages très vivants et attachants. Une Flannery O’Connor touche certes plus profond. Une Patricia Highsmith saisit les tenants de la détresse humaine avec plus de lancinante pénétration. Un William Trevor, en outre, a plus que lui le sens du tragique. Mais Philip Roth, comme un Saul Bellow, et à hauteur égale me semble-t-il, est plus globalement romancier que ces auteurs chers à mon goût.
Pas mal de plaisir, et plus encore d’intérêt à la lecture de La bête qui meurt de Philip Roth, même si ce n’est pas de son meilleur tonneau — disons une longue et bonne nouvelle, où il est question des derniers feux érotiques d’un sexagénaire. Finesse de l’observation, intelligence des situations, sérieux du propos mais jamais pédant: c’est l’écrivain actuel qui me semble le plus intéressant, et je ne vois guère à l’heure qu’il est, en France, un seul auteur pour l’égaler. Ce n’est pas un génie (genre Dostoïevski) ni un fondateur de style non plus (tel un Faulkner) mais c’est une sorte de chroniqueur balzacien de la seconde moitié du XXe siècle qui a le mérite d’aborder les grands thèmes sociaux, politiques et psychologiques de notre temps par le truchement de personnages très vivants et attachants. Une Flannery O’Connor touche certes plus profond. Une Patricia Highsmith saisit les tenants de la détresse humaine avec plus de lancinante pénétration. Un William Trevor, en outre, a plus que lui le sens du tragique. Mais Philip Roth, comme un Saul Bellow, et à hauteur égale me semble-t-il, est plus globalement romancier que ces auteurs chers à mon goût.Dans une vaticination assez fumeuse de la fin des années 50, Céline affirme que le roman contemporain n’a plus rien à nous apprendre, dans la mesure où toute information est désormais filée par le journalisme. Je crois, pour ma part, qu’il a tort, et les romans d’un Philip Roth en sont une bonne illustration.
En lavant ce soir quelques aquarelles sur le balcon, j’écoute Michel Onfray, sur France-Culture, qui parle de La Boétie pour l’opposer à Montaigne. Grosso modo, La Boétie est à ses yeux le génie révolutionnaire inaperçu, tandis que Montaigne est le réactionnaire qui soumet son ami à une certaine censure tout en exaltant leur amitié par le fait d’une de pose antique. Sottises de cuistre.
En lisant La bête qui meurt, et plus précisément l’épisode de la fin de George, le meilleur ami du narrateur qui, dans une suite de gestes ultimes, baise tous ses proches sur la bouche et entreprend de déshabiller sa femme en public, je me suis rappelé les derniers gestes de notre chère Elsa, dansant sur son lit en s’exhibant. Ce dernier amour me fait également penser à La tache (page 85 et suivantes) et, dans La mort à Venise, au dernier émoi du vieil écrivain. La fin de ce petit roman, au tournant de l’an 2000, lorsque sa jeune amante vient relancer David pour lui annoncer qu’elle a un cancer du sein et lui demander de prendre une dernière fois sa poitrine en photo, est également très émouvante.
Commencé la journée en courant après les trois ânes du pré voisin, qui ont fui pendant la nuit et paissaient deux étages plus bas. Ensuite, buvant mon café, je me suis dit que je devrais être beaucoup plus attentif, dans ces carnets, aux faits divers significatifs de l’époque (je ne pense pas aux ânes mais aux hommes, bien plus égarés que ceux-là).
Hier soir relevé une fois de plus, dans sa chronique du Figaro littéraire, la mauvaise foi teigneuse de l’académicien Angelo Rinaldi, qui consacre la moitié de son éreintée de Philip Roth (réduit aux dimensions infimes d’un pornocrate) à régler un compte avec son confrère Jean-Paul Enthoven. Sans dire un mot intelligent des derniers livres du romancier américain, notre pontife blessé (par le fait qu’Enthoven lui reproche son incapacité d’apprécier un roman hétérosexuel) se ridiculise décidément en se justifiant, qui plus est au détriment d’un écrivain qui le surclasse infiniment… Sa façon de grouper M. Kundera et M. Roth pour les rejeter avec dédain rappelle les vieilles ganaches de la critique bourgeoise la plus bornée.
Dans le train, observant la foule des gens, des Japonais, des mères et leurs enfants turbulents, des retraités en balade, tous ces braves gens, et jusqu’à l’insupportable tapeur à cigarettes au bec (six francs le paquet…) qui s’en vient harceler les voyageurs en arguant qu’il n’a pas deux francs pour son billet, je me rappelle le brave monde et je souris.
Je perds encore mon temps et me reproche d’être encore trop accessible aux raseurs. J’ai pourtant fait des progrès. J’ai désormais mon arsenal de ruses et de parades. Où l’on constate une fois de plus que l’homme est perfectible.
Renaud Camus parle de sexe comme d’une espèce d’hygiène, mais on sent assez qu’il en souffre aussi. Jamais si simple qu’on le voudrait. Philip Roth rend mieux la chose, mais le sexe hétéro est naturellement plus compliqué que le sexe homo à base narcissique et non sentimentale. A vrai dire j’ai horreur de la façon dont ce Renaud Camus parle de ça.
 Dans ses Désaxés, Christine Angot me semble avoir sombré dans une écriture de roman-photo. C’est à vrai dire pathétique, complètement artificiel et pis encore: aphone.
Dans ses Désaxés, Christine Angot me semble avoir sombré dans une écriture de roman-photo. C’est à vrai dire pathétique, complètement artificiel et pis encore: aphone.Ce qui me séduit et m’intéresse chez Michel Serres est sa grande capacité de synthèse et de mise au net poétique, qui frise parfois la belle rhétorique, mais la frise seulement, tant on sent là-dessous une connaissance nourrie, une expérience vivante et une santé. Cela d’ailleurs me semble décisif: qu’il est resté près de la nature. Il vient de la mer et va aux glaciers, il va et vient de l’air à la terre.
Assez impressionné par la lecture de Suite française d’Irène Némirovsky, et plus encor: ému. Penser que cette femme, se sachant menacée de mort par les nazis, et préparant la survie de ses deux petites filles, ait trouvé l’énergie d’écrire ce grand livre est réellement bouleversant. Et voilà, me dis-je aussi: chaque fois que le découragement menace, tel geste humain nous fait relever le front.
Bartabas, roman de Jérôme Garcin, d’une très belle écriture, rend magnifiquemenet l’aura de ce très singulier personnage d’artiste à la fois barbare et raffiné.
Une lettre que je reçois ce matin me touche, de Nancy Huston qui me dit son enthousiasme à la lecture des Passions partagées, son sentiment de proximité existentielle (nous avons eu nos enfants à peu près à la même époque) et littéraire (elle nous sent souvent sur la même longueur d’ondes). A ce propos, elle a dû se sentir aussi consternée que moi, ce midi, en apprenant que le Nobel de littérature venait d’être attribué à Elfriede Jelinek, cette peste noire. dont elle a si bien décortiqué les tenants du nihilisme… (En ville, ce 7 octobre).
En même temps que je lis le bouleversant petit livre de P.E. Thomése, L’enfant ombre, évoquant la perte d’une petite fille, en alternance avec les essais de Nancy Huston, j’écoute pour la énième fois le concerto pour violon de Beethoven en ré majeur, dont je connais chaque note et qui me donne l’impression de parcourir toute le gamme des sentiments, grâce aussi à la « voix» de Gidon Kremer. Beethoven me bouleverse « dans la masse », si j’ose dire, alors que Brahms ou Schubert me touchent d’une façon plus intime et personnelle, plus essentiellement émotionnelle. Je vois en la musique de Beethoven une musique de « père » tandis que Mozart, Schubert, Schumann et Brahms sont à mes yeux des « fils ».
Evoquant Romain Gary, qu’elle qualifie de « grand impur », Nancy Huston se qualifie elle aussi de « corps étranger ans la littérature française, et c’est exactement l’impression que j’ai toujours éprouvée en ce qui me concerne, comme ce devait être le cas d’un Louis Calaferte…
Lisant ce soir le travail sur lequel ma bonne amie s’échine depuis des semaines, je suis touché par ce qu’il y a là-dedans non seulement d’intéressant, dans le rapport de l’enseignant avec le langage, mais aussi et surtout de personnel dans ce qu’elle module, en s’aidant de son expérience de la difficulté de communiquer et de ses lectures, notamment de Jung, de Pontalis et de Michel Serres.
En lisant Le temps des loups blancs d’Anne Cuneo, je constate que son récit, apparemment si terre à terre, à l’opposé diamétral de l’écriture d’un Cingria, aboutit néanmoins, avec l’évocation de ce dernier, à l’une des meilleures descriptions de Lausanne entre les années 50 et les années 70. Rien chez elle de littérairement brillant, mais elle tire de ses peines d’enfant et de jeune fille quelque chose de tout aussi important à mes yeux que l’éclat ou les surprises d’un style, et cela finit bel et bien par rejoindre la littérature, avec une sorte de poésie.
J’ai vu cet après-midi le film de guerre le plus original et le plus émouvant à ma connaissance, intitulé Kippur et réalisé par l’Israélien Amos Gitai. Jamais je n’ai ressenti l’engagement physique et moral de la guerre avec autant d’intensité et autant d’émotion, et jamais un tel mélange d’absurdité générale et de compétence personnelle, avec cet extraordinaire lien de solidarité entre tous les jeunes gens jetés au front.
Le Je est une affirmation du courage existentiel. Je suis. Je suis donc je pense.
Trois heures et demie du matin. Réveillé par un drôle de rêve. Adolescence en bande et confusion. Ensuite visions de dissolution. Et cette pensée: que la dissolution est l’Ennemi. L’Ennemi qui rôde et raille. Le Satan qui disperse. Le diabolo toupie. D’un autre point de vue l’on dira que ce sont les violents qui l’emportent, et pourtant quelque chose se prépare en secret.
Et ce quelque chose est ceci: mon travail de ce matin. Décrié par celui qui ne veut pas se lever. Décrié par celui qui pense que cela ne vaut pas le coup. Plus le coup. Que tout est foutu de toute façon. Décrié par celui qui ne veut pas seulement pas faire mais qui voudrait empêcher que quiconque fasse.
Saint Paul aux Romains: tu veux te glorifier, ce n’est pas toi qui portes le racine, c’est la racine qui te porte.
Dans Kippur l’ennemi est invisible. Le seul ennemi semble la guerre elle-même. A la fin ne reste qu’un imbroglio de traces de chenilles et de roues dans la terre ensanglantée. Mais la nécessité de la solidarité, n’est jamais mise en doute.
La conscience moderne, selon Michel Serres, naît avec saint Paul. Dans Hominescence, il disait que c’était avec Augustin. Il se corrige dans Rameaux. Nouvelle pousse. Intéressant de noter la progression.
Paul est l’apôtre des gentils, à savoir: des étrangers.
Peu importe que je ressuscite avant ou après la mort. Ce qui compte est que je ressuscite pour annuler la mort.
Le fils a été chassé par le Père de la Genèse pour le faire échapper au paradis formaté, puis il est revenu au Père dans l’Evangile de Luc, en fils prodigue.
Ce que Michel Serres appelle « la libido d’appartenance » qui fait « aussi mâle rage que chez les rats », je l’ai vue à l’oeuvre de tout près et je crois en avoir été guéri pour jamais.
Répondre au bruit par le silence.
Péguy: «Le génie étant de l’ordre de la nature, le travail du génie et de l’ordre du travail de la nature, toute élaboration du génie est une élaboration naturelle, toute invention, tout renouvellement du génie vient par cette arborescence que nous avons reconnue».
Les Etats-Unis sont actuellement noyautés par une maffia politico-financière dont nous avons découvert ce soir, dans un passionnant documentaire, de nouveaux aspects effrayants. Sous le couvert de la religion et de la démocratie, le gouvernement Bush est de toute évidence une association de malfaiteurs à grande échelle, ce que ses idéologues appellent eux-mêmes un Etat-voyou en désignant l’Irak ou la Corée du nord, en attendant qu’il se fige en dictature à parti unique du type décrit par Orwell dans 1984.
Le conteur noue l’attention.
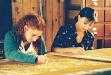 Brodeuses, beau petit film d’Eléonore Faucher, évoque la relation d’abord méfiante et de plus en plus complice, ensuite, de deux femmes malmenées par la vie et dont on pourrait dire qu’elles finissent par s’adopter. Cela commence dans une lumière assez acide, par des scènes vibrantes d’agressivité tous azimuts typique de la « dissociétéé » dans laquelle nous vivons, puis la bonne nature de la plus jeune (qui semble d’abord la plus cynique), impressionnée par l’art de brodeuse de son aînée, la sauvant d’une tentative de suicide et l’accompagnant dans son retour à la vie, et la reconnaissance de l’aînée font évoluer la lumière du film, pourrait-on dire, vers une sorte de nouvelle lumière qui rejaillit sur l’entourage des deux femmes. Rien pour autant d’artificiellement optimiste dans cette métamorphose, de démonstratif ou de lénifiant, mais je n’ai pas craint de parler d’amour pour qualifier les qualités de fond et de forme de ce film qui me semble assez proche de l’esprit des jeunes cinéastes de ma connaissance.
Brodeuses, beau petit film d’Eléonore Faucher, évoque la relation d’abord méfiante et de plus en plus complice, ensuite, de deux femmes malmenées par la vie et dont on pourrait dire qu’elles finissent par s’adopter. Cela commence dans une lumière assez acide, par des scènes vibrantes d’agressivité tous azimuts typique de la « dissociétéé » dans laquelle nous vivons, puis la bonne nature de la plus jeune (qui semble d’abord la plus cynique), impressionnée par l’art de brodeuse de son aînée, la sauvant d’une tentative de suicide et l’accompagnant dans son retour à la vie, et la reconnaissance de l’aînée font évoluer la lumière du film, pourrait-on dire, vers une sorte de nouvelle lumière qui rejaillit sur l’entourage des deux femmes. Rien pour autant d’artificiellement optimiste dans cette métamorphose, de démonstratif ou de lénifiant, mais je n’ai pas craint de parler d’amour pour qualifier les qualités de fond et de forme de ce film qui me semble assez proche de l’esprit des jeunes cinéastes de ma connaissance.En assistant à cette fuite en avant dans l’exhibition privée qui caractérise les médias, je me dis que cet étalage est par excellence l’opposé d’une culture de l’aveu. On se déboutonne, on déballe — pour ne rien dire. On ne dit que ce qui conforte la norme ambiante, et jusqu’à celle qui se pose en anti-norme, comme l’illustre la nouvelle confrérie hyper-conformiste des gays. L’aveu est l’affirmation d’une personne unique, alors que ces gens qui prônent leur différence ne font que niveler tout particularisme. Ils n’aimeraient rien tant que leur différence devînt la nouvelle norme établie.
-
Les enfants perdus
Elle avait l’air
d’une petite fille endormie,
la toute vieille dame
au bord de la nuit,
et c’est ainsi que nous l’avons quittée.
Ainsi qu’elle nous a quittés,
cette nuit,
en catimini ;
comme quand, au Jeu,
elle se cachait.
Et ce matin,
c’est nous qui sommes
tout petits,
comme perdus
dans la forêt… -
Notes panoptiques 2005, V
On entre dans Cosmos incorporated comme dans un cauchemar éveillé avec la sensation de participer psychiquement et physiquement à la genèse d’un espace-temps et d’un personnage se construisant à vue. D’emblée on ressent la même oppression que dans les premières pages de 1984, à cela près que la surveillance n’est pas ici que du Dehors bigbrotherisé mais de partout, puisqu’on vous scanne jusqu’à l’ADN et qu’on vous manipule du Dedans par contrôle d’information.
Le cauchemar a des dehors fascinants de film psychique hyperplastique, dont le début est une genèse en raccourci, lumière rouge et matière blanche, œil émergeant de la soupe originelle avec un iris scellant l’identité de l’Adam apparu dans le portique de contrôle, plus exactement prénommé Sergueï Diego Dimitrievitch, Plotkine de son nom, né en 2001 en Sibérie et en principe âgé de 56 ans mais en réalité deux fois plus jeune à la suite de deux cures de rajeunissement transgéniques. Tout cela qu’il apprend en même temps que le lecteur, et c’est la première belle idée du livre: que le premier personnage émerge du chaos (des «années noires» qui ont fait 500 millions de morts en quatre décennies) sans avoir connu jusque-là que la guerre et se découvrant pourtant des souvenirs d’enfance en Sibérie et ailleurs (il aurait donc vécu en Argentine?) avant de se rappeler sa première mission.
Avec la première esquisse du personnage commence de se brosser une fresque spatio-temporelle assez saisissante, à la fois très maîtrisée dans les grandes largeurs et passionnante par les multiples observations qui la nourrissent. On est là dans une espèce de monde-fourmilière-cerveau où les hommes sont en train de se transformer en machines, à un point de l’Histoire où l’involution se concrétise à la fois par ce déficit de l’élément humain et par la dégringolade de la démographie, entre autres composantes du désastre généralisé, dont le «retournement» du progrès lui-même.
Je n’en suis à l’instant qu’à la page 67, mais cela me semble très bien parti, très dense et dégageant une espèce de sombre beauté…°°°
 Il est cinq heures du matin en ce fuseau de l’Hémisphère nord et noir est l’encrier du monde dans lequel se prépare la chronique du profond Aujourd’hui. Tout à l’heure je secouerai Winnie qui va se pointer en grommelant et prononcera au premier rai de jour la phrase rituelle: «Encore une journée divine». En attendant je me rappelle les visions de catastrophe de ce livre que je lisais hier et que je vais continuer de lire tout à l’heure en me disant: foutaises, mais penser à cela tout le temps.
Il est cinq heures du matin en ce fuseau de l’Hémisphère nord et noir est l’encrier du monde dans lequel se prépare la chronique du profond Aujourd’hui. Tout à l’heure je secouerai Winnie qui va se pointer en grommelant et prononcera au premier rai de jour la phrase rituelle: «Encore une journée divine». En attendant je me rappelle les visions de catastrophe de ce livre que je lisais hier et que je vais continuer de lire tout à l’heure en me disant: foutaises, mais penser à cela tout le temps.°°°
Il a fallu que je me sente les mains d’une mère, une aube pareille de l’automne 1982, il a fallu que je me prenne pour Gaïa accouchant d’une mortelle pour que, mec sans imagination jusque-là, je découvre la beauté de la vie et notre sort de mort à tous. Je savais certes déjà la beauté de la vie mais je n’avais pas eu la révélation de la mort en dépit de tous les morts que j’avais de mes yeux vus, et soudain un enfant m’avait enfanté en seconde naissance, et voilà que je découvrais ce lieu commun de toute éternité que nous sommes mortels et que c’est tout les jours, peut-être tout à l’heure et voici la divine journée.
°°°
Moi l’un me dit que nous allons vers la catastrophe, cependant que Moi l’autre sourit au jour qui vient. Moi l’un qui reste une espèce d’adolescent teigneux, genre Christ beatnik, voit l’Ange exterminateur se démantibuler au-dessus des pylônes en flammes, tandis que Moi l’autre, enfant et vieux sage à la fois, lui rétorque qu’il se fait du cinéma. Moi l’un le fils est en colère, comme tous les matins du monde les fils, tandis que Moi l’autre, le père du monde qui en a vu d’autres, s’apprête à entonner le Psaume du 23 septembre 2005 qui commencera par un solide café et des biscuits pour la route au chien Filou.
Au programme de mes lectures ce sera Dantec et Shakespeare ou Proust par manière de contrepoison. Ce sera l’humour de la vie contre les visions hallucinées, ce sera la prairie d’à côté à faucher contre l’idée que la prairie sera vitrifiée l’an prochain, ce sera le regard doux du chien Filou et la tendre chair de Winnie contre les vitupérations du prophète. Oh le beau jour qui vient sur la mule du vieux Sam…
 Que pense le chien Filou du Grand Djihad? Pense-t-il que cette conjecture de Maurice G. Dantec ait plus de consistance que celle des hordes chinoises déboulant sur les collines de Meudon telle que la prophétisait Céline? Je me le demande, en cette matinée radieuse de votations démocratique sur la libre circulation des personnes, comme je me l’étais demandé en lisant Forteresse de Georges Panchard, où il était déjà question de la dévastation de l’Europe par une nouvelle croisade islamiste. Tout cela, cher Filou, ne relève-t-il pas du fantasme délirant?
Que pense le chien Filou du Grand Djihad? Pense-t-il que cette conjecture de Maurice G. Dantec ait plus de consistance que celle des hordes chinoises déboulant sur les collines de Meudon telle que la prophétisait Céline? Je me le demande, en cette matinée radieuse de votations démocratique sur la libre circulation des personnes, comme je me l’étais demandé en lisant Forteresse de Georges Panchard, où il était déjà question de la dévastation de l’Europe par une nouvelle croisade islamiste. Tout cela, cher Filou, ne relève-t-il pas du fantasme délirant?
Le premier enseignement du chien Filou, au lendemain de son entrée dans notre maison, a été de me rappeler la force de la douceur, retenant la main qui frappe. Nous étions en balade dans les bois, je l’avais rappelé trois fois, il n’avait pas obéi, gamin qu’il était encore, donc je le frappai de ma canne ferrée lorsqu’il revint penaud, et alors il me fit cet œil noir de pacifiste: on ne frappe pas le chien Filou, disait cet œil. Sur quoi l’animal se ferma à toute négociation jusqu’au coucher, me préparant visiblement un chien de sa chienne. Le lendemain matin, aux aubes, une merde m’attendait au milieu de mon atelier, et Filou assis sur ses pattes me toisait avec ce message triomphal dans son regard de scottish ressentimental: «Je t’emmerde». C’était l’époque de la fin de la guerre balkanique, après les tueries de Bosnie et avant celles du Kosovo. Mes amis serbes me taxaient de fiote angélique, et moi je les emmerdais, prêt en somme à m’entendre avec Filou. Mais que pense donc Filou du Grand Djihad?°°°
A l’instant Filou reluque la mésange Zoé qui lui picore ses croûtons, tandis que je lis Du Jihad à la Fitna de Gilles Kepel, dont Sophie m’a déchiffré l’inscription de couverture: «Il n’y a Dieu que Dieu, Mohammed est son prophète».
 Aux dernières nouvelles, notre enfant ne semble pas sur la voie de porter le voile, mais c’est en somme à l’école de Filou qu’elle a appris elle aussi la force de la douceur (connaître pour mieux comprendre et discuter, voire disputer). Or que dit Gilles Képel?
Aux dernières nouvelles, notre enfant ne semble pas sur la voie de porter le voile, mais c’est en somme à l’école de Filou qu’elle a appris elle aussi la force de la douceur (connaître pour mieux comprendre et discuter, voire disputer). Or que dit Gilles Képel?
Qu’il y a Jihad et Jihad. Que la source du terme signifie effort, et d’abord dans la réalisation de la perfection individuelle. La dimension positive du jihad réside en cela qu’il «permet de se dépasser en tendant vers le Bien». Comme on le sait cependant, l’effort implique aussi la visée militaire et guerrière «pour étendre l’emprise de l’islam», qui peut aboutir à la discorde originelle de la fitna, liée aux débuts conflictuels de l’islam- la fitna désignant plus précisément la guerre à l’intérieur de l’isl, dès le schisme entre sunnites et chiites. Rappelant les composantes spécifiques de l’expansion de l’islam, Gille Kepel en illustre à la fois la dynamique, soumise à l’autorité des oulémas, et la transformation récente de cette instance de contrôle et de décision. «Le droit et la logique du déclenchement du jihad ont été déstabilisé par la révolution de l’information et c’est là ce qu va nous amener à la situation d’excès, de désordre, de terrorisme, que l’on connaît aujourd’hui». Et de montrer ensuite comment, niant l’histoire, les jihadistes contemporains s’efforcent de rejouer la geste du prophète en s’appuyant sur Internet «qui abolit l’histoire et l’espace». C’est dans les années 80, lors de la défaite de l’URSS en Afghanistan, que Gilles Kepel situe ce «bouleversement complet à proclamer le jihad», alors que commençaient de proliférer les guérillas-jihads initialement soutenues par les USA et qui se retourneraient bientôt contre ceux-ci.
Ce que montre ensuite Kepel, à la lumière des événements d’Algérie notamment, c’est comment la société civile s’est désolidarisée des jihads des années 1990. A propos de cet échec, il cite le grand idéologue d’al-Qaida, l’Egyptien Ayman Al-Zawahiri, lié à l’assasinat de Sadate puis devenu compagnon de Ben Laden en Afghanistan, qui publia en décembre 2001 un pamphlet dans un quotidien arabe de Londres où il affrmait: «Nous avons échoué à mobiliser les masses, nous n’avons pas réussi à faire comprendre notre mesage, les masses se sont détournées de nous et il faut que nous les réveillions par des opérations spectaculaires», ce qu’il appelle des «opérations martyres».
Celles-ci suffiront-elles à déclencher le Grand Djihad que prophétise Maurice G. Dantec dans Cosmos incorporated? Je discerne un doute dans l’œil du chien Fellow. Va-t-on aujourd’hui, en Irak, vers un jihad qui va mobiliser les masses comme l’espère Zawahiri? Ou bien est-ce ceux qui sont contre ce jihad, relevant de la fitna, qui mobiliseront les sociétés civiles contre les fauteurs de violence?
Le chien Filou se retient de se jeter sur la mésange Zoé, mais c’est avec la dernière détermination que je vais me lancer, tout soudain, dans mon projet d’extermination des dernières berces duCaucase au lait venimeux qui prolifèrent le long de notre chemin de pacifistes.
 L’exergue de William Blake annonçait la couleur: «There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her»… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on pressent initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre.
L’exergue de William Blake annonçait la couleur: «There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her»… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on pressent initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre.
Le seul nom de Blake évoque des visions, et c’est la dominante aussi de Cosmos incorporated, dont les tableaux successifs établissent une atmosphère poétique tout à fait particulière, dont l’écho porte au-delà de la seule tension de thriller futuriste. Cela pourrait faire kitsch ou toc, et d’autant plus que s’y greffent moult références au rock des années 80 que le lecteur n’«entend» pas forcément, et pourtant on avance là-dedans avec une curiosité croissante, comme happé par ce dédale spatio-mental envoûtant, produisant l’effet hyperréel des rêves. Le parcours de la Heavy Metal Valley, où s’entassent des millions de carcasses de voitures du siècle précédent, et dans lequel Sergueï découvre des reliques de culte chrétien, semble ainsi communiquer avec ses rêves, comme le feu de ceux-ci se prolonge dans l’hôtel Laïka où il découvre une post-adolescente en flammes qu’il vient d’apercevoir en songe. Or tout cela, qui pourrait être lourdement symbolique ou carrément insupportable, dans le genre chromo new age, dégage un réel mystère et une beauté crépusculaire réellement prenante.
Au seuil de la deuxième partie de Cosmos incorporated, je suis à la fois perplexe et très intéressé par la suite de ce curieux roman, mêlant l’attrait apparent d’un récit de SF et, crescendo, l’enjeu d’un autre type de littérature à caractère symbolico-mystique. Dieu sait que le wagnérisme artistique, les pompes symbolistes à la Gustave Moreau, pis encore: la littérature de prétendus Grands Initiés ne m’ont jamais transporté, mais une fois encore je suis curieux de voir où nous conduit ce drôle d’apôtre de Dantec…°°°
Les mots sont une chose, mais la couleur me manque depuis quelque temps, et l’aquarelle n’est pas autre chose à mes yeux: c’est la couleur.
C’est une énigme que la couleur. J’ai beau savoir qu’elle s’explique scientifiquement: je ressens tout autre chose, et qui n’a rien à voir avec la symbolique, la psychologie ou l’ésotérisme.
Chez moi la couleur est une composante de l’affectivité et de l’Eros, c’est une manifestation dionysiaque, mais pas en aquarelle – ou rarement, car l’aquarelle telle que je la pratique est essentiellement apollinienne. Il y a cependant une aquarelle qu’on pourrait dire de fusion et qui rejoint alors l’huile la plus «érotique», ainsi que l’illustre le mieux, me semble-t-il, un Turner. Mais assez de mots: passons à la chose…°°°
J’étais sur le point de laisser tomber. Dantec me semblait en train de se planter. A la page 264 j’ai lu cette phrase: «L’extension maximale du surpli dévoilé au «monde», l’expansion soudainement formatée de sa «conscience» au sein d’une matrice de signifiants ne surcodant plus qu’eux-mêmes, provoquaient en réaction une condensation infinie du point de rupture, c’est-à-dire le moment où tout dans son corps-esprit devenait point de rupture, le moment où le Néant-Être qu’elle était devenue faisait place à l’invasion globale du Monde, et de la souffrance – physique, psychique, absolue – qui lui est corrélative».
 Allais-je donc avaler cette sorte de galimatias? Avant que je ne me décide à renvoyer Dantec à ses fumeuses cogitations, celles-ci se dissipaient soudain par un retournement du récit où tout, de la première partie du roman, allait prendre un sens nouveau, tandis que le voile se levait sur la genèse même et le projet du livre.
Allais-je donc avaler cette sorte de galimatias? Avant que je ne me décide à renvoyer Dantec à ses fumeuses cogitations, celles-ci se dissipaient soudain par un retournement du récit où tout, de la première partie du roman, allait prendre un sens nouveau, tandis que le voile se levait sur la genèse même et le projet du livre.
On a dit que Faulkner consommait l’irruption de la tragédie grecque dans le roman noir. De la même façon, on pourrait dire que Cosmos incorporated marque la fusion du roman d’anticipation, de la contre-utopie et de la mystique judéo-chrétienne.
Plus précisément on découvre, dans la seconde partie du roman, que celui-ci est né dans l’imagination fertile d’une jeune fille de feu tombée du ciel, née sur un Anneau orbital sis à 500 km de la terre, sérieusement instruite en matière de tradition théologique, autant que son frère est ferré en littérature, et qui a entrepris de créer un Golem avec la complicité momentanée d’un agent logiciel qu’elle baptise Métatron, ange gardien de Sergueï constituant la réplique futuriste du prophète biblique Enoch…°°°
Un cuistre teigneux, probablement second couteau de la bande des «ramuziens» commis à la préparation des Œuvres complètes ou des deux volumes de La pléiade à paraître ces prochains jours, m’attaque dans le courrier des lecteurs de 24Heures, ne supportant pas que j’aie ironisé sur le caractère «scientifique» du Chantier Ramuz. On voit de mieux en mieux que ce qui importe le plus à ces gens-là n’est pas de défendre et d’illustrer une grande œuvre littéraire mais de se poser en spécialistes exclusifs de la chose, tels les Docteurs de la loi.
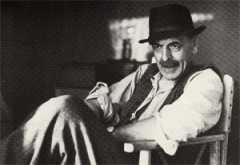 Je me suis bien diverti, en lisant le quatrième volume de la monumentale Histoire de la littérature romande, dirigée par Roger Francillon, de constater que cet ouvrage à prétention «scientifique», précisément, dérivait autant que ceux des temps précédents dans le parti pris et les assertions arbitraires, voire parfois le règlement de compte, particulièrement sous la plume de jeunes auteurs imbus de scientificité.
Je me suis bien diverti, en lisant le quatrième volume de la monumentale Histoire de la littérature romande, dirigée par Roger Francillon, de constater que cet ouvrage à prétention «scientifique», précisément, dérivait autant que ceux des temps précédents dans le parti pris et les assertions arbitraires, voire parfois le règlement de compte, particulièrement sous la plume de jeunes auteurs imbus de scientificité.
Pour ma part, je n’ai rien contre les écarts «subjectifs» de tel ou tel critique, mais que celui-ci se prévale de son autorité «scientifique» pour légitimer ses jugements me paraît fort de café. Cela me rappelle furieusement notre ami Alexandre Zinoviev, qui balayait toute la littérature russe contemporaine sous prétexte qu’elle n’était pas «scientifique», étant entendu que la sienne seule l’était. Or précisément, ce qui nous intéressait dans son œuvre était cela même qui échappait à la «science». Au reste on la vu dans l’évolution de son travail littéraire autant que dans ses jugements sur l’époque: lui qui se prétendait scientifiquement rigoureux a proféré tout et son contraire avant de s’enfoncer dans une spirale paranoïaque à mes yeux significative…°°°
 On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais mordu jusque-là à Dantec, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose à la masse, sans discerner vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant de substances nocives.
On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais mordu jusque-là à Dantec, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose à la masse, sans discerner vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant de substances nocives.
Or Cosmos incorporated correspond à ce que j’attends d’une nouvelle forme de narration, à la fois entée sur le Grand Récit des littératures et de la science dont parle Michel Serres, poreux au présent et pariant pour une possible écriture à venir, qui passe ici par la (ré) incarnation d’un personnage de notre monde déchu (genre tueurrusse de téléfilm) en figure de héros vivant une «nouvelle enfance».
Il y a du génie visionnaire à la Tarkovski et à la Burroughs dans l’exploration de la ville contaminée de Neon Park, à la fois dépotoir électrifié en surface et souterrain dostoïevskien, où Slotkine passe avant de repérer, au bord d’une rivière, une vieille voyante orphique fumeuse de pipe et le chien Balthazar qui «agit comme un chien» mais «parle comme un homme, au moment où les hommes se conduisent comme des porcs et parlent comme des machines».
Ce livre me rappelle une injonction qui me tient lieu de vieille conviction de post-adolescence, résumée par le titre d’un roman de Miroslav Karleja lu dans ma vingtaine et intitulé Je ne joue plus. C’est cela qui arrive à Plotkine, à la fois à son corps défendant (il est choisi, désigné, inventé par Vivian) et de son libre choix assumé. Il sait maintenant qu’il doit trahir ce qu’il a été, «dépouiller le vieil homme» comme disait l’autre, reconnaissant la nécessité absolue de «la trahison de tout ce qui désintègre en permanence la liberté dans l’espace grand ouvert de la Métrastructure de Contrôle et de l’ensemble de ses rhizomes, mafieux, flicards, humanitaires, culturel, techniques». Quand on se sent pris dans ce filet on sort son poignard et ensuite seulement on peut écrire… Quand Dantec écrit qu’«amour et trahison du monde allaient de pair» et qu’il repère un «temps discret» courant de L’Aquinate et Leibniz à l’espace-temps d’un nouveau récit «en douce», tout cela censé marquer une «réunification poétique de l’être» en suivant la souple marche d’un chien, je balance un clin d’œil à mon compère Fellow et je souris aux anges…
 Il est assez rare, par les temps qui courent, de se trouver en présence d’un génie créateur en activité (comme on le dirait d’un volcan), mais c’est exactement l’impression que me fait, en crescendo, la lecture de Cosmos incorporated, dont la réflexion que Dantec développe sur l’à-venir de l’humanité, sur le Mal qui la menace d’anéantissement et sur le mystère de l’Être, me paraît sans équivalent dans le roman contemporain. Ce livre peut donner l’impression d’un fumeux échafaudage de conjectures techno-scientifiques et de spéculations mystico-philosophiques, voire d’un indigeste brouet mêlant rogatons de contre-culture (de Burroughs aux Stooges), visions catastrophistes et relents de théologie patristique, dans le genre bric-à-brac new age, mais une lecture sérieuse révèle, je crois, un livre sérieux. Sans même parler de l’artefact, signalant une incroyable maestria dans la combinatoire narrative, c’est un livre qui danse en même temps qu’il pense, illustrant de manière presque ingénue (c’est le fait du genre investi, avec tout le décorum propre à la SF de haute volée, genre Greg Egan ou Philip K. Dick) une réflexion aux fondements sûr et des intuitions de véritable poète, au sens d’une poésie cristallisant tous les savoirs au cap extrême de l’Aporie.
Il est assez rare, par les temps qui courent, de se trouver en présence d’un génie créateur en activité (comme on le dirait d’un volcan), mais c’est exactement l’impression que me fait, en crescendo, la lecture de Cosmos incorporated, dont la réflexion que Dantec développe sur l’à-venir de l’humanité, sur le Mal qui la menace d’anéantissement et sur le mystère de l’Être, me paraît sans équivalent dans le roman contemporain. Ce livre peut donner l’impression d’un fumeux échafaudage de conjectures techno-scientifiques et de spéculations mystico-philosophiques, voire d’un indigeste brouet mêlant rogatons de contre-culture (de Burroughs aux Stooges), visions catastrophistes et relents de théologie patristique, dans le genre bric-à-brac new age, mais une lecture sérieuse révèle, je crois, un livre sérieux. Sans même parler de l’artefact, signalant une incroyable maestria dans la combinatoire narrative, c’est un livre qui danse en même temps qu’il pense, illustrant de manière presque ingénue (c’est le fait du genre investi, avec tout le décorum propre à la SF de haute volée, genre Greg Egan ou Philip K. Dick) une réflexion aux fondements sûr et des intuitions de véritable poète, au sens d’une poésie cristallisant tous les savoirs au cap extrême de l’Aporie.
Sous le titre de Process, la troisième partie de Cosmos incorporated introduit le personnage de l’Homme-Machine, planqué dans le dôme sommital de l’Hôtel Laïka, sous la forme semi-apparente d’un spectre d’enfant doté de tous les sexes et de 99 noms virtuels, le 100e étant à deviner par le lecteur féru en démonologie… On peut y voir en effet l’incarnation du Non-être, qui n’a plus de sexualité, juste bon à l’assouvissement virtuel de son gardien pervers, ni de nom personnel, l’Enfant-Machine étant la métaphore de l’Innommé ou de ce que Maurice Blanchot appelait «l’indestructible infiniment détruit».
Un chroniqueur distrait des Inrockuptibles a cru voir dans ce livre un illisible salmigondis: le contraire serait étonnant, s’agissant d’un roman qui jongle avec les dernières théories de la physique quantique et les intègre (le saut à la supercorde…) dans sa narration avec autant d’humour qu’il recycle à sa façon la théologie apophatique de Nicolas de Cues ou la controverse sur le monopsychisme opposant Thomas d’Aquin et Averroès…
Or ce qui est assez éberluant là-dedans, c’est que la vision globale du livre est d’une cohérence que je dirais essentiellement poétique, où la réflexion basique sur l’aliénation de l’homme à la Métastructure-Machine se vit comme dans un roman de chevalerie christo-futuriste, avec les Gentils qu’on aime et les Méchants dont on espère la défaite – ce qui s’appellera bientôt «baiser la Métastructure». Jamais, depuis G.K. Chesterton, ou peut-être C.S. Lewis à un degré plus modeste, un auteur n’avait combiné ainsi la narration la plus «populaire» et la méditation la plus pure sous ses airs déjantés. J’en suis baba: je me pince. Mais non: je ne rêve pas: c’est écrit et c’est beau, cela pulse, cela vit.
 Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’on la trouve dans l’une des nouvelles de From Death to Morning (De la mort au matin), sous le titre de Circus at Dawn et commençant ainsi: «Thre were times un early autumn – in September – when the greater circuses would come to town – The Ringling Brothers, Robinson’s, and Barnum and Bailey shows, and when I was a route-boy on the morning paper, on those mornings when the circus would be coming in I would rush madly through my route in the cool and thrilling darkness that comes just before break of day, and then I would go back home and get my brother out of bed.»
Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’on la trouve dans l’une des nouvelles de From Death to Morning (De la mort au matin), sous le titre de Circus at Dawn et commençant ainsi: «Thre were times un early autumn – in September – when the greater circuses would come to town – The Ringling Brothers, Robinson’s, and Barnum and Bailey shows, and when I was a route-boy on the morning paper, on those mornings when the circus would be coming in I would rush madly through my route in the cool and thrilling darkness that comes just before break of day, and then I would go back home and get my brother out of bed.»
 Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de ce haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge: «Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die…»
Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de ce haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge: «Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die…»°°°
L’arrivée des éléphants, ce matin, au milieu des voitures bloquées, n’avait rien de cette magie crépusculaire ni de cette grandeur muette, mais la présence d’une petite troupe d’enfants escortant les sept sages m’a fait sourire à l’idée que, dans une trentaine ou une quarantaine d’années, cette matinée revivrait peut-être dans quelques mémoires comme un moment sauvé de la grisaille des jours.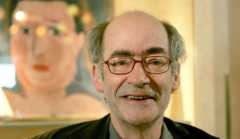 La France aime toujours la littérature, écrire un livre semble plus que jamais y signaler un «supplément d’âme», et même le personnage de l’écrivain qui n’écrit pas - l’écrivain «empêché», comme on dit, y jouit d’une sorte de prestige, d’autant plus que toute Française ou tout Français se sent un peu dans ce cas, rêvant d’écrire un jour «son» roman et préparant, dans son bain, les réponses qu’elle ou il fera tantôt à Patrick Poivre d’Arvor ou à Guillaume Durand, après la parution de l’ouvrage rêvé chez Grasset. Chez Grasset justement vient de paraître le dernier roman longtemps «empêché» de François Weyergans, le type de l’écrivain en difficulté, à propos duquel ses proches ont toujours un peu peur (il est si fragile, le pôvchéri), et que Madame Public, quand elle lira enfin ce roman «que tout le monde attendait», n’aura de cesse de prendre dans ses bras pour le consoler.
La France aime toujours la littérature, écrire un livre semble plus que jamais y signaler un «supplément d’âme», et même le personnage de l’écrivain qui n’écrit pas - l’écrivain «empêché», comme on dit, y jouit d’une sorte de prestige, d’autant plus que toute Française ou tout Français se sent un peu dans ce cas, rêvant d’écrire un jour «son» roman et préparant, dans son bain, les réponses qu’elle ou il fera tantôt à Patrick Poivre d’Arvor ou à Guillaume Durand, après la parution de l’ouvrage rêvé chez Grasset. Chez Grasset justement vient de paraître le dernier roman longtemps «empêché» de François Weyergans, le type de l’écrivain en difficulté, à propos duquel ses proches ont toujours un peu peur (il est si fragile, le pôvchéri), et que Madame Public, quand elle lira enfin ce roman «que tout le monde attendait», n’aura de cesse de prendre dans ses bras pour le consoler.
Dans Trois jours chez ma mère, François Weyergans explique comment François Weyergraf (son double romanesque, n’est-ce pas) n’arrive pas à écrire les divers romans (dont un qui parle de volcans) pour lesquels il a déjà reçu des à-valoir, et comment il est en train d’écrire Trois jours chez ma mère. Est-ce intéressant? Pas moins que la voisine qui vous explique comment apprêter le homard à la nage ou le voisin qui vous confie, sous l’effet d’alcools divers, que sa femme accoutume de le branler dans les trains. Cela fait-il un livre? Pas plus que la matière des chroniques de Bernard Frank en feraient des chroniques, sans le ton de Bernard Frank. Car François Weyergans a un ton. Et puis il a de l’humour, François Weyergans. Cela fait déjà deux bons points de plus qu’à Marc Levy, à cela près que celui-ci est mieux mal rasé que Weyergans et qu’il sait comme filer une intrigue combinant l’Amour, genre Love story, et le Drame, genre Urgences. Ainsi est-il douteux que Spielberg propose jamais à Weyergans de tirer un film de Trois jours chez ma mère. Celui-ci, en revanche, aura droit à une belle grande chronique de Jérôme Garcin, dans Le Nouvel Obs, où un élégant parallèle sera tiré entre ce livre «tellement attendu» et le fameux Paludes de Gide, ce roman fameux d’un auteur en train d’écrire Paludes…
°°°
Je suis, pour ma part, en train d’écrire n’importe quoi du fait d’une putain d’insomnie. J’ai dû relancer le chauffage tout à l’heure sur la position Hiver. Mes femmes vont partir ce matin pour le Midi tandis que je resterai à la niche comme un bon chien avec mon compère Filou. Je vais passer trois jours avec mon chien. Trois jours avec mon chien: voilà le titre d’un roman dont l’écriture me demandera bien trois jours aussi…
°°°
J’étais en train de lire la fin de Cosmos incorporated en écoutant le Te deum d’Arvo Pärt, lorsque je suis tombé sur ces mots: «Vous savez bien que la mort n’existe pas». Le contexte du chapitre dans lequel ces mots sont prononcés, autant que le fait que ces mots constituent le titre exact (Que la mort n’existe pas) de la dernière partie de mon dernier ouvrage paru, Les passions partagées, où j’évoque les derniers jours et l’agonie de ma mère, tout cela m’a plongé dans un mélange de profonde mélancolie et de joie paradoxale qui imprègne aussi bien les cinquante dernières pages de ce livre complètement renversant où je lisais encore une page plus loin «l’Amour tue la Mort, l’Amour est capable de vous rendre insensible, non à lui-même mais à son antimonde, à ce qui n’est pas réel, et qui pourtant modèle la réalité du monde. Seul l’Amour est réel, pensait-il…»
Et de fait, malgré les multiples «prodiges» que ploie et déploie la narration du roman de Dantec, qu’on pourrait dire une fiction nourrie de conjectures scientifiques plus encore que de la science fiction, c’est bel et bien de réalité qu’il s’agit là, en tout cas c’est ainsi que je le perçois, à la fois physiquement et métaphysiquement comme avec aucun autre écrivain à ce point d’incandescence et de vertige depuis Witkiewcicz, dont la vision du futur restait essentiellement mécaniste dans son catastrophisme, sans rien de la vision religieuse et mystique de Dantec.
J’ai pensé, en lisant les déclarations de l’intempestif dans les journaux, que sa position spirituelle relevait de l’idéologie d’emprunt ou du plaquage de pacotille, mais il n’en est rien: c’est visiblement une espèce de converti sauvage qui emprunte autant au réalisme pur et dur de Thomas d’Aquin qu’à la vision en rupture de Giordano Bruno et à toutes sortes de visionnaires mystiques de l’Ancien Testament et des premiers siècles, via l’Apocalypse, pour fonder une approche de la réalité très nourrie aussi de culture scientifique et littéraire, sans parler de ses multiples références de fan de rock faisant paraître tout ce qui précède du pipeau folky.
Or, il n’en est rien: ce livre se tient magnifiquement, tant au niveau de sa narration «triviale» qu’à celui de ses multiples résonances morales, poétiques ou téléologiques. Sa dernière partie, malgré sa vision catastrophiste que ma nature débonnaire refuse absolument d’admettre, est même bouleversante d’humanité, et notamment quand il parle de «la beauté intrinsèque que ne parvenaient pas à souiller les abominations de l’homme» ou, tout à la fin, à propos du «texte» à venir qu’il reste à chacun de nous à écrire «dans la clameur atroce des tueries et le vacarme tonitruant des foules livrées à elles-mêmes», quand il évoque une dernière voix sur Terre, «celle qui fait de chacun d’entre nous autre chose qu’une routine dans le programme, autre chose qu’une boîte dans un ensemble infini de boîtes, autre chose qu’une machine dans la mégamachine. Cette voix, c’est tout ce que l’humanité n’ose pas se dire, tout ce dont l’humain ne veut pas entendre parler, c’est-à-dire lui-même et ses atroces défaillances, ses immondes dysfonctionnements, sa monstruosité non assumée», cette voix qui est de l’origine et «qui permet au monde de se faire», cette voix censée se taire à la fin de Cosmos incorporated et dont la modulation dit précisément le contraire… -
Varia 2005, VI
Paul Léautaud se flattait de n’avoir jamais menti de toute sa vie, et c’est sûrement vrai. Jamais en tout cas, à le lire, on n’a l’impression qu’il cherche à plaire au lecteur ou qu’il se ménage lui-même en s’observant. Voici par exemple ce qu’il écrivait dans son le dimanche 4 mars 1951 dans son Journal littéraire: «Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne.»
Le même jour (l’écrivain avait alors 79 ans) Léautaud remarquait qu’il avait toujours été «fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement», et qu’une seule chose avait compté pour lui: le plaisir précisément. «Ce mot plaisir représente pour moi le moteur de toutes actions humaines».
Son plaisir, Léautaud l’avait trouvé avec quelques femmes, avec les poètes dont il fut l’anthologiste au début du siècle (lui qui se prétendait fermé au sentiment, pleurait comme une madeleine quand il récitait par cœur Verlaine, Jammes ou Apollinaire), dans les conversations quotidiennes au Mercure de France dont il était l’employé, avec les dizaines des chats et de chiens qu’il recueillait dans son pavillon d’ermite urbain de Fontenay-aux-Roses, et surtout à écrire, tous les soirs à la chandelle, le rapport circonstancié de ses journées, consigné à la plume d’oie sur des feuilles collées les unes aux autres et dont l’ensemble nourrit les dix-huit volumes de la première édition du Journal littéraire.
A part celui-ci, Le petit ami, évoquant sa jeunesse de gandin préférant les lorettes de bals populaires aux bourgeoises, et le poignant In memoriam, écrit au chevet de son père mourant avec autant de ressentiment (justifié) que d’émotion (Léautaud est un super-émotif sous son rictus), quelques proses stendhaliennes et ses chroniques de théâtre réunies sous le pseudonyme de Maurice Boissard, constituent toute son œuvre; à quoi s’ajoute la formidable série d’entretiens radiophoniques qu’il a réalisés avec Robert Mallet, qui le fit connaître de la France entière et dont l’intégrale est disponible en CD.
Paul Léautaud avait 21 ans lorsqu’il entreprit la rédaction de son Journal littéraire, qu’il tint jusqu’à la veille de sa mort, le 22 février 1956. Tôt abandonné par sa mère (qu’il ne reverra qu’une ou deux fois et dont il rêva comme d’une amante), laissé très libre par un père cavaleur qui l’introduisit dans les coulisses des théâtres (il fut successivement comédien et souffleur au Français), Léautaud fut très tôt indépendant et pourtant le poulbot de Montmartre sera du genre sensible et studieux, pour devenir un clerc lettré puis une figure originale du Quartier latin, avec sa dégaine de clochard shakespearien reçu dans les salons (chez Florence Gould, il se prend volontiers de bec avec Cingria, son contraire en tout et qui dira magnifiquement tout ce que nous donne Léautaud mais aussi tout ce dont sa sécheresse française nous prive, du jazz syncopé à la Renaissance italienne ou du romantisme allemand à la mystique médiévale…) et redouté pour ses traits de cynique voltairien.
Dès ses débuts, Léautaud dit se méfier des «grands styles» et n’aspirer qu’à «simplifier, sans cesse». C’est qu’il n’en a qu’au mot juste. L’épiderme de sa maîtresse, dite Le Fléau, lui paraît-il un peu rêche, qu’il écrit: «Une peau… comme une râpe». Et tout à l’avenant, qu’il s’agisse des grands écrivains qu’il fréquente (Valéry, Gide) ou des petites gens du populo (qu’il juge le plus souvent sans aménité), des pièces de théâtre qu’il va voir le soir et qu’il juge selon son seul goût tout classique (donc insensible au «galimatias» d’un Claudel), des idées dont il se méfie et des idéologies qui lui semblent autant de fumées, de la comédie littéraire (il rate de peu le Goncourt avec le petit ami) et des tribulations de l’époque, dont il ne parle guère, contemporain de Saint-Simon ou de Diderot plus que de Sartre et consorts.
C’est de fait dans cette ligne claire et tonifiante, qui relance celle de Stendhal ou de Chamfort, que se situe l’écriture de Léautaud, où il fait bon se retremper mais à laquelle la littérature ne saurait être réduite.
Les montagnes de Savoie ont ce matin un extraordinaire relief, alors que l’oblique lumière d’automne éclaire chaque détail des deux rives, du port de Clarens à celui de Saint-Gingolph en face, avec une netteté qui cisèle aussi la fine dentelle des feuillages d’or rouillé et souligne les verts encore intenses du val suspendu que nous surplombons de notre balcon en lisière de forêt.
Or contemplant cette image tissée de temps et me rappelant ce que dit Michel Serres des multiples temps, justement, qui tissent un paysage, je me retrouve dans un état de silencieuse songerie qui me remplit à la fois de reconnaissance et me conforte dans la conviction que ce tissage quotidien de tous les temps du Grand Récit de la nature ou de l’Histoire (le château médiéval de Chillon jouxtant là-bas le viaduc de l’autoroute), des vies singulières des braves gens qui vaquent alentour, et de nous aussi, de nos enfants qui s’en vont pour en amener peut-être d’autres au monde, du chien Fellow et de la mésange Zoé, enfin des dizaines de milliers de livres dont les voix bruissent autour de nous, constitue à la fois le livre du jour et le nuancier approprié à l’écriture ou à la peinture du jour.
En repensant aux intempestifs et aux péremptoires que j’ai lus (ou relus) ces derniers jours, de Houellebecq à Joseph de Maistre et de Dantec à Léon Bloy, je me suis dit que c’est cela qui me manquait chez ceux-là: le détail et la nuance, ou plus encore: l’intimité. Des imprécateurs que je connaisse, seul Vassily Rozanov allie, avec son génie de l’immédiateté saisie dans l’instant, l’Idée et le Sentiment; et la femme est toujours proche chez l’auteur de Feuilles tombées, incarnation même de l’intimité.Dantec s’en prend souvent et violemment, dans Le théâtre des opérations, - dont le titre guerrier annonce la démarche, et qui me passionne sans me convaincre toujours -, au nombrilisme de la littérature française actuelle. Je partage en partie son point de vue, mais en partie seulement, car la réalité est mille fois plus riche et nuancée, autant que le paysage de ce matin, comme est plus riche et nuancée la littérature anglo-saxonne contemporaine, qu’il réduit à peu près au roman «pop» des Burroughs, Dick, DonDeLillo et Ballard.
J’aime que la littérature française oppose le fulminant Léon Bloy et les non moins tonitruants Tailhade ou Vallès, conformément au dualisme propre au pays de Descartes, mais j’aime aussi me rappeler une bonne conversation avec François Cheng qui me faisait l’éloge du regard tiers, et voici le paysan parisien Marcel Aymé ou le docteur Anton Pavlovitch Tchekhov, ou ce maître de toutes les nuances nettement dessinées que figure à mes yeux William Trevor, pour s’inscrire en faux contre tel esprit réducteur, tel froid de tels discours.Réveillé, cette nuit, par un cauchemar glaçant. Une Cadillac de granit, aux roues à jantes de luxe diffusant une espèce de neige carbonique, arrivait du bout de l’allée de la maison du réalisateur italien que nous squattions en notre adolescence. Peu après s’être immobilisé, le véhicule s’en retournait lentement, et tout à coup un chien, du type berger allemand, mais de la taille d’un tigre, tombait du toit tandis que deux jeunes types en jeans, porteurs d’un couteau, s’éloignait derrière la maison, l’air menaçant.
Aussitôt je me suis rappelé le contrat lancé contre moi par je ne sais plus qui, ni pour quel motif, dans un autres rêve, et du coup je me suis retrouvé, soudain, dans l’état de panique mentale où m’a plongé, des années durant, le rêve du meurtre dont je me suis rendu coupable à la fin des années 60, sur la personne du jeune assassin angélique du tenancier du bar Le Shangaï, à Lausanne-City; et je vois à l’instant un couteau suspendu, celui-là même de la nouvelle intitulée L’irréparable, dans le nouveau recueil d’Anne-Lou Steininger, Les contes des jours volés, qui traite justement de la violence en nous et des frères ennemis qui se vouent, en notre for secret, tout l’amour-haine de Dieu sait quelle préhistoire des pulsions… Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros ventre – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa bêtise. Et pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.
Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros ventre – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa bêtise. Et pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.
On a parlé de Flannery O’Connor comme d’une sorte de Bernanos au féminin, et c’est vrai qu’il y a de ça, à cela près que l’écriture de Flannery est d’une densité poétique et d’une violence, d’un humour et d’une acuité sans pareils. On peut lire ses histoires au «premier degré», comme de fantastiques morceaux d’observation des comportements humains, dans cette Amérique de la paysannerie pauvre en butte aux conflits de races et de classes, où les prêcheurs de tout acabit foisonnent. En outre, sous les dehors les moins lénifiants qui soient (d’aucuns lui ont même reproché d’être cynique, ce qu’elle n’est pas du tout – mais il est vrai qu’elle ne s’en laisse pas conter…), c’est une véritable arène d’affrontement du Bien et du Mal que les histoires de cette féroce catholique claudiquant (une horrible maladie l’a détruite encore jeune) au milieu de ses poules et de ses paons, plus souvent du côté des supposés coupables que des prétendus vertueux…
La Côte d’or n’a jamais si bien porté son nom qu’en cette fin de matinée d’automne aux irradiants flamboiements, et c’est comme un visage que je reconnais tout en reprenant la lecture amorcée ce matin d’un livre abordant immédiatement ce phénomène de la reconnaissance, au multiple sens du terme, d’un paysage, d’un visage ou de quelque image retrouvée de notre bloc d’enfance, petite musique ou picturale odeur de cage d’escalier où des fantômes montent au ciel de notre mémoire comme à l’échelle de Jacob, du côté de Proust, de Freud et de Spinoza.
Je sais toujours ce que j’ai à faire du côté de Proust, surtout en TGV descendant sur Paris, avec l’idée qu’en glissant plus bas je verrai Chartres et plus bas sous les nuages tendres l’église là-bas aux vitraux mythiques, et je saurai proche la Vivonne, mais Freud et Spinoza: moi pas savoir.
Or ce matin Max Dorra m’y emmène, et là encore il est question de «retrouver la force d’exister» chez ceux qu’a menacés l’écrasement, le déni et l’excommunication.
Dans le TGV il y a plein d’hommes-machines qui crépitent de formules. Un voisin disait tout à l’heure à son compère qu’il fallait gérer l’historique de l’Entreprise ou mourir.
Ne préfère-t-on pas mourir dans ces cas-là, en écoutant un peu de musique.
Ah oui: le livre s’intitule: Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être?
…
L’accord entre deux êtres et la musique de leur relation est à la fois une question de peau et de rythme, liée à la possibilité d’associer les sentiments et les mots, les bribes de rêves et de murmures matinaux (dans l’intimité d’avant l’aube) dans un langage inouï, au sens propre. Je le note en poursuivant plusieurs lectures à la fois, de la première apparition, dans Sodome et Gomorrhe, de Charlus à la Raspelière où les Verdurin le «testent», tandis qu’il drague Morel et diffuse ses «signes» d’un autre monde que la pauvre Verdurin s’efforce de capter; de la lente descente aux enfers de feu glacial de Monsieur Ouine, d’un petit livre singulier de Jean-Jacques Nuel jouant sur la fascination d’un auteur pour un nom (cela s’intitule d’ailleurs Le nom) devenu mot et possible réceptacle d’un nouvel inventaire du monde; enfin cet essai dont la phrase même est rythme et musique, de Max Dorra (ce nom fait aussi pour errer la nuit dans quelle ville mitteleuropéenne…), intitulé Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être? et dont chaque page me fait songer et réfléchir, surtout: m’apprend.Gilles Deleuze, dont j’ai acheté hier Proust et les signes, que j’ai commencé d’annoter le soir au Buffet de la gare de Lausanne en attendant mon ami le Loup, voit en La Recherche un livre tourné vers l’à-venir et non sur le passé, et c’est exactement ce que je ressens à chaque page: je voudrais savoir, j’apprends, raconte, tu m’étonnes, et voici Madame Cottard qui se réveille d’un petit somme clandestin au milieu de la compagnie et s’écrie sous le regard furibond du docteur. «Mon bain est bien comme chaleur, mais les plumes du dictionnaire»… De ces mots à fleur de rêve ou à fleur d’enfance, on ne sait pas trop, dans cet incroyable bruissement de gestes et de mots du théâtre de la Raspelière où Marcel poursuit son exploration.
Et me le rappelant je lis sous la plume de Max Dorra, évoquant lui-même la présence d’un interlocuteur virtuel, ces mots qui me parlent immédiatement et par leur sens et par leur modulation vocale-musicale: «La chorégraphie d’un être à une signification: le sédiment des manières, la trace des groupes qu’il a traversés».
Je me rappelle aussi que, pendant que je lisais Deleuze dans le grand buffet au Cervin peint à fresque, kitsch mandarine, l’arrivée de mon compère le Loup, formidable ami retour de Roumanie où il est allé installer de force l’électricité et le téléphone dans la caverne post-communiste de sa mère (sa mère qui a montré son cul à son frère et ses cousines pour leur signifier qu’elle voulait croupir seule avec Dieu dans sa trappe), et voici que je tombe sur le récit, par Max Dorra, des «congrès» liant Freud à son ami Fliess et cette phrase parfaite à ce moment: «La vertu de certains amitiés réside dans la musique d’une voix, les rythmes d’un être»…
Et cela sur le style: «Un style, c’est la succession, le rythme de ces arrachements du sens où du sens se bat pour ne pas être étranglé par des codes. L’incessant combat d’un enfant pour se reconstruire face à un monde». Ou ceci encore: «Sur une musique qu’il est seul à entendre, chacun danse». Enfin: «Les individus qui s’attirent ont un rythme similaire»…
Enfin je lis ce matin la brume d’automne aux fenêtres et je me rappelle la marche à tâtons du géant Richter dans la sonate posthume de Schubert, ces gouttes d’être dans la nuit, cette «petite phrase bouleversante» qui nous relie à Quoi?
Je ne suis pas philosophe et ma culture scientifique est à peu près nulle, et je me sens pourtant comme chez moi dans le dernier livre de Max Dorra, Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être?, dont je lisais ce matin, au lit, ces lignes à ma bonne amie en train de potasser ses dossiers sur l’apprentissage des adultes et, plus précisément, ces derniers temps, sur les travaux de Francisco Varela: «Le cerveau. De quoi rêver. Il faudrait, pour explorer ce cosmos, imaginer un véritable équivalent de la NASA. Et avant tout, une NASA de la mémoire. La formation d’un chercheur y serait diversifiée. Neurophysiologiste, il partirait à la conquête de l’encéphale, tout en sachant qu’il en modifiera les connexions en les observant. Poète, il laisserait venir les métaphores, ces carrefours germinatifs entre associations et modèles. Il devrait aussi ne pas ignorer l’histoire e la philosophie, ne serait-ce que pour débusquer les préjugés idéologiques, voire les croyances qui pourraient à son insu parasiter sa propre démarche. Neurophysiologiste, poète, philosophe, il lui faudrait de toute façon ‘etre capable d’accueillir l’inattendu, pour élaborer des concepts nouveaux, et avoir ainsi une chance de commencer un jour à comprendre le cerveau humain».
Lorsqu’elle a entendu l’expression «d’accueillir l’inattendu», ma bonne amie a murmuré «serendipity», qui m’a rappelé du même coup la première fois que j’ai entendu ce mot dans la bouche de René Berger, sur un trottoir lausannois (rayon de soleil oblique flamboyant sur le capot argenté de ma Jazz…) et que j’ai retrouvé dans le dernier essai, Rameaux, de Michel Serres.Serendipity: ou l’art de trouver un truc quand on cherchait un machin. Dès que le mot est lâché, L. me sort une paire de feuillets photocopiés d’un livre de Jacques Lévy qui détaille le concept à sa façon ; le même Jacques Lévy, spécialiste de l’internet (et plus récemment des blogs) dont j’ai lu les livres en 1996, quand je préparais mon «roman virtuel», devenu Le viol de l’ange, dont la structure procède de la même phénoménologie poétique.
Max Dorra lui encore, après avoir rompu une lance contre «l’actuelle fétichisation de la scientificité», revient sur les prétentions scientifiques du structuralisme, qui valaient leur poids de dogme au tournant de nos vingt piges, pour conclure sans conclure: «La linguistique, de toute façon, méconnaît une part essentielle de la parole: la musique des phrases, le rythme des corps, l’imprévu des mimiques, la danse des gestes».
Accueillir l’inattendu: quel plus beau programme pour un écrivain et, plus généralement, pour n’importe quel lecteur. Rozanov l’a saisi mieux que quiconque: je m’assieds pour écrire telle chose, et c’est telle autre qui me vient de tout ailleurs, de plus profond ou de la simple apparition de la nuque de ma bien-aimée dans telle lumière de telle instant.
A l’instant je lis sur un autre feuillet polycopié de ma moitié: Francisco Varela: «Le cerveau n’est pas un ordinateur»…
Max Dorra n’est pas un homme-machine mais un médecin-poète poreux. Un soir à la radio, Jacques Weber disait que Shakespeare était à ses yeux le poète absolu de la porosité, à savoir la capacité de tout absorber et de tout transmuter. Tout cela va contre tous les savoirs claquemurés, tous les pouvoirs jaloux, tous les fanatismes aussi. Ce n’est pas l’ouverture à n’importe quoi ni l’omnitolérance, mais c’est une saine éthique de la connaissance socratique vécu au temps de la couche-culotte quantique…
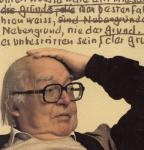 Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, que je retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du nouveau recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre: «Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer: un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en céleste clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté»…
Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, que je retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du nouveau recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre: «Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer: un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en céleste clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté»…
Cette comète qui passe là haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.
Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald. Celui-ci prolonge la tradition des grands promeneurs européens qui va de Thomas Platter, le futur grand érudit descendu pieds nus de sa montagne avec les troupes d’escholiers marchant jusqu’en Pologne, Ulrich Bräker le berger du Toggenburg qui traduira Shakespeare, ou Robert Walser se mettant «pour ainsi dire lui-même sous tutelle», comme l’écrit Sebald, sans cesser de griffonner de son minuscule bout de crayon sous les étoiles… -
Varia 2005, VII
Olivier Charles, Huile sur toile.
On était morose, on était comme un vitrail dans la pénombre, et tout à coup il s’est passé quelque chose, la lumière s’est faite dans le vitrail, on a changé d’humeur en voyant ce qu’il y avait là: cette mer de brouillard ce matin, les montagnes enneigées, le ciel rose et gris, le fumet du café, nom de Dieu je vis.
Ce que le Mac de Max Dorra compute en ces termes: «Une petite phrase, un jour, un fragment d’avenir, s’est trouvée incarcérée dans une partition. Pour s’en échapper, elle a tout misé sur sa différence. Longtemps elle a semblé imiter, répéter. Progressivement pourtant, elle s’affirmait. Nourrie de mémoire, elle en faisait un devenir. La fugue raconte cette histoire singulière. Un contrepoint de l’actuel et du virtuel. Et qui défie la mort, et qui fait reculer l’angoisse, ce passé déguisé.»
Et Scriabine d’ajouter: «La pierre et le rêve sont faits de la même substance et sont aussi réels l’un que l’autre».( A La Désirade, ce mardi 8 novembre.)
Ce mauvais coucheur de Castoriadis parlait, à propos de l’évolution de la culture contemporaine, de «montée de l’insignifiance» et celle-ci me paraît précisément caractériser les prix littéraires de cet automne, mais est-ce bien nouveau? Cela ne fait-il pas un siècle que le Goncourt revient à des Weyergans, et le Nobel de littérature n’a-t-il pas été inauguré par Sully Prudhomme? Le ciment d’une société reste le conformisme et l’on serait bien niais (comme je le suis à mes heures…) de s’attendre à ce que la non-conformité fût consacrée, même à une époque ou le pire conformisme se pare des plumes du non conformisme. Bref, on ne devrait pas s’étonner de voir le Goncourt attribué à une chose aussi insignifiante que Trois jours avec ma mère et pas à La possibilité d’une île de Michel Houellebecq, ce malappris, ou pire: à l’époustouflant Cosmos incorporated de Maurice G. Dantec, ce réac foldingue qui n’est apparu dans aucune liste à ce que je sache.
Que le prix Médicis soit attribué à Fuir de Jean-Philippe Toussaint, ce savon de luxe qui vous glisse entre les pattes, et que le prix Femina revienne à Asiles de fous de Régis Jauffret, cet esthète de la désespérance affectée, paraît également ressortir au littérairement correct et à la norme, comme l’Interallié, en principe réservé à un journaliste, collé par raccroc à Houellebecq, relève du n’importe quoi…
A supposer que Monsieur Ouine de Bernanos, Vie de Samuel Belet de Ramuz ou L’apprenti de Raymond Guérin eussent été publiés cette année, les noms de ces auteurs seraient-ils apparus sur les listes des prix? C’est possible mais pas du tout certain. Ce qui est sûr en revanche, c’est que ces livres ont été primés par le Temps, et qu’ils signifient aujourd’hui plus que jamais avec ou sans médailles…
Une magnifique évocation posthume de W.G. Sebald, par son ami l’artiste Jan Peter Tripp, conclut Séjours à la campagne en situant le grand art de l’écrivain dans la tradition des graveurs de la manière noire. «Homme enseveli sous les ténèbres, ce maître du temps et de l’espace dont le regard s’animait au royaume des Ombres, n’était-il pas devenu lui-même, au fil des ans, dans son Royaume mélancolique, une sorte de plante de l’ombre? D’ailleurs, dans son pays d’adoption, l’Angleterre, la manière noire avait connu au XVIIIe siècle un épanouissement unique, porté par les plus grands artistes. Travailler en partant des ténèbres pour aller vers la lumière est une question de conscience – ôter de la noirceur au lieu d’apporter la clarté. Aussi l’habitant de l’ombre devait-il ne s’exposer qu’avec précaution à l’éclat de la lumière».
C’est exactement le processus par lequel Sebald, dans cette suite de plongées dans le temps que constituent ses approches des œuvres de Hebel, Rousseau, Möricke, Keller, Walser ou Tripp lui-même, qui sont à chaque fois des approches de visages engloutis dans la nuit du Temps, révèle progressivement les traits d’une destinée particulière cristallisant les éléments dominants de telle ou telle époque en tel ou tel lieu.
Après la terrifiante traversée de l’Allemagne en flammes, dans Une destruction, Sebald rassemble ici plusieurs avatars de la culture préalpine et du mode de vie propres à l’Allemagne du Sud et à la Suisse, dont un élément commun est cette Weltfrömmigkeit (une sorte de métaphysique naturelle ou de mystique panthéiste assez caractéristique du romantisme allemand) qu’il trouve chez Gottfried Keller, dont le chapitre qu’il lui consacre, autour de Martin Salander et d’Henri le Vert, est une pure merveille. Je n’en retiendrai que cette mise en évidence d’une scène emblématique, aussi profondément poétique que l’évocation proustienne des livres de Bergotte survivant à celui-ci dans une vitrine à la manière d’ailes déployées, où l’on voit Henri ajuster, sur le cercueil de sa cousine Anna, une petite fenêtre de verre sur laquelle, en transparence, il découvre le reflet d’une gravure de petits anges musiciens. Et Sebald de préciser aussitôt: «La consolation qu’Henri trouve dans ce chapitre de l’histoire de sa vie n’a rien à voir avec l’espérance d’une félicité céleste (…) La réconciliation avec la mort n’a lieu pour Keller que dans l’ici-bas, dans le travail bien fait, dans le reflet blanc et neigeux du bois des sapin, dans la calme traversée en barque avec la plaque de verre et dans la perception, au travers du voile d’affliction qui lentement se lève, de la beauté de l’air, de la lumière et de l’eau pure, qu’aucune transcendance ne vient troubler»…
C’est le soir, ce matin je lisais ce qu’écrit Max Dorra sur l’heureuse rencontre que constitue le Dieu de Spinoza, j’y ai pensé toute la journée, j’y ai pensé en nageant 500 mètres en brasse coulée, j’y ai pensé en faisant l’acquisition d’un Bouddha de l’époque Song entièrement rongé par les termites à l’exception de l’impassible visage au sourire doux qui a traversé sept siècles avant de rayonner ce soir dans notre maison au bord du ciel, et j’y pense encore à l’instant en lisant le Manuel de contemplation en montagne d’Yves Leclair ou je copie à l’instant: «Tout le monde dort dans la paume d’un Dieu qui rêve», et je lis en moi: «Tout le monde rêve dans la paume d’un Dieu qui dort», et Dhôtel cité par Leclair: «L’univers vagabonde comme un enfant à travers ses abîmes. Mais il n’y a rien, absolument rien que le temps de Dieu, que chacun mesure à sa façon.»
On est pris, dès qu’on entre dans cette chronique fascinante du règne de Staline et de sa clique, dans un drame grandiose et crapuleux dont le Prologue annonce le mélange d’incroyable brutalité et de non moins trouble complexité, à croire qu’on est à la fois chez les Atrides et dans l’arrière-cour conchiée de la tribu Deschiens. Dès son avant-propos, l’auteur annonce son intention de couper court à la légende d’un monstre réduit à une «énigme» aussi peu explicable que celle d’Hitler, ou à un «génie satanique», pour lui opposer la réalité d’un «homme de son temps», une personnalité certes hypocondriaque mais exceptionnelle à tous égards, aux multiples visages, à la fois politicien supérieurement intelligent et potentat ne visant qu’à l’affirmation de son rôle historique, d’un égotisme messianique exacerbe et parlant de lui a la troisième personne comme d’une entité de sa fabrication. Ainsi répondit-il à son fils Vassili, qui prétendait être lui aussi «un Staline», que Staline était le pouvoir soviétique incarné: «Staline est ce qu’il est dans les journaux et ses portraits, pas toi ni même moi».
Or dès les premières pages, Montefiore rend le personnage extraordinairement présent, autant que sa femme Nadia, qui va se suicider au terme du Prologue, dont la durée recouvre la réunion annuelle et le banquet des pontes du régime fêtant l’anniversaire de la révolution, plus précisément en l’occurrence le 8 novembre 1932. En une trentaine de pages frénétiques, qui s’achèvent sur une scène de ménage sauvage et pathétique à la fois (Staline jetant pelures d’oranges et mégots à la femme de sa femme pour l’humilier), l’auteur rend en outre le climat très particulier régnant alors au Kremlin. La tragédie scellant la fin de cette nuit, dont les circonstances exactes restent encore obscures, marque en effet un tournant décisif dans l’histoire du régime: c’est le début de la grande famine planifiée (à laquelle Nadia Allilouïeva s’opposait d’ailleurs) et la fin d’une période certes sanglante pour la Russie mais plutôt heureuse pour Staline et les siens. La réaction de Staline lui-même, à la mort de sa femme (qui lui aurait laissé une lettre «terrible», oscille entre le désespoir et la rage, la fureur d’être «trahi» et la tentation de se supprimer à son tour – bref tout est en place pour le récit de 800 pages qui va suivre…
La pratique consistant à lire plusieurs livres à la fois, qui est la mienne depuis toujours et se combine avec une lecture du monde incluant la musique et le cinéma, les rencontres, les voyages, les songeries en forêt ou en ville, les escales à ma rédaction ou dans les cafés, le théâtre et les expositions, les lettres de mes compères ou les téléphones nocturnes avec mon ami Bernard, me semble correspondre de mieux en mieux avec la perception simultanéiste de notre époque. Ainsi, le même jour, ai-je lu le passage prodigieux de Sodome et Gomorrhe où Charlus séduit Morel en l’humiliant tandis que Marcel sarcle amoureusement le terrain de sa jalousie à venir, tout en regardant d’un œil, sur le PC qui recueille ces notes, le film de Raoul Ruiz intitulé Le temps retrouvé (avec un John Malkovitch assez convaincant dans le rôle de Charlus) et en poursuivant la lecture du livre si pénétrant et stimulant de Max Dorra (Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être?) qui parle, précisément, d’un passe de La recherche que je viens de lire, sur l’humiliation de Saniette par les Verdurin et, plus généralement, sur ceux qui se taisent par opposition à ceux qui la ramènent – Gide racontant ses conversations avec le brillantissime Valéry, et moi me rappelant tous ces moments de timide à patauger en société: «Un individu, soudain, écrit Max Dorra, ne reçoit plus de récompenses. Aucune gratification. Il trouve en face de lui, quand il se hasarde à dire quelques mots, des mimiques figées ou réprobatrices, agacées ou méprisantes. Un silence. L’absence de tout sourire.»
Le langage et «l’être du sens», au lieu du «sens de l’être», se trouve au cœur du livre de Max Dorra, et dans ses multiples manifestations, approché de multiples façons dans ce livre combien étrange et familier, à la fois savant et fraternel, parfois décousu en apparence mais cousu par-dessous si l’on peut dire, lié ensemble comme est liée ensemble notre aperception du monde.
Ce matin j’avais aux jambes une foutue lourdeur de plomb, problèmes de circulation du voyageur en avion (le rêve prolongé), risque de thrombose (la dernière en revenant du Canada) et sensation d’aphasie, sur quoi je déchiffre les pages que Dorra consacre à l’aphasie, ensuite de quoi je me replonge dans le récit littéralement plombé de l’anéantissement de la paysannerie russe par Staline incessamment justifié par une langue de plomb. On ne sortira pas de ces mises en rapport. Pourtant il importe d’en éviter la propension diluante ou nivelante. Tout n’est pas dans tout quand le corps se réveille…
Max Dorra: «La vraie vie est un mixage improbable, déconcertant». Et plus tard on parlera, je le pressens, de musique et de politique, que les Chinois et les Grecs associaient…
Bien plus que la différence, dont on nous rebat les oreilles et qui signifie peu de chose à mes yeux, c’est la ressemblance qui m’importe en cela qu’elle surmonte les particularismes raciaux, sociaux ou sexuels au bénéfice de valeurs plus fondamentales. L’exaltation de la différence fleure déjà, à mes yeux, le clan ou la secte, avec ce relent de revendication qui cherche à forcer la main, alors que la découverte de la ressemblance aboutit à une vraie rencontre.
«Une bonne rencontre est celle qui permet de co-renaître», écrit Max Dorra, «chacun apportant à l’autre, malgré la différence des instruments, des timbres, la note qui manquait à un accord enfin résolutif». Or lisant tout haut cette phrase à celle que j’ai rencontrée pour de bon après divers essais infructueux de part et d’autre à travers les années, je l’entends me dire: «c’est pile mon sujet de mémoire, ça recoupe Damasio et Varela sur quoi je bosse, faudra que je m’achète ce bouquin pasque tes notes au crayon bleu ça devient pas possible…»
Et du coup je me rappelle cette rencontre et toutes celles, «résolutives» pour un moment décisif d’évolution personnelle, qui ont précédé et suivi et que je m’obstine à ne pas croire le fruit du hasard: nécessaires à ce moment précis.
Avec L. on se rencontre à dix-huit ans, on fleurète, on se bécote et se tripote, mais le moment n’est pas venu. L’année du bac on se rencontre presque, on aurait fait des enfants avant le divorce probable, mais non: je vais de mon côté, elle se trouve un autre complice avant de divorcer, elle me relance (coiffure afro, engagée un max à gauche dans le groupe Mozambique) entre temps j’ai rencontré XYZ que j’ai aimés et lâchés faute de co-renaissance réciproque, ainsi de suite.
Cette notion de co-renaissance est devenue la base de toutes mes relations, fondées sur la réciprocité. Toutes les amitiés qui n’ont pas été tissées de co-renaissance se sont étiolées avant de défunter. On me juge sans doute un piètre ami selon les codes de la répétition, mais tant pis, je n’aime pas faire semblant ni ne tolère le chantage à l’amitié qui force à se trahir.
Je fréquente Max Dorra depuis moins d’un mois. Pas idée de qui il est. Jamais vu son visage. Mais plus proche de lui ces jours que de tant de gens qui prétendent me connaître, par les petites phrases que son livre relaie, vraie rencontre occulte, comme celle de Proust tous les matins que je lis aux «lieux», le Salon Proust de la Désirade où s’empilent tous les écrits de et sur Marcel Proust.
A l’instant, à la fenêtre, le paysage est divisé en deux: ciel céleste et mer de brouillard. Gloire apparente du dessus, mais c’est à l’enfant sous la table que je pense. L. me raconte justement l’histoire de cette enseignante qui vient vers elle lui dire que la passionne la thématique de l’Ogre dans les contes, qu’elle aimerait traiter dans ses classes d’enfants difficiles, et qui fond soudain en larmes…
Les hasards de l’édition me font lire, en même temps, deux livres intéressants que relient un même thème: la faillite du communisme réel. Le premier est une somme de près de 800 pages, qui nous plonge dans la vie quotidienne du cercle des potentats staliniens, style clan militaro-clérical, fanatiques bâtisseurs prêts à fusiller leur mère pour la cause des Travailleurs, avec lesquels on s’enfonce dans une épouvantable spirale de répression de masse préludant aux procès fratricides et aux exécutions. L’autre est un petit récit de Claude Duneton, fils de paysan du Limousin qui a baigné dans les grandes espérances nourries par la glorieuse Union soviétique (son père, devenu magasinier chez Renault, voyait en la Russie le paradis sur terre), et qui se retrouve en 1991 dans la cuisine de Tamara, belle blonde septuagénaire qui lui raconte sa vie de fille de plombier sous le socialisme réel, à cinq personnes dans la même pièce pendant vingt ans.
A lire ces deux livres, on éprouve un sentiment qui ne se retrouve jamais à la lecture de témoignages sur le nazisme. Un sentiment mélangé d’horreur et de compassion. Même décrits dans le déchaînement de leur paranoïa, les potentats staliniens (et Staline lui-même) conservent quelque chose qui ressemble à de la «bonne volonté». Le tableau de La cour du Tsar rouge est extraordinairement détaillé et foisonne d’observations révélatrices. Par exemple celui-ci: que Staline tance Molotov sur son usage incertain du point virgule, en même temps qu’on planifie la famine en Ukraine; que tous, bourreaux de travail, se soucient mutuellement de leur santé et de l’éducation des enfants; qu’il lisent beaucoup et sont convaincus de servir un Idéal chevaleresque… Nadia, la femme de Staline, ne bronche pas quand on lui annonce la déportation d’un million de paysans, mais ce n’est pas un monstre pour autant, et puis ces paysans sont des koulaks. Et koulak, dans le catéchisme communiste, signifie exploiteur, vampire. En réalité pour la plupart: petits paysans pauvres qu’on vient dépouiller de leurs biens. Et les récoltes de se trouver confisquées et revendues pour doter l’industrie. Et la famine de ravager l’Ukraine, dont les ressortissants seront les victimes d’un massacre sans précédent. Cela non par racisme mais au nom de la fraternité!
Et de même est-ce au nom de la fraternité que le père de Claude Duneton voit-il en Thorez un apôtre de l’Avenir Radieux, sans savoir que le grand Maurice ment aux travailleurs français pour asseoir son propre pouvoir, comme Aragon a menti pour consolider le sien.
A lire ces deux livres en parallèle, le plus curieux est qu’on ne sent nullement conforté dans ce qu’on appelle l’anticommunisme. Il ne s’agit pas de ça mais de la foi aveugle en quelque idéologie que ce soit, catholique ou fasciste, maoïste ou léniniste. Claude Duneton observe que ses voisins paysans illettrés, dans le Limousin, résistaient mieux aux sirènes des lendemains qui chantent que son père lecteur. Or on se rappelle les œillères du père Sartre à Cuba: mentons au nom de l’Avenir et pour ne pas désespérer Billancourt, ce genre de discours.
Surtout ce qui m’enchante dans ces deux livres, c’est qu’ils sont purs de toute haine et de tout ce qui fonde l’hubris destructeur. Lorsque Beria entre dans le cercle des potentats staliniens, Nadia Staline frémit d’horreur comme lorsque le Démon Stavroguine entre dans une pièce, chez Dostoievski. Il y a un diable parmi nous: et Staline le sait. Mais Staline sait aussi que ce démon va le servir mieux que certains de ses amis, que Beria torturera avec un soin particulier. Claude Duneton a été communiste lui aussi, comme tant de jeunes gens de bonne foi, et je me rappelle un premier voyage en Pologne, en 1967, j’avais vingt ans et je me croyais si progressiste que j’enjoignais nos hôtes, serrés à dix dans trois pièces, de croire à l’Avenir pour ne pas nous désespérer…
A relever enfin cela d’épatant dans Loin des forêts rouges: que Duneton, qui ne parle pas russe, s’entretient avec Tamara, qui baragouine à peine anglais. Cela donne donc un échange plus mimé que parlé qui devient, de page en page, une véritable pièce de théâtre. Dans le langage célinien de l’écrivain, on se régale et d’autant plus que Duneton n’est pas du genre à se dorloter de mélancolie…
Il fait nuit sur les monts tandis que l’hiver gagne. A la fenêtre là-bas scintillent, dans le noir où se distingue le contour du lac en ligne noire sur fond noir, le cliquetis-piquetis des lumières d’Evian. Et je lis sous la lampe ces mots d’ Yves Leclair écrits de sa Chine pyrénéenne où la neige, dit-on, a déjà recouvert les hauteurs: «La table est vide sous le halo orange de l’ampoule. Profonde obscurité à l’entour: j’y vois plus clair». Et comme je viens de m’éveiller je lis ce qui suit comme un écho inverse: «Dernier éveil avant de plonger dans le sommeil: femme, un Dieu clair a laissé son sceau sur ta peau laiteuse comme un point final – un beau grain de beauté dans ta neige, tout près de ton geai bleu».
 On a besoin le matin de phrases limpides, on se lave à l’eau des mots, on lit par exemple: «le samedi midi, c’est le jour du bifteck de cheval. Louise le mange cru, non haché mas recouvert d’une nappe de sucre en poudre».
On a besoin le matin de phrases limpides, on se lave à l’eau des mots, on lit par exemple: «le samedi midi, c’est le jour du bifteck de cheval. Louise le mange cru, non haché mas recouvert d’une nappe de sucre en poudre».
Ou bien on lit: «L’auteur revoyait dans une succession d’images presque arrêtées tout ce que son père lui avait apporté, au-delà des mots si rares, au-delà des gestes encore plus rares, ces attentions, cette tendresse informulée, ces soucis, ces espoirs pour l’avenir d’un fils, seul garçon de la famille». Ou bien encore on lit: «Il cherche, une fois de plus, les mots du commencement, des mots, par exemple, capables de nommer ce qui fait le miracle du corps humain, son inexplicable animation, sitôt noué son dialogue muet avec les autres, le monde et lui-même – et aussi la fragilité de ce miracle». Ou encore ceci tandis que le jour se lève sur les pentes givrées: «Donne à qui sait lire ton âme, fuis qui la déchire, car tu n’as pas le temps».
Tous les dimanches, Hervé Guibert allait voir Suzanne et Louise, deux vieilles femmes, ses grand-tantes, qu’il photographiait et décrivait au milieu de leurs objets, deux vieilles petites filles qui ne se parlaient guère qu’en sa présence, et son écriture toute unie et pure raconte le Carmel de Louise et les jambes de Suzanne, les cheveux très très longs de Louise jouant à se mettre la muselière du chien Whiskey et le corps de Suzanne jouant à être morte avant de se livrer à la faculté de médecine. Tous les jours Jean-Jacques Nuel revenait à sa table pour y sacrifier au Rite de l’écriture, tous les jours Cézanne revenait au corps du monde, tous ces matins Giovanna s’en va dans le froid du monde avec en elle peut-être une petite phrase bouleversante qui lui revient de cette page d’un livre entrouvert: «donne à qui sait lire ton âme»…
Hervé Guibert retrouvé ce matin, l’esprit d’Hervé que je retrouve au coin du feu, le corps d’Hervé libéré de sa torture, l’écriture sans rature d’Hervé Guibert décrit le Paradis de Louise: «Elle dit qu’elle ne l’imagine pas. Le corps, de toute façon, n’a plus d’existence, et elle me cite un passage de l’Evangile où un esprit naïf demande avec lequel de ses sept maris une femme qui s’est mariée sept fois entrera au Paradis». Et je lis du petit livre entrouvert: «Si les livres n’avaient pas été là, je serais mort dans cette forêt. Lire m’a sauvé la vie et le voyage a commencé. Les mots sont mon sang, mon fouet, mon feu». Enfin je lis ces mots de Jean-Jacques Nuel: «Tout était à écrire. Un livre n’y suffirait pas».
J’avais repris les œuvres de l’énergumène pour lire de mes yeux les mots éclatés d’Artaud le Mômo, et j’ai lu «L’esprit ancré/vissé en moi/par la poussée psycho-lubrique/du ciel/est celui qui pense toute tentation/tout désir/toute inhibition», j’ai lu «o dedi/a dada orzoura/o dou zoura/a dada skizi», j’ai lu «o kaya/o kaya pontoura/o ponoura/a pena/poni», je me suis rappelé ces mots sortant des babines du grand bambin couillu babolant dans son corps tournoyant, au théâtre l’autre soir, et j’ai repris au vol «C’est la toile d’araignée pentrale/la poile onoure/d’où – ou la voile,/la plaque anale d’anavou», et j’ai lu encore «(Tu ne lui enlèves rien, dieu/parce que c’est moi. Tu ne m’as jamais rien enlevé de cet ordre./Je l’écris ici pour la première fois,/je le trouve pour la première fois», et j’ai noté ces mots: «Je l’écris ici pour la première fois/je le trouve pour la première fois», car c’est cela même Artaud pour moi, Comme Van Gogh ou comme Louis Soutter, tous trois foudroyés à consommer tout cru à pleine langue et les dents dans la viande des mots, d’ailleurs je zappais et lisais maintenant: «On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh qui, dans toute sa vie, ne s’est fait cuire qu’une main et n’a pas fait plus, pour le reste, que de se trancher une fois l’oreille gauche, dans un monde où on mage chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau-né flagellé et rage, tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel».
Je lisais ces mots écrits à l’instant pour la première fois, puisque lus comme ça pour la première fois par moi, et je pensais à la Toile, poile onoure ou pentrale peu importe, mais à l’araignée, et je voyais Artaud dans la Toile, le sceptre levé: «La pointe extrême du mysticisme,/je la tiens maintenant dans le réel et dans mon corps,/comme un balai de cabinets», me disant: qu’est-ce que cela change?
Qu’est-ce que cela change Internet? J’envoie à l’instant Louis Soutter sur l’Internet, il titube, il rouspète, mais il a ses plumes et son encre chourée au bureau de poste voisin (il y a encore des postes à la poque de la poile onoure ou pentrale) et mon compère Antonin (l’autre, l’ancien comédien lui aussi devenu nécrivain) qui m’écrit des SMS ou des Mails à chaque bouquin que je lui intime de lire me répond: sûr qu’Artaud le Mômo campe sur la toile - même qu’il y a son trou noir où ces mots flamboient: «L’intelligence est venue après la sottise/laquelle l’a toujours sodomisée de près – Et après»…
Et après il y avait l’objet à la pointe extrême du regard de Van Gogh, et téléphone ou pas, il y avait la douleur à la pointe extrême du regard de Louis Soutter, et fax laser ou pas il y a ce fou d’Artaud qui dit tout et le contraire de tout mais qui le dit et le vit et ce cri échappe à toute connivence de ma part ou de la tienne, il dit au flic du Dôme qui veut le copiner: «Pas de tutoiement, ni de copinage,/Jamais avec moi,/ pas plus dans la vie que dans la pensée», et ça c’est partout qu’il le dit, il n’y a qu’à lire, l’Internet n’est rien, les machines ne baisent pas le corps, c’est le corps qui baise l’esprit et l’esprit rend gorge: «Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas-côtés de foudre. La frange ténébreuse insolite du vide montant d’après l’éclair. Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile. Suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d’une suffocation d’en-haut. Et pourtant tout le tableau est riche. Riche, somptueux et calme le tableau»…La neige était là tôt l’aube, la féerie de toujours mais ce matin plutôt comme une ombre blanche aux fenêtres - et justement je resongeais à ce monde apparemment réduit à rien du minimalisme qui peut relever aussi bien de l’impuissance créatrice que de l’ascèse poétique, comme dans les épures de Rothko, et je revoyais l’immensité apparemment vide de Gerry, le film de Gus Van Sant que j’ai regardé hier soir, juste après avoir repris la fin du roman de Jean-Jacques Nuel, Le nom, qui se risque lui aussi sur le fil du rasoir du vide apparent.
Il ne se passe à peu près rien dans Gerry où deux amis se perdent dans la vastitude infinie d’un paysage, mais ce désert est aussi vibrant de présence que celui dont parle Théodore Monod, et ce qui se passe, à peu près sans mots, entre les deux garçons reste étrangement prenant. De la même façon, et malgré le paradoxe et le risque encouru par toute forme de «performance» littéraire, le roman de Jean-Jacques Nuel résiste à la vacuité et non seulement par la musique de l’écriture mais par tout ce qui filtre de la présence du romancier et de ce qui pour l’écrivain relève de l’essentiel, en deçà et par delà le nom qu’il écrit et réécrit comme un écolier sa première page de lettres copiées à la ronde ou comme un saint au désert ce qu’on appelle la prière du cœur, se bornant aux mêmes mots répétés à l’infini.
Or que dire de plus à propos de ces expériences-limites? Peut-être ceci: qu’elles constituent des pointes qui s’émoussent à la moindre réitération complaisante. Ainsi le minimalisme devenu système, en peinture, sombre-t-il dans le dérisoire, de même que le maniérisme du rien en littérature, quand telle vie minuscule ou telle petite gorgée de bière se réduisent au must d’une mode…
Il y a des moments de présence intense dans Gerry, quand les garçons marchent au bord du ciel ou dans le sel éblouissant-assoiffant du désert, quand Gerry évoque ses royaumes imaginaires à côté du feu de nuit ou lorsque couchés, exténués, leurs corps se rapprochent, leurs mains se cherchent, leurs sentiments mêlés d’affection et de rage esquissent une lutte-étreinte les rejetant finalement dans leur solitude muette tandis que le ciel roule ses vagues bleues en accéléré - mais tiens, voici du bleu sur la neige
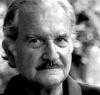 On est très vite entraîné dans le vif du dernier roman de Carlos Fuentes, par l’entremise d’une femme de tête, la cinquantaine et dans la haute politique mexicaine, qui drague épistolairement un fringant trentenaire qu’elle vient de rencontrer et qu’elle se propose d’aider à se mettre en selle avant de lui ouvrir son bunker privé. Cela se passe en 2020, alors que le président mexicain vient de damer le pion aux Américains en refusant de cautionner leur invasion de la Colombie et de s’opposer à la hausse du prix du pétrole. Par mesure de rétorsion, les USA ont coupé toute liaison entre le satellite qu’ils contrôlent et le Mexique, de sorte que celui-ci se trouve privé e toute forme de communication, obligeant les protagonistes du roman de Fuentes à s’exprimer par lettres. Et tout de suite ça vole très haut, c’est très allant, très dense et captivant. La grande silhouette de Machiavel ne tarde à se profiler à l’horizon, d’emblée les intrications de la passion du pouvoir et des menées humaines, sentimentales ou sexuelles, nourrissent ces vifs échanges, et ça y va. La distribution aligne donc Maria del Rosario Galvan, qui dit entre autres que le ressentiment est le vice national du Mexique et l’injustice l’écriture sacrée des terres latino-américaine, le jeune Nicolas Valdivia en lequel on pressent un Julien Sorel à dégaine de métis aussi séduisant de corps que d’esprit, Xavier Zaragoza dit Sénèque le conseiller du Président dont il flatte le «moi moral» tandis que son contraire, Tacito de la Canal, figure l’âme noire et servile de ces coulisses. Bref ça a l’air parti pour un beau grand roman de conjecture politique, dont les personnages sont immédiatement campés avec vigueur. On passera volontiers trois jours en leur compagnie, au lieu d’embêter la mère de Weyergans…
On est très vite entraîné dans le vif du dernier roman de Carlos Fuentes, par l’entremise d’une femme de tête, la cinquantaine et dans la haute politique mexicaine, qui drague épistolairement un fringant trentenaire qu’elle vient de rencontrer et qu’elle se propose d’aider à se mettre en selle avant de lui ouvrir son bunker privé. Cela se passe en 2020, alors que le président mexicain vient de damer le pion aux Américains en refusant de cautionner leur invasion de la Colombie et de s’opposer à la hausse du prix du pétrole. Par mesure de rétorsion, les USA ont coupé toute liaison entre le satellite qu’ils contrôlent et le Mexique, de sorte que celui-ci se trouve privé e toute forme de communication, obligeant les protagonistes du roman de Fuentes à s’exprimer par lettres. Et tout de suite ça vole très haut, c’est très allant, très dense et captivant. La grande silhouette de Machiavel ne tarde à se profiler à l’horizon, d’emblée les intrications de la passion du pouvoir et des menées humaines, sentimentales ou sexuelles, nourrissent ces vifs échanges, et ça y va. La distribution aligne donc Maria del Rosario Galvan, qui dit entre autres que le ressentiment est le vice national du Mexique et l’injustice l’écriture sacrée des terres latino-américaine, le jeune Nicolas Valdivia en lequel on pressent un Julien Sorel à dégaine de métis aussi séduisant de corps que d’esprit, Xavier Zaragoza dit Sénèque le conseiller du Président dont il flatte le «moi moral» tandis que son contraire, Tacito de la Canal, figure l’âme noire et servile de ces coulisses. Bref ça a l’air parti pour un beau grand roman de conjecture politique, dont les personnages sont immédiatement campés avec vigueur. On passera volontiers trois jours en leur compagnie, au lieu d’embêter la mère de Weyergans…Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque le Pouvoir rebaptisa sa ville natale de Nijni-Novgorod de son nom, en pensant à son ami Tchekhov. Ainsi le jeune homme avait-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Pouvoir. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchekhov.
J’avais repris depuis quelques jours la lecture de Gorki, dont vient de paraître le premier volume des Oeuvres en Pléiade. Je m’étais rappelé ma lecture, une nuit à Sorrente, de la correspondance du jeune Gorki et de Tchekhov, où celui-là dit à peu près ceci au cher docteur: tout ce qui se fait aujourd’hui en Russie semble un raclement de bûches sur du papier de sac de patates à côté de ce que vous écrivez vous de tellement sensible et délicat. Je pestais contre mes putains de chaînes que mes mains glacées ne parvenaient pas à désentortiller dans la nuit plus russe que russe, et je pensais à Tchekhov, mon âme chantonnait tandis que le chien Fellow se tirait des lignes de neige en twistant comme un fol autour de moi, le rat. Et j’imaginais le docteur partant seul dans la nuit sur son traîneau, à l’appel d’un malade à dix verstes de là, et flûte pour ces putains de chaîne, me suis-je alors dit, je rentre à l’isba, à peine trois verstes, ça me donnera le temps de penser à Tchekhov, et voilà que me revenait cette phrase d’Anton Pavlovitch au jeune Gorki: « «On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part»…On mesure mieux, à la lecture du Siège de l’aigle de Carlos Fuentes, le grand vide du roman français actuel, à quelques exceptions près. En tout cas je ne vois pas, pour ma part, un seul titre de ces dernières décennies qui puisse rivaliser avec cette magnifique intelligence de la politique et des grands fauves qui se disputent le pouvoir, cette pénétration de la psychologie humaine et ce grand art de pur romancier qui fait apparaître, l’un après l’autre, et comme en ronde-bosse, par le seul truchement de lettres qui s’entrecroisent, ces formidables personnages gravitant, en 2020, trois avant l’élection de son successeur, autour du Président mexicain qui vient de sortit de son aboulie pour tenir tête aux Américains après leur invasion de la Colombie.
Je n’ai jamais mis les pieds au Mexique mais après 220 pages de ce roman, qui n’est en rien «documentaire» au demeurant, j’ai l’impression d’avoir déjà vécu dans ce pays, alors même que tout ce qui se rapporte à son économie, à ses intrigues politiques, à ses problèmes sociaux (paysans, étudiants, crime organisé, etc.) me renvoie à la politique et à l’économie de nos pays, alors que les personnages qui s’y dessinent renvoient à un théâtre de tous les temps, de Plutarque à Macbeth.
Qui a fait, en Europe, en France, en Allemagne, en Italie, un roman aussi clair et limpide de forme, sur une matière aussi trouble et complexe, et qui sonne si vrai et qui nous en apprenne tant? Car c’est cela même: comme dans Les illusions perdues de Balzac ou dans la Trilogie américaine de Philip Roth, on apprend une quantité de choses dans Le siège de l’aigle, tout en observant cette étonnante empoignade de formidables prédateurs qui ne sont jamais des caricatures (on se rappelle le pauvre Automne du patriarche de Garcia Marquez) et que le jeu du roman épistolaire permet de traquer dans leur intimité masquée ou leur obscène fausse franchise. Quel savoir et quel culot de voyou (un vrai romancier doit être un voyou), quelle malice et quelle vieille tendresse (le vrai romancier donne raison à tous ses personnages), enfin et surtout: comme on se sent bien là-dedans. Voilà ce qu’on voudrait lire aussi en Europe. La semaine passée, j’ai relu des pages d’Henri le vert de Gottfried Keller, et je me disais: voilà ce qu’on voudrait lire aujourd’hui. Or le plus amusant est que Fuentes, avec un clin d’œil, parle du obel de littérature attribué en 2020 l’écrivain Cesar Aira. Et voilà la générosité des grands: du coup je me suis rappelé que je voulais lire Varamo, et je suis allé le repêcher dans la pile des «à lire absolument»… du coup j’y ai passé l’après-midi, avant de redescendre en plaine et d’acheter La princesse Printemps. Quel plus beau titre un soir de neige à vous enchaîner dans la brouillasse? Tarnation est un collage qui déroute d’abord par sa vitesse et ses ellipses, après quoi l’histoire se met en place qui a quelque chose d’un roman-photo américain des années 50, où tout de suite apparaît la mère du cinéaste dont il est question dès les premières séquences, avec l’annonce d’une overdose de lithium. Et c’est part pour unlife-movie renée a été reine de beauté au texas. En 1952 elle a rencontré un représentant de commerce, le beau Steve. Lovestory. Sauf que Steve fout le camp tôt et que Renée déjante au point que le gosse se trouve casé, chez des gens qui l’abusent bientôt. Jonathan placé, René va dans une prison, et les images video commencent de redéfiler.
Tarnation est un collage qui déroute d’abord par sa vitesse et ses ellipses, après quoi l’histoire se met en place qui a quelque chose d’un roman-photo américain des années 50, où tout de suite apparaît la mère du cinéaste dont il est question dès les premières séquences, avec l’annonce d’une overdose de lithium. Et c’est part pour unlife-movie renée a été reine de beauté au texas. En 1952 elle a rencontré un représentant de commerce, le beau Steve. Lovestory. Sauf que Steve fout le camp tôt et que Renée déjante au point que le gosse se trouve casé, chez des gens qui l’abusent bientôt. Jonathan placé, René va dans une prison, et les images video commencent de redéfiler.
Car c’est de ça qu’est fait ce film recomposé: de toutes les images que Jonathan Caouette a collectées et, dès sa quatorzième année, filmées ou fait filmer lui-même.
Ce film est à mes yeux la négation de l’art. C’est une sorte de déchet existentiel et pourtant il me touche, comme m’a touché l’autre jour ce billet d’une collégienne insultant son prof, d’une écriture de sang et de rage. Et voir le petit Jonathan de 15 ans en travelo, devant sa camera, jouant un rôle et pleurant de désespoir, me poigne aussi bien, mais que faire avec ça?
Où est la limite du fait divers et de la tautologie? Toutes nos scènes de ménage et de manège ne sont-elles pas «à filmer»? Et tout ne va-t-il pas s’esthétiser de cette façon en patchworks «cultes»?
«C’est pas mon genre les grossièretés» dit ce garçon qui se regarde et dit son amour pour sa mère, qu’on traite aux électrochocs. Je pense aux lettres d’Antonin Artaud et je vois ce pauvre gosse sans mots qui évoque le viol du vieux salaud auquel il a été confié, lequel apparaît bientôt à l’écran et lui ordonne de virer sa caméra…
Vertige de cette horreur: et beauté tout de même à la longue, comme renouant avec une immense tendresse perdue et un pardon, où les images deviennent bel et bien récit…
C’est l’histoire d’amour d’un fils et de sa mère, que tout a séparés et qui se retrouvent comme deux enfants perdus. De ces images absolument idiotes que sont celles qu’on prend en vidéo se dégage une espèce de poème. Cela fait un peu nouvelle de Carver racontée par à-coups sur un répondeur téléphonique ou envoyées par images segmentées. Pourtant une histoire se raconte là-dedans où se colmate un immense vide et s’esquisse une mélodie belle…
Il y a des jours avec et, des jours sans, et c’est qu’il faut plutôt faire avec, au lieu de se cabrer ou de se fâcher avec soi, en tâchant de ruser, pour mieux déjouer la prétention de tout maîtriser ou la tentation de lâcher toute prise.
Je prends ces notes chaque jour, mais comment ne pas comprendre qu’elles ne sont que d’infimes traces de chaque journée, dont seul compte peut-être le mouvement d’en retenir ces bribes ?
J’étais curieux de lire l’essai qu’annonçaient les éditions Zoé, sous la signature de Nicolas Bouvier: Charles-Albert Cingria en roue libre, qui me semblait virtuellement intéressant. Et je ne croyais pas si bien penser, car ce Cingria par Bouvier est en effet un ouvrage virtuel. L’essentiel du livre est en effet consacré, par la professeure Doris Jakubec, à ce que qu’aurait pu être un livre de Nicolas Bouvier. Les textes de Bouvier sur Cingria rassemblés dans là-dedans, sous non seul nom en page de couverture, se réduisent en effet à une cinquantaine de pages déjà connues, notamment par une conférence qu’il avait donnée à Lausanne (je le sais puisque c’est moi qui l’y avais invité), à quoi s’ajoutent quelques feuillets épars, à peine des esquisses, que Doris Jakubec commente en même temps qu’elle présente, très bien d’ailleurs, l’œuvre de notre cher Cingria.
Et je ne croyais pas si bien penser, car ce Cingria par Bouvier est en effet un ouvrage virtuel. L’essentiel du livre est en effet consacré, par la professeure Doris Jakubec, à ce que qu’aurait pu être un livre de Nicolas Bouvier. Les textes de Bouvier sur Cingria rassemblés dans là-dedans, sous non seul nom en page de couverture, se réduisent en effet à une cinquantaine de pages déjà connues, notamment par une conférence qu’il avait donnée à Lausanne (je le sais puisque c’est moi qui l’y avais invité), à quoi s’ajoutent quelques feuillets épars, à peine des esquisses, que Doris Jakubec commente en même temps qu’elle présente, très bien d’ailleurs, l’œuvre de notre cher Cingria.
Lors de sa conférence à Lausanne, Nicolas Bouvier nous sortit une énormité qui prouvait sa connaissance lacunaire du sujet, en regrettant tout haut que Cingria et Cendrars ne se fussent jamais rencontrés. Et de comparer ce qu’eût pu être une telle amitié avec celle qui avait lié Henry Miller et Lawrence Durrell. Pierre-Olivier Walzer, grand manigancier des Oeuvres complètes de Charles-Albert, qui fut son ami et son éditeur, son soutien et son saint disciple, fit alors remarquer ce que nous savions tous: savoir que Cingria et Cendrars s’étaient bel et bien rencontrés, et tellement aimés qu’ils se fuyaient et multipliaient les entre-piques.
C’est un peu chipoter, mais je vais insister, après m’être tu gentiment ce soir-là, à propos d’une anecdote que rapportait Bouvier en causerie, et qui se trouve cette fois écrite en page 28 et 29, concernant une prétendue rencontre de Nicolas Bouvier et Charles-Albert Cingria, qui relève de la pure affabulation à la Cendrars…
Quelque temps avant son escale à Lausanne, j’avais rencontré à Genève Bouvier qui me certifia n’avoir jamais rencontré Cingria, chose en effet plus que probable puisque celui-ci rejoignit les anges musiciens en août 1954, à cette époque même où Bouvier voyageait en Topolino dans les pays moites. Je lui racontai cependant, entre autres anecdotes, une histoire absolument tordante que le docteur Emile Moeri, cardiologue de mes amis qui s’occupa régulièrement de la santé de Charles-Albert lors de ses passages en Suisse romande, m’avait racontée pour l’avoir vécue à Paris.
Le jeune Moeri Senior (père d’Antonin), emmené par Cingria dans une exposition chic, y fut prié par l’inénarrable bicycliste de lui tenir les deux poches de ses knickerbockers bien ouvertes pendant que celui-ci y enfournait quelques canapés aux anchois bien gras pour la route… Or le cher Emile n’en finissait pas de rire à l’évocation des taches de graisse qui étaient apparues sur les pantalons golf de Cingria. Et Bouvier aussi rit beaucoup lorsque je lui rapportai l’anecdote.
Ce qu’il en fait dans Ecrire sur Cingria, en s’attribuant le rôle du jeune officiant, est si joli que j’ai bien un peu hésité à rétablir «la vérité». Bouvier ne fait pas autre chose en somme, ici, que du Cendrars ou même du Cingria, étant entendu que celui-ci ne s’est pas gêné en matière de mentir vrai.
Bouvier croit rendre hommage à Cingria en se donnant le rôle de lui ouvrir les poches, lui qui n’était alors qu’un tout jeune homme qui n’avait, précise-t-il, «pas lu une ligne de lui». Il fait cependant une erreur de taille en prétendant qu’il n’a empli qu’une poche ce soir-là, la droite, en y déversant un «plateau» entier de «croissants au jambon». Le souci de vérité historique m’oblige cependant à rectifier, puisque c’était de canapés aux anchois bien gras qu’il s’agissait en l’occurrence, déversés symétriquement dans les deux poches de Charles-Albert, et non de croissants au jambon genevois…On ne sait trop où fuit le protagoniste de Fuir, le dernier roman de Jean-Philippe Toussaint, mais il y fuit et on le suit, un peu comme on jouerait à suivre n’importe qui dans la foule de la rue, à ceci près que e quidam fuit jusqu’en Chine, ce qui n’est guère plus remarquable pour lui que s’il fuyait en Belgique. L’important n’est évidemment pas dans ce qu’il découvre en Chine (à savoir rien) où il ne sait pas ce qu’il cherche ni non plus ce qu’il fuit, ayant constaté que ceux qu’il croyait le menacer ne le menacent pas vraiment, qu’il se fait des idées et que tant qu’à fuir il le pourrait aussi bien à l’île d’Elbe où le ramène bientôt une téléphone de Marie, l’amie qui l’a envoyé en Chine pour affaires chic et qui perd ensuite son père, comme cela arrive dans la vie.
Ce qui compte n’est pas le but mais le chemin, disait un sage plein de sagesse, et c’est ce qu’on se dit en fuyant dans la foulée de son élastique personnage qui bondit et rebondit de page en page et de lieu en lieu et en faisant pom-pom comme une balle de tennis sur un court élégant. Dans la foulée on copule dans une chiotte de train chinois, ce qui peut faire sourire si l’on considère l’immensité disponible en Chine pour s’adonner à la chose, mais ce n’est qu’une péripétie de cette fuite où tout se fait comme ça, pour rien peut-être, et peut-être n’est-ce rien? Presque aussi rien, n’était le Médicis, que de passer trois jours chez la mère du Goncourt…Du brave soldat Schweijk à l’indolent Oblomov, en passant par le protagoniste de Je ne joue plus de Miroslav Krleza, la figure de celui qui dit non au jeu social, aussi doucement que fermement, a trouvé de belles illustrations, mais la plus émouvante reste sans doute celle du jeune scribe Bartleby, dans la nouvelle éponyme de Melville, employé de bureau à Wall Street et limitant progressivement son activité en opposant, aux multiples ordres et propositions de son patron, un doux et têtu «je préférerais pas…», traduction plus ou moins satisfaisante de «I would prefer not to…»
Toute forme d’ésotérisme m’est foncièrement étrangère. Je conçois fort bien les tenants et les aboutissants d’un savoir caché, réservé à quelques élus, mais je ne saurais y participer sans trahir mon bon naturel. Il est assez de mystère, dans l’Univers, qui me suffit sans qu’on y rajoute du pseudo-mystère. Par ailleurs, les sectateurs du genre suffiraient à m’en détourner.Tout ce que je fais relève en somme de la mise en ordre, ou plus exactement: de la mise au clair. C’est cela: je tire les choses au net.
Je lis ceci: «Pluie de printemps/toute chose en devient/plus belle.» Des mots calligraphiés par Chyo-ni, une noble Japonaise du XVIIIe siècle. Puis je lis cela.» Un matin glacé/sur mon vélo/j’admire les champs». Les mots de Catherine Sancet, de la classe 6e B du collège Gérard-Philipe de Carquefou. Je viens de me lever dans la nuit glaciale et je lis Le soleil de l’après-midi de Constantin Cavafy. C’est l’histoire du type qui se rappelle la chambre dans laquelle il a aimé quelqu’un «tant de fois». C’est d’une banalité crasse et pourtant, en lisant ce qui suit, tout à coup je me sens plus réel:
«Sont-ils encore quelque part, ces pauvres meubles?/A côté de la fenêtre était le lit./Le soleil de l’après-midi arrivait à la moitié. Un après-midi, à quatre heures, nous nous sommes séparés,/Rien que pour une semaine… Hélas,/Cette semaine-là devait durer toujours».
Ah mais, il fait un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant: «Je ne suis rien./Je ne serai jamais rien./Je ne peux vouloir être rien./A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde./Fenêtres de ma chambre,/Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont/Personne ne sait qui il est/(Et si on le savait, que saurait-on?),/Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,/Une rue inaccessible à toutes pensées,/Réelle au-delà du possible, certaine au-delé du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres, Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,/Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.»
Cela s’intitule Bureau de tabac et c’est évidemment signé Fernando Pessoa, puis je lis ceci en me rappelant l’odeur de tout à l’heure de quelqu’un que j’aime et qui dort encore, sous la plume d’Anna Akhmatova: «Les jours les plus sombres de l’année/Doivent s’éclairer/Je ne trouve pas de mots pour dire/La douceur de tes lèvres».
C’est cela même: on ne trouve pas les mots du plus réel, mais la poésie est peut-être un peu de ça: plus de réel en peu de mots… C’est pendant les pubs de la Star’Ac que j’ai commencé de lire Lunar Park, hier soir, avec un retard qui doit venir des quelques papiers dédaigneux que j’avais lu à gauche et à droite, disant à peu près: pas terrible, déballage narcissique, ragots de pipole, ces choses-là. Ce qui m’étonnait un peu, de la part de Bret Easton Ellis, et d’ailleurs André Clavel m’avait plutôt mis l’eau à la bouche, André Clavel qui est un vrai lecteur. Mais les choses qui doivent se faire se font, et lire Lunar Park pendant les pubs de la Star? Ac est une bonne façon de cumuler les plaisirs du prime, n’est-il pas?
C’est pendant les pubs de la Star’Ac que j’ai commencé de lire Lunar Park, hier soir, avec un retard qui doit venir des quelques papiers dédaigneux que j’avais lu à gauche et à droite, disant à peu près: pas terrible, déballage narcissique, ragots de pipole, ces choses-là. Ce qui m’étonnait un peu, de la part de Bret Easton Ellis, et d’ailleurs André Clavel m’avait plutôt mis l’eau à la bouche, André Clavel qui est un vrai lecteur. Mais les choses qui doivent se faire se font, et lire Lunar Park pendant les pubs de la Star? Ac est une bonne façon de cumuler les plaisirs du prime, n’est-il pas?
Ce qui est sûr, c’est que les 50 premières pages de Lunar Park, qui m’ont bientôt scotché par-delà les pubs, tout en reluquant de loin tel duo d’adorables baleines (Magalie et Liza Minelli) ou tel combat de jeunes coqs (Jérémie et Pascal au coude-à-coude assassin), c’est qu’il faut être bien distrait (ce que sont hélas beaucoup de mes consoeurs et frères) pour ne pas saisir vite la haute malice et la vigueur panique de cette fausse autobiographie jouant avec tous les standards médiatiques du monde actuel pour les «retourner» en quelque sorte.
Bret Easton Ellis raconte en somme comment il est devenu un personnage de Bret Easton Ellis en devenant le romancier multimillionnaire auteur des livres de Bret Easton Ellis, de la même façon que son père, qu’il dit haïr pour de bonnes raisons (on en découvre les premières traces dans Zombies), lui a inspiré le personnage de Pat Bateman d’ American Psycho.
On sait que Pat Bateman est un yuppie psychopathe, voisin de Tom Cruise dans son appart de Manhattan, qui ramène des meufs chez lui pour les tringler avant de les tronçonner. Ces mauvaises manières ont fait dire, par les Ligues féministes américaines, que Bret Easton Ellis était forcément misogyne pour imaginer de tels «comportements inappropriés». Ce que ces dames, et beaucoup de critiques distingués avec elles, n’ont pas vu, c’est que Patrick Bateman ne tuait qu’en imagination. Cela change-t-il quoi que ce soit? Si fait: cela distinguait ce roman de l’hystérie apathique aux coups de sonde dostoïevskiens (Norman Mailer l’a écrit lui aussi) d’un snuff polar banal jouant sur le goût de la violence et du sexe gore. Ce qu’on n’a pas assez compris, depuis Less than zero, c’est que Bret Easton Ellis est le médium d’une certaine réalité américaine, qu’il vit et traduit avec une porosité rare et une intelligence instinctive de pur romancier bien faite pour déstabiliser pas mal de nos confères et soeurs et les pitbullettes des Ligues de vertu.
Le combat faisait rage entre Jérémie et Pascal (en duo de vrais mecs hormonés se coulant des regards je t’aime-je-te-tue à n’en plus pouvoir) quand je suis arrivé à l’évocation, dans Lunar Park, après la «descente aux enfers de la drogue» du romancier et la «main tendue» de Jayne, mère de son fils Robby (lui prétendait que c’était plutôt le fils de Keanu Reeves qui fréquentait Jayne à la même époque, mais le test a prouvé le contraire) vers laquelle il revint du «bout de la nuit», des lendemains du 11 septembre (ils se sont mariés cette année-là) où l’on a commencé de voir, dans toutes les villes d’Amérique, des attentats à tous les coins de rue, et les cadavres innocents s’amonceler jusqu’à la hauteur des derricks, et la peur de tout et l’horreur absolue: «Jayne voulait élever des enfants doués, disciplinés, poussés vers le succès, mais elle redoutait à peu près tout: la menace des pédophiles, des bactéries, des 4 x 4 (nous en avions un), des armes à feu, de la pornographie et du rap, du sucre raffiné, du rayonnement ultraviolet, des terroristes, de nous-mêmes»…
 L’humour embusqué de Bret Easton Ellis n’est pas très éloigné de celui de Michel Houellebecq, en plus fou, et sa fantaisie de fictionnaire mimant les délires contemporains est bien plus riche d’observations virtuelles et actuelles que ne le disent ses détracteurs distraits, comme il en va d’un Maurice Dantec.
L’humour embusqué de Bret Easton Ellis n’est pas très éloigné de celui de Michel Houellebecq, en plus fou, et sa fantaisie de fictionnaire mimant les délires contemporains est bien plus riche d’observations virtuelles et actuelles que ne le disent ses détracteurs distraits, comme il en va d’un Maurice Dantec.
Madame Public a finalement préféré les langueurs mâles de Jérémie aux frémissements de fauve blessé de Pascal. Le dinar a de nouveau pissé un max à la Star Ac et tout est bien. Comme le dit et le répète Nikos: c’est en allant jusqu’au bout de son truc qu’on se dépasse à tous les niveaux du machin, alors voilà…
Le rapport liant le Bret Easton Ellis qui écrit Lunar Park et le Bret du livre qui raconte sa vie de romancier célébrissime et plein aux as tâchant de s’arracher à la drogue, me rappelle curieusement celui qu’entretient Marcel Proust avec le Narrateur de la Recherche. Je sais bien que le rapprochement peut sembler «limite», mais l’idée m’en est venue hier soir en lisant la suite de Lunar Park, qui joue du dire-plus de la fiction en faisant de cette chronique autobiographique un roman brassant le même type d’observations que Moins que zéro, Les lois de l’attraction ou Zombies, avec ce même regard sur ce qu’on pourrait dire les enfants perdus de nos sociétés nanties et avachies, et cette même musique de détresse, qui expliquent sans doute l’extraordinaire retentissement de ces livres.
Des pages 50 à 109, le narrateur de Lunar Park raconte essentiellement comment il replonge dans la dope (sans le reconnaître, avec toute la mauvaise foi connue de l’accro), et comment se distendent les liens l’attachant à Jayne (qui le surveille fébrilement), à Robby (qui le fusille du regard), à la petite Sarah dont l’oiseau de peluche n’est pas content non plus, ou au chien qui le juge grave lui aussi. Une fête démente de Halloween, où affluent les amis de l’écrivain, les voisins, les parents des mômes du quartier et les étudiants shootés du campus où Bret donne un atelier d’écriture, est l’occasion de détailler tout ce petit monde oscillant, comme toute l’Amérique, entre conformisme extrême et défonce, suavité et violence, infantilisme des adultes et sombre regard des enfants.
Or ce qu’il y a là de plus intéressant qu’une peinture de mœurs, c’est qu’un roman couve, avec quelque chose d’aussi inquiétant que ce qu’on sent bouillir à la surface du cratère où est tombée la première machine infernale tombée du ciel, dans La guerre des mondes que justement je regardais d’un oeil en lisant Lunar Park, dans sa version initiale de Byron Haskin, si délicieusement années 50. Dans la foulée, j’ai d’alleurs été saisi par l’incroyable ressemblance entre le reporter se précipitant vers la faille avec son micro et le Bret Easton Ellis des années 80: même profil net et même grand front à même mèche ondulée, même cravate et même œil à vrille, bref le parfait youngster américain.
Enfin, le rapprochement entre Bret et Marcel trouve un autre motif à la page 108 de Lunar Park, lorsque le narrateur léchote le brillant des lèvres de son élève Aimee Light, auquel il trouve un parfum qui le «ramène très loin». Et de préciser: «C’est comme ces petites mandarines chez Proust». Du coup, bon élève, Aimee corrige: «Vous voulez dire madeleines». Alors lui d’insister: «Ouais, comme ces petites mandarines».
Et c’est exactement cela, le roman: c’est cette façon de réinventer la réalité, plus vraie que vraie, qui fait que les madeleines d’hier sont les mandarines d’aujourd’hui… Quel corniaud crevant de faim pourrait-il bien avaler les rogatons que Philippe Djian a recueillis dans son Doggy Bag? Ce qui est sûr, c’est que mon camarade Fellow les a rejetés rien qu’à me voir les détailler, d’un bout à l’autre de la pièce, fronçant en outre ses sourcils à la François-Joseph lorsqu’il m’a entendu lui citer à haute voix cette phrase d’anthologie: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait peiné à la tracter sur du plat»…
Quel corniaud crevant de faim pourrait-il bien avaler les rogatons que Philippe Djian a recueillis dans son Doggy Bag? Ce qui est sûr, c’est que mon camarade Fellow les a rejetés rien qu’à me voir les détailler, d’un bout à l’autre de la pièce, fronçant en outre ses sourcils à la François-Joseph lorsqu’il m’a entendu lui citer à haute voix cette phrase d’anthologie: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait peiné à la tracter sur du plat»…
C’était pourtant un titre assez épatant que Doggy bag et je m’en léchais autant les babines que le chien Fellow, mais au fur et à mesure que j’avalais ces morceaux de feuilleton, les signes de l’indigestion et, bientôt, les spasmes annonciateurs d’un probable dégobillage se manifestèrent au point que, sur cette phrase de la page 127: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait pené à la tracter sur du plat», je résolus de donner le reste au renard…
Tout n’est pas pour autant à jeter du contenu de ce Doggy bag, dont certaines scènes, certains personnages et certaines ambiances (quand les bœufs ne s’en mêlent pas) se rattachent bel et bien à l’univers du romancier si remarquable de Sotos, Criminels, Sainte-Bob, Frictions ou Impuretés.
Ce qui cloche, avec Doggy bag, tient probablement au projet de fabriquer une «série» à partir de deux personnages (deux frères rivaux qui possèdent un garage et voient revenir la femme qu’ils ont partagée après vingt ans d’absence) qui ne sont pas «creusés» comme dans les romans ordinaires mais lancés dans une suite de séquences filées à la diable et dialoguées à la va-vite. En ce qui me concerne en tout cas, je n’y ai pas cru, la terrible scène durant laquelle l’un des couples baise pendant que l’enfant de la femme se noie à deux pas de là fait à peine figure de péripétie, tout ça glisse et patine en surface, bref on se demande si cette Saison I a vraiment besoin des deuxième et troisième saisons annoncées…
Nous sommes là dans le chaos de nos vies, et tout à coup il y a un moment de grâce, une île possible, une beauté qui nous sort de la platitude des jours et de la fuite du temps, et hier soir, chez la Comédienne, ç’a été sa fille Anna, notre filleule à l’Amie de la Comédienne (elle aussi actrice de théâtre, l’une des meilleures que je connaisse avec la Comédienne) et à moi, quand elle s’est assise, petite, avec sa guitare, et a commencé à nous jouer son Menuet d’un Anonyme.
On peut me dire tout ce qu’on veut de la décadence des temps qui courent, de l’enseignement qui fout le camp et de la perte du Sens du Sacré chez les enfants de cette drôle d’époque: je n’en ai rien à souder, parce que c’est faux.
Un Menuet d’un Anonyme joué par Anna, dix ans, avec un sourire de petit bodhisattva, au milieu d’un appart genre bohème artiste mais pas bordélique pour autant, après un repas de saveurs et une discussion enflammée d’abord (sur la pièce jouée ces jours par Denis Lavant, le pote de la Comédienne, où il est question de William Burroughs s’embarquant sur le radeau du Vieux Marin de Coleridge, à quoi la Comédienne n’a pas croché du tout) et ensuite super amicale, ponctuée d’irrésistible imitations d’animaux par l’Amie de la comédienne – tout ça et la beauté des choses et des gens refaisait surface dans notre chaos, comme elle refait surface à certains moments bouleversants de Lunar Park de Bret Easton Elis, quand les personnages naufragés qu’il y a dans ce livre se retrouvent sur un coin de radeau pour se dévisager avec tout ce qui leur reste de bribes d’amour.
Lorsque Bret et Jayne s’affrontent et se retrouvent durant leur thérapie de couple – chef d’œuvre de psychologie dialoguée, soit dit en passant -, ou quand Bret croit enfin rejoindre son fils Robby avant le déchaînement des forces ténébreuses, il y a aussi de ces îles apparemment préservée de tout le linge sale du monde, où ce que nous avons de pur et de bon trouve à s’exprimer.
A l’instant je le revis: Anna détaille chaque note avec gravité dans la nuit d’hiver. Dehors un renard file le long des voitures. Les mères qui m’entourent ont la même dégaine de babouchkas boucanées et bonnes. Le frère d’Anna, grand beau long garçon aux yeux et aux cheveux de berger afghan, nous a quittés quelque temps pour un casting, après quoi le revoici goûter au dessert de la Comédienne, genre crème à la turque, mélange de blanc battu et d’œufs en neige et d’eau-de-vie d’Arak. Un instant tout n’est plus qu’âme, ou disons qu’on se coule dans le corps du monde qui est un moule de beauté…
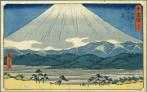 La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
Yves Rosset a voyagé librement une année durant, multipliant les allers-retors entre Berlin où il survit d’expédients (notamment barman de nuit) avec sa petite famille et le Japon, Israël et les States, entre autres points de chute d’un réseau tissant sa maille recoupée par le filet de ses mails amicaux round the world…
Dès les premières pages japonaises de ce livre profus et bigarré, rappelant Cendrars le curieux de tout et le mange-mots plus que Bouvier l’esthète cultivé, j’ai été saisi par la justesse du titubement initial du voyageur occidental au Japon illico confronté à ce qu’il dit ici une «fascination particulaire» détaillée en ces termes dès son arrivée à Tokyo: «Je regardais vers le nord, vers l’ouest, en direction de Shinju-ku, de Toshima-ku. Il pleuvait fort, grisaillait, mais le brouillard n’empêchait pas de voir que la vile ne cessait pas jusqu’à l’horizon. Infinies détrouvailles, approfondissements, différenciations, murmures des mercures humeuses, foulances errées. Deux jours auparavant, en revenant de la plage de Kamakura pour rejoindre la gare, nous étions remontés à contre-courant le flot d’une sorte de rush-humanity extraordinairement clame et disciplinée qui, déversée par la mégapole que forment Kawasaki, Yokohama et Yokosuka, se rendait au bord de l’eau pour assister au hanabi, le feu d’artifice de l’été. Chaque visage intriguait comme une nouvelle étoile, chaque corps vibrait d’une tenson interne au sein du cosmos, chaque rire éclatait comme l’écho d’une manière de big-bang en expansion assourdissante». -
Varia 2005, VIII
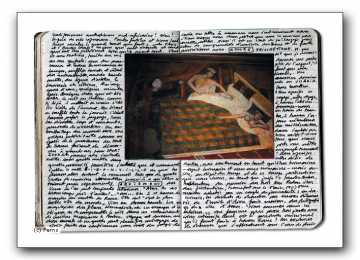 La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.Yves Rosset a voyagé librement une année durant, multipliant les allers-retors entre Berlin où il survit d’expédients (notamment barman de nuit) avec sa petite famille et le Japon, Israël et les States, entre autres points de chute d’un réseau tissant sa maille recoupée par le filet de ses mails amicaux round the world…
Dès les premières pages japonaises de ce livre profus et bigarré, rappelant Cendrars le curieux de tout et le mange-mots plus que Bouvier l’esthète cultivé, j’ai été saisi par la justesse du titubement initial du voyageur occidental au Japon illico confronté à ce qu’il dit ici une «fascination particulaire» détaillée en ces termes dès son arrivée à Tokyo: «Je regardais vers le nord, vers l’ouest, en direction de Shinju-ku, de Toshima-ku. Il pleuvait fort, grisaillait, mais le brouillard n’empêchait pas de voir que la vile ne cessait pas jusqu’à l’horizon. Infinies détrouvailles, approfondissements, différenciations, murmures des mercures humeuses, foulances errées. Deux jours auparavant, en revenant de la plage de Kamakura pour rejoindre la gare, nous étions remontés à contre-courant le flot d’une sorte de rush-humanity extraordinairement clame et disciplinée qui, déversée par la mégapole que forment Kawasaki, Yokohama et Yokosuka, se rendait au bord de l’eau pour assister au hanabi, le feu d’artifice de l’été. Chaque visage intriguait comme une nouvelle étoile, chaque corps vibrait d’une tenson interne au sein du cosmos, chaque rire éclatait comme l’écho d’une manière de big-bang en expansion assourdissante».
Ces notations m’ont rappelé la même sensation-vertige, exactement, qui m’a saisi la première aube blafarde dans le métro de Tokyo, au milieu de milliers de chauve-souris accrochées d’une main à leur poignée, de l’autre tenant l’attaché-case, chacune avec l’étoile éteinte de son visage, jusqu’au rush-humanity de la lente coulée vers les bureaux…
Ensuite le voyageur est en en Judée, qui est celle à la fois d’un croquis rapporté de Chateaubriand («le paysage qui entoure la ville est affreux», où voisinent, dans une atmosphère de banlieue marine décatie. Bédouins de bidonville et soldats fatigués gardant leur arme proche («l’ordre existe de tirer dans la tête si l’on soupçonne que l’être qui s’approche peut être un combattant prêt à mourir»), vestiges archéologiques (Qumrân) et zones militaires, baigneurs de la mer Morte perpétuant la «foultitude solidaire du rhumatisme et de la tordue au fils des ans», et c’est parti pour un arpentage d’Israël qui superpose les images de l’école du dimanche de jadis et celles du vrombissant présent ponctué d’explosions…
C’est un livre à lire lentement et en tous sens, dans l’ordre et dans le désordre, mais avec la même attention qui leste chaque observation de l’auteur. Je vais le trimballer avec moi jusqu’à la fin de l’année et peut-être au-delà. Sa lecture est à la fois intéressante et vivifiante, de point de vue de la langue qu’il touille et travaille au corps.
 Voilà ce que ça donne par exemple: «Emporter en soi un morceau du monde et le bercer pieds nus dans le sable de la Méditerranée ou dans un manteau de laine sous les arbres nus de l’hiver brandebourgeois, parmi un rouge de brique nordique et les odeurs infinitésimales du charbon de houille se glissant dans le décor d’un passé prussien. Quatre millions de réfugiés. Six millions de morts. Le H Manque sur l’inscription en tubes luminescents au sud du Sheraton. Vitres obscures. Mer léchée de flammes perçant le mur protégeant les vivants dormant encore ou déjà parvenus, sains et saufs, sur la plage du réveil. Drames de la mémoire du narrateur à Balbec, imagination de l’eau, lumineuse, lustrale, reflétée aux fenêtres muettes de solitude, encore tapies dans l’ombre».
Voilà ce que ça donne par exemple: «Emporter en soi un morceau du monde et le bercer pieds nus dans le sable de la Méditerranée ou dans un manteau de laine sous les arbres nus de l’hiver brandebourgeois, parmi un rouge de brique nordique et les odeurs infinitésimales du charbon de houille se glissant dans le décor d’un passé prussien. Quatre millions de réfugiés. Six millions de morts. Le H Manque sur l’inscription en tubes luminescents au sud du Sheraton. Vitres obscures. Mer léchée de flammes perçant le mur protégeant les vivants dormant encore ou déjà parvenus, sains et saufs, sur la plage du réveil. Drames de la mémoire du narrateur à Balbec, imagination de l’eau, lumineuse, lustrale, reflétée aux fenêtres muettes de solitude, encore tapies dans l’ombre».Or comme il y en a 500 pages de ce tonneau-là, on se souhaite bon voyage…
Une mentalité me révulse, et c’est celle de la seiche philosophique, qui n’a rien à voir avec la seiche animale, se défendant comme elle le peut et à bon droit. Mais en quoi consiste la particularité de la seiche philosophique? La seiche philosophique a cela de particulier que, plongée dans un bac d’eau claire, elle y diffuse un jet d’encre noire avant de déclarer qu’il n’y a pas plus noir que le monde dans lequel elle, seiche de malheur, a été plongée.
Il y a la seiche du tout est moche. Lui désignez-vous une chose belle, un paysage ou un tableau, un film ou un livre, qu’elle en dénonce aussitôt le défaut.
Il y a la seiche de rien ne vaut le coup qui, arguant que tout a été fait ou que rien ne puisse plus advenir, n’a de cesse de ruiner tout projet et de dénigrer même toute idée de projet, pour mieux se complaire dans son amer bocal.
Enfin il y a la seiche du tout est foutu, dont le goût du noir touche à l’absolu, le seul fait d’être au monde lui semblant la calamité d’origine.
Or comment faire pièce à cette philosophie de la seiche? Essentiellement par un redoublement d’attention, je crois, au détail des choses. Cela seul compte en effet: le détail des choses. Ce qu’on appelle la réalité. L’origine des choses. Le Grand Récit. Paléontologie, livre des strates géologiques, écritures de toutes sortes. Et notre roman d’hier et d’aujourd’hui. Les carnets du papillon et ce qui s’ensuit…
 Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, ce film sublime qu’est les amants réguliers de Philippe Garrel, que j’ai vu hier soir après avoir lu, dans un square, les cinquante première pages de La guerre sexuelle de Frédéric Pajak, qui nous replonge dans l’abjection des temps qui courent.
Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, ce film sublime qu’est les amants réguliers de Philippe Garrel, que j’ai vu hier soir après avoir lu, dans un square, les cinquante première pages de La guerre sexuelle de Frédéric Pajak, qui nous replonge dans l’abjection des temps qui courent.Il va de soi qu’on peut trouver, dans des objets d’art ou de littérature inspirés par des regards diamétralement opposés, le même sentiment de libération intérieure, mais je me garderai bien de situer la satire teigneuse de Pajak au même niveau que le poème de Garrel, dont je suis ressorti intérieurement lavé comme d’un bain de neige. Le blanc de ce film est d’ailleurs celui d’une sorte de neige cernée de cendre, comme les visages irradiant ce qu’on dira simplement, comme chez Bergman, l’âme de chaque individu, dont le réalisateur capte la moindre vibration avec une sensibilité et un amour sans pareils.
Le film de Philippe Garrel «parle» de mai 68 et de la «génération» des soixante-huitards, mais j’étais ravi, à midi, dans la nouvelle livraison de Ligne de risque (No 22, décembre 2005) de lire les propos de Philippe Sollers sur cette foutaise qu’est ce concept de génération, que personnellement je n’ai jamais ressenti, sinon comme une sale idée collante ou un sentiment d’adhésion médiocre. Tout ça pour dire que si Les amants réguliers fait bel et bien signe et sens à propos de ces années-là, c’est tout à fait ailleurs qu’il me touche personnellement, sans rien de la joliesse anecdotique de ce feuilleton italien dont je ne me rappelle plus le nom, relevant du roman-photo.
Ici c’est autre chose. Ce sont surtout des histoires d’amour et c’est le portrait d’un pur. C’est un poème en images dont tous les personnages ont raison. On frise juste un peu l’emphase rhétorique à l’évocation des barricades, mais ce romantisme n’empêche pas la grande noblesse, presque janséniste, du propos; car c’est un filme aussi sur le divertissement en conflit avec l’absolu.
En marchant le long de la rue Saint André-des-Arts, je me suis rappelé les quelques péripéties que nous avons vécues en ces lieux, avec quelques camarades de la jeunesse progressiste, et ma conviction intérieure que ce que je vivais n’avait rien à voir avec ça, que j’étais ailleurs, que toute la rhétorique qui se déchaînait autour de moi tournait à vide, tandis que je retrouve dans ce film tous mes sentiments épars du moment et des temps qui ont suivi, que Philippe Garrel dit de l’inamertume…
C’est à une superbe analyse de La possibilité d’une île que Philippe Sollers se livre dans le dernier numéro de Ligne de risque, où il prend bien soin de préciser tout ce que le distingue, lui le nietzschéen dansant, du schopenhauerien qu’est à l’évidence Houellebecq, mais en multipliant les observations pertinentes et somme toute généreuse, malgré les piques. On retrouve d’ailleurs celles-ci dans le nouveau roman de Sollers, Une vie divine, dont les soixante première pages sont assez épatantes et relèvent nettement plus du vrai roman qu’à l’ordinaire, même si le protagoniste est le même éternel libertin que nous connaissons et qui développe ses vues en coachant une agréable brochette de dames.
Cela étant, Sollers charrie lorsque, comparant Houellebecq et Bret Easton Ellis, il réduit celui-ci à un «simple ludion de marché», une «figure pour magazines».
A-t-il lu sérieusement Lunar Park? Cela m’étonnerait. Evidemment l’auteur américain est peu philosophe, mais je le trouve, pour ma part, plus romancier que Michel Houellebecq et surtout que Philippe Sollers. Comme il en va de Houellebecq pour beaucoup de critiques, l’image médiatique de Bret Easton Ellis fausse probablement la donne, mais que cela a-t-il à voir avec la substance de ces romans. Ce qui est sûr à mes yeux, c’est que celle-ci est organiquement beaucoup mieux «tenue ensemble», et vivante et libre, comme sont vivants et libres tous ses personnages, y compris sa propre projection, que la substance des essais-romans de Philippe Sollers, dont la somptueuse prose (réellement étincelante dans ce nouveau livre, vive et radieuse) et l’intelligence hypercultivée (et hyperétalée) ne font pas illusion, à mes yeux sur le côté complètement plaqué de la création romanesque à proprement parler, le temps, les lieux, les couloirs de la mémoire et du sentiment, bref ce rêve éveillé du roman qu’est précisément Lunar Park et, aussi, dans une toute autre tonalité, La possibilité d’une île.
On sent évidemment, dans les pages d’Une vie divine, la pointe de jalousie que Sollers éprouve à l’égard de Michel Houellebecq, mais il ne devrait pas. Alors qu’il prétend instaurer une nouvelle noblesse du goût, cette façon de se pousser au premier rang de la photo est un peu trop «plèbe», je trouve. Enfin je n’ai rien, pour ma part, contre la «plèbe» qu’il est désormais de bon ton de mépriser. J’ai le tort, sans doute, de ne voir que des gens…
A ce propos, et pour en revenir à un autre roman qui vient également de paraître chez Gallimard, du Lausannois Frédéric Pajak, je trouve chez celui-ci ce même mépris, précisément, mais alors à une dose «panique», dans la peinture endiablée qu’il fait des personnages de La guerre sexuelle, dont l’écriture a heureusement assez de chien pour retenir l’attention. Mais quoi? Faut-il vraiment s’intéresser à cette galerie de nuls? Je me le demande. J’aimais beaucoup Reiser, dont les pires charges avaient toujours quelque chose d’un peu tendre, à part la drôlerie. Chez Pajak, le comique y est certes, mais le trait se force ici jusqu’au mécanique et c’est un peu dommage chez un auteur qui a le punch de Houellebecq mais pas les soubassements…
La lecture d’Une vie divine de Philippe Sollers, dont la brillance me semble de la rhétorique, me laisse un peu sur ma faim après 50 premières pages de lecture. Sollers peut traiter Bret Easton Ellis de «ludion médiatique», pour ma part je trouve bien plus de vraie substance romanesque dans Lunar Park que dans ce nouveau tour de piste de Sollers reconverti au nietzschéisme libertin. Sollers prétend dire ce que personne n’a jamais dit, mais cela me fait sourire. C’est du cirque narcissique du même tonneau que le cirque narcissique d’un Chessex, et leur façon de se mettre en valeur est assez comparable au demeurant
Il y a quelque chose du Pygmalion pédant, chez Sollers autant que chez Chessex, qui me fait sourire. «Et maintenant, nous allons passer à Nietzsche, ma petite…», dit en somme son protagoniste à la charmante Ludi, qui s’en tamponne. On sent l’auteur jaloux, en outre de Houellebecq, qu’il cautionne de manière à la fois paternaliste (l’aîné) et un peu méprisante (le bourgeois). Bref, et une fois de plus, mon sentiment que Sollers est un essayiste de talent, mais un romancier sans entrailles, s’avère. Trop intelligent et trop lucide pour faire un vrai romancier. Intéressant par moments, mais comme une conversation. Son roman en réalité: de la lecture et de la glose. De la glose et de la pose.
C’est Noël et je me réjouis, ce soir et demain, de me retrouver en famille, comme dans nos enfances heureuses et chrétiennes, autour du sapin, lorsque nous tremblions un peu de réciter devant le sapin: «La bougie à l’œil pointu a dit/C’est la fête à Jésus sois gentil.» Depuis hier soir, dans notre isba sous la neige, cela sent de nouveau bon Noël, cela sent la grand-mère à la pommade camphrée et ce soir nos filles et leur oncle ex-taulard nous prépareront un frichti avant les cadeaux. Il n’y aura pas de poésie devant l’arbre puisque les enfants restent à venir mais le sapin est là et les santons de terre cuite et tout le bazar de Noël qu’aucun de nous n’aurait l’idée de démystifier, comme on dit à la télé.
Or l’autre soir à la télé romande, justement, l’idiote de service a cru malin de proposer, à l’heure du Prime, comme ils disent, dans son émission intitulée Scènes de ménage, qui se veut résolument à la coule, le cadeau de Noël original sous la forme d’un godemiché, alternative branchée du rouleau à pâte… Il va sans dire que cela ne m’a pas choqué du point de vue de la morale conventionnelle, mais sous l’angle de la sensibilité je me suis senti réellement blessé en pensant aux braves gens qui ne sont pas armés pour résister à telle insane vulgarité. Le pire blasphème est admissible, non la vulgarité. J’accueillerai volontiers, ce soir, Sade et Genet, dont je sais qu’ils ne ricaneront pas lorsque je réciterai «La petite bougie à l’œil pointu», mais la muflerie médiatique et la vulgarité me semblent absolument inadmissibles.
Le style est la pointe de la discipline et si possible invisible, si possible naturel en apparence, l’effort s’effaçant dans la grâce du geste, comme il en va de la danseuse ou du cavalier, et c’est exactement ce qu’on vit, à l’instant de le lire, à travers deux livres déliés de Marie Nimier et de Jérôme Garcin avec lesquels, en deux bonds élégants, on passera d’une année à l’autre, et qui parlent incidemment de la même chose, à savoir du rapport exact, approprié, supposant un drill rigoureux mais se donnant sans peine, entre la chose vécue et sa transmutation par le verbe.
Marie Nimier se déplace comme sur les pointes dans les nouvelles et autres tableautins de Vous dansez, où sa légèreté de touche, parfois jusqu’à l’évanescence, va de pair avec la concentration et le mordant de l’expression. Prêt à être portés au théâtre (comme plusieurs l’ont d’ailleurs été), ces dialogues oscillent entre l’évocation lyrique et la satire, comme celui qui oppose le journaliste et la ballerine ou le discours in petto de celle qui passe un casting drillé par un expert à formules toutes faites. Même un peu mince, tout ça est très finement filé dans une belle écriture.
 Avec Jérôme Garcin, celle-ci a plus de corps et de coffre. Ceux qui ne sont pas des fous de cheval (comme c’est mon cas, hélas) et qui n’en pincent pas pour le genre diariste (c’est le cas de Garcin, mais pas le mien) seront étonnés de trotter d’emblée, puis de galoper dans la foulée de ce Journal équestre où l’auteur ne consigne en principe que ce qui a trait à son cheval Eaubac et à sa passion.
Avec Jérôme Garcin, celle-ci a plus de corps et de coffre. Ceux qui ne sont pas des fous de cheval (comme c’est mon cas, hélas) et qui n’en pincent pas pour le genre diariste (c’est le cas de Garcin, mais pas le mien) seront étonnés de trotter d’emblée, puis de galoper dans la foulée de ce Journal équestre où l’auteur ne consigne en principe que ce qui a trait à son cheval Eaubac et à sa passion.Or Cavalier seul et bien plus que cela, et d’abord par son style magnifique, dont la tenue reproduit en somme celle de l’écrivain en selle, au double sens du terme. Ce début l’annonce à merveille: «Deux heures de promenade sur la plage désertée de Deauville et sous un ciel bas d’apocalypse. La mer est en colère, elle a sorti son beau gris métal. En guise de préliminaires, les pieds fouettés par les vagues, Eaubac léchouille l’eau salée comme s’il lapait du champagne. C’est un cheval distingué, un peu gourmé. Ensuite, on trotte face au vent et à une fine bruine. Les mouettes s’envolent sur notre passage, Au loin tanguent les bateaux qui rentrent en procession au havre. Eaubac trépigne, à qui la manche donne des envies de rodéo: la marée est très basse, le sable compact, l’air abrasif. Un char à vile nous croise, et le voici parti en coups de cul et autres figures de gymnastique. Je tends à peine les rênes. On s’installe alors dans un galop puissant et cadencé qui n’en finit pas. Extase matérielle».
C’est cela même: extase matérielle. Quand une novice débarquait au couvent d’Avila pour y assouvir son besoin d’élévations mystiques, Thérèse lui désignait aussitôt le seau et la serpillière qu’il y avait là et le grand dallage qu’il y avait là-bas, pour premier exercice spirituel. Dans le même esprit, la danseuse de Marie Nimier et le cavalier de Jérôme Garcin bossent un max pour la seule beauté du geste et de l’art, sans parler du tonifiant plaisir du lecteur. Dans l’un et l’autre cas, la classe du style s’impose le pied-léger…
«Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre», écrivait Mallarmé.
Cela fait-il du monde un cabinet de rat des lettres claquemuré dans sa poussière. Nullement. Car «l’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini», comme le notait Charles-Albert Cingria.
Le même Cingria disait que la meilleure critique ne faisait que coudre ensemble des citations. Lui-même ne s’y tenait pas, mais l’art de la citation est une composante de la bonne critique, et voici que Léon Bloy suggère: «On devrait fonder une chaire pour l’enseignement de la lecture entre les lignes».
L’autre jour, dans son petit bureau de la rue Huyghens, Amélie Nothomb, folle de lecture s’il en est, me rappelait l’observation de Virginia Woolf selon laquelle n’a été vécu que ce qui a été écrit, mais une nuance qualitative est apportée sur ce qui est vécu et écrit par Valéry: «La lecture des histoires et romans sert à tuer le temps de deuxième ou troisième qualité. Le temps de première qualité n’a pas besoin qu’on le tue. C’est lui qui tue tous les livres. Il en engendre quelques-uns».
… Quelques-uns. Le critique d’ultra-droite Robert Poulet écrivit un jour Le livre de quelques-uns, après avoir signé un pamphlet Contre la plèbe. Lorsque je l’ai rencontrà à Marly-le-Roy, je l’ai vu pleurer en évoquant le suicide de sa fille, avant qu’il me recommande de ne jamais faire d’enfants. Je me réjouis de ne l’avoir pas écouté.
Philippe Sollers, dans Une vie divine à paraître au début du prochain millésime, prétend lui aussi, sous l’égide du retour de Nietzsche (l’un des personnages du roman) rétablir telle aristocratie de l’esprit et du goût, non sans hautain mépris. Or celui-ci me semble, précisément, une faute de goût. Virgnia Woolf, elle encore, ne disait-elle pas que l’aristocrate naturel, sachant sa qualité, n’a pas besoin de se comparer ni se se faire valoir. Ces sont des paysans, des artisans, des gens de nos montagnes qui me l’ont appris bien mieux que des patriciens à particule ou des bourgeois. D’ailleurs à Sollers et consorts Nabokov lance au passage: «Le Style et la Structure sont l’essence d’un livre. Les grandes idées ne sont que foutaises».
«Lire, c’est aller à la découverte d’une chose qui va exister», écrivait Italo Calvino et ce n’est pas autre chose que dit Deleuze dans Proust et les signes, qui souligne le dévoilement aval de la mémoire bien plutôt que son involution.
En ceci d’Alberto Manguel, je trouve soudain un écho à ma propre conception de la lecture: «Tout lecteur est un lecteur associatif. Il lit comme si tous les livres étaient les livres d’un même auteur prolifique et sans âge».
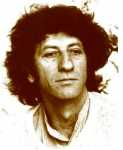 En rangeant mes paperasses, je suis tombé sur la photocopie d’une page de la Lettre internationale, excellente revue disparue depuis des années, reproduisant la version complète des Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis, que je me suis affairé à recopier pour ma gouverne étant entendu qu’un écrivain ne peut que rester jeune et que ces préceptes valent toujours, ou méritent à tout le moins d’être discutés.
En rangeant mes paperasses, je suis tombé sur la photocopie d’une page de la Lettre internationale, excellente revue disparue depuis des années, reproduisant la version complète des Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis, que je me suis affairé à recopier pour ma gouverne étant entendu qu’un écrivain ne peut que rester jeune et que ces préceptes valent toujours, ou méritent à tout le moins d’être discutés.Cultive le doute à l’égard des idéologies régnantes et des princes.
Tiens-toi à l’écart des princes.
Veille à ne pas souiller ton langage du parler des idéologies.
Sois persuadé que tu es plus fort que les généraux, mais ne te mesure pas à eux.
Ne crois pas que tu es plus faible que les généraux mais ne te mesure pas à eux.
Ne crois pas aux projets utopiques, sauf à ceux que tu conçois toi-même.
Montre-toi aussi fier envers les princes qu’envers la populace.
Aie la conscience tranquille quant aux privilèges que te confère ton métier d’écrivain.
Ne confonds pas la malédiction de ton choix avec l’oppression de classe.
Ne sois pas obsédé par l’urgence historique et ne crois pas en la métaphore des trains de l’histoire.
Ne saute donc pas dans les «trains de l’histoire», c’est une métaphore stupide.
Garde sans cesse à l’esprit cette maxime: «Qui atteint le but manque tout le reste».
N’écris pas de reportages sur des pays où tu as séjourné en touriste; n’écris pas de reportages du tout, tu n’es pas journaliste.
Ne te fie pas aux statistiques, aux chiffres, aux déclarations publiques: la réalité est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.
Ne visite pas les usines, les kolkhozes, les chantiers: le progrès est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.
Ne t’occupe pas d’économie, de sociologie, de psychanalyse.
Ne te pique pas de philosophie orientale, zen-bouddhisme etc: tu as mieux à faire.
Sois conscient du fait que l’imagination est sœur du mensonge, et par là-même dangereuse.
Ne t’associe avec personne: l’écrivain est seul.
Ne crois pas ceux qui disent que ce monde est le pire de tous.
Ne crois pas les prophètes, car tu es prophète.
Ne sois pas prophète, car le doute est ton arme.
Aie la conscience tranquille: les princes n’ont rien à voir avec toi, car tu es prince.
Aie la conscience tranquille: les mineurs n’ont rien à voir avec toi, car tu es mineur.
Sache que ce que tu n’as pas dit dans les journaux n’est pas perdu pour toujours: c’est de la tourbe.
N’écris pas sur commande.
Ne parie pas sur l’instant, car tu le regretterais.
Ne parie pas non plus sur l’éternité, car tu le regretterais.
Sois mécontent de ton destin, car seuls les imbéciles sont contents.
Ne sois pas mécontent de ton destin, car tu es un élu.
Ne cherche pas de justifications morales à ceux qui ont trahi.
Garde-toi du «redoutable esprit de suite».
Crois ceux qui paient cher leur inconséquence.
Ne crois pas ceux qui font payer cher leur inconséquence.
Ne prône pas le relativisme de toutes les valeurs: la hiérarchie des valeurs existe.
Reçois avec indifférence les récompenses que te décernent les princes, mais ne fais rien pour les mériter.
Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris st la meilleure de toutes, car tu n’en as pas d’autres.
Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris est la pire de toutes, bien que tu ne l’échangerais contre aucune autre.
«Parce que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche» (Apocalypse 3, 16)
Ne sois pas servile, car les princes te prendraient pour valet.
Ne sois pas présomptueux, car tu ressemblerais aux valets des princes.
Ne te laisse pas persuader que la littérature est socialement inutile.
Ne pense pas que ta littérature est «utile à la société».
Ne pense pas que tu es toi-même un membre utile de la société.
Ne te laisse pas persuader pour autant que tu es un parasite de la société.
Sois convaincu que ton sonnet vaut mieux que les discours des hommes politiques et des riches.
Sache que ton sonnet n’a aucun sens face à la rhétorique des hommes politiques et des princes.
Aie en toute chose ton avis propre.
Ne donne pas en toute chose ton avis.
C’est à toi que les mots coûtent le moins.
Tes mots n’ont pas de prix.
Ne parle pas au nom de ta nation, car qui es-tu pour prétendre représenter quiconque, si ce n’est toi-même?
Ne sois pas dans l’opposition, car tu n’es pas en face, mais au-dessous.
Ne sois pas du côté du pouvoir et des princes, car tu es au-dessus d’eux.
Bats-toi contre les injustices sociales, sans en faire un programme.
Prends garde que la lutte contre les injustices sociales ne te détourne pas de ton chemin.
Apprends ce que pensent les autres, puis oublie-le.
Ne conçois pas de programme politique, ne conçois aucun programme: tu conçois à partir du magma et du chaos du monde.
Garde-toi de ceux qui proposent des solutions finales.
Ne sois pas l’écrivain des minorités.
Dès qu’une communauté te fait sien, remets-toi en question.
N’écris pas pour le «lecteur moyen»: tous les lecteurs sont moyens.
N’écris pas pour l’élite; l’élite n’existe pas: tu es l’élite.
Ne pense pas à mort, mais n’oublie pas que tu es mortel.
Ne crois pas en l’immortalité de l’écrivain, ce sont là sottises de professeurs.
Ne sois pas tragiquement sérieux, car c’est comique.
Ne joue pas la comédie, car les boyards ont l’habitude qu’on les amuse.
Ne sois pas bouffon de cour.
Ne pense pas que les écrivains sont «la conscience de l’humanité»; tu as vu trop de crapules.
Ne te laisse pas persuader que tu n’es rien ni personne: tu as vu que les boyards ont peur des poètes.
Ne va à la mort pour aucune idée et ne convainc personne de mourir.
Ne sois pas lâche, et méprise les lâches.
N’oublie pas que l’héroïsme se paie cher.
N’écris pas pour les fêtes et les jubilés.
N’écris pas de panégyriques, car tu le regretterais.
N’écris pas d’oraisons funèbres aux héros de la nation, car tu le regretterais.
Si tu ne peux pas dire la vérité – tais-toi.
Garde-toi des demi-vérités.
Lorsque c’est la fête, il n’y a pas de raison pour que tu y prennes part.
Ne rends pas service aux princes et aux boyards.
Ne demande pas de service aux princes et aux boyards.
Ne sois pas tolérant par politesse.
Ne défends pas la vérité à tout prix: «On ne discute pas avec un imbécile».
Ne te laisse pas persuader que nous avons tous également raison, et que les goûts ne se discutent pas. Etre deux à avoir tort ne veut pas dire qu’on soit deux à avoir raison» (Karl Popper)
«Admettre que l’autre puisse avoir raison ne nous protège pas contre un autre danger: celui de croire que tout le monde a peut-être raison». (Popper)
Ne discute pas avec des ignorants de choses dont ils t’entendent parler pour la première fois.
N’aie pas de mission.
Garde-toi de ceux qui ont une mission.
Ne crois pas à la «pensée scientifique».
Ne crois pas à l’intuition.
Garde-toi du cynisme, entre autres du tien.
Evite les lieux communs et les citations idéologiques.
Aie le courage de nommer le poème d’Aragon à la gloire du Guépéou une infamie.
Ne lui cherche pas de circonstances atténuantes.
Ne te laisse pas convaincre que dans la polémique Sartre-Camus les deux avaient raison.
Ne crois pas à l’écriture automatique ni au «flou artistique» - tu aspires à la clarté.
Rejette les écoles littéraires qui te sont imposées.
A la mention du «réalisme socialiste», tu renonces à toute discussion.
Sur le thème de la «littérature engagée», tu restes muet comme une carpe: tu laisses cela aux professeurs.
Celui qui compare les camps de concentration à la Santé, tu l’envoies valser.
Celui qui affirme que la Kolyma, c’est différent d’Auschwitz, tu l’envoies au diable.
Celui qui affirme qu’à Auschwitz on n’a exterminé que des poux, et non des hommes, tu le jettes dehors.
Celui qui affirme que tout cela représentait une «nécessité historique», même traitement.
«Segui il carro e lascia dir le genti». (Dante)
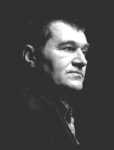 On est ces jours, à La Désirade ensevelie sous la neige, dans le grand silence de l’enfance et des contes, seuls les oiseaux ont des couleurs qui crépitent autour du Macbird’s, et les murmures des livres aussi se distinguent plus nettement, et tel est le conte de ce matin, signé Antoine Volodine, qui me parle d’animale innocence sous le nom de Wong. Il y a de l’oiseau chez Wong, qui se déplace un peu sur les pointes dans la zone minée d’après les Evénements qui ont décimé les cultivateurs de la région, mais on verra bientôt, à l’apparition d’une furie humaine à lance-roquettes et gestes manquant de précision, que Wong n’est pas du genre à s’en laisser conter, surtout d’une créature sentant la crotte.
On est ces jours, à La Désirade ensevelie sous la neige, dans le grand silence de l’enfance et des contes, seuls les oiseaux ont des couleurs qui crépitent autour du Macbird’s, et les murmures des livres aussi se distinguent plus nettement, et tel est le conte de ce matin, signé Antoine Volodine, qui me parle d’animale innocence sous le nom de Wong. Il y a de l’oiseau chez Wong, qui se déplace un peu sur les pointes dans la zone minée d’après les Evénements qui ont décimé les cultivateurs de la région, mais on verra bientôt, à l’apparition d’une furie humaine à lance-roquettes et gestes manquant de précision, que Wong n’est pas du genre à s’en laisser conter, surtout d’une créature sentant la crotte.Aux barbares on ne répond pas, ou pas dans leur langage, mais dans le langage de la civilité. Je me le dis et me le répète alors que je vois se développer une nouvelle tendance des instruits au mépris, qui ne donnera rien de bien. Au mépris il faut substituer le respect sans flatterie et l’attention exigeante, conforme au respect de soi et approprié au niveau de chacun. Il ne s’agit pas de se montrer supérieur, comme y tend un Philippe Sollers, mais bien plutôt de tenir une position digne et généreuse à la fois. Celle d’un William Trevor me semble assez exemplaire, qui relance celle qu’a pu tenir un Tchékhov. Je dirais: une attitude pétrie d’humanité et d’indulgence, mais pure de tout sentimentalisme et de toute démagogie. Chez Tchékhov comme chez Trevor, une égale porosité filtre le double aspect tragique et comique de toute situation humaine. Or je ne cesserai de lire Tchékhov et Trevor durant tote la durée de composition de mon nouveau roman.
On parle aujourd’hui de nouveaux réactionnaires à propos de certains écrivains et autres intellectuels français, tels Michel Houellebecq ou Alain Finkielkraut, mais cette appellation me semble une fabrication médiatique opportuniste plus qu’une catégorie cohérente. En ce qui me concerne, je me suis toujours trouvé en position de réaction, d’abord contre le gauchisme dont les aspects doctrinaires et la visions réductrice du monde n’ont pas tardé à me détourner (peu après la vingtaine, dès le début des années 70), ensuite contre les jobards de tous bords que Marcel Aymé stigmatise si bien dans Le confort intellectuel, enfin contre mes amis de droite confits en bigoterie ou versant dans le nationalisme exacerbé. J’ai souvent été traité de réac par certains, voire de fasciste (à l’époque où j’ai eu le front d’aller interviewer Lucien Rebatet), et sans doute ma position à contre-courant relevait-elle de la droite, sans que le fascisme ni l’antisémitisme ne m’aient jamais tenté d’aucune façon, mais au fond je ne serai jamais qu’un Helvète démocrate un peu bohème et très Monsieur Contrarius, selon l’expression de ma chère mère, surtout poreux, curieux de tout et de plus en plus mal disposé à souscrire à aucune idéologie, tout en m’intéressant de plus en plus aux phénomènes qui en découlent.
Ceci dit, je me sens à des lieues du décri catastrophiste et du mépris humain des écrivains à la Houellebecq, Dantec ou Sollers, tout en partageant bien des vues qu’ils formulent sur la vulgarité et les aveuglements collectifs de l’époque.
A quoi cela tient-il que certaines œuvres de jadis ou naguère nous semblent comme faites ce matin, et que d’autres plus récentes, qui se voulaient novatrices, se ressentent tant de leur époque qu’elles paraissent plus vieilles que les autres? C’est la question qu’une fois de plus je me posais en regardant ces jours La splendeur des Amberson d’ Orson Welles, qui date de 1942, et ensuite Effi Briest de Rainer Werner Fassbinder, tourné en 1974.
 Dans l’œuvre prolifique et passionnante, non moins qu’inégale de Fassbinder, qu’un nouveau coffret réunissant 18 de ses meilleurs films permet de (re) découvrir chez soi, Effi Briest est un bijou qui n’est pas loin de l’esthétique splendide de Welles, avec un effet de distanciation (le fameux V-Effekt de Maître Brecht) qui en signale la «modernité». Relisant le roman éponyme de Theodor Fontane (autre merveille à (re) découvrir), Fassbinder use et abuse de jeux de miroirs et d’artifices de toute sorte pour donner à cette histoire de femme-enfant toute pure en apparence (Hanna Schygulla, d’une beauté à consistance de Sèvres) prise au piège d’un mariage hyper-bourgeois et d’un milieu hyper-conventionnel, sa touche de classicisme formel, quelque part entre Monet et le Visconti de Senso, mais comme dédouané ou dédoublé par l’esprit critique, étant entendu que nous ne sommes pas dupes.
Dans l’œuvre prolifique et passionnante, non moins qu’inégale de Fassbinder, qu’un nouveau coffret réunissant 18 de ses meilleurs films permet de (re) découvrir chez soi, Effi Briest est un bijou qui n’est pas loin de l’esthétique splendide de Welles, avec un effet de distanciation (le fameux V-Effekt de Maître Brecht) qui en signale la «modernité». Relisant le roman éponyme de Theodor Fontane (autre merveille à (re) découvrir), Fassbinder use et abuse de jeux de miroirs et d’artifices de toute sorte pour donner à cette histoire de femme-enfant toute pure en apparence (Hanna Schygulla, d’une beauté à consistance de Sèvres) prise au piège d’un mariage hyper-bourgeois et d’un milieu hyper-conventionnel, sa touche de classicisme formel, quelque part entre Monet et le Visconti de Senso, mais comme dédouané ou dédoublé par l’esprit critique, étant entendu que nous ne sommes pas dupes.Rien de cela dans La splendeur des Amberson, qui «assume» absolument son faste formel et n’en a pas pris une ride pour autant. Paradoxalement en revanche, et malgré sa beauté, Effi Briest se ressent de son maniérisme et d’un soupçon de pédantisme qui procèdent finalement de cette tare d’une certaine esthétique «moderniste», fondée sur la conviction que l’artiste doit rester à distance. On l’a vu mille fois dans les mises en scène théâtrales de la même époque, mais on en revient aujourd’hui. Tant mieux n’est-ce pas? D’aucuns en tirent prétexte pour taxer de réactionnaire ce retour à l’intelligence d’understatement, alors que cette réaction salutaire passe les modes et les doctrines…
Chaque fin d’année est comme une fin de vie, on meurt, on coule, on va toucher le fond, on se dit que c’est affreux, quelle horreur ces cadeaux, quelle horreur ces fêtes, quelle horreur ces gens qui vont se réjouir, on se plaint en se goinfrant de douceurs, on se lamente en se tassant la cloche, on est plus malheureux que les malheureux qui battent la semelle dans la rue glaciale, après quoi sonne Minuit et c’est le lendemain qui chante, rien ne sera plus comme avant, on prend des tas de résolutions, on se sent déjà meilleur rien que d’y penser…( A La Désirade, ce samedi 31 décembre)
-
Dantec le cyborg

Lecture de Grande Jonction (6)
Maurice G. Dantec est un visionnaire déjanté, doublé d’un conteur conjectural et d’un poète aux envolées parfois éblouissantes, comme le prouvent une fois de plus les pages centrales de Grande Jonction, après une assez morne plaine.
Je parle de pages centrales (de 500 à 600) parce qu’on y retrouve une sorte de fusion de l’idée et de la forme qui, proche du délire, nous replonge au cœur de la vraie fiction, par delà le récit de guerre ou la dissertation philosophico-théologique, et qui constitue bel et bien la sphère centrale de Grande Jonction, née de l’autre sphère de Cosmos incorporated
De quoi s’agit-il plus précisément ? Ni plus ni moins que de la lutte contre la destruction de l’Humanité, au sens ontologique. De la lutte contre la mort spirituelle. De la lutte contre ce qui défait l’unicité de l’individu.
Comme on l’a vu dans les 500 premières pages, Dantec brosse la fresque apocalyptique d’une fin du monde dont une entité mortifère, dite La Chose, qui plus qu'une entité est à vrai dire une composante de l’humanité elle-même, exerce ses ravages en vidant les hommes de leur substance « numérique ». Deux forces antagonistes entrent alors en lutte dans le Territoire, lieu-forteresse préservé où se situe le roman, regroupant d’un côté les ennemis de La Chose, et de l’autre un malfaiteur androgyne décidé à s’accaparer tout les pouvoirs en la chevauchant pour ainsi dire...
Dans la prolongation directe de Cosmos incoporated, trois héros (le jeune Link de Nova, guitariste « élu » gratifié du don artistico-spirituel à l’état pur, Youri le soldat-métaphysicien et Campbell l’ordinateur vivant) vont vivre une expérience décisive qui fera de Link un cyborg vivant, relance du Mystère de l’incarnation et produit souriant de la Pure Fiction, en quelque sorte…
On s’embête encore un peu à la lecture de la cogitation sur les mérites théologique de Duns Scot, que le cher Youri découvre avec émerveillement pour les relier aux théories de Cantor, rétablissant ainsi angéliquement le dialogue interrompu de la Théologie et de la Science, mais la suite redevient captivante et rigolote, si l’on peut dire, puisqu’il y est question de la chute de Rome (le dernier carré de la papauté, Pontife en tête, crucifié-pendu-écrabouillé par les hordes hérétiques de tout poil) et de l’abomination universelle que le jeune Link s’apprête à réparer avec sa chouette guitare.
Que tout cela m’apprend-il réellement ? Je me le demande tout de même, alors que je ne me suis jamais posé la question en lisant 1984 d’Orwell, Nous autres de Zamiatine ou L’Inassouvissement de Witkiewicz, ces contre-utopies qui ne cessent jamais de nous parler de notre monde et de notre sort.
Or la paranoïa de Dantec est si ravageuse, et si lourdes ses béquilles idéologiques, que le génie du conteur et du peintre à la Bosch s’en ressent hélas. Ses personnages restent terriblement stéréotypés, l’écriture très inégale dans le détail, et le hiatus est énorme entre la substance théologique dense mais plaquée et cette dramaturgie de bande dessinée.
Ce que j’aime beaucoup, pourtant, chez ce fou de Dantec, est qu’il va justement au bout de son délire, ou du moins qu'il y tend avec une énergie pantelante. Puisse seulement le poète phagocyter progressivement l’apôtre, et l’artiste-écrivain envoyer promener l’idéologue. Mais je rêve peut-être ?
-
Les voix de la nuit
Avant de s’endormir les bonnes dames se repassent le film de cette journée super en se reprochant de n’avoir pas dit ceci ou cela, mais parfois elles oublient quoi (surtout Marieke) et puis elles se disent qu’elles le diront la prochaine fois, si prochaine fois il y a.
Lena se réjouit de rentrer chez elle. Ce n’est pas qu’elle se soit ennuyée un instant en Alberta où elle a été reçue comme sa Majesté la reine d’Angleterre, selon l’expression d’un des mails qu’a rédigé pour elle la très attentionnée Alma, mais les Benjamin n’ont pas d’enfants et donc point non plus de petits-enfants et ça lui manque toujours un peu, à Lena, les petits-enfants des autres.
A l’instant, justement, Clara pense à tout ce que Lena a donné à leurs enfants et leurs petits-enfants, tout en essayant de se représenter ce qu’a pu être cette vie plus ou moins sacrifiée, tant il est vrai que Lena se sera toujours dévouée toute sa vie à telle ou telle cause, non sans prendre la vie du bon côté, comme on dit, et Clara conclut une fois de plus en se disant que Lena est en somme une bonne nature, contrairement à leur sœur aînée qui était tellement plus tourmentée - leur sœur Greta dont le souvenir la tourmente elle-même toujours un peu sans qu’elle n’ait rien à vrai dire à se reprocher, du moins est-ce ce que Paul- Louis n’aura cessé de lui seriner, lui qui ne supportait plus ce qu’il appelait les manigances de Greta en ses dernières années…
Une question que se pose à l’instant Clara lui revient malgré son envie de dormir et c’est la question de la privation : Greta n’a-t-elle pas trop souffert de la privation, j’entends du manque d’amour (tout au moins à ce qu’elle suppose, mais elle en est quasi certaine) et de ne s’être jamais confiée pour se libérer, en tout cas à elle pas plus qu’à Lena.
Paul-Louis semblait avoir de la peine à le concevoir : qu’une femme puisse souffrir de la privation au point d’en devenir pénible, même déplaisante et de l’énerver à la fin : ta sœur est une vieille pénible, disait-il sur son lit de grand malade, ta sœur se montre vraiment déplaisante à ton égard - mais ce que ta sœur peut être tuante…
Paul-Louis n’aimait pas parler de ces choses, mais on sentait bien que c’était cela même qu’il entendait : qu’il avait manqué à Greta de tenir un homme dans ses bras. On le sentait contrarié dès qu’il en était question, comme il était gêné chaque fois qu’elle-même avait essayé d’en parler pour ce qui les concernait, mais c’était comme ça, même s’il était également agacé par ce que sa mère à lui disait de ces choses en les appelant avec humeur ces saletés…
C’est le premier des Trois Tourments de Clara, avec sa sœur Greta et son fils Walter, que de n’avoir pu parler de ces choses du vivant de Paul-Louis, et même avec ses filles d’une génération qui s’est libérée elle n’a pas osé, mais au moins cette chère Marieke, elle, l’a écoutée et l’a pris sans se moquer ni dramatiser, juste ce qu’il fallait, sans réponse pour autant mais au moins ce qui devait être dit l’a été.
Accoudée à la rambarde de la galerie de bois gardant la chaleur de la journée, Marieke en chemise de nuit et en cheveux resonge aux aveux de Clara en se disant en même temps qu’elle aimerait bien rencontrer Lena quand elle reviendra du Canada anglais : cette Lena qui est restée si gaie à ce que sa sœur lui a dit, mais sait-on ce que signifie la gaieté ? se demande aussi Marieke.
Ce qu’elle aimerait comprendre avant de s’en aller, se dit Marieke, ce qu’elle aimerait comprendre à la fin des fins, ce qu’elle aspire un peu plus chaque jour à comprendre, c’est : justement comprendre…
L’emmerdant c’est qu’elle ne se sent pas à la hauteur.
Ce sont les termes exacts de sa cogitation nocturne dans le vent doux : l’emmerdant. Jamais Clara ne parlerait comme ça, on est d’accord, et moins encore Lena. Mais Marieke pense bel et bien : l’emmerdant, et en constatant cette verdeur de langage chez elle, elle se demande : merde, mais d’où ça me vient-il nom de Dieu ? Et les images-réponses affluent alors, qui éclipsent l’image-question sur laquelle elle voulait concentrer son mental.
Ce langage est celui de l’atelier de ses amis de la bohème d’Amsterdam entre-deux-guerres, où l’Art était la Question, l’Art et le Sens de la Vie, l’Art et le Grand Pourquoi ou le Quoi faire ? Et Marieke se le rappelle avec mélancolie : quelque chose a été coupé à ce moment-là…
Et merde aussi, safran de malheur, putain de foc, lançait le Capitaine en mâchant sa Gitane papier maïs sous le vent. Ou m’emmerde pas, scandaient son frère le manchot et son fils le taulard. Nains de jardin et compagnie, on les emmerde ! chantaient-ils de concert à leurs fêtes du petit clan ou aux grandes soupes qu’elle préparait pour les militants aux veillées d’armes ou eux lendemains de leurs Actions de Masse.
Tout cela la fait sourire à présent : toutes leurs motivations et ce qu’elles cachaient souvent, les petits capitalistes en puissance dans les menées des prétendus grands militants, le profit dévié, les envies masquées, tout ce petit tas de caca, elle pourrait mettre des noms mais elle n’a plus l’âge de ces choses et puis juger, tu sais…
Or Clara rétorquait : quand même, ne pas juger, ne pas juger… il faut malgré tout qu’on distingue ce qu’on doit et ce qu’on ne doit pas, d’ailleurs c’est sûrement ça qui leur à fait perdre la boule à un moment donné (elle pense à leurs deux fils malandrins), c’est de ne plus savoir, et presque tout le monde est aujourd’hui comme ça, où est le HAUT et où est le BAS.
Les tribulations de son fils aîné ont cependant laissé comme une béance dans ce besoin chez Clara de s’appuyer à des certitudes. De cela elle ne parle pas, mais la nuit recueille sa pensée et la transmet, que Lena et Marieke entendent d’une façon ou d’une autre.
C’est comme dans un roman, se dit Clara en pensant à son autre fils qui écrit et qui lui parle parfois de ça, la nuit serait comme un roman : j’ouvre la fenêtre et j’essaie de le rejoindre, mais je n’y arrive qu’en le laissant parler. J’ai trop longtemps parlé à Paul-Louis sans le laisser en placer une, jusqu’au moment où, je ne sais comment, cela m’est apparu : que lui aussi voulait me parler, et c’est ainsi que je me suis tue et qu’il a parlé et que nous nous sommes retrouvés, comme dans un roman. Parce que tu peux dire ce que tu veux : quand on te l’a enlevé, quand celui qui a été ta moitié t’est arraché tu restes amputé et ça ce n’est pas inventé.
Quant à son fils aîné, Clara déplore qu’ils ne soient jamais vraiment retrouvés, d’ailleurs elle a consacré à ce Tourment les pages les plus désemparées du Cahier noir…
Lena les a vus passer les uns après les autres. Elle se trouvait en somme à l’autre bout de ce lien qui nous tient ensemble, et c’était à elle, dans son dernier emploi, qu’il incombait de conclure, leur tenant la main tandis que le fil se coupait, en tout cas ceux qui n’avaient plus personne.
Lena pourrait dire elle-même qu’elle sait ce que ça représente de n’avoir personne, mais elle le prend surtout pour les autres.
En Alberta la nuit lui semble plus grande que dans sa ville natale de Lucerne, sur la colline d’où elle voit les montagnes et le lac de cristal, mais la plus grande nuit qu’elle se rappelle a été celle de son premier emploi sur les hauts de Berg am See, d’où il lui semblait flotter au milieu des étoiles.
C’est l’heure de la sieste à Calgary, tandis que Clara, et cette chère Marieke qu’elle ne connaît pas encore vraiment, viennent à peine de s’enfoncer dans l’obscurité, et la nostalgie de Lena la porte à remonter le cours du temps : se retrouver à vingt ans avec les petits enfants de sa première classe d’orphelins de guerre, là-haut sur la montagne, dans la fraîcheur des prairies où, tôt l’aube, elle aimait surprendre les lapins de lune, comme elle les appelait au dam de sa sœur aînée, laquelle la traitait d’affabulatrice écervelée.
Clara a raison quand elle dit que sa bonne nature lui permet de prendre les choses du bon côté, mais ce n’est pas qu’une question de nature, car elle n’ignore pas ce qui ne va pas, mais elle préfère ne pas en parler, j’entends : ne pas s’en parler à elle-même, c’est une affaire de principe, on ne se plaint pas de crainte d’ajouter à ce qui cloche dans le monde.
Il y a en elle une secouriste et, dans l’équipement de celle-ci, une espèce de sourire qui ne la quitte pas. Marieke a raison de se poser la question de sa gaieté, car Jean qui rit tient la main de Jean qui pleure. Il y a en elle un puits de larmes, mais personne n’est censé le savoir : d’où le sourire, dans la pleine conscience de la détresse des petits. Voilà ce qu’elle se rappelle de ses premières années : la peine des orphelins, et leur sourire, qui l’ont marquée à vie et l’ont poussée à rendre service. Elle dirait ça de sa vie en toute modestie et simplicité : j’ai tâché de rendre service, mais à vrai dire c’était tout naturel, c’était sa nature d’être émue par le pauvre sourire de Benjy, au milieu des pauvres sourires des orphelins qui lui ont été confiés à Berg am See, c’était son travail et son bonheur aussi de participer un tout petit peu à la réparation des dégâts de guerre, c’était sa chance aussi peut-être puisque Benjy est devenu le docteur Benjamin, qui lui a fait rencontrer Alma et que leurs retrouvailles ont été si belles.
Alma se dit plutôt bouddhiste mais ça ne la dérange pas autrement : c’est une artiste et qui a voué sa propre vie à l’idéal de la musique en rappelant volontiers à ses élèves que chacun d’eux est « capable du ciel ».
Par ailleurs, la gaîté que Lena sent en elle est peut-être un don, elle ne sait pas, mais peut-être aussi affaire de tenue, se dit-elle souvent en pensant à la mère de sa mère sur la grande photo de famille toujours en bonne place chez sa sœur Clara. Ces gens-là, se dit-elle, n’étaient pas de la haute société, mais quelle tenue ils avaient, quelle affirmation tranquille de ce qu’ils étaient.
Bien entendu, Lena n’est pas tombée de la dernière pluie : elle est plus ou moins au courant des penchants et des tourments de chacune et chacun, sur la photo, et puis on ne passe pas la moitié de sa vie dans la cour des miracles des orphelins ou des rejetons de soiffards et autres miséreux sans se forger une image nuancée de la détresse humaine.
Sa sœur Greta s’indignait saintement contre le Vice, mais sans doute son propre tourment la portait-elle à s’ériger en juge, alors que Lena n’aura cessé, au fil de ses pérégrinations, de constater la difficulté de juger.
Que serais-je si j’étais née, comme la petite Nina, dans une famille de sept enfants dont le père buvait pour supporter la perte de son travail (c’était en 1935) et battait sa femme exténuée, qui est morte l’année où Nina s’est retrouvée sur le pavé et dans les mauvais lieux du Niederdorf ?
Par la fenêtre ouverte Lena distinguait maintenant un livre oublié sur le muret de la pergola des Benjamin, et elle pensa : ne pas savoir lire, ne pas avoir été aimé, ne jamais entendre un bon conseil, ne se rappeler aucun beau geste, ne voir devant soi que des murs sales et n’entendre que des cris…
On entend des cris à l’autre bout de la nuit, dans les bas quartiers du monde, et pourtant c’est ici que ça se passe, constate Clara qui se rappelle la remarque de son romancier de fils devant la photo de famille, quand elle lui a fait observer que les personnages étaient si présents qu’il ne leur manquait que la parole, et lui : « Mais ils parlent ! Tu ne les entends pas ? »
A l’instant c’est le défilé des visages sur l’écran de l’insomnie, et de toutes les époques à la fois, au gré des ressemblances et de ses sentiments.
Sa mère est là qui la regarde, sa mère et la mère de sa mère, tous ils la regardent avec l’air de lui dire : tu es seule et nous sommes tous, mais le tendre colosse qui les domine, son grand-oncle le chercheur d’or au visage d’archange qui les surplombe de sa carrure de lutteur semble ajouter en aparté que tous tant qu’ils sont, tous au ciel malgré leurs péchés, tous ils sont là pour veiller sur elle.
Parfois elle ne sait plus que penser de cette histoire de ciel, mais l’enfant angélique à petite houppe blonde que fut leur premier garçon, ce fils devenu très lourd à la cinquantaine et redevenu très léger à son brusque déclin, cet elfe du portrait encadré sur son mur des consolations, selon l’expression de son autre fils, cet innocent et son Paul-Louis se liguent pour lui faire penser que non : que cela ne se peut pas, qu’on ne peut pas se trouver ainsi séparés à jamais, que ce n’est pas vrai, que ça ne peut pas être permis.
Mais ce ciel où est-il donc ? C’est ce qu’elle a demandé au pasteur Amédée à l’époque où elle cherchait encore Paul-Louis quand elle se réveillait en proie à son Tourment, et la réponse qu’Amédée lui fit, que le ciel était dans son cœur à elle, ne l’a pas tout à fait satisfaite sur le moment, car elle se tourmentait encore à l’idée qu’avec la mort de son cœur à elle Paul-Louis disparaîtrait à tout jamais, sur quoi le bien nommé Amédée l’a rassurée en lui affirmant que leurs cœurs à tous deux se rejoindraient dans cet autre ciel qu’est le cœur de l’Amour éternel.
Mettons, s’était-elle alors dit : admettons. Elle a douté, mais elle admet. C’est en elle qu’il y a le manque et c’est par là qu’elle chutait et rechutait, Amédée ou pas, et pas d’Amour éternel pour la rassurer : le cauchemar la reprenait.
Où est le cœur d’un corps qui tombe ? était la question de ce maudit rêve, dont le Cahier noir de cette période est plein.
Elle l’avait noté : la sensation de perdre pied, dans le rêve, devenait sentiment, et ce n’était plus seulement son corps qui perdait pied, mais son cœur tombait avec, et l’amour de sa vie.
Tantôt c’était dans une tour dont l’escalier se désagrégeait sous ses pas alors qu’elle allait rejoindre son conjoint en train de fumer là-haut sa Parisienne ; et tantôt un abrupt aux vires et aux prises cédant l’une après l’autre et l’angoisse de la chute la réveillait alors pour l’acculer à cet autre vertige d’être réveillée.
Pourtant elle a fait du chemin depuis lors, et cette journée marquera peut-être un nouveau tournant, se dit-elle à l’instant. Elle voudrait le croire, et vouloir croire est déjà croire un peu mieux que ne pas croire. Et la pensée de Marieke, qui dit ne pas croire, l’aide néanmoins à repiquer.
Il ne faut pas se laisser rattraper par le noir, se répète-t-elle. Tu dois t’accrocher. Il faut, tu dois : mais c’est là du vocabulaire militaire, lui objecteront Marieke et son fils qui écrit, mais elle n’y peut rien : elle est comme ça et ce n’est pas demain qu’on la changera.
C’est d’ailleurs ce que lui dit et seriné sa fille puînée, qui lui répond du tac au tac alors que, sur la photo d’elle qu’il y a là, la petite fille bouclée semblait de la meilleure composition qui se puisse imaginer.
Et Marieke de prendre le parti de la rebelle : mais tu as du bol qu’elle te tienne tête, au moins c’est un caractère et la preuve qu’elle tient à sa liberté. Ne me dis pas que tu préférerais une brebis bénie oui-oui…
Or Clara en sourit bel et bien, et de la fronde de sa petite dernière qui a passé la cinquantaine, c’est pourtant vrai, et des pointes de Marieke qui lui font plutôt du bien. De fait cela la détend : même que l’expression relax, Max lui revient du fils aîné de sa fille puînée, que ses cousins appellent le Gourou.
L’adorable Gourou : sur sa photo lui aussi, le petit bout de chou fait bien peigné, mais aujourd’hui quel air d’apôtre en sandales à chevelure de Jésus et aux yeux clairs comme une eau de rivière, enfin quelle irradiante bonté et cette si tranquille opposition à toute manière de conformité – alors comment ne pas l’aimer lui aussi ?
Peut-être était-ce cela, finalement, l’amour éternel ? Peut-être ne lui demandait-on rien d’autre que d’aimer l’amour tel qu’il se manifestait autour d’elle ?
Avec le sommeil Clara s’éloignait peu à peu, cependant, de la berge des visages. Il lui semblait flotter au-dessus d’elle-même. Comme une paix se répandait en elle, et comme une lumière sous ses yeux fermés.
Je suis hier et je connais demain songe la dormeuse dont les doigts continuent de filer au fil de l’eau, et Marieke n’a plus de nom à l’instant d’entrevoir les Masques : elle se sent prête à la pesée ; il n’est que de garder le fil en main et le reste est leur affaire.
Une fois de plus elle se reproche de ne pas connaître la profondeur de l’eau, mais les Masques pourvoiront, songe-t-elle maintenant qu’elle les a bel et bien entrevus ; ce qu’elle sait ou qu’elle devine est que l’heure de la simplicité lui est annoncé par le fil de prémonition et qu’à celui-ci le fil de mémoire ajoute la pleine conscience que ce qui a été sera, sous son nom propre.
Masque Soleil est debout sur sa barque qui s’éloigne vers l’Ouest, poussé par Masque Temps que l’exténuement du jour ne suffit pas à ralentir d’une nanoseconde.
Les images que déploie Masque Fantaisie, toutes liées pour l’instant à l’eau, la ramènent fatalement à ces eaux sombres qu’elle n’en finit pas de scruter.
Le fleuve est celui de son enfance et c’est dans ses eaux que sa mère s’est jetée. Voilà qui est dit : ce sera donc écrit ; c’est un secret qu’elle porte en elle depuis son adolescence et c’est de ce poids qu’on la délivrera, du poids de ce pourquoi qu’elle n’a cessé de traîner, ce lancinant pourquoi dont le fil de mémoire n’a jamais cessé de lui meurtrir les doigts, cet indémêlable pourquoi.
Or, à la pesée de Masque Vérité, elle sait maintenant que ce poids sera le premier à lui être compté et retiré, et rien que d’y penser la soulage.
Les voix de la nuit ne sont parfois que des murmures indistincts, parfois aussi des bribes dénuées de sens, mais c’est le job du romancier de capter celles qui ajoutent à la compréhension de son histoire à dormir debout, puis de les noter le plus clairement possible.
Une voix n’en finit pas de répéter très doucement « Mère, pourquoi m’as-tu abandonnée ? », que le roulement du fleuve, comme d’un train derrière les levées des berges, submerge sans l’engloutir jamais, et cette béance permet de mieux saisir l’origine des silences de Marieke.
Aucun des petits crevés que sont les hommes, selon son jugement de jeune femme trahie et de mère prête à tous les pardons, n’a creusé en elle un tel abîme, mais jamais l’enfant n’a jugé la Criminelle, comme l’appelaient les Sœurs de la Pitié, qu’elle n’a jamais nommée elle-même que l’Affligée, sans pouvoir arracher le clou du pourquoi de ses entrailles.
Les Sœurs de la Pitié papotaient à n’en plus finir en dépit de leur vœu de silence, et cela donnait plus de force encore à l’enfant : je suis seule et vous êtes toutes, le Seigneur soit avec vous, moi je ne comprends pas, murmurait-elle aux lisières du sommeil et sa petite main cherchait celle qui battait follement à la surface de l’eau.
Or Clara, dans un de ces éclairs de lucidité qui lui venaient par l’insomnie, n’était pas loin de deviner que Marieke cherchait autre chose de l’autre côté de l’eau.
Une même confiance en la vie reliait cependant les bonnes dames, et cette même capacité terre à terre de considérer les objets pour ce qu’ils sont, la chose et son mystère.
D'ailleurs, un aspect du rêve captivant le romancier est précisément ce côté terre à terre, lesté de réalité et prodigue d’effets comiques, et cette idée d’Egypte, ainsi, venue de Clara et lancée un peu au hasard, que Marieke avait accueillie avec un rugissement de satisfaction, et qui sûrement emballerait Lena dès qu’on la lui proposerait, cette idée serait le nouvel objet, la folie du moment qui les ferait rêver - et plus encore si ça se trouvait, qui donnerait enfin sa ligne de fond à la deuxième partie du roman.
Ce serait mon dernier voyage, se dira Marieke en émergeant de son léger sommeil, dans cet espace-temps de l’éveil si propice aux imaginations voyageuses, mais pour l’instant elle pionce encore, voyant son fils en Bouddha baigneur, sa fille en paysanne russe défrichant un champ de ronces pour y semer ses achillées boréales, les jumelles jouant en quatre mains sur l’harmonium qu’elle n’a jamais eu les moyens de leur acheter mais dont elle rêve assez souvent, résurgence probable d’une petite église de l’arrière-pays où elle aimait à retrouver le Capitaine au tout début de leur flirt, l’année d’Hiroshima.
Après Caracas en 1981, se rappelle Clara, la neige le matin et le soir le sapin de Noël en plastique au milieu des gommiers et des bananiers, c’est l’Egypte que nous voulions faire avec Paul-Louis, et plus tard la Chine si sa santé donnait le tour.
La retraite anticipée de son conjoint malade, enfin délivré de son emploi d’inspecteur de sinistres à La vie assurée, leur a permis de découvrir le monde après tant d’années à se serrer la ceinture, selon l’expression de Clara, et c’est ainsi qu’ils ont fait la Grèce et la Tunisie en basse saison, le châteaux de la Loire et la route romantique d’Allemagne du Sud, l’île Maurice où ils eurent à subir la grossièreté d’un groupe d’Anglais, l’Espagne et le Portugal une autre année, le Tyrol une autre année encore, et Vienne où Lena les avait rejoints.
C’est à Vienne que Paul-Louis, Clara se le rappelle maintenant, avait évoqué une première fois la Vallée des Rois et son désir de voir les colosses de Memnon, à l’occasion ; ce qui tentait également Lena, autant pour les fleurs du bord du Nil que par souci de visiter les Trésors de l’Humanité.
Paul-Louis disait souvent, avec sa modestie prudente : à l’occasion, et Clara ne l’en aimait que plus, convaincue que ce qui nous est donné n’est pas dû et qu’on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais aussi, ce rêve d’Egypte l’avait revisitée à la faveur d’un récent documentaire à la télé, dont les images lui avaient rappelé les cauchemars du début de son deuil.
Une jeune égyptologue avait parlé, dans le reportage, de la chrysalide de la momie, de laquelle s’envole le papillon de l’âme du défunt, et cette image avait saisi Clara, qui recoupait précisément la vision d’un des rêves obsessionnels dont elle avait consigné la description dans son Cahier noir.
Clara ne voyait pas trop à quoi tout ça rimait, n’osant trop en parler à Ludmila, qu’elle savait pourtant assez familière de l’Egypte ancienne, mais l’immédiate réceptivité de Marieke à ce sujet, ce même après-midi, lui avait rendu confiance et peut-être était-ce, une chose en appelant une autre, cette implication très intime qui lui avait inspiré l’idée de telle équipée égyptienne ?
De ce séjour à Vienne, et d’une conversation animée à Grinzing, dont le vin doré les avait un peu éméchés, date le rêve de Lena qui lui a suggéré l’idée que le fil de la vie, loin d’être coupé par la mort, se renoue et rebondit comme un lapin de lune.
Clara et Paul-Louis avaient été étonnés, même un peu émerveillés, l’alcool aidant, d’entendre Lena leur parler des lapins de lune qu'elle allait guetter tôt l’aube au début des années de guerre, sur les hauteurs de Berg am See où elle avait décroché son premier poste, et l’on avait ensuite parlé de ce qu’il y a après, qui restait assez vague à ce qu’elle se rappelait, seuls les lapins bleus restant très présents à sa mémoire.
Jamais Lena n’a voulu creuser : elle a préféré les savoir en elle, libres et bondissants, jolis, mutins, imprévisibles. Elle aurait pu le demander au savant docteur Benjamin qui avait été psychiatre avant de se consacrer entièrement à la musique, mais elle a finalement gardé son petit secret, comme celui du jeune homme des îles Samoa.
La vie rebondit ainsi en dépit de nos rhumatismes et de l’encrassement de nos artères, songe Lena qui vient de relire, après un petit somme, le chapitre final de Vie de Samuel Belet du romancier welche Ramuz que lui a offert son neveu qui écrit.
Elle lit ces mots qui la rendent à la fois triste et gaie, parce qu’ils sont vrais. Samuel a vécu. Il a vu du pays, comme on dit. Il regrette seulement de n’avoir pas su aimer assez ou au bon moment, alors que lui-même est entré dans la vie par la petite porte, comme beaucoup des orphelins dont elle s’est occupée ; il regrette d’avoir été rejeté par sa première amoureuse et, ensuite, de n’avoir pas été accepté par l’enfant de la veuve qu’il a épousée sans trop l’aimer, mais ce qu’il écrit tout à la fin dans son cahier, après le récit de la mort de sa pauvre femme et celle de son pauvre garçon, Lena le lit et le relit en pensant évidemment à sa propre vie : « Car tout est confondu, la distance en allée et le temps supprimé. Il n’y a plus ni mort, ni vie. Il n’y a plus que cette grande image du monde, dans quoi tout est contenu, et rien n’en sort jamais, et rien n’y est détruit ; c’est un degré de plus, il faut encore le franchir ; mais on voit devant soi se lever ce visage, qui est le visage de Dieu. Lui aussi, j’ai appris à l’aimer et à le connaître ; je sais qu’il est tout et qu’il est partout ».
Lena pense aux Indiennes aussi, à propos de Marieke qu’elle n’a rencontrée que deux ou trois fois mais qui lui a parlé de la sagesse des tribus de la Prairie, pour lesquelles la terre est une mère et les rivières le sang de leurs ancêtres. Alma et Benjy sont également très attirés par cette façon de voir et d’aimer la vie, qui rejoint en somme celle de Ramuz : que tout est contenu dans la même Image, que tous les êtres sont reliés.
C’est d’ailleurs dans le même esprit que la voyageuse, depuis le temps de Berg am See et partout où elle a séjourné, aux quatre coins du monde, n’a cessé de compléter son herbier dont elle aime feuilleter les cahiers chaque fois qu’elle se retrouve seule dans la maison sur la colline.
Elles l’ont appelé la femme du vent parce que Marieke a raconté aux jumelles que le dernier amant à la caresser était le vent, mais par elles s’entendent aussi toutes les nanas de cousinage, qui se retrouvent de temps à autre en petit gang.
Clara cuisine l’aînée de son aîné, la plus fidèle au scrabble, mais actuellement aux Maldives avec son trader napolitain, à roucouler probablement O sole mio sur quelque atoll, et Valentine la renseigne volontiers. Ainsi Clara fantasme-t-elle un peu à l’instant sur cette histoire de caresses en regrettant de n’avoir pas eu de cousines avec lesquelles jaboter.
Les filles en fleur sont tellement plus décontractées que celles de sa génération, mais attention : elle voit bien que tout ne tourne pas forcément comme sur des roulettes et que les problèmes restent les problèmes.
A l’approche du jour, après que l’insomnie blanche a soudain cédé à la coulée du sommeil, Clara se sent plus réceptive qu’à aucun moment de la journée, avec des poussées de panique mais des embellies aussi, et de plus en plus, en tout cas depuis ses retrouvailles d’avec Marieke, qui lui font soudain oublier que le temps est le temps et qu’il va falloir s’activer comme à l’accoutumée, parce qu’elle ce n’est pas le vent qui va l’aider ce matin.
Clara pourrait être un peu jalouse de l’image si romantique ou romanesque que les cousines se font de Marieke, et pourtant non : Clara n’est pas jalouse. Elle estime malgré tout qu’elle a reçu tout ce qu’elle pouvait espérer, et que ce qui lui a été repris sera repris à tous, ma fi : c’est la vie. Comme Paul-Louis le disait à propos de sa maladie quand elle repartait après des mois de semblant de rémission : c’est la vie.
Et chacun son style, se disait-elle aussi à l’instant, en se rappelant que Paul-Louis ne pouvait dormir qu’en pyjama, alors que la plupart des cousines, ainsi que le lui avait révélé Valentine, dormaient en t-shirt.
Cette histoire de vent lui rappelait, cependant, que jamais, dans sa famille, quiconque n’aurait eu l’idée d’aller nu sur une plage ou, pour les femmes, de dormir dans une autre tenue que la bonne vieille chemise de nuit. Mais à propos : dans quel vêtement les squaws dormaient-elles ? Et de quelle étoffe pouvait bien être la chemise de nuit de Marieke ?
A l’instant précis, éveillée elle aussi, Marieke se livrait, dans la chemise de coton XLL que Ludmila lui avait ramené du Midi, aux exercices de yoga-stretching qu’elle faisait tous les matins sur les conseils de son fils.
La souplesse est une manière d’être, répétait-elle volontiers aux jumelles en luttant contre ses propres rigidités, et le fait est que l’exercice l’avait aidée à se conserver à tous égards, physique et mental, et ce malgré tout le bazar des artères encrassées et des questions non résolues qu’elle aurait encore aimé travailler, selon son expression.
Cette histoire d’âme d’un côté, qui est pure, et de corps impur de l’autre, disait-elle également aux jumelles, parce que toute son éducation chez les Sœurs de la Pitié en avait été saturée, tout ça c’est de la pensée-cervelle que vous ne trouvez pas dans la Nature, et c’est ça que les Indiens nous rappellent, nom de bleu : que la chair et le vent, la terre et les rivières ont partie liée.
Pour autant, pas plus que Clara ou Lena, Marieke ne rejetait l’idée que l’âme survivrait au corps, à cela près qu’elle se disait parfois que tout était corps et que l’âme était comme un souffle, et parfois au contraire que tout était âme et que le corps n’en était que la partie visible et sensible. Mais voyait-on vraiment le corps ? Et l’âme était-elle réellement invisible ?
Deux des bonnes dames émergeaient ainsi de la nuit, tandis que la troisième allait s’y enfoncer tout à l’heure. Or Lena venait d’éclater de rire en relisant, dans le récit de Samuel Belet, le passage lié au Robinson suisse et sa remarque ingénue : « Je me passionnais surtout pour quand le boa mange l’âne ».
C’était cela la vie, se disait Lena : c’est se passionner pour quand le boa mange l’âne.
Et sous l’effet de l’effet papillon, que la licence poétique de la fiction permet de recycler, il est loisible aussi de penser que le rire de Lena, le boa et l’âne, ont à voir dans la gaîté matinale de Clara et Marieke, qui ont pour point commun d’avoir lu le Robinson suisse à leurs enfants.
Vous allez me dessiner le boa qui mange l’âne, ordonne l’instituteur Dieu Le Père à sa classe Humanité, et les cancres sont les plus rapides à s’exécuter.
Le boa mange donc l’âne dont l’âme coupera cependant aux dents du crocodile, car nulle part il n’est dit qu’une âme d’âne ait à subir la pesée.
Les ânes du bord du Nil, à l’instant où deux bonnes dames saluent la lumière diaphane du nouveau jour tandis que la troisième se remplit de la douceur du soir, se découpent en fines silhouettes que ne fait même pas trembler le tremblement du Temps.
Les ânes furent et seront, partie du décor que les bonnes dames prendront bientôt en photo sans s’en rendre compte, juste émerveillées par les felouques du bord du Nil, et par les felouquiers grimpant pieds nus aux palmiers.
De fait cette idée d’Egypte fait s’activer Clara avec une neuve énergie, elle qui a déjà aéré et tendu son lit au carré et se demande maintenant s’il est convenable, à cette heure, de proposer à Lena cette folie…
(Ce texte constitue la dernière séquence de la première partie du roman intitulé Les bonnes dames, en cours de finition) -
Devant la mort qui vient
Les bonnes dames ne sont plus qu’une, aujourd’hui, pour se rappeler comment s’acheva cette soirée, l’avant-veille de leur retour de Louxor, mais Lena se fait à son tour de plus en plus oublieuse, qui a gardé pourtant quelque part une photo de leurs deux amis américains qu’elle se reproche de n’avoir pas encore remerciés, gottverdammi, pour leurs derniers vœux de Nouvel-An 2006, et voilà qu’on se retrouve une fois de plus à la veille de l’été indien.
Le romancier eût aimé lire, à Marieke, le récit de leur périple égyptien, mais à peine l’avait-il achevé que la mère de Ludmila, au terme d’une nuit à se vider de son sang, se retrouvait dans une cellule de l’Hôpital de Nuit, murmurant quelques derniers mots à ses enfants puis se retirant sur cette espèce de radeau du lit blanc.
- Tu n’aurais pas dû, lui reprocha doucement le romancier en se penchant sur elle, après qu’Adalbert et Ludmila lui eurent raconté leur nuit à la veiller, et sur un bout de papier il nota au crayon violet :
Combien nos mots semblent vains
quand l’heure est venue,
et l’heure est là : tu t’en es allée déjà.
Tu repose devant nous, nous t’entourons,
mais tu n’es plus nulle part
que partout, à jamais,
dans nos entrailles,
on ne sait où.
Celui que tu as lavé petit
t’a lavée cette nuit ;
celle que tu as bercée
te berce de ses larmes
dont la mer afflue
au désert de l’absence,
et quel autre mot dira
Cela ?
Le lendemain, avec Adalbert, il retrouva dans les affaires de la mourante le poème aux Enfants de Louxor et les photos qu’il s’apprêtait justement à lui demander pour le premier chapitre de la troisième partie de son roman, où les bonnes dames se retrouveraient afin d’évoquer leur désormais légendaire odyssée.
Marieke reposait bien blanche sur son lit blanc, respirant régulièrement au contraire de Clara que, quatre ans auparavant, dès le même jour de l’Assomption, lui et ses soeurs avaient veillée dix jours durant, bien blanche elle aussi sur son lit blanc mais semblant combien plus tourmentée.
Qui est là ? s’était-il demandé, et Ludmila l’avait regardé pendant qu’il entrouvrait le Cahier noir, et sept jours durant il avait sangloté en déchiffrant, une page après l’autre, les mots de la détresse solitaire de sa mère.
La suite de l’autre poème lui revint :
Combien de papyrus enroulés dans ma tête
ne verront pas le jour ou seront oubliés
aussi vite que moi.
Cela le fit sourire : les oublis de Marieke…
Puis il pensa qu’au même instant, dans un repli de la mémoire de Joe Felice ces autres mots survivaient peut-être :
J'aurais aimé pourtant bâtir ma Pyramide
et que tous mes amis puissent dormir dedans…
Or que pouvait bien être sa poésie à celui-là ?
Le romancier l’imaginait simple et limpide, songeuse un peu, douce comme il s’était figuré le personnage en le plaçant sur le chemin des bonnes dames, et comment ne pas prendre pour un signe clair le fait que Joe s’était donné la peine de mémoriser ce poème, à croire que lui-même aurait pu le composer ?
D’ailleurs à l’instant le poème revenait bel et bien à Joe Felice, quelque part dans une forêt d’Amérique où il cheminait:
Les enfants de Louksor ont quatre millénaires
ils dansent sur les murs et toujours de profil…
Il semblait au romancier que des sphères contenaient tous ces visages et ces voix, ces paysages, ces heures, les méandres là-bas de ce fleuve qui roulait quoique semblant immobile, et tout lui revenait en allant, demain il irait voir sa chère Lena mais lui dirait-il que leur Marieke agonisait ? Plutôt il lui ferait raconter la suite de son roman, Lena lui dirait ce que Marieke lui avait confié dans la lumière bleutée du Pavillon, doucement il la cuisinerait puisque tel était son métier, puis on se régalerait dans le restau stylé où il accoutumait de l’inviter, enfin elle le raccompagnerait au train, il lui aurait apporté un nouveau livre comme à l’accoutumée, elle lui dirait merci, il la verrait s’éloigner au bout du quai, toute cassée comme un fétu.
A l’Hôpital de Nuit, contemplant la gisante, le romancier se rappela les mots de Ludmila qui s’imaginait Marieke se promenant un peu dans ses pensées avant de se décider au grand lâcher de ballons, et l’image des sphères colorées lui remémora une autre conversation avec Adalbert.
- Nous cherchons tous notre forme, lui avait dit le fils repenti qui, de la zizanie contestataire aux malversations frottées d’idéal artiste, s’était retrouvé, libéré de plusieurs années de réclusion, une nouvelle âme qui se nourrissait aux sources les plus diverses et s’épanouissait dans l’invention culinaire autant que dans la spéculation philosophique.
- Je sens ma forme actuelle déchirée par l’angoisse d’attente et c’est pourquoi je chiale si dru, poursuivit-il en s’excusant.
Et le romancier de s’accaparer aussitôt cette formulation d’un sentiment qui le touchait au corps plus qu’au palpitant.
- Sait-on jamais ce qu’il en est de la limite de réseau de nos antennes ? médita-t-il tout haut en pensant aux sphères en formation de ses phrases, puis la courbe de l’une d’elles le ramena au gosier entrouvert de Marieke, dont il se disait que plus jamais aucun mot ne sortirait.
Et le cher Adalbert de tout piger et d’enchaîner :
- Ne voudrais-tu pas, camarade, en fumer une rien qu’une sur le gazon, je ne supporte plus la vue de ce maman-poisson cherchant sa bolée d’air.
- Mais je ne fume plus, ni toi, que je sache.
- Raison de plus pour caser ça dans ton roman.
Et de fait le romancier fit ressurgir un paquet de Job d’avant le Déluge de son velours côtelé, ou des Players, des Craven, des Lucky, des Boyards, des Gitanes, des Gauloises bleues, enfin tout ce qu’on avait exhalé de par les années ; et dans la tabagie on les vit fouler la pelouse toute bénie de rosée.
Sur la barque de la nuit, entre deux rivages, la bonne dame repose en attendant la pesée de son âme.
- Nom de bleu, qu’on me débarrasse de tout ça, semble-t-elle maugréer dans son bloc de silence. Y es-tu Capitaine ?
Il y a tant de temps qu’elle aspire à se délester, Marieke. Qu’on lui prenne tout ce poids, aura-t-elle ronchonné souvent, mais à l’instant tout ça lui semble si léger. C’est vrai : la vie est en train de faire d’elle une plume, pour un peu qu’elle se mettrait à voler.
Et de constater: ils sont allés, les sacripants, s’en fumer une à la récré ; et Ludmila non plus n’est pas là, ni mes jumelles à moi, donc c’est le moment où jamais : je vais m’esquiver fissa...
Mais d’où sort-il celui-là ? se demande le romancier quand, avec Adalbert il remonte à l’Hôtel de Nuit pour reprendre la veille.
Il y a là, tout contre la fenêtre et cherchant à s’échapper visiblement, une espèce de papillon immaculé.
Alors on fait, n’est-ce pas ? ce qu’on fait dans ces cas-là : on le rend au ciel, c’est cela, bon vol et va donc voir si le Capitaine y est, ma bonne Marieke…(Ce texte constitue la dernière séquence de la deuxième partie du roman intitulé Les bonnes dames, en cours de finition)
-
Dernier repas
C’est presque sans dire un mot que Marieke présida à son dernier repas en présence de ses enfants, du romancier et des filles de sa fille, à l’Auberge du Soleil, quelques jours avant son entrée dans le grand silence.
- Nom de bleu ce qu’on se régale, s’exclama-t-elle pourtant en touchant à peine à la poule faisane qu’elle avait commandée, et si fort que quelques Chinois qu’il y avait juste à côté se retournèrent.
Et ceux qu’elle aimait de remarquer, à l’unisson, qu’avec le coffre qui lui restait on était parti pour le centenaire.
Or tel était bien son dernier vœu, à Marieke, qui avait commencé de se taire pour se contenter de les écouter tout en se parlant à elle-même.
De fait, Marieke ne cessa de se parler pendant tout ce dernier repas au milieu de ceux qu’elle aimait, elle ne cessa de se raconter à elle-même ce que sa vie avait été.
En feignant d’écouter Adalbert qui s’était lancé, avec l’aînée des jumelles, dans un débat passionné sur la distinction tout à fait essentielle, n'est-ce pas, entre les notions de Djihad et de Fitna, elle se rappela son père et le père de son père dont celui-ci n’avait jamais rien voulu leur dire, à elle et à son frère.
C’est comme si nous venions à moitié de nulle part, songea Marieke en souriant vaguement au romancier qui souriait à Molly dont le sourire béat laissait à penser qu’elle était tout en pensée avec son joli cœur de Billy.
Son frère Sigisbert avait fait des recherches de son côté, se rappela Marieke, mais avait-il jamais découvert la vérité? Pour sa part, elle se contentait de penser que ce refus de parler de son père, peu causant au demeurant, devait relever de la même douleur qu’il manifestait chaque fois qu’on évoquait devant lui la neurasthénie de leur mère et de sa sœur, toutes deux suicidées.
Elle repensait à la question que le tendre Jim avait formulé ce soir-là, dans la chambre de Clara: que savons-nous des autres?
Elle y pensait à l’instant en remerciant son Adalbert qui lui reversait un verre de vin d’Arbois: et qui était-il celui-là qu’elle avait porté? Et Ludmila et son lascar? Et Dolly qui déployait maintenant toute sa science d’arabisante alors qu’elle avait gardé quelque chose du petit écureuil vif-argent qu’elle avait été en son enfance, et Molly qui passait en un quart de seconde de l’irradiante vivacité à la plus noire mélancolie, et le Capitaine parti sans un mot d’adieu?
La pauvre Clara s’est tourmentée à propos de son insaisissable Peter, songeait Marieke, son Cahier noir est plein de ce tourment à ce que m’a dit le compagnon de Ludmila, jamais elle n’aura compris le comportement fuyant et dissimulé de son premier enfant devenu mythomane et pour ainsi dire délinquant avant de sombrer dans la maladie et d’y succomber en moins d’un an. Jamais Dora elle-même, comme elle l’a raconté au romancier en veillant au chevet de Clara mourante, jamais elle n’a percé à jour celui dont elle a partagé la vie, pas plus que ses deux enfants n’auront jamais eu l’impression de rencontrer vraiment leur père, et voici mon tourment à moi: ma pauvre Flora qui ce matin-là, j’ai douze ans, enjambe la barrière du pont du chemin de fer surplombant la Meuse, avant de rendre son dernier soupir dans les bras des pêcheurs qui ont tout fait pour la ramener à la vie.
- Êtes-vous servie, Madame? lui demande une dame assez stylée qui lui rappelle ses propres années de service à la pension La Prairie tenue par la mère du Capitaine.
- Je me suis délectée. Vous pouvez desservir. Mais les filles, reprenez donc de la poule faisane de la patronne!
Or qui se doute, autour de cette table heureuse, de ce que ça fait d’apprendre, à douze ans, que ta mère plus jamais ne te prendra dans ses bras?
Sa Ludmila, dont ils ont craint quelque temps que jamais elle ne serait mère, après la déconvenue d’une première séparation, sa Ludmila l’a été, mère, pour Dolly et Molly, comme elle-même a essayé de l’être pour ses enfants, et cela aide comme on dit…
Or Ludmila y va précisément de son numéro:
- Les jumelles, je vous rappelle qu’on ne sauce pas son assiette, lance-t-elle à ses modèles d’éducation bohème tout en sauçant elle-même son auge faute de pouvoir la nettoyer à grands coups de langue.
En somme on me l’a jouée trois fois Cendrillon, se dit Marieke en consultant la carte des desserts (comme c’est elle qui invite, elle a conseillé Dolly et Molly de se taper ce qu’il y a de plus cher), Père a tenu parole en ne se remariant pas avant ses dix-huit ans mais sa Bettina m’a traitée exactement comme la femme et les filles du Docteur Jawohl et comme la mère du Capitaine, et d’ailleurs Adalbert, à propos de Bettina, a confirmé lorsqu’il est allé rendre visite à la chipie.
- C’est exactement ça: c’est la vilaine marâtre de Walt Disney aux doigts crochus. Comme je comprends que tu aies foutu le camp, Marieke!
Et c’est exactement ça aussi: son fils l’appelle Marieke, comme il a toujours appelé son père le Capitaine. Marieke a de la peine à imaginer que les enfants de Clara l’appellent par son prénom, mais cela se fait ainsi dans le petit clan indien qu’ils ont formé, jusqu’aux militants que lui ramenait Adalbert à la grande époque de la contestation – tous l’auront toujours appelée Marieke, va savoir pourquoi.
- Marieke?
- Dolly et Molly se sont mises ensemble pour la ramener sur terre.
- Marieke. Tu n’a donc pas envie de dessert?
- Si, je prendrai de leur sorbet à la rose…
Après le dessert, elle le leur demandé assez solennellement, ils la laisseront seule un moment, elle marchera jusqu’à la corne du bois, là-bas vers le promontoire dominant l’immense conque bleue du Léman, ce lac qu’elle a tant aimé traverser depuis que le Capitaine lui a fait faux bond, mais pour l’instant on lui présente son sorbet qu’elle va arroser de trois doigts de liqueur de genièvre (c’est elle qui, en douce, en a sorti une fiole de son sac à fourbi) et elle dit come ça de son ton le plus inspiré:
- Merci bien, au moins.
Cette dame assez stylée doit avoir l’âge qu’elle avait quand elle a vécu le plus triste épisode de sa vie, à la fin de la guerre, mais le pire n'a pas été pour elle la guerre, malgré les horreurs de celle-ci, le pire a été cet homme qu’elle a aimé comme une damnée, ce lâche comme ils le sont si souvent, ce catho de bonne famille qui n’a pas voulu de leur premier enfant, la charcutant lui-même avec ses instruments d’étudiant, ni du second qu’il lui arracha de la même façon par souci de convenance bourgeoise et de religion, tu vois ça, quand même pas qu’une fille d’ouvrier chef de syndicat et de suicidée s’en vienne entacher mon nom et ma carrière, oui Madame Assez Stylée lorsque j’arrive dans ton petit pays bien peigné je suis la ruine ambulante sortant des décombres encore fumants, et à vous ma révérence:
- Votre sorbet est délicieux.
Autour d’elle la conversation n’a pas tari; elle se sent bien Marieke, et ça se voit, elle fait semblant d’écouter mais sans doute Ludmila n’est-elle pas tout à fait dupe, qui sait combien elle aspire depuis quelque temps à s’envoler, destination le Sud suprême où l’attend, clope au bec, le Capitaine; autant qu’elle-même, Ludmila est pourvu d’antennes spéciales et peut-être même a-t-il déjà deviné que ce repas serait le dernier?
Statistiquement, pense Marieke tandis que la dame assez stylée croit bien faire en lui proposant un déca (et quoi encore, mijaurée, tu me crois incapable de supporter un bon shoot de caféine?), statistiquement il y a, sur dix mecs, un quota régulier de trois sales cons, je suis en mesure, n’est-ce pas Molly (qui en a fait la cuisante expérience avant de se rattraper aux branches de Billy) et Dolly, n’est-ce pas Ludmila? je suis et vous êtes, nous sommes en mesure de donner des noms…
Mais nous les emmerdons, poursuit Marieke qui n’a que faire de donner des noms, tandis que Molly, justement, fait voir ses MMS de Billy au restant de la tablée, nous les emmerdons car c’est à la bonne vie et aux bonnes gens que seront consacrés nos derniers pensers.
La lumière revient dans le film de sa vie avec le souvenir des bons types de la statistique: et voici paraître son artiste de frère Sigisbert et ses amis nos grands peintres amstellodamois, ou êtes-vous aujourd’hui mes chevaliers servants à la folle palette, où êtes vous Ger Lataster et Pieter Defesche dont les toiles m’ont accompagnée partout et reviendront à Dolly et Molly, où traînez-vous vos auréoles de saints clandestins, en quelle Utopie dont nous avons tant rêvé au long de nos longues nuits de rebelles?
La p’tite Clara me confiait ses Problèmes et c’était touchant de la voir se délester de ses humbles secrets de bonne dame dont je me gardais bien de me gausser, sachant qu’aucune peine ne se mesure ni ne se compare.
Et puis merde aussi: sans ce carabin de malheur je ne serai pas partie de là-bas, je n’aurais pas rencontré le petit chevrier aux casseroles aussi étincelantes que ses dents, pas de Capitaine non plus sans ce con-là, pas de Ludmila, pas d’Adalbert et par conséquent ni Dolly ni Molly, tu vois la cata?
- Marieke, eh bien Marieke, ne voulais-tu pas faire quelques pas? Marieke, la nuit va tomber…
C’était Adalbert qui la secouait, Adalbert auquel Marieke, rassemblant ses faibles forces, s’appuya pour se lever tout en lui désignant le sac aux trésors de la vioque dans lequel il suffisait de puiser pour régler l’addition, et, quelques paires de minutes plus tard à clopiner jusque là-bas, voilà qu’elle se tenait à la corne du bois où elle poursuivit et même acheva sa songerie.Et voilà notre dernier tableau, se dit-elle avec une dernière pensée à ses amis rapins auxquels elle irait bientôt rapporter les derniers ragots de la vie.
Le Capitaine m’en a fait voir lui aussi, et mon fils Adalbert ne m’a pas épargnée non plus, mais les bougres sont du bon côté de la statistique, autant que vous deux.
Voilà le tableau: cette lumière du soir, tout ce bleu et cet or en fusion c’est ma vie nom de Dieu, tout ce bleu du lac qui a l’air d’une mer dans ses moments de rêve ou de colère, tout ce bleu de nom de Dieu qu’on croit qu’il n’existe pas alors que là je le regarde dans les yeux, allez regarde-moi foutu Vieux, regarde ce que tu as fait de la Marieke, regarde de ta myriade d’yeux de Dieu qui voit la fourmi noire sur la pierre noire au fond du trou tout noir, regarde tout ce bleu qui me boit, tout ce bleu qui fond en moi en déclinant là-bas dans l’outremer, regarde le bleu qui sombre, je te rends ma vieille peau Grand Esprit, Grand Tout, qui que tu sois, Gaïa ou Père de Iéshouah, je m’en fous pas mal de ton Nom, allez, allons, en allons-nous et ils s’en allent, je titube et ça va comme ça, je rends mon tablier dans lequel vous trouverez tout mon Amour.Ce texte constitue l'avant-dernier chapitre du roman Les bonnes dames, achevé le dimanche 3 septembre.
-
Le rêve de Lena
Lena refait volontiers le voyage de Louxor avec les bonnes dames, le diligent Adalbert lui ayant remis, selon les volontés de la défunte, le vormidable ordinateur qu’il acquit naguère avec l’argent de Marieke, dont il lui a patiemment expliqué l’usage.
Son projet de se raconter ne s’est pas concrétisé pour autant, en revanche elle est tout à fait capable d’utiliser la messagerie de l’appareil, elle fait désormais ses comptes au moyen de celui-ci, via l’Internet qui lui permet en outre de se commander du pain de poire et autres denrées, enfin plus sensationnel encore: de voter et de surfer.
Lena écrit ainsi chaque semaine à ses amis de Calgary, qui lui ont promis de lui rendre visite à la fin de l’année pour un dernier pèlerinage à Berg am See dont les vestiges de l’hôtel sont voués à la démolition.
Les larmes lui viennent souvent aux yeux lorsque, voyant défiler les images de l’aube vaporeuse sur le Nil, des monts sacrés de la Vallée des Rois, des statues énigmatiques ou des petits cireurs de chaussures qui les poursuivaient en piaillant, du Pavillon des Bleuets ou de leurs amis américains, elle se rappelle leur choli trio. Elle sourit, aussi, en se rappelant la calèche ou la tchaktchouka que Clara n’avait pu terminer, sur la terrasse à l’enseigne de Chez Omar, tant elle craignait, avait-elle prétendu sous l’effet probable du vin rouge qu’avait commandé cette viveuse de Marieke, que tant d’épices épicées l’accablent de coupables Désirs…
Lena ne s’était pas senti la force, à la mort de Marieke, de faire le voyage, mais elle avait pleuré cette vormidable amie, autant que l’avait chagrinée la mort de sa sœur Clara.
Ce fut en inscrivant, un dimanche matin, le nom de Samoa sur son moteur de recherche, que Lena découvrit pourquoi, peut-être, ce bonheur-là ne lui avait pas été accordé.
Le jeune homme en paréo dont elle gardait, pour elle, le souvenir ardent, cet Adam des Samoa qu’elle avait brièvement rencontré lors d’un voyage dans l’archipel auquel l’avait invité le Docteur Benjamin, ce garçon si doux et intelligent, si beau, si rayonnant de bonté qui l’avait accompagnée trois jours durant avant de lui présenter les siens, cet innocent de l’innocent Jardin, et le Désir qu’il avait suscité et qu’elle n’avait pas osé consommer, tout ce charme s’était soudain évanoui devant les images multipliant l’illusion de ce paradis de paillotes préfabriquées où le bonheur s’achetait désormais comme partout ailleurs.
Finalement, se disait Lena, finalement je ne crois pas que j’aie à regretter cela. Finalement je me vois mal ne rien faire qu’être heureuse sous les cocotiers. Finalement je dois l’avoir un peu cherché, d’être restée simplement ce que j’ai toujours été.
Lena se réjouit toujours de nos visites, ne répondant plus guère aux invitations trop lointaines, qui la fatiguent un peu beaucoup trop vielmal, dit-elle; ainsi n’a-t-elle plus séjourné dans l’Hacienda depuis plus d’une année et craint-elle que ce soit pour jamais, arguant du fait qu’elle baisse décidément, selon son expression. Mais Anna fait parfois le voyage avec son Hidalgo, se réjouissant de la réjouir.
Et moi aussi je me réjouis de la réjouir.
A chaque nouveau rendez-vous elle est là-bas, au bout du quai, punkt au train de midi.
Le temps de l’apercevoir je pense alors à ma mère et à la pauvre Greta dont le romancier n’a presque rien dit, ce rat, alors que la vie de Greta est un roman en soi, un peu triste et qui finit en douleur.
Mais qui étais-tu donc, p’tite Greta que j’ai vue si menue dans ton cercueil de poupée? Et toi ma p’tite Clara, qui étais-tu, toute pomponnée dans le tien, l’air un peu d’une princesse inca?
Nous allons et venons: avec Lena les pas se font, à chaque fois, un peu plus lents et plus comptés, mais cessera-t-on jamais de se réjouir?
Tout à l’heure nous avons bien ri: une fois de plus nous avons parlé de quand le boa mange l’âne.
Je vais me retourner pour la dernière fois. Elle est là tout au bout du quai. Elle est un peu plus cassée que la dernière fois mais je la vois sourire encore. Il me semble que ce sera pour toujours qu’elle nous sourit ainsi. Elle se réjouit déjà de nous revoir et nous aussi cela nous met en joie.
La Désirade, ce 3 septembre 2006.Cette séquence constitue le dernier chapitre du roman Les bonnes dames, à paraître en octobre 2006 chez Bernard Campiche.
Les Saintes. Aquarelle de Frédérique Noir.
-
Fin d'un roman
A La Désirade, ce dimanche 3 septembre. – C’est dans les pleurs, les sanglots nerveux et les larmes de croco que j’ai mis le point final, ce soir à huit heures, à mon roman Les bonnes dames. J’en étais si ému du fait que la matière de ce roman si près de notre vie est pour moi chargé d’émotion, surtout depuis que l’une de mes trois vieilles petites filles, Marieke, Katia dans la vie, est entrée dans un coma profond, le 25 août dernier, et que nous vivons cette étrange situation que j’ai vécue avec ma propre mère il y a quatre ans et presque jours pour jours, très pénible aujourd’hui à ma bonne amie qui voit sa mère mourir sans mourir.
Dans l’espèce de transe qui m’a saisi depuis que notre chère Katia est entrée dans sa nuit, j’ai écrit d’affilée des vingt et trente pages manuscrites par jour, presque sans hésiter, que je recopiais à mesure presque sans rien corriger. J’ai mieux compris, à ces moments-là, le phénomène du jaillissement par concentration extrême qu’a vécu un Simenon.
Voilà : c’est fini pour le roman, mais la vie continue et son roman de tous les jours.
A La Désirade, ce lundi 4 septembre. – Cinq heures du matin : je me réveille. Le pli est pris. Je me suis levé tous les jours à cette heure depuis des mois que je travaillais à mes Bonnes dames, et maintenant je vais continuer aujourd’hui dans la foulée comme un brave percheron sur son sillon.
D’ailleurs c’est à l’instant même que je me lance dans Le souffle de la vie, le troisième volume de mes carnets qui regroupera les années 2000 à 2006.
En outre une autre aventure commence pour Les bonnes dames, dont je me réjouis aussi. Mon éditeur est aussi l’un de mes meilleurs lecteurs, Bernard vit les livres qu’il lit et qu’il fait et c’est toujours un vrai bonheur de travailler avec lui. Et puis nous nous nous mettrons peu après sur un autre bouquin que j’ai déjà fini, qu’il publiera le printemps prochain. Enfin j’ai très envie, ces jours, de me consacrer plus à la peinturlure de paysages et de visages, enfin je vais en avoir un peu le temps. J’ai reçu l’autre jour une magnifique aquarelle de l’ami Bona, évoquant des espèces de fleurs de volcan, la grande fermentation des rouges et des bleus noirs charnels de l’ombre organique happée par une lumière plus que réelle, de l’autre côté des choses, et ce cadeau m’a bonnement irradié et impatienté de me replonger dans le cratère des couleurs.Papier découpé. LK, 2004.
-
Les escholiers

L’auteur masqué (27)
Ce texte est tiré des premières pages de l'extraordinaire nouvelle de Nicolas Gogol, intitulée Vij, du nom du chef des gnomes russes dont les paupières sont si lourdement plombées qu'elles tombent jusque par terre. Cherchez la ressemblance avec ceux qui s'aveuglent. En attendant, personne n'a identifié Gogol dont le style se reconnaît pourtant à 33 verstes, même en traduction (ici, dans la Petite Bibliothèque Ombres, de Louise Viardot).
« Dès que la cloche du séminaire, qui était pendue à la porte du couvent des frères, à K., se mettait en branle, on voyait arriver de toutes les parties de la ville des groupes d’écoliers. Les grammairiens, les rhétoriciens, les philosophes et les théologiens se rendaient aux classes avec leurs cahiers sous le bras.
Les grammairiens étaient encore des enfants; en marchant, ils se poussaient les uns les autres, et se disaient des injures d’une voix de fausset. Ils avaient presque tous des habits sales et déchirés, et leurs poches étaient toujours remplies de mille brimborions, tels qu’osselets, sifflets de plume, croûtes de pâtés, et jusqu'à des jeunes moineaux auxquels il arrivait de pépier dans le silence de la classe, ce qui attirait quelque fois sur leur possesseur des coups de férule ou même une bonne cinglée de verges en cerisier. Les rhétoriciens marchaient avec plus de gravité; leurs habits avaient moins d’accrocs, mais en revanche ils portaient presque toujours sur leurs visages quelques ornements dans le style des figures de rhétorique, un œil au beurre noir ou une lèvre toute boursouflée. Ceux-là devisaient entre eux et juraient d’une voix de ténor.
Les philosophes et les théologiens parlaient une octave plus bas, et n’avaient rien dans leurs poches que des brins de tabac noir. Ils ne faisaient jamais de provisions, car ils dévoraient dans l’instant tout ce qui leur tombait sous la main. Ils sentaient tous la pipe et l’eau-de-vie, et de si loin que plus d’un artisan, allant à sa besogne, s’arrêtait et flairait longtemps l’air comme un limier. » -
Les Vaches Noires
Sur cette plage infinie, noyée dans un ciel de plomb,
Qui écrase la mer aplatie sur l’horizon bouché,
Et les vagues rampantes sur le sable humide,
Je scrute les scories et les strates,
Rejetées par les flots des tempêtes et des marées passées…
Cueillant dans les galets,
Ces émeraudes douces et polies, témoins de liesses ou de solitudes,
Tessons et bris de verre, rendus inoffensifs par le flux incessant,
Triant coquilles pétrifiées et fossiles, vestiges d’autres époques,
Ramassant squelettes d’oursins désarmés et coquillages brillants,
Fantômes vides des multitudes myopes et grouillantes des fonds,
Récoltant ces trésors de mémoire, humides et scintillants,
Bientôt spectres secs et ternes, dans une coupe,
Foulant aux pieds, meuniers du sable, les coques fragiles,
Suivant l’empreinte éphémère, d’un pied nu, d’un fer,
Ou d’un filet d’eau, indécis, ruisselant vers la mer effacée…
Butant sur un blockhaus aveugle, ensablé sur le flanc,
Dérisoire rempart de combats oubliés,
Devinant dans la brume, les lointains colombages du Normandy,
Qui protègent le confort douillet d’un faste révolu, et ses secrets d’alcôve,
Fouillant ces passés, proches ou perdus dans la nuit des temps,
Comme Midas, dans ce désert minéral, dans ce silence immobile,
En quête d’une voix métallique et virtuelle,
Pour se forger des souvenirs qui ne seront jamais…
Frédérique Noir
Ce poème inédit a paru dans la dernière livraison du Passe-Muraille, juillet 2006, No 70.Les Saintes, aquarelle de Frédérique Noir, médecin aux Hôpitaux de Paris.
-
Le tueur et la demoiselle

Le dernier roman d’Amélie Nothomb
Quinze ans et quinze titres après Hygiène de l’assassin, qui révéla son talent atypique et tout à fait original, n’en déplaise aux vigiles du littérairement correct qui la snobent à qui mieux mieux, Amélie Nothomb en revient à un tueur propre sur lui que le goût des sensations neuves, révélé par un morceau de Radiohead (Pulk/Pull revolving Doors) alors qu’il se sentait « châtré de partout » après la fin d’un fol amour bête, lance dans une nouvelle carrière de tueur à gages « expérimental » mettant en valeur son ton inné de tireur d’élite.
Après avoir « explosé » un commercial de l’alimentaire, un journaliste évidemment inutile à la société, un ministre et une directrice de centre culturel non moins offensants par leur seule existence, avec une volupté virginale (« Rien n’est vierge comme un tueur ») et croissante, cet onaniste de l’acte semi-gratuit (et doublement payé) se trouve piégé dans une embrouille plus compliquée que ses exécutions impeccables à deux-coups, où telle jeune fille sauvage, comme les aimait Anouilh, le prend de vitesse et au dépourvu, ayant, elle, une raison supérieurement motivée de tuer : le viol, par son salaud de père, de son plus personnel secret.
Vif et incisif, superbement enlevé, truffé comme à l’ordinaire de digressions pénétrantes (sur les cinq sens comparés, le sexe, la rencontre, l’intimité, les textes sacrés), ce Journal d’Hirondelle, après un Acide sulfurique controversé, d’ailleurs assez injustement, et un peu bâclé tout de même sur la fin, relève de la meilleure veine de la romancière pêchant ici dans les eaux perverses d’un Mishima qu’elle admire, entre conte (a)moral et méditation paradoxale, au fil d’une écriture cinglante et truffée de trouvailles d’un humour sardonique assez irrésistible.
Citations au vol :
« C’est le corps qui rend gentil et plein de compassion pour le prochain ».
« Rien n’emporte autant l’adhésion que le cliché de zinc ».
« Le corps n’est pas mauvais, c’est l’âme qui l’est ».
« C’est le gras du cerveau qui a inventé le mal ».
« Un tueur est un individu qui s’investit davantage dans ses rencontres que le commun des mortels ».
« Si Proust avait assassiné Joyce dans ce taxi, on serait moins déçu, on se dirait que ces deux-là s’étaient trouvés ».
« Les petites dindes qui forment la majorité des vierges, sont aussi dépourvues de mystère que leurs aînées. Mais il y a ces cas de demoiselles silencieuses qui, elles, sont ce que la nature humaine a produit de plus étranger».
« On entend beaucoup moins bien la musique les yeux fermés. Les yeux sont les narines des oreilles ».
« Aucune fleur ne fleurit autant que la pivoine. Comparées à elle, les autres fleurs ont l’air de maugréer entre leurs dents ».
Amélie Nothomb. Journal d’Hirondelle. Albin Michel, 136p. -
Un démon très ordinaire
En lisant Les Bienveillantes de Jonathan Littell (1)
Le diable du XXe siècle n’est pas un monstre cornu et fourchu mais un homme ordinaire soucieux de son devoir, comme le fut par exemple Adolf Eichmann, l’un des planificateurs de la Solution finale les plus zélés. Hannah Arendt provoqua la controverse en insistant sur la banalité de cet homme gris et froid, mais d’innombrables documents, depuis lors, dont par exemple le significatif Journal du Dr Göbbels, donnent raison à cette thèse, à laquelle on pense immédiatement en se lançant dans la lecture du premier roman de Jonathan Littell, écrit en français et intitulé Les Bienveillantes.
La première phrase de ce livre de 904 pages extrêmement serrées, mais qui nous prennent aussitôt par la gueule, annonce pour ainsi dire la couleur : « Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça c’est passé ».
D’emblée, d’un ton à la fois posé et tout objectif, sans chercher à séduire, commençant d’écrire dans son bureau directorial de l’usine de dentelles qu’il a remis sur pied avec un talent certain pour l’organisation, après être revenu en France déguisé en travailleur du STO (Service du Travail Obligatoire), Max Aue, moitié Allemand et moitié Français, nous explique donc « fraternellement » que ce qu’il a fait, nous aurions très bien pu le faire à supposer que nous eussions été pris dans l’engrenage qui l’a happé.
Va-t-il nous la jouer Günter Grass se battant les flancs ? Nullement. Plus que des remords, il a des renvois de mauvaise digestion et souffre de constipation, mais surtout il a besoin de s’occuper et c’est pour lui-même, pour voir plus clair sur la « rivière noire » de ses souvenirs, qu’il commence à se raconter.
Les trente premières pages de la Toccata qui ouvre le livre, dont tous les titres de chapitres relèvent de la nomenclature musicale, évoquent la Weltanschaung (vision du monde) de ce nihiliste minutieux qui dit avoir vu « plus de souffrance que la plupart » et déclare cependant : « Si jamais vous arriviez à me faire pleurer, mes larmes vous vitrioleraient le visage ».
Il ne bluffe pas : c’est le poison vivant que cet homme qui se rappelle la sentence de Sophocle, « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né », avant d’invoquer Schopenhauer et de conclure que nous vivons dans le pire monde qui soit.
Contrairement à Eichmann, Max Aue ne s’excuse pas par l’argument de la soumission aux ordres : il assume en somme. Il pense même que l’homme ordinaire est plus dangereux, dans les circonstances qu’il a connues, que le monstre psychopathe ou la brute soumise. Lui-même n’a jamais demandé à devenir un assassin. Il n’a pu devenir pianiste faute de don, il aurait préféré faire carrière dans la littérature ou la philo que dans le droit, en outre cet homme sans qualité n’a jamais aimé ni sa mère ni les hommes avec lesquels il a couché avant de se marier bourgeoisement, lucide au point de dire qu’il eût préféré être une femme et que la seule qu’il ait aimé était sa sœur, ce qui complique un peu les choses.
Le piège se referme sur lui à l’instigation de son ami Thomas avec lequel, à la veille de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, il a fait à Paris un rapport secret sur les dispositions bellicistes de la France, rencontrant à cette occasion Brasillach et Rebatet, ledit Thomas lui faisant valoir que désormais, pour un officier SS (car c’est ça qu’il est devenu on ne sait encore comment), le front de Pologne est l’endroit où on va s’amuser, ce qui le fait rire et constater que « c’est ainsi que le Diable élargit son domaine ».
Sous le titre d’Allemandes I et II, le grand chapitre suivant nous plonge dans les premières opérations de nettoyage et de liquidation des obstacles humains à la progression de la Wehrmacht, par la division SS à laquelle il est rattaché.
C’est dans une confusion totale des commandements que cela commence, aux confins de l’Ukraine où les massacres du NKVD russe (Polonais et Ukrainiens exécutés en masse) sont attribués aux Juifs pour simplifier. A ce moment, on est encore loin d’avoir, même dans cette hiérarchie SS, une idée claire de l’extermination à venir. Même, lorsque les premières représailles de masse sont ordonnées contres les civils juifs, ça râle sec chez les chevaliers aryens, et Max n’est pas relax. Or la machine génocidaire est bel et bien en marche, mais là j’arrête parce que je fatigue, un max…Jonathan Littell. Les Bienveillantes. Gallimard, 904p.
-
L’apprentissage de l’abjection
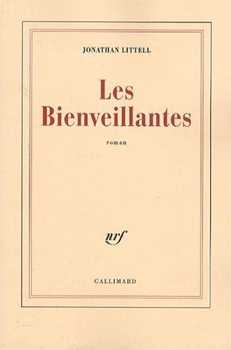
En lisant Les Bienveillantes (2)
Comment un jeune homme fin et cultivé, étudiant en droit à la fin des années 30, se rapproche-t-il de la SS avant d’être recruté parmi les « hommes de confiance » dont on fera, avec le temps et l’expérience, de bons exécutants ? Dans quelles circonstances plus précises Max Aue s’est-il retrouvé affecté sur le front de l’Ukraine, où il assista aux premières Actions de nettoyage des Sonderkommandos appuyant la Wehrmacht, d’abord sous forme de représailles désordonnée puis de manière de plus en plus « professionnelle » et organisée, au fur et mesure que se mettait en place une extermination qui devait immédiatement susciter « des doutes » chez les soldats autant que chez les officiers ? Or le Führer l'avait dit: que les Chefs devraient à l'Allemagne le sacrifice de leurs doutes...
C’est à ces questions que répondent, de façon prodigieusement détaillée, le deuxième grand chapitre des Bienveillantes, au fil duquel nous voyons l’Obersturmführer Max Aue (grade équivalent à celui d’un lieutenant) descendre lentement dans les cercles de l’enfer tout en restant d’une complète lucidité et sans une once du cynisme de son ami Thomas dont nous apprenons comment il l’a sauvé une première fois, menacé d'être déclassé pour faits d'homosexualité, avant de l’entraîner sur le front de l'Est.
« Depuis mon enfance, écrit Max Aue, j’étais hanté par la passion de l’absolu et du dépassement des limites ; maintenant cette passion m’avait mené au bord des fosses communes de l’Ukraine ».
Or quand il fait ce constat, ce témoin qui évite le plus possible de salir ses propres mains, mais qui ne se sent pas moins partie prenante et consentante, par conviction idéologique et devoir, des abominations auxquelles il assiste, voit clairement, à un premier travail d’amateurs (exécutions de masse de juifs civils assimilés à des terroristes pro-soviétiques, avec des méthodes d’une inutile brutalité) se substituer une planification et des formes d’exécution réellement efficientes, bientôt marquées par l’apparition d’Eichmann en personne.
Or tout cela, loin du reportage ou du récit linéaire, se trouve raconté « dans la masse » et la spirale temporelle des événements et des sentiments personnels constamment mêlés, au fil d’un récit signalant, incontestablement, un souffle et un talent de romancier de très grande envergure. Extraordinairement documenté, Jonathan Littell n’en avance pas moins par une forme de narration qui incorpore à la fois les sensations physiques, les émotions à fleur de peau, tous les signes du Réel protéiforme perçus avec une incroyable porosité alors que le narrateur fait proliférer les personnages autour de lui par un système de dialogues enchâssés d’une justesse de ton quasiment sans faille.
C’est un livre à lire lentement et continûment que Les Bienveillantes, qui nous immerge dans la matière humaine en fusion de la guerre; dans la « radicalité de l’abîme », observe plus précisément le narrateur qui philosophe en même temps qu’il évoque la merde et le sang.
On a parlé déjà, à propos de Jonathan Littell, de Tolstoï et de Vassili Grossman. Rapprochements publicitaires ? Je ne vois as encore, pour ma part, se déployer l’art suprême de La guerre et la paix là-dedans, mais en effet la peinture, la puissance épique et la vertigineuse plongée dans les individualités, le sens du tragique et les touches de lyrisme dans les évocations de la lumière ou de la nature, tout cela relève assez de la même grande coulée, du même sérieux absolu et de la même sainte colère (de l’auteur évidemment) qu’on trouve dans Vie et destin...
Lire Les Bienveillantes constitue jusque-là, pour moi, un profond ébranlement comme je n’en ai connu que quelques fois ces dernières décennies, avec Le temps du mal de Dobritsa Tchossitch, L’école d’impiété d’Alexandre Tisma ou Vie et destin de Vassili Grossman, précisément. En ces temps d’atterrante futilité et d’agitation vulgaire, ce livre ramène au sérieux de la littérature. Voilà : c’est un livre sérieux, je crois. Captivant, nous forçant à lire chaque mot, intéressant pour qui s'intéresse à tout le phènomène humain regardé sans oeillères, répugnant par ce qu’il détaille et lumineux par la nécessité qui fonde l’urgence de détailler le Mal. -
Un roman désincarné ?
En lisant les Bienveillantes (3)
A en croire Claude Lanzmann, le défaut majeur des Bienveillantes de Jonathan Littell serait de n’être pas assez incarné, alors même qu’il lui reproche d’ajouter de la chair romanesque à la seule matière documentaire.
Or qu’en est-il ? Les Bienveillantes n’est-il qu’une masse d’informations juste romancées sur les bords, et la « littérature » qu’il y a dans ce roman est-elle un frein à notre compréhension ?
Pour en juger sur pièces, entre d’innombrables autres exemples, j’ai choisi deux passages proches, illustrant à la fois l’aspect onirico-baroque de certaines visions du protagoniste, et la verve qu’il module en citant les personnages qu’il rencontre.
La première scène se passe à Kharkov, lors de l’avancée de la Wehrmacht en Russie à laquelle participe l’unité SS du narrateur, lequel va d’un ébranlement à l’autre. Soit dit en passant, la jeune fille dont il est question dans ce passage est celle dont la photographie du corps supplicié est à l’origine, avec le film Shoah (!) de la composition des Bienveillantes, ainsi que Jonathan Littell l’a expliqué à Jérôme Garcin dans son entretien du Nouvel Observateur des 24-30 août.
«Un incident mineur jeta un éclairage cru sur ces fissures qui allaient s’élargissant. Dans le grand parc enneigé, derrière la statue de Chevtchenko, on menait une jeune partisane à la potence. Une foule d’Allemands se rassemblait: des Landser de la Wehrmacht et des Orpo, mais aussi des hommes de l’organisation Tost, des Goldfanasen de l’Ostministerium, des pilotes de la Luftwaffe. C’était une jeune fille assez maigre, au visage touché par l’hystérie, encadré de lourds cheveux noirs coupés courts, très grossièrement, comme au sécateur. Un officier lui lia les mains, la plaça sous la potence et lui mit la corde au cou. Alors les soldats et les officiers présents défilèrent devant elle et l’embrassèrent l’un après l’autre sur la bouche. Elle restait muette et gardait les yeux ouverts. Certains l’embrassaient tendrement, presque chastement, comme des écoliers; d’autres lui prenaient la tête à deux mains pour lui forcer les lèvres. Lorsque vint mon tour, elle me regarda, un regard clair et lumineux, lavé de tout, et je vis qu’elle, elle comprenait tout, savait tout, et devant ce savoir si pur j’éclatai en flammes. Mes vêtements crépitaient, la peau de mon ventre se fendait, la graisse grésillait, le feu rugissait dans mes orbites et ma bouche et nettoyait l’intérieur de mon crâne. L’embrasement était si intense qu’elle dut détourner la tête. Je me calcinai, mes restes se transformaient en statue de sel; vite refroidis, des morceaux se détachaient, d’abord une épaule, puis une main, puis la moitié de la tête. Enfin je m’effondrai entièrement à ses pieds et le vent balaya ce tas de sel et le dispersa. Déjà l’officier suivant s’avançait, et quand tous furent passés, on la pendit. Des jours durant je réfléchis à cette scène étrange ; mais ma réflexion se dressait devant moi comme un miroir, et ne me renvoyait jamais que ma propre image, inversée certes, mais fidèle. Le corps de cette fille aussi était pour moi un miroir. La corde s’était cassée ou on l’avait coupée, et elle gisait dans la neige du jardin des Syndicats, la nuque brisée, les lèvres gonflées, un sein dénudé rongé par les chiens. Ses cheveux rêches formaient une crête de méduse autour de sa tête et elle me semblait fabuleusement belle, habitant la mort comme une idole, Notre-Dames-des-neiges. Quel que fût le chemin que je prenais pour me rendre de l’hôtel à nos bureaux, je la trouvais toujours couchée sur mon passage, une question têtue, bornée, qui me projetait dans un labyrinthe de vaines spéculations et me faisait perdre pied. Cela dura des semaines ».
Le second passage est d’un tout autre ton, qui suit immédiatement le précédent, touchant au personnage (réel, comme l’a relevé Lanzmann) de Blobel, qui vient de diriger une opération d’extermination de grande envergure.
« Blobel mit fin à l’Aktion quelques jours après le Nouvel-An. On avait gardé plusieurs milliers de Juifs au KhTZ pour des travaux de force dans la ville; ils seraient fusillés plus tard. Nous venions d’apprendre que Blobel allait être remplacé. Lui-même le savait depuis des semaines, mais n’en avait rien dit. Il était d’ailleurs grand temps qu’il parte. Depuis son arrivée à Kharkov, il était devenu une loque nerveuse, en aussi mauvais état, presque, qu’à Lutsk : un moment, il nous réunissait pour s’extasier sur les derniers totaux cumulés du Sonderkommando, le suivant, il s’époumonnait de rage, incohérent, pour une bêtise, une remarque de travers. Un jour, début janvier, j’entrai dans son bureau pour lui porter un rapport de Woytinek. Sans me saluer, il me lança une feuille de papier : « Regardez-moi cette merde ». Il était ivre, blanc de colère. Je pris la feuille : c’était un ordre du Général von Manstein, le commandant de la 11e armées, en Crumée. « C’est votre patron Ohlendorf qui m’a transmis ça. Lisez, lisez. Vous voyez, là en bas ? Il est déshonorant que les officiers soient présents aux exécutions de Juifs. Déshonorant ! Les enculés. Comme si ce qu’ils faisaient était honorable… comme s’ils traitaient leurs prisonniers avec honneur… J’ai fait la Grande Guerre, moi. Pendant la Grande Guerre on s’occupait des prisonniers, on les nourrissait, on ne les laissait pas crever de faim comme du bétail. » Une bouteille de schnaps traînait sur la table ; il s’en versa une rasade, qu’il avala d’une traite. J’étais toujours debout face à son bureau, je ne disais rien. « Comme si tous on ne prenait pas nos ordres à la même source… Les salopards. Ils veulent garder les mains propres, ces petites merdes de la Wehrmacht. Ils veulent nous laisser le sale boulot ». Il se montait la tête, son visage s’empourprait. « Les chiens. Ils veulent pouvoir dire, après : ah non, les horreurs, c’était pas nous. C’étaient eux, les autres, là, les assassins de la SS. Nous ‘avions rien à voir avec tout ça. Nous nous sommes battus comme des soldats, avec honneur. » Mais qui c’est qui a pris toutes ces villes qu’on nettoie ? Hein ! Qui est-ce qu’on protège, nous, quand on élimine les partisans et les Juifs et toute la racaille ? Vous croyez qu’ils se plaignent ? Ils nous le demandent ! » Il criait tellement qu’il postillonnait. « Cette ordure de Manstein, cette ordure, cet hypocrite, ce demi-youtre qui apprend à son chien à lever la patte quand il entend « Heil Hitler », et qui fait accrocher derrière son bureau, c’est Ohlendorf qui me l’a dit, un panneau imprimé où c’est écrit : Mais qu’est-ce que le Führer dirait de cela ? Eh bien justement, qu’est-ce qu’il en dirait notre Führer ? Qu’est-ce qu’il dirait, quand l’AOK11 demande à son Einsatzgruppe de liquider tous les Juifs de Simferopol avant la Noël pour que les officiers puissent passer des fêtes judenfrei ? Et puis qu’ils promulguent des torchons sur l’honneur de la Wehrmacht ? Les porcs. Qui c’est qui a signé le Kommisarbefehl ? Qui c’est qui a signé l’ordre sur les juridictions ? Qui c’est ? Le Reichsführer peut-être ? » Il s’arrêta pour reprendre sa respiration et boire un autre verre ; il avala de travers, s’étouffa, toussa ». Et si ça tourne mal, ils vont tout nous mettre sur le dos. Tout. Ils vont s’en sortir tout propres, tout élégants, en agitant du papier à chiottes comme ça » - il m’avait arraché le feuillet des mains et le secouait en l’air – et en disant : « Non ce n’est pas nous qui avons tué les Juifs, les commissaires, les Tsiganes, on peut le prouver, vous voyez, on n’était pas d’accord, c’était tout de la faute du Führer et des SS »… Sa voix devenait geignarde. « Bordel, même si on gagne ils nous enculeront. Parce que, écoutez-moi, Aue, écoutez-moi bien » - il chuchotait presque, maintenant, sa voix était rauque – « Un jour tout ça va ressortir. Tout. Il y a trop de gens qui savent, trop de témoins. Et quand ça ressortira, qu’on ait gagné ou perdu la guerre, ça va faire du bruit, ça va être le scandale. Il faudra des têtes. Et ça sera nos têtes qu’on servira à la foule tandis que tous les Prusso-youtres comme von Manstein, tous les von Rundstedt et les von Kluge retourneront à leurs von manoirs confortables et écriront leurs von mémoires, en se donnant des claques dans le dos les uns les autres pour avoir été des von soldats si décents et honorable »…
Est-ce cela qu’on peut dire, sérieusement, de la littérature manquant d’incarnation ?
(Les Bienveillantes, pages 170-172)
-
De la lecture

« Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe » (Jacques Audiberti)
« Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond ». (Annie Dillard)
« Et toute lecture – même entreprise pour les motifs les plus bas – nous fait pénétrer dans le cabinet secret où l’humanité nous entretient à voix basse du sort qui lui est fait sous le soleil ». (John Cowper Powys)
« Laissez venir l’immensité des choses » (C.F. Ramuz)