 La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
Yves Rosset a voyagé librement une année durant, multipliant les allers-retors entre Berlin où il survit d’expédients (notamment barman de nuit) avec sa petite famille et le Japon, Israël et les States, entre autres points de chute d’un réseau tissant sa maille recoupée par le filet de ses mails amicaux round the world…
Dès les premières pages japonaises de ce livre profus et bigarré, rappelant Cendrars le curieux de tout et le mange-mots plus que Bouvier l’esthète cultivé, j’ai été saisi par la justesse du titubement initial du voyageur occidental au Japon illico confronté à ce qu’il dit ici une «fascination particulaire» détaillée en ces termes dès son arrivée à Tokyo: «Je regardais vers le nord, vers l’ouest, en direction de Shinju-ku, de Toshima-ku. Il pleuvait fort, grisaillait, mais le brouillard n’empêchait pas de voir que la vile ne cessait pas jusqu’à l’horizon. Infinies détrouvailles, approfondissements, différenciations, murmures des mercures humeuses, foulances errées. Deux jours auparavant, en revenant de la plage de Kamakura pour rejoindre la gare, nous étions remontés à contre-courant le flot d’une sorte de rush-humanity extraordinairement clame et disciplinée qui, déversée par la mégapole que forment Kawasaki, Yokohama et Yokosuka, se rendait au bord de l’eau pour assister au hanabi, le feu d’artifice de l’été. Chaque visage intriguait comme une nouvelle étoile, chaque corps vibrait d’une tenson interne au sein du cosmos, chaque rire éclatait comme l’écho d’une manière de big-bang en expansion assourdissante».
Ces notations m’ont rappelé la même sensation-vertige, exactement, qui m’a saisi la première aube blafarde dans le métro de Tokyo, au milieu de milliers de chauve-souris accrochées d’une main à leur poignée, de l’autre tenant l’attaché-case, chacune avec l’étoile éteinte de son visage, jusqu’au rush-humanity de la lente coulée vers les bureaux…
Ensuite le voyageur est en en Judée, qui est celle à la fois d’un croquis rapporté de Chateaubriand («le paysage qui entoure la ville est affreux», où voisinent, dans une atmosphère de banlieue marine décatie. Bédouins de bidonville et soldats fatigués gardant leur arme proche («l’ordre existe de tirer dans la tête si l’on soupçonne que l’être qui s’approche peut être un combattant prêt à mourir»), vestiges archéologiques (Qumrân) et zones militaires, baigneurs de la mer Morte perpétuant la «foultitude solidaire du rhumatisme et de la tordue au fils des ans», et c’est parti pour un arpentage d’Israël qui superpose les images de l’école du dimanche de jadis et celles du vrombissant présent ponctué d’explosions…
C’est un livre à lire lentement et en tous sens, dans l’ordre et dans le désordre, mais avec la même attention qui leste chaque observation de l’auteur. Je vais le trimballer avec moi jusqu’à la fin de l’année et peut-être au-delà. Sa lecture est à la fois intéressante et vivifiante, de point de vue de la langue qu’il touille et travaille au corps.
 Voilà ce que ça donne par exemple: «Emporter en soi un morceau du monde et le bercer pieds nus dans le sable de la Méditerranée ou dans un manteau de laine sous les arbres nus de l’hiver brandebourgeois, parmi un rouge de brique nordique et les odeurs infinitésimales du charbon de houille se glissant dans le décor d’un passé prussien. Quatre millions de réfugiés. Six millions de morts. Le H Manque sur l’inscription en tubes luminescents au sud du Sheraton. Vitres obscures. Mer léchée de flammes perçant le mur protégeant les vivants dormant encore ou déjà parvenus, sains et saufs, sur la plage du réveil. Drames de la mémoire du narrateur à Balbec, imagination de l’eau, lumineuse, lustrale, reflétée aux fenêtres muettes de solitude, encore tapies dans l’ombre».
Voilà ce que ça donne par exemple: «Emporter en soi un morceau du monde et le bercer pieds nus dans le sable de la Méditerranée ou dans un manteau de laine sous les arbres nus de l’hiver brandebourgeois, parmi un rouge de brique nordique et les odeurs infinitésimales du charbon de houille se glissant dans le décor d’un passé prussien. Quatre millions de réfugiés. Six millions de morts. Le H Manque sur l’inscription en tubes luminescents au sud du Sheraton. Vitres obscures. Mer léchée de flammes perçant le mur protégeant les vivants dormant encore ou déjà parvenus, sains et saufs, sur la plage du réveil. Drames de la mémoire du narrateur à Balbec, imagination de l’eau, lumineuse, lustrale, reflétée aux fenêtres muettes de solitude, encore tapies dans l’ombre».
Or comme il y en a 500 pages de ce tonneau-là, on se souhaite bon voyage…
Une mentalité me révulse, et c’est celle de la seiche philosophique, qui n’a rien à voir avec la seiche animale, se défendant comme elle le peut et à bon droit. Mais en quoi consiste la particularité de la seiche philosophique? La seiche philosophique a cela de particulier que, plongée dans un bac d’eau claire, elle y diffuse un jet d’encre noire avant de déclarer qu’il n’y a pas plus noir que le monde dans lequel elle, seiche de malheur, a été plongée.
Il y a la seiche du tout est moche. Lui désignez-vous une chose belle, un paysage ou un tableau, un film ou un livre, qu’elle en dénonce aussitôt le défaut.
Il y a la seiche de rien ne vaut le coup qui, arguant que tout a été fait ou que rien ne puisse plus advenir, n’a de cesse de ruiner tout projet et de dénigrer même toute idée de projet, pour mieux se complaire dans son amer bocal.
Enfin il y a la seiche du tout est foutu, dont le goût du noir touche à l’absolu, le seul fait d’être au monde lui semblant la calamité d’origine.
Or comment faire pièce à cette philosophie de la seiche? Essentiellement par un redoublement d’attention, je crois, au détail des choses. Cela seul compte en effet: le détail des choses. Ce qu’on appelle la réalité. L’origine des choses. Le Grand Récit. Paléontologie, livre des strates géologiques, écritures de toutes sortes. Et notre roman d’hier et d’aujourd’hui. Les carnets du papillon et ce qui s’ensuit…
 Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, ce film sublime qu’est les amants réguliers de Philippe Garrel, que j’ai vu hier soir après avoir lu, dans un square, les cinquante première pages de La guerre sexuelle de Frédéric Pajak, qui nous replonge dans l’abjection des temps qui courent.
Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, ce film sublime qu’est les amants réguliers de Philippe Garrel, que j’ai vu hier soir après avoir lu, dans un square, les cinquante première pages de La guerre sexuelle de Frédéric Pajak, qui nous replonge dans l’abjection des temps qui courent.
Il va de soi qu’on peut trouver, dans des objets d’art ou de littérature inspirés par des regards diamétralement opposés, le même sentiment de libération intérieure, mais je me garderai bien de situer la satire teigneuse de Pajak au même niveau que le poème de Garrel, dont je suis ressorti intérieurement lavé comme d’un bain de neige. Le blanc de ce film est d’ailleurs celui d’une sorte de neige cernée de cendre, comme les visages irradiant ce qu’on dira simplement, comme chez Bergman, l’âme de chaque individu, dont le réalisateur capte la moindre vibration avec une sensibilité et un amour sans pareils.
Le film de Philippe Garrel «parle» de mai 68 et de la «génération» des soixante-huitards, mais j’étais ravi, à midi, dans la nouvelle livraison de Ligne de risque (No 22, décembre 2005) de lire les propos de Philippe Sollers sur cette foutaise qu’est ce concept de génération, que personnellement je n’ai jamais ressenti, sinon comme une sale idée collante ou un sentiment d’adhésion médiocre. Tout ça pour dire que si Les amants réguliers fait bel et bien signe et sens à propos de ces années-là, c’est tout à fait ailleurs qu’il me touche personnellement, sans rien de la joliesse anecdotique de ce feuilleton italien dont je ne me rappelle plus le nom, relevant du roman-photo.
Ici c’est autre chose. Ce sont surtout des histoires d’amour et c’est le portrait d’un pur. C’est un poème en images dont tous les personnages ont raison. On frise juste un peu l’emphase rhétorique à l’évocation des barricades, mais ce romantisme n’empêche pas la grande noblesse, presque janséniste, du propos; car c’est un filme aussi sur le divertissement en conflit avec l’absolu.
En marchant le long de la rue Saint André-des-Arts, je me suis rappelé les quelques péripéties que nous avons vécues en ces lieux, avec quelques camarades de la jeunesse progressiste, et ma conviction intérieure que ce que je vivais n’avait rien à voir avec ça, que j’étais ailleurs, que toute la rhétorique qui se déchaînait autour de moi tournait à vide, tandis que je retrouve dans ce film tous mes sentiments épars du moment et des temps qui ont suivi, que Philippe Garrel dit de l’inamertume…
C’est à une superbe analyse de La possibilité d’une île que Philippe Sollers se livre dans le dernier numéro de Ligne de risque, où il prend bien soin de préciser tout ce que le distingue, lui le nietzschéen dansant, du schopenhauerien qu’est à l’évidence Houellebecq, mais en multipliant les observations pertinentes et somme toute généreuse, malgré les piques. On retrouve d’ailleurs celles-ci dans le nouveau roman de Sollers, Une vie divine, dont les soixante première pages sont assez épatantes et relèvent nettement plus du vrai roman qu’à l’ordinaire, même si le protagoniste est le même éternel libertin que nous connaissons et qui développe ses vues en coachant une agréable brochette de dames.
Cela étant, Sollers charrie lorsque, comparant Houellebecq et Bret Easton Ellis, il réduit celui-ci à un «simple ludion de marché», une «figure pour magazines».
A-t-il lu sérieusement Lunar Park? Cela m’étonnerait. Evidemment l’auteur américain est peu philosophe, mais je le trouve, pour ma part, plus romancier que Michel Houellebecq et surtout que Philippe Sollers. Comme il en va de Houellebecq pour beaucoup de critiques, l’image médiatique de Bret Easton Ellis fausse probablement la donne, mais que cela a-t-il à voir avec la substance de ces romans. Ce qui est sûr à mes yeux, c’est que celle-ci est organiquement beaucoup mieux «tenue ensemble», et vivante et libre, comme sont vivants et libres tous ses personnages, y compris sa propre projection, que la substance des essais-romans de Philippe Sollers, dont la somptueuse prose (réellement étincelante dans ce nouveau livre, vive et radieuse) et l’intelligence hypercultivée (et hyperétalée) ne font pas illusion, à mes yeux sur le côté complètement plaqué de la création romanesque à proprement parler, le temps, les lieux, les couloirs de la mémoire et du sentiment, bref ce rêve éveillé du roman qu’est précisément Lunar Park et, aussi, dans une toute autre tonalité, La possibilité d’une île.
On sent évidemment, dans les pages d’Une vie divine, la pointe de jalousie que Sollers éprouve à l’égard de Michel Houellebecq, mais il ne devrait pas. Alors qu’il prétend instaurer une nouvelle noblesse du goût, cette façon de se pousser au premier rang de la photo est un peu trop «plèbe», je trouve. Enfin je n’ai rien, pour ma part, contre la «plèbe» qu’il est désormais de bon ton de mépriser. J’ai le tort, sans doute, de ne voir que des gens…
A ce propos, et pour en revenir à un autre roman qui vient également de paraître chez Gallimard, du Lausannois Frédéric Pajak, je trouve chez celui-ci ce même mépris, précisément, mais alors à une dose «panique», dans la peinture endiablée qu’il fait des personnages de La guerre sexuelle, dont l’écriture a heureusement assez de chien pour retenir l’attention. Mais quoi? Faut-il vraiment s’intéresser à cette galerie de nuls? Je me le demande. J’aimais beaucoup Reiser, dont les pires charges avaient toujours quelque chose d’un peu tendre, à part la drôlerie. Chez Pajak, le comique y est certes, mais le trait se force ici jusqu’au mécanique et c’est un peu dommage chez un auteur qui a le punch de Houellebecq mais pas les soubassements…
La lecture d’Une vie divine de Philippe Sollers, dont la brillance me semble de la rhétorique, me laisse un peu sur ma faim après 50 premières pages de lecture. Sollers peut traiter Bret Easton Ellis de «ludion médiatique», pour ma part je trouve bien plus de vraie substance romanesque dans Lunar Park que dans ce nouveau tour de piste de Sollers reconverti au nietzschéisme libertin. Sollers prétend dire ce que personne n’a jamais dit, mais cela me fait sourire. C’est du cirque narcissique du même tonneau que le cirque narcissique d’un Chessex, et leur façon de se mettre en valeur est assez comparable au demeurant
Il y a quelque chose du Pygmalion pédant, chez Sollers autant que chez Chessex, qui me fait sourire. «Et maintenant, nous allons passer à Nietzsche, ma petite…», dit en somme son protagoniste à la charmante Ludi, qui s’en tamponne. On sent l’auteur jaloux, en outre de Houellebecq, qu’il cautionne de manière à la fois paternaliste (l’aîné) et un peu méprisante (le bourgeois). Bref, et une fois de plus, mon sentiment que Sollers est un essayiste de talent, mais un romancier sans entrailles, s’avère. Trop intelligent et trop lucide pour faire un vrai romancier. Intéressant par moments, mais comme une conversation. Son roman en réalité: de la lecture et de la glose. De la glose et de la pose.
C’est Noël et je me réjouis, ce soir et demain, de me retrouver en famille, comme dans nos enfances heureuses et chrétiennes, autour du sapin, lorsque nous tremblions un peu de réciter devant le sapin: «La bougie à l’œil pointu a dit/C’est la fête à Jésus sois gentil.» Depuis hier soir, dans notre isba sous la neige, cela sent de nouveau bon Noël, cela sent la grand-mère à la pommade camphrée et ce soir nos filles et leur oncle ex-taulard nous prépareront un frichti avant les cadeaux. Il n’y aura pas de poésie devant l’arbre puisque les enfants restent à venir mais le sapin est là et les santons de terre cuite et tout le bazar de Noël qu’aucun de nous n’aurait l’idée de démystifier, comme on dit à la télé.
Or l’autre soir à la télé romande, justement, l’idiote de service a cru malin de proposer, à l’heure du Prime, comme ils disent, dans son émission intitulée Scènes de ménage, qui se veut résolument à la coule, le cadeau de Noël original sous la forme d’un godemiché, alternative branchée du rouleau à pâte… Il va sans dire que cela ne m’a pas choqué du point de vue de la morale conventionnelle, mais sous l’angle de la sensibilité je me suis senti réellement blessé en pensant aux braves gens qui ne sont pas armés pour résister à telle insane vulgarité. Le pire blasphème est admissible, non la vulgarité. J’accueillerai volontiers, ce soir, Sade et Genet, dont je sais qu’ils ne ricaneront pas lorsque je réciterai «La petite bougie à l’œil pointu», mais la muflerie médiatique et la vulgarité me semblent absolument inadmissibles.
Le style est la pointe de la discipline et si possible invisible, si possible naturel en apparence, l’effort s’effaçant dans la grâce du geste, comme il en va de la danseuse ou du cavalier, et c’est exactement ce qu’on vit, à l’instant de le lire, à travers deux livres déliés de Marie Nimier et de Jérôme Garcin avec lesquels, en deux bonds élégants, on passera d’une année à l’autre, et qui parlent incidemment de la même chose, à savoir du rapport exact, approprié, supposant un drill rigoureux mais se donnant sans peine, entre la chose vécue et sa transmutation par le verbe.
Marie Nimier se déplace comme sur les pointes dans les nouvelles et autres tableautins de Vous dansez, où sa légèreté de touche, parfois jusqu’à l’évanescence, va de pair avec la concentration et le mordant de l’expression. Prêt à être portés au théâtre (comme plusieurs l’ont d’ailleurs été), ces dialogues oscillent entre l’évocation lyrique et la satire, comme celui qui oppose le journaliste et la ballerine ou le discours in petto de celle qui passe un casting drillé par un expert à formules toutes faites. Même un peu mince, tout ça est très finement filé dans une belle écriture.
 Avec Jérôme Garcin, celle-ci a plus de corps et de coffre. Ceux qui ne sont pas des fous de cheval (comme c’est mon cas, hélas) et qui n’en pincent pas pour le genre diariste (c’est le cas de Garcin, mais pas le mien) seront étonnés de trotter d’emblée, puis de galoper dans la foulée de ce Journal équestre où l’auteur ne consigne en principe que ce qui a trait à son cheval Eaubac et à sa passion.
Avec Jérôme Garcin, celle-ci a plus de corps et de coffre. Ceux qui ne sont pas des fous de cheval (comme c’est mon cas, hélas) et qui n’en pincent pas pour le genre diariste (c’est le cas de Garcin, mais pas le mien) seront étonnés de trotter d’emblée, puis de galoper dans la foulée de ce Journal équestre où l’auteur ne consigne en principe que ce qui a trait à son cheval Eaubac et à sa passion.
Or Cavalier seul et bien plus que cela, et d’abord par son style magnifique, dont la tenue reproduit en somme celle de l’écrivain en selle, au double sens du terme. Ce début l’annonce à merveille: «Deux heures de promenade sur la plage désertée de Deauville et sous un ciel bas d’apocalypse. La mer est en colère, elle a sorti son beau gris métal. En guise de préliminaires, les pieds fouettés par les vagues, Eaubac léchouille l’eau salée comme s’il lapait du champagne. C’est un cheval distingué, un peu gourmé. Ensuite, on trotte face au vent et à une fine bruine. Les mouettes s’envolent sur notre passage, Au loin tanguent les bateaux qui rentrent en procession au havre. Eaubac trépigne, à qui la manche donne des envies de rodéo: la marée est très basse, le sable compact, l’air abrasif. Un char à vile nous croise, et le voici parti en coups de cul et autres figures de gymnastique. Je tends à peine les rênes. On s’installe alors dans un galop puissant et cadencé qui n’en finit pas. Extase matérielle».
C’est cela même: extase matérielle. Quand une novice débarquait au couvent d’Avila pour y assouvir son besoin d’élévations mystiques, Thérèse lui désignait aussitôt le seau et la serpillière qu’il y avait là et le grand dallage qu’il y avait là-bas, pour premier exercice spirituel. Dans le même esprit, la danseuse de Marie Nimier et le cavalier de Jérôme Garcin bossent un max pour la seule beauté du geste et de l’art, sans parler du tonifiant plaisir du lecteur. Dans l’un et l’autre cas, la classe du style s’impose le pied-léger…
«Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre», écrivait Mallarmé.
Cela fait-il du monde un cabinet de rat des lettres claquemuré dans sa poussière. Nullement. Car «l’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini», comme le notait Charles-Albert Cingria.
Le même Cingria disait que la meilleure critique ne faisait que coudre ensemble des citations. Lui-même ne s’y tenait pas, mais l’art de la citation est une composante de la bonne critique, et voici que Léon Bloy suggère: «On devrait fonder une chaire pour l’enseignement de la lecture entre les lignes».
L’autre jour, dans son petit bureau de la rue Huyghens, Amélie Nothomb, folle de lecture s’il en est, me rappelait l’observation de Virginia Woolf selon laquelle n’a été vécu que ce qui a été écrit, mais une nuance qualitative est apportée sur ce qui est vécu et écrit par Valéry: «La lecture des histoires et romans sert à tuer le temps de deuxième ou troisième qualité. Le temps de première qualité n’a pas besoin qu’on le tue. C’est lui qui tue tous les livres. Il en engendre quelques-uns».
… Quelques-uns. Le critique d’ultra-droite Robert Poulet écrivit un jour Le livre de quelques-uns, après avoir signé un pamphlet Contre la plèbe. Lorsque je l’ai rencontrà à Marly-le-Roy, je l’ai vu pleurer en évoquant le suicide de sa fille, avant qu’il me recommande de ne jamais faire d’enfants. Je me réjouis de ne l’avoir pas écouté.
Philippe Sollers, dans Une vie divine à paraître au début du prochain millésime, prétend lui aussi, sous l’égide du retour de Nietzsche (l’un des personnages du roman) rétablir telle aristocratie de l’esprit et du goût, non sans hautain mépris. Or celui-ci me semble, précisément, une faute de goût. Virgnia Woolf, elle encore, ne disait-elle pas que l’aristocrate naturel, sachant sa qualité, n’a pas besoin de se comparer ni se se faire valoir. Ces sont des paysans, des artisans, des gens de nos montagnes qui me l’ont appris bien mieux que des patriciens à particule ou des bourgeois. D’ailleurs à Sollers et consorts Nabokov lance au passage: «Le Style et la Structure sont l’essence d’un livre. Les grandes idées ne sont que foutaises».
«Lire, c’est aller à la découverte d’une chose qui va exister», écrivait Italo Calvino et ce n’est pas autre chose que dit Deleuze dans Proust et les signes, qui souligne le dévoilement aval de la mémoire bien plutôt que son involution.
En ceci d’Alberto Manguel, je trouve soudain un écho à ma propre conception de la lecture: «Tout lecteur est un lecteur associatif. Il lit comme si tous les livres étaient les livres d’un même auteur prolifique et sans âge».
 En rangeant mes paperasses, je suis tombé sur la photocopie d’une page de la Lettre internationale, excellente revue disparue depuis des années, reproduisant la version complète des Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis, que je me suis affairé à recopier pour ma gouverne étant entendu qu’un écrivain ne peut que rester jeune et que ces préceptes valent toujours, ou méritent à tout le moins d’être discutés.
En rangeant mes paperasses, je suis tombé sur la photocopie d’une page de la Lettre internationale, excellente revue disparue depuis des années, reproduisant la version complète des Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis, que je me suis affairé à recopier pour ma gouverne étant entendu qu’un écrivain ne peut que rester jeune et que ces préceptes valent toujours, ou méritent à tout le moins d’être discutés.
Cultive le doute à l’égard des idéologies régnantes et des princes.
Tiens-toi à l’écart des princes.
Veille à ne pas souiller ton langage du parler des idéologies.
Sois persuadé que tu es plus fort que les généraux, mais ne te mesure pas à eux.
Ne crois pas que tu es plus faible que les généraux mais ne te mesure pas à eux.
Ne crois pas aux projets utopiques, sauf à ceux que tu conçois toi-même.
Montre-toi aussi fier envers les princes qu’envers la populace.
Aie la conscience tranquille quant aux privilèges que te confère ton métier d’écrivain.
Ne confonds pas la malédiction de ton choix avec l’oppression de classe.
Ne sois pas obsédé par l’urgence historique et ne crois pas en la métaphore des trains de l’histoire.
Ne saute donc pas dans les «trains de l’histoire», c’est une métaphore stupide.
Garde sans cesse à l’esprit cette maxime: «Qui atteint le but manque tout le reste».
N’écris pas de reportages sur des pays où tu as séjourné en touriste; n’écris pas de reportages du tout, tu n’es pas journaliste.
Ne te fie pas aux statistiques, aux chiffres, aux déclarations publiques: la réalité est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.
Ne visite pas les usines, les kolkhozes, les chantiers: le progrès est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.
Ne t’occupe pas d’économie, de sociologie, de psychanalyse.
Ne te pique pas de philosophie orientale, zen-bouddhisme etc: tu as mieux à faire.
Sois conscient du fait que l’imagination est sœur du mensonge, et par là-même dangereuse.
Ne t’associe avec personne: l’écrivain est seul.
Ne crois pas ceux qui disent que ce monde est le pire de tous.
Ne crois pas les prophètes, car tu es prophète.
Ne sois pas prophète, car le doute est ton arme.
Aie la conscience tranquille: les princes n’ont rien à voir avec toi, car tu es prince.
Aie la conscience tranquille: les mineurs n’ont rien à voir avec toi, car tu es mineur.
Sache que ce que tu n’as pas dit dans les journaux n’est pas perdu pour toujours: c’est de la tourbe.
N’écris pas sur commande.
Ne parie pas sur l’instant, car tu le regretterais.
Ne parie pas non plus sur l’éternité, car tu le regretterais.
Sois mécontent de ton destin, car seuls les imbéciles sont contents.
Ne sois pas mécontent de ton destin, car tu es un élu.
Ne cherche pas de justifications morales à ceux qui ont trahi.
Garde-toi du «redoutable esprit de suite».
Crois ceux qui paient cher leur inconséquence.
Ne crois pas ceux qui font payer cher leur inconséquence.
Ne prône pas le relativisme de toutes les valeurs: la hiérarchie des valeurs existe.
Reçois avec indifférence les récompenses que te décernent les princes, mais ne fais rien pour les mériter.
Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris st la meilleure de toutes, car tu n’en as pas d’autres.
Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris est la pire de toutes, bien que tu ne l’échangerais contre aucune autre.
«Parce que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche» (Apocalypse 3, 16)
Ne sois pas servile, car les princes te prendraient pour valet.
Ne sois pas présomptueux, car tu ressemblerais aux valets des princes.
Ne te laisse pas persuader que la littérature est socialement inutile.
Ne pense pas que ta littérature est «utile à la société».
Ne pense pas que tu es toi-même un membre utile de la société.
Ne te laisse pas persuader pour autant que tu es un parasite de la société.
Sois convaincu que ton sonnet vaut mieux que les discours des hommes politiques et des riches.
Sache que ton sonnet n’a aucun sens face à la rhétorique des hommes politiques et des princes.
Aie en toute chose ton avis propre.
Ne donne pas en toute chose ton avis.
C’est à toi que les mots coûtent le moins.
Tes mots n’ont pas de prix.
Ne parle pas au nom de ta nation, car qui es-tu pour prétendre représenter quiconque, si ce n’est toi-même?
Ne sois pas dans l’opposition, car tu n’es pas en face, mais au-dessous.
Ne sois pas du côté du pouvoir et des princes, car tu es au-dessus d’eux.
Bats-toi contre les injustices sociales, sans en faire un programme.
Prends garde que la lutte contre les injustices sociales ne te détourne pas de ton chemin.
Apprends ce que pensent les autres, puis oublie-le.
Ne conçois pas de programme politique, ne conçois aucun programme: tu conçois à partir du magma et du chaos du monde.
Garde-toi de ceux qui proposent des solutions finales.
Ne sois pas l’écrivain des minorités.
Dès qu’une communauté te fait sien, remets-toi en question.
N’écris pas pour le «lecteur moyen»: tous les lecteurs sont moyens.
N’écris pas pour l’élite; l’élite n’existe pas: tu es l’élite.
Ne pense pas à mort, mais n’oublie pas que tu es mortel.
Ne crois pas en l’immortalité de l’écrivain, ce sont là sottises de professeurs.
Ne sois pas tragiquement sérieux, car c’est comique.
Ne joue pas la comédie, car les boyards ont l’habitude qu’on les amuse.
Ne sois pas bouffon de cour.
Ne pense pas que les écrivains sont «la conscience de l’humanité»; tu as vu trop de crapules.
Ne te laisse pas persuader que tu n’es rien ni personne: tu as vu que les boyards ont peur des poètes.
Ne va à la mort pour aucune idée et ne convainc personne de mourir.
Ne sois pas lâche, et méprise les lâches.
N’oublie pas que l’héroïsme se paie cher.
N’écris pas pour les fêtes et les jubilés.
N’écris pas de panégyriques, car tu le regretterais.
N’écris pas d’oraisons funèbres aux héros de la nation, car tu le regretterais.
Si tu ne peux pas dire la vérité – tais-toi.
Garde-toi des demi-vérités.
Lorsque c’est la fête, il n’y a pas de raison pour que tu y prennes part.
Ne rends pas service aux princes et aux boyards.
Ne demande pas de service aux princes et aux boyards.
Ne sois pas tolérant par politesse.
Ne défends pas la vérité à tout prix: «On ne discute pas avec un imbécile».
Ne te laisse pas persuader que nous avons tous également raison, et que les goûts ne se discutent pas. Etre deux à avoir tort ne veut pas dire qu’on soit deux à avoir raison» (Karl Popper)
«Admettre que l’autre puisse avoir raison ne nous protège pas contre un autre danger: celui de croire que tout le monde a peut-être raison». (Popper)
Ne discute pas avec des ignorants de choses dont ils t’entendent parler pour la première fois.
N’aie pas de mission.
Garde-toi de ceux qui ont une mission.
Ne crois pas à la «pensée scientifique».
Ne crois pas à l’intuition.
Garde-toi du cynisme, entre autres du tien.
Evite les lieux communs et les citations idéologiques.
Aie le courage de nommer le poème d’Aragon à la gloire du Guépéou une infamie.
Ne lui cherche pas de circonstances atténuantes.
Ne te laisse pas convaincre que dans la polémique Sartre-Camus les deux avaient raison.
Ne crois pas à l’écriture automatique ni au «flou artistique» - tu aspires à la clarté.
Rejette les écoles littéraires qui te sont imposées.
A la mention du «réalisme socialiste», tu renonces à toute discussion.
Sur le thème de la «littérature engagée», tu restes muet comme une carpe: tu laisses cela aux professeurs.
Celui qui compare les camps de concentration à la Santé, tu l’envoies valser.
Celui qui affirme que la Kolyma, c’est différent d’Auschwitz, tu l’envoies au diable.
Celui qui affirme qu’à Auschwitz on n’a exterminé que des poux, et non des hommes, tu le jettes dehors.
Celui qui affirme que tout cela représentait une «nécessité historique», même traitement.
«Segui il carro e lascia dir le genti». (Dante)
 On est ces jours, à La Désirade ensevelie sous la neige, dans le grand silence de l’enfance et des contes, seuls les oiseaux ont des couleurs qui crépitent autour du Macbird’s, et les murmures des livres aussi se distinguent plus nettement, et tel est le conte de ce matin, signé Antoine Volodine, qui me parle d’animale innocence sous le nom de Wong. Il y a de l’oiseau chez Wong, qui se déplace un peu sur les pointes dans la zone minée d’après les Evénements qui ont décimé les cultivateurs de la région, mais on verra bientôt, à l’apparition d’une furie humaine à lance-roquettes et gestes manquant de précision, que Wong n’est pas du genre à s’en laisser conter, surtout d’une créature sentant la crotte.
On est ces jours, à La Désirade ensevelie sous la neige, dans le grand silence de l’enfance et des contes, seuls les oiseaux ont des couleurs qui crépitent autour du Macbird’s, et les murmures des livres aussi se distinguent plus nettement, et tel est le conte de ce matin, signé Antoine Volodine, qui me parle d’animale innocence sous le nom de Wong. Il y a de l’oiseau chez Wong, qui se déplace un peu sur les pointes dans la zone minée d’après les Evénements qui ont décimé les cultivateurs de la région, mais on verra bientôt, à l’apparition d’une furie humaine à lance-roquettes et gestes manquant de précision, que Wong n’est pas du genre à s’en laisser conter, surtout d’une créature sentant la crotte.
Aux barbares on ne répond pas, ou pas dans leur langage, mais dans le langage de la civilité. Je me le dis et me le répète alors que je vois se développer une nouvelle tendance des instruits au mépris, qui ne donnera rien de bien. Au mépris il faut substituer le respect sans flatterie et l’attention exigeante, conforme au respect de soi et approprié au niveau de chacun. Il ne s’agit pas de se montrer supérieur, comme y tend un Philippe Sollers, mais bien plutôt de tenir une position digne et généreuse à la fois. Celle d’un William Trevor me semble assez exemplaire, qui relance celle qu’a pu tenir un Tchékhov. Je dirais: une attitude pétrie d’humanité et d’indulgence, mais pure de tout sentimentalisme et de toute démagogie. Chez Tchékhov comme chez Trevor, une égale porosité filtre le double aspect tragique et comique de toute situation humaine. Or je ne cesserai de lire Tchékhov et Trevor durant tote la durée de composition de mon nouveau roman.
On parle aujourd’hui de nouveaux réactionnaires à propos de certains écrivains et autres intellectuels français, tels Michel Houellebecq ou Alain Finkielkraut, mais cette appellation me semble une fabrication médiatique opportuniste plus qu’une catégorie cohérente. En ce qui me concerne, je me suis toujours trouvé en position de réaction, d’abord contre le gauchisme dont les aspects doctrinaires et la visions réductrice du monde n’ont pas tardé à me détourner (peu après la vingtaine, dès le début des années 70), ensuite contre les jobards de tous bords que Marcel Aymé stigmatise si bien dans Le confort intellectuel, enfin contre mes amis de droite confits en bigoterie ou versant dans le nationalisme exacerbé. J’ai souvent été traité de réac par certains, voire de fasciste (à l’époque où j’ai eu le front d’aller interviewer Lucien Rebatet), et sans doute ma position à contre-courant relevait-elle de la droite, sans que le fascisme ni l’antisémitisme ne m’aient jamais tenté d’aucune façon, mais au fond je ne serai jamais qu’un Helvète démocrate un peu bohème et très Monsieur Contrarius, selon l’expression de ma chère mère, surtout poreux, curieux de tout et de plus en plus mal disposé à souscrire à aucune idéologie, tout en m’intéressant de plus en plus aux phénomènes qui en découlent.
Ceci dit, je me sens à des lieues du décri catastrophiste et du mépris humain des écrivains à la Houellebecq, Dantec ou Sollers, tout en partageant bien des vues qu’ils formulent sur la vulgarité et les aveuglements collectifs de l’époque.
A quoi cela tient-il que certaines œuvres de jadis ou naguère nous semblent comme faites ce matin, et que d’autres plus récentes, qui se voulaient novatrices, se ressentent tant de leur époque qu’elles paraissent plus vieilles que les autres? C’est la question qu’une fois de plus je me posais en regardant ces jours La splendeur des Amberson d’ Orson Welles, qui date de 1942, et ensuite Effi Briest de Rainer Werner Fassbinder, tourné en 1974.
 Dans l’œuvre prolifique et passionnante, non moins qu’inégale de Fassbinder, qu’un nouveau coffret réunissant 18 de ses meilleurs films permet de (re) découvrir chez soi, Effi Briest est un bijou qui n’est pas loin de l’esthétique splendide de Welles, avec un effet de distanciation (le fameux V-Effekt de Maître Brecht) qui en signale la «modernité». Relisant le roman éponyme de Theodor Fontane (autre merveille à (re) découvrir), Fassbinder use et abuse de jeux de miroirs et d’artifices de toute sorte pour donner à cette histoire de femme-enfant toute pure en apparence (Hanna Schygulla, d’une beauté à consistance de Sèvres) prise au piège d’un mariage hyper-bourgeois et d’un milieu hyper-conventionnel, sa touche de classicisme formel, quelque part entre Monet et le Visconti de Senso, mais comme dédouané ou dédoublé par l’esprit critique, étant entendu que nous ne sommes pas dupes.
Dans l’œuvre prolifique et passionnante, non moins qu’inégale de Fassbinder, qu’un nouveau coffret réunissant 18 de ses meilleurs films permet de (re) découvrir chez soi, Effi Briest est un bijou qui n’est pas loin de l’esthétique splendide de Welles, avec un effet de distanciation (le fameux V-Effekt de Maître Brecht) qui en signale la «modernité». Relisant le roman éponyme de Theodor Fontane (autre merveille à (re) découvrir), Fassbinder use et abuse de jeux de miroirs et d’artifices de toute sorte pour donner à cette histoire de femme-enfant toute pure en apparence (Hanna Schygulla, d’une beauté à consistance de Sèvres) prise au piège d’un mariage hyper-bourgeois et d’un milieu hyper-conventionnel, sa touche de classicisme formel, quelque part entre Monet et le Visconti de Senso, mais comme dédouané ou dédoublé par l’esprit critique, étant entendu que nous ne sommes pas dupes.
Rien de cela dans La splendeur des Amberson, qui «assume» absolument son faste formel et n’en a pas pris une ride pour autant. Paradoxalement en revanche, et malgré sa beauté, Effi Briest se ressent de son maniérisme et d’un soupçon de pédantisme qui procèdent finalement de cette tare d’une certaine esthétique «moderniste», fondée sur la conviction que l’artiste doit rester à distance. On l’a vu mille fois dans les mises en scène théâtrales de la même époque, mais on en revient aujourd’hui. Tant mieux n’est-ce pas? D’aucuns en tirent prétexte pour taxer de réactionnaire ce retour à l’intelligence d’understatement, alors que cette réaction salutaire passe les modes et les doctrines…
Chaque fin d’année est comme une fin de vie, on meurt, on coule, on va toucher le fond, on se dit que c’est affreux, quelle horreur ces cadeaux, quelle horreur ces fêtes, quelle horreur ces gens qui vont se réjouir, on se plaint en se goinfrant de douceurs, on se lamente en se tassant la cloche, on est plus malheureux que les malheureux qui battent la semelle dans la rue glaciale, après quoi sonne Minuit et c’est le lendemain qui chante, rien ne sera plus comme avant, on prend des tas de résolutions, on se sent déjà meilleur rien que d’y penser…( A La Désirade, ce samedi 31 décembre)


 C’est une bien belle rencontre que j’ai faite ce matin au Salon du livre, passant deux heures en compagnie de Boualem Sansal auquel nous avons consacré l’ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille. Comment résumer l’impression que me fait cet homme à l’évidence simple et bon, qu’en disant que c’est un vrai. Un vrai de vrai: voilà ce que me semble l’individu autant que l’auteur du Serment des barbares et d’Harraga. Une anecdote qu’il m’a racontée, propos de son passage dans les hautes sphères du pouvoir, au titre ronflant de Directeur de l’industrie, définit assez bien sa position d’homme de bonne volonté qui ne trahira jamais sa morale personnelle, ne se laissera pousser la barbe par opprtunisme ni ne cautionnera la mensonge. Un jour donc, un ministre lui ayant demandé d’établir un rapport sur les relations entre l’endettement et le développement des pays du Sud-méditerranéen, il s’y emploie en ayant recours aux chiffres du FMI et de la banque mondiale pour constater que seul Israël, dans les pays les plus endettés, pallie cette situation par un super-développement manifeste. Confronté audit rapport, le ministre entre en fureur et ordonne, aussitôt, de refaire le rapport sans y mentionner Israël, ce que Boualem Sansal refuse absolument, prêt à présenter illico sa démission et à prendre même sur lui un refus d’obtempérer. Il faudra la parution du Serment des barbares, quelques années plus tard, pour lui valoir d’être limogé.
C’est une bien belle rencontre que j’ai faite ce matin au Salon du livre, passant deux heures en compagnie de Boualem Sansal auquel nous avons consacré l’ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille. Comment résumer l’impression que me fait cet homme à l’évidence simple et bon, qu’en disant que c’est un vrai. Un vrai de vrai: voilà ce que me semble l’individu autant que l’auteur du Serment des barbares et d’Harraga. Une anecdote qu’il m’a racontée, propos de son passage dans les hautes sphères du pouvoir, au titre ronflant de Directeur de l’industrie, définit assez bien sa position d’homme de bonne volonté qui ne trahira jamais sa morale personnelle, ne se laissera pousser la barbe par opprtunisme ni ne cautionnera la mensonge. Un jour donc, un ministre lui ayant demandé d’établir un rapport sur les relations entre l’endettement et le développement des pays du Sud-méditerranéen, il s’y emploie en ayant recours aux chiffres du FMI et de la banque mondiale pour constater que seul Israël, dans les pays les plus endettés, pallie cette situation par un super-développement manifeste. Confronté audit rapport, le ministre entre en fureur et ordonne, aussitôt, de refaire le rapport sans y mentionner Israël, ce que Boualem Sansal refuse absolument, prêt à présenter illico sa démission et à prendre même sur lui un refus d’obtempérer. Il faudra la parution du Serment des barbares, quelques années plus tard, pour lui valoir d’être limogé. Après ce que j’ai lu de si bête dans L’Hebdo, qui remet en cause le droit du romancier de traiter des faits divers, comme si ce n’était pas la base même de son travail, la lecture de L’enfant d’octobre de Philippe Besson m’a beaucoup intéressé, qui évite à la fois les écueils de la démagogie et ceux du délire d’interprétation personnel auquel s’était livrée Marguerite Duras. L’intuition de l’écrivain se tient à ce qu’il me semble, qui voit en le couple de Christine et Jean-Michel Villemin une paire de jeunes gens un peu farouches et un peu frustes mais non moins décidés à à sortir de la trappe de leur milieu populaire, voire sordide, pour s’établir un peu plus confortablement (appartement mieux situé, voiture et vacances en Italie), ce que le clan n’admet pas du tout – d’où l’opprobre, les menaces et finalement le meurtre de l’enfant. Au demeurant, le romancier ne pousse pas au-delé de ces conjectures très vraisemblables, et son livre touche par un indéniable accent de vérité.
Après ce que j’ai lu de si bête dans L’Hebdo, qui remet en cause le droit du romancier de traiter des faits divers, comme si ce n’était pas la base même de son travail, la lecture de L’enfant d’octobre de Philippe Besson m’a beaucoup intéressé, qui évite à la fois les écueils de la démagogie et ceux du délire d’interprétation personnel auquel s’était livrée Marguerite Duras. L’intuition de l’écrivain se tient à ce qu’il me semble, qui voit en le couple de Christine et Jean-Michel Villemin une paire de jeunes gens un peu farouches et un peu frustes mais non moins décidés à à sortir de la trappe de leur milieu populaire, voire sordide, pour s’établir un peu plus confortablement (appartement mieux situé, voiture et vacances en Italie), ce que le clan n’admet pas du tout – d’où l’opprobre, les menaces et finalement le meurtre de l’enfant. Au demeurant, le romancier ne pousse pas au-delé de ces conjectures très vraisemblables, et son livre touche par un indéniable accent de vérité. Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Qu’il ait tiré des coups avec Madeleine ou se soit fait sucer par son «préféré», comme l’insinuent certains catholiques apostoliques ou certains mécréants, m’est complètement égal: la question n’est pas là. La question est dans la survie de sa lumière, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir deux fois.
Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Qu’il ait tiré des coups avec Madeleine ou se soit fait sucer par son «préféré», comme l’insinuent certains catholiques apostoliques ou certains mécréants, m’est complètement égal: la question n’est pas là. La question est dans la survie de sa lumière, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir deux fois. A l’instant nous arrivons à Dole, et du coup j’en aurais pour des pages à célébrer mon (occulte) ami Marcel Aymé côté vouivre et forêts, entre Brûlebois et Le moulin de la sourdine, mais du coup la vouivre me rappelle la taille hyperfine d’Alina Reyes traversant la terrasse du Café de la Mairie, et une heure avant les transes dans lesquelles, à l’hôtel Louisiane, j’ai rendu hommage à Alexandre Zinoviev dont ma bonne amie venait de m’apprendre la mort au téléphone – Zinoviev que je revoyais dans sa cuisine munichoise, incapable même de nous faire un œuf au plat et m’emmenant à travers les rues de la ville, jusqu’à certaine brasserie de sinistre mémoire où Hitler éructa ses premiers discours… et voici qu’ayant bouclé et envoyé mon papier je tombe sur le le vieil Albert Cossery plus déplumé et plus dandy que jamais, sans doute sur le point de gagner sa mangeoire de l’Emporio Armani où quelque mécène lui offre sa spaghettata quotidienne… et voici que mon portable grelotte une fois encore, sur lequel un éditeur ami m’annonce la mort la nuit passée de son père…
A l’instant nous arrivons à Dole, et du coup j’en aurais pour des pages à célébrer mon (occulte) ami Marcel Aymé côté vouivre et forêts, entre Brûlebois et Le moulin de la sourdine, mais du coup la vouivre me rappelle la taille hyperfine d’Alina Reyes traversant la terrasse du Café de la Mairie, et une heure avant les transes dans lesquelles, à l’hôtel Louisiane, j’ai rendu hommage à Alexandre Zinoviev dont ma bonne amie venait de m’apprendre la mort au téléphone – Zinoviev que je revoyais dans sa cuisine munichoise, incapable même de nous faire un œuf au plat et m’emmenant à travers les rues de la ville, jusqu’à certaine brasserie de sinistre mémoire où Hitler éructa ses premiers discours… et voici qu’ayant bouclé et envoyé mon papier je tombe sur le le vieil Albert Cossery plus déplumé et plus dandy que jamais, sans doute sur le point de gagner sa mangeoire de l’Emporio Armani où quelque mécène lui offre sa spaghettata quotidienne… et voici que mon portable grelotte une fois encore, sur lequel un éditeur ami m’annonce la mort la nuit passée de son père… En reprenant ce soir la lecture de L’Homme ralenti de J.M. Coetzee, je me dis, par opposition à tant de lectures ne laissant point de traces, que ce livre à la fois astringent et lesté de tant d’observations pénétrantes sur la vie qui va et l’étiolement du désir ou de la simple vitalité, est de ceux qui relèvent de cette littérature « réaliste » qui m’intéresse plus que tout aujourd’hui, plus exactement : de cette littérature poreuse et saturée de réel qui ne se contente pas de reproduire servilement celui-ci mais le recueille et le transforme, le pense, l’interprète et le restitue dans une forme où le fait devient à la fois signe et symbole.
En reprenant ce soir la lecture de L’Homme ralenti de J.M. Coetzee, je me dis, par opposition à tant de lectures ne laissant point de traces, que ce livre à la fois astringent et lesté de tant d’observations pénétrantes sur la vie qui va et l’étiolement du désir ou de la simple vitalité, est de ceux qui relèvent de cette littérature « réaliste » qui m’intéresse plus que tout aujourd’hui, plus exactement : de cette littérature poreuse et saturée de réel qui ne se contente pas de reproduire servilement celui-ci mais le recueille et le transforme, le pense, l’interprète et le restitue dans une forme où le fait devient à la fois signe et symbole.


 Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. “je sens que je serais capable de traverser un mur”, dit-il ainsi à son maître. Et lui: “Alors vas-y”. Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hybris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: “Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition”. Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.
Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. “je sens que je serais capable de traverser un mur”, dit-il ainsi à son maître. Et lui: “Alors vas-y”. Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hybris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: “Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition”. Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.
 Repris ce matin la lecture des Conversations avec Antonio Lobo Antunes, qui parle de l’Exhortation aux crocodiles comme de son meilleur livre. Très intéressant éclairage sur la vie de cet écrivain à la fois intègre et lancé dans ce qui me semble tout de même une certaine impasse de langage, tout à fait dans la filiation du
Repris ce matin la lecture des Conversations avec Antonio Lobo Antunes, qui parle de l’Exhortation aux crocodiles comme de son meilleur livre. Très intéressant éclairage sur la vie de cet écrivain à la fois intègre et lancé dans ce qui me semble tout de même une certaine impasse de langage, tout à fait dans la filiation du En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assasin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait». Je relève la phrase: « Les gens se pourlèchent de ce genre de chose ».
En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assasin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait». Je relève la phrase: « Les gens se pourlèchent de ce genre de chose ». Pas mal de plaisir, et plus encore d’intérêt à la lecture de La bête qui meurt de Philip Roth, même si ce n’est pas de son meilleur tonneau — disons une longue et bonne nouvelle, où il est question des derniers feux érotiques d’un sexagénaire. Finesse de l’observation, intelligence des situations, sérieux du propos mais jamais pédant: c’est l’écrivain actuel qui me semble le plus intéressant, et je ne vois guère à l’heure qu’il est, en France, un seul auteur pour l’égaler. Ce n’est pas un génie (genre Dostoïevski) ni un fondateur de style non plus (tel un Faulkner) mais c’est une sorte de chroniqueur balzacien de la seconde moitié du XXe siècle qui a le mérite d’aborder les grands thèmes sociaux, politiques et psychologiques de notre temps par le truchement de personnages très vivants et attachants. Une Flannery O’Connor touche certes plus profond. Une Patricia Highsmith saisit les tenants de la détresse humaine avec plus de lancinante pénétration. Un William Trevor, en outre, a plus que lui le sens du tragique. Mais Philip Roth, comme un Saul Bellow, et à hauteur égale me semble-t-il, est plus globalement romancier que ces auteurs chers à mon goût.
Pas mal de plaisir, et plus encore d’intérêt à la lecture de La bête qui meurt de Philip Roth, même si ce n’est pas de son meilleur tonneau — disons une longue et bonne nouvelle, où il est question des derniers feux érotiques d’un sexagénaire. Finesse de l’observation, intelligence des situations, sérieux du propos mais jamais pédant: c’est l’écrivain actuel qui me semble le plus intéressant, et je ne vois guère à l’heure qu’il est, en France, un seul auteur pour l’égaler. Ce n’est pas un génie (genre Dostoïevski) ni un fondateur de style non plus (tel un Faulkner) mais c’est une sorte de chroniqueur balzacien de la seconde moitié du XXe siècle qui a le mérite d’aborder les grands thèmes sociaux, politiques et psychologiques de notre temps par le truchement de personnages très vivants et attachants. Une Flannery O’Connor touche certes plus profond. Une Patricia Highsmith saisit les tenants de la détresse humaine avec plus de lancinante pénétration. Un William Trevor, en outre, a plus que lui le sens du tragique. Mais Philip Roth, comme un Saul Bellow, et à hauteur égale me semble-t-il, est plus globalement romancier que ces auteurs chers à mon goût. Dans ses Désaxés, Christine Angot me semble avoir sombré dans une écriture de roman-photo. C’est à vrai dire pathétique, complètement artificiel et pis encore: aphone.
Dans ses Désaxés, Christine Angot me semble avoir sombré dans une écriture de roman-photo. C’est à vrai dire pathétique, complètement artificiel et pis encore: aphone. En lisant Le temps des loups blancs d’Anne Cuneo, je constate que son récit, apparemment si terre à terre, à l’opposé diamétral de l’écriture d’un Cingria, aboutit néanmoins, avec l’évocation de ce dernier, à l’une des meilleures descriptions de Lausanne entre les années 50 et les années 70. Rien chez elle de littérairement brillant, mais elle tire de ses peines d’enfant et de jeune fille quelque chose de tout aussi important à mes yeux que l’éclat ou les surprises d’un style, et cela finit bel et bien par rejoindre la littérature, avec une sorte de poésie.
En lisant Le temps des loups blancs d’Anne Cuneo, je constate que son récit, apparemment si terre à terre, à l’opposé diamétral de l’écriture d’un Cingria, aboutit néanmoins, avec l’évocation de ce dernier, à l’une des meilleures descriptions de Lausanne entre les années 50 et les années 70. Rien chez elle de littérairement brillant, mais elle tire de ses peines d’enfant et de jeune fille quelque chose de tout aussi important à mes yeux que l’éclat ou les surprises d’un style, et cela finit bel et bien par rejoindre la littérature, avec une sorte de poésie. Brodeuses, beau petit film d’Eléonore Faucher, évoque la relation d’abord méfiante et de plus en plus complice, ensuite, de deux femmes malmenées par la vie et dont on pourrait dire qu’elles finissent par s’adopter. Cela commence dans une lumière assez acide, par des scènes vibrantes d’agressivité tous azimuts typique de la « dissociétéé » dans laquelle nous vivons, puis la bonne nature de la plus jeune (qui semble d’abord la plus cynique), impressionnée par l’art de brodeuse de son aînée, la sauvant d’une tentative de suicide et l’accompagnant dans son retour à la vie, et la reconnaissance de l’aînée font évoluer la lumière du film, pourrait-on dire, vers une sorte de nouvelle lumière qui rejaillit sur l’entourage des deux femmes. Rien pour autant d’artificiellement optimiste dans cette métamorphose, de démonstratif ou de lénifiant, mais je n’ai pas craint de parler d’amour pour qualifier les qualités de fond et de forme de ce film qui me semble assez proche de l’esprit des jeunes cinéastes de ma connaissance.
Brodeuses, beau petit film d’Eléonore Faucher, évoque la relation d’abord méfiante et de plus en plus complice, ensuite, de deux femmes malmenées par la vie et dont on pourrait dire qu’elles finissent par s’adopter. Cela commence dans une lumière assez acide, par des scènes vibrantes d’agressivité tous azimuts typique de la « dissociétéé » dans laquelle nous vivons, puis la bonne nature de la plus jeune (qui semble d’abord la plus cynique), impressionnée par l’art de brodeuse de son aînée, la sauvant d’une tentative de suicide et l’accompagnant dans son retour à la vie, et la reconnaissance de l’aînée font évoluer la lumière du film, pourrait-on dire, vers une sorte de nouvelle lumière qui rejaillit sur l’entourage des deux femmes. Rien pour autant d’artificiellement optimiste dans cette métamorphose, de démonstratif ou de lénifiant, mais je n’ai pas craint de parler d’amour pour qualifier les qualités de fond et de forme de ce film qui me semble assez proche de l’esprit des jeunes cinéastes de ma connaissance.
 Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros ventre – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa bêtise. Et pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.
Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros ventre – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa bêtise. Et pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.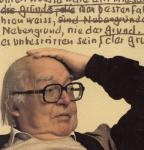 Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, que je retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du nouveau recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre: «Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer: un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en céleste clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté»…
Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, que je retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du nouveau recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre: «Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer: un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en céleste clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté»…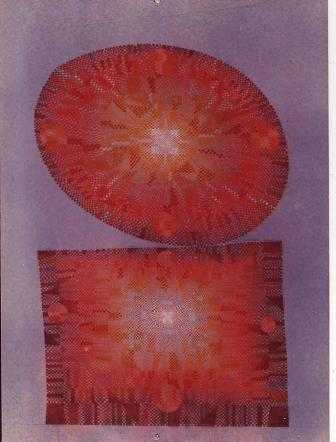
 Une magnifique évocation posthume de W.G. Sebald, par son ami l’artiste Jan Peter Tripp, conclut Séjours à la campagne en situant le grand art de l’écrivain dans la tradition des graveurs de la manière noire. «Homme enseveli sous les ténèbres, ce maître du temps et de l’espace dont le regard s’animait au royaume des Ombres, n’était-il pas devenu lui-même, au fil des ans, dans son Royaume mélancolique, une sorte de plante de l’ombre? D’ailleurs, dans son pays d’adoption, l’Angleterre, la manière noire avait connu au XVIIIe siècle un épanouissement unique, porté par les plus grands artistes. Travailler en partant des ténèbres pour aller vers la lumière est une question de conscience – ôter de la noirceur au lieu d’apporter la clarté. Aussi l’habitant de l’ombre devait-il ne s’exposer qu’avec précaution à l’éclat de la lumière».
Une magnifique évocation posthume de W.G. Sebald, par son ami l’artiste Jan Peter Tripp, conclut Séjours à la campagne en situant le grand art de l’écrivain dans la tradition des graveurs de la manière noire. «Homme enseveli sous les ténèbres, ce maître du temps et de l’espace dont le regard s’animait au royaume des Ombres, n’était-il pas devenu lui-même, au fil des ans, dans son Royaume mélancolique, une sorte de plante de l’ombre? D’ailleurs, dans son pays d’adoption, l’Angleterre, la manière noire avait connu au XVIIIe siècle un épanouissement unique, porté par les plus grands artistes. Travailler en partant des ténèbres pour aller vers la lumière est une question de conscience – ôter de la noirceur au lieu d’apporter la clarté. Aussi l’habitant de l’ombre devait-il ne s’exposer qu’avec précaution à l’éclat de la lumière». On a besoin le matin de phrases limpides, on se lave à l’eau des mots, on lit par exemple: «le samedi midi, c’est le jour du bifteck de cheval. Louise le mange cru, non haché mas recouvert d’une nappe de sucre en poudre».
On a besoin le matin de phrases limpides, on se lave à l’eau des mots, on lit par exemple: «le samedi midi, c’est le jour du bifteck de cheval. Louise le mange cru, non haché mas recouvert d’une nappe de sucre en poudre». On est très vite entraîné dans le vif du dernier roman de Carlos Fuentes, par l’entremise d’une femme de tête, la cinquantaine et dans la haute politique mexicaine, qui drague épistolairement un fringant trentenaire qu’elle vient de rencontrer et qu’elle se propose d’aider à se mettre en selle avant de lui ouvrir son bunker privé. Cela se passe en 2020, alors que le président mexicain vient de damer le pion aux Américains en refusant de cautionner leur invasion de la Colombie et de s’opposer à la hausse du prix du pétrole. Par mesure de rétorsion, les USA ont coupé toute liaison entre le satellite qu’ils contrôlent et le Mexique, de sorte que celui-ci se trouve privé e toute forme de communication, obligeant les protagonistes du roman de Fuentes à s’exprimer par lettres. Et tout de suite ça vole très haut, c’est très allant, très dense et captivant. La grande silhouette de Machiavel ne tarde à se profiler à l’horizon, d’emblée les intrications de la passion du pouvoir et des menées humaines, sentimentales ou sexuelles, nourrissent ces vifs échanges, et ça y va. La distribution aligne donc Maria del Rosario Galvan, qui dit entre autres que le ressentiment est le vice national du Mexique et l’injustice l’écriture sacrée des terres latino-américaine, le jeune Nicolas Valdivia en lequel on pressent un Julien Sorel à dégaine de métis aussi séduisant de corps que d’esprit, Xavier Zaragoza dit Sénèque le conseiller du Président dont il flatte le «moi moral» tandis que son contraire, Tacito de la Canal, figure l’âme noire et servile de ces coulisses. Bref ça a l’air parti pour un beau grand roman de conjecture politique, dont les personnages sont immédiatement campés avec vigueur. On passera volontiers trois jours en leur compagnie, au lieu d’embêter la mère de Weyergans…
On est très vite entraîné dans le vif du dernier roman de Carlos Fuentes, par l’entremise d’une femme de tête, la cinquantaine et dans la haute politique mexicaine, qui drague épistolairement un fringant trentenaire qu’elle vient de rencontrer et qu’elle se propose d’aider à se mettre en selle avant de lui ouvrir son bunker privé. Cela se passe en 2020, alors que le président mexicain vient de damer le pion aux Américains en refusant de cautionner leur invasion de la Colombie et de s’opposer à la hausse du prix du pétrole. Par mesure de rétorsion, les USA ont coupé toute liaison entre le satellite qu’ils contrôlent et le Mexique, de sorte que celui-ci se trouve privé e toute forme de communication, obligeant les protagonistes du roman de Fuentes à s’exprimer par lettres. Et tout de suite ça vole très haut, c’est très allant, très dense et captivant. La grande silhouette de Machiavel ne tarde à se profiler à l’horizon, d’emblée les intrications de la passion du pouvoir et des menées humaines, sentimentales ou sexuelles, nourrissent ces vifs échanges, et ça y va. La distribution aligne donc Maria del Rosario Galvan, qui dit entre autres que le ressentiment est le vice national du Mexique et l’injustice l’écriture sacrée des terres latino-américaine, le jeune Nicolas Valdivia en lequel on pressent un Julien Sorel à dégaine de métis aussi séduisant de corps que d’esprit, Xavier Zaragoza dit Sénèque le conseiller du Président dont il flatte le «moi moral» tandis que son contraire, Tacito de la Canal, figure l’âme noire et servile de ces coulisses. Bref ça a l’air parti pour un beau grand roman de conjecture politique, dont les personnages sont immédiatement campés avec vigueur. On passera volontiers trois jours en leur compagnie, au lieu d’embêter la mère de Weyergans… Tarnation est un collage qui déroute d’abord par sa vitesse et ses ellipses, après quoi l’histoire se met en place qui a quelque chose d’un roman-photo américain des années 50, où tout de suite apparaît la mère du cinéaste dont il est question dès les premières séquences, avec l’annonce d’une overdose de lithium. Et c’est part pour unlife-movie renée a été reine de beauté au texas. En 1952 elle a rencontré un représentant de commerce, le beau Steve. Lovestory. Sauf que Steve fout le camp tôt et que Renée déjante au point que le gosse se trouve casé, chez des gens qui l’abusent bientôt. Jonathan placé, René va dans une prison, et les images video commencent de redéfiler.
Tarnation est un collage qui déroute d’abord par sa vitesse et ses ellipses, après quoi l’histoire se met en place qui a quelque chose d’un roman-photo américain des années 50, où tout de suite apparaît la mère du cinéaste dont il est question dès les premières séquences, avec l’annonce d’une overdose de lithium. Et c’est part pour unlife-movie renée a été reine de beauté au texas. En 1952 elle a rencontré un représentant de commerce, le beau Steve. Lovestory. Sauf que Steve fout le camp tôt et que Renée déjante au point que le gosse se trouve casé, chez des gens qui l’abusent bientôt. Jonathan placé, René va dans une prison, et les images video commencent de redéfiler. Et je ne croyais pas si bien penser, car ce Cingria par Bouvier est en effet un ouvrage virtuel. L’essentiel du livre est en effet consacré, par la professeure Doris Jakubec, à ce que qu’aurait pu être un livre de Nicolas Bouvier. Les textes de Bouvier sur Cingria rassemblés dans là-dedans, sous non seul nom en page de couverture, se réduisent en effet à une cinquantaine de pages déjà connues, notamment par une conférence qu’il avait donnée à Lausanne (je le sais puisque c’est moi qui l’y avais invité), à quoi s’ajoutent quelques feuillets épars, à peine des esquisses, que Doris Jakubec commente en même temps qu’elle présente, très bien d’ailleurs, l’œuvre de notre cher Cingria.
Et je ne croyais pas si bien penser, car ce Cingria par Bouvier est en effet un ouvrage virtuel. L’essentiel du livre est en effet consacré, par la professeure Doris Jakubec, à ce que qu’aurait pu être un livre de Nicolas Bouvier. Les textes de Bouvier sur Cingria rassemblés dans là-dedans, sous non seul nom en page de couverture, se réduisent en effet à une cinquantaine de pages déjà connues, notamment par une conférence qu’il avait donnée à Lausanne (je le sais puisque c’est moi qui l’y avais invité), à quoi s’ajoutent quelques feuillets épars, à peine des esquisses, que Doris Jakubec commente en même temps qu’elle présente, très bien d’ailleurs, l’œuvre de notre cher Cingria. C’est pendant les pubs de la Star’Ac que j’ai commencé de lire Lunar Park, hier soir, avec un retard qui doit venir des quelques papiers dédaigneux que j’avais lu à gauche et à droite, disant à peu près: pas terrible, déballage narcissique, ragots de pipole, ces choses-là. Ce qui m’étonnait un peu, de la part de Bret Easton Ellis, et d’ailleurs André Clavel m’avait plutôt mis l’eau à la bouche, André Clavel qui est un vrai lecteur. Mais les choses qui doivent se faire se font, et lire Lunar Park pendant les pubs de la Star? Ac est une bonne façon de cumuler les plaisirs du prime, n’est-il pas?
C’est pendant les pubs de la Star’Ac que j’ai commencé de lire Lunar Park, hier soir, avec un retard qui doit venir des quelques papiers dédaigneux que j’avais lu à gauche et à droite, disant à peu près: pas terrible, déballage narcissique, ragots de pipole, ces choses-là. Ce qui m’étonnait un peu, de la part de Bret Easton Ellis, et d’ailleurs André Clavel m’avait plutôt mis l’eau à la bouche, André Clavel qui est un vrai lecteur. Mais les choses qui doivent se faire se font, et lire Lunar Park pendant les pubs de la Star? Ac est une bonne façon de cumuler les plaisirs du prime, n’est-il pas? L’humour embusqué de Bret Easton Ellis n’est pas très éloigné de celui de Michel Houellebecq, en plus fou, et sa fantaisie de fictionnaire mimant les délires contemporains est bien plus riche d’observations virtuelles et actuelles que ne le disent ses détracteurs distraits, comme il en va d’un Maurice Dantec.
L’humour embusqué de Bret Easton Ellis n’est pas très éloigné de celui de Michel Houellebecq, en plus fou, et sa fantaisie de fictionnaire mimant les délires contemporains est bien plus riche d’observations virtuelles et actuelles que ne le disent ses détracteurs distraits, comme il en va d’un Maurice Dantec. Quel corniaud crevant de faim pourrait-il bien avaler les rogatons que Philippe Djian a recueillis dans son Doggy Bag? Ce qui est sûr, c’est que mon camarade Fellow les a rejetés rien qu’à me voir les détailler, d’un bout à l’autre de la pièce, fronçant en outre ses sourcils à la François-Joseph lorsqu’il m’a entendu lui citer à haute voix cette phrase d’anthologie: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait peiné à la tracter sur du plat»…
Quel corniaud crevant de faim pourrait-il bien avaler les rogatons que Philippe Djian a recueillis dans son Doggy Bag? Ce qui est sûr, c’est que mon camarade Fellow les a rejetés rien qu’à me voir les détailler, d’un bout à l’autre de la pièce, fronçant en outre ses sourcils à la François-Joseph lorsqu’il m’a entendu lui citer à haute voix cette phrase d’anthologie: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait peiné à la tracter sur du plat»… La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
 Voilà ce que ça donne par exemple: «Emporter en soi un morceau du monde et le bercer pieds nus dans le sable de la Méditerranée ou dans un manteau de laine sous les arbres nus de l’hiver brandebourgeois, parmi un rouge de brique nordique et les odeurs infinitésimales du charbon de houille se glissant dans le décor d’un passé prussien. Quatre millions de réfugiés. Six millions de morts. Le H Manque sur l’inscription en tubes luminescents au sud du Sheraton. Vitres obscures. Mer léchée de flammes perçant le mur protégeant les vivants dormant encore ou déjà parvenus, sains et saufs, sur la plage du réveil. Drames de la mémoire du narrateur à Balbec, imagination de l’eau, lumineuse, lustrale, reflétée aux fenêtres muettes de solitude, encore tapies dans l’ombre».
Voilà ce que ça donne par exemple: «Emporter en soi un morceau du monde et le bercer pieds nus dans le sable de la Méditerranée ou dans un manteau de laine sous les arbres nus de l’hiver brandebourgeois, parmi un rouge de brique nordique et les odeurs infinitésimales du charbon de houille se glissant dans le décor d’un passé prussien. Quatre millions de réfugiés. Six millions de morts. Le H Manque sur l’inscription en tubes luminescents au sud du Sheraton. Vitres obscures. Mer léchée de flammes perçant le mur protégeant les vivants dormant encore ou déjà parvenus, sains et saufs, sur la plage du réveil. Drames de la mémoire du narrateur à Balbec, imagination de l’eau, lumineuse, lustrale, reflétée aux fenêtres muettes de solitude, encore tapies dans l’ombre». Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, ce film sublime qu’est les amants réguliers de Philippe Garrel, que j’ai vu hier soir après avoir lu, dans un square, les cinquante première pages de La guerre sexuelle de Frédéric Pajak, qui nous replonge dans l’abjection des temps qui courent.
Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, ce film sublime qu’est les amants réguliers de Philippe Garrel, que j’ai vu hier soir après avoir lu, dans un square, les cinquante première pages de La guerre sexuelle de Frédéric Pajak, qui nous replonge dans l’abjection des temps qui courent. Avec Jérôme Garcin, celle-ci a plus de corps et de coffre. Ceux qui ne sont pas des fous de cheval (comme c’est mon cas, hélas) et qui n’en pincent pas pour le genre diariste (c’est le cas de Garcin, mais pas le mien) seront étonnés de trotter d’emblée, puis de galoper dans la foulée de ce Journal équestre où l’auteur ne consigne en principe que ce qui a trait à son cheval Eaubac et à sa passion.
Avec Jérôme Garcin, celle-ci a plus de corps et de coffre. Ceux qui ne sont pas des fous de cheval (comme c’est mon cas, hélas) et qui n’en pincent pas pour le genre diariste (c’est le cas de Garcin, mais pas le mien) seront étonnés de trotter d’emblée, puis de galoper dans la foulée de ce Journal équestre où l’auteur ne consigne en principe que ce qui a trait à son cheval Eaubac et à sa passion. En rangeant mes paperasses, je suis tombé sur la photocopie d’une page de la Lettre internationale, excellente revue disparue depuis des années, reproduisant la version complète des Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis, que je me suis affairé à recopier pour ma gouverne étant entendu qu’un écrivain ne peut que rester jeune et que ces préceptes valent toujours, ou méritent à tout le moins d’être discutés.
En rangeant mes paperasses, je suis tombé sur la photocopie d’une page de la Lettre internationale, excellente revue disparue depuis des années, reproduisant la version complète des Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis, que je me suis affairé à recopier pour ma gouverne étant entendu qu’un écrivain ne peut que rester jeune et que ces préceptes valent toujours, ou méritent à tout le moins d’être discutés. On est ces jours, à La Désirade ensevelie sous la neige, dans le grand silence de l’enfance et des contes, seuls les oiseaux ont des couleurs qui crépitent autour du Macbird’s, et les murmures des livres aussi se distinguent plus nettement, et tel est le conte de ce matin, signé Antoine Volodine, qui me parle d’animale innocence sous le nom de Wong. Il y a de l’oiseau chez Wong, qui se déplace un peu sur les pointes dans la zone minée d’après les Evénements qui ont décimé les cultivateurs de la région, mais on verra bientôt, à l’apparition d’une furie humaine à lance-roquettes et gestes manquant de précision, que Wong n’est pas du genre à s’en laisser conter, surtout d’une créature sentant la crotte.
On est ces jours, à La Désirade ensevelie sous la neige, dans le grand silence de l’enfance et des contes, seuls les oiseaux ont des couleurs qui crépitent autour du Macbird’s, et les murmures des livres aussi se distinguent plus nettement, et tel est le conte de ce matin, signé Antoine Volodine, qui me parle d’animale innocence sous le nom de Wong. Il y a de l’oiseau chez Wong, qui se déplace un peu sur les pointes dans la zone minée d’après les Evénements qui ont décimé les cultivateurs de la région, mais on verra bientôt, à l’apparition d’une furie humaine à lance-roquettes et gestes manquant de précision, que Wong n’est pas du genre à s’en laisser conter, surtout d’une créature sentant la crotte. Dans l’œuvre prolifique et passionnante, non moins qu’inégale de Fassbinder, qu’un nouveau coffret réunissant 18 de ses meilleurs films permet de (re) découvrir chez soi, Effi Briest est un bijou qui n’est pas loin de l’esthétique splendide de Welles, avec un effet de distanciation (le fameux V-Effekt de Maître Brecht) qui en signale la «modernité». Relisant le roman éponyme de Theodor Fontane (autre merveille à (re) découvrir), Fassbinder use et abuse de jeux de miroirs et d’artifices de toute sorte pour donner à cette histoire de femme-enfant toute pure en apparence (Hanna Schygulla, d’une beauté à consistance de Sèvres) prise au piège d’un mariage hyper-bourgeois et d’un milieu hyper-conventionnel, sa touche de classicisme formel, quelque part entre Monet et le Visconti de Senso, mais comme dédouané ou dédoublé par l’esprit critique, étant entendu que nous ne sommes pas dupes.
Dans l’œuvre prolifique et passionnante, non moins qu’inégale de Fassbinder, qu’un nouveau coffret réunissant 18 de ses meilleurs films permet de (re) découvrir chez soi, Effi Briest est un bijou qui n’est pas loin de l’esthétique splendide de Welles, avec un effet de distanciation (le fameux V-Effekt de Maître Brecht) qui en signale la «modernité». Relisant le roman éponyme de Theodor Fontane (autre merveille à (re) découvrir), Fassbinder use et abuse de jeux de miroirs et d’artifices de toute sorte pour donner à cette histoire de femme-enfant toute pure en apparence (Hanna Schygulla, d’une beauté à consistance de Sèvres) prise au piège d’un mariage hyper-bourgeois et d’un milieu hyper-conventionnel, sa touche de classicisme formel, quelque part entre Monet et le Visconti de Senso, mais comme dédouané ou dédoublé par l’esprit critique, étant entendu que nous ne sommes pas dupes.
 Je me trouvais là bras-deci bras-deça avec deux très vieilles gredines pleines de malice auxquelles j’avais proposé de se rendre en certaine auberge Zum Schiff pour s’y tasser la cloche, ensuite de quoi nous irions à la Collection Rosengart revoir les Cézanne et les Rouault, en traversant vite fait les trois grandes salles de Picasso. Et nous nous sommes retrouvés devant les Baigneuses bleues de Cézanne; et le temps s’est arrêté entre le paysage nocturne de Rouault et la tempête d’huile de Soutine… (A Lucerne, ce 7 janvier)
Je me trouvais là bras-deci bras-deça avec deux très vieilles gredines pleines de malice auxquelles j’avais proposé de se rendre en certaine auberge Zum Schiff pour s’y tasser la cloche, ensuite de quoi nous irions à la Collection Rosengart revoir les Cézanne et les Rouault, en traversant vite fait les trois grandes salles de Picasso. Et nous nous sommes retrouvés devant les Baigneuses bleues de Cézanne; et le temps s’est arrêté entre le paysage nocturne de Rouault et la tempête d’huile de Soutine… (A Lucerne, ce 7 janvier) En lisant la nouvelle de Buzzati intitulée Le mot prohibé, je découvre une société toute pareille à la nôtre, avec des observations recoupant exactement celle de Dürrenmatt dans son Discours à Vaclav Havel, où l’écrivain alémanique comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont chaque habitant serait le geôlier. Tout au long de la nouvelle, le narrateur, débarqué depuis trois mois dans une ville étrangère, harcèle un des amis qu’il s’y est fait pour que celui-ci lui dise enfin quel est le mot désormais prohibé en ces lieux. L’ami se dérobe, lui expliquant que la prohibition de ce mot découle du besoin d’harmonie des habitants de la ville, qui ont découvert que le conformisme était en somme la meilleure façon de vivre ensemble, avec pour condtion le seul sacrifice de ce mot. Buzzati laisse blancs les deux espaces où le narrateur prononce bel et bien ce mot, que le lecteur est supposé deviner, ce que j’ai fait aussitôt, obsédé que je suis par le besoin de. En lisant la nouvelle à ma bonne amie, elle a prononcé le mot confiance, mais ce n’était pas cela - du moins sa réponse m’a-t-elle paru significative. D’ailleurs je me dis que ce pourrait être un test éclairant. Dis-moi ce que que tu redoutes les plus de voir prohibé et je te dirai qui tu es. La première phrase dans laquelle Buzzati suggère le mot est celle-ci. «Mais nous pouvons parler en toute…. Il n’y a ici personne pour nous entendre. Tu peux bien me le dire, ce fichu mot. Quoi pourrait te dénoncer?» Et la seconde: «Et la …? Le bien suprême. Jadis, tu l’aimais. Tu aurais fait n’importe quoi pour ne pas la perdre. Et maintenant?»
En lisant la nouvelle de Buzzati intitulée Le mot prohibé, je découvre une société toute pareille à la nôtre, avec des observations recoupant exactement celle de Dürrenmatt dans son Discours à Vaclav Havel, où l’écrivain alémanique comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont chaque habitant serait le geôlier. Tout au long de la nouvelle, le narrateur, débarqué depuis trois mois dans une ville étrangère, harcèle un des amis qu’il s’y est fait pour que celui-ci lui dise enfin quel est le mot désormais prohibé en ces lieux. L’ami se dérobe, lui expliquant que la prohibition de ce mot découle du besoin d’harmonie des habitants de la ville, qui ont découvert que le conformisme était en somme la meilleure façon de vivre ensemble, avec pour condtion le seul sacrifice de ce mot. Buzzati laisse blancs les deux espaces où le narrateur prononce bel et bien ce mot, que le lecteur est supposé deviner, ce que j’ai fait aussitôt, obsédé que je suis par le besoin de. En lisant la nouvelle à ma bonne amie, elle a prononcé le mot confiance, mais ce n’était pas cela - du moins sa réponse m’a-t-elle paru significative. D’ailleurs je me dis que ce pourrait être un test éclairant. Dis-moi ce que que tu redoutes les plus de voir prohibé et je te dirai qui tu es. La première phrase dans laquelle Buzzati suggère le mot est celle-ci. «Mais nous pouvons parler en toute…. Il n’y a ici personne pour nous entendre. Tu peux bien me le dire, ce fichu mot. Quoi pourrait te dénoncer?» Et la seconde: «Et la …? Le bien suprême. Jadis, tu l’aimais. Tu aurais fait n’importe quoi pour ne pas la perdre. Et maintenant?» Je riais sous cape ce matin en me rappelant l’irrésistible histoire que raconte Alexandre Jollien, dans son Eloge de la faiblesse, évoquant son pote handicapé qui, dans le train, pour n’avoir pas à payer sa course, tire la langue au moment où le contrôleur se pointe dans son compartiment. Le drôle en question appelle ça: Opération Lézard. Or ce que je me dis ce matin, c’est que toute la philosophie de Jollien tient en ce programme basique de l’Opération Lézard. C’est en tirant la langue à sa poisse de naissance qu’il est devenu ce qu’il est: à savoir un putain de clown de Dieu, un danseur à la Nietzsche, un resquilleur du SuperHandicap de vivre.
Je riais sous cape ce matin en me rappelant l’irrésistible histoire que raconte Alexandre Jollien, dans son Eloge de la faiblesse, évoquant son pote handicapé qui, dans le train, pour n’avoir pas à payer sa course, tire la langue au moment où le contrôleur se pointe dans son compartiment. Le drôle en question appelle ça: Opération Lézard. Or ce que je me dis ce matin, c’est que toute la philosophie de Jollien tient en ce programme basique de l’Opération Lézard. C’est en tirant la langue à sa poisse de naissance qu’il est devenu ce qu’il est: à savoir un putain de clown de Dieu, un danseur à la Nietzsche, un resquilleur du SuperHandicap de vivre.
 Dans la catégorie variée des femmes d’écrivains, un genre me fait horreur et c’est celui que l'Auteur désigne comme l’Admirable Compagne, dont la seule appellation dissimule le plus souvent des liens de dépendance plus que douteux, alors que me ravit le type en voie de disparition de l’épouse aux petits soins, qui s’écrit naturellement sans majuscules et s’entend avec malice. Telle étant Madame Berchtold.
Dans la catégorie variée des femmes d’écrivains, un genre me fait horreur et c’est celui que l'Auteur désigne comme l’Admirable Compagne, dont la seule appellation dissimule le plus souvent des liens de dépendance plus que douteux, alors que me ravit le type en voie de disparition de l’épouse aux petits soins, qui s’écrit naturellement sans majuscules et s’entend avec malice. Telle étant Madame Berchtold. «L’art doit être aussi méticuleux que la vie», dit Fellini à propos de la forme artistique la plus proche de la réalité que semble le cinéma, qui requiert précisément, alors, la transformation de la réalité apparente en trompe-l’œil dont la mer de plastique du Casanova est l’un des exemples.
«L’art doit être aussi méticuleux que la vie», dit Fellini à propos de la forme artistique la plus proche de la réalité que semble le cinéma, qui requiert précisément, alors, la transformation de la réalité apparente en trompe-l’œil dont la mer de plastique du Casanova est l’un des exemples. En regardant, hier, le film consacré à Fellini Par Damian Pettigrew, j’étais ému d’y retrouver maintes observations sur le travail de l’artiste qui valent évidemment pour l’écrivain, comme ces propos que je relève dans une lettre de Rilke à Clara datant de 1907: «… Mais à propos de Cézanne, je voulais encore dire ceci: que jamais n’était mieux apparu à quel point la peinture a lieu dans les couleurs, et qu’il faut les laisser seules afin qu’elles s’expliquent réciproquement. Leur commerce est toute la peinture. Celui qui leur coupe la parole, qui arrange, qui fait intervenir d’une manière ou d’une autre sa réflexion, ses astuces, ses plaidoyers, son agilité d’esprit, dérange et trouble leur action. Le peintre (comme l’artiste en général), ne devrait pas pouvoir prendre conscience de ses découvertes; il faut que ses progrès, énigmatiques à lui-même, passent, sans le détour de la réflexon, si rapidement dans son travail qu’il soit incapable de les reconna’itre au passage. Quiconque, à ce moment-là, les épie, les observe, les arrête, les verra se métamorphoser comme l’or des contes, qui ne peut rester pur par la faute de tel ou tel détail. Le fait que les lettres de Van Gogh se lisent si bien, soient si riches, parlen en fin de compte contre lui, comme parle contre ce peintre (comparé à Cézanne) le fait davoir voulu, su, éprouvé ceci ou cla: que le bleu appelait l’orange, et le vert le rouge; ainsiq u’il l’avait entendu dire, le curieux, aux aguets au fond de son œil. Aussi peignait-il des tableaux fondés sur un seul contrast, tout en pensant au coloris simplifié des Japonais qui ordonnent les surfaces selon le on voison, plus haut ou plus bas, et les additionnent pour obtenir une valeur totale; ce qui les conduit au contour continu, exprimé (c’est-à-dire inventé), serrissage de surfaces équivalentes, donc à l’ntentionnel, à l’arbitraire, en un mot: au décoratif.
En regardant, hier, le film consacré à Fellini Par Damian Pettigrew, j’étais ému d’y retrouver maintes observations sur le travail de l’artiste qui valent évidemment pour l’écrivain, comme ces propos que je relève dans une lettre de Rilke à Clara datant de 1907: «… Mais à propos de Cézanne, je voulais encore dire ceci: que jamais n’était mieux apparu à quel point la peinture a lieu dans les couleurs, et qu’il faut les laisser seules afin qu’elles s’expliquent réciproquement. Leur commerce est toute la peinture. Celui qui leur coupe la parole, qui arrange, qui fait intervenir d’une manière ou d’une autre sa réflexion, ses astuces, ses plaidoyers, son agilité d’esprit, dérange et trouble leur action. Le peintre (comme l’artiste en général), ne devrait pas pouvoir prendre conscience de ses découvertes; il faut que ses progrès, énigmatiques à lui-même, passent, sans le détour de la réflexon, si rapidement dans son travail qu’il soit incapable de les reconna’itre au passage. Quiconque, à ce moment-là, les épie, les observe, les arrête, les verra se métamorphoser comme l’or des contes, qui ne peut rester pur par la faute de tel ou tel détail. Le fait que les lettres de Van Gogh se lisent si bien, soient si riches, parlen en fin de compte contre lui, comme parle contre ce peintre (comparé à Cézanne) le fait davoir voulu, su, éprouvé ceci ou cla: que le bleu appelait l’orange, et le vert le rouge; ainsiq u’il l’avait entendu dire, le curieux, aux aguets au fond de son œil. Aussi peignait-il des tableaux fondés sur un seul contrast, tout en pensant au coloris simplifié des Japonais qui ordonnent les surfaces selon le on voison, plus haut ou plus bas, et les additionnent pour obtenir une valeur totale; ce qui les conduit au contour continu, exprimé (c’est-à-dire inventé), serrissage de surfaces équivalentes, donc à l’ntentionnel, à l’arbitraire, en un mot: au décoratif. Un peintre qui écrivait, donc un peintre qui n’en était pas un, a voulu inciter Cézanne aussi à s’expliquer en lui posant des questions de peinture: mais, quand on lit les quelques lettres du vieillard, on constate qu’il en est resté à une ébauche maladroite, et qui lui répugnait infiniment à lui-même, d’espression. Il ne pouvait presque rien dire. Les phrases où il s’y efforce s’étirent, s’embrouillent, se hérissent, se nouent, et il finit par les abandonner, furieux. En revanche, il parvient à écrire très clairement: «Je crois que ce qui vaut mieux, c’est el travail». Ou bien: «Je fais tous les jours des progrès, quoique lentement». Ou bien: «J’ai près de soixante-dix ans». Ou bien: «Je vous répondrai avec des tableaux». Ou encore: «L’humble et colossal Pissaro» (celui qui lui a appris à travailler); ou enfin, après avoir bataillé un peu (on sent comme c’est caligraphié, et avec soulagement), la signature complète: «Pictor Paul Cézanne». Et dans la dernière lettre (du 21 septembre 1905), après des plaintes sur sa mauvaise santé, simplement: «Je continue donc mes études». Et dans la dernière lettre (du 21 septembre 1905), après des plaintes sur sa mauvaise santé, simplement: «Je continue donc mes études». Et le vœu qui a été exaucé littéralement: «Je me suis juré de mourir en peignant.» Comme dans une vieille Danse des Morts, la Mort a saisi sa main apr derrière, posant elle-même la dernière touche, avec un frisson de plaisir; son ombre s’étendait depuis quelque temps sur sa palette, elle avait eu le temps de choisir, dans la ronde franche des couleurs, celle qui lui plaisait le mieux; quand le pinceau y aurait plongé, elle s’en saisirait et peindrait… Le moment vint; la Mort allonga la main et posa sa touche, la seule dont elle soit capable». Et cela enfin qui me semble incontestable: «Toute parlote est un malentendu. Il n’y a de compréhension qu’à l’intérieur du travail, sans aucun doute.»
Un peintre qui écrivait, donc un peintre qui n’en était pas un, a voulu inciter Cézanne aussi à s’expliquer en lui posant des questions de peinture: mais, quand on lit les quelques lettres du vieillard, on constate qu’il en est resté à une ébauche maladroite, et qui lui répugnait infiniment à lui-même, d’espression. Il ne pouvait presque rien dire. Les phrases où il s’y efforce s’étirent, s’embrouillent, se hérissent, se nouent, et il finit par les abandonner, furieux. En revanche, il parvient à écrire très clairement: «Je crois que ce qui vaut mieux, c’est el travail». Ou bien: «Je fais tous les jours des progrès, quoique lentement». Ou bien: «J’ai près de soixante-dix ans». Ou bien: «Je vous répondrai avec des tableaux». Ou encore: «L’humble et colossal Pissaro» (celui qui lui a appris à travailler); ou enfin, après avoir bataillé un peu (on sent comme c’est caligraphié, et avec soulagement), la signature complète: «Pictor Paul Cézanne». Et dans la dernière lettre (du 21 septembre 1905), après des plaintes sur sa mauvaise santé, simplement: «Je continue donc mes études». Et dans la dernière lettre (du 21 septembre 1905), après des plaintes sur sa mauvaise santé, simplement: «Je continue donc mes études». Et le vœu qui a été exaucé littéralement: «Je me suis juré de mourir en peignant.» Comme dans une vieille Danse des Morts, la Mort a saisi sa main apr derrière, posant elle-même la dernière touche, avec un frisson de plaisir; son ombre s’étendait depuis quelque temps sur sa palette, elle avait eu le temps de choisir, dans la ronde franche des couleurs, celle qui lui plaisait le mieux; quand le pinceau y aurait plongé, elle s’en saisirait et peindrait… Le moment vint; la Mort allonga la main et posa sa touche, la seule dont elle soit capable». Et cela enfin qui me semble incontestable: «Toute parlote est un malentendu. Il n’y a de compréhension qu’à l’intérieur du travail, sans aucun doute.» En sortant l’autre soir de la représentation de Liberté à Brême de Fassbinder, dont le sarcasme va de pair avec la question sérieuse de savoir à quel moment nous devenons capables de tuer, je me suis rappelé la scène que j’ai vécue il y a quelques années, dans un wagon-restau où, interrompant ma lecture de La force de tuer de Lars Noren, dont il fixait depuis un moment le titre avec des yeux inquisiteurs, tel jeune homme m’a soudain entrepris sur le sujet, affirmant d’abord qu’il était, lui, absolument incapable d’imaginer une situation dans laquelle il aurait la force de tuer…
En sortant l’autre soir de la représentation de Liberté à Brême de Fassbinder, dont le sarcasme va de pair avec la question sérieuse de savoir à quel moment nous devenons capables de tuer, je me suis rappelé la scène que j’ai vécue il y a quelques années, dans un wagon-restau où, interrompant ma lecture de La force de tuer de Lars Noren, dont il fixait depuis un moment le titre avec des yeux inquisiteurs, tel jeune homme m’a soudain entrepris sur le sujet, affirmant d’abord qu’il était, lui, absolument incapable d’imaginer une situation dans laquelle il aurait la force de tuer… Se réveiller à l’hôtel a toujours signifié pour moi: je serais nulle part, je ne serais personne. Je serais le commercial X. ou la cheffe de projet Y. Peut-être un transsexuel? Peut-être un pasteur méthodiste ou un brasseur bavarois en tournée de promotion? Peut-être un ancien amant de Marthe Keller que j’ai cru voir tout à l’heure, assise seule sur un mur, sous la pluie mêlée de neige, en robe de chambre, là-bas près de la place d’aviation?
Se réveiller à l’hôtel a toujours signifié pour moi: je serais nulle part, je ne serais personne. Je serais le commercial X. ou la cheffe de projet Y. Peut-être un transsexuel? Peut-être un pasteur méthodiste ou un brasseur bavarois en tournée de promotion? Peut-être un ancien amant de Marthe Keller que j’ai cru voir tout à l’heure, assise seule sur un mur, sous la pluie mêlée de neige, en robe de chambre, là-bas près de la place d’aviation? Il y a des années que j’en veux férocement, à toute une caste d’intellectuels sans entrailles, d’entretenir le cliché d’un pays mortifère, réduit à ses banques et à ses névroses, aussi est-ce avec un plaisir d’enfant que j’ai retrouvé, dans le tourbillon farceur de My name ist Eugen du jeune réalisateur Michael Steiner, qui vient d’obtenir le Prix du meilleur film de fiction aux Journées cinématographiques de Soleure, ce que je ressens au fond de moi comme un atavisme sauvage et qui participe de l’esprit du conte.
Il y a des années que j’en veux férocement, à toute une caste d’intellectuels sans entrailles, d’entretenir le cliché d’un pays mortifère, réduit à ses banques et à ses névroses, aussi est-ce avec un plaisir d’enfant que j’ai retrouvé, dans le tourbillon farceur de My name ist Eugen du jeune réalisateur Michael Steiner, qui vient d’obtenir le Prix du meilleur film de fiction aux Journées cinématographiques de Soleure, ce que je ressens au fond de moi comme un atavisme sauvage et qui participe de l’esprit du conte. J’ai commencé, ces derniers jours, à rédiger une espèce de journal parallèle dont le fil conducteur est ma lecture d’ Une vie divine de Philippe Sollers, livre-mulet qui a commencé par m’agacer et qui m’intéresse de plus en plus. C’est un jeu curieux dont je nourris mes Carnets de JLK, avec maints échos au fur et à mesure témoignant de l’intérêt de mes lecteurs, et que je vois comme une sorte de prolongation phénoménologique du livre, lequel est lui-même enté sur l’œuvre de Nietzsche. (A La Désirade, ce samedi 21 janvier).
J’ai commencé, ces derniers jours, à rédiger une espèce de journal parallèle dont le fil conducteur est ma lecture d’ Une vie divine de Philippe Sollers, livre-mulet qui a commencé par m’agacer et qui m’intéresse de plus en plus. C’est un jeu curieux dont je nourris mes Carnets de JLK, avec maints échos au fur et à mesure témoignant de l’intérêt de mes lecteurs, et que je vois comme une sorte de prolongation phénoménologique du livre, lequel est lui-même enté sur l’œuvre de Nietzsche. (A La Désirade, ce samedi 21 janvier). Une vie divine est le grand roman solaire – il faudrait plutôt dire conversation, carnet de croisière, essai-gigogne, livre-mulet, exercice de mimétisme, work in progess phénoménologique et poétique à la fois – du retour de Nietzsche, surgi de son suaire à la page 52 sous les initiales de M.N., «instruit par l’épouvantable saloperie du 20e siècle (dont 70 ans passés au goulag)» et revivant, ses livres battant des ailes autour du lecteuri, sous la plume d’un écrivain-philosophe du début du XXIe siècle flanqué d’une Nelly (très ferrée elle aussi en questions essentielles, non moins que bien dans son corps) et d’une Ludi (la femme-fille à croquer dont la jeunesse stimule son fringant barbon), radieuse trinité faisant la pige à l’humanité humanitaire, au bénéfice d’un nouvel homme à venir, mais lequel?
Une vie divine est le grand roman solaire – il faudrait plutôt dire conversation, carnet de croisière, essai-gigogne, livre-mulet, exercice de mimétisme, work in progess phénoménologique et poétique à la fois – du retour de Nietzsche, surgi de son suaire à la page 52 sous les initiales de M.N., «instruit par l’épouvantable saloperie du 20e siècle (dont 70 ans passés au goulag)» et revivant, ses livres battant des ailes autour du lecteuri, sous la plume d’un écrivain-philosophe du début du XXIe siècle flanqué d’une Nelly (très ferrée elle aussi en questions essentielles, non moins que bien dans son corps) et d’une Ludi (la femme-fille à croquer dont la jeunesse stimule son fringant barbon), radieuse trinité faisant la pige à l’humanité humanitaire, au bénéfice d’un nouvel homme à venir, mais lequel? Celui qui fait la gueule pendant que Madame regarde Les Experts/Celle qui est toujours en conférence/Ceux qui s’interrogent sur les mystères de la météo/Celui qui salue tous les matins le Drapeau/Celle qui parle du cash-flow de Vivendi au bar du Lutetia/Ceux qui disent que la plaine Monceau n’est plus ce qu’elle fut/Celui qui a tant aimé l’odeur des couches de ses enfants petits/Celle qui vitupère les chiens malpropres de la rue Legendre/Celui qui trouve que Bob Geldof a mérité le Prix Nobel de la paix/Celle qui a connu la cousine de Bob Geldof lors d’un séjour en Cornouailles/Ceux qui pensent que Bob Geldof est un Tour Operator travaillant sur l’Afrique/Celui qui prétend que Lou Reed est un meilleur poète que Jim Morrison/Celle qui a vu tous les concerts de Nico/Ceux qui ont bu des coups avec Reiser/Celui qui dit qu’il n’en a rien à foutre de l’atomisme de Démocrite/Celle qui prétend que Cauet gagne à être connu/Ceux qui se sont promis de mettre un pain sur la gueule de Cauet/Celui qui prétend que sa belle-sœur s’est tapé Poivre d’Arvor dans une boîte échangiste de Soulac-sur-mer/Celle qui se frotte au citron tous les soirs/Ceux qui écoutent Haydn les yeux fermées/Celui qui va chier dans le jardin du presbytère/Celle qui découvre les Evangiles apocyrphes et le dit à sa manucure/Ceux qui savent où se trouve Aldébaran/Celui punit ses enfants d’il ne sait quoi/Celle qui mate les gens pendant la prière/Ceux qui parlent de leur Admirable Compagne/Celui qui se rappellent les cabanes de leur enfance, etc.
Celui qui fait la gueule pendant que Madame regarde Les Experts/Celle qui est toujours en conférence/Ceux qui s’interrogent sur les mystères de la météo/Celui qui salue tous les matins le Drapeau/Celle qui parle du cash-flow de Vivendi au bar du Lutetia/Ceux qui disent que la plaine Monceau n’est plus ce qu’elle fut/Celui qui a tant aimé l’odeur des couches de ses enfants petits/Celle qui vitupère les chiens malpropres de la rue Legendre/Celui qui trouve que Bob Geldof a mérité le Prix Nobel de la paix/Celle qui a connu la cousine de Bob Geldof lors d’un séjour en Cornouailles/Ceux qui pensent que Bob Geldof est un Tour Operator travaillant sur l’Afrique/Celui qui prétend que Lou Reed est un meilleur poète que Jim Morrison/Celle qui a vu tous les concerts de Nico/Ceux qui ont bu des coups avec Reiser/Celui qui dit qu’il n’en a rien à foutre de l’atomisme de Démocrite/Celle qui prétend que Cauet gagne à être connu/Ceux qui se sont promis de mettre un pain sur la gueule de Cauet/Celui qui prétend que sa belle-sœur s’est tapé Poivre d’Arvor dans une boîte échangiste de Soulac-sur-mer/Celle qui se frotte au citron tous les soirs/Ceux qui écoutent Haydn les yeux fermées/Celui qui va chier dans le jardin du presbytère/Celle qui découvre les Evangiles apocyrphes et le dit à sa manucure/Ceux qui savent où se trouve Aldébaran/Celui punit ses enfants d’il ne sait quoi/Celle qui mate les gens pendant la prière/Ceux qui parlent de leur Admirable Compagne/Celui qui se rappellent les cabanes de leur enfance, etc. Rencontrer des gens est un privilège de mon activité de journaliste, dont je ne me lasse pas. Nanti de mon carnet de notes et de mon ordinateur portable, je grappille sans discontinuer impresssions et sensations, bribes de conversations et de lectures. Je me retrouve, dans ce quartier, plus de trente-cinq ans après y avoir erré comme une âme en peine, avec une vivacité d’esprit aussi aiguë que celle du garçon de vingt ans que j’étais, avec la même sourde conviction que tout cela a un sens, à quoi s’ajoute un certain bagage acquis depuis lors. Je me rappelle, comme d’aujourd’hui, le désarroi total dans lequel je me trouvais cette année-là, précisément au début de l’été 1968, qui m’amena au bord de la délinquance, avant certaine rencontre qui compta pour moi, de quelqu’un que je n’ai plus vu depuis trente ans… Or, resongeant à tous ceux qui ont compté pour moi, à un moment donné, et que j’ai perdus en route, je n’éprouve plus désormais la moindre tristesse, le moindre regret ni la moindre nostalgie, comme si tout cela procédait du scénario d’un film à la fois chaotique et cohérent, dont je poursuis aujourd’hui plus librement le tournage… (A Zurich, au Niederdorf, ce vendredi 27 janvier.)
Rencontrer des gens est un privilège de mon activité de journaliste, dont je ne me lasse pas. Nanti de mon carnet de notes et de mon ordinateur portable, je grappille sans discontinuer impresssions et sensations, bribes de conversations et de lectures. Je me retrouve, dans ce quartier, plus de trente-cinq ans après y avoir erré comme une âme en peine, avec une vivacité d’esprit aussi aiguë que celle du garçon de vingt ans que j’étais, avec la même sourde conviction que tout cela a un sens, à quoi s’ajoute un certain bagage acquis depuis lors. Je me rappelle, comme d’aujourd’hui, le désarroi total dans lequel je me trouvais cette année-là, précisément au début de l’été 1968, qui m’amena au bord de la délinquance, avant certaine rencontre qui compta pour moi, de quelqu’un que je n’ai plus vu depuis trente ans… Or, resongeant à tous ceux qui ont compté pour moi, à un moment donné, et que j’ai perdus en route, je n’éprouve plus désormais la moindre tristesse, le moindre regret ni la moindre nostalgie, comme si tout cela procédait du scénario d’un film à la fois chaotique et cohérent, dont je poursuis aujourd’hui plus librement le tournage… (A Zurich, au Niederdorf, ce vendredi 27 janvier.) Amélie Nothomb m’avait dit que cette nouvelle était l’un des plus beaux textes contemporains qu’elle connaissait, en ajoutant prudemment qu’elle ne cautionnait pas pour autant son côté «facho». Or je ne trouve rien là dedans que de conforme absolument à la règle d’un Empire et d’un ordre militaire rigoureux, sans quoi la tragédie n’y serait pas. Le tragique tient au dilemme insoluble devant lequel se trouve le lieutenant, qui sait que l’empereur va lui ordonner de châtier ses frères d’armes, sait qu’il ne peut désobéir au maître sacré ni tuer ses camarades.
Amélie Nothomb m’avait dit que cette nouvelle était l’un des plus beaux textes contemporains qu’elle connaissait, en ajoutant prudemment qu’elle ne cautionnait pas pour autant son côté «facho». Or je ne trouve rien là dedans que de conforme absolument à la règle d’un Empire et d’un ordre militaire rigoureux, sans quoi la tragédie n’y serait pas. Le tragique tient au dilemme insoluble devant lequel se trouve le lieutenant, qui sait que l’empereur va lui ordonner de châtier ses frères d’armes, sait qu’il ne peut désobéir au maître sacré ni tuer ses camarades.
 Les carnets de Monsieur Bonnard, c’est du matin au soir et tous les jours, guerre ou pas guerre. D’ailleurs en 1945, voilà ce qu’il trouve à peindre au lieu d’un hymne à la Paix ou à la Liberté: des baigneurs au soleil couchant. Le sable du premier plan est jaune chiné de vert céladon et de rose pompon avec plein de blanc comme le décrit scientifiquement le bon Théodore Monod du Musée de l’Homme. La mer est faite de cent bleus et de cent verts friselés d’écume, et le ciel au-dessus est une fusion de mauves orangés sur fond d’ocre sable comme si le ciel était un peu le pendant pendu du sable du rivage. Et là au milieu barbotent une douzaine de taches d’or orangé humain visiblement insouciantes des séquelles de la guerre. Et Monsieur Bonnard de noter sur son carnet, mais c’était en 1939: «A l’instant où l’on dit qu’on est heureux, on ne l’est plus».
Les carnets de Monsieur Bonnard, c’est du matin au soir et tous les jours, guerre ou pas guerre. D’ailleurs en 1945, voilà ce qu’il trouve à peindre au lieu d’un hymne à la Paix ou à la Liberté: des baigneurs au soleil couchant. Le sable du premier plan est jaune chiné de vert céladon et de rose pompon avec plein de blanc comme le décrit scientifiquement le bon Théodore Monod du Musée de l’Homme. La mer est faite de cent bleus et de cent verts friselés d’écume, et le ciel au-dessus est une fusion de mauves orangés sur fond d’ocre sable comme si le ciel était un peu le pendant pendu du sable du rivage. Et là au milieu barbotent une douzaine de taches d’or orangé humain visiblement insouciantes des séquelles de la guerre. Et Monsieur Bonnard de noter sur son carnet, mais c’était en 1939: «A l’instant où l’on dit qu’on est heureux, on ne l’est plus».
 Il est peu d’êtres qui, autant que Rainer Maria Rilke, donnent, et simultanément, l’impression d’une telle fragilité et d’une telle détermination, d’une telle évanescence et d’une telle force concentrée, d’une telle propenson à la fuite et d’une telle présence. L’être qui avait le plus besoin d’être aimé est à la fois celui qui esquive toute relation durable, comme si l’amour ne pouvait réellement s’incarner, jamais composer avec ce qu’on appelle le quotidien. Comme Clara, épouse momentanée et amie d’une vie, artiste elle aussi et aussi peu faite pour s’occuper de leur enfant, Rilke pourrait sembler le parangon de l’égocentrisme artiste, et d’ailleurs il est le premier à se taxer de monstre, mais on aurait tort de réduire ses arrangements avec la matérielle, où mécènes et riches protectrices se succèdent de lieu en lieu, à une sorte d’élégant parasitisme dans lequel il se dorlote et se pourlèche. Cette manière d’exil, loin de la vie ordinaire, qu’il a choisi et qui lui rend pénible la seule présence même de ses amies, ou du moindre chien, le rend à vrai dire malheureux, autant que la solitude qu’il revendique et qui le déprime, mais tel est l’absolu auquel il a bel et bien résolu de consacrer sa vie, et «la création exclut la vie».
Il est peu d’êtres qui, autant que Rainer Maria Rilke, donnent, et simultanément, l’impression d’une telle fragilité et d’une telle détermination, d’une telle évanescence et d’une telle force concentrée, d’une telle propenson à la fuite et d’une telle présence. L’être qui avait le plus besoin d’être aimé est à la fois celui qui esquive toute relation durable, comme si l’amour ne pouvait réellement s’incarner, jamais composer avec ce qu’on appelle le quotidien. Comme Clara, épouse momentanée et amie d’une vie, artiste elle aussi et aussi peu faite pour s’occuper de leur enfant, Rilke pourrait sembler le parangon de l’égocentrisme artiste, et d’ailleurs il est le premier à se taxer de monstre, mais on aurait tort de réduire ses arrangements avec la matérielle, où mécènes et riches protectrices se succèdent de lieu en lieu, à une sorte d’élégant parasitisme dans lequel il se dorlote et se pourlèche. Cette manière d’exil, loin de la vie ordinaire, qu’il a choisi et qui lui rend pénible la seule présence même de ses amies, ou du moindre chien, le rend à vrai dire malheureux, autant que la solitude qu’il revendique et qui le déprime, mais tel est l’absolu auquel il a bel et bien résolu de consacrer sa vie, et «la création exclut la vie». n définir la qualité la plus caractéristique, représente à mes yeux la meilleure définition de l’aptitude à la transmutation poétique: la porosité psychique et physique, et par conséquent aussi l’empathie, qui en est le prolongement affectif. Après cela la langue coule de source.
n définir la qualité la plus caractéristique, représente à mes yeux la meilleure définition de l’aptitude à la transmutation poétique: la porosité psychique et physique, et par conséquent aussi l’empathie, qui en est le prolongement affectif. Après cela la langue coule de source. Richard Millet célèbre justement «l’extraordinaire bonheur de lecture donné par cette œuvre: une phrase sèche, coupante, irisée, comme du verre qu’n brise au soleil, et dont l’éclat garde quelque chose de la nuit éternelle: une phrase classique tendue à l’extrême et néanmoins baroque, au sens où Ponge dit du classicisme qu’il est la corde la plus tendue du baroque; une écriture de la mesure dans l’excès et de l’excès dans l’apparente mesure, nourrie des classiques français autant que des mystiques chrétiens, de la littérature gréco-latine et de la Bible. »
Richard Millet célèbre justement «l’extraordinaire bonheur de lecture donné par cette œuvre: une phrase sèche, coupante, irisée, comme du verre qu’n brise au soleil, et dont l’éclat garde quelque chose de la nuit éternelle: une phrase classique tendue à l’extrême et néanmoins baroque, au sens où Ponge dit du classicisme qu’il est la corde la plus tendue du baroque; une écriture de la mesure dans l’excès et de l’excès dans l’apparente mesure, nourrie des classiques français autant que des mystiques chrétiens, de la littérature gréco-latine et de la Bible. » Avant le matin est en effet un roman catholique d’inspiration hédoniste, en tout cas dans sa première partie, marqué ensuite par une sorte de retour du refoulé puritain, aboutissant à la folie du personnage. Celui-ci, du nom de Joseph d’Avry, se disant médiocre enseignant chassé du corps professoral, et maintenant hagiographe non accrédité par le Vatican, a résolu de témoigner de ce qu’il a vécu auprès d’Aloysia Pia Canisia Piller, fille de pauvres gens de la Basse Ville entrée au couvent de la Maigrauge à l’adolescence, dont elle est sortie a trente ans pour vivre dans la simplicité auprès des humbles et des miséreux, se donnant à eux et parfois à tous les sens du terme. «L’abbesse Canisia savait qu’aucune règle de bienséance ne contient l’élan de l’être vers l’extase. Elle se donnait comme elle jeûnait, ou marchait pieds nus dans le gel, ou s’abstenait de sommeil une semaine entière, pour approcher le vertige de Dieu». Ledit Joseph bénéficie lui-même aussitôt de ce don d’amour en se trouvant pacouru d’une «extraordinaire vibration». Plus tard elle lui confiera sa façon de consoler ses miséreux: «J’avais mes pauvres, mes errants, mes sans-papiers, Fribourgeois perclus d’alcool et d’année de chômages, Africains, Yougoslaves, tout ce que la société repousse à la faim et à l’égout». Le personnage frise alors le chromo sulpicien, qui parle comme les saintes des livres, aime les vitraux de Bazaine comme Chessex, regrette de n’avoir pas été Marie-Madeleine, trouve les sculptures de Tinguely «plus proches de Golgotha que la plupart des crucifix qui pullulent dans les églises», raffole des films de Tarzan, entraîne une jeune disciple dans ses bienfaits en la faisant se livrer aux indigents et aux infirmes dans les caves et les taudis, enfin meurt... Tout cela relevant finalement du chromo inversé, du cliché peu crédible à vrai dire faute d'incarnation.
Avant le matin est en effet un roman catholique d’inspiration hédoniste, en tout cas dans sa première partie, marqué ensuite par une sorte de retour du refoulé puritain, aboutissant à la folie du personnage. Celui-ci, du nom de Joseph d’Avry, se disant médiocre enseignant chassé du corps professoral, et maintenant hagiographe non accrédité par le Vatican, a résolu de témoigner de ce qu’il a vécu auprès d’Aloysia Pia Canisia Piller, fille de pauvres gens de la Basse Ville entrée au couvent de la Maigrauge à l’adolescence, dont elle est sortie a trente ans pour vivre dans la simplicité auprès des humbles et des miséreux, se donnant à eux et parfois à tous les sens du terme. «L’abbesse Canisia savait qu’aucune règle de bienséance ne contient l’élan de l’être vers l’extase. Elle se donnait comme elle jeûnait, ou marchait pieds nus dans le gel, ou s’abstenait de sommeil une semaine entière, pour approcher le vertige de Dieu». Ledit Joseph bénéficie lui-même aussitôt de ce don d’amour en se trouvant pacouru d’une «extraordinaire vibration». Plus tard elle lui confiera sa façon de consoler ses miséreux: «J’avais mes pauvres, mes errants, mes sans-papiers, Fribourgeois perclus d’alcool et d’année de chômages, Africains, Yougoslaves, tout ce que la société repousse à la faim et à l’égout». Le personnage frise alors le chromo sulpicien, qui parle comme les saintes des livres, aime les vitraux de Bazaine comme Chessex, regrette de n’avoir pas été Marie-Madeleine, trouve les sculptures de Tinguely «plus proches de Golgotha que la plupart des crucifix qui pullulent dans les églises», raffole des films de Tarzan, entraîne une jeune disciple dans ses bienfaits en la faisant se livrer aux indigents et aux infirmes dans les caves et les taudis, enfin meurt... Tout cela relevant finalement du chromo inversé, du cliché peu crédible à vrai dire faute d'incarnation. Dans le premier des trois textes de Comment guérir un fanatique, petit livre paru récemment en traduction française, Amos Oz parle de la nécessité, pour un romancier, de se glisser dans la peau de l’autre. «Chaque matin, écrit-il, je me lève, prends mon café, effecte ma promenade quotidienne dans le désert et m’installe à mon bureau en me demandant ce que je ressentirais si j’étais à la place de mon héroïne ou de l’un de mes protagonistes masculins, ce qui est indispensable avant d’écrire même un simple dialogue: vous vous devez d’être loyal et spontané envers tous les personnages. En paraphrasant D.H. Lawrence, je dirais que pour écrire un roman il faut être capable d’éprouver une demi-douzaine de sentiments et d’opinions contradictoires avec le même degré de conviction, d’ntensité et d’énergie. Disons que je suis un peu mieux armé qu’un autre pour comprendre, de mon point de vue de juif israélien, ce que ressent un Palestinien déplacé, un Arabe palestinien dont la patrie est occupée par des «extraterrestres», un colon israélien en Cisjordanie. Mais oui, il m’arrive de me mettre dans la peau de ces ultra orthodoxes. Ou d’essayer tout au moins»…
Dans le premier des trois textes de Comment guérir un fanatique, petit livre paru récemment en traduction française, Amos Oz parle de la nécessité, pour un romancier, de se glisser dans la peau de l’autre. «Chaque matin, écrit-il, je me lève, prends mon café, effecte ma promenade quotidienne dans le désert et m’installe à mon bureau en me demandant ce que je ressentirais si j’étais à la place de mon héroïne ou de l’un de mes protagonistes masculins, ce qui est indispensable avant d’écrire même un simple dialogue: vous vous devez d’être loyal et spontané envers tous les personnages. En paraphrasant D.H. Lawrence, je dirais que pour écrire un roman il faut être capable d’éprouver une demi-douzaine de sentiments et d’opinions contradictoires avec le même degré de conviction, d’ntensité et d’énergie. Disons que je suis un peu mieux armé qu’un autre pour comprendre, de mon point de vue de juif israélien, ce que ressent un Palestinien déplacé, un Arabe palestinien dont la patrie est occupée par des «extraterrestres», un colon israélien en Cisjordanie. Mais oui, il m’arrive de me mettre dans la peau de ces ultra orthodoxes. Ou d’essayer tout au moins»… Le plaisir va-t-il devenir obligatoire? L’hédonisme fera-t-il l’objet demain de cours sanctionnés par des examens? Faut-il se réjouir de voir Michel Onfray devenir LE philosophe le plus lu de la France du poète Villepin? Je me pose ces graves questions ce dimanche matin, en écoutant une plaque de Buddy Guy trouvée hier pour une thune dans une grande surface de la zone industrielle voisine, au milieu des champs de neige, après avoir repris la lecture du Voyage des morts de François Augiéras, réédité dans Les Cahiers Rouges alors que paraît une biographie (et même deux paraît-il) consacré à cet étrange personnage, mystique barbare et merveilleux écrivain au demeurant.
Le plaisir va-t-il devenir obligatoire? L’hédonisme fera-t-il l’objet demain de cours sanctionnés par des examens? Faut-il se réjouir de voir Michel Onfray devenir LE philosophe le plus lu de la France du poète Villepin? Je me pose ces graves questions ce dimanche matin, en écoutant une plaque de Buddy Guy trouvée hier pour une thune dans une grande surface de la zone industrielle voisine, au milieu des champs de neige, après avoir repris la lecture du Voyage des morts de François Augiéras, réédité dans Les Cahiers Rouges alors que paraît une biographie (et même deux paraît-il) consacré à cet étrange personnage, mystique barbare et merveilleux écrivain au demeurant. «J’étais jeune et comme les races que nous avions créées, il me semblait voir la lumière pour la première fois», écrit François Augiéras ce dimanche matin, tandis que Buddy Guy, le nègre à couilles pleines de lait blanc comme la neige, pousse son Broken hearted blues qui me fait jouir de douleur bleue.
«J’étais jeune et comme les races que nous avions créées, il me semblait voir la lumière pour la première fois», écrit François Augiéras ce dimanche matin, tandis que Buddy Guy, le nègre à couilles pleines de lait blanc comme la neige, pousse son Broken hearted blues qui me fait jouir de douleur bleue.
 En reprenant la lecture du Journal littéraire de Paul Léautaud, comme souvent à travers les années, depuis plus de trente ans, je me sens à la fois très proche de ces notations si limpides et si libres, d’un esprit si vif et d’une expression si naturelle, tout en me situant à l’opposé de sa position d’égotiste aux curiosités par trop étroites, dont l’horizon ne dépasse guère le pourtour de l’île-de-France, ni la profondeur de son encrier. Au demeurant, restant lui-même et farouchement, Léautaud ne m’intéresse pas moins à tout coup pour la justesse et la sincérité de tout ce qu’il note, et sa phrase seule a quelque chose de salubre et de revigorant.
En reprenant la lecture du Journal littéraire de Paul Léautaud, comme souvent à travers les années, depuis plus de trente ans, je me sens à la fois très proche de ces notations si limpides et si libres, d’un esprit si vif et d’une expression si naturelle, tout en me situant à l’opposé de sa position d’égotiste aux curiosités par trop étroites, dont l’horizon ne dépasse guère le pourtour de l’île-de-France, ni la profondeur de son encrier. Au demeurant, restant lui-même et farouchement, Léautaud ne m’intéresse pas moins à tout coup pour la justesse et la sincérité de tout ce qu’il note, et sa phrase seule a quelque chose de salubre et de revigorant. Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour: son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, un hommage funèbre amical à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la «rumeur» captée dans l’instant.
Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour: son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, un hommage funèbre amical à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la «rumeur» captée dans l’instant. Les Japonais avaient leur pèlerinage de poètes comme les musulmans ont celui de La Mecque ou les chrétiens les chemins de Compostelle, qu’ils appelaient la route du Tôkaidô, reliant en cinq cents kilomètres les deux capitales de Kyoto et d’Edo. «Ce n’est pas pour son grand rôle politique que cette route nous est connue», écrit Pierre Michon dans la belle préface au recueil de chroniques que Pierre Pachet vient de publier sous le titre de Loin de Paris, «mais parce que, une fois au moins dans leur vie, les lettrés se sentaient tenus d’emprunter cette route, et d’y méditer à leur façon sur chacune des cinquante-trois étapes qui la jalonnaient. Ils s’y remémoraient tel poème, y voyaient tel arbre, tel oiseau, telle auberge que leurs prédécesseurs avaient mentionnés; ils versaient à l’endroit convenu les larmes qu’un très ancien poète avait versées; il leur arrivait d’attendre longuement à une étape que le vent se mette à souffler dans la direction exacte décrite cent ans plus tôt, et qu’il emporte cette feuille de pêcher qu’il avait emportée cent ans plus tôt. Leur cœur alors se serrait sans qu’ils sachent pourquoi, disaient-ils, ils reprenaient leur bâton et allaient se serrer le cœur à l’étape suivante. Parfois même ils avaient une émotion nouvelle que les anciens n’avaient pas eue, saisissaient une conjonction inédite d’arbre et d’oiseau et de saison. Et ceux qui venaient après eux en faisaient usage ». Sur une voie de la mémoire rappelant la route du Tôkaidô, Pierre Michon se rappelle deux ou trois choses qu’il doit à Pierre Pachet, et par exemple de lui avoir commenté un fragment d’Héraclite et de lui avoir appris à reconnaître les corneilles mantelées.
Les Japonais avaient leur pèlerinage de poètes comme les musulmans ont celui de La Mecque ou les chrétiens les chemins de Compostelle, qu’ils appelaient la route du Tôkaidô, reliant en cinq cents kilomètres les deux capitales de Kyoto et d’Edo. «Ce n’est pas pour son grand rôle politique que cette route nous est connue», écrit Pierre Michon dans la belle préface au recueil de chroniques que Pierre Pachet vient de publier sous le titre de Loin de Paris, «mais parce que, une fois au moins dans leur vie, les lettrés se sentaient tenus d’emprunter cette route, et d’y méditer à leur façon sur chacune des cinquante-trois étapes qui la jalonnaient. Ils s’y remémoraient tel poème, y voyaient tel arbre, tel oiseau, telle auberge que leurs prédécesseurs avaient mentionnés; ils versaient à l’endroit convenu les larmes qu’un très ancien poète avait versées; il leur arrivait d’attendre longuement à une étape que le vent se mette à souffler dans la direction exacte décrite cent ans plus tôt, et qu’il emporte cette feuille de pêcher qu’il avait emportée cent ans plus tôt. Leur cœur alors se serrait sans qu’ils sachent pourquoi, disaient-ils, ils reprenaient leur bâton et allaient se serrer le cœur à l’étape suivante. Parfois même ils avaient une émotion nouvelle que les anciens n’avaient pas eue, saisissaient une conjonction inédite d’arbre et d’oiseau et de saison. Et ceux qui venaient après eux en faisaient usage ». Sur une voie de la mémoire rappelant la route du Tôkaidô, Pierre Michon se rappelle deux ou trois choses qu’il doit à Pierre Pachet, et par exemple de lui avoir commenté un fragment d’Héraclite et de lui avoir appris à reconnaître les corneilles mantelées.
 Philip Roth aurait pu « changer les noms », comme on dit, mais que cela aurait-il changé alors que le rapport entre les personnages et leurs « modèles » restait si manifeste ?
Philip Roth aurait pu « changer les noms », comme on dit, mais que cela aurait-il changé alors que le rapport entre les personnages et leurs « modèles » restait si manifeste ? Tant d’intersections de vraie vie féconde. Ma bonne amie que je surprends à l’instant plongée dans Matière et mémoire de Bergson, alors que tous les jours je retrouve moi-même la matière et la mémoire de la Recherche du temps perdu. Et ma chère L. de me dire que ces rencontres la délivrent du poids des engluements de la vie et de tant de menées de médiocres bureaucrates ne détestant rien tant que ce qui bouge et respire - les éternels morts-vivants se perdant dans le simulacre de travail.
Tant d’intersections de vraie vie féconde. Ma bonne amie que je surprends à l’instant plongée dans Matière et mémoire de Bergson, alors que tous les jours je retrouve moi-même la matière et la mémoire de la Recherche du temps perdu. Et ma chère L. de me dire que ces rencontres la délivrent du poids des engluements de la vie et de tant de menées de médiocres bureaucrates ne détestant rien tant que ce qui bouge et respire - les éternels morts-vivants se perdant dans le simulacre de travail. Très intéressé, plus même : passionné par La chaste vie de Jean Genet de Lydie Dattas, qui évoque la quête d’absolu de l’écrivain en le tirant du côté de la sainteté plus ou moins accomplie. L’idée directrice est qu’il y a en Genet un enfant humilié et offensé, petit paysan de France initialement rejeté par sa mère, ensuite relégué dans la caste maudite des orphelins et, de cercle en cercle, refoulé jusques au fond des oubliettes des parias, où il s’est forgé son personnage et sa morale avant d’en remonter par le truchement d’un style incomparable.
Très intéressé, plus même : passionné par La chaste vie de Jean Genet de Lydie Dattas, qui évoque la quête d’absolu de l’écrivain en le tirant du côté de la sainteté plus ou moins accomplie. L’idée directrice est qu’il y a en Genet un enfant humilié et offensé, petit paysan de France initialement rejeté par sa mère, ensuite relégué dans la caste maudite des orphelins et, de cercle en cercle, refoulé jusques au fond des oubliettes des parias, où il s’est forgé son personnage et sa morale avant d’en remonter par le truchement d’un style incomparable.
 Oui je crois que c’est cela : Jonathan Littell ressaisit, dans Les Bienveillantes, la double régression collective et individuelle du totalitarisme et de l’inceste (deux façons de nier la réalité et les composantes de la vie ou de la société) pour en donner une représentation globale et tenter de l’exorciser. (A La Désirade, ce 21 septembre).
Oui je crois que c’est cela : Jonathan Littell ressaisit, dans Les Bienveillantes, la double régression collective et individuelle du totalitarisme et de l’inceste (deux façons de nier la réalité et les composantes de la vie ou de la société) pour en donner une représentation globale et tenter de l’exorciser. (A La Désirade, ce 21 septembre). Tout enveloppées de brume, sur lesquelles elles semblaient flotter comme des îles fantomatiques, les montagnes de Savoie avaient ce matin quelque chose des paysages aquarellés par les Chinois, et je me suis promis de les fixer à mon tour sur le papier à l’instant même où ma bonne amie me signalait ce qu’elle voyait elle-même à la fenêtre de l’étage d’en dessous. Or c’est cela même qui se passe souvent entre nous, qui voyons la même chose au même instant et qui nous le signalons alors : « Regarde… »
Tout enveloppées de brume, sur lesquelles elles semblaient flotter comme des îles fantomatiques, les montagnes de Savoie avaient ce matin quelque chose des paysages aquarellés par les Chinois, et je me suis promis de les fixer à mon tour sur le papier à l’instant même où ma bonne amie me signalait ce qu’elle voyait elle-même à la fenêtre de l’étage d’en dessous. Or c’est cela même qui se passe souvent entre nous, qui voyons la même chose au même instant et qui nous le signalons alors : « Regarde… » De quelle nature animale a été ma bêtise ? Je me le demande en lisant cette phrase de Roland Dubillard : « Comment les hommes en sont-ils venus avoir peur et honte de leur bêtise ? » Or justement, je n’ai, pour ma part, ni peur ni honte de ma bêtise. Je l’assume, comme on dit. « Aller où boivent les vaches », recommandait Rimbaud. Et de fait, j’ai toujours pris le parti des vaches, si j’ose dire, contre celui des clercs et des cuistres. Je préfère en somme avoir l’être bête que de passer pour l’un d’eux… J’en conclus que ma bêtise est surtout bovine, relevant au passage que dans ce mot il y a « bon » et « vin »…
De quelle nature animale a été ma bêtise ? Je me le demande en lisant cette phrase de Roland Dubillard : « Comment les hommes en sont-ils venus avoir peur et honte de leur bêtise ? » Or justement, je n’ai, pour ma part, ni peur ni honte de ma bêtise. Je l’assume, comme on dit. « Aller où boivent les vaches », recommandait Rimbaud. Et de fait, j’ai toujours pris le parti des vaches, si j’ose dire, contre celui des clercs et des cuistres. Je préfère en somme avoir l’être bête que de passer pour l’un d’eux… J’en conclus que ma bêtise est surtout bovine, relevant au passage que dans ce mot il y a « bon » et « vin »…