Paul Léautaud se flattait de n’avoir jamais menti de toute sa vie, et c’est sûrement vrai. Jamais en tout cas, à le lire, on n’a l’impression qu’il cherche à plaire au lecteur ou qu’il se ménage lui-même en s’observant. Voici par exemple ce qu’il écrivait dans son le dimanche 4 mars 1951 dans son Journal littéraire: «Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne.»
Le même jour (l’écrivain avait alors 79 ans) Léautaud remarquait qu’il avait toujours été «fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement», et qu’une seule chose avait compté pour lui: le plaisir précisément. «Ce mot plaisir représente pour moi le moteur de toutes actions humaines».
Son plaisir, Léautaud l’avait trouvé avec quelques femmes, avec les poètes dont il fut l’anthologiste au début du siècle (lui qui se prétendait fermé au sentiment, pleurait comme une madeleine quand il récitait par cœur Verlaine, Jammes ou Apollinaire), dans les conversations quotidiennes au Mercure de France dont il était l’employé, avec les dizaines des chats et de chiens qu’il recueillait dans son pavillon d’ermite urbain de Fontenay-aux-Roses, et surtout à écrire, tous les soirs à la chandelle, le rapport circonstancié de ses journées, consigné à la plume d’oie sur des feuilles collées les unes aux autres et dont l’ensemble nourrit les dix-huit volumes de la première édition du Journal littéraire.
A part celui-ci, Le petit ami, évoquant sa jeunesse de gandin préférant les lorettes de bals populaires aux bourgeoises, et le poignant In memoriam, écrit au chevet de son père mourant avec autant de ressentiment (justifié) que d’émotion (Léautaud est un super-émotif sous son rictus), quelques proses stendhaliennes et ses chroniques de théâtre réunies sous le pseudonyme de Maurice Boissard, constituent toute son œuvre; à quoi s’ajoute la formidable série d’entretiens radiophoniques qu’il a réalisés avec Robert Mallet, qui le fit connaître de la France entière et dont l’intégrale est disponible en CD.
Paul Léautaud avait 21 ans lorsqu’il entreprit la rédaction de son Journal littéraire, qu’il tint jusqu’à la veille de sa mort, le 22 février 1956. Tôt abandonné par sa mère (qu’il ne reverra qu’une ou deux fois et dont il rêva comme d’une amante), laissé très libre par un père cavaleur qui l’introduisit dans les coulisses des théâtres (il fut successivement comédien et souffleur au Français), Léautaud fut très tôt indépendant et pourtant le poulbot de Montmartre sera du genre sensible et studieux, pour devenir un clerc lettré puis une figure originale du Quartier latin, avec sa dégaine de clochard shakespearien reçu dans les salons (chez Florence Gould, il se prend volontiers de bec avec Cingria, son contraire en tout et qui dira magnifiquement tout ce que nous donne Léautaud mais aussi tout ce dont sa sécheresse française nous prive, du jazz syncopé à la Renaissance italienne ou du romantisme allemand à la mystique médiévale…) et redouté pour ses traits de cynique voltairien.
Dès ses débuts, Léautaud dit se méfier des «grands styles» et n’aspirer qu’à «simplifier, sans cesse». C’est qu’il n’en a qu’au mot juste. L’épiderme de sa maîtresse, dite Le Fléau, lui paraît-il un peu rêche, qu’il écrit: «Une peau… comme une râpe». Et tout à l’avenant, qu’il s’agisse des grands écrivains qu’il fréquente (Valéry, Gide) ou des petites gens du populo (qu’il juge le plus souvent sans aménité), des pièces de théâtre qu’il va voir le soir et qu’il juge selon son seul goût tout classique (donc insensible au «galimatias» d’un Claudel), des idées dont il se méfie et des idéologies qui lui semblent autant de fumées, de la comédie littéraire (il rate de peu le Goncourt avec le petit ami) et des tribulations de l’époque, dont il ne parle guère, contemporain de Saint-Simon ou de Diderot plus que de Sartre et consorts.
C’est de fait dans cette ligne claire et tonifiante, qui relance celle de Stendhal ou de Chamfort, que se situe l’écriture de Léautaud, où il fait bon se retremper mais à laquelle la littérature ne saurait être réduite.
Les montagnes de Savoie ont ce matin un extraordinaire relief, alors que l’oblique lumière d’automne éclaire chaque détail des deux rives, du port de Clarens à celui de Saint-Gingolph en face, avec une netteté qui cisèle aussi la fine dentelle des feuillages d’or rouillé et souligne les verts encore intenses du val suspendu que nous surplombons de notre balcon en lisière de forêt.
Or contemplant cette image tissée de temps et me rappelant ce que dit Michel Serres des multiples temps, justement, qui tissent un paysage, je me retrouve dans un état de silencieuse songerie qui me remplit à la fois de reconnaissance et me conforte dans la conviction que ce tissage quotidien de tous les temps du Grand Récit de la nature ou de l’Histoire (le château médiéval de Chillon jouxtant là-bas le viaduc de l’autoroute), des vies singulières des braves gens qui vaquent alentour, et de nous aussi, de nos enfants qui s’en vont pour en amener peut-être d’autres au monde, du chien Fellow et de la mésange Zoé, enfin des dizaines de milliers de livres dont les voix bruissent autour de nous, constitue à la fois le livre du jour et le nuancier approprié à l’écriture ou à la peinture du jour.
En repensant aux intempestifs et aux péremptoires que j’ai lus (ou relus) ces derniers jours, de Houellebecq à Joseph de Maistre et de Dantec à Léon Bloy, je me suis dit que c’est cela qui me manquait chez ceux-là: le détail et la nuance, ou plus encore: l’intimité. Des imprécateurs que je connaisse, seul Vassily Rozanov allie, avec son génie de l’immédiateté saisie dans l’instant, l’Idée et le Sentiment; et la femme est toujours proche chez l’auteur de Feuilles tombées, incarnation même de l’intimité.
Dantec s’en prend souvent et violemment, dans Le théâtre des opérations, - dont le titre guerrier annonce la démarche, et qui me passionne sans me convaincre toujours -, au nombrilisme de la littérature française actuelle. Je partage en partie son point de vue, mais en partie seulement, car la réalité est mille fois plus riche et nuancée, autant que le paysage de ce matin, comme est plus riche et nuancée la littérature anglo-saxonne contemporaine, qu’il réduit à peu près au roman «pop» des Burroughs, Dick, DonDeLillo et Ballard.
J’aime que la littérature française oppose le fulminant Léon Bloy et les non moins tonitruants Tailhade ou Vallès, conformément au dualisme propre au pays de Descartes, mais j’aime aussi me rappeler une bonne conversation avec François Cheng qui me faisait l’éloge du regard tiers, et voici le paysan parisien Marcel Aymé ou le docteur Anton Pavlovitch Tchekhov, ou ce maître de toutes les nuances nettement dessinées que figure à mes yeux William Trevor, pour s’inscrire en faux contre tel esprit réducteur, tel froid de tels discours.
Réveillé, cette nuit, par un cauchemar glaçant. Une Cadillac de granit, aux roues à jantes de luxe diffusant une espèce de neige carbonique, arrivait du bout de l’allée de la maison du réalisateur italien que nous squattions en notre adolescence. Peu après s’être immobilisé, le véhicule s’en retournait lentement, et tout à coup un chien, du type berger allemand, mais de la taille d’un tigre, tombait du toit tandis que deux jeunes types en jeans, porteurs d’un couteau, s’éloignait derrière la maison, l’air menaçant.
Aussitôt je me suis rappelé le contrat lancé contre moi par je ne sais plus qui, ni pour quel motif, dans un autres rêve, et du coup je me suis retrouvé, soudain, dans l’état de panique mentale où m’a plongé, des années durant, le rêve du meurtre dont je me suis rendu coupable à la fin des années 60, sur la personne du jeune assassin angélique du tenancier du bar Le Shangaï, à Lausanne-City; et je vois à l’instant un couteau suspendu, celui-là même de la nouvelle intitulée L’irréparable, dans le nouveau recueil d’Anne-Lou Steininger, Les contes des jours volés, qui traite justement de la violence en nous et des frères ennemis qui se vouent, en notre for secret, tout l’amour-haine de Dieu sait quelle préhistoire des pulsions…
 Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros ventre – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa bêtise. Et pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.
Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros ventre – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa bêtise. Et pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.
On a parlé de Flannery O’Connor comme d’une sorte de Bernanos au féminin, et c’est vrai qu’il y a de ça, à cela près que l’écriture de Flannery est d’une densité poétique et d’une violence, d’un humour et d’une acuité sans pareils. On peut lire ses histoires au «premier degré», comme de fantastiques morceaux d’observation des comportements humains, dans cette Amérique de la paysannerie pauvre en butte aux conflits de races et de classes, où les prêcheurs de tout acabit foisonnent. En outre, sous les dehors les moins lénifiants qui soient (d’aucuns lui ont même reproché d’être cynique, ce qu’elle n’est pas du tout – mais il est vrai qu’elle ne s’en laisse pas conter…), c’est une véritable arène d’affrontement du Bien et du Mal que les histoires de cette féroce catholique claudiquant (une horrible maladie l’a détruite encore jeune) au milieu de ses poules et de ses paons, plus souvent du côté des supposés coupables que des prétendus vertueux…
La Côte d’or n’a jamais si bien porté son nom qu’en cette fin de matinée d’automne aux irradiants flamboiements, et c’est comme un visage que je reconnais tout en reprenant la lecture amorcée ce matin d’un livre abordant immédiatement ce phénomène de la reconnaissance, au multiple sens du terme, d’un paysage, d’un visage ou de quelque image retrouvée de notre bloc d’enfance, petite musique ou picturale odeur de cage d’escalier où des fantômes montent au ciel de notre mémoire comme à l’échelle de Jacob, du côté de Proust, de Freud et de Spinoza.
Je sais toujours ce que j’ai à faire du côté de Proust, surtout en TGV descendant sur Paris, avec l’idée qu’en glissant plus bas je verrai Chartres et plus bas sous les nuages tendres l’église là-bas aux vitraux mythiques, et je saurai proche la Vivonne, mais Freud et Spinoza: moi pas savoir.
Or ce matin Max Dorra m’y emmène, et là encore il est question de «retrouver la force d’exister» chez ceux qu’a menacés l’écrasement, le déni et l’excommunication.
Dans le TGV il y a plein d’hommes-machines qui crépitent de formules. Un voisin disait tout à l’heure à son compère qu’il fallait gérer l’historique de l’Entreprise ou mourir.
Ne préfère-t-on pas mourir dans ces cas-là, en écoutant un peu de musique.
Ah oui: le livre s’intitule: Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être?
…
L’accord entre deux êtres et la musique de leur relation est à la fois une question de peau et de rythme, liée à la possibilité d’associer les sentiments et les mots, les bribes de rêves et de murmures matinaux (dans l’intimité d’avant l’aube) dans un langage inouï, au sens propre. Je le note en poursuivant plusieurs lectures à la fois, de la première apparition, dans Sodome et Gomorrhe, de Charlus à la Raspelière où les Verdurin le «testent», tandis qu’il drague Morel et diffuse ses «signes» d’un autre monde que la pauvre Verdurin s’efforce de capter; de la lente descente aux enfers de feu glacial de Monsieur Ouine, d’un petit livre singulier de Jean-Jacques Nuel jouant sur la fascination d’un auteur pour un nom (cela s’intitule d’ailleurs Le nom) devenu mot et possible réceptacle d’un nouvel inventaire du monde; enfin cet essai dont la phrase même est rythme et musique, de Max Dorra (ce nom fait aussi pour errer la nuit dans quelle ville mitteleuropéenne…), intitulé Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être? et dont chaque page me fait songer et réfléchir, surtout: m’apprend.
Gilles Deleuze, dont j’ai acheté hier Proust et les signes, que j’ai commencé d’annoter le soir au Buffet de la gare de Lausanne en attendant mon ami le Loup, voit en La Recherche un livre tourné vers l’à-venir et non sur le passé, et c’est exactement ce que je ressens à chaque page: je voudrais savoir, j’apprends, raconte, tu m’étonnes, et voici Madame Cottard qui se réveille d’un petit somme clandestin au milieu de la compagnie et s’écrie sous le regard furibond du docteur. «Mon bain est bien comme chaleur, mais les plumes du dictionnaire»… De ces mots à fleur de rêve ou à fleur d’enfance, on ne sait pas trop, dans cet incroyable bruissement de gestes et de mots du théâtre de la Raspelière où Marcel poursuit son exploration.
Et me le rappelant je lis sous la plume de Max Dorra, évoquant lui-même la présence d’un interlocuteur virtuel, ces mots qui me parlent immédiatement et par leur sens et par leur modulation vocale-musicale: «La chorégraphie d’un être à une signification: le sédiment des manières, la trace des groupes qu’il a traversés».
Je me rappelle aussi que, pendant que je lisais Deleuze dans le grand buffet au Cervin peint à fresque, kitsch mandarine, l’arrivée de mon compère le Loup, formidable ami retour de Roumanie où il est allé installer de force l’électricité et le téléphone dans la caverne post-communiste de sa mère (sa mère qui a montré son cul à son frère et ses cousines pour leur signifier qu’elle voulait croupir seule avec Dieu dans sa trappe), et voici que je tombe sur le récit, par Max Dorra, des «congrès» liant Freud à son ami Fliess et cette phrase parfaite à ce moment: «La vertu de certains amitiés réside dans la musique d’une voix, les rythmes d’un être»…
Et cela sur le style: «Un style, c’est la succession, le rythme de ces arrachements du sens où du sens se bat pour ne pas être étranglé par des codes. L’incessant combat d’un enfant pour se reconstruire face à un monde». Ou ceci encore: «Sur une musique qu’il est seul à entendre, chacun danse». Enfin: «Les individus qui s’attirent ont un rythme similaire»…
Enfin je lis ce matin la brume d’automne aux fenêtres et je me rappelle la marche à tâtons du géant Richter dans la sonate posthume de Schubert, ces gouttes d’être dans la nuit, cette «petite phrase bouleversante» qui nous relie à Quoi?
Je ne suis pas philosophe et ma culture scientifique est à peu près nulle, et je me sens pourtant comme chez moi dans le dernier livre de Max Dorra, Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être?, dont je lisais ce matin, au lit, ces lignes à ma bonne amie en train de potasser ses dossiers sur l’apprentissage des adultes et, plus précisément, ces derniers temps, sur les travaux de Francisco Varela: «Le cerveau. De quoi rêver. Il faudrait, pour explorer ce cosmos, imaginer un véritable équivalent de la NASA. Et avant tout, une NASA de la mémoire. La formation d’un chercheur y serait diversifiée. Neurophysiologiste, il partirait à la conquête de l’encéphale, tout en sachant qu’il en modifiera les connexions en les observant. Poète, il laisserait venir les métaphores, ces carrefours germinatifs entre associations et modèles. Il devrait aussi ne pas ignorer l’histoire e la philosophie, ne serait-ce que pour débusquer les préjugés idéologiques, voire les croyances qui pourraient à son insu parasiter sa propre démarche. Neurophysiologiste, poète, philosophe, il lui faudrait de toute façon ‘etre capable d’accueillir l’inattendu, pour élaborer des concepts nouveaux, et avoir ainsi une chance de commencer un jour à comprendre le cerveau humain».
Lorsqu’elle a entendu l’expression «d’accueillir l’inattendu», ma bonne amie a murmuré «serendipity», qui m’a rappelé du même coup la première fois que j’ai entendu ce mot dans la bouche de René Berger, sur un trottoir lausannois (rayon de soleil oblique flamboyant sur le capot argenté de ma Jazz…) et que j’ai retrouvé dans le dernier essai, Rameaux, de Michel Serres.
Serendipity: ou l’art de trouver un truc quand on cherchait un machin. Dès que le mot est lâché, L. me sort une paire de feuillets photocopiés d’un livre de Jacques Lévy qui détaille le concept à sa façon ; le même Jacques Lévy, spécialiste de l’internet (et plus récemment des blogs) dont j’ai lu les livres en 1996, quand je préparais mon «roman virtuel», devenu Le viol de l’ange, dont la structure procède de la même phénoménologie poétique.
Max Dorra lui encore, après avoir rompu une lance contre «l’actuelle fétichisation de la scientificité», revient sur les prétentions scientifiques du structuralisme, qui valaient leur poids de dogme au tournant de nos vingt piges, pour conclure sans conclure: «La linguistique, de toute façon, méconnaît une part essentielle de la parole: la musique des phrases, le rythme des corps, l’imprévu des mimiques, la danse des gestes».
Accueillir l’inattendu: quel plus beau programme pour un écrivain et, plus généralement, pour n’importe quel lecteur. Rozanov l’a saisi mieux que quiconque: je m’assieds pour écrire telle chose, et c’est telle autre qui me vient de tout ailleurs, de plus profond ou de la simple apparition de la nuque de ma bien-aimée dans telle lumière de telle instant.
A l’instant je lis sur un autre feuillet polycopié de ma moitié: Francisco Varela: «Le cerveau n’est pas un ordinateur»…
Max Dorra n’est pas un homme-machine mais un médecin-poète poreux. Un soir à la radio, Jacques Weber disait que Shakespeare était à ses yeux le poète absolu de la porosité, à savoir la capacité de tout absorber et de tout transmuter. Tout cela va contre tous les savoirs claquemurés, tous les pouvoirs jaloux, tous les fanatismes aussi. Ce n’est pas l’ouverture à n’importe quoi ni l’omnitolérance, mais c’est une saine éthique de la connaissance socratique vécu au temps de la couche-culotte quantique…
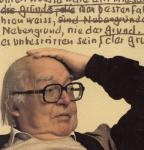 Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, que je retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du nouveau recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre: «Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer: un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en céleste clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté»…
Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, que je retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du nouveau recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre: «Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer: un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en céleste clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté»…
Cette comète qui passe là haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.
Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald. Celui-ci prolonge la tradition des grands promeneurs européens qui va de Thomas Platter, le futur grand érudit descendu pieds nus de sa montagne avec les troupes d’escholiers marchant jusqu’en Pologne, Ulrich Bräker le berger du Toggenburg qui traduira Shakespeare, ou Robert Walser se mettant «pour ainsi dire lui-même sous tutelle», comme l’écrit Sebald, sans cesser de griffonner de son minuscule bout de crayon sous les étoiles…
