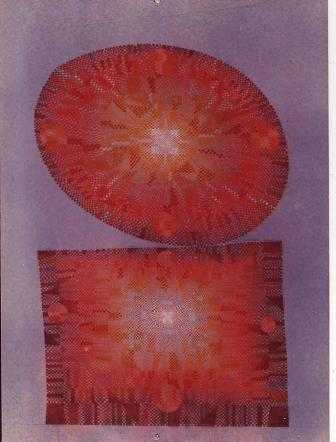Olivier Charles, Huile sur toile.
On était morose, on était comme un vitrail dans la pénombre, et tout à coup il s’est passé quelque chose, la lumière s’est faite dans le vitrail, on a changé d’humeur en voyant ce qu’il y avait là: cette mer de brouillard ce matin, les montagnes enneigées, le ciel rose et gris, le fumet du café, nom de Dieu je vis.
Ce que le Mac de Max Dorra compute en ces termes: «Une petite phrase, un jour, un fragment d’avenir, s’est trouvée incarcérée dans une partition. Pour s’en échapper, elle a tout misé sur sa différence. Longtemps elle a semblé imiter, répéter. Progressivement pourtant, elle s’affirmait. Nourrie de mémoire, elle en faisait un devenir. La fugue raconte cette histoire singulière. Un contrepoint de l’actuel et du virtuel. Et qui défie la mort, et qui fait reculer l’angoisse, ce passé déguisé.»
Et Scriabine d’ajouter: «La pierre et le rêve sont faits de la même substance et sont aussi réels l’un que l’autre».( A La Désirade, ce mardi 8 novembre.)
Ce mauvais coucheur de Castoriadis parlait, à propos de l’évolution de la culture contemporaine, de «montée de l’insignifiance» et celle-ci me paraît précisément caractériser les prix littéraires de cet automne, mais est-ce bien nouveau? Cela ne fait-il pas un siècle que le Goncourt revient à des Weyergans, et le Nobel de littérature n’a-t-il pas été inauguré par Sully Prudhomme? Le ciment d’une société reste le conformisme et l’on serait bien niais (comme je le suis à mes heures…) de s’attendre à ce que la non-conformité fût consacrée, même à une époque ou le pire conformisme se pare des plumes du non conformisme. Bref, on ne devrait pas s’étonner de voir le Goncourt attribué à une chose aussi insignifiante que Trois jours avec ma mère et pas à La possibilité d’une île de Michel Houellebecq, ce malappris, ou pire: à l’époustouflant Cosmos incorporated de Maurice G. Dantec, ce réac foldingue qui n’est apparu dans aucune liste à ce que je sache.
Que le prix Médicis soit attribué à Fuir de Jean-Philippe Toussaint, ce savon de luxe qui vous glisse entre les pattes, et que le prix Femina revienne à Asiles de fous de Régis Jauffret, cet esthète de la désespérance affectée, paraît également ressortir au littérairement correct et à la norme, comme l’Interallié, en principe réservé à un journaliste, collé par raccroc à Houellebecq, relève du n’importe quoi…
A supposer que Monsieur Ouine de Bernanos, Vie de Samuel Belet de Ramuz ou L’apprenti de Raymond Guérin eussent été publiés cette année, les noms de ces auteurs seraient-ils apparus sur les listes des prix? C’est possible mais pas du tout certain. Ce qui est sûr en revanche, c’est que ces livres ont été primés par le Temps, et qu’ils signifient aujourd’hui plus que jamais avec ou sans médailles…

C’est exactement le processus par lequel Sebald, dans cette suite de plongées dans le temps que constituent ses approches des œuvres de Hebel, Rousseau, Möricke, Keller, Walser ou Tripp lui-même, qui sont à chaque fois des approches de visages engloutis dans la nuit du Temps, révèle progressivement les traits d’une destinée particulière cristallisant les éléments dominants de telle ou telle époque en tel ou tel lieu.
Après la terrifiante traversée de l’Allemagne en flammes, dans Une destruction, Sebald rassemble ici plusieurs avatars de la culture préalpine et du mode de vie propres à l’Allemagne du Sud et à la Suisse, dont un élément commun est cette Weltfrömmigkeit (une sorte de métaphysique naturelle ou de mystique panthéiste assez caractéristique du romantisme allemand) qu’il trouve chez Gottfried Keller, dont le chapitre qu’il lui consacre, autour de Martin Salander et d’Henri le Vert, est une pure merveille. Je n’en retiendrai que cette mise en évidence d’une scène emblématique, aussi profondément poétique que l’évocation proustienne des livres de Bergotte survivant à celui-ci dans une vitrine à la manière d’ailes déployées, où l’on voit Henri ajuster, sur le cercueil de sa cousine Anna, une petite fenêtre de verre sur laquelle, en transparence, il découvre le reflet d’une gravure de petits anges musiciens. Et Sebald de préciser aussitôt: «La consolation qu’Henri trouve dans ce chapitre de l’histoire de sa vie n’a rien à voir avec l’espérance d’une félicité céleste (…) La réconciliation avec la mort n’a lieu pour Keller que dans l’ici-bas, dans le travail bien fait, dans le reflet blanc et neigeux du bois des sapin, dans la calme traversée en barque avec la plaque de verre et dans la perception, au travers du voile d’affliction qui lentement se lève, de la beauté de l’air, de la lumière et de l’eau pure, qu’aucune transcendance ne vient troubler»…
C’est le soir, ce matin je lisais ce qu’écrit Max Dorra sur l’heureuse rencontre que constitue le Dieu de Spinoza, j’y ai pensé toute la journée, j’y ai pensé en nageant 500 mètres en brasse coulée, j’y ai pensé en faisant l’acquisition d’un Bouddha de l’époque Song entièrement rongé par les termites à l’exception de l’impassible visage au sourire doux qui a traversé sept siècles avant de rayonner ce soir dans notre maison au bord du ciel, et j’y pense encore à l’instant en lisant le Manuel de contemplation en montagne d’Yves Leclair ou je copie à l’instant: «Tout le monde dort dans la paume d’un Dieu qui rêve», et je lis en moi: «Tout le monde rêve dans la paume d’un Dieu qui dort», et Dhôtel cité par Leclair: «L’univers vagabonde comme un enfant à travers ses abîmes. Mais il n’y a rien, absolument rien que le temps de Dieu, que chacun mesure à sa façon.»
On est pris, dès qu’on entre dans cette chronique fascinante du règne de Staline et de sa clique, dans un drame grandiose et crapuleux dont le Prologue annonce le mélange d’incroyable brutalité et de non moins trouble complexité, à croire qu’on est à la fois chez les Atrides et dans l’arrière-cour conchiée de la tribu Deschiens. Dès son avant-propos, l’auteur annonce son intention de couper court à la légende d’un monstre réduit à une «énigme» aussi peu explicable que celle d’Hitler, ou à un «génie satanique», pour lui opposer la réalité d’un «homme de son temps», une personnalité certes hypocondriaque mais exceptionnelle à tous égards, aux multiples visages, à la fois politicien supérieurement intelligent et potentat ne visant qu’à l’affirmation de son rôle historique, d’un égotisme messianique exacerbe et parlant de lui a la troisième personne comme d’une entité de sa fabrication. Ainsi répondit-il à son fils Vassili, qui prétendait être lui aussi «un Staline», que Staline était le pouvoir soviétique incarné: «Staline est ce qu’il est dans les journaux et ses portraits, pas toi ni même moi».
Or dès les premières pages, Montefiore rend le personnage extraordinairement présent, autant que sa femme Nadia, qui va se suicider au terme du Prologue, dont la durée recouvre la réunion annuelle et le banquet des pontes du régime fêtant l’anniversaire de la révolution, plus précisément en l’occurrence le 8 novembre 1932. En une trentaine de pages frénétiques, qui s’achèvent sur une scène de ménage sauvage et pathétique à la fois (Staline jetant pelures d’oranges et mégots à la femme de sa femme pour l’humilier), l’auteur rend en outre le climat très particulier régnant alors au Kremlin. La tragédie scellant la fin de cette nuit, dont les circonstances exactes restent encore obscures, marque en effet un tournant décisif dans l’histoire du régime: c’est le début de la grande famine planifiée (à laquelle Nadia Allilouïeva s’opposait d’ailleurs) et la fin d’une période certes sanglante pour la Russie mais plutôt heureuse pour Staline et les siens. La réaction de Staline lui-même, à la mort de sa femme (qui lui aurait laissé une lettre «terrible», oscille entre le désespoir et la rage, la fureur d’être «trahi» et la tentation de se supprimer à son tour – bref tout est en place pour le récit de 800 pages qui va suivre…
La pratique consistant à lire plusieurs livres à la fois, qui est la mienne depuis toujours et se combine avec une lecture du monde incluant la musique et le cinéma, les rencontres, les voyages, les songeries en forêt ou en ville, les escales à ma rédaction ou dans les cafés, le théâtre et les expositions, les lettres de mes compères ou les téléphones nocturnes avec mon ami Bernard, me semble correspondre de mieux en mieux avec la perception simultanéiste de notre époque. Ainsi, le même jour, ai-je lu le passage prodigieux de Sodome et Gomorrhe où Charlus séduit Morel en l’humiliant tandis que Marcel sarcle amoureusement le terrain de sa jalousie à venir, tout en regardant d’un œil, sur le PC qui recueille ces notes, le film de Raoul Ruiz intitulé Le temps retrouvé (avec un John Malkovitch assez convaincant dans le rôle de Charlus) et en poursuivant la lecture du livre si pénétrant et stimulant de Max Dorra (Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être?) qui parle, précisément, d’un passe de La recherche que je viens de lire, sur l’humiliation de Saniette par les Verdurin et, plus généralement, sur ceux qui se taisent par opposition à ceux qui la ramènent – Gide racontant ses conversations avec le brillantissime Valéry, et moi me rappelant tous ces moments de timide à patauger en société: «Un individu, soudain, écrit Max Dorra, ne reçoit plus de récompenses. Aucune gratification. Il trouve en face de lui, quand il se hasarde à dire quelques mots, des mimiques figées ou réprobatrices, agacées ou méprisantes. Un silence. L’absence de tout sourire.»
Le langage et «l’être du sens», au lieu du «sens de l’être», se trouve au cœur du livre de Max Dorra, et dans ses multiples manifestations, approché de multiples façons dans ce livre combien étrange et familier, à la fois savant et fraternel, parfois décousu en apparence mais cousu par-dessous si l’on peut dire, lié ensemble comme est liée ensemble notre aperception du monde.
Ce matin j’avais aux jambes une foutue lourdeur de plomb, problèmes de circulation du voyageur en avion (le rêve prolongé), risque de thrombose (la dernière en revenant du Canada) et sensation d’aphasie, sur quoi je déchiffre les pages que Dorra consacre à l’aphasie, ensuite de quoi je me replonge dans le récit littéralement plombé de l’anéantissement de la paysannerie russe par Staline incessamment justifié par une langue de plomb. On ne sortira pas de ces mises en rapport. Pourtant il importe d’en éviter la propension diluante ou nivelante. Tout n’est pas dans tout quand le corps se réveille…
Max Dorra: «La vraie vie est un mixage improbable, déconcertant». Et plus tard on parlera, je le pressens, de musique et de politique, que les Chinois et les Grecs associaient…
Bien plus que la différence, dont on nous rebat les oreilles et qui signifie peu de chose à mes yeux, c’est la ressemblance qui m’importe en cela qu’elle surmonte les particularismes raciaux, sociaux ou sexuels au bénéfice de valeurs plus fondamentales. L’exaltation de la différence fleure déjà, à mes yeux, le clan ou la secte, avec ce relent de revendication qui cherche à forcer la main, alors que la découverte de la ressemblance aboutit à une vraie rencontre.
«Une bonne rencontre est celle qui permet de co-renaître», écrit Max Dorra, «chacun apportant à l’autre, malgré la différence des instruments, des timbres, la note qui manquait à un accord enfin résolutif». Or lisant tout haut cette phrase à celle que j’ai rencontrée pour de bon après divers essais infructueux de part et d’autre à travers les années, je l’entends me dire: «c’est pile mon sujet de mémoire, ça recoupe Damasio et Varela sur quoi je bosse, faudra que je m’achète ce bouquin pasque tes notes au crayon bleu ça devient pas possible…»
Et du coup je me rappelle cette rencontre et toutes celles, «résolutives» pour un moment décisif d’évolution personnelle, qui ont précédé et suivi et que je m’obstine à ne pas croire le fruit du hasard: nécessaires à ce moment précis.
Avec L. on se rencontre à dix-huit ans, on fleurète, on se bécote et se tripote, mais le moment n’est pas venu. L’année du bac on se rencontre presque, on aurait fait des enfants avant le divorce probable, mais non: je vais de mon côté, elle se trouve un autre complice avant de divorcer, elle me relance (coiffure afro, engagée un max à gauche dans le groupe Mozambique) entre temps j’ai rencontré XYZ que j’ai aimés et lâchés faute de co-renaissance réciproque, ainsi de suite.
Cette notion de co-renaissance est devenue la base de toutes mes relations, fondées sur la réciprocité. Toutes les amitiés qui n’ont pas été tissées de co-renaissance se sont étiolées avant de défunter. On me juge sans doute un piètre ami selon les codes de la répétition, mais tant pis, je n’aime pas faire semblant ni ne tolère le chantage à l’amitié qui force à se trahir.
Je fréquente Max Dorra depuis moins d’un mois. Pas idée de qui il est. Jamais vu son visage. Mais plus proche de lui ces jours que de tant de gens qui prétendent me connaître, par les petites phrases que son livre relaie, vraie rencontre occulte, comme celle de Proust tous les matins que je lis aux «lieux», le Salon Proust de la Désirade où s’empilent tous les écrits de et sur Marcel Proust.
A l’instant, à la fenêtre, le paysage est divisé en deux: ciel céleste et mer de brouillard. Gloire apparente du dessus, mais c’est à l’enfant sous la table que je pense. L. me raconte justement l’histoire de cette enseignante qui vient vers elle lui dire que la passionne la thématique de l’Ogre dans les contes, qu’elle aimerait traiter dans ses classes d’enfants difficiles, et qui fond soudain en larmes…
Les hasards de l’édition me font lire, en même temps, deux livres intéressants que relient un même thème: la faillite du communisme réel. Le premier est une somme de près de 800 pages, qui nous plonge dans la vie quotidienne du cercle des potentats staliniens, style clan militaro-clérical, fanatiques bâtisseurs prêts à fusiller leur mère pour la cause des Travailleurs, avec lesquels on s’enfonce dans une épouvantable spirale de répression de masse préludant aux procès fratricides et aux exécutions. L’autre est un petit récit de Claude Duneton, fils de paysan du Limousin qui a baigné dans les grandes espérances nourries par la glorieuse Union soviétique (son père, devenu magasinier chez Renault, voyait en la Russie le paradis sur terre), et qui se retrouve en 1991 dans la cuisine de Tamara, belle blonde septuagénaire qui lui raconte sa vie de fille de plombier sous le socialisme réel, à cinq personnes dans la même pièce pendant vingt ans.
A lire ces deux livres, on éprouve un sentiment qui ne se retrouve jamais à la lecture de témoignages sur le nazisme. Un sentiment mélangé d’horreur et de compassion. Même décrits dans le déchaînement de leur paranoïa, les potentats staliniens (et Staline lui-même) conservent quelque chose qui ressemble à de la «bonne volonté». Le tableau de La cour du Tsar rouge est extraordinairement détaillé et foisonne d’observations révélatrices. Par exemple celui-ci: que Staline tance Molotov sur son usage incertain du point virgule, en même temps qu’on planifie la famine en Ukraine; que tous, bourreaux de travail, se soucient mutuellement de leur santé et de l’éducation des enfants; qu’il lisent beaucoup et sont convaincus de servir un Idéal chevaleresque… Nadia, la femme de Staline, ne bronche pas quand on lui annonce la déportation d’un million de paysans, mais ce n’est pas un monstre pour autant, et puis ces paysans sont des koulaks. Et koulak, dans le catéchisme communiste, signifie exploiteur, vampire. En réalité pour la plupart: petits paysans pauvres qu’on vient dépouiller de leurs biens. Et les récoltes de se trouver confisquées et revendues pour doter l’industrie. Et la famine de ravager l’Ukraine, dont les ressortissants seront les victimes d’un massacre sans précédent. Cela non par racisme mais au nom de la fraternité!
Et de même est-ce au nom de la fraternité que le père de Claude Duneton voit-il en Thorez un apôtre de l’Avenir Radieux, sans savoir que le grand Maurice ment aux travailleurs français pour asseoir son propre pouvoir, comme Aragon a menti pour consolider le sien.
A lire ces deux livres en parallèle, le plus curieux est qu’on ne sent nullement conforté dans ce qu’on appelle l’anticommunisme. Il ne s’agit pas de ça mais de la foi aveugle en quelque idéologie que ce soit, catholique ou fasciste, maoïste ou léniniste. Claude Duneton observe que ses voisins paysans illettrés, dans le Limousin, résistaient mieux aux sirènes des lendemains qui chantent que son père lecteur. Or on se rappelle les œillères du père Sartre à Cuba: mentons au nom de l’Avenir et pour ne pas désespérer Billancourt, ce genre de discours.
Surtout ce qui m’enchante dans ces deux livres, c’est qu’ils sont purs de toute haine et de tout ce qui fonde l’hubris destructeur. Lorsque Beria entre dans le cercle des potentats staliniens, Nadia Staline frémit d’horreur comme lorsque le Démon Stavroguine entre dans une pièce, chez Dostoievski. Il y a un diable parmi nous: et Staline le sait. Mais Staline sait aussi que ce démon va le servir mieux que certains de ses amis, que Beria torturera avec un soin particulier. Claude Duneton a été communiste lui aussi, comme tant de jeunes gens de bonne foi, et je me rappelle un premier voyage en Pologne, en 1967, j’avais vingt ans et je me croyais si progressiste que j’enjoignais nos hôtes, serrés à dix dans trois pièces, de croire à l’Avenir pour ne pas nous désespérer…
A relever enfin cela d’épatant dans Loin des forêts rouges: que Duneton, qui ne parle pas russe, s’entretient avec Tamara, qui baragouine à peine anglais. Cela donne donc un échange plus mimé que parlé qui devient, de page en page, une véritable pièce de théâtre. Dans le langage célinien de l’écrivain, on se régale et d’autant plus que Duneton n’est pas du genre à se dorloter de mélancolie…
Il fait nuit sur les monts tandis que l’hiver gagne. A la fenêtre là-bas scintillent, dans le noir où se distingue le contour du lac en ligne noire sur fond noir, le cliquetis-piquetis des lumières d’Evian. Et je lis sous la lampe ces mots d’ Yves Leclair écrits de sa Chine pyrénéenne où la neige, dit-on, a déjà recouvert les hauteurs: «La table est vide sous le halo orange de l’ampoule. Profonde obscurité à l’entour: j’y vois plus clair». Et comme je viens de m’éveiller je lis ce qui suit comme un écho inverse: «Dernier éveil avant de plonger dans le sommeil: femme, un Dieu clair a laissé son sceau sur ta peau laiteuse comme un point final – un beau grain de beauté dans ta neige, tout près de ton geai bleu».
 On a besoin le matin de phrases limpides, on se lave à l’eau des mots, on lit par exemple: «le samedi midi, c’est le jour du bifteck de cheval. Louise le mange cru, non haché mas recouvert d’une nappe de sucre en poudre».
On a besoin le matin de phrases limpides, on se lave à l’eau des mots, on lit par exemple: «le samedi midi, c’est le jour du bifteck de cheval. Louise le mange cru, non haché mas recouvert d’une nappe de sucre en poudre».
Ou bien on lit: «L’auteur revoyait dans une succession d’images presque arrêtées tout ce que son père lui avait apporté, au-delà des mots si rares, au-delà des gestes encore plus rares, ces attentions, cette tendresse informulée, ces soucis, ces espoirs pour l’avenir d’un fils, seul garçon de la famille». Ou bien encore on lit: «Il cherche, une fois de plus, les mots du commencement, des mots, par exemple, capables de nommer ce qui fait le miracle du corps humain, son inexplicable animation, sitôt noué son dialogue muet avec les autres, le monde et lui-même – et aussi la fragilité de ce miracle». Ou encore ceci tandis que le jour se lève sur les pentes givrées: «Donne à qui sait lire ton âme, fuis qui la déchire, car tu n’as pas le temps».
Tous les dimanches, Hervé Guibert allait voir Suzanne et Louise, deux vieilles femmes, ses grand-tantes, qu’il photographiait et décrivait au milieu de leurs objets, deux vieilles petites filles qui ne se parlaient guère qu’en sa présence, et son écriture toute unie et pure raconte le Carmel de Louise et les jambes de Suzanne, les cheveux très très longs de Louise jouant à se mettre la muselière du chien Whiskey et le corps de Suzanne jouant à être morte avant de se livrer à la faculté de médecine. Tous les jours Jean-Jacques Nuel revenait à sa table pour y sacrifier au Rite de l’écriture, tous les jours Cézanne revenait au corps du monde, tous ces matins Giovanna s’en va dans le froid du monde avec en elle peut-être une petite phrase bouleversante qui lui revient de cette page d’un livre entrouvert: «donne à qui sait lire ton âme»…
Hervé Guibert retrouvé ce matin, l’esprit d’Hervé que je retrouve au coin du feu, le corps d’Hervé libéré de sa torture, l’écriture sans rature d’Hervé Guibert décrit le Paradis de Louise: «Elle dit qu’elle ne l’imagine pas. Le corps, de toute façon, n’a plus d’existence, et elle me cite un passage de l’Evangile où un esprit naïf demande avec lequel de ses sept maris une femme qui s’est mariée sept fois entrera au Paradis». Et je lis du petit livre entrouvert: «Si les livres n’avaient pas été là, je serais mort dans cette forêt. Lire m’a sauvé la vie et le voyage a commencé. Les mots sont mon sang, mon fouet, mon feu». Enfin je lis ces mots de Jean-Jacques Nuel: «Tout était à écrire. Un livre n’y suffirait pas».
J’avais repris les œuvres de l’énergumène pour lire de mes yeux les mots éclatés d’Artaud le Mômo, et j’ai lu «L’esprit ancré/vissé en moi/par la poussée psycho-lubrique/du ciel/est celui qui pense toute tentation/tout désir/toute inhibition», j’ai lu «o dedi/a dada orzoura/o dou zoura/a dada skizi», j’ai lu «o kaya/o kaya pontoura/o ponoura/a pena/poni», je me suis rappelé ces mots sortant des babines du grand bambin couillu babolant dans son corps tournoyant, au théâtre l’autre soir, et j’ai repris au vol «C’est la toile d’araignée pentrale/la poile onoure/d’où – ou la voile,/la plaque anale d’anavou», et j’ai lu encore «(Tu ne lui enlèves rien, dieu/parce que c’est moi. Tu ne m’as jamais rien enlevé de cet ordre./Je l’écris ici pour la première fois,/je le trouve pour la première fois», et j’ai noté ces mots: «Je l’écris ici pour la première fois/je le trouve pour la première fois», car c’est cela même Artaud pour moi, Comme Van Gogh ou comme Louis Soutter, tous trois foudroyés à consommer tout cru à pleine langue et les dents dans la viande des mots, d’ailleurs je zappais et lisais maintenant: «On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh qui, dans toute sa vie, ne s’est fait cuire qu’une main et n’a pas fait plus, pour le reste, que de se trancher une fois l’oreille gauche, dans un monde où on mage chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau-né flagellé et rage, tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel».
Je lisais ces mots écrits à l’instant pour la première fois, puisque lus comme ça pour la première fois par moi, et je pensais à la Toile, poile onoure ou pentrale peu importe, mais à l’araignée, et je voyais Artaud dans la Toile, le sceptre levé: «La pointe extrême du mysticisme,/je la tiens maintenant dans le réel et dans mon corps,/comme un balai de cabinets», me disant: qu’est-ce que cela change?
Qu’est-ce que cela change Internet? J’envoie à l’instant Louis Soutter sur l’Internet, il titube, il rouspète, mais il a ses plumes et son encre chourée au bureau de poste voisin (il y a encore des postes à la poque de la poile onoure ou pentrale) et mon compère Antonin (l’autre, l’ancien comédien lui aussi devenu nécrivain) qui m’écrit des SMS ou des Mails à chaque bouquin que je lui intime de lire me répond: sûr qu’Artaud le Mômo campe sur la toile - même qu’il y a son trou noir où ces mots flamboient: «L’intelligence est venue après la sottise/laquelle l’a toujours sodomisée de près – Et après»…
Et après il y avait l’objet à la pointe extrême du regard de Van Gogh, et téléphone ou pas, il y avait la douleur à la pointe extrême du regard de Louis Soutter, et fax laser ou pas il y a ce fou d’Artaud qui dit tout et le contraire de tout mais qui le dit et le vit et ce cri échappe à toute connivence de ma part ou de la tienne, il dit au flic du Dôme qui veut le copiner: «Pas de tutoiement, ni de copinage,/Jamais avec moi,/ pas plus dans la vie que dans la pensée», et ça c’est partout qu’il le dit, il n’y a qu’à lire, l’Internet n’est rien, les machines ne baisent pas le corps, c’est le corps qui baise l’esprit et l’esprit rend gorge: «Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas-côtés de foudre. La frange ténébreuse insolite du vide montant d’après l’éclair. Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile. Suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d’une suffocation d’en-haut. Et pourtant tout le tableau est riche. Riche, somptueux et calme le tableau»…
La neige était là tôt l’aube, la féerie de toujours mais ce matin plutôt comme une ombre blanche aux fenêtres - et justement je resongeais à ce monde apparemment réduit à rien du minimalisme qui peut relever aussi bien de l’impuissance créatrice que de l’ascèse poétique, comme dans les épures de Rothko, et je revoyais l’immensité apparemment vide de Gerry, le film de Gus Van Sant que j’ai regardé hier soir, juste après avoir repris la fin du roman de Jean-Jacques Nuel, Le nom, qui se risque lui aussi sur le fil du rasoir du vide apparent.
Il ne se passe à peu près rien dans Gerry où deux amis se perdent dans la vastitude infinie d’un paysage, mais ce désert est aussi vibrant de présence que celui dont parle Théodore Monod, et ce qui se passe, à peu près sans mots, entre les deux garçons reste étrangement prenant. De la même façon, et malgré le paradoxe et le risque encouru par toute forme de «performance» littéraire, le roman de Jean-Jacques Nuel résiste à la vacuité et non seulement par la musique de l’écriture mais par tout ce qui filtre de la présence du romancier et de ce qui pour l’écrivain relève de l’essentiel, en deçà et par delà le nom qu’il écrit et réécrit comme un écolier sa première page de lettres copiées à la ronde ou comme un saint au désert ce qu’on appelle la prière du cœur, se bornant aux mêmes mots répétés à l’infini.
Or que dire de plus à propos de ces expériences-limites? Peut-être ceci: qu’elles constituent des pointes qui s’émoussent à la moindre réitération complaisante. Ainsi le minimalisme devenu système, en peinture, sombre-t-il dans le dérisoire, de même que le maniérisme du rien en littérature, quand telle vie minuscule ou telle petite gorgée de bière se réduisent au must d’une mode…
Il y a des moments de présence intense dans Gerry, quand les garçons marchent au bord du ciel ou dans le sel éblouissant-assoiffant du désert, quand Gerry évoque ses royaumes imaginaires à côté du feu de nuit ou lorsque couchés, exténués, leurs corps se rapprochent, leurs mains se cherchent, leurs sentiments mêlés d’affection et de rage esquissent une lutte-étreinte les rejetant finalement dans leur solitude muette tandis que le ciel roule ses vagues bleues en accéléré - mais tiens, voici du bleu sur la neige
 On est très vite entraîné dans le vif du dernier roman de Carlos Fuentes, par l’entremise d’une femme de tête, la cinquantaine et dans la haute politique mexicaine, qui drague épistolairement un fringant trentenaire qu’elle vient de rencontrer et qu’elle se propose d’aider à se mettre en selle avant de lui ouvrir son bunker privé. Cela se passe en 2020, alors que le président mexicain vient de damer le pion aux Américains en refusant de cautionner leur invasion de la Colombie et de s’opposer à la hausse du prix du pétrole. Par mesure de rétorsion, les USA ont coupé toute liaison entre le satellite qu’ils contrôlent et le Mexique, de sorte que celui-ci se trouve privé e toute forme de communication, obligeant les protagonistes du roman de Fuentes à s’exprimer par lettres. Et tout de suite ça vole très haut, c’est très allant, très dense et captivant. La grande silhouette de Machiavel ne tarde à se profiler à l’horizon, d’emblée les intrications de la passion du pouvoir et des menées humaines, sentimentales ou sexuelles, nourrissent ces vifs échanges, et ça y va. La distribution aligne donc Maria del Rosario Galvan, qui dit entre autres que le ressentiment est le vice national du Mexique et l’injustice l’écriture sacrée des terres latino-américaine, le jeune Nicolas Valdivia en lequel on pressent un Julien Sorel à dégaine de métis aussi séduisant de corps que d’esprit, Xavier Zaragoza dit Sénèque le conseiller du Président dont il flatte le «moi moral» tandis que son contraire, Tacito de la Canal, figure l’âme noire et servile de ces coulisses. Bref ça a l’air parti pour un beau grand roman de conjecture politique, dont les personnages sont immédiatement campés avec vigueur. On passera volontiers trois jours en leur compagnie, au lieu d’embêter la mère de Weyergans…
On est très vite entraîné dans le vif du dernier roman de Carlos Fuentes, par l’entremise d’une femme de tête, la cinquantaine et dans la haute politique mexicaine, qui drague épistolairement un fringant trentenaire qu’elle vient de rencontrer et qu’elle se propose d’aider à se mettre en selle avant de lui ouvrir son bunker privé. Cela se passe en 2020, alors que le président mexicain vient de damer le pion aux Américains en refusant de cautionner leur invasion de la Colombie et de s’opposer à la hausse du prix du pétrole. Par mesure de rétorsion, les USA ont coupé toute liaison entre le satellite qu’ils contrôlent et le Mexique, de sorte que celui-ci se trouve privé e toute forme de communication, obligeant les protagonistes du roman de Fuentes à s’exprimer par lettres. Et tout de suite ça vole très haut, c’est très allant, très dense et captivant. La grande silhouette de Machiavel ne tarde à se profiler à l’horizon, d’emblée les intrications de la passion du pouvoir et des menées humaines, sentimentales ou sexuelles, nourrissent ces vifs échanges, et ça y va. La distribution aligne donc Maria del Rosario Galvan, qui dit entre autres que le ressentiment est le vice national du Mexique et l’injustice l’écriture sacrée des terres latino-américaine, le jeune Nicolas Valdivia en lequel on pressent un Julien Sorel à dégaine de métis aussi séduisant de corps que d’esprit, Xavier Zaragoza dit Sénèque le conseiller du Président dont il flatte le «moi moral» tandis que son contraire, Tacito de la Canal, figure l’âme noire et servile de ces coulisses. Bref ça a l’air parti pour un beau grand roman de conjecture politique, dont les personnages sont immédiatement campés avec vigueur. On passera volontiers trois jours en leur compagnie, au lieu d’embêter la mère de Weyergans…
Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque le Pouvoir rebaptisa sa ville natale de Nijni-Novgorod de son nom, en pensant à son ami Tchekhov. Ainsi le jeune homme avait-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Pouvoir. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchekhov.
J’avais repris depuis quelques jours la lecture de Gorki, dont vient de paraître le premier volume des Oeuvres en Pléiade. Je m’étais rappelé ma lecture, une nuit à Sorrente, de la correspondance du jeune Gorki et de Tchekhov, où celui-là dit à peu près ceci au cher docteur: tout ce qui se fait aujourd’hui en Russie semble un raclement de bûches sur du papier de sac de patates à côté de ce que vous écrivez vous de tellement sensible et délicat. Je pestais contre mes putains de chaînes que mes mains glacées ne parvenaient pas à désentortiller dans la nuit plus russe que russe, et je pensais à Tchekhov, mon âme chantonnait tandis que le chien Fellow se tirait des lignes de neige en twistant comme un fol autour de moi, le rat. Et j’imaginais le docteur partant seul dans la nuit sur son traîneau, à l’appel d’un malade à dix verstes de là, et flûte pour ces putains de chaîne, me suis-je alors dit, je rentre à l’isba, à peine trois verstes, ça me donnera le temps de penser à Tchekhov, et voilà que me revenait cette phrase d’Anton Pavlovitch au jeune Gorki: « «On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part»…
On mesure mieux, à la lecture du Siège de l’aigle de Carlos Fuentes, le grand vide du roman français actuel, à quelques exceptions près. En tout cas je ne vois pas, pour ma part, un seul titre de ces dernières décennies qui puisse rivaliser avec cette magnifique intelligence de la politique et des grands fauves qui se disputent le pouvoir, cette pénétration de la psychologie humaine et ce grand art de pur romancier qui fait apparaître, l’un après l’autre, et comme en ronde-bosse, par le seul truchement de lettres qui s’entrecroisent, ces formidables personnages gravitant, en 2020, trois avant l’élection de son successeur, autour du Président mexicain qui vient de sortit de son aboulie pour tenir tête aux Américains après leur invasion de la Colombie.
Je n’ai jamais mis les pieds au Mexique mais après 220 pages de ce roman, qui n’est en rien «documentaire» au demeurant, j’ai l’impression d’avoir déjà vécu dans ce pays, alors même que tout ce qui se rapporte à son économie, à ses intrigues politiques, à ses problèmes sociaux (paysans, étudiants, crime organisé, etc.) me renvoie à la politique et à l’économie de nos pays, alors que les personnages qui s’y dessinent renvoient à un théâtre de tous les temps, de Plutarque à Macbeth.
Qui a fait, en Europe, en France, en Allemagne, en Italie, un roman aussi clair et limpide de forme, sur une matière aussi trouble et complexe, et qui sonne si vrai et qui nous en apprenne tant? Car c’est cela même: comme dans Les illusions perdues de Balzac ou dans la Trilogie américaine de Philip Roth, on apprend une quantité de choses dans Le siège de l’aigle, tout en observant cette étonnante empoignade de formidables prédateurs qui ne sont jamais des caricatures (on se rappelle le pauvre Automne du patriarche de Garcia Marquez) et que le jeu du roman épistolaire permet de traquer dans leur intimité masquée ou leur obscène fausse franchise. Quel savoir et quel culot de voyou (un vrai romancier doit être un voyou), quelle malice et quelle vieille tendresse (le vrai romancier donne raison à tous ses personnages), enfin et surtout: comme on se sent bien là-dedans. Voilà ce qu’on voudrait lire aussi en Europe. La semaine passée, j’ai relu des pages d’Henri le vert de Gottfried Keller, et je me disais: voilà ce qu’on voudrait lire aujourd’hui. Or le plus amusant est que Fuentes, avec un clin d’œil, parle du obel de littérature attribué en 2020 l’écrivain Cesar Aira. Et voilà la générosité des grands: du coup je me suis rappelé que je voulais lire Varamo, et je suis allé le repêcher dans la pile des «à lire absolument»… du coup j’y ai passé l’après-midi, avant de redescendre en plaine et d’acheter La princesse Printemps. Quel plus beau titre un soir de neige à vous enchaîner dans la brouillasse?
 Tarnation est un collage qui déroute d’abord par sa vitesse et ses ellipses, après quoi l’histoire se met en place qui a quelque chose d’un roman-photo américain des années 50, où tout de suite apparaît la mère du cinéaste dont il est question dès les premières séquences, avec l’annonce d’une overdose de lithium. Et c’est part pour unlife-movie renée a été reine de beauté au texas. En 1952 elle a rencontré un représentant de commerce, le beau Steve. Lovestory. Sauf que Steve fout le camp tôt et que Renée déjante au point que le gosse se trouve casé, chez des gens qui l’abusent bientôt. Jonathan placé, René va dans une prison, et les images video commencent de redéfiler.
Tarnation est un collage qui déroute d’abord par sa vitesse et ses ellipses, après quoi l’histoire se met en place qui a quelque chose d’un roman-photo américain des années 50, où tout de suite apparaît la mère du cinéaste dont il est question dès les premières séquences, avec l’annonce d’une overdose de lithium. Et c’est part pour unlife-movie renée a été reine de beauté au texas. En 1952 elle a rencontré un représentant de commerce, le beau Steve. Lovestory. Sauf que Steve fout le camp tôt et que Renée déjante au point que le gosse se trouve casé, chez des gens qui l’abusent bientôt. Jonathan placé, René va dans une prison, et les images video commencent de redéfiler.
Car c’est de ça qu’est fait ce film recomposé: de toutes les images que Jonathan Caouette a collectées et, dès sa quatorzième année, filmées ou fait filmer lui-même.
Ce film est à mes yeux la négation de l’art. C’est une sorte de déchet existentiel et pourtant il me touche, comme m’a touché l’autre jour ce billet d’une collégienne insultant son prof, d’une écriture de sang et de rage. Et voir le petit Jonathan de 15 ans en travelo, devant sa camera, jouant un rôle et pleurant de désespoir, me poigne aussi bien, mais que faire avec ça?
Où est la limite du fait divers et de la tautologie? Toutes nos scènes de ménage et de manège ne sont-elles pas «à filmer»? Et tout ne va-t-il pas s’esthétiser de cette façon en patchworks «cultes»?
«C’est pas mon genre les grossièretés» dit ce garçon qui se regarde et dit son amour pour sa mère, qu’on traite aux électrochocs. Je pense aux lettres d’Antonin Artaud et je vois ce pauvre gosse sans mots qui évoque le viol du vieux salaud auquel il a été confié, lequel apparaît bientôt à l’écran et lui ordonne de virer sa caméra…
Vertige de cette horreur: et beauté tout de même à la longue, comme renouant avec une immense tendresse perdue et un pardon, où les images deviennent bel et bien récit…
C’est l’histoire d’amour d’un fils et de sa mère, que tout a séparés et qui se retrouvent comme deux enfants perdus. De ces images absolument idiotes que sont celles qu’on prend en vidéo se dégage une espèce de poème. Cela fait un peu nouvelle de Carver racontée par à-coups sur un répondeur téléphonique ou envoyées par images segmentées. Pourtant une histoire se raconte là-dedans où se colmate un immense vide et s’esquisse une mélodie belle…
Il y a des jours avec et, des jours sans, et c’est qu’il faut plutôt faire avec, au lieu de se cabrer ou de se fâcher avec soi, en tâchant de ruser, pour mieux déjouer la prétention de tout maîtriser ou la tentation de lâcher toute prise.
Je prends ces notes chaque jour, mais comment ne pas comprendre qu’elles ne sont que d’infimes traces de chaque journée, dont seul compte peut-être le mouvement d’en retenir ces bribes ?
J’étais curieux de lire l’essai qu’annonçaient les éditions Zoé, sous la signature de Nicolas Bouvier: Charles-Albert Cingria en roue libre, qui me semblait virtuellement intéressant.
 Et je ne croyais pas si bien penser, car ce Cingria par Bouvier est en effet un ouvrage virtuel. L’essentiel du livre est en effet consacré, par la professeure Doris Jakubec, à ce que qu’aurait pu être un livre de Nicolas Bouvier. Les textes de Bouvier sur Cingria rassemblés dans là-dedans, sous non seul nom en page de couverture, se réduisent en effet à une cinquantaine de pages déjà connues, notamment par une conférence qu’il avait donnée à Lausanne (je le sais puisque c’est moi qui l’y avais invité), à quoi s’ajoutent quelques feuillets épars, à peine des esquisses, que Doris Jakubec commente en même temps qu’elle présente, très bien d’ailleurs, l’œuvre de notre cher Cingria.
Et je ne croyais pas si bien penser, car ce Cingria par Bouvier est en effet un ouvrage virtuel. L’essentiel du livre est en effet consacré, par la professeure Doris Jakubec, à ce que qu’aurait pu être un livre de Nicolas Bouvier. Les textes de Bouvier sur Cingria rassemblés dans là-dedans, sous non seul nom en page de couverture, se réduisent en effet à une cinquantaine de pages déjà connues, notamment par une conférence qu’il avait donnée à Lausanne (je le sais puisque c’est moi qui l’y avais invité), à quoi s’ajoutent quelques feuillets épars, à peine des esquisses, que Doris Jakubec commente en même temps qu’elle présente, très bien d’ailleurs, l’œuvre de notre cher Cingria.
Lors de sa conférence à Lausanne, Nicolas Bouvier nous sortit une énormité qui prouvait sa connaissance lacunaire du sujet, en regrettant tout haut que Cingria et Cendrars ne se fussent jamais rencontrés. Et de comparer ce qu’eût pu être une telle amitié avec celle qui avait lié Henry Miller et Lawrence Durrell. Pierre-Olivier Walzer, grand manigancier des Oeuvres complètes de Charles-Albert, qui fut son ami et son éditeur, son soutien et son saint disciple, fit alors remarquer ce que nous savions tous: savoir que Cingria et Cendrars s’étaient bel et bien rencontrés, et tellement aimés qu’ils se fuyaient et multipliaient les entre-piques.
C’est un peu chipoter, mais je vais insister, après m’être tu gentiment ce soir-là, à propos d’une anecdote que rapportait Bouvier en causerie, et qui se trouve cette fois écrite en page 28 et 29, concernant une prétendue rencontre de Nicolas Bouvier et Charles-Albert Cingria, qui relève de la pure affabulation à la Cendrars…
Quelque temps avant son escale à Lausanne, j’avais rencontré à Genève Bouvier qui me certifia n’avoir jamais rencontré Cingria, chose en effet plus que probable puisque celui-ci rejoignit les anges musiciens en août 1954, à cette époque même où Bouvier voyageait en Topolino dans les pays moites. Je lui racontai cependant, entre autres anecdotes, une histoire absolument tordante que le docteur Emile Moeri, cardiologue de mes amis qui s’occupa régulièrement de la santé de Charles-Albert lors de ses passages en Suisse romande, m’avait racontée pour l’avoir vécue à Paris.
Le jeune Moeri Senior (père d’Antonin), emmené par Cingria dans une exposition chic, y fut prié par l’inénarrable bicycliste de lui tenir les deux poches de ses knickerbockers bien ouvertes pendant que celui-ci y enfournait quelques canapés aux anchois bien gras pour la route… Or le cher Emile n’en finissait pas de rire à l’évocation des taches de graisse qui étaient apparues sur les pantalons golf de Cingria. Et Bouvier aussi rit beaucoup lorsque je lui rapportai l’anecdote.
Ce qu’il en fait dans Ecrire sur Cingria, en s’attribuant le rôle du jeune officiant, est si joli que j’ai bien un peu hésité à rétablir «la vérité». Bouvier ne fait pas autre chose en somme, ici, que du Cendrars ou même du Cingria, étant entendu que celui-ci ne s’est pas gêné en matière de mentir vrai.
Bouvier croit rendre hommage à Cingria en se donnant le rôle de lui ouvrir les poches, lui qui n’était alors qu’un tout jeune homme qui n’avait, précise-t-il, «pas lu une ligne de lui». Il fait cependant une erreur de taille en prétendant qu’il n’a empli qu’une poche ce soir-là, la droite, en y déversant un «plateau» entier de «croissants au jambon». Le souci de vérité historique m’oblige cependant à rectifier, puisque c’était de canapés aux anchois bien gras qu’il s’agissait en l’occurrence, déversés symétriquement dans les deux poches de Charles-Albert, et non de croissants au jambon genevois…
On ne sait trop où fuit le protagoniste de Fuir, le dernier roman de Jean-Philippe Toussaint, mais il y fuit et on le suit, un peu comme on jouerait à suivre n’importe qui dans la foule de la rue, à ceci près que e quidam fuit jusqu’en Chine, ce qui n’est guère plus remarquable pour lui que s’il fuyait en Belgique. L’important n’est évidemment pas dans ce qu’il découvre en Chine (à savoir rien) où il ne sait pas ce qu’il cherche ni non plus ce qu’il fuit, ayant constaté que ceux qu’il croyait le menacer ne le menacent pas vraiment, qu’il se fait des idées et que tant qu’à fuir il le pourrait aussi bien à l’île d’Elbe où le ramène bientôt une téléphone de Marie, l’amie qui l’a envoyé en Chine pour affaires chic et qui perd ensuite son père, comme cela arrive dans la vie.
Ce qui compte n’est pas le but mais le chemin, disait un sage plein de sagesse, et c’est ce qu’on se dit en fuyant dans la foulée de son élastique personnage qui bondit et rebondit de page en page et de lieu en lieu et en faisant pom-pom comme une balle de tennis sur un court élégant. Dans la foulée on copule dans une chiotte de train chinois, ce qui peut faire sourire si l’on considère l’immensité disponible en Chine pour s’adonner à la chose, mais ce n’est qu’une péripétie de cette fuite où tout se fait comme ça, pour rien peut-être, et peut-être n’est-ce rien? Presque aussi rien, n’était le Médicis, que de passer trois jours chez la mère du Goncourt…
Du brave soldat Schweijk à l’indolent Oblomov, en passant par le protagoniste de Je ne joue plus de Miroslav Krleza, la figure de celui qui dit non au jeu social, aussi doucement que fermement, a trouvé de belles illustrations, mais la plus émouvante reste sans doute celle du jeune scribe Bartleby, dans la nouvelle éponyme de Melville, employé de bureau à Wall Street et limitant progressivement son activité en opposant, aux multiples ordres et propositions de son patron, un doux et têtu «je préférerais pas…», traduction plus ou moins satisfaisante de «I would prefer not to…»
Toute forme d’ésotérisme m’est foncièrement étrangère. Je conçois fort bien les tenants et les aboutissants d’un savoir caché, réservé à quelques élus, mais je ne saurais y participer sans trahir mon bon naturel. Il est assez de mystère, dans l’Univers, qui me suffit sans qu’on y rajoute du pseudo-mystère. Par ailleurs, les sectateurs du genre suffiraient à m’en détourner.
Tout ce que je fais relève en somme de la mise en ordre, ou plus exactement: de la mise au clair. C’est cela: je tire les choses au net.
Je lis ceci: «Pluie de printemps/toute chose en devient/plus belle.» Des mots calligraphiés par Chyo-ni, une noble Japonaise du XVIIIe siècle. Puis je lis cela.» Un matin glacé/sur mon vélo/j’admire les champs». Les mots de Catherine Sancet, de la classe 6e B du collège Gérard-Philipe de Carquefou. Je viens de me lever dans la nuit glaciale et je lis Le soleil de l’après-midi de Constantin Cavafy. C’est l’histoire du type qui se rappelle la chambre dans laquelle il a aimé quelqu’un «tant de fois». C’est d’une banalité crasse et pourtant, en lisant ce qui suit, tout à coup je me sens plus réel:
«Sont-ils encore quelque part, ces pauvres meubles?/A côté de la fenêtre était le lit./Le soleil de l’après-midi arrivait à la moitié. Un après-midi, à quatre heures, nous nous sommes séparés,/Rien que pour une semaine… Hélas,/Cette semaine-là devait durer toujours».
Ah mais, il fait un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant: «Je ne suis rien./Je ne serai jamais rien./Je ne peux vouloir être rien./A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde./Fenêtres de ma chambre,/Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont/Personne ne sait qui il est/(Et si on le savait, que saurait-on?),/Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,/Une rue inaccessible à toutes pensées,/Réelle au-delà du possible, certaine au-delé du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres, Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,/Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.»
Cela s’intitule Bureau de tabac et c’est évidemment signé Fernando Pessoa, puis je lis ceci en me rappelant l’odeur de tout à l’heure de quelqu’un que j’aime et qui dort encore, sous la plume d’Anna Akhmatova: «Les jours les plus sombres de l’année/Doivent s’éclairer/Je ne trouve pas de mots pour dire/La douceur de tes lèvres».
C’est cela même: on ne trouve pas les mots du plus réel, mais la poésie est peut-être un peu de ça: plus de réel en peu de mots…
 C’est pendant les pubs de la Star’Ac que j’ai commencé de lire Lunar Park, hier soir, avec un retard qui doit venir des quelques papiers dédaigneux que j’avais lu à gauche et à droite, disant à peu près: pas terrible, déballage narcissique, ragots de pipole, ces choses-là. Ce qui m’étonnait un peu, de la part de Bret Easton Ellis, et d’ailleurs André Clavel m’avait plutôt mis l’eau à la bouche, André Clavel qui est un vrai lecteur. Mais les choses qui doivent se faire se font, et lire Lunar Park pendant les pubs de la Star? Ac est une bonne façon de cumuler les plaisirs du prime, n’est-il pas?
C’est pendant les pubs de la Star’Ac que j’ai commencé de lire Lunar Park, hier soir, avec un retard qui doit venir des quelques papiers dédaigneux que j’avais lu à gauche et à droite, disant à peu près: pas terrible, déballage narcissique, ragots de pipole, ces choses-là. Ce qui m’étonnait un peu, de la part de Bret Easton Ellis, et d’ailleurs André Clavel m’avait plutôt mis l’eau à la bouche, André Clavel qui est un vrai lecteur. Mais les choses qui doivent se faire se font, et lire Lunar Park pendant les pubs de la Star? Ac est une bonne façon de cumuler les plaisirs du prime, n’est-il pas?
Ce qui est sûr, c’est que les 50 premières pages de Lunar Park, qui m’ont bientôt scotché par-delà les pubs, tout en reluquant de loin tel duo d’adorables baleines (Magalie et Liza Minelli) ou tel combat de jeunes coqs (Jérémie et Pascal au coude-à-coude assassin), c’est qu’il faut être bien distrait (ce que sont hélas beaucoup de mes consoeurs et frères) pour ne pas saisir vite la haute malice et la vigueur panique de cette fausse autobiographie jouant avec tous les standards médiatiques du monde actuel pour les «retourner» en quelque sorte.
Bret Easton Ellis raconte en somme comment il est devenu un personnage de Bret Easton Ellis en devenant le romancier multimillionnaire auteur des livres de Bret Easton Ellis, de la même façon que son père, qu’il dit haïr pour de bonnes raisons (on en découvre les premières traces dans Zombies), lui a inspiré le personnage de Pat Bateman d’ American Psycho.
On sait que Pat Bateman est un yuppie psychopathe, voisin de Tom Cruise dans son appart de Manhattan, qui ramène des meufs chez lui pour les tringler avant de les tronçonner. Ces mauvaises manières ont fait dire, par les Ligues féministes américaines, que Bret Easton Ellis était forcément misogyne pour imaginer de tels «comportements inappropriés». Ce que ces dames, et beaucoup de critiques distingués avec elles, n’ont pas vu, c’est que Patrick Bateman ne tuait qu’en imagination. Cela change-t-il quoi que ce soit? Si fait: cela distinguait ce roman de l’hystérie apathique aux coups de sonde dostoïevskiens (Norman Mailer l’a écrit lui aussi) d’un snuff polar banal jouant sur le goût de la violence et du sexe gore. Ce qu’on n’a pas assez compris, depuis Less than zero, c’est que Bret Easton Ellis est le médium d’une certaine réalité américaine, qu’il vit et traduit avec une porosité rare et une intelligence instinctive de pur romancier bien faite pour déstabiliser pas mal de nos confères et soeurs et les pitbullettes des Ligues de vertu.
Le combat faisait rage entre Jérémie et Pascal (en duo de vrais mecs hormonés se coulant des regards je t’aime-je-te-tue à n’en plus pouvoir) quand je suis arrivé à l’évocation, dans Lunar Park, après la «descente aux enfers de la drogue» du romancier et la «main tendue» de Jayne, mère de son fils Robby (lui prétendait que c’était plutôt le fils de Keanu Reeves qui fréquentait Jayne à la même époque, mais le test a prouvé le contraire) vers laquelle il revint du «bout de la nuit», des lendemains du 11 septembre (ils se sont mariés cette année-là) où l’on a commencé de voir, dans toutes les villes d’Amérique, des attentats à tous les coins de rue, et les cadavres innocents s’amonceler jusqu’à la hauteur des derricks, et la peur de tout et l’horreur absolue: «Jayne voulait élever des enfants doués, disciplinés, poussés vers le succès, mais elle redoutait à peu près tout: la menace des pédophiles, des bactéries, des 4 x 4 (nous en avions un), des armes à feu, de la pornographie et du rap, du sucre raffiné, du rayonnement ultraviolet, des terroristes, de nous-mêmes»…
 L’humour embusqué de Bret Easton Ellis n’est pas très éloigné de celui de Michel Houellebecq, en plus fou, et sa fantaisie de fictionnaire mimant les délires contemporains est bien plus riche d’observations virtuelles et actuelles que ne le disent ses détracteurs distraits, comme il en va d’un Maurice Dantec.
L’humour embusqué de Bret Easton Ellis n’est pas très éloigné de celui de Michel Houellebecq, en plus fou, et sa fantaisie de fictionnaire mimant les délires contemporains est bien plus riche d’observations virtuelles et actuelles que ne le disent ses détracteurs distraits, comme il en va d’un Maurice Dantec.
Madame Public a finalement préféré les langueurs mâles de Jérémie aux frémissements de fauve blessé de Pascal. Le dinar a de nouveau pissé un max à la Star Ac et tout est bien. Comme le dit et le répète Nikos: c’est en allant jusqu’au bout de son truc qu’on se dépasse à tous les niveaux du machin, alors voilà…
Le rapport liant le Bret Easton Ellis qui écrit Lunar Park et le Bret du livre qui raconte sa vie de romancier célébrissime et plein aux as tâchant de s’arracher à la drogue, me rappelle curieusement celui qu’entretient Marcel Proust avec le Narrateur de la Recherche. Je sais bien que le rapprochement peut sembler «limite», mais l’idée m’en est venue hier soir en lisant la suite de Lunar Park, qui joue du dire-plus de la fiction en faisant de cette chronique autobiographique un roman brassant le même type d’observations que Moins que zéro, Les lois de l’attraction ou Zombies, avec ce même regard sur ce qu’on pourrait dire les enfants perdus de nos sociétés nanties et avachies, et cette même musique de détresse, qui expliquent sans doute l’extraordinaire retentissement de ces livres.
Des pages 50 à 109, le narrateur de Lunar Park raconte essentiellement comment il replonge dans la dope (sans le reconnaître, avec toute la mauvaise foi connue de l’accro), et comment se distendent les liens l’attachant à Jayne (qui le surveille fébrilement), à Robby (qui le fusille du regard), à la petite Sarah dont l’oiseau de peluche n’est pas content non plus, ou au chien qui le juge grave lui aussi. Une fête démente de Halloween, où affluent les amis de l’écrivain, les voisins, les parents des mômes du quartier et les étudiants shootés du campus où Bret donne un atelier d’écriture, est l’occasion de détailler tout ce petit monde oscillant, comme toute l’Amérique, entre conformisme extrême et défonce, suavité et violence, infantilisme des adultes et sombre regard des enfants.
Or ce qu’il y a là de plus intéressant qu’une peinture de mœurs, c’est qu’un roman couve, avec quelque chose d’aussi inquiétant que ce qu’on sent bouillir à la surface du cratère où est tombée la première machine infernale tombée du ciel, dans La guerre des mondes que justement je regardais d’un oeil en lisant Lunar Park, dans sa version initiale de Byron Haskin, si délicieusement années 50. Dans la foulée, j’ai d’alleurs été saisi par l’incroyable ressemblance entre le reporter se précipitant vers la faille avec son micro et le Bret Easton Ellis des années 80: même profil net et même grand front à même mèche ondulée, même cravate et même œil à vrille, bref le parfait youngster américain.
Enfin, le rapprochement entre Bret et Marcel trouve un autre motif à la page 108 de Lunar Park, lorsque le narrateur léchote le brillant des lèvres de son élève Aimee Light, auquel il trouve un parfum qui le «ramène très loin». Et de préciser: «C’est comme ces petites mandarines chez Proust». Du coup, bon élève, Aimee corrige: «Vous voulez dire madeleines». Alors lui d’insister: «Ouais, comme ces petites mandarines».
Et c’est exactement cela, le roman: c’est cette façon de réinventer la réalité, plus vraie que vraie, qui fait que les madeleines d’hier sont les mandarines d’aujourd’hui…
 Quel corniaud crevant de faim pourrait-il bien avaler les rogatons que Philippe Djian a recueillis dans son Doggy Bag? Ce qui est sûr, c’est que mon camarade Fellow les a rejetés rien qu’à me voir les détailler, d’un bout à l’autre de la pièce, fronçant en outre ses sourcils à la François-Joseph lorsqu’il m’a entendu lui citer à haute voix cette phrase d’anthologie: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait peiné à la tracter sur du plat»…
Quel corniaud crevant de faim pourrait-il bien avaler les rogatons que Philippe Djian a recueillis dans son Doggy Bag? Ce qui est sûr, c’est que mon camarade Fellow les a rejetés rien qu’à me voir les détailler, d’un bout à l’autre de la pièce, fronçant en outre ses sourcils à la François-Joseph lorsqu’il m’a entendu lui citer à haute voix cette phrase d’anthologie: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait peiné à la tracter sur du plat»…
C’était pourtant un titre assez épatant que Doggy bag et je m’en léchais autant les babines que le chien Fellow, mais au fur et à mesure que j’avalais ces morceaux de feuilleton, les signes de l’indigestion et, bientôt, les spasmes annonciateurs d’un probable dégobillage se manifestèrent au point que, sur cette phrase de la page 127: «L’ambiance était mortelle, si lourde qu’un attelage de bœufs aurait pené à la tracter sur du plat», je résolus de donner le reste au renard…
Tout n’est pas pour autant à jeter du contenu de ce Doggy bag, dont certaines scènes, certains personnages et certaines ambiances (quand les bœufs ne s’en mêlent pas) se rattachent bel et bien à l’univers du romancier si remarquable de Sotos, Criminels, Sainte-Bob, Frictions ou Impuretés.
Ce qui cloche, avec Doggy bag, tient probablement au projet de fabriquer une «série» à partir de deux personnages (deux frères rivaux qui possèdent un garage et voient revenir la femme qu’ils ont partagée après vingt ans d’absence) qui ne sont pas «creusés» comme dans les romans ordinaires mais lancés dans une suite de séquences filées à la diable et dialoguées à la va-vite. En ce qui me concerne en tout cas, je n’y ai pas cru, la terrible scène durant laquelle l’un des couples baise pendant que l’enfant de la femme se noie à deux pas de là fait à peine figure de péripétie, tout ça glisse et patine en surface, bref on se demande si cette Saison I a vraiment besoin des deuxième et troisième saisons annoncées…
Nous sommes là dans le chaos de nos vies, et tout à coup il y a un moment de grâce, une île possible, une beauté qui nous sort de la platitude des jours et de la fuite du temps, et hier soir, chez la Comédienne, ç’a été sa fille Anna, notre filleule à l’Amie de la Comédienne (elle aussi actrice de théâtre, l’une des meilleures que je connaisse avec la Comédienne) et à moi, quand elle s’est assise, petite, avec sa guitare, et a commencé à nous jouer son Menuet d’un Anonyme.
On peut me dire tout ce qu’on veut de la décadence des temps qui courent, de l’enseignement qui fout le camp et de la perte du Sens du Sacré chez les enfants de cette drôle d’époque: je n’en ai rien à souder, parce que c’est faux.
Un Menuet d’un Anonyme joué par Anna, dix ans, avec un sourire de petit bodhisattva, au milieu d’un appart genre bohème artiste mais pas bordélique pour autant, après un repas de saveurs et une discussion enflammée d’abord (sur la pièce jouée ces jours par Denis Lavant, le pote de la Comédienne, où il est question de William Burroughs s’embarquant sur le radeau du Vieux Marin de Coleridge, à quoi la Comédienne n’a pas croché du tout) et ensuite super amicale, ponctuée d’irrésistible imitations d’animaux par l’Amie de la comédienne – tout ça et la beauté des choses et des gens refaisait surface dans notre chaos, comme elle refait surface à certains moments bouleversants de Lunar Park de Bret Easton Elis, quand les personnages naufragés qu’il y a dans ce livre se retrouvent sur un coin de radeau pour se dévisager avec tout ce qui leur reste de bribes d’amour.
Lorsque Bret et Jayne s’affrontent et se retrouvent durant leur thérapie de couple – chef d’œuvre de psychologie dialoguée, soit dit en passant -, ou quand Bret croit enfin rejoindre son fils Robby avant le déchaînement des forces ténébreuses, il y a aussi de ces îles apparemment préservée de tout le linge sale du monde, où ce que nous avons de pur et de bon trouve à s’exprimer.
A l’instant je le revis: Anna détaille chaque note avec gravité dans la nuit d’hiver. Dehors un renard file le long des voitures. Les mères qui m’entourent ont la même dégaine de babouchkas boucanées et bonnes. Le frère d’Anna, grand beau long garçon aux yeux et aux cheveux de berger afghan, nous a quittés quelque temps pour un casting, après quoi le revoici goûter au dessert de la Comédienne, genre crème à la turque, mélange de blanc battu et d’œufs en neige et d’eau-de-vie d’Arak. Un instant tout n’est plus qu’âme, ou disons qu’on se coule dans le corps du monde qui est un moule de beauté…
 La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
La sensation-vertige d’ubiquité qui caractérise l’homme actuel dans sa relation au monde se perçoit à la fois psychiquement et physiquement (par ce qu’on pourrait dire la physique du processus de lecture) dès les premières pages de ce maëlstrom de notations que constituent les Oasis de transit d’ Yves Rosset, monstrueux journal de bord recomposé d’un voyage autour du monde sillonnant et quadrillant l’espace autant que les strates du temps.
Yves Rosset a voyagé librement une année durant, multipliant les allers-retors entre Berlin où il survit d’expédients (notamment barman de nuit) avec sa petite famille et le Japon, Israël et les States, entre autres points de chute d’un réseau tissant sa maille recoupée par le filet de ses mails amicaux round the world…
Dès les premières pages japonaises de ce livre profus et bigarré, rappelant Cendrars le curieux de tout et le mange-mots plus que Bouvier l’esthète cultivé, j’ai été saisi par la justesse du titubement initial du voyageur occidental au Japon illico confronté à ce qu’il dit ici une «fascination particulaire» détaillée en ces termes dès son arrivée à Tokyo: «Je regardais vers le nord, vers l’ouest, en direction de Shinju-ku, de Toshima-ku. Il pleuvait fort, grisaillait, mais le brouillard n’empêchait pas de voir que la vile ne cessait pas jusqu’à l’horizon. Infinies détrouvailles, approfondissements, différenciations, murmures des mercures humeuses, foulances errées. Deux jours auparavant, en revenant de la plage de Kamakura pour rejoindre la gare, nous étions remontés à contre-courant le flot d’une sorte de rush-humanity extraordinairement clame et disciplinée qui, déversée par la mégapole que forment Kawasaki, Yokohama et Yokosuka, se rendait au bord de l’eau pour assister au hanabi, le feu d’artifice de l’été. Chaque visage intriguait comme une nouvelle étoile, chaque corps vibrait d’une tenson interne au sein du cosmos, chaque rire éclatait comme l’écho d’une manière de big-bang en expansion assourdissante».