
On entre dans Cosmos incorporated comme dans un cauchemar éveillé avec la sensation de participer psychiquement et physiquement à la genèse d’un espace-temps et d’un personnage se construisant à vue. D’emblée on ressent la même oppression que dans les premières pages de 1984, à cela près que la surveillance n’est pas ici que du Dehors bigbrotherisé mais de partout, puisqu’on vous scanne jusqu’à l’ADN et qu’on vous manipule du Dedans par contrôle d’information.
Le cauchemar a des dehors fascinants de film psychique hyperplastique, dont le début est une genèse en raccourci, lumière rouge et matière blanche, œil émergeant de la soupe originelle avec un iris scellant l’identité de l’Adam apparu dans le portique de contrôle, plus exactement prénommé Sergueï Diego Dimitrievitch, Plotkine de son nom, né en 2001 en Sibérie et en principe âgé de 56 ans mais en réalité deux fois plus jeune à la suite de deux cures de rajeunissement transgéniques. Tout cela qu’il apprend en même temps que le lecteur, et c’est la première belle idée du livre: que le premier personnage émerge du chaos (des «années noires» qui ont fait 500 millions de morts en quatre décennies) sans avoir connu jusque-là que la guerre et se découvrant pourtant des souvenirs d’enfance en Sibérie et ailleurs (il aurait donc vécu en Argentine?) avant de se rappeler sa première mission.
Avec la première esquisse du personnage commence de se brosser une fresque spatio-temporelle assez saisissante, à la fois très maîtrisée dans les grandes largeurs et passionnante par les multiples observations qui la nourrissent. On est là dans une espèce de monde-fourmilière-cerveau où les hommes sont en train de se transformer en machines, à un point de l’Histoire où l’involution se concrétise à la fois par ce déficit de l’élément humain et par la dégringolade de la démographie, entre autres composantes du désastre généralisé, dont le «retournement» du progrès lui-même.
Je n’en suis à l’instant qu’à la page 67, mais cela me semble très bien parti, très dense et dégageant une espèce de sombre beauté…
°°°
 Il est cinq heures du matin en ce fuseau de l’Hémisphère nord et noir est l’encrier du monde dans lequel se prépare la chronique du profond Aujourd’hui. Tout à l’heure je secouerai Winnie qui va se pointer en grommelant et prononcera au premier rai de jour la phrase rituelle: «Encore une journée divine». En attendant je me rappelle les visions de catastrophe de ce livre que je lisais hier et que je vais continuer de lire tout à l’heure en me disant: foutaises, mais penser à cela tout le temps.
Il est cinq heures du matin en ce fuseau de l’Hémisphère nord et noir est l’encrier du monde dans lequel se prépare la chronique du profond Aujourd’hui. Tout à l’heure je secouerai Winnie qui va se pointer en grommelant et prononcera au premier rai de jour la phrase rituelle: «Encore une journée divine». En attendant je me rappelle les visions de catastrophe de ce livre que je lisais hier et que je vais continuer de lire tout à l’heure en me disant: foutaises, mais penser à cela tout le temps.
°°°
Il a fallu que je me sente les mains d’une mère, une aube pareille de l’automne 1982, il a fallu que je me prenne pour Gaïa accouchant d’une mortelle pour que, mec sans imagination jusque-là, je découvre la beauté de la vie et notre sort de mort à tous. Je savais certes déjà la beauté de la vie mais je n’avais pas eu la révélation de la mort en dépit de tous les morts que j’avais de mes yeux vus, et soudain un enfant m’avait enfanté en seconde naissance, et voilà que je découvrais ce lieu commun de toute éternité que nous sommes mortels et que c’est tout les jours, peut-être tout à l’heure et voici la divine journée.
°°°
Moi l’un me dit que nous allons vers la catastrophe, cependant que Moi l’autre sourit au jour qui vient. Moi l’un qui reste une espèce d’adolescent teigneux, genre Christ beatnik, voit l’Ange exterminateur se démantibuler au-dessus des pylônes en flammes, tandis que Moi l’autre, enfant et vieux sage à la fois, lui rétorque qu’il se fait du cinéma. Moi l’un le fils est en colère, comme tous les matins du monde les fils, tandis que Moi l’autre, le père du monde qui en a vu d’autres, s’apprête à entonner le Psaume du 23 septembre 2005 qui commencera par un solide café et des biscuits pour la route au chien Filou.
Au programme de mes lectures ce sera Dantec et Shakespeare ou Proust par manière de contrepoison. Ce sera l’humour de la vie contre les visions hallucinées, ce sera la prairie d’à côté à faucher contre l’idée que la prairie sera vitrifiée l’an prochain, ce sera le regard doux du chien Filou et la tendre chair de Winnie contre les vitupérations du prophète. Oh le beau jour qui vient sur la mule du vieux Sam…
 Que pense le chien Filou du Grand Djihad? Pense-t-il que cette conjecture de Maurice G. Dantec ait plus de consistance que celle des hordes chinoises déboulant sur les collines de Meudon telle que la prophétisait Céline? Je me le demande, en cette matinée radieuse de votations démocratique sur la libre circulation des personnes, comme je me l’étais demandé en lisant Forteresse de Georges Panchard, où il était déjà question de la dévastation de l’Europe par une nouvelle croisade islamiste. Tout cela, cher Filou, ne relève-t-il pas du fantasme délirant?
Que pense le chien Filou du Grand Djihad? Pense-t-il que cette conjecture de Maurice G. Dantec ait plus de consistance que celle des hordes chinoises déboulant sur les collines de Meudon telle que la prophétisait Céline? Je me le demande, en cette matinée radieuse de votations démocratique sur la libre circulation des personnes, comme je me l’étais demandé en lisant Forteresse de Georges Panchard, où il était déjà question de la dévastation de l’Europe par une nouvelle croisade islamiste. Tout cela, cher Filou, ne relève-t-il pas du fantasme délirant?
Le premier enseignement du chien Filou, au lendemain de son entrée dans notre maison, a été de me rappeler la force de la douceur, retenant la main qui frappe. Nous étions en balade dans les bois, je l’avais rappelé trois fois, il n’avait pas obéi, gamin qu’il était encore, donc je le frappai de ma canne ferrée lorsqu’il revint penaud, et alors il me fit cet œil noir de pacifiste: on ne frappe pas le chien Filou, disait cet œil. Sur quoi l’animal se ferma à toute négociation jusqu’au coucher, me préparant visiblement un chien de sa chienne. Le lendemain matin, aux aubes, une merde m’attendait au milieu de mon atelier, et Filou assis sur ses pattes me toisait avec ce message triomphal dans son regard de scottish ressentimental: «Je t’emmerde». C’était l’époque de la fin de la guerre balkanique, après les tueries de Bosnie et avant celles du Kosovo. Mes amis serbes me taxaient de fiote angélique, et moi je les emmerdais, prêt en somme à m’entendre avec Filou. Mais que pense donc Filou du Grand Djihad?
°°°
A l’instant Filou reluque la mésange Zoé qui lui picore ses croûtons, tandis que je lis Du Jihad à la Fitna de Gilles Kepel, dont Sophie m’a déchiffré l’inscription de couverture: «Il n’y a Dieu que Dieu, Mohammed est son prophète».
 Aux dernières nouvelles, notre enfant ne semble pas sur la voie de porter le voile, mais c’est en somme à l’école de Filou qu’elle a appris elle aussi la force de la douceur (connaître pour mieux comprendre et discuter, voire disputer). Or que dit Gilles Képel?
Aux dernières nouvelles, notre enfant ne semble pas sur la voie de porter le voile, mais c’est en somme à l’école de Filou qu’elle a appris elle aussi la force de la douceur (connaître pour mieux comprendre et discuter, voire disputer). Or que dit Gilles Képel?
Qu’il y a Jihad et Jihad. Que la source du terme signifie effort, et d’abord dans la réalisation de la perfection individuelle. La dimension positive du jihad réside en cela qu’il «permet de se dépasser en tendant vers le Bien». Comme on le sait cependant, l’effort implique aussi la visée militaire et guerrière «pour étendre l’emprise de l’islam», qui peut aboutir à la discorde originelle de la fitna, liée aux débuts conflictuels de l’islam- la fitna désignant plus précisément la guerre à l’intérieur de l’isl, dès le schisme entre sunnites et chiites. Rappelant les composantes spécifiques de l’expansion de l’islam, Gille Kepel en illustre à la fois la dynamique, soumise à l’autorité des oulémas, et la transformation récente de cette instance de contrôle et de décision. «Le droit et la logique du déclenchement du jihad ont été déstabilisé par la révolution de l’information et c’est là ce qu va nous amener à la situation d’excès, de désordre, de terrorisme, que l’on connaît aujourd’hui». Et de montrer ensuite comment, niant l’histoire, les jihadistes contemporains s’efforcent de rejouer la geste du prophète en s’appuyant sur Internet «qui abolit l’histoire et l’espace». C’est dans les années 80, lors de la défaite de l’URSS en Afghanistan, que Gilles Kepel situe ce «bouleversement complet à proclamer le jihad», alors que commençaient de proliférer les guérillas-jihads initialement soutenues par les USA et qui se retourneraient bientôt contre ceux-ci.
Ce que montre ensuite Kepel, à la lumière des événements d’Algérie notamment, c’est comment la société civile s’est désolidarisée des jihads des années 1990. A propos de cet échec, il cite le grand idéologue d’al-Qaida, l’Egyptien Ayman Al-Zawahiri, lié à l’assasinat de Sadate puis devenu compagnon de Ben Laden en Afghanistan, qui publia en décembre 2001 un pamphlet dans un quotidien arabe de Londres où il affrmait: «Nous avons échoué à mobiliser les masses, nous n’avons pas réussi à faire comprendre notre mesage, les masses se sont détournées de nous et il faut que nous les réveillions par des opérations spectaculaires», ce qu’il appelle des «opérations martyres».
Celles-ci suffiront-elles à déclencher le Grand Djihad que prophétise Maurice G. Dantec dans Cosmos incorporated? Je discerne un doute dans l’œil du chien Fellow. Va-t-on aujourd’hui, en Irak, vers un jihad qui va mobiliser les masses comme l’espère Zawahiri? Ou bien est-ce ceux qui sont contre ce jihad, relevant de la fitna, qui mobiliseront les sociétés civiles contre les fauteurs de violence?
Le chien Filou se retient de se jeter sur la mésange Zoé, mais c’est avec la dernière détermination que je vais me lancer, tout soudain, dans mon projet d’extermination des dernières berces duCaucase au lait venimeux qui prolifèrent le long de notre chemin de pacifistes.
 L’exergue de William Blake annonçait la couleur: «There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her»… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on pressent initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre.
L’exergue de William Blake annonçait la couleur: «There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her»… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on pressent initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre.
Le seul nom de Blake évoque des visions, et c’est la dominante aussi de Cosmos incorporated, dont les tableaux successifs établissent une atmosphère poétique tout à fait particulière, dont l’écho porte au-delà de la seule tension de thriller futuriste. Cela pourrait faire kitsch ou toc, et d’autant plus que s’y greffent moult références au rock des années 80 que le lecteur n’«entend» pas forcément, et pourtant on avance là-dedans avec une curiosité croissante, comme happé par ce dédale spatio-mental envoûtant, produisant l’effet hyperréel des rêves. Le parcours de la Heavy Metal Valley, où s’entassent des millions de carcasses de voitures du siècle précédent, et dans lequel Sergueï découvre des reliques de culte chrétien, semble ainsi communiquer avec ses rêves, comme le feu de ceux-ci se prolonge dans l’hôtel Laïka où il découvre une post-adolescente en flammes qu’il vient d’apercevoir en songe. Or tout cela, qui pourrait être lourdement symbolique ou carrément insupportable, dans le genre chromo new age, dégage un réel mystère et une beauté crépusculaire réellement prenante.
Au seuil de la deuxième partie de Cosmos incorporated, je suis à la fois perplexe et très intéressé par la suite de ce curieux roman, mêlant l’attrait apparent d’un récit de SF et, crescendo, l’enjeu d’un autre type de littérature à caractère symbolico-mystique. Dieu sait que le wagnérisme artistique, les pompes symbolistes à la Gustave Moreau, pis encore: la littérature de prétendus Grands Initiés ne m’ont jamais transporté, mais une fois encore je suis curieux de voir où nous conduit ce drôle d’apôtre de Dantec…
°°°
 Les mots sont une chose, mais la couleur me manque depuis quelque temps, et l’aquarelle n’est pas autre chose à mes yeux: c’est la couleur.
Les mots sont une chose, mais la couleur me manque depuis quelque temps, et l’aquarelle n’est pas autre chose à mes yeux: c’est la couleur.
C’est une énigme que la couleur. J’ai beau savoir qu’elle s’explique scientifiquement: je ressens tout autre chose, et qui n’a rien à voir avec la symbolique, la psychologie ou l’ésotérisme.
Chez moi la couleur est une composante de l’affectivité et de l’Eros, c’est une manifestation dionysiaque, mais pas en aquarelle – ou rarement, car l’aquarelle telle que je la pratique est essentiellement apollinienne. Il y a cependant une aquarelle qu’on pourrait dire de fusion et qui rejoint alors l’huile la plus «érotique», ainsi que l’illustre le mieux, me semble-t-il, un Turner. Mais assez de mots: passons à la chose…
°°°
J’étais sur le point de laisser tomber. Dantec me semblait en train de se planter. A la page 264 j’ai lu cette phrase: «L’extension maximale du surpli dévoilé au «monde», l’expansion soudainement formatée de sa «conscience» au sein d’une matrice de signifiants ne surcodant plus qu’eux-mêmes, provoquaient en réaction une condensation infinie du point de rupture, c’est-à-dire le moment où tout dans son corps-esprit devenait point de rupture, le moment où le Néant-Être qu’elle était devenue faisait place à l’invasion globale du Monde, et de la souffrance – physique, psychique, absolue – qui lui est corrélative».
 Allais-je donc avaler cette sorte de galimatias? Avant que je ne me décide à renvoyer Dantec à ses fumeuses cogitations, celles-ci se dissipaient soudain par un retournement du récit où tout, de la première partie du roman, allait prendre un sens nouveau, tandis que le voile se levait sur la genèse même et le projet du livre.
Allais-je donc avaler cette sorte de galimatias? Avant que je ne me décide à renvoyer Dantec à ses fumeuses cogitations, celles-ci se dissipaient soudain par un retournement du récit où tout, de la première partie du roman, allait prendre un sens nouveau, tandis que le voile se levait sur la genèse même et le projet du livre.
On a dit que Faulkner consommait l’irruption de la tragédie grecque dans le roman noir. De la même façon, on pourrait dire que Cosmos incorporated marque la fusion du roman d’anticipation, de la contre-utopie et de la mystique judéo-chrétienne.
Plus précisément on découvre, dans la seconde partie du roman, que celui-ci est né dans l’imagination fertile d’une jeune fille de feu tombée du ciel, née sur un Anneau orbital sis à 500 km de la terre, sérieusement instruite en matière de tradition théologique, autant que son frère est ferré en littérature, et qui a entrepris de créer un Golem avec la complicité momentanée d’un agent logiciel qu’elle baptise Métatron, ange gardien de Sergueï constituant la réplique futuriste du prophète biblique Enoch…
°°°
Un cuistre teigneux, probablement second couteau de la bande des «ramuziens» commis à la préparation des Œuvres complètes ou des deux volumes de La pléiade à paraître ces prochains jours, m’attaque dans le courrier des lecteurs de 24Heures, ne supportant pas que j’aie ironisé sur le caractère «scientifique» du Chantier Ramuz. On voit de mieux en mieux que ce qui importe le plus à ces gens-là n’est pas de défendre et d’illustrer une grande œuvre littéraire mais de se poser en spécialistes exclusifs de la chose, tels les Docteurs de la loi.
 Je me suis bien diverti, en lisant le quatrième volume de la monumentale Histoire de la littérature romande, dirigée par Roger Francillon, de constater que cet ouvrage à prétention «scientifique», précisément, dérivait autant que ceux des temps précédents dans le parti pris et les assertions arbitraires, voire parfois le règlement de compte, particulièrement sous la plume de jeunes auteurs imbus de scientificité.
Je me suis bien diverti, en lisant le quatrième volume de la monumentale Histoire de la littérature romande, dirigée par Roger Francillon, de constater que cet ouvrage à prétention «scientifique», précisément, dérivait autant que ceux des temps précédents dans le parti pris et les assertions arbitraires, voire parfois le règlement de compte, particulièrement sous la plume de jeunes auteurs imbus de scientificité.
Pour ma part, je n’ai rien contre les écarts «subjectifs» de tel ou tel critique, mais que celui-ci se prévale de son autorité «scientifique» pour légitimer ses jugements me paraît fort de café. Cela me rappelle furieusement notre ami Alexandre Zinoviev, qui balayait toute la littérature russe contemporaine sous prétexte qu’elle n’était pas «scientifique», étant entendu que la sienne seule l’était. Or précisément, ce qui nous intéressait dans son œuvre était cela même qui échappait à la «science». Au reste on la vu dans l’évolution de son travail littéraire autant que dans ses jugements sur l’époque: lui qui se prétendait scientifiquement rigoureux a proféré tout et son contraire avant de s’enfoncer dans une spirale paranoïaque à mes yeux significative…
°°°
 On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais mordu jusque-là à Dantec, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose à la masse, sans discerner vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant de substances nocives.
On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais mordu jusque-là à Dantec, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose à la masse, sans discerner vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant de substances nocives.
Or Cosmos incorporated correspond à ce que j’attends d’une nouvelle forme de narration, à la fois entée sur le Grand Récit des littératures et de la science dont parle Michel Serres, poreux au présent et pariant pour une possible écriture à venir, qui passe ici par la (ré) incarnation d’un personnage de notre monde déchu (genre tueur
russe de téléfilm) en figure de héros vivant une «nouvelle enfance».
Il y a du génie visionnaire à la Tarkovski et à la Burroughs dans l’exploration de la ville contaminée de Neon Park, à la fois dépotoir électrifié en surface et souterrain dostoïevskien, où Slotkine passe avant de repérer, au bord d’une rivière, une vieille voyante orphique fumeuse de pipe et le chien Balthazar qui «agit comme un chien» mais «parle comme un homme, au moment où les hommes se conduisent comme des porcs et parlent comme des machines».
Ce livre me rappelle une injonction qui me tient lieu de vieille conviction de post-adolescence, résumée par le titre d’un roman de Miroslav Karleja lu dans ma vingtaine et intitulé Je ne joue plus. C’est cela qui arrive à Plotkine, à la fois à son corps défendant (il est choisi, désigné, inventé par Vivian) et de son libre choix assumé. Il sait maintenant qu’il doit trahir ce qu’il a été, «dépouiller le vieil homme» comme disait l’autre, reconnaissant la nécessité absolue de «la trahison de tout ce qui désintègre en permanence la liberté dans l’espace grand ouvert de la Métrastructure de Contrôle et de l’ensemble de ses rhizomes, mafieux, flicards, humanitaires, culturel, techniques». Quand on se sent pris dans ce filet on sort son poignard et ensuite seulement on peut écrire… Quand Dantec écrit qu’«amour et trahison du monde allaient de pair» et qu’il repère un «temps discret» courant de L’Aquinate et Leibniz à l’espace-temps d’un nouveau récit «en douce», tout cela censé marquer une «réunification poétique de l’être» en suivant la souple marche d’un chien, je balance un clin d’œil à mon compère Fellow et je souris aux anges…
 Il est assez rare, par les temps qui courent, de se trouver en présence d’un génie créateur en activité (comme on le dirait d’un volcan), mais c’est exactement l’impression que me fait, en crescendo, la lecture de Cosmos incorporated, dont la réflexion que Dantec développe sur l’à-venir de l’humanité, sur le Mal qui la menace d’anéantissement et sur le mystère de l’Être, me paraît sans équivalent dans le roman contemporain. Ce livre peut donner l’impression d’un fumeux échafaudage de conjectures techno-scientifiques et de spéculations mystico-philosophiques, voire d’un indigeste brouet mêlant rogatons de contre-culture (de Burroughs aux Stooges), visions catastrophistes et relents de théologie patristique, dans le genre bric-à-brac new age, mais une lecture sérieuse révèle, je crois, un livre sérieux. Sans même parler de l’artefact, signalant une incroyable maestria dans la combinatoire narrative, c’est un livre qui danse en même temps qu’il pense, illustrant de manière presque ingénue (c’est le fait du genre investi, avec tout le décorum propre à la SF de haute volée, genre Greg Egan ou Philip K. Dick) une réflexion aux fondements sûr et des intuitions de véritable poète, au sens d’une poésie cristallisant tous les savoirs au cap extrême de l’Aporie.
Il est assez rare, par les temps qui courent, de se trouver en présence d’un génie créateur en activité (comme on le dirait d’un volcan), mais c’est exactement l’impression que me fait, en crescendo, la lecture de Cosmos incorporated, dont la réflexion que Dantec développe sur l’à-venir de l’humanité, sur le Mal qui la menace d’anéantissement et sur le mystère de l’Être, me paraît sans équivalent dans le roman contemporain. Ce livre peut donner l’impression d’un fumeux échafaudage de conjectures techno-scientifiques et de spéculations mystico-philosophiques, voire d’un indigeste brouet mêlant rogatons de contre-culture (de Burroughs aux Stooges), visions catastrophistes et relents de théologie patristique, dans le genre bric-à-brac new age, mais une lecture sérieuse révèle, je crois, un livre sérieux. Sans même parler de l’artefact, signalant une incroyable maestria dans la combinatoire narrative, c’est un livre qui danse en même temps qu’il pense, illustrant de manière presque ingénue (c’est le fait du genre investi, avec tout le décorum propre à la SF de haute volée, genre Greg Egan ou Philip K. Dick) une réflexion aux fondements sûr et des intuitions de véritable poète, au sens d’une poésie cristallisant tous les savoirs au cap extrême de l’Aporie.
Sous le titre de Process, la troisième partie de Cosmos incorporated introduit le personnage de l’Homme-Machine, planqué dans le dôme sommital de l’Hôtel Laïka, sous la forme semi-apparente d’un spectre d’enfant doté de tous les sexes et de 99 noms virtuels, le 100e étant à deviner par le lecteur féru en démonologie… On peut y voir en effet l’incarnation du Non-être, qui n’a plus de sexualité, juste bon à l’assouvissement virtuel de son gardien pervers, ni de nom personnel, l’Enfant-Machine étant la métaphore de l’Innommé ou de ce que Maurice Blanchot appelait «l’indestructible infiniment détruit».
Un chroniqueur distrait des Inrockuptibles a cru voir dans ce livre un illisible salmigondis: le contraire serait étonnant, s’agissant d’un roman qui jongle avec les dernières théories de la physique quantique et les intègre (le saut à la supercorde…) dans sa narration avec autant d’humour qu’il recycle à sa façon la théologie apophatique de Nicolas de Cues ou la controverse sur le monopsychisme opposant Thomas d’Aquin et Averroès…
Or ce qui est assez éberluant là-dedans, c’est que la vision globale du livre est d’une cohérence que je dirais essentiellement poétique, où la réflexion basique sur l’aliénation de l’homme à la Métastructure-Machine se vit comme dans un roman de chevalerie christo-futuriste, avec les Gentils qu’on aime et les Méchants dont on espère la défaite – ce qui s’appellera bientôt «baiser la Métastructure». Jamais, depuis G.K. Chesterton, ou peut-être C.S. Lewis à un degré plus modeste, un auteur n’avait combiné ainsi la narration la plus «populaire» et la méditation la plus pure sous ses airs déjantés. J’en suis baba: je me pince. Mais non: je ne rêve pas: c’est écrit et c’est beau, cela pulse, cela vit.
 Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’on la trouve dans l’une des nouvelles de From Death to Morning (De la mort au matin), sous le titre de Circus at Dawn et commençant ainsi: «Thre were times un early autumn – in September – when the greater circuses would come to town – The Ringling Brothers, Robinson’s, and Barnum and Bailey shows, and when I was a route-boy on the morning paper, on those mornings when the circus would be coming in I would rush madly through my route in the cool and thrilling darkness that comes just before break of day, and then I would go back home and get my brother out of bed.»
Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’on la trouve dans l’une des nouvelles de From Death to Morning (De la mort au matin), sous le titre de Circus at Dawn et commençant ainsi: «Thre were times un early autumn – in September – when the greater circuses would come to town – The Ringling Brothers, Robinson’s, and Barnum and Bailey shows, and when I was a route-boy on the morning paper, on those mornings when the circus would be coming in I would rush madly through my route in the cool and thrilling darkness that comes just before break of day, and then I would go back home and get my brother out of bed.»
 Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de ce haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge: «Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die…»
Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de ce haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge: «Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die…»
°°°
L’arrivée des éléphants, ce matin, au milieu des voitures bloquées, n’avait rien de cette magie crépusculaire ni de cette grandeur muette, mais la présence d’une petite troupe d’enfants escortant les sept sages m’a fait sourire à l’idée que, dans une trentaine ou une quarantaine d’années, cette matinée revivrait peut-être dans quelques mémoires comme un moment sauvé de la grisaille des jours.
 La France aime toujours la littérature, écrire un livre semble plus que jamais y signaler un «supplément d’âme», et même le personnage de l’écrivain qui n’écrit pas - l’écrivain «empêché», comme on dit, y jouit d’une sorte de prestige, d’autant plus que toute Française ou tout Français se sent un peu dans ce cas, rêvant d’écrire un jour «son» roman et préparant, dans son bain, les réponses qu’elle ou il fera tantôt à Patrick Poivre d’Arvor ou à Guillaume Durand, après la parution de l’ouvrage rêvé chez Grasset. Chez Grasset justement vient de paraître le dernier roman longtemps «empêché» de François Weyergans, le type de l’écrivain en difficulté, à propos duquel ses proches ont toujours un peu peur (il est si fragile, le pôvchéri), et que Madame Public, quand elle lira enfin ce roman «que tout le monde attendait», n’aura de cesse de prendre dans ses bras pour le consoler.
La France aime toujours la littérature, écrire un livre semble plus que jamais y signaler un «supplément d’âme», et même le personnage de l’écrivain qui n’écrit pas - l’écrivain «empêché», comme on dit, y jouit d’une sorte de prestige, d’autant plus que toute Française ou tout Français se sent un peu dans ce cas, rêvant d’écrire un jour «son» roman et préparant, dans son bain, les réponses qu’elle ou il fera tantôt à Patrick Poivre d’Arvor ou à Guillaume Durand, après la parution de l’ouvrage rêvé chez Grasset. Chez Grasset justement vient de paraître le dernier roman longtemps «empêché» de François Weyergans, le type de l’écrivain en difficulté, à propos duquel ses proches ont toujours un peu peur (il est si fragile, le pôvchéri), et que Madame Public, quand elle lira enfin ce roman «que tout le monde attendait», n’aura de cesse de prendre dans ses bras pour le consoler.
Dans Trois jours chez ma mère, François Weyergans explique comment François Weyergraf (son double romanesque, n’est-ce pas) n’arrive pas à écrire les divers romans (dont un qui parle de volcans) pour lesquels il a déjà reçu des à-valoir, et comment il est en train d’écrire Trois jours chez ma mère. Est-ce intéressant? Pas moins que la voisine qui vous explique comment apprêter le homard à la nage ou le voisin qui vous confie, sous l’effet d’alcools divers, que sa femme accoutume de le branler dans les trains. Cela fait-il un livre? Pas plus que la matière des chroniques de Bernard Frank en feraient des chroniques, sans le ton de Bernard Frank. Car François Weyergans a un ton. Et puis il a de l’humour, François Weyergans. Cela fait déjà deux bons points de plus qu’à Marc Levy, à cela près que celui-ci est mieux mal rasé que Weyergans et qu’il sait comme filer une intrigue combinant l’Amour, genre Love story, et le Drame, genre Urgences. Ainsi est-il douteux que Spielberg propose jamais à Weyergans de tirer un film de Trois jours chez ma mère. Celui-ci, en revanche, aura droit à une belle grande chronique de Jérôme Garcin, dans Le Nouvel Obs, où un élégant parallèle sera tiré entre ce livre «tellement attendu» et le fameux Paludes de Gide, ce roman fameux d’un auteur en train d’écrire Paludes…
°°°
Je suis, pour ma part, en train d’écrire n’importe quoi du fait d’une putain d’insomnie. J’ai dû relancer le chauffage tout à l’heure sur la position Hiver. Mes femmes vont partir ce matin pour le Midi tandis que je resterai à la niche comme un bon chien avec mon compère Filou. Je vais passer trois jours avec mon chien. Trois jours avec mon chien: voilà le titre d’un roman dont l’écriture me demandera bien trois jours aussi…
°°°
J’étais en train de lire la fin de Cosmos incorporated en écoutant le Te deum d’Arvo Pärt, lorsque je suis tombé sur ces mots: «Vous savez bien que la mort n’existe pas». Le contexte du chapitre dans lequel ces mots sont prononcés, autant que le fait que ces mots constituent le titre exact (Que la mort n’existe pas) de la dernière partie de mon dernier ouvrage paru, Les passions partagées, où j’évoque les derniers jours et l’agonie de ma mère, tout cela m’a plongé dans un mélange de profonde mélancolie et de joie paradoxale qui imprègne aussi bien les cinquante dernières pages de ce livre complètement renversant où je lisais encore une page plus loin «l’Amour tue la Mort, l’Amour est capable de vous rendre insensible, non à lui-même mais à son antimonde, à ce qui n’est pas réel, et qui pourtant modèle la réalité du monde. Seul l’Amour est réel, pensait-il…»
Et de fait, malgré les multiples «prodiges» que ploie et déploie la narration du roman de Dantec, qu’on pourrait dire une fiction nourrie de conjectures scientifiques plus encore que de la science fiction, c’est bel et bien de réalité qu’il s’agit là, en tout cas c’est ainsi que je le perçois, à la fois physiquement et métaphysiquement comme avec aucun autre écrivain à ce point d’incandescence et de vertige depuis Witkiewcicz, dont la vision du futur restait essentiellement mécaniste dans son catastrophisme, sans rien de la vision religieuse et mystique de Dantec.
J’ai pensé, en lisant les déclarations de l’intempestif dans les journaux, que sa position spirituelle relevait de l’idéologie d’emprunt ou du plaquage de pacotille, mais il n’en est rien: c’est visiblement une espèce de converti sauvage qui emprunte autant au réalisme pur et dur de Thomas d’Aquin qu’à la vision en rupture de Giordano Bruno et à toutes sortes de visionnaires mystiques de l’Ancien Testament et des premiers siècles, via l’Apocalypse, pour fonder une approche de la réalité très nourrie aussi de culture scientifique et littéraire, sans parler de ses multiples références de fan de rock faisant paraître tout ce qui précède du pipeau folky.
Or, il n’en est rien: ce livre se tient magnifiquement, tant au niveau de sa narration «triviale» qu’à celui de ses multiples résonances morales, poétiques ou téléologiques. Sa dernière partie, malgré sa vision catastrophiste que ma nature débonnaire refuse absolument d’admettre, est même bouleversante d’humanité, et notamment quand il parle de «la beauté intrinsèque que ne parvenaient pas à souiller les abominations de l’homme» ou, tout à la fin, à propos du «texte» à venir qu’il reste à chacun de nous à écrire «dans la clameur atroce des tueries et le vacarme tonitruant des foules livrées à elles-mêmes», quand il évoque une dernière voix sur Terre, «celle qui fait de chacun d’entre nous autre chose qu’une routine dans le programme, autre chose qu’une boîte dans un ensemble infini de boîtes, autre chose qu’une machine dans la mégamachine. Cette voix, c’est tout ce que l’humanité n’ose pas se dire, tout ce dont l’humain ne veut pas entendre parler, c’est-à-dire lui-même et ses atroces défaillances, ses immondes dysfonctionnements, sa monstruosité non assumée», cette voix qui est de l’origine et «qui permet au monde de se faire», cette voix censée se taire à la fin de Cosmos incorporated et dont la modulation dit précisément le contraire…










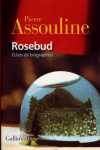
 « L’essentiel est dans les détails »
« L’essentiel est dans les détails »



 Yesterday comes, d'Ilene Barnes
Yesterday comes, d'Ilene Barnes
 Nobel de littérature
Nobel de littérature
 Pour lire Anna Politkovskaïa
Pour lire Anna Politkovskaïa
 Maos de Morgan Sportès
Maos de Morgan Sportès Morgan Sportès. Maos. Grasset, 406p.
Morgan Sportès. Maos. Grasset, 406p.

 Le dernier souvenir que je garde de Zouc est un pur moment d’âpre émotion, il doit bien y avoir vingt ans de ça, au Théâtre Municipal, dans sa bouleversante traversée de vies fracassées. Ce n’était pas la Zouc enjouée mais la fille du bord des gouffres à la manière helvète sauvage, proche de Louis Soutter et de Robert Walser. On conçoit que de celle-ci, Nathalie Baye ne puisse rien restituer. Reste un nom qui fait tilt comme le nom de Baye fait tilt pour les pipoles, et le nom de Guibert.
Le dernier souvenir que je garde de Zouc est un pur moment d’âpre émotion, il doit bien y avoir vingt ans de ça, au Théâtre Municipal, dans sa bouleversante traversée de vies fracassées. Ce n’était pas la Zouc enjouée mais la fille du bord des gouffres à la manière helvète sauvage, proche de Louis Soutter et de Robert Walser. On conçoit que de celle-ci, Nathalie Baye ne puisse rien restituer. Reste un nom qui fait tilt comme le nom de Baye fait tilt pour les pipoles, et le nom de Guibert. Guibert, Zouc et Godard procèdent par collage, comme Fellini et Montaigne aussi. Drôle de mélange, mais ça me botte de couper du bois en laissant tourner JLG sur le magnétoscope et en relisant de loin en loin, slurpant un café dans la foulée, des pages de Fou de Vincent de Guibert, ce si beau patchwork de fragments amoureux obscènes et doux.
Guibert, Zouc et Godard procèdent par collage, comme Fellini et Montaigne aussi. Drôle de mélange, mais ça me botte de couper du bois en laissant tourner JLG sur le magnétoscope et en relisant de loin en loin, slurpant un café dans la foulée, des pages de Fou de Vincent de Guibert, ce si beau patchwork de fragments amoureux obscènes et doux. J’étais hier soir au cabaret de L’Esprit frappeur où passaient le blond Riquet houppé Thierry Romanens, le charme zazou et le talent doux-acide jeté en personne, puis l’immense Allain Leprest, toujours au bord de s’effondrer mais ouvrant tout grand son ciel d’âme pure.
J’étais hier soir au cabaret de L’Esprit frappeur où passaient le blond Riquet houppé Thierry Romanens, le charme zazou et le talent doux-acide jeté en personne, puis l’immense Allain Leprest, toujours au bord de s’effondrer mais ouvrant tout grand son ciel d’âme pure.

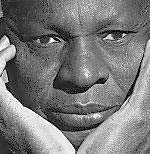





 Il est cinq heures du matin en ce fuseau de l’Hémisphère nord et noir est l’encrier du monde dans lequel se prépare la chronique du profond Aujourd’hui. Tout à l’heure je secouerai Winnie qui va se pointer en grommelant et prononcera au premier rai de jour la phrase rituelle: «Encore une journée divine». En attendant je me rappelle les visions de catastrophe de ce livre que je lisais hier et que je vais continuer de lire tout à l’heure en me disant: foutaises, mais penser à cela tout le temps.
Il est cinq heures du matin en ce fuseau de l’Hémisphère nord et noir est l’encrier du monde dans lequel se prépare la chronique du profond Aujourd’hui. Tout à l’heure je secouerai Winnie qui va se pointer en grommelant et prononcera au premier rai de jour la phrase rituelle: «Encore une journée divine». En attendant je me rappelle les visions de catastrophe de ce livre que je lisais hier et que je vais continuer de lire tout à l’heure en me disant: foutaises, mais penser à cela tout le temps. Que pense le chien Filou du Grand Djihad? Pense-t-il que cette conjecture de Maurice G. Dantec ait plus de consistance que celle des hordes chinoises déboulant sur les collines de Meudon telle que la prophétisait Céline? Je me le demande, en cette matinée radieuse de votations démocratique sur la libre circulation des personnes, comme je me l’étais demandé en lisant Forteresse de Georges Panchard, où il était déjà question de la dévastation de l’Europe par une nouvelle croisade islamiste. Tout cela, cher Filou, ne relève-t-il pas du fantasme délirant?
Que pense le chien Filou du Grand Djihad? Pense-t-il que cette conjecture de Maurice G. Dantec ait plus de consistance que celle des hordes chinoises déboulant sur les collines de Meudon telle que la prophétisait Céline? Je me le demande, en cette matinée radieuse de votations démocratique sur la libre circulation des personnes, comme je me l’étais demandé en lisant Forteresse de Georges Panchard, où il était déjà question de la dévastation de l’Europe par une nouvelle croisade islamiste. Tout cela, cher Filou, ne relève-t-il pas du fantasme délirant? Aux dernières nouvelles, notre enfant ne semble pas sur la voie de porter le voile, mais c’est en somme à l’école de Filou qu’elle a appris elle aussi la force de la douceur (connaître pour mieux comprendre et discuter, voire disputer). Or que dit Gilles Képel?
Aux dernières nouvelles, notre enfant ne semble pas sur la voie de porter le voile, mais c’est en somme à l’école de Filou qu’elle a appris elle aussi la force de la douceur (connaître pour mieux comprendre et discuter, voire disputer). Or que dit Gilles Képel? L’exergue de William Blake annonçait la couleur: «There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her»… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on pressent initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre.
L’exergue de William Blake annonçait la couleur: «There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her»… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on pressent initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre. Les mots sont une chose, mais la couleur me manque depuis quelque temps, et l’aquarelle n’est pas autre chose à mes yeux: c’est la couleur.
Les mots sont une chose, mais la couleur me manque depuis quelque temps, et l’aquarelle n’est pas autre chose à mes yeux: c’est la couleur. Allais-je donc avaler cette sorte de galimatias? Avant que je ne me décide à renvoyer Dantec à ses fumeuses cogitations, celles-ci se dissipaient soudain par un retournement du récit où tout, de la première partie du roman, allait prendre un sens nouveau, tandis que le voile se levait sur la genèse même et le projet du livre.
Allais-je donc avaler cette sorte de galimatias? Avant que je ne me décide à renvoyer Dantec à ses fumeuses cogitations, celles-ci se dissipaient soudain par un retournement du récit où tout, de la première partie du roman, allait prendre un sens nouveau, tandis que le voile se levait sur la genèse même et le projet du livre. Je me suis bien diverti, en lisant le quatrième volume de la monumentale Histoire de la littérature romande, dirigée par Roger Francillon, de constater que cet ouvrage à prétention «scientifique», précisément, dérivait autant que ceux des temps précédents dans le parti pris et les assertions arbitraires,
Je me suis bien diverti, en lisant le quatrième volume de la monumentale Histoire de la littérature romande, dirigée par Roger Francillon, de constater que cet ouvrage à prétention «scientifique», précisément, dérivait autant que ceux des temps précédents dans le parti pris et les assertions arbitraires, On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais mordu jusque-là à Dantec, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose à la masse, sans discerner vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant de substances nocives.
On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais mordu jusque-là à Dantec, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose à la masse, sans discerner vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant de substances nocives. Il est assez rare, par les temps qui courent, de se trouver en présence d’un génie créateur en activité (comme on le dirait d’un volcan), mais c’est exactement l’impression que me fait, en crescendo, la lecture de Cosmos incorporated, dont la réflexion que Dantec développe sur l’à-venir de l’humanité, sur le Mal qui la menace d’anéantissement et sur le mystère de l’Être, me paraît sans équivalent dans le roman contemporain. Ce livre peut donner l’impression d’un fumeux échafaudage de conjectures techno-scientifiques et de spéculations mystico-philosophiques, voire d’un indigeste brouet mêlant rogatons de contre-culture (de Burroughs aux Stooges), visions catastrophistes et relents de théologie patristique, dans le genre bric-à-brac new age, mais une lecture sérieuse révèle, je crois, un livre sérieux. Sans même parler de l’artefact, signalant une incroyable maestria dans la combinatoire narrative, c’est un livre qui danse en même temps qu’il pense, illustrant de manière presque ingénue (c’est le fait du genre investi, avec tout le décorum propre à la SF de haute volée, genre Greg Egan ou Philip K. Dick) une réflexion aux fondements sûr et des intuitions de véritable poète, au sens d’une poésie cristallisant tous les savoirs au cap extrême de l’Aporie.
Il est assez rare, par les temps qui courent, de se trouver en présence d’un génie créateur en activité (comme on le dirait d’un volcan), mais c’est exactement l’impression que me fait, en crescendo, la lecture de Cosmos incorporated, dont la réflexion que Dantec développe sur l’à-venir de l’humanité, sur le Mal qui la menace d’anéantissement et sur le mystère de l’Être, me paraît sans équivalent dans le roman contemporain. Ce livre peut donner l’impression d’un fumeux échafaudage de conjectures techno-scientifiques et de spéculations mystico-philosophiques, voire d’un indigeste brouet mêlant rogatons de contre-culture (de Burroughs aux Stooges), visions catastrophistes et relents de théologie patristique, dans le genre bric-à-brac new age, mais une lecture sérieuse révèle, je crois, un livre sérieux. Sans même parler de l’artefact, signalant une incroyable maestria dans la combinatoire narrative, c’est un livre qui danse en même temps qu’il pense, illustrant de manière presque ingénue (c’est le fait du genre investi, avec tout le décorum propre à la SF de haute volée, genre Greg Egan ou Philip K. Dick) une réflexion aux fondements sûr et des intuitions de véritable poète, au sens d’une poésie cristallisant tous les savoirs au cap extrême de l’Aporie. Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’on la trouve dans l’une des nouvelles de From Death to Morning (De la mort au matin), sous le titre de Circus at Dawn et commençant ainsi: «Thre were times un early autumn – in September – when the greater circuses would come to town – The Ringling Brothers, Robinson’s, and Barnum and Bailey shows, and when I was a route-boy on the morning paper, on those mornings when the circus would be coming in I would rush madly through my route in the cool and thrilling darkness that comes just before break of day, and then I would go back home and get my brother out of bed.»
Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’on la trouve dans l’une des nouvelles de From Death to Morning (De la mort au matin), sous le titre de Circus at Dawn et commençant ainsi: «Thre were times un early autumn – in September – when the greater circuses would come to town – The Ringling Brothers, Robinson’s, and Barnum and Bailey shows, and when I was a route-boy on the morning paper, on those mornings when the circus would be coming in I would rush madly through my route in the cool and thrilling darkness that comes just before break of day, and then I would go back home and get my brother out of bed.» Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de ce haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge: «Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die…»
Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de ce haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge: «Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die…» La France aime toujours la littérature, écrire un livre semble plus que jamais y signaler un «supplément d’âme», et même le personnage de l’écrivain qui n’écrit pas - l’écrivain «empêché», comme on dit, y jouit d’une sorte de prestige, d’autant plus que toute Française ou tout Français se sent un peu dans ce cas, rêvant d’écrire un jour «son» roman et préparant, dans son bain, les réponses qu’elle ou il fera tantôt à Patrick Poivre d’Arvor ou à Guillaume Durand, après la parution de l’ouvrage rêvé chez Grasset. Chez Grasset justement vient de paraître le dernier roman longtemps «empêché» de François Weyergans, le type de l’écrivain en difficulté, à propos duquel ses proches ont toujours un peu peur (il est si fragile, le pôvchéri), et que Madame Public, quand elle lira enfin ce roman «que tout le monde attendait», n’aura de cesse de prendre d
La France aime toujours la littérature, écrire un livre semble plus que jamais y signaler un «supplément d’âme», et même le personnage de l’écrivain qui n’écrit pas - l’écrivain «empêché», comme on dit, y jouit d’une sorte de prestige, d’autant plus que toute Française ou tout Français se sent un peu dans ce cas, rêvant d’écrire un jour «son» roman et préparant, dans son bain, les réponses qu’elle ou il fera tantôt à Patrick Poivre d’Arvor ou à Guillaume Durand, après la parution de l’ouvrage rêvé chez Grasset. Chez Grasset justement vient de paraître le dernier roman longtemps «empêché» de François Weyergans, le type de l’écrivain en difficulté, à propos duquel ses proches ont toujours un peu peur (il est si fragile, le pôvchéri), et que Madame Public, quand elle lira enfin ce roman «que tout le monde attendait», n’aura de cesse de prendre d