 Entretien avec Nancy Huston
Entretien avec Nancy Huston
Contre les néantistes. Contre ceux qui rompent avec toute filiation, rejetant ascendance et descendance. Contre ceux qui exaltent le génie artistique d'essence masculine, au mépris de la chair bassement féminine. Contre les esthètes du suicide. Telles sont, schématiquement résumées, les positions de Professeurs de désespoir de Nancy Huston qui pose des questions essentielles sur les liens vivants et complexes de la vie et de l'art. De Schopenhauer à Thomas Bernhard, ou de Milan Kundera à Christine Angot, en passant par Imre Kertsez ou Elfriede Jelinek, la romancière-essayiste détaille les frustrations affectives, les tragédies ou les refoulements qui ont abouti à autant de visions du monde mortifères.
- Quelle est la genèse de ce livre ?
- L'un de ses points de départ est une expérience que font toutes les femmes dès leur enfance. Nous sommes censées nous identifier à un garçon en lisant Tom Sawyer ou Huckleberry Finn, nous nous glissons dans tous les "nous" et les "on", un peu comme un Noir découvrant la littérature des Blancs. Puis nous constatons que nous n'étions pas vraiment inclues dans ce "nous". Un autre point de départ a été ma lecture de la poésie anglaise des XVIIIe et XIXe siècles: j'ai été frappée par la façon différente, chez les hommes et les femmes, de percevoir la mort et d'exprimer la peur de celle-ci. J'en suis venue à me demander si les hommes n'avaient pas plus peur de mourir que les femmes. Si je passe en revue les plus grandes poétesses, je constate que le thème de leur mort personnelle est absent. J'y ai réfléchi et bientôt a cristallisé ce thème du nihilisme, avec sa haine du corps, le refus des origines et de l'enfantement, ce mépris des masses et des nuances, cette sacralisation de l'écriture aussi...
- Avez-vous connu, personnellement, la tentation du désespoir ?
- Je sais très bien ce que c'est d'être une jeune fille anorexique, fragile, solitaire et brillante qui erre dans une grande ville avec des envies de suicide. Si la maternité m'a sauvée, ce n'est pas parce que les enfants sont mignons mais parce que de les voir se développer m’a appris que le postulat du nihilisme ne tient pas debout. Pour pouvoir dire "je...suis...seul", il faut avoir appris le langage et c'est avec d'autres qu'on le fait. Comme j'ai moi-même été abandonnée par ma mère, je ne savais pas vraiment ce que c'est d'être mère. J'ai dû l'apprendre comme une langue étrangère. En outre, il y aussi des morts qui m'ont aidé à sortir de cette pensée nihiliste. D'après celle-ci, la mort est une catastrophe. Or, en perdant des gens très proches, et même si je les regrette beaucoup, j'ai fait cette expérience enrichissante qu'ils continuaient de vivre en moi.
- Quels critères ont dicté votre choix d'auteurs nihilistes ?
- J'ai pensé à Agota Kristof, puis me suis dit, en la relisant, qu'elle n'était pas de ce clan, quoique son regard soit noir. Mais mes romans aussi sont assez sombres. Même chose pour J.M. Coetzee. Pourtant Elizabeth Costello contient d'extraordinaires inflexions de tendresse humaine. Il y avait aussi Sartre et Beauvoir. Celle-ci avait une horreur physique de l'enfantement et le couple a encouragé le mythe de l'auto-engendrement. Mais ce ne sont pas des néantistes. J’ai retenu ceux qui, dans la lignée de Schopenhauer, considèrent la vie comme une abomination, vomissent les mères et les femmes (Bernhard, Kundera, Houellebecq ), maudissent la paternité (Cioran, Kertesz, Jelinek, Angot), les enfants et la vie familiale (tous tant qu’ils sont). Par contraste, j’ai parlé aussi de deux rescapés de l’horreur nazie (Jean Améry et Charlotte Delbo) qui ne concluent pas au désespoir, et j’ai évoqué la façon dont Linda Lê s’arrache elle aussi à la noirceur absolue.
- Vous affirmez, avec une crâne solennité frottée d’ironie, que l'homme et la femme sont différents...
- L'idéologie dominante, de Beauvoir à Badinter, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les sexes, ce qui revient à dire que les femmes devraient devenir des hommes. La femme a toujours été tenue pour muse ou inspiratrice, mais tout sauf créatrice, et ce n'est pas d’un instant à l’autre qu'elle va manipuler les symboles avec la même autorité. Cela étant, pour reprendre de vieux clichés qui ont du vrai, je crois que les hommes sont plus angoissés, plus seuls, dans la chaîne du vivant. Le fait de mettre au monde inscrit les femmes dans la filiation. L'oeuvre d'art est en revanche la trace qui signera le passage de l'homme. Pour ma part, quoique très attachée à l'art, à la musique et à la connaissance, je m'efforce de relativiser cette survalorisation de l'oeuvre qui aboutit à mépriser les gens doués pour la vie.
- Pour autant, vous ne valorisez pas non plus le “quotidien” et la confession brute...
- Je crois que le roman n'a pas pour fonction de révéler au public la vie privée de l'auteur ou d’exalter la platitude mais de transporter les gens et de repousser les murs de leur moi, de les agrandir en leur faisant découvrir le point de vue des autres. Typique à cet égard, un Houellebecq flatte la médiocrité et la bassesse à force de simplifications. A sa façon de réduire l’islam à une “connerie”, alors qu’il se prétend romancier, j’opposerai le livre de la veuve de Danny Pearl, décapité par les fanatiques, qui cherche, elle, à comprendre le monde islamique au lieu de le juger avec mépris. Romain Gary disait justement que “le côté inhumain fait partie de l’humain” et qu’il incombe au romancier d’en saisir les tenants et les aboutissants. Mais dire que tout est inhumain, ou que tout est de la merde, est absurde. A mes yeux, la vie n’est ni absurde ni pas absurde: elle est ce que les gens en font...
Sous le signe du lien
C’est un livre salutaire et très vivifiant que Professeurs de désespoir, qui s’inscrit dans le droit fil de l’évolution en constante expansion d’une romancière à l’admirable capacité d’empathie, comme l’illustrent Instruments de ténèbres, Dolce agonia ou Une adoration, notamment. Pour illustrer les vingt dernières années de cette trajectoire aux engagements non dogmatiques, un choix de textes vient de paraître simultanément sous le titre d’ Ames et corps dont le premier (Déracinement du savoir) est particulièrement éclairant.
Quant à Professeurs de désespoir, précisons d’emblée qu’il n’est en rien un hymne à l’optimisme béat. Son propos n’est pas d’édulcorer le tragique de la condition humaine mais de lutter, au nom des nuances et de la complexité du réel, contre les généralisations qui tuent et contre l’absolutisme négatif de penseurs et d’écrivains exerçant aujourd’hui une inquiétante fascination.
Pourquoi des intellectuels et des romanciers prônant le néant de toute chose, le malheur d’être né (Schopenhauer) et le crime d’engendrer (Cioran), la haine tous azimuts (Jelinek), le mépris de sa communauté (Bernhard), le rejet des enfants (Kundera) ou l’exaltation de l’abjection (Houellebecq) rencontrent-ils tant de succès ?
Pour le comprendre, Nancy Huston remonte aux sources du nihilisme européen avant d’approcher treize destinées souvent marquées par une enfance massacrée. Tous les enfants maltraités ne deviennent pas pour autant Hitler (dans le crime de masse) ou Thomas Bernhard (dans la méchanceté délirante), et certaines femmes martyres (une Flannery O’Connor) tireront un surcroît de vitalité créatrice de la même infortune qui en brisera d’autres (le suicide de Sarah Kane) ou les rejettera dans le narcissisme destructeur (Christine Angot).
Thomas Bernhard, estimant qu’un Seigneur Dieu ne peut être que masculin, se moquait d’une certaine “Déesse Suzy” que ses menstrues et ses grossesse empêcherait décidément d’adorer. Or cette Déesse Suzy, “merveilleusement érotique et maternelle” devient ici l’interlocutrice privilégiée de Nancy Huston. Régal de malice à gros sabots qui fera se récrier les chantres du nihilisme de salon et autres vestales du littérairement correct.
A relever enfin que les analyses percutantes de l’essayiste alternent avec de beaux interludes évoquant ses liens de femme et d’artiste avec la vie, la perte d’un ami, la complicité d’une sale gamine octogénaire, le souvenir de Romain Gary, les bonheurs et les blessures, un mari du genre admirable (Tzvetan Todorov), les livres et les gens. Beau geste de gratitude que ce livre, du côté de la vie...
Nancy Huston. Professeurs de désespoir. Actes Sud, 380p.
Nancy Huston, Ames et corps. Textes choisis (1981-2003) Leméac-Actes Sud, 255p.
Un nouveau roman de Nancy Huston est annoncé aux éditions Actes Sud, à paraître à l'automne 2006.
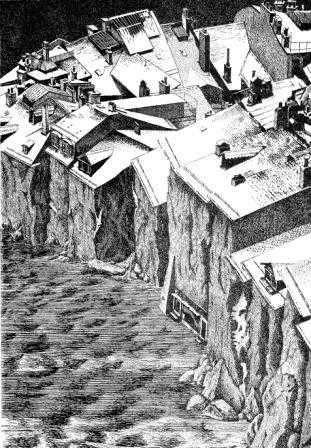

 Comme une seconde naissance
Comme une seconde naissance Entretien avec Nancy Huston
Entretien avec Nancy Huston





 xtraordinaire, à la fois au sens où l’entendait Jules Verne, et pour la nouveauté des espaces imaginaires qu’il ouvre dans la tête du lecteur, que nous propose le dernier roman de l’écrivain français en exil (lire encadré) Maurice G. Dantec, brassant un savoir impressionnant dans un thriller d’anticipation qui joue à la fois sur les ressorts « naïfs » du genre, la vision géopolitique catastrophiste d’un futur proche (vers 2050) et une extravagante histoire de démons et d’anges « quantiques » puisant aux deux sources de la conjecture scientifique et du symbolisme mystique. Le cocktail molotov des références du romancier, imbibé de rock anglais des années 80, de contre-utopie littéraire (du côté de William Burroughs et Philip K. Dick) et citant saint Augustin, Nicolas de Cues ou Giordano Bruno, pourrait alimenter le pire kitsch post-punk ou cyber-new age, et pourtant il n’en est rien. Ce roman saisit en effet par le sentiment du tragique qui l’inspire, sa révolte fondamentale contre le suicide spirituel de l’humanité, et la poésie, la beauté novatrice de sa forme.
xtraordinaire, à la fois au sens où l’entendait Jules Verne, et pour la nouveauté des espaces imaginaires qu’il ouvre dans la tête du lecteur, que nous propose le dernier roman de l’écrivain français en exil (lire encadré) Maurice G. Dantec, brassant un savoir impressionnant dans un thriller d’anticipation qui joue à la fois sur les ressorts « naïfs » du genre, la vision géopolitique catastrophiste d’un futur proche (vers 2050) et une extravagante histoire de démons et d’anges « quantiques » puisant aux deux sources de la conjecture scientifique et du symbolisme mystique. Le cocktail molotov des références du romancier, imbibé de rock anglais des années 80, de contre-utopie littéraire (du côté de William Burroughs et Philip K. Dick) et citant saint Augustin, Nicolas de Cues ou Giordano Bruno, pourrait alimenter le pire kitsch post-punk ou cyber-new age, et pourtant il n’en est rien. Ce roman saisit en effet par le sentiment du tragique qui l’inspire, sa révolte fondamentale contre le suicide spirituel de l’humanité, et la poésie, la beauté novatrice de sa forme.

 t quand je dis "on" c'est parce que celui qui écrit en ligne n'est pas tout à fait le même que celui qui écrit pour lui; et quand je dis lecture, c'est en effet de livres qu'on parlerait, mais aussi de tout ce qui passe par les mots et par les rencontres et les voyages, autant dire: le livre du monde...
t quand je dis "on" c'est parce que celui qui écrit en ligne n'est pas tout à fait le même que celui qui écrit pour lui; et quand je dis lecture, c'est en effet de livres qu'on parlerait, mais aussi de tout ce qui passe par les mots et par les rencontres et les voyages, autant dire: le livre du monde...