
Avec Mal tiempo, David Fauquemberg nous plonge dans le grand jeu de la boxe sous l’angle du bilan existentiel. Michel Déon l'a aimé !
C’est un livre à la fois puissant et très sensible, dense et intense que Mal tiempo de David Fauquemberg, deuxième roman de l’auteur du mémorable Nullarbor, gratifié du Prix Nicolas Bouvier en 2007 et désormais disponible en Folio. Elliptique et percutant, combinant admirablement les lignes narratives du double drame intérieur vécu par un jeune champion cubain du genre indomptable et par le narrateur, dit le Francés, boxeur amateur trentenaire en passe de laisser tomber The Game, et d’une plongée dans les univers imbriqués de la boxe et de la vie cubaine dont l’arrière-plan social et politique se trouve ressaisi à fines touches précises et combien significatives aussi. On peut ne rien connaître à la boxe, ni ne s’y intéresser particulièrement : aussitôt on est pris, embarqué dès la première page par le premier combat qui est aussi le dernier du narrateur méchamment démoli par un truqueur ; et c’est dans cette mêlée brutale, de l’intérieur de la boxe pourrait-on dire, que s’amorce le récit du Francés à double valeur de quête existentielle et de reportage au sens le plus noble du terme, dans un temps qui est cependant essentiellement le temps d’un roman et avec une frise de personnages campés avec vigueur.
La première partie de Mal tiempo évoque le séjour à Cuba d’un groupe de boxeurs français, aux fins d’entraînement des meilleurs éléments de la relève, auquel le Francés hispanophone est convié comme pair et interprète, alors même qu’il se sent proche de « décrocher ». Les accompagne aussi l’imposant Rouslan, vieux coach d’origine russe qui a guidé les pas du narrateur, en lequel il a reconnu un type régulier. Côté cubain, dès l’arrivée sur l’île, c’est un autre mentor aussi probe qu’exigeant qui apparaît ensuite en la personne de Sarbelio Marquez, entraîneur des jeunes Cubains dont l’un d’eux, colosse solitaire et farouche du nom de Yoangel Corto, se trouve bientôt remarqué et recherché par le Francés, gratifié plus tard du titre amical de « socio » en signe de reconnaissance. Plus encore: Corto révélera son arrière-monde personnel à l’étranger attentif, l’origine filiale de sa révolte douloureuse et l’humiliation qui l’a fait user une première fois de sa terrible force naturelle, avant la boxe, son rapport avec le dieu-tonnerre de la tradition yoruba et la grotte secrète où il se ressource, son père artiste vaguement dégénéré et l’absence de sa mère, le quartier de misère d’où il sort et les filles dont il change comme de chemise au scandale de sa grand-mère le couvant amoureusement du regard – tout cela très vivant et frémissant, contrastant avec les sévères galères, les cris et les coups de l’entraînement.
La question du sens de la boxe se pose déjà au fil de cette première partie de Mal tiempo, qui renvoie incidemment à la question du sens de l’art ou du sens du travail humain. Cette question se pose notamment pour Corto, qui évoque précisément, à un moment donné, la question de l’art, et qui ne semble pas attacher à la notion de victoire le même sens que les autres. La bascule de la première partie dans la trivialité, après une victoire de Corto qui le laisse comme impatienté, dans une boîte à cul où son honneur bafoué le force une fois de plus à corriger un touriste imbécile qui l’a provoqué, débouche sur un retour à la mesquinerie face à laquelle le jeune révolté ne peut mais. Surdoué mais insoumis à l’ordre établi, selon lequel un touriste même taré reste sacré, Corto sera jeté pour un temps, le temps que ses pairs champions cèdent aux sirènes étrangères et que le sport national s’en ressente au point qu’on le rappelle…
À la question pure du sens de la boxe, que Yoangel et le Francés se posent chacun à sa façon, succèdent alors, dans la seconde partie de Mal tiempo, deux ans plus tard, les questions plus troubles et tordues des enjeux commerciaux et nationaux de la boxe, dans un contexte de « marché » plus ouvert, à Port of Spain où, deux ans plus tard, le narrateur va retrouver son « socio ».
Or celui-ci a changé, constate-t-il, même si Corto, plus fort que jamais, se trouve capable de terrasser tous ses adversaires. Comme une réserve mélancolique s’est emparée de lui, que le Francés comprend. Alors même qu’on attend que le champion humilié par les bureaucrates prenne sa revanche, le voici risquer de passer pour traître en retenant sa force. La fin du roman, qui frustrera le lecteur avide de conclusion, et donc de victoire, rappelle les refus de ces autres « dissidents » que sont un Bartleby ou un Schweyk. Or du vrai combat on aura compris, sans démonstration explicite pour autant, que seuls Corto et son « socio » savent l’issue…
Tout cela est passionnant, mais on n’aura rien dit sans ajouter que ce roman, qu’on dirait écrit par tous les côtés à la fois, comme sculpté dans la matière verbale, comme filmé par les mots (alors qu’il n’est en rien conçu « pour le film » comme tant de feuilletons habiles), vaut par son écriture à la fois dégraissée, elliptique, précise et rapide, mais non sans diffusion lyrique et sans ouvertures constantes à la rêverie ou à l’arrêt méditatif. On avait compris, avec Nullarbor, qu’il faudrait désormais compter avec David Fauquemberg. Mal tiempo le confirme en beauté…
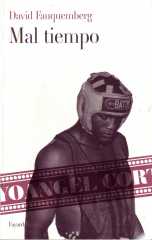 David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p.
David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p.
 L'Auteur sur le ring, dialogue.
L'Auteur sur le ring, dialogue.
- Quelle a été la genèse de Mal Tiempo ?
- Bien avant d'avoir terminé Nullarbor, j'avais écrit une première version de la scène d'ouverture, mais je suis incapable de travailler sur deux textes en parallèle avec la même intensité... Et puis il y avait le titre, Mal Tiempo. Il me venait d'une expression souvent entendue à Cuba, et pour cause : Al Mal tiempo Buena Cara - Faire bonne figure au mauvais temps ("Contre mauvaise fortune, bon coeur"), ou, comme je l'entends : "Sourire à l'adversité". Bref, j'avais cette idée d'adversité, et aussi l'idée de tempo, de rythme. Tout le roman est parti de là. Le narrateur à contretemps (autre interprétation possible du titre), et le boxeur cubain qui impose son tempo, domine le temps.
Au départ, j'avais deux envies : écrire Cuba, et écrire la boxe. Cuba étant la meilleure école de boxe au monde, et comme j'avais eu l'occasion de voir de près les boxeurs de là-bas, ces deux projets se sont fondus l'un dans l'autre pour n'en faire plus qu'un. La boxe me permettait d'entrer différemment dans Cuba, par les banlieues des petites villes, par les hommes tels qu'ils vivent; Cuba m'offrait une boxe différente, plus proche du "noble art" que la boxe professionnelle qu'on voit aujourd'hui à la télévision. Cuba, c'est une certaine idée de la boxe : l'amateurisme (le sport professionnel est interdit par le régime), le respect de l'autre, presque une ascèse, et puis le STYLE ! Pour un amateur de boxe, voir combattre les Cubains est un régal, une émotion esthétique - le sens du rythme, la technique réduite à l'essentiel, sans fioritures, la force et la souplesse. Les grands champions cubains, surtout Felix Savon (trois fois champion olympique des lourds), sont d'une classe à part.
En outre, le Cuba qui m’intéressait dépasse et de beaucoup la seule réalité du dernier demi-siècle : c'est un Cuba plus profond (on le voit dans la scène de la grotte), le Cuba des campagnes, car la culture de l'île est essentiellement paysanne - la musique, l'amour de la terre, la pesanteur des croyances populaires - indiennes, yorubas, etc. Mon héros, Yoangel Corto, est constitué de tout cela. Il en tire une force un peu surnaturelle, et surtout une certaine rigueur morale, l'attachement à des principes, une armature.
 - Quels rapports personnels entretenez-vous avec la boxe ?
- Quels rapports personnels entretenez-vous avec la boxe ?
- J'ai toujours été fasciné par la boxe, par l'extrême simplicité du dispositif, par sa frontalité, son intensité extrême, ce mélange unique de confusion (on est toujours dépassé par le combat) et de maîtrise - le bon boxeur, c'est celui qui impose sa maîtrise dans la confusion, sa maîtrise du corps, bien sûr, mais avant tout du temps. La boxe m'intéresse depuis longtemps comme matière littéraire, il y a quelque chose dans ce duel à l'état pur, dans cette violence domestiquée, dans ces changements de rythme incessants qui me donnait envie d'écrire - et puis l'idée que derrière la technique, le résultat, il y a deux hommes avec leurs intentions, leur histoire, leur vision de l'adversité. La boxe, je l'ai pratiquée en amateur, intensément, dans ma vingtaine. Mais j'étais un lourd trop léger, je n'avais pas vraiment LE truc. Au demeurant, le fait de connaître la boxe de l'intérieur, d'avoir goûté au ring, m'a certainement aidé dans l'écriture de Mal tiempo, car ce que je voulais faire n'avait rien à voir avec un hommage à la boxe, ni avec un roman qui se serait servi de la boxe comme d'un simple prétexte. Je voulais être sur le ring, et que le lecteur sente la boxe, sa dureté, ses odeurs, ses bruits...
- Le personnage de Corto relève-t-il de votre pure imagination ?
- Question délicate. Qu'est-ce qui ne relève pas de mon imagination ? J'ai l'impression que ma perception du monde est, en majeure partie, imagination. Mais le pouvoir majeur de l'imagination, pour moi, n'est pas de l'ordre de la création, ni de l'invention. Son pouvoir, c'est surtout de recombiner les faits après coup, de réorganiser, de poétiser. Mais elle est incapable de créer à partir de rien. On imagine parce qu'on a vu, senti, vécu, et à partir de cela. Donc la notion même d'imagination "pure" m'est incompréhensible. Enfin...
Yoangel Corto n'existe que dans Mal tiempo. Son histoire n'appartient qu'à lui, je n'ai rencontré personne qui ait vécu cela, parlé comme cela, pris de telles décisions. Comme boxeur, il ressemble à certains champions : Savon le Cubain (la posture, le rythme, la fougue), Monzon l'Argentin (la fausse raideur, l'absolue confiance en soi, l'impression qu'il a déjà broyé l'autre avant même de combattre, et ce masque terrifiant d'impassibilité), etc. L'homme, lui, s'est construit naturellement, inspiré bien sûr de rencontres que j'ai pu faire à Cuba, d'histoires entendues, de choses vues. Mais j'insiste : Corto s'est imposé de lui-même dans ce récit, l'a pris à son compte, a dicté les choix narratifs.
- Comment avez-vous travaillé ?
- Mon titre en main, et deux ou trois idées sur là où je voulais aller, je me suis lancé dans ce roman sans "réfléchir", au sens où je voulais me laisser guider par le rythme, par la phrase. J'avais le narrateur, un "je" fatigué, sans réelle intériorité, sorte de caméra sensorielle qui, connaissant la boxe, emmenait le lecteur au ras des choses. Et puis, en chemin, j'ai rencontré Yoangel, qui s'est littéralement emparé du récit - pas le genre à se laisser dicter ses actes et ses paroles, ce Corto... J'ai beaucoup fonctionné par scènes, c'est-à-dire qu'une fois que les deux personnages ont commencé à se dessiner, à imposer leur personnalité, j'avais une phrase de dialogue, une décision, une action de l'un ou de l'autre qui venait, et à partir de là une scène s'imposait. C'était très instinctif, absolument pas cérébral ni construit, et pourtant les dialogues, les scènes ont commencé à se répondre, fonctionnant par touches successives, par sédimentation.
J'ai eu la chance, au bout d'une année de travail, d'obtenir une résidence dans le sud-ouest de la France, à Lombez, deux mois dans un village paumé, à la fin de l'automne, à ne faire que ça - ruminer, écrire, relire, ruminer, réécrire... Je crois que le roman y a gagné en densité, en intensité. Après, comme toujours, c'est une affaire de réécritures...
- Que vous appris l’écriture de ce livre ?
- Mon dieu... D'abord, j'ai l'impression d'être allé plus loin dans l'intensité, dans la densité, de m'être approché de ce que je recherche en écriture - le sujet s'y prêtait, je le savais, encore fallait-il tenir la distance et maîtriser au mieux la confusion, comme en boxe. Je crois que j'ai appris à faire davantage confiance au romanesque, au fait que l'action seule, les dialogues, les ambiances portent en eux tout le sens d'une histoire, si on écoute ses personnages et qu'on les laisse vivre. Pas de discours, des voix, des émotions, des sensations.




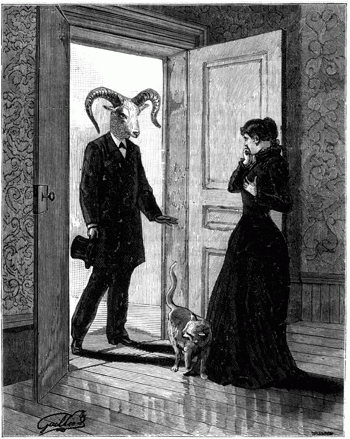



 Les questions reviennent
Les questions reviennent Les vérités mesurées
Les vérités mesurées Les petites résurrections
Les petites résurrections Et Michène fera
Et Michène fera
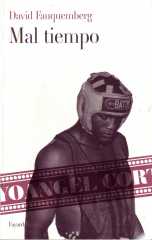 David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p.
David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p. L'Auteur sur le ring, dialogue.
L'Auteur sur le ring, dialogue. -
-



 Rafik Ben Salah. La véritable histoire de Gayoum ben Tell. Xénia, 139p.
Rafik Ben Salah. La véritable histoire de Gayoum ben Tell. Xénia, 139p.
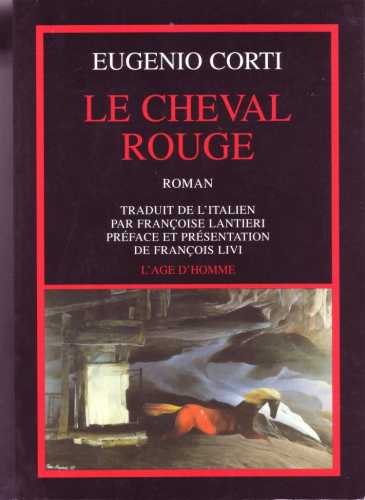
 Première impression, le lendemain, du Marché des amants de Christine Angot, entamé les pieds dans l’eau ? Va-t-on vers un nouvel épisode de la lettre à la petite cousine dont parlait l’affreux Céline ? De Marc qu’elle découvre à Bruno dont elle s’est un peu fatiguée mais qui est plus beau que Marc, lequel hésite la moindre avant de partir en Corse avec les siens, le feuilleton se dessine mais c’est la phrase, surtout, qui me scotche. La phrase d’Angot se délie et le dialogue a la pêche. Ecriture électrique. Bon, mais là faut regagner la ville pour faire ses adieux à sa grande petite fille qui se tire un mois en Colombie…
Première impression, le lendemain, du Marché des amants de Christine Angot, entamé les pieds dans l’eau ? Va-t-on vers un nouvel épisode de la lettre à la petite cousine dont parlait l’affreux Céline ? De Marc qu’elle découvre à Bruno dont elle s’est un peu fatiguée mais qui est plus beau que Marc, lequel hésite la moindre avant de partir en Corse avec les siens, le feuilleton se dessine mais c’est la phrase, surtout, qui me scotche. La phrase d’Angot se délie et le dialogue a la pêche. Ecriture électrique. Bon, mais là faut regagner la ville pour faire ses adieux à sa grande petite fille qui se tire un mois en Colombie…

 Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.
Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.  La grande affaire de ce roman est ce qu'on pourrait dire, sans railler, le mystère de l'incarnation. Toutes les conférences, colloques et autres séminaires n'expliqueront jamais ce qui n'est jamais qu'une question d'implication - Costello parle plus exactement d'"incrustation". Or c'est bien plus dans sa rencontre physique avec sa soeur Blanche, religieuse versée dans l'étude du sida en Afrique, que dans les véhéments débats qui les opposent (Blanche ne jure que par la Vérité chrétienne, alors qu'Elizabeth défend l'humanisme de source grecque)que le « mystère » agit. Et le récit "out of record" qu'Elizabeth fait au lecteur, faute d'oser en parler à Blanche, de l'acte (érotique) le plus charitable qu'elle ait jamais commis, pour l'apaisement d'un vieux mourant, "incarne" également une vérité humaine inavouable que l'espace du roman fait résonner, dans la conscience et le coeur du lecteur, comme un aveu faisant valdinguer toutes les « idées ».
La grande affaire de ce roman est ce qu'on pourrait dire, sans railler, le mystère de l'incarnation. Toutes les conférences, colloques et autres séminaires n'expliqueront jamais ce qui n'est jamais qu'une question d'implication - Costello parle plus exactement d'"incrustation". Or c'est bien plus dans sa rencontre physique avec sa soeur Blanche, religieuse versée dans l'étude du sida en Afrique, que dans les véhéments débats qui les opposent (Blanche ne jure que par la Vérité chrétienne, alors qu'Elizabeth défend l'humanisme de source grecque)que le « mystère » agit. Et le récit "out of record" qu'Elizabeth fait au lecteur, faute d'oser en parler à Blanche, de l'acte (érotique) le plus charitable qu'elle ait jamais commis, pour l'apaisement d'un vieux mourant, "incarne" également une vérité humaine inavouable que l'espace du roman fait résonner, dans la conscience et le coeur du lecteur, comme un aveu faisant valdinguer toutes les « idées ».












 - La perception de la beauté est-elle universelle selon vous ?
- La perception de la beauté est-elle universelle selon vous ? - Qu’est-ce qui caractérise la vision chinoise à cet égard ?
- Qu’est-ce qui caractérise la vision chinoise à cet égard ?




 Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.
Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.  L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.
L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.
 Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir…
Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir…


 A tous les étages habités du Devero, qu’on atteint par une route très escarpée en bifurquant, sur la route du Simplon, à quelques kilomètres en aval de Domodossola, l’on est ainsi frappé par le goût des reconstructions à toits de pierre et boiseries dans le style des Walser, autant que, passé le barrage à toute circulation automobile, par la qualité des chemins piétonniers. Le céleste bleu pur de ces jours fait affluer, de Milan et de partout, une inconcevable procession d’automobiles, toutes garées le long de la route de montagne, sur des kilomètres et des kilomètres. Vision buzzatienne des enfers du XXIe siècle que cet interminable scolopendre multicolore, mais au-delà d’un hallucinant tunnel non éclairé traversant la montagne de part en part : halte-là, tout le monde continue
A tous les étages habités du Devero, qu’on atteint par une route très escarpée en bifurquant, sur la route du Simplon, à quelques kilomètres en aval de Domodossola, l’on est ainsi frappé par le goût des reconstructions à toits de pierre et boiseries dans le style des Walser, autant que, passé le barrage à toute circulation automobile, par la qualité des chemins piétonniers. Le céleste bleu pur de ces jours fait affluer, de Milan et de partout, une inconcevable procession d’automobiles, toutes garées le long de la route de montagne, sur des kilomètres et des kilomètres. Vision buzzatienne des enfers du XXIe siècle que cet interminable scolopendre multicolore, mais au-delà d’un hallucinant tunnel non éclairé traversant la montagne de part en part : halte-là, tout le monde continue La foule est encore dense sur la moquette de gazon du vaste amphithéâtre du premier val Devero, mais au fur et à mesure qu’on s’élève, par les paliers successifs d’une espèce d’escalier montant vers le ciel à travers les forêts de châtaigniers dominant des lacs vert émeraude, et par d’immenses hauts plateaux de tourbières traversées de ruisseaux d’une traînante limpidité, jusqu’aux citadelles rocheuses découpant là-haut leurs créneaux dentelés, les marcheurs se font plus rares et, en fin de journée, c’est dans une solitude absolue que nous serons redescendus à travers ces jardins suspendus coupés de falaises à pic, de cascades aux eaux fumantes et de vertigineuses vires.
La foule est encore dense sur la moquette de gazon du vaste amphithéâtre du premier val Devero, mais au fur et à mesure qu’on s’élève, par les paliers successifs d’une espèce d’escalier montant vers le ciel à travers les forêts de châtaigniers dominant des lacs vert émeraude, et par d’immenses hauts plateaux de tourbières traversées de ruisseaux d’une traînante limpidité, jusqu’aux citadelles rocheuses découpant là-haut leurs créneaux dentelés, les marcheurs se font plus rares et, en fin de journée, c’est dans une solitude absolue que nous serons redescendus à travers ces jardins suspendus coupés de falaises à pic, de cascades aux eaux fumantes et de vertigineuses vires.

