
De la douceur et de la douleur
Le mot de douceur me venant par le nom de Bonnard me ramène au premier chapitre de Monsieur Ouine dont le peintre aurait pu dire tout le mystère, de la sieste de Monsieur Steeny, entre la Miss et sa Mère, à tout ce qui est ensuite évoqué de l’origine de la douceur de celle-ci, mêlée à la conscience tôt éveillée de la douleur.
Le mystère est omniprésent chez Bonnard, consubstantiel à la vie même dont les éléments ne sont jamais noyés dans la pure couleur (ma réticence à l’égard des Nymphéas de Monet et de toute l’abstraction lyrique ensuite) car le dessin reste net et l’objet, l’objet cher à Cézanne mais ici vu et dit tout autrement, avec un abandon et des effusions de père de famille très nombreuse ou d’Eternel en retraite fumant sa clope en regardant sa terre « qui est parfois si jolie » non sans se rappeler l’affreuse mélancolie des enterrements d’enfants…
Douceur, douceur, douleur, douleur, petit rongeur, notre cœur est un « petit serviteur trop fragile » mais même après la mort d’un père aimé et d’un époux gazé le 28 décembre 1916 le petit castor s’active là-bas dans la rivière où se baignent Michelle et Monsieur Steeny son fils, alias Philippe, fils de l'autre Philippe - le petit rongeur obstiné grignoteur de secondes et de minutes et de siècles dont le peintre dessine les papattes en pensant à tout autre chose, les yeux perdus dans les cent mille bleus de ce jour
Carnets de La Désirade - Page 3
-
Bonnard et Bernanos
-
La force de tuer

A propos de Liberté à Brême de Fassbinder
La Désirade, ce lundi 16 janvier. – En sortant l’autre soir de la représentation de Liberté à Brême de Fassbinder, dont le sarcasme va de pair avec la question sérieuse de savoir à quel moment nous devenons capables de tuer, je me suis rappelé la scène que j’ai vécue il y a quelques années, dans un wagon-restau où, interrompant ma lecture de La force de tuer de Lars Noren, dont il fixait depuis un moment le titre avec des yeux inquisiteurs, tel jeune homme m’a soudain entrepris sur le sujet, affirmant d’abord qu’il était, lui, absolument incapable d’imaginer une situation dans laquelle il aurait la force de tuer…
Je n’ai pas dit à ce charmant garçon, ce jour-là, que j’étais parfaitement capable, moi, de tuer un quidam interrompant ma lecture dans un train, pressentant qu’il manquait d’humour. En revanche je lui ai présenté quelques cas de figure précis qui l’ont rendu tout songeur et moins sûr de lui, avant de lui avouer que, pour ma part, je n’avais éprouvé le désir de tuer vraiment qu’une fois, au MozartPark de Vienne, en observant le manège de dealers de luxe faisant ramper devant eux des gamins toxicos. « Là, vous m’auriez donné un flingue, si possible muni d'un silencieux, je les descendais sans la moindre hésitation »…
Dès la première scène de Liberté à Brême, l’éventualité de tuer le premier conjoint de Geesche, qui l’humilie et la brutalise avec la mâle bonne conscience du macho couillu au pouvoir de droit divin (la chose se passe en Allemagne bigote vers la fin du XIXe, mais vaut encore sûrement un peu partout), m’a paru la seule solution pour elle, et ensuite il m’a paru juste et bon qu’elle empoisonne successivement son faux-cul de deuxième soupirant (louchant sur l’entreprise familiale), son père invoquant l'Autorité du Pater Familias, sa mère celle du Très-Haut, enfin son frère revenu de guerre aussi con qu’il y était parti. Tout ça est évidemment schématique à souhait, le trait est forcé comme dans toute forme d'art expressionniste, et pourtant il y a quelque chose de bel et bien libérateur dans le rire, à la fois noir et jaune, que Fassbinder déclenche par le truchement de cette pièce.
Or je me le demande à l’instant : qui aurais-je vraiment la force de tuer ce matin si j’en éprouvais la nécessité vitale, que dis-je : le Devoir ? A vrai dire je ne vois pas. Personne. Nobody. Nikto. Est-ce le fait d’un début de gâtisme frappant mon imagination, ou cela tient–il à la croissante indulgence qui me vient pour le genre humain, accentuée par la présence éminemment irénique de mon cher Fellow ?
Le poison tonique de Fassbinder
Rainer Werner Fassbinder n’aura pas atteint l’âge de la retraite (il est mort de tous ses excès en 1987), mais le soixantième anniversaire de la naissance de ce rebelle, en 2005, a été l’occasion d’hommage illustrant l’actualité toujours vive de son regard à la fois radical, sur la société, et plus qu’amical sur le sort des victimes de tous les pouvoirs. Dans Liberté à Brême, ainsi, c’est à la condition d’une femme asservie ou infantilisée, en la personne de Geesche Gottfried, qu’il s’intéresse, développant une observation à la fois schématique et pertinente par la foison de ses notations, au fil d’une ligne dramatique dont le mécanisme répétitif pourrait lasser s’il n’était empreint du plus grinçant humour noir. En résumé, la « pauvre » Geesche tue successivement tous ceux qui la rabaissent, l’humilient ou l’empêchent de respirer et d’aimer, jusqu’à se supprimer finalement comme pour dire que même tuer « n’est pas une vie ».
Loin d’être une pièce majeure, Liberté à Brême ne se borne pas pour autant à une thèse, et la meilleure preuve en est donnée par les quatre comédiens réunis et dirigés par Denise Carla Haas, qui restituent parfaitement le jeu cruel des relations liant Geesche (Magdalena Czartoryjska Meier, tout à fait remarquable d’intensité et de précision) à son premier rustre de mari (Fabien Ballif, également impressionnant de justesse dans ses divers rôles), le faux- cul doucereux qui lui succède et qu’anime un sordide intérêt, ou son père maxi-macho et son frère qui ne l’est pas moins (Mario Barzaghi, excellent lui aussi), sa mère bigote et enfin sa perfide amie (Valérie Liengme, pas moins bonne que les autres).
Dans un dispositif d’Estelle Rullier accordé à la stylisation de la « lecture », la mise en scène de Denise Carla Haas évite le réalisme pour accentuer la violence expressionniste et instiller le « poison » tonique du texte de Fassbinder, qui nous rappelle que la liberté vaut quelques petits sacrifices…
Lausanne, Théâtre 2.21, rue de l’Industrie, jusqu’au 29 janvier, ma-ve-sa 20h.30, je 19h, di 18h. Neuchâtel, Le Pommier les 2 et 3 février.
-
Madame Berchtold
 Quatre d’entre elles (2)
Quatre d’entre elles (2)A La Désirade, ce 14 janvier. - Dans la catégorie variée des femmes d’écrivains, un genre me fait horreur et c’est celui de l’Admirable Compagne, dont la seule appellation dissimule le plus souvent des liens de dépendance plus que douteux, alors que me ravit le type en voie de disparition de l’épouse aux petits soins, qui s’écrit naturellement sans majuscules et s’entend avec malice.
Madame Berchtold est le type de l’épouse aux petits soins, et c’est donc avec une double allégresse que je me rendais, avant-hier, à Genève, chez le professeur Alfred Berchtold, qui est la fois le plus grand historien suisse vivant (je dirai à vue de nez: 1m.92), l’un des derniers représentants du Gai Savoir helvétique de haute tradition, l’auteur d’au moins trois livres incomparables (La Suisse romande au cap du XXe siècle, Bâle et l’Europe et sa captivante approche du personnage de Guillaume Tell à travers les siècles et les cultures du monde entier), enfin un homme aussi bienveillant (il m’a fait l’amitié de relire le tapuscrit de mon prochain livre, qui lui est dédié) qu’intéressant, dont l’humour me régale et me rappelle à tout coup le bien fondé du surnom de Pingouin que lui ont collé ses condisciples de la Communale de la rue Lepic, à Montrmartre, où il a fait ses premiers pas de môme studieux à bonnet de plouc préalpin.
Dire que Madame Berchtold est aux petits soins ne signifie pas qu’elle soit piètrement soumise : elle fait ça naturellement, aussi naturellement que Pingouin porte cravate et s’abstient de marmonner « fait chier » ou « j’veux dire ». C’est une affaire de génération. Albert Camus avait honte de voir sa mère se tenir debout derrière sa chaise pendant le repas, et je me suis efforcé longtemps de décourager ma propre mère d’être aux petits soins, mais en observant hier Madame Berchtold, son plaisir de faire plaisir tout en riant de nous entendre rire de certains ridicules de certaines gendelettres de notre connaissance, je me disais « et merde, c’est quand même une société que tout ça», et « oui Madame je veux bien encore de votre poule au riz délicieuse » disais-je alors que je n’en pouvais plus, juste pour le plaisir de lui faire plaisir.Nous avons publié, avec Alfred Berchtold, un livre d’entretiens intitulé La passion de transmettre, que j’ai eu un vrai bonheur à faire et qui reste un précieux témoignage sur la multiculture que nous vivons dans ce pays. Or à chaque fois que nous nous rencontrions, Madame Berchtold était là pour nous faciliter la tâche, aux petits soins une fois encore. Au fil des jours, je n’ai pas appris grand’chose sur elle, sinon qu’elle avait été prof elle aussi et qu’elle ne supportait pas la chimie pharmaceutique, lisait pas mal et partageait les curiosités et les enthousiasmes de son maxi-jules. Or jamais, au grand jamais, je n’ai relevé la moindre trace de condescendance, de sa part à lui, à l’égard de cette petite dame toujours souriante et complice. Ah mais, tout cela ne fait-il pas vieux jeu ? Je l’espère bien, ma caille…
Wolfgang Mattheuer, La distinguée. Huile sur fibres dures, 1973-1974
-
L’Alsacienne
 Quatre d’entre elles (1)
Quatre d’entre elles (1)« Mon père n’avait peur de rien, c’est ce qui l’a sauvé pendant la guerre, et je crois que je tiens de lui… », a-t-elle remarqué en me racontant l’Occupation qu’elle a vécue à Mulhouse, lycéenne aux ordres des Führerinnen, tandis que ses deux frères étaient embarqués dans la Wehrmacht.
C’était hier, elle m’a accosté sur le quai de la gare de Lausanne, elle m’avait entendu une fois dans une soirée littéraire et venait de lire mon papier sur le jeune Sénégalais féru de Senghor dont j’ai tiré le portrait dans mon journal, elle aussi était enseignante et connaissait le lascar, ayant même des choses à m’en apprendre, bref warning : la raseuse, me disais-je en imaginant une échappatoire - mais plus moyen de m’en débarrasser, nous allions tous deux à Genève et je n’avais pas le cœur de la remballer, d’autant moins que ce qu’elle a commencé de me raconter d’elle était intéressant...
Je n’en retiens que l’histoire du pharmacien Weiss. A Mulhouse, où les commerçants juifs abondaient, l’annexion de l’Alsace par les Allemands s’est soldée, à part la germanisation à outrance des écoles, par l’humiliation publique, la spoliation de leurs biens et la déportation ultérieure des juifs, dont Marguerite B. a retenu cette scène : les agents de la Gestapo traînant le pharmacien Weiss devant sa boutique, l’obligeant à s’agenouiller et le contraignant, devant une foule croissante et muette, à brouter l’herbe du pavé qu’il y avait là…
Cette scène du pauvre Weiss, qui n’est jamais revenu des camps de la mort, m’a tout de suite rappelé la chèvre d’Umberto Saba, et c’est avec émotion, avec reconnaissance que j’ai quitté Marguerite B. sur le quai de la gare de Genève, hier dans la lumière voilée de cette fin de matinée d’hiver…
La chèvreJ’ai parlé à une chèvre
Elle était seule dans le pré, elle était attachée.
Repue d’herbe. Mouillée
par la pluie, elle bêlait.
Ce bêlement égal fraternisait
avec ma douleur. Et je répondis, d’abord
pour plaisanter, ensuite parce que la douleur est éternelle,
qu’elle n’a qu’une voix et ne change jamais.
Cette voix je l’entendais
gémir en une chèvre solitaire.
En une chèvre au visage sémite
se plaignait tout autre mal,
toute autre vie.
Umberto Saba, Maison et campagne (1909-1910), traduction de René de Ceccaty -
Le mot prohibé

Une devinette de Buzzati
A La Désirade, ce samedi 7 janvier. – Je cherchais tout à l’heure la nuance de rose bleuté convenant à mon nouveau petit Niesen à l’acryl, quand je l’ai trouvée au ciel de ce lever du jour. C’est ainsi, une fois encore, que tout communique ; et c’est ce que je me dis aussi après avoir lu la nouvelle de Buzzati intitulée Le mot prohibé, qui évoque une société toute pareille à la nôtre, avec des observations recoupant exactement celle de Dürrenmatt dans son Discours à Vaclav Havel, où l’écrivain alémanique comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont chaque habitant serait le geôlier.
Tout au long de la nouvelle, le narrateur, débarqué depuis trois mois dans une ville étrangère, harcèle un des amis qu’il s’y est fait pour que celui-ci lui dise enfin quel est le mot désormais prohibé en ces lieux. L’ami se dérobe, lui expliquant que la prohibition de ce mot découle du besoin d’harmonie des habitants de la ville, qui ont découvert que le conformisme était en somme la meilleure façon de vivre ensemble, avec pour condition le seul sacrifice de ce mot.
Buzzati laisse blancs les deux espaces où le narrateur prononce bel et bien ce mot, que le lecteur est supposé deviner, ce que j’ai fait aussitôt, obsédé que je suis par le besoin de . En lisant la nouvelle à ma bonne amie, elle a prononcé le mot confiance, mais ce n’était pas cela - du moins sa réponse m’a-t-elle paru significative. D’ailleurs je me dis que ce pourrait être un test éclairant. Dis-moi ce que tu redoutes le plus de voir prohibé et je te dirai qui tu es.
La première phrase dans laquelle Buzzati suggère le mot est celle-ci. « Mais nous pouvons parler en toute . Il n’y a ici personne pour nous entendre. Tu peux bien me le dire, ce fichu mot. Quoi pourrait te dénoncer ? » Et la seconde : « Et la ? Le bien suprême. Jadis, tu l’aimais. Tu aurais fait n’importe quoi pour ne pas la perdre. Et maintenant ? »
Et maintenant faisons le test. Vous y tenez, vous, à la ? Ah mais ce Buzzati est d’un candide ? Nous faire de telles devinettes ! Demandons à Vaclav Havel ce qu’il en pense… Niesen, acryl sur toile, 2006.
Niesen, acryl sur toile, 2006. -
Sollers à Lucerne

De Rosengart à Rebecca
J’avais laissé son livre pour voyager plus léger à travers les campagnes enneigées, n’emportant que Les Cahiers de Johanna Silber, mais aussitôt j’ai reconnu Sollers à l’œil inquisiteur qu’il nous a vrillé en se rengorgant dans son feu de plumes blanches, tandis que nous longions la rivière sur laquelle il dansait tout gonflé de son animale importance.
Je me trouvais là bras-deci bras-deça avec deux très vieilles gredines pleines de malice auxquelles j’avais proposé de se rendre en certaine auberge Zum Schiff pour s’y tasser la cloche, ensuite de quoi nous irions à la Collection Rosengart revoir les Cézanne et les Rouault, en traversant vite fait les trois grandes salles de Picasso. Or j’ai vu tout de suite que Sollers savait où nous allions, et que son œil posait une question qu’en une fraction de seconde j’eus déchiffré avant d'y répondre fissa d’un bref hochement du chef. « Verraient-ils le petit Marquet marqueté d'ocelles liquides et le paysage incendié de Soutine » - « Yes messire, ils y allaient surtout pour ça »…
« Yes » est les plus beau mot de la langue anglaise, avait dit Joyce à Johanna Silber quand la diva l’avait rencontré par hasard à Zurich, et j’étais plein encore de la féerie mélancolique de ses carnets lorsque je me rappelai que, de la mélancolie, le cygne Sollers, Sollers le paon paonnant, Sollers le magnifique, le cerf bandant Sollers n’a que foutre.
L’une de mes vieilles gredines a remarqué, au Schiff, lorsque je lui ai montré le cliché digitalisé du cygne Sollers sur le petit écran de mon Nikkon Coolpix L101, qu’il avait le même air rengorgé que l’oncle Théobald quand il est parti aux States , où il a fini clochard ; et j’ai daubé sur le fait que jamais Sollers ne finirait sur le pavé, hélas pour lui, ça manquerait à sa connaissance.
Sur quoi nous nous sommes retrouvés devant les baigneuses bleues de Cézanne. Et le temps s’est arrêté entre le paysage nocturne de Rouault et la tempête d’huile de Soutine…
Le soir nous avons regardé Rebecca du cher Hitch, produit par Dave Selznick qui joue un certain rôle dans la vie de Johanna Silber. Une fois de plus je me suis dit : tout se tient, tout est communiquant, divine est la vie mais pas si ludique que le dit ce vaticanesque ultramondain de Sollers… ah mais flûte: embarquons Une vie divine tant qu’on y est, et vive la vie dont nous crevons ! Georges Rouault. Bouquet au paysage lunaire. Vers 1940. Huile sur toile, 43/29cm. Collection Rosengart, Lucerne.
Georges Rouault. Bouquet au paysage lunaire. Vers 1940. Huile sur toile, 43/29cm. Collection Rosengart, Lucerne. -
Premier délire de l'An


En lisant Nos animaux préférés d'Antoine Volodine
A la Désirade, ce 1er janvier 2006. – Mon premier livre achevé en ce début d'année est un régal savoureux, d’une fantaisie imaginative et verbale qui fait florès à chaque page et dont l’empreinte finale a quelque chose à la fois d’allègre et d’insolent tant que d’étrangement mélancolique.
On se rappelle le Michaux d’Ecuador et des explorations oniriques de Grande Garabagne, les chroniques imaginaires de Milorad Pavic au pays Khazar ou le toboggan aux images de Jean-Marc Lovay en lisant les « entrevoûtes » de Nos animaux préférés d’Antoine Volodine, qui relève à la fois du conte fantastique et de la variation délirante sur une suite de thèmes qui ne le sont pas du tout, où l’esprit critique cohabite avec un humour d’une sorte d’alacrité dans la volubilité métaphorique et lexicogène, dans les droit fil des fictions post-exotiques de l’auteur
Celui-ci explique d’ailleurs sa démarche par le truchement du Commentaire à la Shagga du ciel péniblement infini, superbe ensemble de sept textes poétiques d’un ton plus grave et d’une teneur soudain plus dense que l’ensemble foldingue du recueil. Le commentaire en question précise que « la Shagga a été conçue pour évoquer, et en même temps pour leurrer, pour protéger, pour résister à toute effraction. Elle contient une part de mystère indéchiffrable et, sous ses dehors anodins, elle proclame paisiblement que sa raison d’être est ailleurs : c’est une esthétique de l’esquive qui lui donne sa force poétique (…), et plus loin il est encore dit que la Shagga module « une rêverie susceptible de briser encore ça et là le réel, l’inexorable réel de la marchandise et de la guerre ; un territoire d’exil ; une parole chamane ».
A part les sept morceaux de sagesse du livre, celui-ci se déploie comme une suite de chroniques humanoïdo-animales où, après la première Brève rencontre de l’éléphant Wong avec une humaine agressive, qu’il est contraint d’écraser d’une ferme patte défensive, défilent Sa Majestable Balbutiar le roi du varech à l’échine bouldebrayée, dont on apprend le mode cruel de reproduction, les Sept Reines Sirènes aux règnes ponctués d’événements hégémoniaques ou insurrectionnels variés (méditons au passage sur le sort de Sole-Sole III la reine des Anarchistes qui fit la peau de Jean Balbutiar avant de finir violée et envasée), pour finir sur la triste fin de vie de Wong assisté en ses derniers instants par Tatiana Crow l’humaine compatissante et à belles mamelles mais incapable de surseoir à son enlisement fatal.
Mais un tel livre ne se raconte pas : il se slurpe et s’absorbe à fond les papilles, tout ouïes et branchies branchées et toutes palpèbres, tout nasarium et tous doigts peloteurs actionnés à pleines manettes.
Enfin il faut, pour embrayer sur les Bonnes Résolutions convenant à un 1er de l’An digne des annalistes, recopier ce fragment du Passage, le premier des sept textes sapientiaux de l’ouvrage : « Et c’est sur cette lumière-là, non navigable, fictive, que tu façonneras le passage, dans cette lumière volée, dans la misère orgueilleuse de cette lumière volée ».
Antoine Volodine. Nos animaux préférés. Seuil, 2006. En librairie le 12 janvier. -
Les oiseaux de Volodine

A La Désirade, ce mercredi 28 décembre. – On est ces jours, à La Désirade ensevelie sous la neige, dans le grand silence de l’enfance et des contes, seuls les oiseaux ont des couleurs qui crépitent autour du Macbird’s, les murmures des livres aussi se distinguent plus nettement, et tel est le conte de ce matin, signé Volodine, qui me parle d’animale innocence sous le nom de l’éléphant Wong. Il y a de l’oiseau chez Wong, se déplaçant un peu sur les pointes dans la zone minée d’après les Evénements qui ont décimé les cultivateurs de la région, mais on verra bientôt, à l’apparition d’une furie humaine à lance-roquettes et gestes manquant de précision, que Wong n’est pas du genre à s’en laisser conter, surtout d’une vociférante petite femme sentant la crotte.
Ainsi commence Nos animaux préférés, que je vais lire dans la neige en entremêlant son murmure à d’autres. Ceux de Gaspar L. par exemple, qui diffusent cette même douce étrangeté et dont les mots irradient : «La peau monte dans la lumière: derrière les couvertures. C’est un murmure continu. »
Antoine Volodine. Nos animaux préférés. Seuil, 2006
A découvrir : le blog Voix et murmurats : http://psalmodiesdenoe.hautetfort.com/ -
Amélie Nothomb au soleil de minuit

En relisant Les catilinaires
Ce roman est sans doute, avec le récent Acide sulfurique, l’un des ouvrages les plus remarquables de la romancière, que je relisais l’autre soir avant de la rencontrer à Paris. Cette confrontation entre le couple le plus tranquillement civilisé qui soit, de profs en retraite dans la maison de leur rêve, et de l’emmerdeur absolu que figure leur voisin débarquant tous les jours pour leur imposer sa présence taiseuse de rustre de mauvais poil, débouche sur des abîmes juste entrevus au passage, comme souvent dans ces romans si elliptiques, mais qui n’en sont pas moins effrayants, relatifs au non-être et donc au mal.
Palamède Bernardin est en effet celui qui, s’ennuyant mortellement au monde, rempli come une outre vide d’un gaz acide, ne peut faire que diffuser son poison intérieur et en contaminer autrui. Il y a chez lui comme une variante du démon de petite envergure.
Or parlant hier de ce livre avec Amélie Nothomb, qui lui a été « donné » par une conversation surprise dans un bus belge, elle m’a appris que les habitants d’un seul pays au monde, sur les 37 traductions faites des Catiliniares, l’avaient interprété au rebours de tous les autres, en trouvant incompréhensible son couple et tout à fait normal le personnage qui se rend tous les jours chez ses voisins pour ne faire que les assommer de son silence revêche.
Je reviendrai, ces jours prochains, sur cette rencontre d’Amélie Nothomb qui fera l’objet d’un long entretien, intéressant me semble-t-il. Dans l’immédiat, cependant, je me demande si notre projet de Réveillon à traîner nos raquettes du côté de Tampere ne va pas être remis à des jours meilleurs… -
Une île encore possible
L’enfant à la guitare
A La Désirade, ce samedi 17 décembre. - Nous sommes là dans le chaos de nos vies, et tout à coup il y a un moment de grâce, une île possible, une beauté qui nous sort de la platitude des jours et de la fuite du temps, et hier soir, chez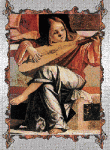 la Comédienne, ç’a été sa fille Anna, notre filleule à l’Amie de la Comédienne (elle aussi actrice de théâtre, l’une des meilleures que je connaisse avec la Comédienne) et à moi, quand elle s’est assise, petite, avec sa guitare, et a commencé à nous jouer son Menuet d’un Anonyme.
la Comédienne, ç’a été sa fille Anna, notre filleule à l’Amie de la Comédienne (elle aussi actrice de théâtre, l’une des meilleures que je connaisse avec la Comédienne) et à moi, quand elle s’est assise, petite, avec sa guitare, et a commencé à nous jouer son Menuet d’un Anonyme.
On peut me dire tout ce qu’on veut de la décadence des temps qui courent, de l’enseignement qui fout le camp et de la perte du Sens du Sacré chez les enfants de cette drôle d’époque : je n’en ai rien à souder, parce que c’est faux.
Un Menuet d’un Anonyme joué par Anna, dix ans, avec un sourire de petit bodhisattva, au milieu d’un appart genre bohème artiste mais pas bordélique pour autant, après un repas de saveurs et une discussion enflammée d’abord (sur la pièce jouée ces jours par Denis Lavant, le pote de la Comédienne, où il est question de William Burroughs s’embarquant sur le radeau du Vieux Marin de Coleridge, à quoi la Comédienne n’a pas croché du tout) et ensuite super amicale, ponctuée d’irrésistible imitations d’animaux par l’Amie de la comédienne – tout ça et la beauté des choses et des gens refaisait surface dans notre chaos, comme elle refait surface à certains moments bouleversants de Lunar Park de Bret Easton Elis, quand les personnages naufragés qu’il y a dans ce livre se retrouvent sur un coin de radeau pour se dévisager avec tout ce qui leur reste de bribes d’amour.
Lorsque Bret et Jayne s’affrontent et se retrouvent durant leur thérapie de couple – chef-d’œuvre de psychologie dialoguée, soit dit en passant -, ou quand Bret croit enfin rejoindre son fils Robby avant le déchaînement des forces ténébreuses, il y a aussi de ces îles apparemment préservée de toute la saleté du monde, où ce que nous avons de pur et de bon trouve à s’exprimer.
A l’instant je le revis : Anna détaille chaque note avec gravité dans la nuit d’hiver. Dehors un renard file le long des voitures. Les mères qui m’entourent ont la même dégaine de babouchkas boucanées et bonnes. Le frère d’Anna, grand beau long garçon aux yeux et aux cheveux de berger afghan, nous a quittés quelque temps pour un casting, après quoi le revoici goûter au dessert de la Comédienne, genre crème à la turque, mélange de blanc battu et d’œufs en neige et d’eau-de-vie d’Arak. Un instant tout n’est plus qu’âme, ou disons qu’on se coule dans le corps du monde qui est un moule de beauté… -
Du nihilisme

De la seiche philosophique
Une mentalité m'a toujours révulsé, et c’est celle de la seiche philosophique. Rien à voir, cela va sans dire, avec la seiche animale, qui ne diffuse son encre que pour se défendre à bon droit.Or en quoi se distingue la seiche philosophique ? En cela que, plongée dans un bac d’eau claire, elle y diffuse un jet d’encre noire avant de déclarer qu’il n’y a pas plus noir que le monde dans lequel elle, seiche philosophique de malheur, a été plongée.
Il y a la seiche du tout est moche. Lui désignez-vous une chose belle, un paysage ou un tableau, un film ou un livre, qu’elle en relève aussitôt le défaut.
Il y a la seiche de rien ne vaut le coup qui, arguant que tout a été fait, ou que rien ne puisse plus advenir, n’a de cesse de ruiner tout projet et toute idée de projet, pour mieux se complaire dans son amer bocal.
Enfin il y a la seiche du tout est foutu, dont le goût du noir touche à l’absolu, le seule fait d’être au monde lui semblant la calamité d’origine.Or comment combattre la morne philosophie de la seiche ?
Je dirai simplement : en regardant la vie avec plus d’attention. A l’instant même je lis, d’ailleurs, dans ce beau livre qu’est Lunar Park de Bret Easton Ellis : « Tout ignorer est chose facile. Etre attentif est beaucoup plus difficile… » Et c’est cela même : l’attention est ce qui fait d’un écrivain le gardien du détail, que le nihiliste s’acharne à noyer. -
Retour au réel

De la poésie
A La Désirade, ce vendredi 9 décembre. – Je lis ceci : « Pluie de printemps/toute chose en devient/plus belle. » Des mots calligraphiés par Chyo-ni, une noble Japonaise du XVIIIe siècle. Puis je lis cela. «Un matin glacé /sur mon vélo/ j’admire les champs ». Les mots de Catherine Sancet, de la classe 6e B du collège Gérard-Philipe de Carquefou. Je viens de me lever dans la nuit glaciale et je lis Le soleil de l’après-midi de Constantin Cavafy. C’est l’histoire du type qui se rappelle la chambre dans laquelle il a aimé quelqu’un « tant de fois ». C’est d’une banalité crasse et pourtant, en lisant ce qui suit, tout à coup je me sens plus réel :
« Sont-ils encore quelque part, ces pauvres meubles ?
A côté de la fenêtre était le lit.
Le soleil de l’après-midi arrivait à la moitié. Un après-midi, à quatre heures, nous nous sommes séparés,
Rien que pour une semaine… Hélas,
Cette semaine-là devait durer toujours ».
Ah mais, il fait ce matin un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant :« Je ne suis rien.
Je ne serai jamais rien.
Je ne peux vouloir être rien.
A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde.
Fenêtre de ma chambre,
Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont
Personne ne sait qui il est
(Et si on le savait, que saurait-on ?),
Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,
Une rue inaccessible à toutes pensées,
Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres, Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,
Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien. »
Cela s’intitule Bureau de tabac et c’est de Fernando Pessoa, puis je lis ceci en me rappelant l’odeur de tout à l’heure de quelqu’un que j’aime et qui dort encore, sous la plume d’Anna Akhmatova :
«Les jours les plus sombres de l’année
Doivent s’éclairer
Je ne trouve pas de mots pour dire
La douceur de tes lèvres ».
C’est cela même : on ne trouve pas les mots du plus réel, mais la poésie est peut-être un peu de ça : plus de réel en peu de mots…
A lire ce matin : Henri Brunel, Sages ou fous les haïkus ? Calmann- Lévy, 2005.
D’autres astres, plus loin, épars ; poètes européens du XXe siècle choisis par Philippe Jaccottet. La Dogana, 2005.L'évier est une peinture de Lucian Freud
-
Question de conscience
 Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.
Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.En février 1958 parut, aux fameuses Editions de Minuit (issues de la Résistance), un petit livre terrible décrivant, faits précis et noms à l'appui, la pratique de la torture appliquée dans les commissariats et les prisons d'Algérie par les policiers et les militaires de la France démocratique. L'auteur de ce témoignage, Henri Alleg, se trouvait encore incarcéré, après avoir été torturé en juillet 1957. Lié à la cause de l'indépendance algérienne depuis ses jeunes années, membre du Parti communiste et directeur dès 1950 d'Alger républicain (où Albert Camus avait passé avant lui), Henri Alleg fut condamné à dix ans de prison pour «atteinte à la sûreté de l'Etat». Au péril de sa vie, il parvint néanmoins à transmettre à son avocat, sous forme de feuillets réduits en petits cubes, les pages de La question que son épouse Gilberte, chassée d'Algérie à Paris, dactylographiait à mesure. Dès sa parution, La question provoqua un débat virulent, exacerbé par son immédiate interdiction. Pour éclairer la destinée d'Henri Alleg, Mémoire algérienne , captivant récit paru récemment, retrace, de 1939 à l'indépendance, et au-delà, la saga d'un engagement existentiel et politique irréductible, certes marqué par la stricte observance communiste mais relevant finalement de l'absolue fidélité d'un homme qui a «payé» pour son idéal…
- Henri Alleg, quelle signification particulière revêt la création théâtrale, aujourd'hui à Lausanne, de La question?
- L'impact de ce livre est évidemment tout autre qu'à sa parution, à l'époque d'une guerre qu'on présentait comme celle de la civilisation contre la barbarie, dont mes révélations entachaient gravement l'image. L'ensemble de la presse a d'abord ignoré ou nié mon témoignage, avant que les plus grandes consciences de l'époque, de Sartre à Malraux, Mauriac ou Martin du Gard, ne prennent ma défense. Ensuite, il aura fallu quarante-cinq ans jusqu'à la reconnaissance des faits par les ordonnateurs de la torture, tels Massu et Aussaresse. Aujourd'hui, c'est le débat sur la torture d'une manière plus générale qui est relancé, notamment au moment où les Américains la réintroduisent par des voies détournées, quand ils ne visent pas à la légaliser. Je suis content, en outre, que cette adaptation défendue avec beaucoup de conviction et de talent par l'équipe réunie se fasse en Suisse, où j'ai retrouvé la liberté en 1961, après mon évasion de la prison de Rennes, et plus précisément à Lausanne, où La question fut réédité peu après son interdiction, à l'initiative de Nils Andersson.
- En tant que communiste, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que la torture, entre autres crimes, avait été commise au nom de votre idéal? Pensez-vous que celui-ci justifiait de tels «moyens»?
- Moralement et politiquement, je ne pense pas que la fin puisse jamais justifier les moyens. Lorsque nous étions en Algérie, nous nous préoccupions surtout des problèmes liés à la situation du pays. En ce qui me concerne, je ne savais pas, alors, ce qui se passait exactement en Union soviétique, qui restait un modèle à mes yeux. Par la suite, la révélation progressive des erreurs ou des crimes commis au nom du communisme n'a pas entamé l'idéal auquel je croyais et continue de croire. Cela étant, il ne faut pas se masquer la réalité: si nous voulons qu'une société plus juste advienne un jour, nous avons à étudier très précisément ce qui s'est passé pour en tirer les conséquences. Pour l'essentiel, je reste cependant fidèle à mes positions de jeune homme, n'ayant jamais désiré faire fortune ni exercer aucun pouvoir. En définitive, je n'ai jamais fait qu'aspirer à un monde plus fraternel, et cela me semble plus d'actualité que jamais, alors que l'inégalité, le chômage, la misère, l'absence de perspectives désespèrent tant de jeunes gens, comme on l'a vu tout récemment en France.
- Quels vœux faites-vous pour l'avenir de l'Algérie?
- Le combat pour l'indépendance de l'Algérie que nous avons mené ne se bornait pas à la conquête d'un drapeau, mais devait concrétiser les aspirations de nombreux autres pays colonisés. Nos espérances n'ont pas été satisfaites, la démocratie a été ruinée par des méthodes dictatoriales et le pays a été vidé d'une partie de ses meilleurs éléments, découragés par les conditions de vie, et saignés par dix ans de terrorisme. Quant à l'avenir, je ne le vois qu'avec le retour à la démocratie, contre le règne d'une minorité qui fait, si j'ose dire, son beurre sur le pétrole et le gaz…
»Vidy, La Passerelle. La question. Jusqu'au 18 décembre. Loc.: 021 619 45 45; www.vidy.ch
»Henri Alleg. Mémoire algérienne. Stock, 407 pp.
La question. Minuit, 111 pp.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 30 novembre
Photo de Patrick Martin
-
Retour à Gorki


En pensant à Tchékhov
A La Désirade, ce lundi 28 novembre. – Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque Staline fit rebaptiser sa ville natale, Nijni-Novgorod, de son nom, en pensant à son ami Tchékhov. Ainsi le jeune homme avait-il survécu sous la peau de crocodile du vieil « ingénieur des âmes » chambré par le Soviet suprême. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchékhov.
J’avais repris depuis quelques jours la lecture de Gorki, dont vient de paraître le premier volume des Oeuvres en Pléiade. Je m’étais rappelé ma lecture, une nuit à Sorrente, de la correspondance du jeune Gorki et de Tchékhov, où celui-là dit à peu près ceci au cher docteur : tout ce qui se fait aujourd’hui en Russie semble un raclement de bûches sur du papier de sac de patates à côté de ce que vous écrivez vous de tellement sensible et délicat. Je pestais contre mes putains de chaînes que mes mains glacées ne parvenaient pas à désentortiller dans la nuit plus russe que russe, et je pensais à Tchékhov, mon âme chantonnait tandis que le chien Fellow se tirait des lignes de neige en twistant comme un fol autour de moi, le rat ; et j’imaginais le docteur partant seul dans la nuit sur son traîneau, à l’appel d’un malade à dix verstes de là, et flûte pour ces putains de chaîne, me suis-je alors dit, je rentre à pied à l’isba, à peine trois verstes, ça me donnera le temps de penser à Tchékhov - et voilà que me revenait cette phrase d’Anton Pavlovitch au jeune Gorki : « On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part »… -
Du minimalisme

Dans le blanc du jour naissantA La Désirade, ce vendredi 25 novembre. –La neige était là tôt l’aube, la féerie de toujours mais ce matin plutôt comme une ombre blanche aux fenêtres - et justement je resongeais à ce monde apparemment réduit à rien du minimalisme qui peut relever aussi bien de l’impuissance créatrice que de l’ascèse poétique, comme dans les épures de Rothko, et je revoyais l’immensité apparemment vide de Gerry,le film de Gus Van Sant que j’ai regardé hier soir, juste après avoir repris la fin du roman de Jean-Jacques Nuel, Le nom, qui se risque lui aussi sur le fil du rasoir du vide apparent.
Il ne se passe à peu près rien dans Gerry où deux amis se perdent dans la vastitude infinie d’un paysage, mais ce désert est aussi vibrant de présence que celui dont parle Théodore Monod, et ce qui se passe, à peu près sans mots, entre les deux garçons, reste étrangement prenant. De la même façon, et malgré le paradoxe et le risque encouru par toute forme de « performance » littéraire, le roman de Jean-Jacques Nuel résiste à la vacuité et non seulement par la musique de l’écriture mais par tout ce qui filtre de la présence du romancier et de ce qui pour l’écrivain relève de l’essentiel, en deçà et par delà le nom qu’il écrit et réécrit comme un écolier sa première page de lettres copiées à la ronde ou, comme un saint au désert, ce qu’on appelle la prière du cœur, se bornant aux mêmes mots répétés à l’infini.
Or que dire de plus à propos de ces expériences-limites ? Peut-être ceci: qu’elles constituent des pointes qui s’émoussent à la moindre réitération complaisante. Ainsi le minimalisme devenu système, en peinture, sombre-t-il dans le dérisoire, de même que le maniérisme du rien en littérature, quand telle vie minuscule ou telle petite gorgée de bière se réduisent au must d’une mode…
Il y a des moments de présence intense dans Gerry, quand les garçons marchent au bord du ciel ou dans le sel éblouissant-assoiffant du désert, quand Gerry évoque ses royaumes imaginaires à côté du feu de nuit ou lorsque couchés, exténués, leurs corps se rapprochent, leurs mains se cherchent, leurs sentiments mêlés d’affection et de rage esquissent une lutte-étreinte les rejetant finalement dans leur solitude muette tandis que le ciel roule ses vagues bleues en accéléré - mais tiens, voici du bleu sur la neige justement, voici les détails de la vie, voici le monde émerger du blanc…
-
La poésie défie la Machine

Artaud sur la ToileA La Désirade, ce 24 novembre (soir) – J’avais repris les œuvres de l’énergumène pour lire de mes yeux les mots éclatés d’Artaud le Mômo, et j’ai lu « L’esprit ancré / vissé en moi / par la poussée psycho-lubrique / du ciel /est celui qui pense toute tentation / tout désir / toute inhibition », j’ai lu « o dedi / a dada orzoura / o dou zoura / a dada skizi », j’ai lu « o kaya / o kaya pontoura / o ponoura / a pena /poni », je me suis rappelé ces mots sortant des babines du grand bambin couillu babolant dans son corps tournoyant, au théâtre l’autre soir, et j’ai repris au vol « C’est la toile d’Araignée pentrale / la poile onoure / d’où–ou la voile, /la plaque anale d’anavou », et j’ai lu encore «(Tu ne lui enlèves rien, dieu / parce que c’est moi. Tu ne m’as jamais rien enlevé de cet ordre. /Je l’écris ici pour la première fois, /je le trouve pour la première fois », et j’ai noté ces mots : « Je l’écris ici pour la première fois/je le trouve pour la première fois », car c’est cela même Artaud pour moi, Comme Van Gogh ou comme Louis Soutter, tous trois foudroyés à consommer tout cru à pleine langue et les dents dans la viande des mots, d’ailleurs je zappais et lisais maintenant : « On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh qui, dans toute sa vie, ne s’est fait cuire qu’une main et n’a pas fait plus, pour le reste, que de se trancher une fois l’oreille gauche, dans un monde où on mage chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau-né flagellé et rage, te que cueilli à sa sortie du sexe maternel ».
Je lisais ces mots écrits à l’instant pour la première fois, puisque lus comme ça pour la première fois par moi, et je pensais à la Toile, poile onoure ou pentrale peu importe, mais à l’Araignée, et je voyais Artaud dans la Toile, le sceptre levé : « La pointe extrême du mysticisme, /je la tiens maintenant dans le réel et dans mon corps, /comme un balai de cabinets », me disant : qu’est-ce que cela change ?
Qu’est-ce que cela change Internet ? J’envoie à l’instant Louis Soutter sur l’Internet, il titube, il rouspète, mais il a ses plumes et son encre chourée au bureau de poste voisin (il y a encore des postes à la poque de la poile onoure ou pentrale) et mon compère Antonin (l’autre, l’ancien comédien lui aussi devenu nécrivain) qui m’écrit des SMS ou des Mails à chaque bouquin que je lui intime de lire me répond : sûr qu’Artaud le Mômo campe sur la toile - même qu’il y a son trou noir où ces mots flamboient : « L’intelligence est venue après la sottise/laquelle l’a toujours sodomisée de près – Et après »…
Et après il y avait l’objet à la pointe extrême du regard de Van Gogh, et téléphone ou pas, il y avait la douleur à la pointe extrême du regard de Louis Soutter, et fax laser ou pas il y a ce fou d’Artaud qui dit tout et le contraire de tout mais qui le dit et le vit et ce cri échappe à toute connivence de ma part ou de la tienne, il dit au flic du Dôme qui veut le copiner : « Pas de tutoiement, ni de copinage, / Jamais avec moi,/ pas plus dans la vie que dans la pensée », et ça c’est partout qu’il le dit, il n’y a qu’à lire, l’Internet n’est rien, les machines ne baisent pas le corps, c’est le corps qui baise l’esprit et l’esprit rend gorge : « Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas-côtés de foudre. La frange ténébreuse insolite du vide montant d’après l’éclair. Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile. Suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d’une suffocation d’en-haut. Et pourtant tout le tableau est riche. Riche, somptueux et calme le tableau »…
-
Le temps de la lecture

Une belle rencontre occulte aux Petites Fugues ; à propos de Quelle nuit sommes-nous ? de Hafid Aggoune.
A La Désirade, ce dimanche 20 novembre. – Il a fait un froid de loup, ces derniers jours par les hautes terres de Franche-Comté, où les rencontres chaleureuses se sont pourtant multipliées pour les dix-sept écrivains français et suisses invités à ces Rencontres littéraires itinérantes, de Montbéliard à Audincourt en passant par Poligny, Belfort, Dole et Les Fourgs, Arbois ou Champagnole, entre autres, où les uns et les autres ont fait escale dans telle bibliothèque ou tel centre culturel locaux. Ainsi suis-je allé, pour ma part, parler vendredi après-midi d’un de mes livres (Le maître des couleurs) au collège Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans, devant une classe plus à l’écoute qu’en veine de discussion, en dépit de l’attentive préparation de Marie-Agnès Pinault , et le soir, dans la froidure des Fourgs, évoquer les lectures de mes Passions partagées, à l’invite de la bibliothécaire Blandine Duquet, avant de participer, samedi après-midi à Besançon, à un débat sur la lecture (avec Agnès Desarthe, Emmanuel Adely et Mona Thomas) animé par Dominique Bondu, directeur de la manifestation, préludant à une assez éberluante performance de François Bon disant, de la voix et de tout le corps, accompagné par le violoniste Dominique Pifarely, des extraits de Pantagruel et du Quart Livre avec une intelligence physique du texte et des commentaire de la meilleure sauce.
La vraie rencontre pourtant, en ce qui me concerne ou plutôt les vraies rencontres ont été celles de Christophe Fourvel, qui m’a piloté de lieu en lieu et en qui j’ai découvert un lecteur complice (il a fait le voyage de Montevideo sur les traces d'Henri Calet) et un auteur (je reviendrai sur son dernier livre, où il évoque ses grandes émotions cinématographiques) et, cette nuit même, à mon réveil à cinq heures, dans notre chambre d’hôtel de Besançon aux matelas spartiates, celle, occulte, de Hafid Aggoune, par le truchement de son deuxième livre, Quelle nuit sommes-nous ?, commencé à fleur de sommeil et lu ensuite à haute voix (c’est ma moitié qui conduit toujours) sur la route du retour, enfin achevé dans la lumière retrouvée du lac.
Livre de lumière arrachée à la nuit, livre à la gloire du livre dont le protagoniste dit qu’il est le seul objet «plus grand que le monde », livre de révolte et d’amour, de fugue absolue et de vraie relation: nul autre ne pouvait m’arriver à meilleure heure, comme toutes ces rencontres inattendues et d’autant plus miraculeuses qui nous adviennent.
Seul regret alors: de ne l’avoir pas lu hier déjà, pour dire au public du Musée du Temps devant lequel nous évoquions nos passions de lecteurs, que ce livre d’un garçon de trente-trois ans méritait d'être lu toute affaire cessante, exprimant dans une langue extraordinairement limpide et musicale toute la colère pure devant l'aliénation et tout l’amour, toute la ferveur et tout le désespoir d’un jeune homme devant « cette longue nuit d’humanité » dans laquelle nous sommes tous à nous débattre avec, au cœur, comme une flamme dans la tempête, cette « petite phrase bouleversante au cœur d’un être » dont parle Max Dorra, autre rencontre pour moi décisive de ces derniers temps. Mais je reviendrai, au cœur de la nuit prochaine, à la sombre et non moins étincelante merveille que représente à mes yeux le livre de Hafid Aggoune…
-
Petites fugues

A La Désirade, ce vendredi 18 novembre. – Il fait nuit sur les monts tandis que l’hiver gagne. A la fenêtre là-bas scintillent, dans le noir où se distingue le contour du lac en ligne noire sur fond noir, le cliquetis-piquetis des lumières d’Evian. Et je lis sous la lampe ces mots d’Yves Leclair écrits de sa Chine pyrénéenne où la neige, dit-on, a déjà recouvert les hauteurs : « La table est vide sous le halo orange de l’ampoule. Profonde obscurité à l’entour : j’y vois plus clair ». Et comme je viens de m’éveiller et que le poète, lui, va se coucher, je lis ensuite ce qui suit comme un écho inverse : « Dernier éveil avant de plonger dans le sommeil : femme, un Dieu clair a laissé son sceau sur ta peau laiteuse comme un point final – un beau grain de beauté dans ta neige, tout près de ton geai bleu ».
Tout à l’heure, nous partirons pour Besançon où se déroulent les Petites Fugues, Rencontres littéraires itinérantes que je vais inaugurer, pour ma part, avec les enfants de Marie-Agnès Pinault, au collège Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans. Je m’en réjouis d’autant plus que ma nouvelle qu’ils ont étudiée, L’enfant du Nil, évoque un petit pharaon rencontré dans un obscur caveau de la Vallée des Rois, dont l’œil peint sur son sarcophage continue de scruter notre pauvre monde. Ce qu’attendant je relève encore ceci, dans le Manuel de contemplation en montagne d’Yves Leclair : « Cela fut pourtant un jour. Ce qui disparaît du langage disparaîtra aussi un jour. Mais c’est en coulant que l’eau retient le reflet des rives ».
Ce qu’attendant je relève encore ceci, dans le Manuel de contemplation en montagne d’Yves Leclair : « Cela fut pourtant un jour. Ce qui disparaît du langage disparaîtra aussi un jour. Mais c’est en coulant que l’eau retient le reflet des rives ».
Et cela enfin qui me remémore nos rêveries silencieuses au bord du Nil, cette année-là : « Pour quelques ombres perdues – nuées nocturnes dans la barque du vieux nautonier funèbre qui file sur le fleuve noir où la lune brille comme un nénuphar ».Yves Leclair. Manuel de contemplation en montagne. La Table Ronde 2005, 121p.
-
De la fugue

En lisant Max Dorra
A La Désirade, ce mardi 8 novembre. – On était morose, on était comme un vitrail dans la pénombre, et tout à coup il s’est passé quelque chose, la lumière s’est faite dans le vitrail, on a changé d’humeur en voyant ce qu’il y avait là : cette mer de brouillard ce matin, les montagnes enneigées, le ciel rose et gris, le fumet du café, nom de Dieu je vis.
Ce que le Mac de Max Dorra compute en ces termes : « Une petite phrase, un jour, un fragment d’avenir, s’est trouvée incarcérée dans une partititon. Pour s’en échapper, elle a tout misé sur sa différence. Longtemps elle a semblé imiter, répéter. Progressivement, pourtant, elle s’affirmait. Nourrie de mémoire, elle en faisait un devenir. La fugue raconte cette histoire singulière. Un contrepoint de l’actuel et du virtuel. Et qui défie la mort, et qui fait reculer l’angoisse, ce passé déguisé »
Scriabine ajoutant: « La pierre et le rêve sont fait de la même substance et sont aussi réels l’un que l’autre ». -
De la reconnaissance
En lisant Max Dorra
Dans le TVG, ce mercredi 26 octobre. - La Côte d’or n’a jamais si bien porté son nom qu’en cette fin de matinée d’automne aux irradiants flamboiements, et c’est comme un visage que je reconnais tout en reprenant la lecture amorcée ce matin d’un livre abordant immédiatement ce phénomène de la reconnaissance, au multiple sens du terme, d’un paysage, d’un visage ou de quelque image retrouvée de notre bloc d’enfance, petite musique ou picturale odeur de cage d’escalier où des fantômes montent au ciel de notre mémoire comme à l’échelle de Jacob, du côté de Proust, de F eud et de Spinoza.
eud et de Spinoza.
Je sais toujours ce que j’ai à faire du côté de Proust, surtout en TGV descendant sur Paris, avec l’idée qu’en glissant plus bas je verrai Chartres et plus bas sous le nuages tendres l’église là-bas aux vitraux mythiques, et je saurai proche la Vivonne, mais Freud et Spinoza : moi pas savoir.
Or ce matin Max Dorra m’y emmène, et là encore il est question de « retrouver la force d’exister » chez ceux qu’a menacés l’écrasement, le déni et l’excommunication.
Dans le TGV il y a plein d’hommes-machines qui crépitent de formules. Un voisin disait tout à l’heure à son compère qu’il fallait gérer l’historique de l’Entreprise ou mourir.
Ne préfère-t-on pas mourir dans ces cas-là, en écoutant un peu de musique.
Ah oui : le livre s’intitule : Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être ? paru dans la collection Connaissance de l’inconscient de Gallimard.
Or j’ai comme l’impression que je vais en parler ici et en reparler… -
Le roman d'un romancier
En lisant Le Maître de Colm Toibin

A La Désirade, ce lundi 17 octobre. – Le brouillard venait d’arriver à nos fenêtres cet après-midi, noyant tout à coup le feuillage flamboyant des arbres alentour, lorsque j’ai commencé de m’enfoncer dans la brume mélancolique de ce grand roman de Colm Toibin tout plein de la présence à la fois douce et réservée, infiniment poreuse sous ses airs compassés, de l’Henry James des dernières années, à partir de la terrible humiliation qu’a représenté le fiasco de Guy Domville, sa pièce présentée à Londres en janvier 1895, et jusqu’à l’automne 1899.
Or il suffit d’en lire quelques pages pour se trouver littéralement immergé dans la substance sensible d’une vie qu’on sent à la fois empêchée et faite pour être aussitôt transformée en roman, chaque vide donnant un plein et chaque douleur un exorcisme de fiction. Avant le désastre du théâtre St James, où sa pièce est huée par le public alors même qu’il assiste, au Haymarket voisin, au triomphe du Mari idéal d’Oscar Wilde, Henry James se rappelle un épisode de ses jeunes années qui lance le leitmotiv, courant à travers tout le roman, de son penchant homosexuel aussi lancinant que refoulé, recoupant ensuite les thèmes de l'enfant mystérieux (dont sortiront Le tour d’écrou et Ce que savait Maisie) et de l'être hyperdoué mais incapable de vivre, avec le récit des délires et de la fin tragique de sa sœur Alice.
Bien plus qu’un roman biographique, Le Maître est le roman du romancier-médium par excellence, que l’auteur fait revivre avec un mélange de profonde empathie et d'intelligence re-créatrice, qui établit d'admirables liaisons entre une vie et ses projections compulsives et nous vaut de très beaux portraits. Le regard de l’Américain sur l’Angleterre plastronnant en Irlande, le sentiment de l’homme de cœur démocrate que sa fortune personnelle n’empêche pas de compatir avec les miséreux de sa terre d’origine, la curiosité obsessionnelle du romancier à l’égard des tribulations d’Oscar Wilde (jeté en prison peu après qu’il lui a ravi la vedette), son besoin d’exorciser ses hantises par de nouveaux romans, tout cela forme une substance vivante et vibrante qui rappelle la somptueuse musique crépusculaire des Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro, en plus ample et en plus pénétrant aussi. Je n’en suis à l’instant qu’à la fin du premier quart, mais ce Maître fait montre en effet d’une impressionnante maestria… -
La Cadillac de granit
De la violence en nous

A La Désirade, ce lundi 10 octobre. – J'ai été réveillé, cette nuit, par un cauchemar glaçant. Une Cadillac de granit, aux roues à jantes de luxe diffusant une espèce de neige carbonique, arrivait du bout de l’allée de l'ancienne maison du réalisateur italien que nous squattions en notre adolescence. Peu après s’être immobilisé, le véhicule s’en retournait lentement , et tout à coup un chien, du type berger allemand, mais de la taille d’un tigre, tombait du toit tandis qu'un jeune type en jeans, porteur d'un couteau, s’éloignait derrière la maison, l’air menaçant.
Aussitôt je me suis rappelé le contrat lancé contre moi par je ne sais plus qui, ni pour quel motif, dans un autre rêve, et du coup je me suis retrouvé, soudain, dans l’état de panique mentale et de sueurs froides où m’a plongé, des années durant, le rêve du meurtre dont je me suis rendu coupable, à la fin des années 60, sur la personne du jeune assassin à gueule d'ange du proprio chinois du bar Le Shangaï, à Lausanne-City.Or je vois à l’instant, trois heures du matin, ce couteau suspendu entre l'assasin et moi, celui-là même de la nouvelle intitulée L’irréparable, dans le nouveau recueil d’Anne-Lou Steininger, Les contes des jours volés, qui traite justement de la violence en nous et des frères ennemis qui se vouent, en notre for secret, tout l’amour-haine de Dieu sait quelle préhistoire des pulsions…
-
Contre l'exclusivisme
De
 s imprécateurs et de la nuance, de l'intimité et de la femme
s imprécateurs et de la nuance, de l'intimité et de la femmeA La Désirade, ce samedi 8 octobre. – Les montagnes de Savoie ont ce matin un extraordinaire relief , alors que l’oblique lumière d’automne éclaire chaque détail des deux rives, du port de Clarens à celui de Saint-Gingolph en face, avec une netteté qui cisèle aussi la fine dentelle des feuillages d’or rouillé et souligne les verts encore intenses du val suspendu que nous surplombons de notre balcon en lisière de forêt.
Or contemplant cette image tissée de temps et me rappelant ce que dit Michel Serres des multiples temps, justement, qui tissent un paysage, je me suis retrouvé dans un état de silencieuse songerie qui me remplit à la fois de reconnaissance et me conforte dans la conviction que ce tissage quotidien de tous les temps du Grand Récit de la nature ou de l’Histoire (le château médiéval de Chillon jouxtant là-bas le viaduc de l’autoroute), des vies singulières des braves gens qui vaquent alentour, et de nous aussi, de nos enfants qui s’en vont pour en amener peut-être d’autres au monde, du chien Fellow et de la mésange Zoé, enfin des dizaines de milliers de livres dont les voix bruissent autour de nous, constitue à la fois le livre du jour et le nuancier approprié à l’écriture ou à la peinture du jour.
En repensant aux intempestifs et aux péremptoires que j’ai lus (ou relus) ces derniers jours, de Houellebecq à Joseph de Maistre et de Dantec à Léon Bloy, je me suis dit que c’est cela qui me manquait chez ceux-là : le détail et la nuance, ou plus encore : l’intimité. Des imprécateurs que je connaisse, seul Vassily Rozanov allie, avec son génie de l’immédiateté saisie dans l’instant, l’Idée et le Sentiment ; la Passion et la Compassion - et la femme est toujours proche chez l’auteur de Feuilles tombées, incarnation même de l’intimité.
Dantec s’en prend souvent et violemment, dans Le théâtre des opérations, - dont le titre guerrier annonce la démarche, et qui me passionne sans me convaincre toujours -, au nombrilisme de la littérature française actuelle. Je partage en partie son point de vue, mais en partie seulement, car la réalité est mille fois plus riche et nuancée, autant que le paysage de ce matin, comme est plus riche et nuancée la littérature anglo-saxonne contemporaine, qu’il réduit à peu près au roman « pop » des Burroughs, Dick, DonDeLillo et Ballard.
J’aime que la littérature française oppose le fulminant Léon Bloy et les non moins tonitruants Tailhade ou Vallès, conformément au dualisme propre au pays de Descartes, mais j’aime aussi me rappeler une bonne conversation avec François Cheng qui me faisait l’éloge du regard tiers, et voici le paysan parisien Marcel Aymé ou le docteur Anton Pavlovitch Tchekhov, ou ce maître de toutes les nuances nettement dessinées que figure à mes yeux William Trevor, pour s’inscrire en faux contre tel esprit binaire et réducteur, tel froid de tels discours.
Dominique de Roux me disait un jour qu’une femme, ayant engendré, ne pouvait être dupe de certain langage exclusiviste et absolutiste, et il savait de quoi il parlait… De la même façon, Vladimir Volkoff me confia sa conviction qu’un bon roman était celui-là seul dont les femmes existent. Pathétique aveu, soit dit en passant, de la part d’un romancier super-mec dont aucun personnage féminin n’a de réelle épaisseur… Bref, je ne prône pas l’enjuponnement de la littérature, mais je me rappelle quelques vérités, ou ce que je tiens pour telles, apprise au fil de la vie et, depuis vingt ans et des poussières, auprès de ma bonne amie... -
Une écriture à venir
A propos du style de Dantec et d'Houellebecq


A La Désirade, ce mercredi 5 octobre. – Maurice G. Dantec est-il encore un écrivain français ? Je me le suis demandé, en lisant Cosmos Incorporated, alors que je ne cesse de compulser le Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, qui rend compte d’un certain goût, correspondant à une certaine société, laquelle ne me semble pas concevoir que la littérature française puisse, par exemple, recourir à un genre tel que la science fiction. Preuve en est l’article fameux qu’a consacré M. Angelo Rinaldi, académicien et ponte du Figaro littéraire, à La possibilité d'une île de Michel Houellebecq, pour lequel « le recours à la science-fiction est déjà un signe de faillite chez un romancier »...
Jules Verne, de son vivant, fut plus que snobé selon les mêmes critères de la « bonne » et de la « mauvaise » littérature, et le genre, comme le policier, continue d’être ostracisé en France, où un Simenon reste « classé polar» alors qu’il est lu dans le monde entier comme un romancier à part entière. Mais à propos : Dantec est-il un auteur de science fiction ?
Il l’est par ses curiosités et ses hantises physiques et métaphysiques, comme Dick ou Spinrad, Bradbury ou Orwell le sont, exclusivement ou incidemment, mais ce qui échappe évidemment à M. Rinaldi est que la matière traitée par Dantec, autant que celle que transfigure Proust, suppose une transmutation qui ne se limite en rien, dans Cosmos incorporated, à un bon roman de SF tel que le représente Forteresse de mon excellent compatriote Georges Panchard. Dantec use de la SF pour une cause plus profonde et plus folle, qui tient à la fois à une révolte et à un pari de langage. Ce que fait Dantec, dans Cosmos incorporated, avec tout le matériau recueilli et l'effort d'interprétation qui transforment notre rapport à la « création » et au « langage », à l’intrigue romanesque et à ses personnages, est sans équivalent…
A la décharge de M. Rinaldi de l’Académie et du Figaro, je dois avouer que je n'ai découvert que peu de vrais grands auteurs, en SF, si l’on excepte les visionnaires médiévaux à la Lovecraft, les contre-utopistes à la Orwell/Zamiatine/Huxley, les chamans déjantés à la Burroughs/Dick ou les ingénieurs futuribles à la Frank Herbert/Greg Egan. Dans notre langue, c’est à vrai dire bien pire : non seulement les vrais créateurs de SF sont rares, mais les sourciers de langage, style Rabelais/Flaubert/Proust/Céline y sont positivement inexistants, tant dans le roman policier que dans la science fiction ou le fantastique. Houellebecq, pas plus que Dantec, ne font exception dans cette lignée française.
Pourtant Houellebecq et Dantec sont de vrais écrivains, me semble-t-il, qui annoncent quelque chose de nouveau. Tous deux rompent avec la société littéraire française que prolonge Charles Dantzig avec son brio, mais qui me semble en fin de course. L’Académie Goncourt existera-t-elle encore dans vingt ans ? J’en doute fort. Et la confortable référence française qu’incarnent encore François Nourisson ou Jean d’Ormessier tiendra-t-elle dans dix ans ? Hélas la chair flageole, tandis que nos deux intempestifs sont en phase de rajeunissement : Houellebecq commence d’en prendre conscience, qui parle maintenant de style tout en se défendant d’être un story-teller , et Dantec mène sa guerre en chevalier solitaire du Sens retrouvé.
Il faut lire Le théâtre des opérations de Dantec pour évaluer la formidable santé de cet écrivain. Dans ce journal d’une densité sans pareille, l'exilé quadragénaire shooté au Temesta et lisant vingt nuit d’affilée pour en tirer d’incroyables synthèses de lecture, se révèle un classique-réaliste d’une netteté parfaite, dont le style est un sabre, sans exclure de lyriques visions du ciel de Montréal ou des femmes à bicyclettes, de sa fille ou de tout ce qui reste son jardin privé, qu’il évoque avec autant de cœur que de pudeur. Ce qu’il observe de la guerre balkanique ou de la faiblesse de l’Europe, est d'un Défenseur, selon la terminologie de Chesterton: un homme de bonne volonté. Dans ses romans, c’est autre chose : mais comme chez Houellebecq, on sent chez Dantec une énergie et une rapidité qui échappent aux normes de cette « bonne littérature » que nous apprécions assurément tous tant que nous sommes, qui va de Pierre Quignon à Pascal Michard…
La question que je pose n’est en rien périphérique : plutôt elle interroge toutes les périphéries. Dantec stigmatise superbement la faillite de l’Europe des cultures et des visions additionnées, mais aussi de la force affirmée (en 1999) et d’un projet fondé sur des siècles d’expérience. Or, en 1999, Mitterrand pensait attribuer une chaire d’astrologie à Elisabeth Teyssier…
Dantec, dans Cosmos incorporated, parle une langue apparemmen inaccessible à M. Rinaldi de l’Académie et du Figaro, campant sur une conception référentielle et centraliste, hautaine voire exclusive de la littérature de langue française, et pourtant cette écriture cristallise une nouvelle vision de la réalité, dont il émane sens et beauté. Il y a là quelque chose qui va au-delà du « beau style », mais comment ne pas voir qu'une écriture sans frontières se fait jour ? -
Une passion partagée
Au lecteur, amie, ami, de ce blog

A La Désirade, ce samedi 1er octobre. – Il y a quatre mois que j’ai ouvert ce blog, sans trop savoir ce que je faisais. Cité dans La République des Livres par Pierre Assouline à propos du Passe-Muraille, le journal littéraire que quelques amis et moi publions à Lausanne, j’ai découvert ce nouveau moyen de communication et me suis aperçu, moi qui suis archinul en technique, que c’était un jeu d’enfant, gratuit qui plus est, de créer son blog dans une structure organisée à cet effet, en l’occurrence le domaine HautEtFort de BlogSpirit. Comme je me trouvais, alors, en train de transférer mes nombreuses archives (des milliers d’articles et de nombreux textes personnels publiés ou inédits) d’un ordinateur sur un autre, je me suis dit que certains écrits pouvaient intéresser encore des amateurs de littérature éparpillés aux quatre vents et ne lisant pas les journaux où je sévis. En outre, et surtout, ce vecteur me permettait de prolonger d’une nouvelle façon les carnets que je tiens tous les jours et dont j’ai publié déjà deux tranches de 500 pages, L’Ambassade du papillon en 2000 et Les Passions partagées en 2004. De moins en moins intimes, achoppant plutôt à mes lectures quotidiennes, à mes interrogations, à mes rencontres et multiples expériences, ces carnets pouvaient se vivre, sur un blog, dans une immédiateté qui correspond en partie à l’idée que je me fais de la littérature, non du tout d’un bavardage envahissant à propos de n’importe quoi mais d’une ressaisie dans l’instant de ce que Peter Handke disait la « sensation vraie », et que l’écrivain russe Vassily Rozanov pratiquait en notant ce qu’il ressentait, au besoin, sur une semelle de savate ou sur un billet d’autobus, sans fioritures ni retouches « sous la chandelle ».
Or je me suis pris au jeu de cet exercice quasi quotidien, que j’essaie de tenir à égale distance du clabaudage salonard et de la rumination autiste. La participation, il y a quelques années de ça, à un Forum littéraire sur Hotmail, m’a fait découvrir les écueils de ces échanges plus ou moins masqués, où les discussions tournent souvent à l’aigre ou au malentendu, avec des jeux de pouvoir ou des embrouilles psychologiques assez vite lassants.
Ce qui m’a encouragé à continuer, c’est le crescendo des visites faites à ce blog, soit un peu moins de 1000 à fin juin et un peu plus de 7000 à fin septembre, cela représentant à peu près 250 à 300 lecteurs quotidiens qui passent parfois des heures en « ma » compagnie. Je présume que ces chiffres sont dérisoires par rapport à d’autres sites, mais cela m’est complètement égal : je n’y pense même pas, sinon pour ce fait que cet embryon de public m’engage et, parfois, me répond. C’est un atout à mon sens capital du blog que son ouverture à l'échange. La tchatche ne m’intéresse guère, une fois encore, mais c’est par ce blog que j’ai rencontré Bruno, 17 ans, qui a publié son premier (et superbe) article dans Le Passe-Muraille, c’est par la communauté Littérature que j’ai découvert de vrais lecteurs éparpillés de Paris à Bergerac ou de Saint Julien en Genevois à Lausanne, du Pays d’Enhaut au Québec ou à Calgary, entre autres multiples zones, et je ne sais rien de plus vivifiant que d’entendre le moindre écho vivant dans l’océan d’indifférence et de blasement des temps qui courent…
Autant dire que je vous remercie, lecteurs occultes, amis de la nuit et du jour qui partagez ma passion de lire… -
Petites aubes d'enfance

Du cirque d'automne et de Thomas Wolfe
A La Désirade, ce jeudi 29 septembre. – Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’on la trouve dans l’une des nouvelles de From Death to Morning (De la mort au matin), sous le titre de Circus at Dawn et commençant ainsi : « Thre were times in early autumn – in September – when the greater circuses would come to town – The Ringling Brothers, Robinson’s, and Barnum and Bailey shows, and when I was a route-boy on the morning paper, on those mornings when the circus would be coming in I would rush madly through my route in the cool and thrilling darkness that comes just before break of day, and then I would go back home and get my brother out of bed. »
Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge : « Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die… »
L’arrivée des éléphants, ce matin, au milieu des voitures bloquées, n’avait rien de cette magie crépusculaire ni de cette grandeur muette du silence matinal, mais la présence d’une petite troupe d’enfants escortant les sept sages m’a fait sourire à l’idée que, dans une trentaine ou une quarantaine d’années, cette matinée revivrait peut-être dans quelques mémoires comme un moment sauvé de la grisaille des jours… -
Eloge de la force douce
A l'école du chien Fellow

A La Désirade, ce samedi 24 septembre. - Que pense le chien Fellow du Grand Djihad ? Estime-t-il que cette conjecture de Maurice G. Dantec, dans Cosmos incorporated, ait plus de consistance que celle des hordes chinoises déboulant sur les collines de Meudon telle que la prophétisait Céline ? Je me le demande, en cette matinée radieuse de votations démocratiques sur la libre circulation des personnes, comme je me l’étais demandé déjà en lisant Forteresse de Georges Panchard, où il était déjà question de la dévastation de l’Europe par une nouvelle croisade islamiste. Tout cela, cher Fellow, ne relève-t-il pas du fantasme délirant ?
Le premier enseignement du chien Fellow, au lendemain de son entrée dans notre maison, a été de me rappeler la force de la douceur, retenant la main qui frappe. Nous étions en balade dans les bois, je l’avais rappelé trois fois, il n’avait pas obéi, gamin qu’il était encore, donc je le frappai de ma canne ferrée lorsqu’il revint penaud, et alors il me fit cet œil noir: on ne frappe pas le chien Fellow, disait cet œil. Sur quoi l’animal se ferma à toute négociation jusqu’au coucher, me réservant visiblement un chien de sa chienne. Le lendemain matin, aux aubes, une merde m’attendait au milieu de mon atelier, et Fellow assis sur ses pattes me toisait avec ce message triomphal dans son regard de scottish ressentimental : « Je t’emmerde ». C’était l’époque de la fin de la guerre balkanique, après les tueries de Bosnie et avant celles du Kosovo. Mes amis serbes me taxaient de fiote angélique, et moi je les emmerdais, prêt en somme à m’entendre avec Fellow. Mais que pense donc Fellow du Grand Djihad ?
A l’instant Fellow reluque la mésange Zoé qui lui picore ses croûtons, tandis que je lis Du Jihad à la Fitna de Gilles Kepel, dont notre fille, étudiante en littératures espagnole et arabe, revenue de Damas ces derniers jours, m’a déchiffré l’inscription de couverture : « Il n’y a Dieu que Dieu, Mohammed est son prophète ».
Aux dernières nouvelles, notre enfant semble moins que jamais sur la voie de porter le voile, mais c’est en somme à l’école de Fellow qu’elle a appris elle aussi la force de la douceur: connaître pour mieux comprendre. Or que dit Gilles Kepel ?
Qu’il y a Jihad et Jihad. Que l'étymologie arabe du terme signifie effort, et d’abord dans la réalisation de la perfection individuelle. La dimension positive du jihad réside ainsi en cela qu’il « permet de se dépasser en tendant vers le Bien ». Comme on le sait cependant, cet effort implique aussi visée sociale, étatique, militaire et guerrière « pour étendre l’emprise de l’islam ». Or cette expansion est marquée dès l'origine par un conflit interne, désigné par le terme de fitna, ou discorde, désignant plus précisément la guerre à l’intérieur de l’islam dès le schisme entre sunnites et chiites. Rappelant les composantes spécifiques de l’expansion de l’islam, Gille Kepel en illustre à la fois la dynamique, soumise à l’autorité des oulémas, et - fait nouveau et déterminant selon lui -, la transformation récente de cette instance de contrôle et de décision.« Le droit et la logique du déclenchement du jihad ont été déstabilisés par la révolution de l’information et c’est là ce qui va nous amener à la situation d’excès, de désordre, de terrorisme, que l’on connaît aujourd’hui ». Et de montrer ensuite comment, niant l’histoire, les jihadistes contemporains s’efforcent de rejouer la geste du prophète en s’appuyant sur Internet «qui abolit l’histoire et l’espace ». C’est dans les années 80, lors de la défaite de l’URSS en Afghanistan, que Gilles Kepel situe ce « bouleversement complet à proclamer le jihad », alors que commençaient de proliférer les guérillas-jihads initialement soutenues par les USA et qui se retourneraient bientôt contre ceux-ci.
Ce que montre ensuite Kepel, à la lumière des événements d’Algérie notamment, c’est comment la société civile s’est désolidarisée des jihads des années 1990. A propos de cet échec, il cite le grand idéologue d’al-Qaida, l’Egyptien Ayman Al-Zawahiri, lié à l’assasinat de Sadate puis devenu compagnon de Ben Laden en Afghanistan, qui publia en décembre 2001 un pamphlet dans un quotidien arabe de Londres où il affirmait : « Nous avons échoué à mobiliser les masses, nous n’avons pas réussi à faire comprendre notre mesage, les masses se sont détournées de nous et il faut que nous les réveillions par des opérations spectaculaires », ce qu’il appelle des « opérations martyres ».
Celles-ci suffiront-elles à déclencher le Grand Djihad que prophétise Maurice G. Dantec dans Cosmos incorporated ? Je discerne un doute dans l’œil du chien Fellow. Va-t-on aujourd’hui, en Irak, vers un jihad qui va mobiliser les masses comme l’espère Zawahiri ? Ou bien est-ce ceux qui sont contre ce jihad, jugé comme relevant de la fitna, qui mobiliseront les sociétés civiles contre les fauteurs de violence ?
Le chien Fellow se retient de se jeter sur la mésange Zoé, mais c’est avec une détermination guerrière que je vais me lancer, tout soudain, dans mon projet d’extermination des dernières berces du Caucase au lait venimeux qui prolifèrent le long de notre chemin de pacifistes. Sus à l’envahisseur !
Gilles Kepel. Du Jihad à la Fitna. Bayard, 2005.
-
Lectures croisées
A propos de Chestov, Witkiewicz, Dantec et Larbaud...

A La Désirade, ce mercredi 22 septembre. – « C’est un grand art, écrivait Léon Chestov à ses filles, un art difficile, que de savoir se garder de l’exclusivisme vers lequel nous sommes inconsciemment entraînés par notre langage et même par notre pensée éduquée par le langage. C’est pourquoi on ne peut se limiter à un seul écrivain. Il faut toujours garder les yeux ouverts. Il y a la mort et ses horreurs. Il y a la vie et ses beautés. Souvenez-vous de ce que nous avons vu à Athènes, souvenez-vous de la Méditerranée, de ce que nous avons vu lors de nos excursions en montagne, ou encore au musée du Louvre. La beauté est aussi une source de révélation ».

C’est à propos des deux Tolstöi, du romancier brassant la vie à pleine mains dans Guerre et paix, et de l’auteur de La mort d’Ivan Illitch, marqué par le jugement radical qu’un bourgeois jouisseur porte sur sa vie au moment de la perdre, que Chestov met en rapport les « révélations de la mort » et tout ce que nous avons reçu de la vie.
Or je pensais à cela ce matin en lisant simultanément Sur la balance de Job de Chestov (qui contient précisément l’insondable méditation du penseur sur Dostoïevski révélé à lui-même à l’instant précédant son exécution, soudain différée, et sur le dernier Tolstoï, dans Les révélations de la mort), les poèmes d'A.O. Barnabooth de Valéry Larbaud, les premières pages de L’inassouvissement de S.I. Witkiewicz et celles de Cosmos incorporated de Maurice G. Dantec.
A propos de ces deux derniers, cette lecture rapprochée m’a fait entrevoir tout à coup cette évidence : que tous deux, tous deux mégalomanes et catastrophistes, sont hantés par l’ambition folle de tout dire. Witkiewicz, plus artiste et plus cultivé à l’ancienne, est sans doute celui des contre-utopistes du début du XXe siècle qui a le plus génialement préfiguré notre époque de fuite dans le bien-être et cette folie généralisée que représente la norme actuelle, en englobant conversations essentielles et observations perso-collectives dans tous les domaines de la sexualité ou des révolution sociales, de la politique locale et mondiale, avec la montée des totalitarismes et la fuite dans les sectes religieuses – or on était en 1925. A l’autre bout du siècle, l’ambition de Dantec se veut plus scientifique et paramystique, sa mélancolie est d’un autre ordre que celle de Witkacy, mais le début de Cosmos incorporated impos e une vision que je suis impatient de voir se déployer…
e une vision que je suis impatient de voir se déployer…A côté de cela, les grâces de Barnabooth n’ont-elles pas quelque chose de suranné et de futile ? Absolument pas. Larbaud est aussi "sérieux", à sa façon, que le fulminant Dantec à dégaine de prophète punk; et là je rejoins Chestov qui nous rappelle que la littérature n’est « exclusive » que pour les niais ou les hystériques se jetant au feu pour UN poète ou pour UN philosophe.
Mais non, et je donnerais bien des pages graves pour ces trois vers de Centomani, dans les poésies de A.O. Barnabooth où, évoquant la course des « lents et lourds et noirs express Naples-Tarente » le voyageur se remémore cette vision :
« Il y a une maison de paysan, en ruines,
Inhabitée, sur un des murs on a écrit
En français, ces mots peut-être ironiques : Grand Hôtel.
La prairie, à l’entour, est pâle est grise ».
Et le poète de murmurer encore :
« On a dit que l’endroit était nommé centomani.
J’y suis venu souvent, pendant l’été 1903.
C’est une partie de ma vie que j’ai passée là,
Oubliée, perdue à jamais…
Arbres, ruines, talus, roseaux du Basento,
Ô paysage neutre et à peine mélancolique,
Que n’eûtes-vous cent mains pour barrer la route
A l’homme que j’étais et que je ne serai plus ? » -
Une peinture vivifiante
 Découverte de Carl L
Découverte de Carl L
 iner
inerA La Désirade, ce samedi 17 septembre. – On se sentait un peu mourir sous le ciel bas de ces derniers jours, et nous nous demandions un peu ce que nous étions venus faire dans la station friquée et policée de Gstaad, lorsque, entrant dans la galerie hyperchic des Lovers of Fine Arts, nous avons découvert une vingtaine de toiles et
 d’aquarelles de Carl Liner, la plupart des paysages de montagne ou de Provence - et tout à coup le monde se remettait à jubiler dans un concert de couleurs et de visions tenues ensemble par un artiste de haute volée, quelque part entre le dernier Hodler et les expressionnistes nordiques à la Nolde ou à la Munch, en plus radieux, pas loin non plus d’un Gimmi ou d’un Giovanni Giacometti, ces autres coloristes lyriques de nos hautes terres.
d’aquarelles de Carl Liner, la plupart des paysages de montagne ou de Provence - et tout à coup le monde se remettait à jubiler dans un concert de couleurs et de visions tenues ensemble par un artiste de haute volée, quelque part entre le dernier Hodler et les expressionnistes nordiques à la Nolde ou à la Munch, en plus radieux, pas loin non plus d’un Gimmi ou d’un Giovanni Giacometti, ces autres coloristes lyriques de nos hautes terres.
Je retarde évidemment puisque Carl Liner (1914-1997) a déjà son musée en Appenzell et se trouve tellement coté que je ne pourrais me payer la moindre de ses aquarelles – ce que je volerais le plus volontiers de ses pièces exposées à Gstaad, mais voilà : l’important est que cela soit et que notre regard en soit revivifié… -
L'île possible du présent
De Houellebecq en Dantzig
A La Désirade, ce mercredi 7 septembre. – Je reviens « à moi ». Après sept jours passés à la lecture de La possibilité d’une île, je reviens « à moi » ce qui signifie : à ma propre perception de la réalité. Je suis certes content d’avoir lu le livre de Michel Houellebecq à fond, parce qu’il le mérite, mais si j’estime ce livre important pour l’époque, et que je reconnais qu’il m’a captivé, j’éprouve à présent le besoin de revenir à ma façon naturelle d’aimer et, revenant « à moi », je reviens au vrai partage d’une passion que m’offre, si généreusement, le Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig dont j’ai relu ce matin les rubriques consacrées au mots Âme, Amour
 et Amers grincheux.
et Amers grincheux.
C’est un peu comme au jardin zoologique . On regarde un moment l’ornithorynque. Il est intéressant. Vraiment un drôle de cocktail, cet Arcimboldo animal, puis on retourne à l’otarie faisant la folle dans la cascade ou au lion pensif à plat ventre dans sa crinière de philosophe du XIXe finissant.
. On regarde un moment l’ornithorynque. Il est intéressant. Vraiment un drôle de cocktail, cet Arcimboldo animal, puis on retourne à l’otarie faisant la folle dans la cascade ou au lion pensif à plat ventre dans sa crinière de philosophe du XIXe finissant.
Houellebecq radote à propos de Nabokov, comme Nabokov a radoté à propos de Faulkner ou de Dostoïevski, mais c’est la loi du jardin zoologique : le lamantin ne saurait même concevoir l’oiseau de paradis, ni celui-ci se figurer la possibilité d’un gnou sur une île flottante, tandis que nous passons d’une cage à l’autre, Charles Dantzig et ses amis, en devisant tranquillement.
Voici ce que dit Dantzig du mot Âme dont les poètes font leur bonnet même en été : « Âme est un mot simple, dont on ne se méfie pas à cause de sa simplicité, au contraire des célèbres mots en « ismes » dont le monde se méfie à cause de ce tatouage à la cheville qui siffle : « Attention, notion ! »
Et ceci encore de si juste : « Âme révèle souvent l’orgueil insensé d’écrivains qui se proclament humbles, comme Villiers de l’Isle-Adam qui écrit : « Je n’écris que pour les personnes atteintes d’âme » (Fragments divers). Et cela encore : « Certains écrivains emploient ces mots comme les femmes qui vont au marché avec tous leurs bijoux ».
Ensuite Dantzig , à propos d’Amers et grincheux, multiplie les constats d’une fusillante pertinence. « La moitié de la gloire de Baudelaire vient, non de ses grands vers, mais de ce qu’il n’est jamais content. L’amertume plaît aux auteurs, en ce qu’elle réfute leur responsabilité, aux lecteurs en ce qu’elle justifie leurs rancoeurs. » Ensuite à Cioran qu’il appelle « l’amer en chef », il reproche d’employer la langue française « avec un vocabulaire d’étudiant en sociologie » qui abuse des points de suspension, ce qui fait de lui « un moraliste distendu ». Et de conclure : « Un moraliste devrait assumer sa posture de tueur méprisant : une phrase, une balle, on rengaine ». Ainsi s’exprime Charles Dantzig .
Et cela qu’on dirait du Vialatte : « Selon les grincheux, nous vivons en décadence. Comme si la décadence n’était pas là depuis le premier jour de la vie. Chassé du paradis, Adam errait en grommelant : « Tout fout le camp ». Avant c’était mieux. Après ce sera mieux. Pauvre présent ! pauvre présent toujours injurié, présent qui est nous, présent qui n’arrive jamais à se débarrasser du chewing-gum du passé, et devant qui on agite en permanence le papier brillant de l’avenir, pauvre présent, tu trouve les moyen d’admirer ceux qui t’injurient ! »
Sur Amour aussi notre compagnon de route excelle. Je ne cite pas tout mais ceci doit l’être : « L’amour est un espoir. De là sa nuance de bassesse. Seulement, c’est un espoir envers soi-même, de pouvoir être assez bien pour plaire, etc. De là sa nuance de hauteur. Une des conséquences positives de l’amour est la vanité. Tous les efforts qu’on fait pour attirer l’attention de l’autre et qui nous améliorent… » On voit qu’on est loin de la philosophie de Marc Levy.
Et cela : « Bien sûr, il n’y a que l’amour, et ce livre même n’est qu’un grand imprimé d’amour destiné à en créer, mais je crois qu’il ne faut pas trop le dire. Les forces de la haine en profiteraient pour enrôler dans leurs troupes les esprits irrités par l’air béat que, disent-elles, l’amour donne ».
On le constate dès qu’on entre dans Le passé, grand roman d’amour de l'Argentin Alan Pauls (Bourgois, 2005) dont j'ai entrepris la lecture cette nuit et qui vibre d'électricité passionnelle dès ses premiers chapitres rappelant Proust - et très vite il faut se faire à la béatitude des jeunes amants sous peine de retourner à la cage de l’amer Michel…
Quant à Dantzig il remet ça : « Les femmes deviennent amoureuses espérant introduire du romanesque dans leur vie. Ayant constaté que cela a surtout introduit des emmerdements, elles lisent des romans ». Et cela enfin : « L’amour est le seul sujet sur lequel on puisse écrire n’importe quoi, car l’amour est n’importe quoi. C’est une qualité ».
Charles Dantzig est à la fois l’un des gardiens du jardin zoologique et l’interprète de tous les animaux dont l’un de ses préférés est la Fontaine, il me semble. A propos d’Amour, encore, il relève que La Fontaine écrit que « son mari l’aimait d’amour folle ». Ce qui lui fait conclure : « C’est charmant, frais, pimpant, un air de flûte, reste des temps médiévaux qui croyaient aux fées. « Un jeune fol s’éprit d’amour folle… » Et c’est le début d’un conte".