
Réponse à Juan Asensio.
Un écrivain peut-il tout dire ? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective ? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect ? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure ? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables ?
 Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais fou de l’écriture, auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme ; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase qui chantait. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le trait
Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais fou de l’écriture, auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme ; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase qui chantait. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le trait é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...
é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...
En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz ? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite ? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable ?
 Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.
Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.
Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à les fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.
Plus je vais et plus la littérature me semble le lieu de la relation et non de la séparation, de la continuité et non de la rupture, de la fécondité et non du repli sur soi. Je comprends qu’on la trouve aujourd’hui menacée et vilipendée, mais je vois aussi qu’on la comprend mal. J’essaie de comprendre ce que dit Juan Asensio dans L’infréquentable est le révolutionnaire le plus abouti, et je vois que des notions séparatrices, pour ne pas dire sectaires, contredisent absolument une exigence de liberté qui accorde ou dénie la qualité en fonction de jugements restreignant précisément ladite liberté. Ainsi célèbre-t-on le style, en référence au « grammairien par excellence » que serait Dieu, pour mieux rejeter un Julien Gracq ou un Francis Ponge, stylistes manquant en somme à la foi si je comprends bien, moi qui trouve pourtant chez Ponge et Gracq bien plus de pages vivantes et vibrantes que chez un Renaud Camus, dont la seul qualité est probablement de penser un peu, parfois, à contre-courant - sans style aucun hélas, à mon goût tout au moins.
Mais penser mal est-il, au fait, une qualité suffisante à faire un écrivain ? Juan Asensio s’interroge sur ce qui fait le propre d’un infréquentable, sans parvenir vraiment à se convaincre de ses approximations successives, et c’est tant mieux. On ne voit pas bien ce qu’est « le révolutionnaire le plus abouti », pas plus que ce qui distingue celui qui assume ses positions (de droite évidemment) ou sa foi (catholique résolument) équivaut à un brevet d’infréquentabilité, ni moins encore la qualité de « logocrate » chère à George Steiner, qui ne connaît aucune frontière idéologique. Est-ce l’ « échec social des antimodernes » qui les valorise alors ? Quelle dérision ce serait, que de considérer qu’une réussite sociale fasse ainsi illusion. D’un glissement l’autre, Juan Asensio finit donc par établir que l’infréquentable serait « d’abord et avant tout un homme libre », ou bien encore « celui qui dérange les Assis », à moins que, der des ders, l’infréquentable ne soit « qu’une notion sans consistance autre que celle que veulent à tout prix lui donner les censeurs, un non-lieu où sont prudemment relégués celles et ceux qui ont osé et osent affronter les minables catégories érigées par la bouche anonyme de « l’universel reportage ».
Il y a du vrai dans tout cela, mais beaucoup de rhétorique aussi, à base d’idéologie. La littérature excède ces limites. Or il est intéressant, à lire attentivement les textes (très inégaux eux-mêmes) réunis sous le fronton de ces Ecrivains infréquentables, combien se mêlent les goûts et les idées, les partis pris et les conclusions hâtives, la liberté de jugement et les âneries à œillères. La vraie critique littéraire demande de l’humilité et de la précision, de l’amour et des citations. On en trouve heureusement, par exemple dans le texte de Sarah Vajda consacré à Corneille, ou dans les introductions à Dominique de Roux, Léautaud ou Nicolas Gomez Davila, entre autres. Mais ce que je préfère dans cette revue, c’est que l’oreille de la liberté pointe bel et bien un peu partout, avec des éclats de littérature. Une ou deux lettres de Dominique de Roux et c’est parti. Ensuite, infréquentables ou pas, reste à voir sur pièces. Car cela seul est intéressant : le détail et non la catégorie. Le détail, pour aller voir ailleurs, c’est In memoriam de Paul Léautaud, notes griffonnées au chevet du père agonisant, c’est relire Corneille et s’en amuser en se foutant des nouvelles conventions le classant républicain pro-Bush. C’est lire Gombrowicz dans son Journal et le Gombrowicz de Dominique de Roux, c’est relire Bernanos qui est au purgatoire plus qu’au placard des infréquentables, c’est lire Post Mortem ou Ma confession de Caraco, c’est lire Ponge et Michaux aussi volontiers que Suarès ou Darien, c’est lire Giorgio Agamben qui lit Carl Schmitt qui lit Dostoïevski ou Bloy, c’est lire Bloy contre Zola et Jules Renard contre Bloy.
Vous avez raison finalement, Juan Asensio : les infréquentables ne le sont que par délation médiocre. Nul écrivain de qualité, nul penseur de valeur n’est infréquentable. Mais les médiocres se fréquentent, et ça fait du monde place de Grève…










 A cette proliférante beauté, Samivel, que Jean-Pierre Coutaz, commissaire de l’exposition, appelle « le dernier des romantiques », n’a cessé de rendre hommage, avant de la défendre contre les déprédations de l’homme. Ce romantique-là n’était pas, en effet, du genre seulement contemplatif, puisqu’il fut à l’origine des parcs nationaux (cofondateur notamment du Parc de la Vanoise) et ne cessa de mettre en garde ses semblables, dès les années où il fit équipe avec Paul-Emile Victor, contre la dégradation de notre environnement.
A cette proliférante beauté, Samivel, que Jean-Pierre Coutaz, commissaire de l’exposition, appelle « le dernier des romantiques », n’a cessé de rendre hommage, avant de la défendre contre les déprédations de l’homme. Ce romantique-là n’était pas, en effet, du genre seulement contemplatif, puisqu’il fut à l’origine des parcs nationaux (cofondateur notamment du Parc de la Vanoise) et ne cessa de mettre en garde ses semblables, dès les années où il fit équipe avec Paul-Emile Victor, contre la dégradation de notre environnement. Je reviendrai sur la magnifique exposition de Saint-Maurice d’Agaune, qu’il faut absolument visiter. Mais il me faut citer encore le commentaire si pénétrant de Jean-Pierre Coutaz à propos des mots de Samivel : « Il y a dans ce souvenir d’enfance relaté dans L’œil émerveillé la quintessence de la vie, de l’art et de l’œuvre de l’artiste. On imagine aisément le petit garçon solitaire, observateur et rêveur, accroupi au pied d’un arbre (comme le sage en méditation face à la montagne dans Au vrai sommet de L’Opéra des pics), perdu dans son monde et balayant du regard le sol saupoudré d’or automnal. Le bruissement des feuilles si proche du clapotis des vagues berce sa mélancolie et l’enfant cueille une feuille et de son œil d’alchimiste accomplit le grand œuvre. Paul Klee, à quelques années près, n’écrivait-il pas d’ailleurs que le rôle de l’artiste n’est pas de reproduire le visible mais de produire l’invisible ».
Je reviendrai sur la magnifique exposition de Saint-Maurice d’Agaune, qu’il faut absolument visiter. Mais il me faut citer encore le commentaire si pénétrant de Jean-Pierre Coutaz à propos des mots de Samivel : « Il y a dans ce souvenir d’enfance relaté dans L’œil émerveillé la quintessence de la vie, de l’art et de l’œuvre de l’artiste. On imagine aisément le petit garçon solitaire, observateur et rêveur, accroupi au pied d’un arbre (comme le sage en méditation face à la montagne dans Au vrai sommet de L’Opéra des pics), perdu dans son monde et balayant du regard le sol saupoudré d’or automnal. Le bruissement des feuilles si proche du clapotis des vagues berce sa mélancolie et l’enfant cueille une feuille et de son œil d’alchimiste accomplit le grand œuvre. Paul Klee, à quelques années près, n’écrivait-il pas d’ailleurs que le rôle de l’artiste n’est pas de reproduire le visible mais de produire l’invisible ».
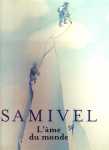


 De ma fenêtre sur la rue, à l’Hôtel Bonaparte, je regardais les gens d’en face comme d’une loge de théâtre, en me rappelant le début de La fenêtre des Rouet, de Simenon, avec la vieille fille dont les séances de voyeurisme me sont comme l’évocation mimétique de l’observation du romancier lui-même.
De ma fenêtre sur la rue, à l’Hôtel Bonaparte, je regardais les gens d’en face comme d’une loge de théâtre, en me rappelant le début de La fenêtre des Rouet, de Simenon, avec la vieille fille dont les séances de voyeurisme me sont comme l’évocation mimétique de l’observation du romancier lui-même.
 Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais fou de l’écriture, auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme ; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase qui chantait. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le trait
Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais fou de l’écriture, auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme ; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase qui chantait. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le trait é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...
é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès... Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.
Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.

 Le dernier souvenir que je garde de Zouc est un pur moment d’âpre émotion, il doit bien y avoir vingt ans de ça, au Théâtre Municipal, dans sa bouleversante traversée de vies fracassées. Ce n’était pas la Zouc enjouée mais la fille du bord des gouffres à la manière helvète sauvage, proche de Louis Soutter et de Robert Walser. On conçoit que de celle-ci, Nathalie Baye ne puisse rien restituer. Reste un nom qui fait tilt comme le nom de Baye fait tilt pour les pipoles, et le nom de Guibert.
Le dernier souvenir que je garde de Zouc est un pur moment d’âpre émotion, il doit bien y avoir vingt ans de ça, au Théâtre Municipal, dans sa bouleversante traversée de vies fracassées. Ce n’était pas la Zouc enjouée mais la fille du bord des gouffres à la manière helvète sauvage, proche de Louis Soutter et de Robert Walser. On conçoit que de celle-ci, Nathalie Baye ne puisse rien restituer. Reste un nom qui fait tilt comme le nom de Baye fait tilt pour les pipoles, et le nom de Guibert. Guibert, Zouc et Godard procèdent par collage, comme Fellini et Montaigne aussi. Drôle de mélange, mais ça me botte de couper du bois en laissant tourner JLG sur le magnétoscope et en relisant de loin en loin, slurpant un café dans la foulée, des pages de Fou de Vincent de Guibert, ce si beau patchwork de fragments amoureux obscènes et doux.
Guibert, Zouc et Godard procèdent par collage, comme Fellini et Montaigne aussi. Drôle de mélange, mais ça me botte de couper du bois en laissant tourner JLG sur le magnétoscope et en relisant de loin en loin, slurpant un café dans la foulée, des pages de Fou de Vincent de Guibert, ce si beau patchwork de fragments amoureux obscènes et doux. J’étais hier soir au cabaret de L’Esprit frappeur où passaient le blond Riquet houppé Thierry Romanens, le charme zazou et le talent doux-acide jeté en personne, puis l’immense Allain Leprest, toujours au bord de s’effondrer mais ouvrant tout grand son ciel d’âme pure.
J’étais hier soir au cabaret de L’Esprit frappeur où passaient le blond Riquet houppé Thierry Romanens, le charme zazou et le talent doux-acide jeté en personne, puis l’immense Allain Leprest, toujours au bord de s’effondrer mais ouvrant tout grand son ciel d’âme pure.











 Houellebecq et les lemmings…
Houellebecq et les lemmings…



 Ce chef-d’œuvre méconnu (enfin : méconnu du grand nombre, je crois) s’intitule Vivre (Ikiru) et constitue le pendant de La mort d’Ivan Illitch de Léon Tolstoï. C’est l’éternelle histoire du soudain éveil de la conscience : tu te figurais être immortel et, tout coup, tu te trouves face à ce mur, devant ce toubib froid qui t’annonce que tu n’as plus que six mois ou six semaines à vivre. Et comment les vivre nom de Dieu ?
Ce chef-d’œuvre méconnu (enfin : méconnu du grand nombre, je crois) s’intitule Vivre (Ikiru) et constitue le pendant de La mort d’Ivan Illitch de Léon Tolstoï. C’est l’éternelle histoire du soudain éveil de la conscience : tu te figurais être immortel et, tout coup, tu te trouves face à ce mur, devant ce toubib froid qui t’annonce que tu n’as plus que six mois ou six semaines à vivre. Et comment les vivre nom de Dieu ?




 Notes à la volée
Notes à la volée Dans le TGV, ce dimanche 19 mars. – La nuit tombe sur la Bourgogne tandis que nous rentrons de Paris, où nous avons fait quelques bonnes rencontres et découvertes, L. et moi. Vendredi soir, ç’a été, pour commencer en beauté, un entretien avec Tzvetan Todorov, à propos de son dernier livre, Les aventuriers des l’absolu. En une heure et demie, nous avons évoqué sa trajectoire personnelle et ses positions, par rapport au culte de l’art, à l’antinomie romantique opposant création et vie quotidienne, et aux séquelles de l’esthétisme d’un Mallarmé dans la littérature française contemporaine, qui m’ont beaucoup intéressé. Tzvetan est un honnête homme, dans la meilleure acception du terme, et j’y ai repensé le lendemain en visitant la superbe exposition consacrée aux Lumières, à la Bibliothèque nationale, dont il est le commissaire.
Dans le TGV, ce dimanche 19 mars. – La nuit tombe sur la Bourgogne tandis que nous rentrons de Paris, où nous avons fait quelques bonnes rencontres et découvertes, L. et moi. Vendredi soir, ç’a été, pour commencer en beauté, un entretien avec Tzvetan Todorov, à propos de son dernier livre, Les aventuriers des l’absolu. En une heure et demie, nous avons évoqué sa trajectoire personnelle et ses positions, par rapport au culte de l’art, à l’antinomie romantique opposant création et vie quotidienne, et aux séquelles de l’esthétisme d’un Mallarmé dans la littérature française contemporaine, qui m’ont beaucoup intéressé. Tzvetan est un honnête homme, dans la meilleure acception du terme, et j’y ai repensé le lendemain en visitant la superbe exposition consacrée aux Lumières, à la Bibliothèque nationale, dont il est le commissaire.
 Festen est le grand film de la transgression d’un secret de famille, qui débouche à la fois sur la purification et la fraternité. J’ai rarement été aussi poigné par une situation exposée au cinéma, et la façon de la présenter m’a conforté dans ma propre détermination de tout dire. C’est simplement l’histoire du gosse qui dit tout haut ce que les autres savent mais préfèrent ignorer. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un gosse mais du fils aîné de la famille, qui choisit le speech qu’on lui demande de prononcer à l’occasion du banquet d’anniversaire des soixante ans de son père pour évoquer, d’un ton égal, comment ledit père les violait, lui et sa soeur, laquelle s’est suicidée pour échapper à la hantise de ce souvenir. Il y a là comme un modèle de ce qu’il faut faire aujourd’hui, non du tout un modèle moral ou sociologique, mais bel et bien artistique; car c’est l’art qui m’intéresse là-dedans au premier chef, c’est à cause de l’art, de la forme, de la beauté de tout ça, de l’émotion, de l’énergie, de l’intensité qui se dégage de tout ça que j’ai été bouleversé, par delà la situation humaine.
Festen est le grand film de la transgression d’un secret de famille, qui débouche à la fois sur la purification et la fraternité. J’ai rarement été aussi poigné par une situation exposée au cinéma, et la façon de la présenter m’a conforté dans ma propre détermination de tout dire. C’est simplement l’histoire du gosse qui dit tout haut ce que les autres savent mais préfèrent ignorer. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un gosse mais du fils aîné de la famille, qui choisit le speech qu’on lui demande de prononcer à l’occasion du banquet d’anniversaire des soixante ans de son père pour évoquer, d’un ton égal, comment ledit père les violait, lui et sa soeur, laquelle s’est suicidée pour échapper à la hantise de ce souvenir. Il y a là comme un modèle de ce qu’il faut faire aujourd’hui, non du tout un modèle moral ou sociologique, mais bel et bien artistique; car c’est l’art qui m’intéresse là-dedans au premier chef, c’est à cause de l’art, de la forme, de la beauté de tout ça, de l’émotion, de l’énergie, de l’intensité qui se dégage de tout ça que j’ai été bouleversé, par delà la situation humaine. Pépites de mémoire
Pépites de mémoire
 Tout le temps que je lui parle du monde tel qu’il va et ne va pas et tel que je le vois et le vis, en regardant tantôt le pèse-bébé et tantôt le grand livre intitulé Le Temple de l’Homme posé sur son bureau, le Docteur prend des notes fébriles en me lançant avec reconnaissance : « Vous m’aidez, Seigneur, vous m’aidez beaucoup ! ». Puis de me recommander soudain de mieux respirer, tout en s’allongeant à plat ventre sur son lit de consultation pour me montrer sa méthode, de danser un peu en tourniquant comme un derviche, puis de m’inviter à prononcer avec lui un long OM en faisant monter le double son de nos voix de notre double tréfonds d'entrailles.
Tout le temps que je lui parle du monde tel qu’il va et ne va pas et tel que je le vois et le vis, en regardant tantôt le pèse-bébé et tantôt le grand livre intitulé Le Temple de l’Homme posé sur son bureau, le Docteur prend des notes fébriles en me lançant avec reconnaissance : « Vous m’aidez, Seigneur, vous m’aidez beaucoup ! ». Puis de me recommander soudain de mieux respirer, tout en s’allongeant à plat ventre sur son lit de consultation pour me montrer sa méthode, de danser un peu en tourniquant comme un derviche, puis de m’inviter à prononcer avec lui un long OM en faisant monter le double son de nos voix de notre double tréfonds d'entrailles.