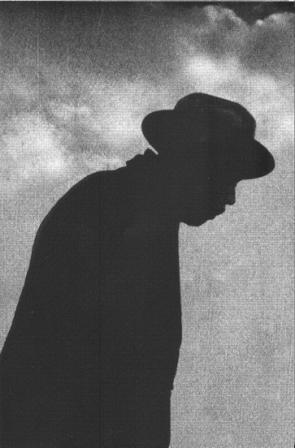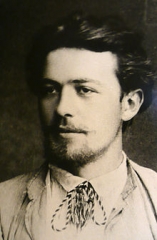Carnets de JLK - Page 8
-
Comme un chant d'innocence
 (Aux nouveaux semeurs de peste)Les vieux enfants sont alignéssous les drapeaux croisés,les rangs sont formés par les ans:les derniers nés devant,et là-bas tout au fond du tempsles vétérans plus lents -la lenteur venant du grand âgedes enfants les plus sagestombés aux plus fringants carnages…La guerre à l’antique était belle:on tuait noblement,on le faisait au nom de dieuxqui s’étripaient entre eux;le sang délicieux au ciboireétait un vrai nectar,on chantait même l’ennemien termes bien choisis…Je suis l’enfant dégénéréd’après les sacrifices,je ne veux pas de vos armées,et c’est sans argumentque je me déclare innocentde vos sacres et massacres -vos sempiternels maléficescommis au nom de l’éternelMammon maquereau de Babel...
(Aux nouveaux semeurs de peste)Les vieux enfants sont alignéssous les drapeaux croisés,les rangs sont formés par les ans:les derniers nés devant,et là-bas tout au fond du tempsles vétérans plus lents -la lenteur venant du grand âgedes enfants les plus sagestombés aux plus fringants carnages…La guerre à l’antique était belle:on tuait noblement,on le faisait au nom de dieuxqui s’étripaient entre eux;le sang délicieux au ciboireétait un vrai nectar,on chantait même l’ennemien termes bien choisis…Je suis l’enfant dégénéréd’après les sacrifices,je ne veux pas de vos armées,et c’est sans argumentque je me déclare innocentde vos sacres et massacres -vos sempiternels maléficescommis au nom de l’éternelMammon maquereau de Babel... -
L'Ouvroir
 (Trésor de JLK)« Je vois encore mes camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine, harassés après un travail dans un froid qui descendait jusqu’à quarante-cinq degrés sous zéro, qui écoutaient nos conférences sur des thèmes tellement éloignés de notre réalité d’alors. Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt intense l’histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire ».(Joseph Czapski, Proust contre la déchéance)°°°« On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman… »(Jeanne Moreau)°°°« La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz».« Le souvenir presque palpable, vivant, d'une tragédie mythique — depuis longtemps galvaudée dans d'autres régions du monde — emplit l'air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l'édifice éthique qu'est — si l'on peut dire — le pilier de l'histoire spirituelle de l'homme. Qu'est cette fracture ? Les pères ont condamné l'enfant à mort. Cela, personne ne s'en est jamais remis. »«Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais. »« Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi, la règle d'un jeu de dupes; l'antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l'on s'écrie: Amour, alors tous savent que l'heure du crime a sonné, et si c'est: loi, c'est celle du vol, du pillage. »(Imre Kertesz. Être sans destin)°°°«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.»(Octave Mirbeau)°°°« Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité. »(Anton Tchekhov, à propos de Tolstoï)°°°« Prie avec les lèvres de la révolte, avec le souffle des démons, avec le silence du désespoir. Prier du sein de l'irréparable, attendre de Dieu sa pâture à travers les branches emmêlées de l'impossible, est-il quelque chose de plus divinement humain ? Songe à ce que serait - j'imagine l'absurde - la prière d'un damné ? »(Gustave Thibon)°°°«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un».(Catherine Safonoff)°°°Qu’entrevoit l’enfant au tréfonds de son sommeil ? Quel spectacle ravissant, qui la fait soudain éclater de son rire argentin au milieu de la nuit ?L’enfant au père, l’air résolu: « Allons, cheval, viens donc promenader ! »La mère, très fatiguée, s’étant réfugiée dans un fauteuil où elle se met à sangloter (les nerfs), l’enfant s’en vient vers elle et l’embrassant, lui demande d’un air bien grave: « Alors, dis-moi, tu as des problèmes ? »L’enfant au père: « Viens maîtressier, allons faire de l’écrition « .Ou encore: « Allez, Zorro, maintenant on ligote l’Indien au poteau de tortue ».».L’enfant les yeux au ciel : « Et le prénom de Dieu, c’est quoi ? »(2007)°°°«Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait… »(Cormac McCarthy, Non ce pays n’est pas pour le vieil homme)°°°«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».« Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté… »«L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».(Christine Singer)°°°«On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même.»«Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».«Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».(Georges Haldas)Peinture JLK: La nuit aux lucioles.
(Trésor de JLK)« Je vois encore mes camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine, harassés après un travail dans un froid qui descendait jusqu’à quarante-cinq degrés sous zéro, qui écoutaient nos conférences sur des thèmes tellement éloignés de notre réalité d’alors. Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt intense l’histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire ».(Joseph Czapski, Proust contre la déchéance)°°°« On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman… »(Jeanne Moreau)°°°« La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz».« Le souvenir presque palpable, vivant, d'une tragédie mythique — depuis longtemps galvaudée dans d'autres régions du monde — emplit l'air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l'édifice éthique qu'est — si l'on peut dire — le pilier de l'histoire spirituelle de l'homme. Qu'est cette fracture ? Les pères ont condamné l'enfant à mort. Cela, personne ne s'en est jamais remis. »«Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais. »« Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi, la règle d'un jeu de dupes; l'antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l'on s'écrie: Amour, alors tous savent que l'heure du crime a sonné, et si c'est: loi, c'est celle du vol, du pillage. »(Imre Kertesz. Être sans destin)°°°«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.»(Octave Mirbeau)°°°« Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité. »(Anton Tchekhov, à propos de Tolstoï)°°°« Prie avec les lèvres de la révolte, avec le souffle des démons, avec le silence du désespoir. Prier du sein de l'irréparable, attendre de Dieu sa pâture à travers les branches emmêlées de l'impossible, est-il quelque chose de plus divinement humain ? Songe à ce que serait - j'imagine l'absurde - la prière d'un damné ? »(Gustave Thibon)°°°«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un».(Catherine Safonoff)°°°Qu’entrevoit l’enfant au tréfonds de son sommeil ? Quel spectacle ravissant, qui la fait soudain éclater de son rire argentin au milieu de la nuit ?L’enfant au père, l’air résolu: « Allons, cheval, viens donc promenader ! »La mère, très fatiguée, s’étant réfugiée dans un fauteuil où elle se met à sangloter (les nerfs), l’enfant s’en vient vers elle et l’embrassant, lui demande d’un air bien grave: « Alors, dis-moi, tu as des problèmes ? »L’enfant au père: « Viens maîtressier, allons faire de l’écrition « .Ou encore: « Allez, Zorro, maintenant on ligote l’Indien au poteau de tortue ».».L’enfant les yeux au ciel : « Et le prénom de Dieu, c’est quoi ? »(2007)°°°«Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait… »(Cormac McCarthy, Non ce pays n’est pas pour le vieil homme)°°°«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».« Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté… »«L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».(Christine Singer)°°°«On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même.»«Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».«Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».(Georges Haldas)Peinture JLK: La nuit aux lucioles. -
Figures de contemplation

Le vert et le rouge sont dites couleurs de la passion, qui composent ici, dans la forme, accentuée par des cernes noirs, de six poires posées sur un guéridon noir adorné de dorures, ce qu’on dirait conventionnellement une nature morte, mais à vrai dire par antiphrase tant elle est vive et chatoie dans le détail foisonnant d’autres touches de couleur, ou encore une façon d’icône profane rappelant les visions d’un Rouault, sans qu’il s’agisse de référence et moins encore de citation.
Ce tableau datant de 1973, qui n’a cessé de nous accompagner, m’apparaît aussi, par son mélange de lyrisme m’évoquant également le chant des vitraux, comme un objet de contemplation qui me rappelle le siècle d’or espagnol plus que les maîtres flamands, et d’emblée s’est imposé le mot d’apparition.Ce sera d’ailleurs, dans le statisme de la contemplation mais aussi par la chose saisie au vol dans le mouvement, une constate de la peinture de Czapksi que de faire apparaître le monde qui nous entoure, et voir, ce qui s’appelle voir, les choses non seulement vues mais regardées – le verbe signifiant « garder avec » - , que le travail du peintre consiste à dégager de leur part anecdotique et contingente pour en fixer la présence et l’aura.
Ce que je vois me regarde, semble nous dire l’Artiste, mais encore s’agit-il de le traduire en sorte de dire que ce que je vois regarde aussi les autres.
Poires vertes, fond rouge. Huile sur toile, 61x50, 1973. Pp LK/JLK.
-
À sa douce présence
 (Chanson de Noël)Elle est devenue ma gardienne,mon ange singulier;alors, plus de chagrin qui tienne:elle me tient éveillé...Elle ne craignait pas cette mortqui nous surprend parfois,s’annonce en si lointain trépasqui voudrait qu’on l’ignore...Elle la savait au coin du bois,ou plutôt en plein cœur:elle entendait de la tumeurce bas bruit et sournois...Devant la Bête elle était bravecomme si de rien n’était,et comme pour la défierelle disait: pas grave !Enfin je l’entends encore direla veille de sa mort :que nous sommes heureux encorede pouvoir en sourire...Notre ange singulier nous gardedans sa douce présence,survivante qui nous regardepar delà toute absence...(À la Maison bleue, ce 25 décembre 2021)
(Chanson de Noël)Elle est devenue ma gardienne,mon ange singulier;alors, plus de chagrin qui tienne:elle me tient éveillé...Elle ne craignait pas cette mortqui nous surprend parfois,s’annonce en si lointain trépasqui voudrait qu’on l’ignore...Elle la savait au coin du bois,ou plutôt en plein cœur:elle entendait de la tumeurce bas bruit et sournois...Devant la Bête elle était bravecomme si de rien n’était,et comme pour la défierelle disait: pas grave !Enfin je l’entends encore direla veille de sa mort :que nous sommes heureux encorede pouvoir en sourire...Notre ange singulier nous gardedans sa douce présence,survivante qui nous regardepar delà toute absence...(À la Maison bleue, ce 25 décembre 2021) -
Le maître des couleurs
En mémoire de mon père
Un jour, au bureau, ils m’ont dit que je n’assurais plus: c’est cela qu’ils m’ont dit, mais je n’ai pas bien saisi sur le moment. Tout a basculé à partir de là, mais je n’ai pas compris, alors, le sens de cette expression.
Vous savez que j’ai toujours été très à cheval sur les expressions, et celle-ci me semblait d’autant moins compréhensible que nous nous trouvions dans une compagnie d’assurances où j’étais employé depuis plus de trente ans et où jamais on ne m’avait fait la moindre remarque désobligeante sur la qualité de mon travail, sauf en apprentissage.
Ils se sont mis à trois pour me le dire. De l’une à l’autre de leurs entrevues, comme ils disaient, je me rappelle que j’avais légèrement desserré ma cravate, signe chez moi de nervosité.
Ils se sont succédé dans mon bureau pour me dire à peu près la même chose. Trois jeunes employés qui me devaient en principe le respect, et qui jamais, en tout cas, vingt ans, plus tôt, ne se seraient permis une telle observation. Deux consultants et la nouvelle responsable des ressources humaines, selon l’expression. Trois nouveaux qui nous connaissaient à peine et qui ont commencé, comme un seul, par me dire merci.
Je ne voyais pas pourquoi. Il n’y avait aucune raison de me féliciter de quoi que ce fût. Je n’avais fait, ces derniers temps, que ce que j’avais toujours accompli pour la Maison: à savoir ce que j’étais supposé faire précisément pour mon salaire.
D’ailleurs je me demande s’ils y croyaient ? J’avais plutôt l’impression qu’ils récitaient une leçon apprise. Ils avaient les mêmes sourires que les gens des sectes religieuses qui se présentent à votre porte, de l’espèce que je tiens prudemment à distance, quitte à paraître inhospitalier.
Ils étaient cordiaux jusqu’à l’indiscrétion. Je n’ai pas du tout apprécié cette approche précipitée à l’objet mal défini. Pourtant je me suis interrogé. Avais-je mal fait d’une manière ou de l’autre ? M’étais-je égaré à l’occasion de mon deuil ?
Je savais, bien entendu, que tous mes collègues s’étaient posé bien des questions à mon sujet à travers les années, et notamment du fait que j’avais toujours refusé tout avancement, mais ma fidélité à la Maison et ma régularité absolue m’avaient valu l’estime des anciens et la considération parfois ironique des plus jeunes, au début, qui apprenaient ensuite à me connaître et que je mettais souvent dans ma poche en leur parlant de mes collections.
Du vivant de Rose, au demeurant, je n’accordais qu’une importance secondaire à la façon dont on me regardait au bureau. Nous avions admis une fois pour toutes que tel serait notre gagne-pain jusqu’à ma retraite, juste augmenté du produit de la vente des découpages folkloriques de ma soeur aux Américains et aux Japonais.
Rose appréciait ce qu’elle disait mon sacrifice, qui n’était à vrai dire, pour moi, qu’un arrangement commode me permettant de me concentrer sur mes vraies préoccupations; et tout aurait pu continuer ainsi quelques années encore, ponctuées de voyages de plus en plus lointains avec Rose, si celle-ci n’avait pas été frappée par la maladie l’année même où les managers, selon la nouvelle dénomination, entreprirent les changements.
De ceux-ci, les premiers signes ne m’apparurent guère, tant j’étais absorbé par l’état de Rose. Certains anciens m’avaient certes mis en garde, qui s’inquiétaient de rumeurs provenant de l’Agence Générale, mais j’avais toujours estimé peu digne de s’alarmer sur des rumeurs, et les silences de Rose, succédant à l’apaisement de chaque découpage, me causaient tant d’inquiétude que plus rien d’autre n’existait.
A la même époque, en outre, l’engagement des trois jeunes cadres formés à la médiation interne selon les termes du communiqué de la Direction Générale, avaient suscité de vives réactions chez certains de mes pairs, sans m’ébranler du tout pour ma part. Mes visites quotidiennes au pavillon d’isolement, où j’avais vu plusieurs jeunes gens s’en aller, m’avaient tellement ému que j’en étais arrivé à ne plus discerner les nuances de l’âge ni craindre de réels bouleversements liés à je ne sais quelle lutte de générations.
J’avais pourtant relevé diverses nouvelles expressions, dans les conversations à la cafétéria, telle l’optimisation des fonctions de la chaîne, dont la tournure me déconcertait autant que celle des fameuses ressources humaines; et ce fut le même langage que me tinrent bel et bien ces trois-là quand ils me dirent quelques mois plus tard que je n’assurais plus.
Ils m’ont dit pour commencer, peut-être pour mieux faire passer la pilule, qu’ils me respectaient. Non sans malice, à ce qu’il m’a semblé, la nouvelle responsable des ressources humaines, une blonde du genre efficient prénommée Ariane, m’a fait valoir que j’étais unique en mon genre, tandis que ses deux collègues s’accordaient à me trouver intéressant.
Tous trois ont reconnu que je représentais un monde qui avait joué son rôle, ils en étaient conscients, seulement voilà: pour eux je n’assurais plus.
Et naturellement ils m’ont expliqué. Et j’ai bientôt compris. J’ai compris beaucoup plus vite qu’ils ne s’y attendaient, et cela les a décontenancés à leur tour. J’ai compris qu’il ne s’agissait pas forcément de se débarrasser de moi mais en tout cas de me reformater, selon leur expression, et du même coup je me suis braqué, et ce fut dès ce moment-là que je retrouvai Rose ou, disons, l’esprit de Rose, le coeur de Rose que j’avais cru perdre à tout jamais dans la confusion du chagrin.
Nous avions toujours vécu, aux Oiseaux, comme si nous étions venus au monde pour rester ensemble. Les vingt ans, puis les trente ans, les quarante ans de Rose avaient passé sans que jamais elle ne me parle de frayer ailleurs. La petite maison que Maman nous avait laissée en héritage, dans la zone villa où nous avions passé notre enfance, convenait à notre genre de vie. Les gens des alentours se posaient peut-être eux aussi des questions à notre propos, mais ce n’était même pas sûr, et de toute façon ça ne portait pas à conséquence tant les relations entre voisins s’étaient distendues avec les années, surtout depuis l’histoire des pervers de la maison bleue.
J’y repense avec tristesse. J’ai parfois l’impression que seule Rose a conçu avec moi ce qui s’est réellement passé alors. Il me semble que tout le monde s’est protégé de la réalité des faits. Et maintenant, repenser à ces événements me fait honte. Notre quartier, notre pays, notre monde, notre espèce devraient avoir honte de cela.
J’en ai parlé avec Marcelo, mon correspondant brésilien, naturaliste à Sao Paulo, qui sait que tous les jours des choses terribles se passent dans les rues de sa ville. Je lui ai dit: Marcelo, voici ce que nous avons vécu au quartier des Oiseaux, et tels sont mes cauchemars, puis je lui racontai ceux qui me hantèrent à l’époque de Da Nang. Il m’a répondu le soir même qu’il avait entendu parler de cette affaire par le satellite et qu’il imaginait ce que je ressentais, que lui-même vivait dans une cage dorée gardée par des vigiles et que ce n’était sûrement pas un hasard si nous préférions l’étude de la nature à celle de ces animaux dénaturés que sont nos semblables.
Tout le temps de l’histoire des pervers de la maison bleue, nous nous étions tenus à l’écart. Lorsque les gens du quartier s’étaient laissés contaminer par le délire public et la haine, j’avais dit à Rose que je pensais préférable de ne pas se ranger dans un camp ou dans l’autre, et elle me répondit en mouillant un scone dans son infusion de verveine: vous avez raison, Gottlieb - mais c’était avant tout parce qu’elle-même avait mal et qu’elle savait mes cauchemars.
Rose pensait aux enfants. Pour ma part je me contentais de subir les visions nocturnes qui m’étaient envoyées par je ne sais quelle terrible divinité, je voyais l’horreur pure ou plutôt je la sentais se déployer en moi comme un film en trois dimensions dans lequel je ne pouvais agir, je me réveillais paralysé au milieu de l’horrible laboratoire qu’avaient décrit les journaux, comme je m’étais réveillé dans les souterrains vietnamiens nettoyés au lance-flammes, mais dès que je me réveillais je me sentais incapable d’exprimer quoi que ce fût, n’était-ce à Rose qui m’écoutait en tremblant elle aussi, et d’autant plus qu’elle ressentait autrement que moi la torture des enfants, la souillure et la torture.
Elle disait que c’était trop tard. Elle essayait de se représenter une femme livrant à un homme un enfant en bas âge. Elle ne pensait qu’aux actes commis. Elle voyait en rêve ces chaînes et ces colliers de chien, ces extenseurs de fer, ces lames de rasoir et ces cutters dont avaient fait usage les deux fous dont les caméras réjouissaient plusieurs centaines d’autres déments ordinaires. Elle voyait l’enfant laissé seul un mois dans ses déjections et marqué au fer rouge. Elle se réveillait en hurlant. Elle se voyait en mère réclamant son enfant. Elle prenait chaque mot des journaux au sérieux, et peut-être est-ce cela aussi qui l’a tuée ?
Pour en revenir à mes jeunes consultants, je savais qu’ils étaient supposés faire vite. J’avais deviné qu’ils n’étaient que des truchements. Je me doutais bien qu’aucun d’eux ne me voulait du mal et qu’ils ne faisaient qu’appliquer des directives. Du moins les voyais-je venir de loin car j’avais alors, de ce qui se tramait, une idée de plus en plus claire.
- Vous avez cinquante-cinq ans, ce n’est pas si vieux, Gottlieb, nous pouvons encore faire quelque chose de vous.
Voilà ce que m’a dit le jeune homme au costume voyant qu’on avait engagé, avec son non moins fringant compère Lemercier, comme consultant externe de médiation.
Il s’appelait Moreno et paraissait le moins enclin à m’écouter, mais je lui sentis bientôt des failles.
Il m’avait demandé, ce soir-là, si je m’identifiais vraiment à l’esprit de l’Entreprise, et comme je paraissais hésiter, il avait réitéré sa question.
- Je vous ai parfaitement entendu, avais-je répondu en me levant, et, désignant mon siège, je le priai de s’asseoir pour m’écouter.
Alors je lui parlai du Grand Nacré.
Je lui dis les moires. Je lui dis les diapres. Je lui dis toute la combinatoire des couleurs. Je le transportai en divers lieux que nous avions explorés Rose et moi.
Moreno n’en revenait pas.
Il a d’abord fait celui à qui l’on a seriné que savoir écouter est un atout indispensable à la bonne gestion.
Puis il a tenté de m’interrompre. Il était, en station debout, nettement plus grand et mieux découplé que moi, mais à l’instant, sur ma chaise tournante d’une autre époque, il semblait contraint de se soumettre à mon discours, que je lui tins avec une douceur persuasive sans cesser de lui tourner autour.
«Il faut voir le Grand Nacré se poser sur la fleur de budleya», lui dis-je en guettant sa moindre réaction, et, ne voyant rien venir, je précisai que cette sorte d’accouplement avait quelque chose de fortement symbolique, tout en relevant la nuance d’étonnement vif qui anima du même coup son regard.
Puis je lui racontai la venue au monde du sphinx Polyphème que ma correspondante de Shadyside, Annie D., m’avait longuement décrite dans l’un de ses mails. Maintes fois j’avais revécu cette scène grâce au récit de mon occulte amie, dont les mots avaient un tel pouvoir évocateur que je m’étais pour ainsi dire approprié son souvenir.
Je racontai à Moreno cette péripétie naturelle sans le laisser m’interrompre.
Lui qui me parlait de restructuration, il devait se représenter, lui dis-je, la mue de la grande chrysalide empaquetée dans sa feuille de chêne cousue, et commençant de bouger puis de taper, de marteler son enveloppe comme de derrière la porte de bois d’un romanesque souterrain à la Monte-Cristo.
A force de me représenter la scène, j’étais en mesure de la raconter comme si je l’avais vécue moi-même. Et je suggérai des analogies: d’une vie toute d’ombre et de repli, comme ce garçon se figurait un peu la mienne, voici qu’allait émerger une tête pelucheuse et deux longues antennes à plumes, un abdomen couvert de fourrure et de longues pattes hirsutes autant que celles d’un ours trempé par l’averse, enfin ces ailes repliées et vernissées ressemblant à s’y méprendre aux plis encore collants d’un parapluie refermé.
- Ceci pour l’ancien bureau, et cela pour le nouveau, lui lançai-je, avec une oeillade sardonique qui lui échappa, en lui désignant ensuite l’image rutilante, au-dessus d’un classeur métallique, du mâle Polyphème aux immenses ailes d’un brun velouté, bordées de bandes bleues et roses aussi délicates que celles d’un lavis, avec l’ocelle énorme, ornant chaque aile postérieure de son splendide oeil doux et dur à la fois, dont le bleu sombre se fondait en un jaune immatériel.
A vrai dire il était médusé.
Il ne s’attendait pas du tout à ma propre métamorphose, lui qui s’était imaginé qu’on pouvait m’épingler comme une poussiéreuse mouche grise, sous prétexte que mes gilets et mes vestons, mes chaussons hors d’âge et mon lorgnon de bureaucrate exhalaient la vieille ambiance des chambres mal aérées. Il croyait m’avoir jugé une fois pour toutes quand je bénéficiais moi-même, à cet égard, d’une assez confortable avance sur ses observations.
De fait je l’avais, d’ores et déjà, radiographié de mon oeil de morphopsychologue amateur.
Tout en donnant l’apparence d’un battant, ce garçon était un mou, un velléitaire et un sensitif. Il y avait en lui un indéniable ressort d’ambition sociale qui lui avait permis de donner le change, mais je voyais bien qu’il ne croyait pas aux mots vides qu’il prononçait et qu’il était en somme meilleur qu’il ne s’en doutait lui-même.
Ce fut ce qui me permit de marquer mes premiers points sur la voie de son éveil, sans me faire trop d’illusions pour autant. Il faut dire que son propre statut était en jeu, et qu’il y avait la question de l’âge qui se reposait à ce moment-là. La conformité s’imposait à ses yeux comme garante de survie, et je me doutais qu’il ne pourrait s’affranchir si facilement d’une illusion si répandue. En outre, je restais par trop méfiant à l’égard des mutations artificielles, qui me faisaient me défier justement des transformations décidées pour l’Entreprise, et que je savais le contraire des vraies métamorphoses auxquelles je prêtais mon attention depuis des lustres.
J’avais d’ailleurs évoqué ces questions avec ma correspondante Annie D., qui me soutenait par de petits messages quotidiens dans ma boîte électronique tandis que les managers de La Vie assurée préparaient en douceur (pensaient-ils) la liquidation de mon cas.
A propos d’ Annie D., dont j’avais découvert les travaux par l’entremise de Marcelo, je m’aperçus bientôt que cette femme admirable avait tant de traits intérieurs comparables à ceux de Rose que je lui en prêtai le visage avant qu’elle ne m’envoie son portrait numérisé, et de fait elle avait les mêmes lignes pures et le même regard d’enfant têtu que ma Rose.
Annie D., en marchant dans sa vallée des Montagnes Bleues, en Virginie, ne cessait de penser aux vraies conditions de la transformation de l’humain, et tout de suite je me sentis compris par elle lorsque je lui envoyai mes réflexions sur l’analogie que j’avais établie entre les mutations codifiées de la momie égyptienne et la métamorphose du papillon. Par mail, le soir même - enfin son soir à elle, de notre jour précédent, puisque nous en étions déjà nous-mêmes à l’heure des croissants -, elle m’écrivit que, by Jove, j’avais bien mérité mon prénom de fan de Dieu.
De tout cela, je ne pouvais évidemment parler avec qui que ce fût à La Vie assurée, où les préoccupations terre à terre constituaient l’essentiel des conversations de la cafétéria, des performances amoureuses des jeunes gens le samedi soir au championnat de football du mercredi.
Comme j’avais toujours fait figure d’original, apparemment figé dans les anciennes manières mais capable d’écouter toute conversation, fût-elle du dernier cri, et que mes jeunes examinateurs en avaient parlé après nos premières entrevues (la pétulante Ariane avait elle-même été subjuguée par ma connaissance de la faune de Bornéo où l’un de ses oncles chasseur avait séjourné, et Lemercier, l’autre consultant, s’était laissé amadouer d’autant plus facilement qu’un séjour aux Maldives l’avait porté à s’intéresser aux grands fonds marins qui n’avaient guère de secrets pour moi ), je compris que, pour quelque temps au moins, j’aurais un peu de répit et d’autant plus que mon nouvel état de solitaire, depuis la mort de Rose, me laissait une complète disponibilité d’esprit.
Notre fier trio se relayait dans le petit bureau où l’on m’avait relégué et dont j’avais fait, comme chaque fois, un repaire tout personnel évoquant un grand livre d’images.
Troublés par le fait que c’était moi qui les recevait et non l’inverse, mes jeunes gens avaient de la peine à exposer clairement ce qu’ils pensaient. Ils manquaient de précision dans leur vocabulaire et plus encore de suite dans l’exercice de la raison. Je me gardais de me gausser d’eux, mais je restais néanmoins sur mes gardes.
Je les regardais en souriant. J’étais gai comme toujours et cela les faisait changer de contenance.
Je savais bien ce qu’ils étaient censés faire sur ordre de la Direction Générale. Je voyais qu’ils s’étaient entendus sur la suite tactique des opérations, mais quelque chose semblait clocher. Ils cherchaient à définir leurs critères et moi je sentais bien que je leur posais un problème inattendu, leur tapais sur les nerfs et les séduisais en même temps.
Visiblement cela ne se passait pas comme avec les autres vieux débris, selon l’expression que j’avais surprise entre eux au détour d’un couloir, dont la plupart avaient été remerciés par l’Entreprise avec des salamalecs.
Avec moi ce serait différent, ils le pressentaient, plus même ils constataient tous les jours qu’il y aurait un problème dans mon cas et qui ne pourrait se régler selon les termes prévus.
Ils avaient établi, sans doute, que je m’en tiendrais décidément à ma pratique éprouvée et à mon goût. Ils devinaient que je ne renoncerais à rien de ce qui avait été. Simultanément, ils savaient que je ne ferais valoir aucune exigence matérielle ni aucune espèce de droit lié à mon ancienneté ou à mes états de service. Ils devaient être convaincus que ma cause était désespérée: que jamais on ne me reformaterais, et pourtant ils ne m’en voulaient pas pour autant. Plus même: ils devaient être tentés de penser que je n’avais pas tout tort - et peut-être même m’enviaient-ils ?
Bien entendu, ils avaient les moyens de m’abattre et je m’en doutais. Pourtant aucun d’eux ne l’a voulu. Je ne sais comment cela s’est arrangé finalement, avant que je ne prenne moi-même la décision de m’en aller, mais probablement est-ce à cause de nos discussions sur la pelouse de la plage de Rivebelle, cet été-là.
C’est avec le responsable de la maintenance informatique, un Vietnamien cultivé du nom de Pham Thuan, avec lequel j’avais beaucoup appris sur la population amphibienne des rives du Mékong et dont je m’étais fait un ami rare en lui révélant la musique de Monteverdi et de Gabriel Fauré, que nous inaugurâmes cette coutume de fin de journée dès le début du mois de juin de cette année-là.
Pham étant fort apprécié de tous, et la splendide Ariane, que j’appelais la Vestale de la Ressource, s’étant jointe à nous en nous proposant le déplacement à bord de sa vaste Chevy blanche, notre groupuscule devint bientôt une jolie bande qui se retrouva parfois, aussi, les fins de semaine et les dimanches sur la moelleuse moquette végétale de Rivebelle.
Ariane m’avait désormais à la bonne: elle m’était reconnaissante de lui donner de précieux conseils tactiques ou psychologiques à propos de cas parfois épineux, puis (détail cocasse en ce qui concerne le personnage entièrement chaste que je représente) elle fut impressionnée par la douceur nacrée de ma peau tout imberbe, elle me dit que je lui avais fait découvrir un nouveau concept de sensualité malgré mon air de clerc anachronique, enfin elle fut heureuse de trouver en moi un partenaire de ping-pong aussi vif que certains play-boys de sa connaissance, et ma courtoisie fit le reste, ma neutralité complète en matière galante et ma courtoisie.
Et de fait, ma façon d’être absolument libre, mais aussi tout pur, étonnait et séduisait même mes jeunes compagnons. Mes questions très précises mais bienveillantes sur leurs moeurs respectives, loin de les gêner, s’étaient naturellement incorporées dans l’ensemble de nos discussions sur le sens de la vie ou des changements de la société, les fluctuations du yen ou la valeur de l’amitié, les merveilles du monde animal qu’ils ne se lassaient pas de m’entendre détailler ou les peines de coeur de celle-ci, les soucis domestiques de celui-là.
La profonde mélancolie que j’avais éprouvée, après la mort de Rose, se trouvait ainsi allégée par le bain et la conversation. Du vivant de Rose, nous avions toujours nagé, été comme hiver, mon seul regret étant de ne pouvoir planer et plonger dans les airs comme les oiseaux voiliers, les fous de Bassan que nous avions observés en Ecosse ou nos majestueux aigles de montagne.
Avec Pham Thuan, deux apprentis aux corps lisses et flexibles m’accompagnaient volontiers et nous faisions des concours de brasse coulée avant de nous étendre sur la pelouse et de confronter nos vues sur l’avenir de l’espèce.
- Pensez-vous réellement, Gottlieb, me demandait Valerio, que les insectes soient amenés un jour à supplanter le genre humain à moyen ou plus long terme ?
Je restais mesuré dans ma réponse, tout en répétant ce que m’avait longuement expliqué un autre de mes correspondants, le professeur huguenot Théodore M. du Musée de l’Homme, à Paris, pour lequel cette éventualité était à prendre en considération.
Ou nous parlions de la possibilité constante de se régénérer en quelque situation qu’on se trouve, qu’on soit larve de libellule ou mineur aux Asturies; et quelque chose se passait entre nous: il nous suffisait de rester là, sur l’herbe, le corps comme épuré par la lumière et l’eau chlorée, pour échanger des opinions purgées de l’ordinaire indifférence et nous sentir des ailes.
Ce fut une belle saison de notre bref séjour terrestre et ma façon, aussi, de prendre congé de la Maison.
Tout à coup, en effet, j’eus envie d’apprendre d’autres langues et de voyager un peu partout. J’eus envie de rajeunir extérieurement aussi et de me dépouiller de mes camisoles. Mais au préalable, j’eus besoin de parler de Rose à mes jeunes amis.
Rose m’a donné les couleurs, commençai-je de raconter au crépuscule diaphane d’un des derniers jours de l’été indien de cette année-là. Rose m’a révélé les couleurs qu’il y avait en moi. Rose a pressenti ma rêverie et l’a protégée. C’est une prescience assez rare aujourd’hui où l’on prétend tout soumettre à l’efficace, mais c’est ce que je puis vous dire avant de m’en aller par les chemins: ne permettez pas qu’on vous empêche de vous abandonner à la rêverie, il n’y a qu’elle qui nous fera concevoir le bon monde de demain.
Je ne leur ai pas parlé de mes cauchemars, qui donnaient à ce que je disais de la rêverie son soubassement vrai. Plus exactement, je n’ai parlé de mes cauchemars qu’avec Pham Thuan, en lequel je m’étais découvert comme un frère. Je n’ai pas été surpris de constater, en me confiant à cet homme délicat à l’épouse silencieuse et aux beaux enfants musiciens, que tout ce que j’avais cauchemardé trente-trois ans plus tôt lui rappelait les récits de son père à Da Nang.
Aux autres j’ai dit, surtout, que les couleurs n’avaient rien à voir avec une parure cosmétique. Je leur ai dit qu’un aveugle savait les couleurs. Je leur ai dit que les lignes de la sculpture participaient de la couleur et que ressentir la couleur, en ce qui me concernait, m’était une façon d’assurer, selon leur maudite expression.
Mais les mots vous savez, leur ai-je dit, les mots on les prend, on les essaie, on essaie de les ajuster au sentiment ou à ce qu’on ressent par le ventre, et la plupart du temps ça ne suffit pas, les mots ne sont pas tout à fait adéquats, pourtant il ne faut pas jeter les mots, il vaut mieux les garder dans son atelier en cherchant des couleurs, parce que la couleur c’est autre chose que les mots, la couleur et la mélodie.
Enfin je leur ai dit, pour parachever ma litanie grave, je leur ai dit de faire bien attention.
Je leur ai dit que l’inattention était la perte des couleurs et qu’avec elle nous venait l’indifférence et la mort annoncée. Je leur ai dit que je ne pourrais plus, pour ma part, assurer à La Vie assurée. Je leur ai dit que je les libérais de mon fardeau, et ils ont protesté pour la forme, mais tous savaient aussi que je ne les quittais pas absolument.
Parfois l’un ou l’autre m’envoie un mail, me demande quand je serai de passage en notre ville, et me propose une entrevue, selon l’expression désormais assortie d’un sourire. C’est toujours moi qui les reçois, le plus souvent au jardin, dont la femme de Pham est chargée de l’entretien en échange de la jouissance, par la famille de mon ami, de notre maison des Oiseaux.
Je ne suis plus, pour ma part, qu’une sorte de nomade à vie. Tous les matins que Dieu fait je me sens des ailes. Il n’y a plus guère que mes cauchemars qui m’empêchent de vraiment assurer... -
Force douce de la pensée
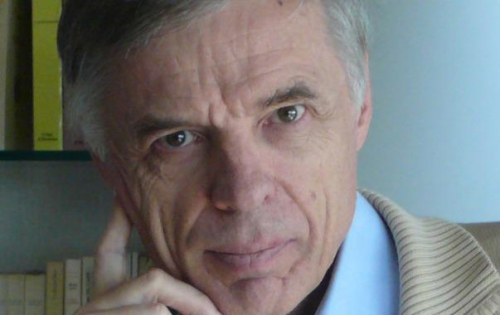
Après les multiples attentats d'inspiration islamiste commis ces dernières années, la lecture de Vertige de la force, essai documenté et pénétrant d'Etienne Barilier, paru en 2017 s'impose décidément.
Dans la foulée, nous revenons, en cet été 2018, au Barilier romancier, avec un grand roman d'immersion historico-existentiel intitulé Dans Khartoum assiégée, qui sonde les tenants mystico-stratégiques de la dérive terroriste islamique actuelle, dans un Soudan de la fin du XIXe siècle où apparut le Mahdi se réclamant directement du Prophète, contre lequel les Anglais envoyèrent le fameux colonel Gordon, qui y laissa sa peau.
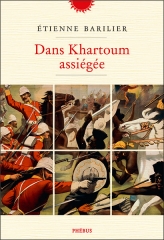
Le contraire de la violence n’est pas tant la non-violence que la pensée, écrivait Etienne Barilier dans son mémorable essai intitulé La ressemblance humaine, et le nouvel ouvrage qu’il vient de publier sous le titre de Vertige de la force, bref mais très dense, et surtout irradiant de lumière intelligente, en est la meilleure preuve, qui conjugue la pensée de l’auteur et celles de quelques grands esprits européens, de Simone Weil à Thomas Mann ou de Goethe à Jules Romains ou Paul Valéry, notamment, contre les forces obscures du fanatisme religieux ou pseudo-religieux.
Vertige de la force est à la fois un texte d’urgence, amorcé sous le coup de l’émotion ressentie lors des attentats du 7 janvier 2015, et conclu après le carnage du 13 novembre, et une réflexion s’imposant la mise à distance et le décentrage par rapport aux formules-choc et autres interprétations hâtives assenées sur le moment, les unes prenant la défense des assassins contre les caricaturistes de Charlie-Hebdo (« Ils ont vengé Dieu ! ») et d’autres invoquant un Occident qui n’aurait « rien à offrir » à la jeunesse en mal d’idéal, voire d’absolu.
Etienne Barilier n’est pas du genre à se répandre sur les plateaux de télé ou par les réseaux sociaux, mais il n’est pas moins attentif aux débats intellectuels en cours, et c’est ainsi que sa réflexion recoupe ici celles de plusieurs figures de l’intelligentsia musulmane, tels Abdelwahab Meddeb et Abdennour Bidar,notamment.
Humaniste immensément cultivé, traducteur et chroniqueur, romancier et conférencier, Barilier, auteur d’une cinquantaine de livres, a consacré plusieurs essais au dialogue ou aux confrontations entre cultures et (notamment dans Le grand inquisiteur) au thème de la violence commise au nom de Dieu.
Or ce qui frappe, à la lecture de Vertige de la force, c’est la parfaite limpidité de son propos et la fermeté avec laquelle il défend l’héritage d’une culture qui nous a fait dépasser le culte des puissances ténébreuses et de la force, sans oublier la longue et sanglante histoire d’une chrétienté conquérante oublieuse de son fonds évangélique.
Les thèmes successifs de Vertige de la force sont la définition du crime de devoir sacré, le scandale d’une idéologie religieuse faisant de la femme une esclave de l’homme et de l’homme un esclave de Dieu, la difficulté pour les intellectuels musulmans de réformer leur religion « de l’intérieur », la conception particulière du temps musulman, la typologie du guerrier djihadiste et, faisant retour à l’Occident, l’étrange fascination exercée sur les meilleurs esprits (tel Ernst Jünger devant la guerre, ou Heidegger devant l’abîme) par la force et les puissances obscures ramenant au «fond des âges ».
Le crime de devoir sacré
 Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.
Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes. Or il est une autre sorte de crime millénaire, conjuguant la violence des deux espèces, qu’on peut dire le« crime de devoir sacré ». Parce qu’ils étaient blasphémateurs, les collaborateurs de Charlie Hebdo répondaient de l’offense faite à Dieu et à son prophète. Parce qu’elles étaient juives, les victimes de la Porte de Vincennes méritaient le châtiment des « infidèles », de même que les 140 étudiants chrétiens massacrés en mars 2015 dans la ville kényane de Garissa. Quant à la tuerie aveugle de novembre 2015, elle illustra finalement la force à l’état pur, dirigée contre tous ceux qui étaient supposés se vautrer dansl’impureté.
Mais l’obsession de la pureté n’a-t-elle pas fait, aussi , des ravages dans notre propre histoire ?
À ceux qui, avec quelle démagogie nihiliste, affirment que nous n’avons« rien à offrir » à la jeunesse désemparée, Etienne Barilier répond qu’au contraire les leçons que nous pouvons tirer de notre histoire sont un legs précieux, tout au moins à ceux qui sont disposés à le recevoir.
« Notre propre histoire montre que le crime de devoir sacré fut jadis, et même naguère, un de nos crimes préférés. Mais elle montre aussi qu’il ne l’est plus. Montesquieu, dans son Esprit des Lois, écrit cette phrase décisive :« Il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais ».
Les martyrs écorchés vifs et brûlés pour la plus grande gloire du Dieu catholique et apostolique n’ont-ils « rien à voir » avec la chrétienté ? Ce serait pure tartufferie que de le prétendre. Mais accompagnant les conquérants espagnols, le moine Las Casas consigne un témoignage accablant qui exprime une révolte contre la force de l’Eglise, de même que Sébastien Castellion s’opposera à Calvin quand celui-ci fera brûler le médecin« hérétique » Michel Servet. C’est d’ailleurs à Castellion qu’on empruntera, en janvier 2015, sa fameuse sentence selon laquelle « tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme ».
Or, de la controverse de Valladolid opposant Las Casas au Grand Inquisiteur, notamment sur la question de savoir si les Indiens ont une âme, jusqu’au jour de 1959 où le bon pape Jean XXIII abrogea la formule de l’oraison du Vendredi saint évoquant les « perfides juifs », nous aurons fait quelques petits progrès dans l’esprit du Christ...
« S’il faut reconnaître ce que nous fîmes, ce n’est pas pour oublier ce que nous sommes », remarque Barilier. Est-ce dire que nous soyons devenus meilleurs ? Disons plutôt que notre rapport avec la force s’est transformé.
À cet égard, évoquant l’héritage décisif d’un Pierre Bayle, qui affirme, après la révocation de l’édit de Nantes et contre le « forcement des consciences » autorisant les dragonnades, que « tout sens littéral qui contient l’obligation de faire des crimes est faux », Barilier le souligne : « La voilà, la lecture en esprit, celle dont on attend qu’elle soit appliquée au Coran comme à la Bible. Ce n’est qu’une question de temps, disent les optimistes. Hélas, nous verrons que le temps de l’islam n’est peut-être pas le nôtre ».
« Oui, nous avons fait la même chose, mais précisément, nous ne le faisons plus. Oui, nous avons comme le crime de devoir sacré, mais ce crime est désormais, pour nous, la chose la plus abominable qui soit ».
Sacrées bonnes femmes !
 Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...
Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle... Distinguant ces crimes de devoir sacré des crimes « de raison » du communisme athée, Barilier relève que dans les deux cas (nazis et terroristes islamiques) « le pouvoir qu’on détient physiquement sur autrui fait procéder à sa destruction morale. Et cette destruction se fait dans l’ivresse sacrée ».
Par le crime de devoir sacré, le tueur exerce un pouvoir absolu, divinement justifié. Or ce pouvoir absolu est le même qui justifie la soumission de la femme à l’homme et l’esclavage de celui-ci au Dieu censé le« libérer ».
Un chapitre à vrai dire central, intitulé Marguerite au rouet, puis sous la hache, constitue l’une des pierres d’achoppement essentielles de Vertige de la force, ou le double pouvoir de l’homme, en vertu de « la loi du plus fort », et de Dieu, continue aujourd’hui de s’imposer à la femme en vertu de préceptes prétendus sacrés.
« Avec l’islamisme, religion qui s’est élaborée dans une société profondément patriarcale, Dieu frappe la femme d’infériorité. Les hommes, dit le Coran, prévalent sur les femmes ».
Mais qui écrit cela ? Un infidèle fieffé ? Nullement : c’et l’Egyptien Mansour Fahmy, dans une thèse présentée en Sorbonne en 1913, sur La Condition de la femme dans l’islam, qui lui vaudra d’être interdit d’enseignement dans son pays et d’y mourir rejeté.
Toujours étonnant par ses rapprochements, Etienne Barilier parle ensuite des souvenirs d’enfance de l’écrivain algérien Rachid Boudjedra, dans La prise de Gibraltar, qui évoque l’acharnement avec lequel un vieillard, « maître de Coran », l’oblige à répéter la fameuse sourate de la vache concluant à l’impureté de la femme, et donc de sa mère, quitte à le battre pour sa réticence avant que son propre père, voire sa mère elle-même, n’en rajoutent ! ».
Sur quoi Barilier, après l’exemple d’un autre écrit éloquent de l’auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane, bifurque sur le sort tragique, et combien révélateur aussi, de Marguerite dans le Faust de Goethe : « La force dans le Dieu qui tue ; la force dans l’oppression des femmes. Ces deux violences se rejoignent étrangement, tout en paraissant se situer aux deux extrémités de l’humain ; le sacré, et les muscles. Mais on a vu que leur lien ne pourrait pas être plus intime : la violence la plus physique prend un sens moral dès lors qu’elle est humaine, et la violence qui prétend trouver sa source dans l’exigence la plus haute, celle de Dieu, est précisément celle qui débouche sur l’usage le plus meurtrier de la brutalité physique. »
Du perdant au guerrier radical
Etienne Barilier ne parle ni de ce qui, socialement ou culturellement, pousse tel jeune à se radicaliser, ni de la« gestion » française des banlieues ni de l’implication du complexe militaro-industriel de l’Empire américain dans la déstabilisation du Moyen-Orient, ni non plus de ce qui rapproche ou distingue un « fou deDieu » à l’ancienne manière russe d’un djihadiste du soi-disant Etat islamique.
Pour autant, l'on ne saurait lui reprocher de se cantonner dans les nuées. Ainsi, à propos de Boko Haram, établit-il un parallèle entre les extrémistes iconoclastes ennemis de toute culture et de tout livre autre que le Coran, et l’Armée de résistance du Seigneur sévissant en Ouganda sous la direction du redoutable Joseph Kony, mélange d’intégriste biblique et de sorcier animiste, terrorisant les populations avec son armée d’enfants soldats et dont on estime les massacres à plus de 100.000 personnes en 25 ans, au nom du seul Dieu juste…
« Sans nul doute », écrit Barilier, moyennenat les distorsions qui s’imposent, n’importe quelle parole divine, y compris celle de l’Evangile, peut devenir un bréviaire de la haine ».
Cela étant, il faut reconnaître que la force n’a pas le même statut dans l’Evagile et le Coran.
« Il n’est que trop vrai que la chrétienté a mis fort longtemps avant de commencer à comprendre le christianisme », écrit Barilier, qui cite l’historien Jean Flori auteur de Guerre sainte, jihad,croisade, violence et religion dans la christianisme et l’islam, établissant la légitimation, par le prophète, de l’action guerrière, au contraire du Christ : « La doctrine du Coran tout comme la conduite du prophète d’Allah sont, sur le point de la violence et de la guerre, radicalement contraires à la doctrine des Evangiles et à l’attitude de Jésus ».
Or à ce propos, les interprètes les plus progressistes du Coran n’en finissent pas (à nos yeux en tout cas) de tourner en rond dans une sorte de cercle coupé du temps, tel qu’on le constate dans les thèses de Mahmoud Mohammed Taha, que Barilier surnomme le « martyr inquiétant », auteur soudanais d’Un islam à vocation libératrice, qui s’ingénie à voir dans l’islam la quintessence de la démocratie et de la liberté tout en prônant la soumission volontaire de l’homme à Dieu et de la femme à l’homme. Or découvrant des phrases de cet improbable réformateur affirmant, après avoir défendu l’usage du sabre « comme un bistouri de chirurgien » que « la servitude équivaut à la liberté », annonçant en somme la novlangue d'un Orwell ou d'un Boualem Sansal, l’on est interloqué d’apprendre que Taha, jugé trop moderniste ( !) finit pendu à Khartoum en janvier1985.
La deuxième pierre d’achoppement fondamentale, dans Vertige de la force, tient à la conception du temps dans la vision musulmane, bonnement nié au motif qu’il n’y a pas d’avant ni d’après l’islam.
« La temporalité islamique n’est ni linéaire ni circulaire ; elle est abolie », écrit Barilier en citant les assertions de Taha selon lequel l’Arabie du VIIe siècle était déjà dans la modernité, que L’islam en tant que religion « apparut avec le premier être humain » et que l’islam englobe toute la philosophie et toute la science qui prétendraient être nées après lui.
Or cette conception « fixiste » n’explique pas seulement l’énorme « retard » pris, depuis le Moyen Âge, par les cultures arabo-musulmanes : elle justifie une prétendue« avance » qui se dédouane en invoquant la perte de toute spiritualité et de tout réel « progrès » dans la civilisation occidentale.
En prolongement de ces observations sur ce profond décalage entre deux conceptions du monde, Barilier revient à un essai de l’écrivain Hans Magnus Enzensberger, datant de 2006, intitulé Le perdant radical et dans lequel était présenté une sorte de nouvel homme du ressentiment fabriqué par notre société capitaliste et concurrentielle où le désir de reconnaissance exacerbe autant les envies que la frustration et l’intolérance.
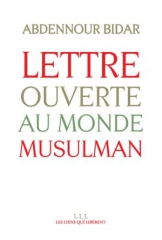 Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.
Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.Et de comparer les terroristes à ces « perdants radicaux » qui, en Occident, compensent leurs propres frustrations en mitraillant les élèves d’un collège ou en « pétant les plombs » de multiples façons.
Or s’agissant des djihadistes islamiques, Etienne Barilier préfère, à la formule de « perdant radical », celle de« guerrier radical », dans la mesure où leur ivresse criminelle se déchaîne dans un cadre prétendu sacré. Or il va de soi que cette « force pure » n’a plus rien à voir avec l’islam que défendait un Mohammed Taha. « Oui, la rage de destruction et de mort – le « vive la mort » - des groupes terroristes islamistes est un moteur plus puissant et plus enivrant que les religions qui leur donnent base légale, caution morale ou verbiage justificatif ».
Dans la lumière d’Engadine
 La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.
La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.La base de cette dernière étape de l’essai de Barilier,avant sa conclusion beaucoup plus lumineuse, est la rencontre historique à Davos, en 1929, de deux grandes figures de l’intelligentsia allemande du XXe siècle, en les personnes d’Ernst Cassirer, modèle d’humaniste attaché à la Raison, à la noblesse du langage et au respect de la forme dont Thomas Mann semble avoir préfiguré les positions dans le personnage du Settembrini de La Montagne magique, alors que l'ombrageux Naphta, mystique anti-bourgeois, annonce (plus ou moins...) un Heidegger rejetant ou dépassant les catégories kantiennes.
 Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...
Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...Comme il s’est défendu ailleurs de procéder par« amalgames », épouvantail commode de ceux qui refusaient a priori de penser après les tragédies de l’an dernier, Barilier se garde d’établir un lien de causalité directe entre la pensée de Heidegger et le déchaînement de la force nazie, « modèle infâme de la force islamiste ». Et pourtant… Et pourtant, il se trouve que certains penseurs iraniens islamisants ont bel et bien fait de Heidegger leur maître à penser en matière de programme identitaire, qu’ils prétendent mieux connaître que tous les Infidèles.
Heidegger ? « Le style de la nuit, donc. Et de l’Abgrund, l’abîme. Un « Abgrund » évidemment sans commune mesure avec les abîmes nazis. Mais ce qui reste vrai, c’est que tout choix de l’abîme, tout refus de la raison humaine, de l’exigence des Lumières, du dialogue dans la lumière, menace d’asservir l’homme au pouvoir de la force ».
Au moment de la libération de Paris, dans un texte intitulé Respirer, Paul Valéry écrivit ceci : « La liberté est une sensation. Cela se respire. L’idée que nous sommes libres dilate l’avenir du moment ».
Parce qu’il est aussi artiste, romancier et musicien, Etienne Barilier sait d’expérience que la liberté est forme, qui doit certes accueillir la force pour exister. Mais « la force de la forme n’est plus force qui tue. C’est la force domptée par la forme, qui n’en garde que l’élan.Ou encore : la forme c’est la patience de la force ». De même Simone Weil parlait-elle d’ »une autre force qui est le rayonnement de l’esprit ».
Tel étant le trésor de mémoire, et de pensée revivifiée, que nous pouvons redécouvrir et transmettre, au dam de ceux –là qui pensent que nous n’avons plus « rien à donner »…
Etienne Barilier. Vertige de la force. Buchet-Chastel, 117p.
Etienne Barilier. Dans Khartoum assiégée. Phébus, 495p.
-
L'Ouvroir
 (Trésor de JLK, IV)«Je regarde comme le plus grand mal de notre siècle, qui ne laisse rien mûrir, cette avidité avec laquelle on dévore à l’instant tout ce qui paraît. On mange son blé en herbe. Rien ne peut assouvir cet appétit famélique qui ne met en réserve pour l’avenir. N’avons-nous pas des journaux pour toutes les heures du jour ? Un habile homme en pourrait encore intercaler un ou plusieurs. Par là tout ce que chacun fait, entreprend, compose, même ce qu’il projette, est traîné sous les yeux du public. Personne ne peut éprouver une joie, une peine, qui ne serve au passe-tenps des autres. Et ainsi chaque nouvelle court de maison en maison, de ville en ville, de royaume en royaume, et enfin d’une partie du monde à une autre, avec une effrayante rapidité».(Goethe, Maximes et réflexions)°°°« Ce cœur ne s’entend plus avec les cœurs, ce cœur ne reconnaît plus personne dans la foule des cœursDes cœurs sont pleins de cris, de bruits, de drapeauxCe cœur n’est pas à l’aise avec ces cœursCe cœur se cache loin de ces cœursCe cœur ne se plaît pas avec ces cœurs ».(Henri Michaux)°°°« Poète nouveau. Retenez bien ce nom, car on n’en parlera plus »…(Jules Renard, Journal)°°°«Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Michel Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle»…(Sébastien Castellion, Traité des hérétiques)°°°« Quand on l’entendait parler, on disait: c’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait: c’est un charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : c’est le bourreau. Au repos, il lui sortait de la bouche une dent».(Victor Hugo)°°°«Si les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus. »(Jules Renard)°°°« Ô Grand Staline, ô chef des peuplesToi qui fais naître l’hommeToi qui fécondes la terreToi qui rajeunis les sièclesToi qui fait fleurir le printempsToi qui fais vibrer les cordes musicalesToi splendeur de mon printemps, toiSoleil reflété par les milliers de cœurs ».(Louis Aragon)°°°«Un monde qui devient de plus en plus irréel à mesure qu'il s'évapore en pur spectacle, qu'il n'existe que pour être vu».(Gustave Thibon)°°°Louis Calaferte : «Toute cette jeunesse en allée… »Et moi : « Mais non, vieux con : toute cette enfance qui revient »…«À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »« Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », etc.(Christophe Ransmayr, Atlas d’un homme inquiet)°°°« Moi je n’ai rien contre les étrangers, mais… » ; « enfin les Juifs, tu sais, quand même… » ; « d’ailleurs les homos, faut les comprendre, pourtant… » ; « et de toute façon, on est bien d’accord, les femmes… » ; « mais tu ne vas pas nier que les Grecs et le travail… »°°°« Après son dernier voyage, Gulliver ne supporte plus l'odeur humaine, et pour pouvoir respirer, va se réfugier dans l'écurie auprès des chevaux ».(Simon Leys, à propos du génocide au Cambodge)°°°«Le premier mouvement des uns est de consulter les livres ; le premier mouvement des autres est de regarder les choses».(Paul Valéry)°°°«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge».(Voltaire)Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire.
(Trésor de JLK, IV)«Je regarde comme le plus grand mal de notre siècle, qui ne laisse rien mûrir, cette avidité avec laquelle on dévore à l’instant tout ce qui paraît. On mange son blé en herbe. Rien ne peut assouvir cet appétit famélique qui ne met en réserve pour l’avenir. N’avons-nous pas des journaux pour toutes les heures du jour ? Un habile homme en pourrait encore intercaler un ou plusieurs. Par là tout ce que chacun fait, entreprend, compose, même ce qu’il projette, est traîné sous les yeux du public. Personne ne peut éprouver une joie, une peine, qui ne serve au passe-tenps des autres. Et ainsi chaque nouvelle court de maison en maison, de ville en ville, de royaume en royaume, et enfin d’une partie du monde à une autre, avec une effrayante rapidité».(Goethe, Maximes et réflexions)°°°« Ce cœur ne s’entend plus avec les cœurs, ce cœur ne reconnaît plus personne dans la foule des cœursDes cœurs sont pleins de cris, de bruits, de drapeauxCe cœur n’est pas à l’aise avec ces cœursCe cœur se cache loin de ces cœursCe cœur ne se plaît pas avec ces cœurs ».(Henri Michaux)°°°« Poète nouveau. Retenez bien ce nom, car on n’en parlera plus »…(Jules Renard, Journal)°°°«Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Michel Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle»…(Sébastien Castellion, Traité des hérétiques)°°°« Quand on l’entendait parler, on disait: c’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait: c’est un charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : c’est le bourreau. Au repos, il lui sortait de la bouche une dent».(Victor Hugo)°°°«Si les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus. »(Jules Renard)°°°« Ô Grand Staline, ô chef des peuplesToi qui fais naître l’hommeToi qui fécondes la terreToi qui rajeunis les sièclesToi qui fait fleurir le printempsToi qui fais vibrer les cordes musicalesToi splendeur de mon printemps, toiSoleil reflété par les milliers de cœurs ».(Louis Aragon)°°°«Un monde qui devient de plus en plus irréel à mesure qu'il s'évapore en pur spectacle, qu'il n'existe que pour être vu».(Gustave Thibon)°°°Louis Calaferte : «Toute cette jeunesse en allée… »Et moi : « Mais non, vieux con : toute cette enfance qui revient »…«À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »« Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », etc.(Christophe Ransmayr, Atlas d’un homme inquiet)°°°« Moi je n’ai rien contre les étrangers, mais… » ; « enfin les Juifs, tu sais, quand même… » ; « d’ailleurs les homos, faut les comprendre, pourtant… » ; « et de toute façon, on est bien d’accord, les femmes… » ; « mais tu ne vas pas nier que les Grecs et le travail… »°°°« Après son dernier voyage, Gulliver ne supporte plus l'odeur humaine, et pour pouvoir respirer, va se réfugier dans l'écurie auprès des chevaux ».(Simon Leys, à propos du génocide au Cambodge)°°°«Le premier mouvement des uns est de consulter les livres ; le premier mouvement des autres est de regarder les choses».(Paul Valéry)°°°«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge».(Voltaire)Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire. -
L'Ouvroir
 (Trésor de JLK, III)« L'univers, ou le multivers, infiniment grand ou petit, se rit de vous, de vos prétentions, de votre idiotie. Il est mort de rire, l'univers, en considérant votre dimension d'insecte ».« De toute façon, Dieu, s'il existe, semble considérer de très loin ce bordel ».(Philippe Sollers)°°°« Votre société s'ingénie à rendre le désespoir attrayant ».(Thierry Vernet)°°°« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour "m'en tirer" !). La machine à laver a de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais ».(Thierry Vernet)°°°« Essi sempre umili / essi sempre deboli / essi sempre timidi / essi sempre infimi /essi sempre colpevoli / essi sempre suditi / essi sempre piccoli ». Eppoi: « Ils amèneront des enfants et le pain et le fromage dans les papiers d'emballage du Lundi de Pâques ».(Pier Paolo Pasolini)°°°« De la mer le limon a recouvert le lit / Le sol fertilisé est devenu culture / On croirait voir l’Egypte en ce coin de nature / Qui n’était que rivage au navigant hardi ».(Le Tasse)« La caresse vient comme le vent, elle ouvre un volet, mais elle n’entre pas si la fenêtre est fermée ».(Guido Ceronetti)°°°« Il faut écrire comme on parle, si on parle bien ».« La poésie m’a sauvé de l’infecte maladie de la rosserie ».«Quelque chose de plus déplaisant que l’arrivisme, c’est l’étalage de la modestie ».(Jules Renard)°°°« Nous vivons dans une société sombre. Réussir, voilà l’enseignement qui tombe goutte à goutte de la corruption en surplomb. Soit dit en passant, c’est une chose assez hideuse que le succès. Sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes. Pour la foule, la réussite a presque le même profil que la suprématie. (…) De nos jours, une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui, porte la livrée du succès, et fait le service de son antichambre. Réussissez : théorie. Prospérité suppose capacité. Gagnez à la loterie, vous voilà un habile homme. Qui triomphe est vénéré. Naissez coiffé, tout est là. Ayez de la chance, vous aurez le reste ; soyez heureux, on vous croira grand. En dehors de cinq ou six exceptions immenses qui font l’éclat d’un siècle, l’admiration contemporaine n’est guère que myopie. Dorure est or. Être le premier venu, cela ne gâte rien, pourvu qu’on soit le parvenu. Le vulgaire est un vieux Narcisse qui s’adore lui-même et qui applaudit le vulgaire. Cette faculté énorme par laquelle on est Moïse, Eschyle, Dante, Michel-Ange ou Napoléon, la multitude la décerne d’emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit. Ils confondent avec les constellations de l’abîme, les étoiles que font dans la vase molle du bourbier, les pattes des canards ».(Victor Hugo)°°°«Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».(Jean Clair)°°°« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ; les propos de table sont des fumées ».(Victor Hugo)°°°« Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à plat contre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus son épaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de la valise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais que mon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son éèaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.Ainsi Hugo est associé à mes plus chères affections ».(Georges Piroué)°°°« Nous sommes en perplexité, mais pas désespérés ».(Charles du Bos)Peinture JLK: Lago delle streghe al Devero.
(Trésor de JLK, III)« L'univers, ou le multivers, infiniment grand ou petit, se rit de vous, de vos prétentions, de votre idiotie. Il est mort de rire, l'univers, en considérant votre dimension d'insecte ».« De toute façon, Dieu, s'il existe, semble considérer de très loin ce bordel ».(Philippe Sollers)°°°« Votre société s'ingénie à rendre le désespoir attrayant ».(Thierry Vernet)°°°« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour "m'en tirer" !). La machine à laver a de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais ».(Thierry Vernet)°°°« Essi sempre umili / essi sempre deboli / essi sempre timidi / essi sempre infimi /essi sempre colpevoli / essi sempre suditi / essi sempre piccoli ». Eppoi: « Ils amèneront des enfants et le pain et le fromage dans les papiers d'emballage du Lundi de Pâques ».(Pier Paolo Pasolini)°°°« De la mer le limon a recouvert le lit / Le sol fertilisé est devenu culture / On croirait voir l’Egypte en ce coin de nature / Qui n’était que rivage au navigant hardi ».(Le Tasse)« La caresse vient comme le vent, elle ouvre un volet, mais elle n’entre pas si la fenêtre est fermée ».(Guido Ceronetti)°°°« Il faut écrire comme on parle, si on parle bien ».« La poésie m’a sauvé de l’infecte maladie de la rosserie ».«Quelque chose de plus déplaisant que l’arrivisme, c’est l’étalage de la modestie ».(Jules Renard)°°°« Nous vivons dans une société sombre. Réussir, voilà l’enseignement qui tombe goutte à goutte de la corruption en surplomb. Soit dit en passant, c’est une chose assez hideuse que le succès. Sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes. Pour la foule, la réussite a presque le même profil que la suprématie. (…) De nos jours, une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui, porte la livrée du succès, et fait le service de son antichambre. Réussissez : théorie. Prospérité suppose capacité. Gagnez à la loterie, vous voilà un habile homme. Qui triomphe est vénéré. Naissez coiffé, tout est là. Ayez de la chance, vous aurez le reste ; soyez heureux, on vous croira grand. En dehors de cinq ou six exceptions immenses qui font l’éclat d’un siècle, l’admiration contemporaine n’est guère que myopie. Dorure est or. Être le premier venu, cela ne gâte rien, pourvu qu’on soit le parvenu. Le vulgaire est un vieux Narcisse qui s’adore lui-même et qui applaudit le vulgaire. Cette faculté énorme par laquelle on est Moïse, Eschyle, Dante, Michel-Ange ou Napoléon, la multitude la décerne d’emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit. Ils confondent avec les constellations de l’abîme, les étoiles que font dans la vase molle du bourbier, les pattes des canards ».(Victor Hugo)°°°«Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».(Jean Clair)°°°« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ; les propos de table sont des fumées ».(Victor Hugo)°°°« Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à plat contre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus son épaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de la valise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais que mon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son éèaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.Ainsi Hugo est associé à mes plus chères affections ».(Georges Piroué)°°°« Nous sommes en perplexité, mais pas désespérés ».(Charles du Bos)Peinture JLK: Lago delle streghe al Devero. -
Ceux qui ne se laissent pas abattre
 Celui qui se plaint à sa jambe de bois qui lui répond que ça la gratte un peu là mais que c’est pas grave Gustave / Celle qui estime que le dégoût n’est question que de goût / Ceux qui ne s’estimeront battus qu’abattus mais c’est pas demain la veille / Celui qui constate qu’il écrit le mieux quand ça va le plus mal / Celle qui demande à Dieu de faire ce matin un effort / Ceux qui ne se plaignent de rien vu qu’il leur reste moins encore / Celui qui écrit pour son tiroir qui n’aspire (croit-il) qu’à s’ouvrir à l’avenir / Celle qui entrevoit de la lumière au bout du couloir / Ceux qui à l’enterrement de son amant disent comme ça à Solange qu’à présent on continue / Celui qui en tant que chien battu comprend le chat échaudé / Celle qui s’en remet au pasteur qui lui dit je vous entends ma sœur / Ceux qui boitent pour se faire prendre en stop / Celui qui prend des nouvelles du Soudan pour se donner du cran / Celle qui prend les coups avec le sourire sauf quand (c’est normal) ça fait trop mal / Ceux qui recommandent à Jean-Patrice en dépression de « penser un peu à Gaza » / Celui qui externalise son optimisme au titre de la monétisation des potentiels / Celle qui se débat dans les filets d’un rabat-joie / Ceux qui décrient plutôt l’impolitesse du désespoir / Celui qui remonte la pente avec l’aide de Nestor son nouveau rollator / Celle qui s’impose en abattant ses cartes / Ceux qu’on croit abattre comme des chênes et qui s’en relèvent non sans peine mais quand même, etc.Peinture: Robert Indermaur
Celui qui se plaint à sa jambe de bois qui lui répond que ça la gratte un peu là mais que c’est pas grave Gustave / Celle qui estime que le dégoût n’est question que de goût / Ceux qui ne s’estimeront battus qu’abattus mais c’est pas demain la veille / Celui qui constate qu’il écrit le mieux quand ça va le plus mal / Celle qui demande à Dieu de faire ce matin un effort / Ceux qui ne se plaignent de rien vu qu’il leur reste moins encore / Celui qui écrit pour son tiroir qui n’aspire (croit-il) qu’à s’ouvrir à l’avenir / Celle qui entrevoit de la lumière au bout du couloir / Ceux qui à l’enterrement de son amant disent comme ça à Solange qu’à présent on continue / Celui qui en tant que chien battu comprend le chat échaudé / Celle qui s’en remet au pasteur qui lui dit je vous entends ma sœur / Ceux qui boitent pour se faire prendre en stop / Celui qui prend des nouvelles du Soudan pour se donner du cran / Celle qui prend les coups avec le sourire sauf quand (c’est normal) ça fait trop mal / Ceux qui recommandent à Jean-Patrice en dépression de « penser un peu à Gaza » / Celui qui externalise son optimisme au titre de la monétisation des potentiels / Celle qui se débat dans les filets d’un rabat-joie / Ceux qui décrient plutôt l’impolitesse du désespoir / Celui qui remonte la pente avec l’aide de Nestor son nouveau rollator / Celle qui s’impose en abattant ses cartes / Ceux qu’on croit abattre comme des chênes et qui s’en relèvent non sans peine mais quand même, etc.Peinture: Robert Indermaur -
Comme un exorcisme
 Tout à coup ce serait ce noirdevant tes yeux ouverts,comme un présage du revoirau regard de travers:tu t’en irais avant le tempsoù tu ferais semblantmine de rien, tu serais làà braver le trépas …Les autres vont en symphoniecélébrer la foisonet les lois de famille normale,toutes les tractationset les notions considérablesà l’appui national -mais toi tu fais le mort…Vivants vous êtes magnifiques,partout où vous allez ,les arbres et les chevaux ailés,les femmes déliées,les garçons de vigueur antique -je m’efface au fond du sourireignorant des empires…Piero della Francesca: Polyptique de la miséricorde.
Tout à coup ce serait ce noirdevant tes yeux ouverts,comme un présage du revoirau regard de travers:tu t’en irais avant le tempsoù tu ferais semblantmine de rien, tu serais làà braver le trépas …Les autres vont en symphoniecélébrer la foisonet les lois de famille normale,toutes les tractationset les notions considérablesà l’appui national -mais toi tu fais le mort…Vivants vous êtes magnifiques,partout où vous allez ,les arbres et les chevaux ailés,les femmes déliées,les garçons de vigueur antique -je m’efface au fond du sourireignorant des empires…Piero della Francesca: Polyptique de la miséricorde. -
Quand le Festival bat son plein tous les Seniors n’ont pas le blues…
 L’esprit du temps et le commerce obligeant : tous devraient hurler de joie et trépigner les bras levés, au risque sinon d’être taxés de ronchons. Mais la fête obligatoire ne suppose-t-elle pas que tous y soient conviés ? Et si l’on poussait alors la logique à bout : si tout le monde se ruait au Festival, rollators et vieilles peaux même en civières ? Question grave : qu’en est-il de notre rapport à l’âge, entre jeunisme et gâtisme ? Et si l’on détendait un peu l’atmosphère ?Ce n’est pas qu’une question d’âge, mais quand même… vous imaginez leurs têtes si les Seniors, comme ils disent, débarquaient en foule au Festival ? Non pas une poignée de boomers un peu barjos se la jouant vieux de la vieille en accros des années 60-70 revenus de Woodstock ou de l’île de Wight avec leurs longs tifs, mais toute la bande de vioques plus ou moins casés par leurs tribus respectives dans tel ou tel établissement socio-médical des hauts de la Dolce riviera et environs, vraiment toute la tribu boomer titubante ou grabataire - toustes (c’est comme ça qu’on s’inclut aujourd’hui) défiant l’exclusion en brandissant leur identifiant consacré : Senior !Non mais quel label, vous êtes-vous toujours dit, et l’autre dimanche vous aurez sursauté au moment pile ou vous auriez aimé « en être », quand ce bon vieux Neil Young était supposé se pointer sur la Scène du lac, à un coup d’aile de votre balcon, et qu’en ouvrant grand vos fenêtres vous auriez pu apercevoir sans les barrières et palissades multiples vous signifiant que lui était « dedans » et vous « dehors » ; et bientôt ce boucan, ce magma, ce martèlement dans le magma, ce vague nasillement d’une voix dans le martèlement, ça Neil Young ? Eh non ! Et c’était votre faute ! Y avait qu’à vous payer le ticket (dès 167 francs, non mais !) et puis non et non : vous ne le sentiez pas, vous n’étiez plus « dedans » comme vous l’étiez plus ou moins en vos jeunes années - mais pas pour autant, ce dimanche soir, le cœur de dénigrer le magma en question vu que c’était vous le Senior « dehors » alors que Neil se la jouait « dedans »…Senior, délivrez-nous de ce mot..Mais Senior, seigneur, pas vraiment l’étoile jaune, mais à vos yeux de vieil ado de nature plutôt débonnaire à l’ordinaire : ce label social collé à votre peau en vertu de quel décret : et quand ça vous tombe dessus ?Quand ça commence d’être Senior ? Ne l’étiez-vous pas dans votre tête ou votre cœur en vos années marquées Junior ? N’étiez-vous pas déjà un foutu vieux sage quand à dix-huit ans vous aurez recopié ces mots de Paul Nizan, l’auteur des Chiens de garde bousculant les têtes molles de la philosophie, dans un autre écrit intitulé Aden Arabie : « J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde »…Or à vingt ans vous étiez déjà revenu de mai 68 vécu dans le magma collectif de la Sorbonne où déjà l’on rejetait le « monde d’avant ». Le Sartre de 63 ans était-il un Senior quand il parlait aux « djeunes » du Quartier latin ? Et l’increvable Edgar Morin revenant de Californie en 1970, que vous aurez rencontré alors et qui fête ces jours son 104e anniversaire ? Et Claude Nobs dans tout ça, rattrapé par « l’âge » à 76 ans dans la neige des hauts de Caux, était-il un Senior sur ses lattes de fond ? Vous le revoyez sur la scène du Festival en 1999, accueillant - cheveux poivre et sel très courts et cravaté comme un cadre bon chic bon gendre, un Jonny Lang de 18 ans en marcel noir et se déhanchant à la Mick Jagger (40 ans de plus…) entre blues et rock bien balancé – Senior Nobs et Jonny Junior ? Okay !Accepter son âge ne serait-il pas, alors, la meilleure façon de s’en distinguer ? Ne pas se la jouer « djeune ». Garder sa cravate comme le Boss Nobs sans en faire un drame si l’on vous traite de «papy». Faire comme si l’âge ne faisait rien à l’affaire en matière de passions partagées - avec un clin d’œil.Restons gentils, cools dans la foule…Le Festival bat encore son plein, le média du coin parle du passage de Neil Young comme d’un grand moment ou « papy » (sic) a fait de la résistance et « tutoyé les sommets », dans le langage branché saturé de cliché qui sied. Et puis quoi ? Dénigrer parce que vous n’y étiez pas ? Dégommer le Festival parce que tout ça relèverait de la pompe à fric comme à Woodstock dont on a souvent magnifié le seul tour angélique, et puis quoi ? Prétendre, comme vous l’avez lu sous la plume d’un de nos chroniqueurs, se la jouant lucide comme pas deux, que cette foule galvanisée ressemble en somme à celle des grands rassemblements nazistes ? Et quoi encore ? Le plaisir partagé est-il forcément suspect ? Et votre défiance envers la tendance à tout étiqueter (Senior, Boomer, Millenial, etc.) va-t-elle vous empêcher de rester gentil ?Le mieux serait alors, question de détendre l’atmosphère, de relier vos propres souvenirs à ceux qui se préparent sous vos fenêtres. Vous vous rappelez les Stones à Montreux en 1964, invités alors à la Rose d’or par Claude Nobs presque en catimini, et les mêmes en seniors de guerre dans un stade géant suisse allemand bondé et survolté, plus de vingt ans après; ou vous vous rappelez Bob Dylan en Senior chapeauté vingt-cinq ans après le Junior Jonny ; ou Bonnie Raitt en vieille gamine de western, ou Joan Baez obligée de se pointer au Festival à cheval (pour cause de dimanche sans voitures), en 1973, et la même y faisant ses adieux en 2019, et tout ça comme un joyeux magma, quitte à vous replier aujourd’hui sur l’autoradio de votre Honda Jazz à écouter ce bon vieux Van Morrison, ou Jonny Lang ou les trios de Mendelssohn et, une fois de plus, l’indomptable Neil dont le média local vous apprend que son dernier concert de l’autre soir s’est achevé sur l’électrisant Rockin’in the free world – mais ça c’est du souvenir futur que se repasseront les Juniors du moment quand ils se prendront, en pleine figure, le label Senior par juste retour de boomerang…
L’esprit du temps et le commerce obligeant : tous devraient hurler de joie et trépigner les bras levés, au risque sinon d’être taxés de ronchons. Mais la fête obligatoire ne suppose-t-elle pas que tous y soient conviés ? Et si l’on poussait alors la logique à bout : si tout le monde se ruait au Festival, rollators et vieilles peaux même en civières ? Question grave : qu’en est-il de notre rapport à l’âge, entre jeunisme et gâtisme ? Et si l’on détendait un peu l’atmosphère ?Ce n’est pas qu’une question d’âge, mais quand même… vous imaginez leurs têtes si les Seniors, comme ils disent, débarquaient en foule au Festival ? Non pas une poignée de boomers un peu barjos se la jouant vieux de la vieille en accros des années 60-70 revenus de Woodstock ou de l’île de Wight avec leurs longs tifs, mais toute la bande de vioques plus ou moins casés par leurs tribus respectives dans tel ou tel établissement socio-médical des hauts de la Dolce riviera et environs, vraiment toute la tribu boomer titubante ou grabataire - toustes (c’est comme ça qu’on s’inclut aujourd’hui) défiant l’exclusion en brandissant leur identifiant consacré : Senior !Non mais quel label, vous êtes-vous toujours dit, et l’autre dimanche vous aurez sursauté au moment pile ou vous auriez aimé « en être », quand ce bon vieux Neil Young était supposé se pointer sur la Scène du lac, à un coup d’aile de votre balcon, et qu’en ouvrant grand vos fenêtres vous auriez pu apercevoir sans les barrières et palissades multiples vous signifiant que lui était « dedans » et vous « dehors » ; et bientôt ce boucan, ce magma, ce martèlement dans le magma, ce vague nasillement d’une voix dans le martèlement, ça Neil Young ? Eh non ! Et c’était votre faute ! Y avait qu’à vous payer le ticket (dès 167 francs, non mais !) et puis non et non : vous ne le sentiez pas, vous n’étiez plus « dedans » comme vous l’étiez plus ou moins en vos jeunes années - mais pas pour autant, ce dimanche soir, le cœur de dénigrer le magma en question vu que c’était vous le Senior « dehors » alors que Neil se la jouait « dedans »…Senior, délivrez-nous de ce mot..Mais Senior, seigneur, pas vraiment l’étoile jaune, mais à vos yeux de vieil ado de nature plutôt débonnaire à l’ordinaire : ce label social collé à votre peau en vertu de quel décret : et quand ça vous tombe dessus ?Quand ça commence d’être Senior ? Ne l’étiez-vous pas dans votre tête ou votre cœur en vos années marquées Junior ? N’étiez-vous pas déjà un foutu vieux sage quand à dix-huit ans vous aurez recopié ces mots de Paul Nizan, l’auteur des Chiens de garde bousculant les têtes molles de la philosophie, dans un autre écrit intitulé Aden Arabie : « J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde »…Or à vingt ans vous étiez déjà revenu de mai 68 vécu dans le magma collectif de la Sorbonne où déjà l’on rejetait le « monde d’avant ». Le Sartre de 63 ans était-il un Senior quand il parlait aux « djeunes » du Quartier latin ? Et l’increvable Edgar Morin revenant de Californie en 1970, que vous aurez rencontré alors et qui fête ces jours son 104e anniversaire ? Et Claude Nobs dans tout ça, rattrapé par « l’âge » à 76 ans dans la neige des hauts de Caux, était-il un Senior sur ses lattes de fond ? Vous le revoyez sur la scène du Festival en 1999, accueillant - cheveux poivre et sel très courts et cravaté comme un cadre bon chic bon gendre, un Jonny Lang de 18 ans en marcel noir et se déhanchant à la Mick Jagger (40 ans de plus…) entre blues et rock bien balancé – Senior Nobs et Jonny Junior ? Okay !Accepter son âge ne serait-il pas, alors, la meilleure façon de s’en distinguer ? Ne pas se la jouer « djeune ». Garder sa cravate comme le Boss Nobs sans en faire un drame si l’on vous traite de «papy». Faire comme si l’âge ne faisait rien à l’affaire en matière de passions partagées - avec un clin d’œil.Restons gentils, cools dans la foule…Le Festival bat encore son plein, le média du coin parle du passage de Neil Young comme d’un grand moment ou « papy » (sic) a fait de la résistance et « tutoyé les sommets », dans le langage branché saturé de cliché qui sied. Et puis quoi ? Dénigrer parce que vous n’y étiez pas ? Dégommer le Festival parce que tout ça relèverait de la pompe à fric comme à Woodstock dont on a souvent magnifié le seul tour angélique, et puis quoi ? Prétendre, comme vous l’avez lu sous la plume d’un de nos chroniqueurs, se la jouant lucide comme pas deux, que cette foule galvanisée ressemble en somme à celle des grands rassemblements nazistes ? Et quoi encore ? Le plaisir partagé est-il forcément suspect ? Et votre défiance envers la tendance à tout étiqueter (Senior, Boomer, Millenial, etc.) va-t-elle vous empêcher de rester gentil ?Le mieux serait alors, question de détendre l’atmosphère, de relier vos propres souvenirs à ceux qui se préparent sous vos fenêtres. Vous vous rappelez les Stones à Montreux en 1964, invités alors à la Rose d’or par Claude Nobs presque en catimini, et les mêmes en seniors de guerre dans un stade géant suisse allemand bondé et survolté, plus de vingt ans après; ou vous vous rappelez Bob Dylan en Senior chapeauté vingt-cinq ans après le Junior Jonny ; ou Bonnie Raitt en vieille gamine de western, ou Joan Baez obligée de se pointer au Festival à cheval (pour cause de dimanche sans voitures), en 1973, et la même y faisant ses adieux en 2019, et tout ça comme un joyeux magma, quitte à vous replier aujourd’hui sur l’autoradio de votre Honda Jazz à écouter ce bon vieux Van Morrison, ou Jonny Lang ou les trios de Mendelssohn et, une fois de plus, l’indomptable Neil dont le média local vous apprend que son dernier concert de l’autre soir s’est achevé sur l’électrisant Rockin’in the free world – mais ça c’est du souvenir futur que se repasseront les Juniors du moment quand ils se prendront, en pleine figure, le label Senior par juste retour de boomerang… -
Mon ami Tchékhov

Ce n’est pas abuser de prétentions occultes, ni non plus céder à je ne sais quel sentimentalisme douteux que de parler de la relation que j’entretiens avec Tchékhov, depuis mes seize à vingt ans, comme d’une amitié, et plus immédiate, immédiatement plus profonde, plus entière, plus candide et grave, plus souriante et mélancolique, plus claire dans le noir et plus lucide, plus durable et jamais entamée, plus durable et jamais déçue que toutes mes amitiés vécues «en réalité» en ces années où mon penchant récurrent à l’élection d’un Ami Unique n’aura fait que multiplier illusions et déconvenues.
C’est cependant par l’émotion, et non sur de sages bases raisonnables, que je me suis attaché à la personne d’Anton Pavlovitch – je dis bien : à la personne, autant sinon plus qu’aux personnages des récits de l’écrivain qui certes me touchaient ou parfois me bouleversaient tout en me ramenant à tout coup à la personne de l’écrivain ; mais là encore je distingue la personne du personnage social ou littéraire de l’écrivain que je ne découvrirais que plus tard et sans en être d’ailleurs jamais troublé le moins du monde puisque, aussi bien, l’écrivain Tchékhov, autant que l’homme Tchékhov, le docteur Tchékhov, ou le fils, le frère, l’ami ou le conjoint, tels que nous le révèlent notamment ses milliers de lettres ou les témoignages de ses proches, n’auront jamais altéré, en moi, la réalité de la personne d’Anton Pavlovitch dont j’ai eu le sentiment, aussitôt rencontré, qu’il incarnait un ami «pour la vie».
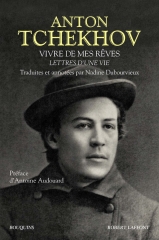
Parler ainsi de «mon ami Tchékhov» ne relève pas d’une fantasmagorie coupée de la réalité, mais inscrit au contraire cette relation, tout ce que j’ai ressenti et donc vécu dès ma lecture du premier bref terrible récit de Tchékhov, intitulé Dormir, suivi d’un autre récit non moins terrible et déchirant intitulé Volodia,au cœur même de la terrible et déchirante réalité vécue par ces personnages (deux adolescents pris au piège de la réalité) dont je percevais la vérité à travers ce qu’en faisait ressentir, de toute évidence, une personne en laquelle j’identifiai, aussitôt, «mon ami Tchékhov», que j’ai retrouvée chaque fois que j’ai lu d’autres récits de l’écrivain Tchékhov, et ce fut La dame au petit chien connue de tous mais que je m’appropriai d’emblée rien que pour moi, toute de délicatesse et de larmes ravalées, ce fut la descente aux enfers combien réels de La Salle 6ou ce furent, en retour ultérieur aux premiers écrits du jeune Anton Pavlovicth, les bousculades hilares et les galéjades de ses premières nouvelles illustrant d’emblée le sens du comique de ce témoin de la tragédie de tous les jours.

Volodia et Varka dans ma tenue d’assaut
J’étais alors un jeune soldat sur les hauteurs ensoleillées, ou c’était la nuit sous une toile camouflée, mais non : c’était la journée puisque, je me le rappelle, deux ou trois exemplaires des Œuvres de Tchékhov, réunies en vingt volumes aux Editeurs française réunis, sous une couverture gris-vert, avec une bande rouge et le motif d’une mouette blanche, alourdissaient ma tenue d’assaut à dix-huit poches, au su de mes camarades et autres caporaux qui aimaient également me voir lire au soleil ou à l’ombre de nos poses sans fin, comme j’aimais boire avec eux ou les écouter me raconter leurs vies de possible personnages de Tchékhov, ou, plus rarement, à tel ou tel que j’aimais plus que les autres, raconter ce que je lisais dans les récits de mon ami Tchékhov.
Ainsi aurai-je fait venir les larmes aux yeux de l’innocent Hans, mon compère soldat du train au physique de forestier et au cœur de tendron, le regard bleu laiteux m’évoquant celui des glaciers qu’on voyait là-haut, et conduisant d’une main sûre l’un des équidés chargés de nos caisses de munition, en lui racontant l’atroce fin de Volodia et le martyre de Varka.
On n’a pas dit assez la tendresse presque féminine des longues poses ponctuant les longue marches militaires, mais c’est bien ainsi que, sous le soleil des hautes terrasses, à la fois revigorés par l’eau glacée des torrents dont nous nous étions soulés avant de nous en asperger le visage et le torse, et tout alanguis par la fatigue et l’estivale touffeur, Hans et moi nous nous tenions quand je lui avais évoqué la détresse de Volodia, moqué par la femme mariée qui lui reproche de ne pas la courtiser alors même qu’il l’aime en secret.
Raconter une histoire déjà racontée par un ami russe à un moujik suisse allemand en tenue d’assaut requiert beaucoup d’attention et d’affection, mais la précision, l’émotion, la compassion, le mélange de dérision marquant la méchante médiocrité des gens observées par mon ami Tchékhov, et la compassion manifestée à Volodia le pataud, le lourdaud, le bêta complexé, par l’écrivain, me faisait raconter à mon ami tringlot le désarroi de Volodia, et l’affreux dénouement du récit, avec une émotion redoublée par le fait que, de toute évidence, Hans comprenait la honte de Volodia et se pénétrait lui-même de chaque détail du récit de l’écrivain Tchékhov que je lui rapportais : la moquerie des femmes, mais aussi le mépris de la vieille femme nantie pour la plus jeune faisant encore la coquette - cette mère de Volodia dont la frivolité faisait horreur à celui-ci, enfin tout ça n’était-il pas clair et net comme la vie, horriblement trivial et délicieux comme la vie, terriblement attirant et tellement dégoûtant qu’il n’y avait plus qu’à se tirer une balle ?
Plus tard je me suis demandé ce qu’était devenu mon ami Hans qui m’avait supplié, après celle de Volodia, de lui raconter d’autres histoires que racontait mon ami Tchékhov. À vrai dire je me rappelle pas une seule personne, tant d’années après, qui ait porté autant d’attention que lui à une histoire que je lui rapportais, en seconde main, comme si je l’avais vécue moi-même et comme s’il lui reconnaissait une vérité d’évidence en consonance parfaite avec sa réalité de jeune paysan dont je savais qu’il n’avait jamais lu aucun livre d’aucun auteur russe, et peut-être aucun autre livre du tout ? Mais avec Hans j’ai partagé, comme avec personne, la détresse de Volodia et la tristesse égale du crime de la petite Varka, pauvre enfant de treize ans dont l’irrépressible envie de dormir la distrait de son rôle de surveiller le sommeil d’un tout petit enfant qu’elle finit par étouffer pour avoir la paix.
Une image à retoucher
L’image d’un Tchékhov poète de l’évanescence et des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe de la fin du siècle passé, continue de se perpétuer à travers le cliché du «doux rêveur», qui vole au contraire en éclats dès qu’on prend la peine de l’approcher vraiment.
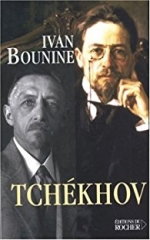
Or j’ai retrouvé mon ami Tchékhov au fil des notes prises, de son vivant, par Ivan Bounine, plus jeune de lui de dix ans et qui fut son bon camarade jusqu’à sa mort. C’est à vrai dire sur le tard, en 1952, que Bounine esquissa ces notes, mais leur caractère d’inachèvement n’enlève rien à leur intérêt et moins encore à leur charme, tant Ivan Bounine excelle, près d’un demi-siècle après sa mort, à rendre vivante et presque palpable la présence de Tchékhov.
Ainsi est-ce c’est par petite touches qu’il complète son portrait «en mouvement» d’un Tchékhov à la fois amical et distant, qui ne perd pas une occasion de rire et n’a décidément rien du geignard que stigmatisent certains critiques. Ne se plaignant jamais de son sort, alors que la maladie lui est souvent cruelle, l’écrivain apparaît, sous le regard de Bounine, comme un homme chaleureux et d’un naturel tout simple, raillant volontiers la jobardise des gendelettres sans poser pour autant au modèle de vertu. Le récit de ses visites au vieux Tolstoï est piquant, et Bounine, accueilli à un moment donné par la mère et la soeur de Tchékhov, éclaire également sa sollicitude affectueuse de fils et de frère. De surcroît, c’est un véritable récit tchékhovien que Bounine esquisse à propos de ce qui fut, selon lui, le grand amour «empêché» d’Anton Pavlovitch, avec une femme mariée du nom de Lidia Alexeievna Avilova, nouvelliste et romancière prête à refaire sa vie avec lui et qu’il aima aussi sans se résoudre à l’arracher à sa famille - la repoussant ainsi fermement mais en douceur.
J’aime que ce soit un ami, et sans doute l’un des plus vrais qui l’aient connu, qui m’en dise ainsi un peu plus de mon ami Tchékhov.
Anton Tchékhov écrivit d’abord pour arrondir les fins de semaine de la famille dont il avait la charge, et seuls les cuistres lui reprocheront de ne pas toujours fignoler son style, alors qu’un souffle de vie constant traverse ses moindres récits. Ses Conseil à un écrivain, tirés de sa correspondance, constituent un inépuisable recueil de malicieuse sagesse, qu’on pourrait intituler aussi «conseils à tout le monde».

Écrire et vivre, pour mon ami Tchékhov, allait de pair, et ses propos sur «la petite vie de tous les jours» ou sur l’authenticité, sur l’intelligentsia ou l’abus de l’adjectif, trahissent autant de positions éthiques d’une exigence que Bounine eût qualifiée de «féroce». C’est qu’à l’opposé du littérateur se payant de mots, de l’homme de lettres trônant sur son propre monument, ou de l’instituteur du peuple, Tchékhov se contentait de chercher, pour chaque sentiment ou chaque fait, le mot juste.
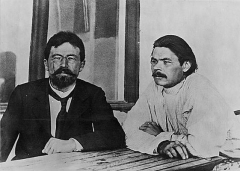
À Sorrente, cette année-là…
Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque Staline fit rebaptiser sa ville natale, Nijni-Novgorod, de son nom, en pensant à son ami Tchékhov.
Ainsi le jeune homme avait-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Soviet suprême; ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je ce soir-là devant la baie de Sorrente en lisant la correspondance du jeune Gorki et de Tchékhov, où celui-là dit à peu près ceci au cher docteur : tout ce qui se fait aujourd’hui en Russie semble un raclement de bûches sur du papier de sac de patates à côté de ce que vous écrivez, vous, de tellement sensible et délicat. Et voilà que me revient cette phrase de mon ami Anton Pavlovitch au jeune Gorki : «On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part»…
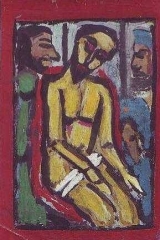 Vertige du Vendredi saint
Vertige du Vendredi saintRétif à toute idéologie de nature politique ou religieuse, mon ami Tchékhov, devenu soutien de famille avant sa vingtième année pour surseoir aux manques d’un père ivrogne et brutal, autant que bigot, a trop souvent été considéré comme un positiviste étranger à toute dimension religieuse.
Or celle-ci se retrouve pourtant dans le récit qu'il disait préférer entre tous, intitulé L'étudiantet constituant une sorte de mystique plongée en cinq pages dans la profondeur du Temps.
Au soir du Vendredi saint, revenant de chasse où il vient de tuer une bécasse, le jeune Ivan Vélikopolski s'arrête auprès de deux veuves dans leur jardin, auxquelles il raconte soudain la nuit durant laquelle Pierre trahit le Christ à trois reprises, comme annoncé. Et voici les veuves bouleversées par son récit, comme si elles s'y trouvaient personnellement impliquées, et voilà que le jeune fils de diacre, étudiant à l'académie religieuse, se trouve rempli d'une joie mystérieuse alors même qu'il constate l'actualité de la nuit terrible: « Alors la joie se mit à bouillonner dans son esprit, si fort qu'il dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Le passé, pensait-il, était lié au présent par une chaîne ininterrompue d'événements qui découlaient les uns des autres. Il lui semblait qu'il voyait les deux extrémités de cette chaîne: il en touche une et voici que l'autre frissonne.
«Comme il prenait le bac pour passer la rivière, et plus tard comme il montait sur la colline en regardant son village natal et le couchant où brillait le ruban étroit d'un crépuscule froid et pourpre, il pensait que la vérité et la beauté qui dirigeaient la vie de l'homme là-bas, dans le jardin et dans la cour du grand-prêtre, s'étaient perpétuées sans s'arrêter jusqu'à ce jour, et qu'elles avaient sans doute toujours été le plus profond, le plus important dans la vie de l'homme, et sur toute la terre en général; et un sentiment de jeunesse, de santé et de force - il n'avait que vingt-deux ans - et une attente indiciblement douce du bonheur, d'un bonheur inconnu, mystérieux, s'emparaient peu à peu de lui, et la vie lui paraissait éblouissante, miraculeuse et toute emplie du sens le plus haut ».
La dernière flûte de Champagne
Durant la nuit du 1er juillet 1904, Anton Tchékhov se réveilla et, pour la première fois, pria son épouse Olga d’appeler un médecin. Lorsque le docteur Schwöhrer arriva, à deux heures du matin, le malade lui dit simplement «ich sterbe», déclinant ensuite la proposition d’envoyer chercher une bouteille d’oxygène. En revanche, Tchékhov accepta de boire une flûte du champagne que son confrère médecin avait fait monter entretemps, remarqua qu’il y avait longtemps qu’il n’en avait plus bu, s’étendit sur le flanc et rendit son dernier souffle. La suite des événements, le jeune Tchékhov aurait pu la décrire avec la causticité qui caractérisait ses premiers écrits.
De fait, c’est dans un convoi destiné au transport d’huîtres que la dépouille de l’écrivain fut rapatriée à Moscou, où les amis et les proches du défunt avisèrent, sur le quai de la gare, un fanfare militaire qui jouait une marche funèbre. Or celle-ci n’était pas destinée à Tchékhov mais à un certain général Keller, mort en Mandchourie, dont la dépouille arrivait le même jour.
Une foule immense n’en attendait pas moins, au cimetière, le cercueil de mon ami Tchékhov porté par deux étudiants...
Ivan Bounine. Tchékhov. Traduit du russe, préfacé et annoté par Claire Hauchard. Editions du Rocher, 210p.
Anton Tchékhov. Conseils à un écrivain. Choix de textes présenté par Pierre Brunello. Traduit du russe par Marianne Gourg. Suivi de Vie d’Anton Tchékhov, par Natalia Ginzburg. Traduit de l’italien par Béatrice Vierne. Editions du Rocher, coll. Anatolia, 240p.
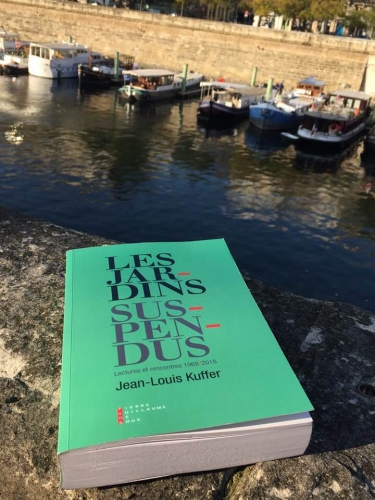
-
Contemplation
 (En mémoire de Thierry Vernet)Le soir la mer n’en finit pas,dans l’ombre ralentied’aller et venir sans fracassans éclats, sans envies,sans plus aucun élancement,comme nous écoutant…Nous sommes là tout silencieuxsongeurs et sans voix,muets entre les deux ombragesde la mer et des bois ;tout se tait sous le grand ciel bastout ne semble que paix…Un nuage immobile passe,ni d’hiver ni d’étéla nuit l’effacera sans tracemais sans nous retournernous l’aurons oubliécomme la grâce de l’Instantreçue comme en passant…Peinture: Thierry Vernet.
(En mémoire de Thierry Vernet)Le soir la mer n’en finit pas,dans l’ombre ralentied’aller et venir sans fracassans éclats, sans envies,sans plus aucun élancement,comme nous écoutant…Nous sommes là tout silencieuxsongeurs et sans voix,muets entre les deux ombragesde la mer et des bois ;tout se tait sous le grand ciel bastout ne semble que paix…Un nuage immobile passe,ni d’hiver ni d’étéla nuit l’effacera sans tracemais sans nous retournernous l’aurons oubliécomme la grâce de l’Instantreçue comme en passant…Peinture: Thierry Vernet. -
Alain Gerber jazzy

Décrire la musique avec des mots relève du grand art, rarement atteint. Parler de musique en spécialiste , ou l'évoquer poétiquement, est une chose. Tout autre chose est de la décrire en substance et en mouvement; tout autre chose d'en capter la source vive ou l'incarnation; tout autre chose encore de saisir, par les seuls mots, d'ou vient ce langage et comment il parle, à quoi il répond de notre tréfonds et quelles ailes il nous fait pousser, comment il fouaille notre chair et comment il nous en délivre - et c'est cela même de "tout autre" que nous vivons en lisant Une année sabbatique d'Alain Gerber, très beau roman d'une rédemption débordant largement, à vrai dire, la seule question du rapport liant la musique et les mots pour englober la relation profonde entre création et destinée, art et simulacre, rumeur d'époque et blues de l'Ange.
L'univers investi par Alain Gerber, fameux romancier du jazz, est une fois de plus celui de cette musique plus souvent improvisée qu'écrite, et c'est d'ailleurs dans cette zone apparemment aléatoire et tourbillonnaire de l'improvisation que le romancier se montre le plus stupéfiant, comme si les sources, les ressources et les ressorts de l'improvisation lui étaient chevillées au corps et à l'âme en véritable réincarnation médiumnique d'un Charlie Parker ou d'un John Coltrane. Or, que je sache, Alain Gerber n'a jamais fait que battre la mesure sur une batterie d'amateur et sur les touches de sa machine à écrire . Mais le voici vivre, corps abouché à ce qu'on appelle l'âme, ce qu'un musicien peut tirer d'un instrument nommé saxophone ou d'un autre nommé trompette, puis d'une paire de gants de boxe, et nous le faire vivre à notre tour par le miracle des seuls mots. Il y a là comme une magie relevant de ce qu'on pourrait dire une grâce. Les lecteurs de La couleur orange et du Buffet de la gare, premiers romans du jeune écrivain de Belfort (né en 1943) rêvant d'égaler Hemingway et Faulkner, ou Thomas Wolfe, se rappellent probablement, avant de la retrouver dans les nouvelles inoubliables des Jours de vin et de roses et dans maintes autres pages de cet auteur extraordinairement profus mais d'inégales densité et intensité, cette présence d'une "grâce" qu'on pourrait dire le signe par excellence de la poésie ou de cette disposition de l'homme à se montrer, comme le disait Enesco de Jean-Sébastien Bach, "capable du ciel". On est très loin du ciel lorsque s'ouvre Une année sabbatique sur cet inspirant incipit: "On vit le samedi les plus belles heures du dimanche. La seule musique digne de nous est celle qu'on n'a pas encore jouée". On est déjà sur le départ frotté de mélancolie, voire de désenchantement, d'un type qui se reproche d'avoir manqué jusque-là ses rendez-vous avec le meilleur de lui-même, brillant certes parmi les brillants mais prenant les hommages comme autant de banderilles plantées dans son cuir honteux. Plus précisément, le saxo ténor Sunny Matthews, qu'on imagine encore jeune, avec sa dégaine de bison, mais qui se sent déjà fatigué de vivre, aussi toxico que son mentor absolu, dit Le Bleu, quitte New York pour le centre de désintoxication de Lexington où il compte se refaire durant quelque temps. Mais qui est ce Sunny Matthews ? se demandera vite le lecteur, familier ou non du jazz. S'agit-il d'un avatar romanesque de Sonny Rollins, comme le suggère une allusion du prière d'insérer ? Et l'aura sans pareille du Bleu, autant que sa propre dépendance aux "substances", renvoient-elles à Charlie Parker ? Et les connaisseurs ne seront-ils pas tentés de chercher les "clefs" des pseudo de l'Hippopotame ou du Serrurier ? Peu importe à vrai dire !
On est très loin du ciel lorsque s'ouvre Une année sabbatique sur cet inspirant incipit: "On vit le samedi les plus belles heures du dimanche. La seule musique digne de nous est celle qu'on n'a pas encore jouée". On est déjà sur le départ frotté de mélancolie, voire de désenchantement, d'un type qui se reproche d'avoir manqué jusque-là ses rendez-vous avec le meilleur de lui-même, brillant certes parmi les brillants mais prenant les hommages comme autant de banderilles plantées dans son cuir honteux. Plus précisément, le saxo ténor Sunny Matthews, qu'on imagine encore jeune, avec sa dégaine de bison, mais qui se sent déjà fatigué de vivre, aussi toxico que son mentor absolu, dit Le Bleu, quitte New York pour le centre de désintoxication de Lexington où il compte se refaire durant quelque temps. Mais qui est ce Sunny Matthews ? se demandera vite le lecteur, familier ou non du jazz. S'agit-il d'un avatar romanesque de Sonny Rollins, comme le suggère une allusion du prière d'insérer ? Et l'aura sans pareille du Bleu, autant que sa propre dépendance aux "substances", renvoient-elles à Charlie Parker ? Et les connaisseurs ne seront-ils pas tentés de chercher les "clefs" des pseudo de l'Hippopotame ou du Serrurier ? Peu importe à vrai dire !
De fait, c'est un espace romanesque autonome et non forcément référentiel qu'Alain Gerber recompose en l'occurrence, où les autres noms de musiciens qui nous viennent à l'esprit en cours de lecture, de John Coltrane ou de Miles Davis, n'appellent pas non plus d'identification formelle. De la même façon, l'on relèvera que la lecture d'Une année sabbatique n'exige pas une connaissance particulière du jazz, alors même que ses thèmes et ses observations se rapportent à la fois à la littérature et aux arts divers, autant qu'à toute destinée individuelle.
Au centre de désintoxication de Lexington, le saxo ténor retrouve d'autres musiciens en cours de sevrage, qui se réunissent volontiers pour jouer à l'instigation d'un psy "à l'écoute", come on dit, dont le répondant, s'agissant du cas "à part" de Sunny, reste limité. Le Bison se tient d'ailleurs à l'écart, se rapprochant cependant de ses compères à l'occasion d'un concert public en hommage au Bleu subitement défunté, dont l'annonce de la mort les a tous atterrés, à commencer par Sunny, tant le Bleu incarnait pour lui le modèle idéal par excellence, et le mentor vivant.
C'est cependant "out of the Blue" (titre de la deuxième partie du roman) que Sunny Matthews, qui se retrouve à la fois libéré de ses tentations, au terme de sa cure, et tenté de renoncer à la musique pour ne plus faire que vivre ("vivre la vie de sa chair endolorie et muette"), que Sunny va rebondir et doublement puisque, en marge de petits boulots de survie aux vertus hygiéniques certaines, il se découvre une nouvelle passion pour la boxe, autre façon de concrétiser son combat contre lui-même, avant de faire la rencontre, foudroyante, d'une sorte d'ange révélateur en la personne d'un tout jeune trompettiste malingre et bonnement génial aux oreilles de Sunny.
Par la médiation vivante de Scott Lloyd, dix-sept ans, Sunny Matthews va se retrouver lui-même dans la situation d'un mentor, dont l'engagement mimétique intransigeant vaudra autant pout l'encouragement fait au gosse de n'écouter que sa seule voix, inouïe, que pour son retour à lui, Sunny, à sa voie, dans un mouvement final exacerbé par le sort tragique de Scottie.
Il y a, chez Alain Gerber, un grand pro du roman à l'américaine, dans la filiation d'Hemingway ou plus précisément, ici, du Nelson Algren de L'Homme au bras d'or, d'ailleurs cité au pied d'une des superbes pages consacrés à la boxe.
Cela étant, ce très remarquable artisan-romancier, qui pourrait nous faire croire qu'il s'est camé lui-même la moitié de ses nuits et a joué du saxo ou de la trompette l'autre moitié, est aussi un artiste et un poète d'une phénoménale porosité. Moins un styliste orfèvre de la phrase, sans doute, qu'un storyteller travaillant à l'énergie et en pleine pâte ou "dans la masse", comme on le dirait d'un sculpteur, dont les thèmes rassemblés ici trouvent leur expression puissante et magnifiquement suggestive, à croire que la rédemption de son personnage coïncide avec celle du romancier.
Alain Gerber. Une année sabbatique. Editions Bernard de Fallois, 302p. -
De salubres emmerdeurs
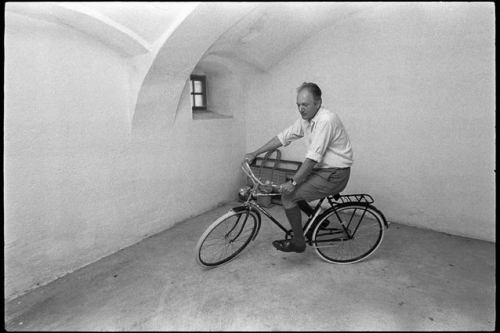 Pour tout dire (93)(À propos de Michel Houellebecq et de Thomas Bernhard, imprécateurs et plus si affinités…)La dépersonnalisation et la violence absolue du monde contemporain sont à la base des imprécations de Thomas Bernhard et de Michel Houellebecq, polémistes virulents et résistant à ce qu’ils tiennent, chacun à sa façon, pour un effondrement.On peut leur reprocher de tout pousser au noir ou aux extrêmes, mais c’est ne pas voir la nostalgie de la lumière et de la vie bonne qu’il y a chez l’un et l’autre, et la tendresse sous la vocifération ou les jets d’acide.Le mot apocalypse signifie à la fois catastrophe et révélation. L’époque moderne, depuis les Lumières, la catastrophe révélatrice des révolutions, l’illusion romantique, la montée aux extrêmes des idéologies et leur déroute, est caractérisée à la fois par l’effondrement et les refondations simultanées, désastres et merveilles créatrices du terrible XXe siècle.
Pour tout dire (93)(À propos de Michel Houellebecq et de Thomas Bernhard, imprécateurs et plus si affinités…)La dépersonnalisation et la violence absolue du monde contemporain sont à la base des imprécations de Thomas Bernhard et de Michel Houellebecq, polémistes virulents et résistant à ce qu’ils tiennent, chacun à sa façon, pour un effondrement.On peut leur reprocher de tout pousser au noir ou aux extrêmes, mais c’est ne pas voir la nostalgie de la lumière et de la vie bonne qu’il y a chez l’un et l’autre, et la tendresse sous la vocifération ou les jets d’acide.Le mot apocalypse signifie à la fois catastrophe et révélation. L’époque moderne, depuis les Lumières, la catastrophe révélatrice des révolutions, l’illusion romantique, la montée aux extrêmes des idéologies et leur déroute, est caractérisée à la fois par l’effondrement et les refondations simultanées, désastres et merveilles créatrices du terrible XXe siècle.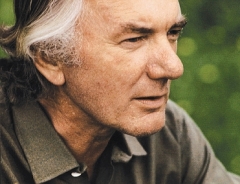 TB et MH, produits remarquables de celui-ci, sont à la fois des entrepreneurs de démolition, dans la lignée d’un Léon Bloy, et des hommes de bonne volonté porteurs de nouvelles énergies.Leur violence apparente se fonde sur une blessure à la fois intime et collective : blessure de l’Histoire avec une grande hache, et blessure personnelle aux occurrences distinctes. Et pour les deux : blessure éprouvée dans et par le langage lui-même, TB achoppant aux séquelles autrichiennes du langage nazi, et Michel Houellebecq à la novlangue de la société win-win.Ce qui distingue cependant, du moins en partie, les œuvres de TB et de MH et leur impact, tient à cela que le premier ressortit surtout au «monde d’avant», tandis que le second est à la bascule d’un monde passé et en devenir – d’ou peut-être sa mauvaise réception dans un certain milieu littéraire campant sur ses nostalgies.Dans une note bien insuffisante, mais significative des crispations et des énervements parisiens plus que de l’aveuglement pur, Pierre Assouline, dans son Dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature souvent passionnant au demeurant, condescend finalement, après trois pages où rien n’est dit du contenu détaillé de l’oeuvre de MH, à reconnaitre qu’ »au moins a-t-il le mérite de présenter un saisissant reflet des peurs, des fantasmes, des haines,des lâchetés, des dénis et du désarroi de la société française ». Or l’écho international, combien plus attentif et sérieux, suscité par les romans de Michel Houellebecq, prouve assez qu’il ne parle pas seulement de la «société française »...Michel Houellebecq est-il le Balzac de la France actuelle ? L’affirmer me semble très exagéré, même s’il y a des traits balzaciens dans le type d’observation et d’analyse de MH, dont le réalisme panique me semble en revanche tout à fait spécifique et propre à a société post-68.En lisant par exemple l’extraordinaire description des prisons où se retrouvent la faux prêtre Carlos Herrera (alias Colin-Vautrin) et Lucien de Rubempré, dans Spkendeurs et misères des courtisanes, puis celle du dédale architectural de Bercy dans lequel évoluent les protagonistes d’anéantir, on mesure à la fois la parenté et le décalage entre les deux auteurs, comme en comparant les retombées (atroces) du suicide de Lucien et celles (presque insignifiantes) de la pendaison d’Aurélien Raison. Autant dire qu’il, faut en revenir aux appréciations modulées par ce que Shakespeare appelait le degree, à savoir la mesure proportionnelle établie selon des échelles hiérarchiques...De la même façon, s’agissant du style de Michel Houellebecq, l’accusation portant sur son prétendu délabrement signale, au mieux, une juste réserve invoquant ce qu’on appelle la bonne littérature, mais le plus souvent un manque d’attention réelle, voire d’oreille musicale (alors qu’on a passé de Monteverdi à Schubert, et de Bartok au hard rock…) même si l’écriture de MH est de densité ou de beauté très variable selon qu’il compose des romans, bricole des poèmes volontairement boiteux, s’exprime sur des plateaux de télé, pose au mage ou se répand en interventions hasardeuses...Cela pour rappeler que la phrase «artiste» de Proust est inséparable de la société encore hiérarchisée dans laquelle a vécu l’écrivain le plus incroyablement «poreux» du XXe siècle, que la musique inouïe jusque, dans son chaos, de Céline, exprime son époque, et qu’en somme nous méritons Houellebecq jusque dans ses grimaces…
TB et MH, produits remarquables de celui-ci, sont à la fois des entrepreneurs de démolition, dans la lignée d’un Léon Bloy, et des hommes de bonne volonté porteurs de nouvelles énergies.Leur violence apparente se fonde sur une blessure à la fois intime et collective : blessure de l’Histoire avec une grande hache, et blessure personnelle aux occurrences distinctes. Et pour les deux : blessure éprouvée dans et par le langage lui-même, TB achoppant aux séquelles autrichiennes du langage nazi, et Michel Houellebecq à la novlangue de la société win-win.Ce qui distingue cependant, du moins en partie, les œuvres de TB et de MH et leur impact, tient à cela que le premier ressortit surtout au «monde d’avant», tandis que le second est à la bascule d’un monde passé et en devenir – d’ou peut-être sa mauvaise réception dans un certain milieu littéraire campant sur ses nostalgies.Dans une note bien insuffisante, mais significative des crispations et des énervements parisiens plus que de l’aveuglement pur, Pierre Assouline, dans son Dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature souvent passionnant au demeurant, condescend finalement, après trois pages où rien n’est dit du contenu détaillé de l’oeuvre de MH, à reconnaitre qu’ »au moins a-t-il le mérite de présenter un saisissant reflet des peurs, des fantasmes, des haines,des lâchetés, des dénis et du désarroi de la société française ». Or l’écho international, combien plus attentif et sérieux, suscité par les romans de Michel Houellebecq, prouve assez qu’il ne parle pas seulement de la «société française »...Michel Houellebecq est-il le Balzac de la France actuelle ? L’affirmer me semble très exagéré, même s’il y a des traits balzaciens dans le type d’observation et d’analyse de MH, dont le réalisme panique me semble en revanche tout à fait spécifique et propre à a société post-68.En lisant par exemple l’extraordinaire description des prisons où se retrouvent la faux prêtre Carlos Herrera (alias Colin-Vautrin) et Lucien de Rubempré, dans Spkendeurs et misères des courtisanes, puis celle du dédale architectural de Bercy dans lequel évoluent les protagonistes d’anéantir, on mesure à la fois la parenté et le décalage entre les deux auteurs, comme en comparant les retombées (atroces) du suicide de Lucien et celles (presque insignifiantes) de la pendaison d’Aurélien Raison. Autant dire qu’il, faut en revenir aux appréciations modulées par ce que Shakespeare appelait le degree, à savoir la mesure proportionnelle établie selon des échelles hiérarchiques...De la même façon, s’agissant du style de Michel Houellebecq, l’accusation portant sur son prétendu délabrement signale, au mieux, une juste réserve invoquant ce qu’on appelle la bonne littérature, mais le plus souvent un manque d’attention réelle, voire d’oreille musicale (alors qu’on a passé de Monteverdi à Schubert, et de Bartok au hard rock…) même si l’écriture de MH est de densité ou de beauté très variable selon qu’il compose des romans, bricole des poèmes volontairement boiteux, s’exprime sur des plateaux de télé, pose au mage ou se répand en interventions hasardeuses...Cela pour rappeler que la phrase «artiste» de Proust est inséparable de la société encore hiérarchisée dans laquelle a vécu l’écrivain le plus incroyablement «poreux» du XXe siècle, que la musique inouïe jusque, dans son chaos, de Céline, exprime son époque, et qu’en somme nous méritons Houellebecq jusque dans ses grimaces… -
Comme une illusion féconde
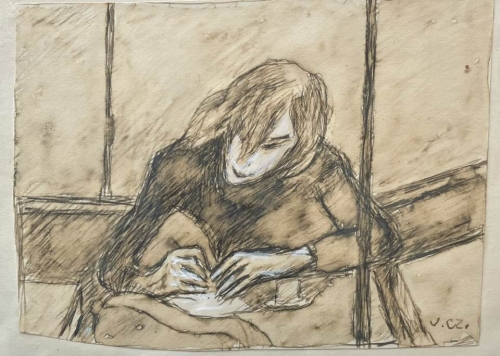 L’écriture serait comme un voeu:en vous comme une grâcevous ferait reconnaîtreque vous êtes vivantset que cela requiert alorscomme d'aucun effortl'abandon absolumentde marquer une trace ardentedans l'orbe insignifiant…Ils s’adonnent aux répugnances:il sourit au néant,elle jouit comme si le ventabouché au vide du tempsla comblait en la dévastant -tout mentalement s’entend ,quand tout au monde immonde,et virtuel, devenait mental et mortel…Le vœu de silence au momentoù tu écris dans l’innocencede qui ferait juste semblantde ne rien savoir de tout ça -ce vœu seul est comme un accueil,et comme au seuil une présenceque tu savais en toiet que relancent ces mots-la…Joseph Czapski: La Lettre - dessin préparatoire-
L’écriture serait comme un voeu:en vous comme une grâcevous ferait reconnaîtreque vous êtes vivantset que cela requiert alorscomme d'aucun effortl'abandon absolumentde marquer une trace ardentedans l'orbe insignifiant…Ils s’adonnent aux répugnances:il sourit au néant,elle jouit comme si le ventabouché au vide du tempsla comblait en la dévastant -tout mentalement s’entend ,quand tout au monde immonde,et virtuel, devenait mental et mortel…Le vœu de silence au momentoù tu écris dans l’innocencede qui ferait juste semblantde ne rien savoir de tout ça -ce vœu seul est comme un accueil,et comme au seuil une présenceque tu savais en toiet que relancent ces mots-la…Joseph Czapski: La Lettre - dessin préparatoire- -
Le cheval
 (En mémoire de Kholstomer le cheval de Tolstoï)Le cheval se laissait aller,fatigué de hennir,bien las d’aller et de venir,en jouet animé,au gré de qui tenait le fouet -le cheval n’aimait pas le fouet…Qui tient le fouet dans la nature,déroge à l’animalqui jamais ne brandit la pierre;il n’est point de cheval qui lacèrele bleu du ciel de cet éclairdu fouet d’où fulgure le Mal -le cheval ne fait pas de mal…Je vous le dis en innocence:vous m’avez fatigué,je suis las rien que de vous voirme taxer d’indécence,vous me rêvez bien habillé,tout de blanc et de noirluisant comme un ciboire -mais le cheval ne rêve pas..
(En mémoire de Kholstomer le cheval de Tolstoï)Le cheval se laissait aller,fatigué de hennir,bien las d’aller et de venir,en jouet animé,au gré de qui tenait le fouet -le cheval n’aimait pas le fouet…Qui tient le fouet dans la nature,déroge à l’animalqui jamais ne brandit la pierre;il n’est point de cheval qui lacèrele bleu du ciel de cet éclairdu fouet d’où fulgure le Mal -le cheval ne fait pas de mal…Je vous le dis en innocence:vous m’avez fatigué,je suis las rien que de vous voirme taxer d’indécence,vous me rêvez bien habillé,tout de blanc et de noirluisant comme un ciboire -mais le cheval ne rêve pas.. -
Comme un péché d'origine
 (Tombeau de l'Enfant)L’enfant trépigne dans l’ovalede sable pur de son Ego,quoi ? dit-il au moineau,tu oserais du bec me rappelerque toi, l’oiseau,tu voles plus haut sans effortque moi le roi des sémaphores ?Et l’Enfant en violence,tout exalté d’intelligence,le trouvant inutile,piétinerait le volatilecependant envoléau défi de sa vanité…À la réu des passereaux,le cas du petit drôlefera figure de cas d’école:oh fumée de fumées !,entonne un corbeau déplumé,et le chœur des loriotsde lui faire le plus bel écho;mais l’Enfant n’en démordra pas,et le pire péché,comme on le pontifie au culte,est qu'il devient Adulte...Peinture: Lê Phô (1907-2001), Jeune garçon à l’oiseau d’or,signé et daté 1936, laque sur panneau noir, argent et rehauts d’or, 69 x 55 cm.
(Tombeau de l'Enfant)L’enfant trépigne dans l’ovalede sable pur de son Ego,quoi ? dit-il au moineau,tu oserais du bec me rappelerque toi, l’oiseau,tu voles plus haut sans effortque moi le roi des sémaphores ?Et l’Enfant en violence,tout exalté d’intelligence,le trouvant inutile,piétinerait le volatilecependant envoléau défi de sa vanité…À la réu des passereaux,le cas du petit drôlefera figure de cas d’école:oh fumée de fumées !,entonne un corbeau déplumé,et le chœur des loriotsde lui faire le plus bel écho;mais l’Enfant n’en démordra pas,et le pire péché,comme on le pontifie au culte,est qu'il devient Adulte...Peinture: Lê Phô (1907-2001), Jeune garçon à l’oiseau d’or,signé et daté 1936, laque sur panneau noir, argent et rehauts d’or, 69 x 55 cm. -
Lorsque l'esprit s'incarne
(Étienne Barilier)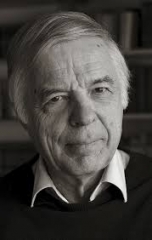
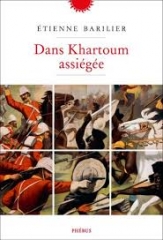
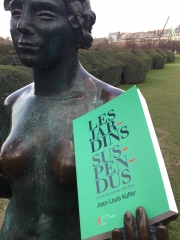 Le génial romancier anglo-américain Henry James estimait que ce qui caractérise un grand roman tient au fait que tous les personnages y ont raison, et c’est ce qu’on se dit aussi bien en achevant la lecture du roman intitulé Dans Khartoum assiégée dont les protagonistes «historiques », semi-fictifs ou imaginés par l’auteur nous semblent avoir, sinon raison dans l’absolu, du moins leurs raisons respectives que le romancier détaille avec une remarquable équité, s’agissant par exemple d’une jeune religieuse italienne torturée ou d’un aristocrate français trafiquant d’ivoire et d’esclaves d’une abjection caractérisée, entre tant d’autres...Au premier rang de tous, héros déjà fameux au moment où il est envoyé à Khartoum par le gouvernement anglais, le général Charles Gordon est lui-même l’incarnation d’une contradiction fondamentale en sa double qualité d’âme sensible et de militaire, mystique lisant tous les soirs l’Imitation de Jésus-Christ et comptant à son actif divers massacres « au nom de Sa Majesté », tendre avec les enfants et les animaux et non moins inflexible en sa fonction, notamment en Chine où il a réprimé la révolte des Taïpings dans le sang.De la même façon, « face » à Gordon, qui ne le rencontrera jamais en personne, le chef de guerre « de droit divin » Mohammed Ahmed, dit le Mahdi (terme supposé tombé de la bouche même du Prophète, signifiant le Bien-Guidé) est à la fois un héritier de la plus haute spiritualité islamique (ses maîtres inspirateurs ont été les mystique soufis Al Ghazali et Ibn Arabi), le libérateur autoproclamé du peuple soudanais colonisé, un conquérant fanatique et un grand seigneur prêt à sauver la vie de son adversaire respecté au prix de sa conversion, sinon pas de quartiers au nom d’Allah miséricordieux !Or tel est le premier mérite de ce roman : de camper sans parti pris (ou peu s’en faut, tant celui du Mahdi semble difficile à endosser jusqu’au bout) deux grandes figures «absolutistes» et des personnages «secondaires » non moins importants, qui constituent la chair vivante du roman de Barilier, illustrant le microcosme de Khartoum.Ville «jeune» (elle n’a été fondée qu’en 1823) et décatie à la fois, menacée de ruine à tout moment en ses murs de terre croulant en boue, garnison de colonie anglaise finissante sous-traitée par le khédive égyptien, ramassis d’aventuriers pratiquant (notamment) les trafics d’ivoire et d’esclaves, avec quelque chose d’un rêve oriental, des jardins édéniques le long du Nil, une mission chrétienne à l’adorable chapelle franciscaine et des bordels, une place pour les exécutions publiques, des marchés bigarrés en veux-tu et des intrigues pourries en voilà : telle est Khartoum à cette époque même où Rimbaud traficote au Harrar...Le pouvoir anglais, les religieux catholiques, les oulémas, les mercenaires égyptiens, les Soudanais dressés à la courbache ou ployant sous les dettes : un vrai souk en plan large. Et en cadre plus serré : quels personnages !Voici donc, au masculin singulier, Hansal le consul d’Autriche-Hongrie, flanqué de sa femme soudanaise et figurant l’homme plutôt débonnaire et même bon ; le comte français Alphonse de Veyssieux, débarqué à Khartoum sans un sou, enrichi dans les trafics à la tête d’une armée de forbans, tenant les Noirs pour des «singes» et cependant passionné de cartographie et d’ornithologie ; Pascal Darrel l’ancien communard, journaliste et écrivain qui voit en le Mahdi un révolutionnaire incarnant l’avenir de l’Afrique ; ou l’archéologue autrichien Karl Richard Lepuschütz en quête d’une élucidation « sur le terrain » de l’écriture méroïque, langue non encore déchiffrée de l’antique royaume de Koush...Ou voilà, au féminin pluriel, si l’on passe un peu vite sur une lady anglaise anti-esclavagiste entichée (pas pour longtemps) de Gordon : la figure lumineuse de Marie, fille de Darrel vouée à la garde de son père et au service des enfants – du pur Barilier ; ou sœur Matilda, pendant féminin du général, en plus impénétrable – elle lit le nihiliste Leopardi et tentera de s’ouvrir les veines –, et au sort final non moins affreux...Enfin, à part celles-ci et ceux-là, sortis de l’imagination du romancier : trois « anges » d’innocence au destin également déchirant, en les personnes des jeunes James et Lual, qu’on pourrait dire les fils adoptifs de Gordon ; et de sœur Concetta venue de Vérone toute soumise au service de son Seigneur doux et tombée aux mains des mahdistes qui lui réservent une fin de martyre relatée dans l’un des plus beaux et terribles chapitres du roman, intitulé « Nativité »...La tragique prise de Khartoum en janvier 1885, par les troupes du Mahdi, fait figure aujourd’hui de « scène primitive » d’un affrontement à la fois terrestre et « cosmique » qui n’en finit pas de ravager le monde contemporain, quand bien même l’origine du conflit remonterait à la nuit des siècles.Une métaphore astronomique marque d’ailleurs l’ouverture du roman sous la forme d’une comète dont l’apparition sera interprétée fort différemment (!) par les uns et les autres, présage de victoire ou de déroute ; et c’est bien de la multiplication des points de vue, que se nourrit ce roman combinant la vue générale (de Sirius, sinon de la comète) et l’immersion nous faisant croire que nous sommes, lecteurs, plongés dans le maelström humain de cette ville dont la topologie se construit comme « autour » de nous...Friedrich Dürenmatt – que Barilier a beaucoup traduit, soit dit en passant, et auquel il fait un clin d’œil en inventant le couple de serviteurs nubiens Hamza & Hamza employés par l’infâme Veyssieux – disait écrire entre le cendrier et l’étoile, et de même pourrait-on dire que Barilier écrit entre le cognac, qu’il fait boire à Gordon de manière compulsive, et le cosmos où son personnage lit son propre avenir «éternel» entre deux méditations empruntées au cardinal Newman, mystique et poète.Dans l’essai percutant intitulé Vertige de la force, paru en 2016, Étienne Barilier a déjà montré sa parfaite connaissance du « sujet islam » en abordant, avec une rare largeur d’esprit, la question de la violence par « devoir sacré » englobant celle des croisés chrétiens, de l’Inquisition espagnole ou du djihadisme actuel.Or Dans Khartoum assiégée nous fait passer de l’essai au roman filtrant tous les aspects de la réalité, laquelle est captée, dans sa profusion, par le détail. Comme on se rappelle l’épisode, dans Tintin, du sparadrap collé au nez ou au talon du capitaine Haddock, le roman de Barilier grave en notre mémoire une profusion de détails significatifs.«Laissez venir l’immensité des choses», disait Ramuz, et c’est, pour ne prendre que ces exemples, le recours récurrent de Gordon l’ascète à sa bouteille de cognac, ou le télescope avec lequel, juché sur le toit de son palais comme un veilleur à la Garcia Marquez, il surveille la progression des troupes du Mahdi par-delà les eaux du fleuve.Du détail à l’ensemble, le romancier se fait ainsi ingénieur, stratège au fait de la pose des mines et du consolidement des fortifications, peintre orientalisant (une scène fameuse de danse du ventre où l’archéologue se fait plumer par ceux qui sont supposés le guider), érudit ou théologien (Barilier est fils de pasteur comme Dürrenmatt), historien ou sondeur d’abysses métaphysiques...Si tous les personnages de ce roman ont raison, c’est que le romancier est allé partout à leur rencontre et à leur écoute. Aucun détour, aucune digression, aucune invention romanesque n’y sont gratuits. Tout sonne juste parce que tout est vrai. On devine l’énorme documentation accumulée par l’auteur pour aboutir à cette prodigieuse masse d’informations filtrées, dont le poids ne se fait jamais sentir, alors que la tension et l’émotion montent quand le siège impose famine après force trahisons et fuites in extremis, jusqu’au grand massacre final.Or une sorte de basse continue traverse tout le roman, qu’on pourrait dire la conscience lucide du tragique de la condition humaine, vécue par Gordon comme une inguérissable douleur d’enfance et une mort annoncée et finalement assumée « pour l’honneur » non sans augmenter l’horreur imposée aux autres, présente aussi chez l’athée Darrel et muettement subie par la religieuse Matilda qui se défénestre pour échapper à la meute des violeurs – et dans la mêlée ce sera Gordon décapité, des dizaines de milliers d’innocents à ajouter aux « dommages collatéraux » des causes diverses, le Mahdi mort peu après du typhus mais son sang roulant dans les veines de ses descendants revenus au pouvoir, bénis en 1990 par un certain Ben Laden, et sus aux impies !Comme je l’ai rappelé à propos de Martin Amis, René Girard a décrit, dans Mensonge romantique et verité romanesque, le processus qui, dans la création littéraire, tend à une façon de purification spirituelle, et c’est cette élévation que nous vivons, précisément, par-delà la montée aux extrêmes des derniers chapitres de ce roman, où la tragédie historico-politique se trouve à la fois dite dans le moindre détail, jusqu’à l’atroce, et comme sublimée par le chant du poète.Dans Khartoum assiégée, cinquante-troisième livre d’Étienne Barilier, constitue sans doute le chef-d’œuvre de l’écrivain à ce jour. Pas un roman de cette envergure n’a été publié en Suisse depuis C. F. Ramuz et Max Frisch, et quel équivalent en France actuelle ?Il y avait de l’enfant de chœur inspiré et du pur-sang farouche dans les premiers romans de Barilier (surtout Laura et Passion, d’une ligne ardente et pure), évoquant les premiers feux de l’amour juvénile (dès Orphée et L’Incendie du château) ou les vertiges du mimétisme (avec le voyeur de Passion), et la figure du junger Bursche surdoué, tiraillé entre la quête du « grand pourquoi » et les occurrences du couchage, court à travers le labyrinthe romanesque de l’écrivain outrageusement fécond (le milieu littéraire romand lui reprochera de trop écrire, et il répondra dans le percutant Soyons médiocres !), mais parallèlement se développeront des essais de haute volée qui font de lui l’un des humanistes européens les plus remarquables, dans la filiation de Denis de Rougemont.Un premier sommet, dans l’œuvre romanesque, sera atteint avec Le Dixième Siècle, splendide évocation de la Renaissance italienne dont les personnages, cependant, de Laurent le Magnifique à Pic de la Mirandole ou Machiavel, en passant par Savonarole et Michel-Ange, ne seront pas tout à fait incarnés «en pleine pâte », à proportion et dans le mouvement fondu du roman. Or ce travers persistera dans les romans ultérieurs de Barilier, comme si la grande intelligence et la vaste culture de l’auteur le contraignaient encore et l’empêchaient de toucher au « mystère de l’incarnation », si j’ose dire, qu’il atteint en revanche avec son dernier livre que son premier éditeur Vladimir Dimitrijević, notre cher Dimitri, devrait apprécier de son balcon en plein ciel...(Ce texte est extrait du recueil de Lectures et rencontres intitulé Les Jardins suspendus, paru en 2018 aux éditions Pierre-Guillaume de Roux)
Le génial romancier anglo-américain Henry James estimait que ce qui caractérise un grand roman tient au fait que tous les personnages y ont raison, et c’est ce qu’on se dit aussi bien en achevant la lecture du roman intitulé Dans Khartoum assiégée dont les protagonistes «historiques », semi-fictifs ou imaginés par l’auteur nous semblent avoir, sinon raison dans l’absolu, du moins leurs raisons respectives que le romancier détaille avec une remarquable équité, s’agissant par exemple d’une jeune religieuse italienne torturée ou d’un aristocrate français trafiquant d’ivoire et d’esclaves d’une abjection caractérisée, entre tant d’autres...Au premier rang de tous, héros déjà fameux au moment où il est envoyé à Khartoum par le gouvernement anglais, le général Charles Gordon est lui-même l’incarnation d’une contradiction fondamentale en sa double qualité d’âme sensible et de militaire, mystique lisant tous les soirs l’Imitation de Jésus-Christ et comptant à son actif divers massacres « au nom de Sa Majesté », tendre avec les enfants et les animaux et non moins inflexible en sa fonction, notamment en Chine où il a réprimé la révolte des Taïpings dans le sang.De la même façon, « face » à Gordon, qui ne le rencontrera jamais en personne, le chef de guerre « de droit divin » Mohammed Ahmed, dit le Mahdi (terme supposé tombé de la bouche même du Prophète, signifiant le Bien-Guidé) est à la fois un héritier de la plus haute spiritualité islamique (ses maîtres inspirateurs ont été les mystique soufis Al Ghazali et Ibn Arabi), le libérateur autoproclamé du peuple soudanais colonisé, un conquérant fanatique et un grand seigneur prêt à sauver la vie de son adversaire respecté au prix de sa conversion, sinon pas de quartiers au nom d’Allah miséricordieux !Or tel est le premier mérite de ce roman : de camper sans parti pris (ou peu s’en faut, tant celui du Mahdi semble difficile à endosser jusqu’au bout) deux grandes figures «absolutistes» et des personnages «secondaires » non moins importants, qui constituent la chair vivante du roman de Barilier, illustrant le microcosme de Khartoum.Ville «jeune» (elle n’a été fondée qu’en 1823) et décatie à la fois, menacée de ruine à tout moment en ses murs de terre croulant en boue, garnison de colonie anglaise finissante sous-traitée par le khédive égyptien, ramassis d’aventuriers pratiquant (notamment) les trafics d’ivoire et d’esclaves, avec quelque chose d’un rêve oriental, des jardins édéniques le long du Nil, une mission chrétienne à l’adorable chapelle franciscaine et des bordels, une place pour les exécutions publiques, des marchés bigarrés en veux-tu et des intrigues pourries en voilà : telle est Khartoum à cette époque même où Rimbaud traficote au Harrar...Le pouvoir anglais, les religieux catholiques, les oulémas, les mercenaires égyptiens, les Soudanais dressés à la courbache ou ployant sous les dettes : un vrai souk en plan large. Et en cadre plus serré : quels personnages !Voici donc, au masculin singulier, Hansal le consul d’Autriche-Hongrie, flanqué de sa femme soudanaise et figurant l’homme plutôt débonnaire et même bon ; le comte français Alphonse de Veyssieux, débarqué à Khartoum sans un sou, enrichi dans les trafics à la tête d’une armée de forbans, tenant les Noirs pour des «singes» et cependant passionné de cartographie et d’ornithologie ; Pascal Darrel l’ancien communard, journaliste et écrivain qui voit en le Mahdi un révolutionnaire incarnant l’avenir de l’Afrique ; ou l’archéologue autrichien Karl Richard Lepuschütz en quête d’une élucidation « sur le terrain » de l’écriture méroïque, langue non encore déchiffrée de l’antique royaume de Koush...Ou voilà, au féminin pluriel, si l’on passe un peu vite sur une lady anglaise anti-esclavagiste entichée (pas pour longtemps) de Gordon : la figure lumineuse de Marie, fille de Darrel vouée à la garde de son père et au service des enfants – du pur Barilier ; ou sœur Matilda, pendant féminin du général, en plus impénétrable – elle lit le nihiliste Leopardi et tentera de s’ouvrir les veines –, et au sort final non moins affreux...Enfin, à part celles-ci et ceux-là, sortis de l’imagination du romancier : trois « anges » d’innocence au destin également déchirant, en les personnes des jeunes James et Lual, qu’on pourrait dire les fils adoptifs de Gordon ; et de sœur Concetta venue de Vérone toute soumise au service de son Seigneur doux et tombée aux mains des mahdistes qui lui réservent une fin de martyre relatée dans l’un des plus beaux et terribles chapitres du roman, intitulé « Nativité »...La tragique prise de Khartoum en janvier 1885, par les troupes du Mahdi, fait figure aujourd’hui de « scène primitive » d’un affrontement à la fois terrestre et « cosmique » qui n’en finit pas de ravager le monde contemporain, quand bien même l’origine du conflit remonterait à la nuit des siècles.Une métaphore astronomique marque d’ailleurs l’ouverture du roman sous la forme d’une comète dont l’apparition sera interprétée fort différemment (!) par les uns et les autres, présage de victoire ou de déroute ; et c’est bien de la multiplication des points de vue, que se nourrit ce roman combinant la vue générale (de Sirius, sinon de la comète) et l’immersion nous faisant croire que nous sommes, lecteurs, plongés dans le maelström humain de cette ville dont la topologie se construit comme « autour » de nous...Friedrich Dürenmatt – que Barilier a beaucoup traduit, soit dit en passant, et auquel il fait un clin d’œil en inventant le couple de serviteurs nubiens Hamza & Hamza employés par l’infâme Veyssieux – disait écrire entre le cendrier et l’étoile, et de même pourrait-on dire que Barilier écrit entre le cognac, qu’il fait boire à Gordon de manière compulsive, et le cosmos où son personnage lit son propre avenir «éternel» entre deux méditations empruntées au cardinal Newman, mystique et poète.Dans l’essai percutant intitulé Vertige de la force, paru en 2016, Étienne Barilier a déjà montré sa parfaite connaissance du « sujet islam » en abordant, avec une rare largeur d’esprit, la question de la violence par « devoir sacré » englobant celle des croisés chrétiens, de l’Inquisition espagnole ou du djihadisme actuel.Or Dans Khartoum assiégée nous fait passer de l’essai au roman filtrant tous les aspects de la réalité, laquelle est captée, dans sa profusion, par le détail. Comme on se rappelle l’épisode, dans Tintin, du sparadrap collé au nez ou au talon du capitaine Haddock, le roman de Barilier grave en notre mémoire une profusion de détails significatifs.«Laissez venir l’immensité des choses», disait Ramuz, et c’est, pour ne prendre que ces exemples, le recours récurrent de Gordon l’ascète à sa bouteille de cognac, ou le télescope avec lequel, juché sur le toit de son palais comme un veilleur à la Garcia Marquez, il surveille la progression des troupes du Mahdi par-delà les eaux du fleuve.Du détail à l’ensemble, le romancier se fait ainsi ingénieur, stratège au fait de la pose des mines et du consolidement des fortifications, peintre orientalisant (une scène fameuse de danse du ventre où l’archéologue se fait plumer par ceux qui sont supposés le guider), érudit ou théologien (Barilier est fils de pasteur comme Dürrenmatt), historien ou sondeur d’abysses métaphysiques...Si tous les personnages de ce roman ont raison, c’est que le romancier est allé partout à leur rencontre et à leur écoute. Aucun détour, aucune digression, aucune invention romanesque n’y sont gratuits. Tout sonne juste parce que tout est vrai. On devine l’énorme documentation accumulée par l’auteur pour aboutir à cette prodigieuse masse d’informations filtrées, dont le poids ne se fait jamais sentir, alors que la tension et l’émotion montent quand le siège impose famine après force trahisons et fuites in extremis, jusqu’au grand massacre final.Or une sorte de basse continue traverse tout le roman, qu’on pourrait dire la conscience lucide du tragique de la condition humaine, vécue par Gordon comme une inguérissable douleur d’enfance et une mort annoncée et finalement assumée « pour l’honneur » non sans augmenter l’horreur imposée aux autres, présente aussi chez l’athée Darrel et muettement subie par la religieuse Matilda qui se défénestre pour échapper à la meute des violeurs – et dans la mêlée ce sera Gordon décapité, des dizaines de milliers d’innocents à ajouter aux « dommages collatéraux » des causes diverses, le Mahdi mort peu après du typhus mais son sang roulant dans les veines de ses descendants revenus au pouvoir, bénis en 1990 par un certain Ben Laden, et sus aux impies !Comme je l’ai rappelé à propos de Martin Amis, René Girard a décrit, dans Mensonge romantique et verité romanesque, le processus qui, dans la création littéraire, tend à une façon de purification spirituelle, et c’est cette élévation que nous vivons, précisément, par-delà la montée aux extrêmes des derniers chapitres de ce roman, où la tragédie historico-politique se trouve à la fois dite dans le moindre détail, jusqu’à l’atroce, et comme sublimée par le chant du poète.Dans Khartoum assiégée, cinquante-troisième livre d’Étienne Barilier, constitue sans doute le chef-d’œuvre de l’écrivain à ce jour. Pas un roman de cette envergure n’a été publié en Suisse depuis C. F. Ramuz et Max Frisch, et quel équivalent en France actuelle ?Il y avait de l’enfant de chœur inspiré et du pur-sang farouche dans les premiers romans de Barilier (surtout Laura et Passion, d’une ligne ardente et pure), évoquant les premiers feux de l’amour juvénile (dès Orphée et L’Incendie du château) ou les vertiges du mimétisme (avec le voyeur de Passion), et la figure du junger Bursche surdoué, tiraillé entre la quête du « grand pourquoi » et les occurrences du couchage, court à travers le labyrinthe romanesque de l’écrivain outrageusement fécond (le milieu littéraire romand lui reprochera de trop écrire, et il répondra dans le percutant Soyons médiocres !), mais parallèlement se développeront des essais de haute volée qui font de lui l’un des humanistes européens les plus remarquables, dans la filiation de Denis de Rougemont.Un premier sommet, dans l’œuvre romanesque, sera atteint avec Le Dixième Siècle, splendide évocation de la Renaissance italienne dont les personnages, cependant, de Laurent le Magnifique à Pic de la Mirandole ou Machiavel, en passant par Savonarole et Michel-Ange, ne seront pas tout à fait incarnés «en pleine pâte », à proportion et dans le mouvement fondu du roman. Or ce travers persistera dans les romans ultérieurs de Barilier, comme si la grande intelligence et la vaste culture de l’auteur le contraignaient encore et l’empêchaient de toucher au « mystère de l’incarnation », si j’ose dire, qu’il atteint en revanche avec son dernier livre que son premier éditeur Vladimir Dimitrijević, notre cher Dimitri, devrait apprécier de son balcon en plein ciel...(Ce texte est extrait du recueil de Lectures et rencontres intitulé Les Jardins suspendus, paru en 2018 aux éditions Pierre-Guillaume de Roux) -
j'te fais vite un brouillon...
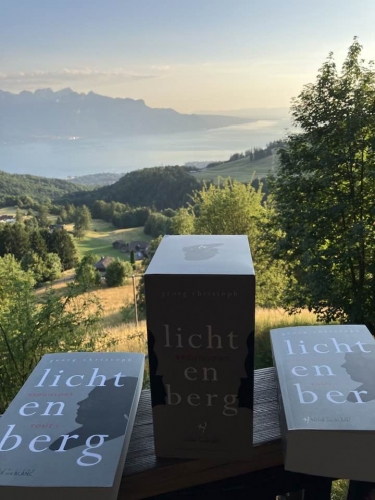 Lichtenberg über Alles...L'événement de ce soir au balcon en forêt de La Désirade, à 1111 mètres au-dessus des déchets marins: l'arrivée du fabuleux Objet éditorial que représentent les deux volumes (3745 pages dont un Index de plus de 100 pages !) des Brouillons de Georg Christoph Lichtenberg, dans la traduction d'Etienne Barilier. Révérence à celui-ci pour son immense travail et merci à Fanny Mossière, aux Editions Noir sur Blanc, pour ce cadeau sans prix. Chronique suivra...
Lichtenberg über Alles...L'événement de ce soir au balcon en forêt de La Désirade, à 1111 mètres au-dessus des déchets marins: l'arrivée du fabuleux Objet éditorial que représentent les deux volumes (3745 pages dont un Index de plus de 100 pages !) des Brouillons de Georg Christoph Lichtenberg, dans la traduction d'Etienne Barilier. Révérence à celui-ci pour son immense travail et merci à Fanny Mossière, aux Editions Noir sur Blanc, pour ce cadeau sans prix. Chronique suivra... -
Comme un voyant illettré
 Il reste toujours à cheval,c’est question de principe :dès ses premiers temps maréchal,du mental en ses tripes,il sera le fils de lui-même :« il n’est pas de problème »aura-t-il clamé par les ans,qui ne se règle au fil d’épée,de taille et puis d’estoc,mes vers ne seront que du toc -je suis mon seul aval…Les psys se sont interrogésau chevet du sujet :il n’y a trace chez ce typedu malheureux Œdipeflinguant son pater militaireet baisant la mégèrelui tenant lieu de mère sévère –rien du scénar à bon marchédes catéchèses éculées :rien que du neuf en ce bel œuf !Les assis n’en reviennent pas,les pontifes aux aboisredoutent la déroute :quoi ce voyou voyantnous la ferait à l’impérialecaracolant sur sa montureindomptable cavale -quoi le temps porté par le ventet ce chant avenantferaient l'enchantementde toute Créature !
Il reste toujours à cheval,c’est question de principe :dès ses premiers temps maréchal,du mental en ses tripes,il sera le fils de lui-même :« il n’est pas de problème »aura-t-il clamé par les ans,qui ne se règle au fil d’épée,de taille et puis d’estoc,mes vers ne seront que du toc -je suis mon seul aval…Les psys se sont interrogésau chevet du sujet :il n’y a trace chez ce typedu malheureux Œdipeflinguant son pater militaireet baisant la mégèrelui tenant lieu de mère sévère –rien du scénar à bon marchédes catéchèses éculées :rien que du neuf en ce bel œuf !Les assis n’en reviennent pas,les pontifes aux aboisredoutent la déroute :quoi ce voyou voyantnous la ferait à l’impérialecaracolant sur sa montureindomptable cavale -quoi le temps porté par le ventet ce chant avenantferaient l'enchantementde toute Créature ! -
Un pas après l'autre
 Le fil invisible (94)Même après sa terrible opération (huit heures au bloc, un arrêt du cœur momentané et une perfo chirurgicale hallucinante au dire d’un des jeunes assistants du patron), Lady L. sûre qu’elle allait mourir disait tranquillement qu’on allait y aller mollo mollo, un pas après l’autre, et toi tu te gardais de la contredire, partageant son goût du vrai et n’en pouvant plus d’entendre ceux qui, pour se rassurer eux-mêmes, l’enjoignaient de s’accrocher, allez allez vous allez remonter la pente, mais elle laissait filer et toi tu te retenais d’aboyer, donc c‘était un pas après l’autre , et quatre étés après ce dernier-là, donc trois hivers après la nuit fatale de peu avant Noël, quand elle a eu encore le cran de te dire qu’on devait être reconnaissant de pouvoir encore rire et sourire de tout ça, ce matin d’un réveil exacerbé par les lancées de crampes à hurler, tu te dis mollo mollo, elle n’est plus là, les filles sont loin, tu vas y aller un pas après l’autre, et voilà que t’arrivent les dernières nouvelles de Gaza et ça fait encore plus mal vu que tu sais qu’il n’y a rien à faire qu’à compatir et que ça fera une belle jambe aux martyrs, et là tu penses à vos kids qui vont débarquer dans ce monde-là et tu te dis que tout est parfait, allez allez on ne se laisse pas aller – allons-y alonso comme à chaque fois que vous repartiez vous royaumer avec Lady l. , cela vous aura fait rire et sourire jusqu’à la fin, tu lui disais comme ça « en allons-nous », c’était reparti pour un pas après l’autre, et elle concluait à la manière d'Alphonse Allais : « et ils s’en allent »…
Le fil invisible (94)Même après sa terrible opération (huit heures au bloc, un arrêt du cœur momentané et une perfo chirurgicale hallucinante au dire d’un des jeunes assistants du patron), Lady L. sûre qu’elle allait mourir disait tranquillement qu’on allait y aller mollo mollo, un pas après l’autre, et toi tu te gardais de la contredire, partageant son goût du vrai et n’en pouvant plus d’entendre ceux qui, pour se rassurer eux-mêmes, l’enjoignaient de s’accrocher, allez allez vous allez remonter la pente, mais elle laissait filer et toi tu te retenais d’aboyer, donc c‘était un pas après l’autre , et quatre étés après ce dernier-là, donc trois hivers après la nuit fatale de peu avant Noël, quand elle a eu encore le cran de te dire qu’on devait être reconnaissant de pouvoir encore rire et sourire de tout ça, ce matin d’un réveil exacerbé par les lancées de crampes à hurler, tu te dis mollo mollo, elle n’est plus là, les filles sont loin, tu vas y aller un pas après l’autre, et voilà que t’arrivent les dernières nouvelles de Gaza et ça fait encore plus mal vu que tu sais qu’il n’y a rien à faire qu’à compatir et que ça fera une belle jambe aux martyrs, et là tu penses à vos kids qui vont débarquer dans ce monde-là et tu te dis que tout est parfait, allez allez on ne se laisse pas aller – allons-y alonso comme à chaque fois que vous repartiez vous royaumer avec Lady l. , cela vous aura fait rire et sourire jusqu’à la fin, tu lui disais comme ça « en allons-nous », c’était reparti pour un pas après l’autre, et elle concluait à la manière d'Alphonse Allais : « et ils s’en allent »… -
Encore une journée divine !
 En marchant sur le quai aux Fleurs avec Lady L. D'une série télé débile évoquant La vie de J.C., et de notre façon de "faire parler le ciel"... Flash back en octobre 2021...(Lectures du monde, 2021)DIMANCHE . – Lady L. peine un peu à marcher long ce matin, tout en gardant son port de reine sous sa couronne blond cendré. Le père Noël glisse dans sa nacelle au-dessus de nous, le long du câble qui vient d’être installé au-dessus de la statue de Fred Mercury, un culte survolant un autre, mais ce matin il fait si limpide, le lac est si clair, les gens ont l’air si détendu - sauf la Roumaine qui essaie de vendre l’une des roses de son bouquet défraîchi datant des invendus d’hier soir à la Migros - , tout me semble si parfait à part la maladie de ma bonne amie, mon genou droit qui lancine, mon souffle au cœur et le sort des jeunes Afghanes, que je ne suis pas d’humeur à critiquer quoi que ce soit même en me rappelant les humiliantes inepties vues hier soir à la télé romande où j’ai fini par regarder trois épisodes, plus imbéciles et insignifiants l’un que l’autre, de la série intitulée La vie de JC, d’une nullité qui reflète bien ce qu’est devenue le média en question, reflet lui-même d’une partie de la société suisse dont la seule vraie religion est celle du wellness et de la conformité matérialiste.Critiquer cela ? Se formaliser du fait qu’on dépense des sommes pour faire naviguer un Santa Claus de supermarché dans notre ciel en cette matinée lustrale, se lancer dans une polémique au motif qu’on montre à la télé de l’irrespect au rabbi Iéshoua, comme si le péché de crétinerie pouvait entacher la pointe de son dernier orteil, et quoi encore ?
En marchant sur le quai aux Fleurs avec Lady L. D'une série télé débile évoquant La vie de J.C., et de notre façon de "faire parler le ciel"... Flash back en octobre 2021...(Lectures du monde, 2021)DIMANCHE . – Lady L. peine un peu à marcher long ce matin, tout en gardant son port de reine sous sa couronne blond cendré. Le père Noël glisse dans sa nacelle au-dessus de nous, le long du câble qui vient d’être installé au-dessus de la statue de Fred Mercury, un culte survolant un autre, mais ce matin il fait si limpide, le lac est si clair, les gens ont l’air si détendu - sauf la Roumaine qui essaie de vendre l’une des roses de son bouquet défraîchi datant des invendus d’hier soir à la Migros - , tout me semble si parfait à part la maladie de ma bonne amie, mon genou droit qui lancine, mon souffle au cœur et le sort des jeunes Afghanes, que je ne suis pas d’humeur à critiquer quoi que ce soit même en me rappelant les humiliantes inepties vues hier soir à la télé romande où j’ai fini par regarder trois épisodes, plus imbéciles et insignifiants l’un que l’autre, de la série intitulée La vie de JC, d’une nullité qui reflète bien ce qu’est devenue le média en question, reflet lui-même d’une partie de la société suisse dont la seule vraie religion est celle du wellness et de la conformité matérialiste.Critiquer cela ? Se formaliser du fait qu’on dépense des sommes pour faire naviguer un Santa Claus de supermarché dans notre ciel en cette matinée lustrale, se lancer dans une polémique au motif qu’on montre à la télé de l’irrespect au rabbi Iéshoua, comme si le péché de crétinerie pouvait entacher la pointe de son dernier orteil, et quoi encore ? Ma bonne amie me disait, en marchant le long du quai aux Fleurs, qu’elle n’avait plus la moindre envie de se pointer dans aucune église, me racontant l’anecdote lamentable d’une pasteure s’adressant à ses paroissiens en les appelant « mes chers schtroumpfs», et je me rappelle le désarroi de mes gentils parents protestants sommés, au culte, par un jeune théologien New Age, de lui soumettre un thème de débat convivial qu’il se contenterait de coacher - dans l’église même des hauts de Lausanne où j’ai confirmé à seize ans, transformée en « espace Dieu » avec wi-fi et coin BD pour les kids, en attendant le jacuzzi king size…
Ma bonne amie me disait, en marchant le long du quai aux Fleurs, qu’elle n’avait plus la moindre envie de se pointer dans aucune église, me racontant l’anecdote lamentable d’une pasteure s’adressant à ses paroissiens en les appelant « mes chers schtroumpfs», et je me rappelle le désarroi de mes gentils parents protestants sommés, au culte, par un jeune théologien New Age, de lui soumettre un thème de débat convivial qu’il se contenterait de coacher - dans l’église même des hauts de Lausanne où j’ai confirmé à seize ans, transformée en « espace Dieu » avec wi-fi et coin BD pour les kids, en attendant le jacuzzi king size…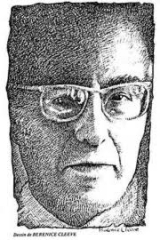 Comme l’écrit virulemment le grand philosophe juif Albert Caraco, nous continuons de vivre en nous référant à un Absolu qui ne représente plus rien aujourd’hui en réalité, la réalité n’étant autre que le culte universel de l’Argent, nous manquons à l’Absolu de l’esprit qui nous ferait convenir de la relativité des choses établies depuis les temps de l’Ecclésiaste et même avant (!), dans la foulée de Nietzsche mais en plus cruellement radical, Caraco se voudrait l’éveilleur futur à la Voltaire en nous mettant en garde contre les mensonges des idéologies religieuses et politiques, mais ce qu’il écrit est si criant de vérité, si brutalement assené parfois, si magnifiquement clamé, comme d’un prophète inspiré, mais dans une langue si merveilleusement anachronique (on dirait un polémiste du XVIIIe siècle) qu’elle sera inintelligible à 99% des followers de réseaux sociaux et autres locuteurs de la meute actuelle…Il y a près de 60 ans que je m’intéresse à ce qui fait « parler le ciel », selon l’expression de Peter Sloterdijk, « mon » penseur actuel de prédilection, avec René Girard, dont le dernier livre traite de « théopoésie », par delà toute théologie.
Comme l’écrit virulemment le grand philosophe juif Albert Caraco, nous continuons de vivre en nous référant à un Absolu qui ne représente plus rien aujourd’hui en réalité, la réalité n’étant autre que le culte universel de l’Argent, nous manquons à l’Absolu de l’esprit qui nous ferait convenir de la relativité des choses établies depuis les temps de l’Ecclésiaste et même avant (!), dans la foulée de Nietzsche mais en plus cruellement radical, Caraco se voudrait l’éveilleur futur à la Voltaire en nous mettant en garde contre les mensonges des idéologies religieuses et politiques, mais ce qu’il écrit est si criant de vérité, si brutalement assené parfois, si magnifiquement clamé, comme d’un prophète inspiré, mais dans une langue si merveilleusement anachronique (on dirait un polémiste du XVIIIe siècle) qu’elle sera inintelligible à 99% des followers de réseaux sociaux et autres locuteurs de la meute actuelle…Il y a près de 60 ans que je m’intéresse à ce qui fait « parler le ciel », selon l’expression de Peter Sloterdijk, « mon » penseur actuel de prédilection, avec René Girard, dont le dernier livre traite de « théopoésie », par delà toute théologie.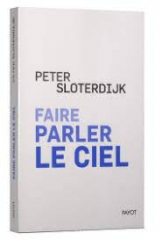 De quoi s’agit-il ? D’une façon de «poétiser» le phénomène religieux ? Absolument pas. Bien plutôt, de rapporter l’esprit religieux à ses sources de perception et d’expression, à ce qui a suscité le premier cri, la première angoisse, le premier pourquoi, etc.À quoi rime le premier chant ? Et comment les dieux, apparaissant dans le vocabulaire de Sapiens, ont-ils évolué jusqu’à s’exprimer comme les individus de notre singulière espèce ?Réduire la religion à un «opium du peuple» (pensée démarquée de Marx et d’ailleurs à faux) est aussi discutable que faire de l’athéologie un progrès, sauf à consommer les gélules de l’apothicaire Michel Onfray qui a réponse à tout, à l’instar des curés plus ou moins sympas. De la même façon s’offusquer des caricatures les plus vulgaires, dans les journaux ou à la télé, procède d’un discours qui n’en finit pas de se mordre la queue, etc.L’important est ailleurs, et peut-être est-cela « le religieux » ? Je lisais hier soir les pages des Dictées de Georges Simenon, relatives au suicide de sa fille Marie-Jo. Et je pensais à la mort de mon meilleur ami, un dimanche d’août de gloire solaire en montagne. Et je pense à l’instant, en me rappelant la réflexion de mon vieil ami Joseph Czapski revenu du bout de la nuit totalitaire, selon laquelle l’histoire du Christ se réduirait pour lui à l’histoire de la bonté, incluant toutes les confessions, à ce que nous vivons ces jours, et je vois le sourire de Lady L. , ce matin, luttant contre la mort sous sa couronne de vivante…
De quoi s’agit-il ? D’une façon de «poétiser» le phénomène religieux ? Absolument pas. Bien plutôt, de rapporter l’esprit religieux à ses sources de perception et d’expression, à ce qui a suscité le premier cri, la première angoisse, le premier pourquoi, etc.À quoi rime le premier chant ? Et comment les dieux, apparaissant dans le vocabulaire de Sapiens, ont-ils évolué jusqu’à s’exprimer comme les individus de notre singulière espèce ?Réduire la religion à un «opium du peuple» (pensée démarquée de Marx et d’ailleurs à faux) est aussi discutable que faire de l’athéologie un progrès, sauf à consommer les gélules de l’apothicaire Michel Onfray qui a réponse à tout, à l’instar des curés plus ou moins sympas. De la même façon s’offusquer des caricatures les plus vulgaires, dans les journaux ou à la télé, procède d’un discours qui n’en finit pas de se mordre la queue, etc.L’important est ailleurs, et peut-être est-cela « le religieux » ? Je lisais hier soir les pages des Dictées de Georges Simenon, relatives au suicide de sa fille Marie-Jo. Et je pensais à la mort de mon meilleur ami, un dimanche d’août de gloire solaire en montagne. Et je pense à l’instant, en me rappelant la réflexion de mon vieil ami Joseph Czapski revenu du bout de la nuit totalitaire, selon laquelle l’histoire du Christ se réduirait pour lui à l’histoire de la bonté, incluant toutes les confessions, à ce que nous vivons ces jours, et je vois le sourire de Lady L. , ce matin, luttant contre la mort sous sa couronne de vivante… -
Alter ego
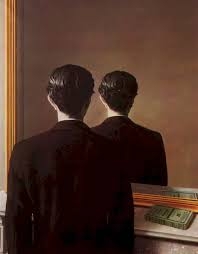 Il ne sera jamais perdu:une main le retient,aux lieux dits les plus dangereuxoù son penchant le porte,son autre Je l’escortequi d'un mot le détournerades périls sans enjeux ;les dieux seraient presque jalouxd'une telle alliancesans ignorer rien de ce faitde la pure confiance...On est là comme à la maison :ce qui semble un dédaleaux froides conversationss’entrouvre soudain et partout,aux petits faits chagrinsmais qui en disent long sur tout,tant qu’aux desseins secrets,que révèle dans l'éphémèrele plus tendre mystère...Nous serons un peu à l’écart,souriant dans le noir,notre alliance paraît équivoqueaux mesquins qui se moquent,mais que nous importe l’importantde ces cages sans portesau dernier lever des amarresdans l’effusion du soir…
Il ne sera jamais perdu:une main le retient,aux lieux dits les plus dangereuxoù son penchant le porte,son autre Je l’escortequi d'un mot le détournerades périls sans enjeux ;les dieux seraient presque jalouxd'une telle alliancesans ignorer rien de ce faitde la pure confiance...On est là comme à la maison :ce qui semble un dédaleaux froides conversationss’entrouvre soudain et partout,aux petits faits chagrinsmais qui en disent long sur tout,tant qu’aux desseins secrets,que révèle dans l'éphémèrele plus tendre mystère...Nous serons un peu à l’écart,souriant dans le noir,notre alliance paraît équivoqueaux mesquins qui se moquent,mais que nous importe l’importantde ces cages sans portesau dernier lever des amarresdans l’effusion du soir… -
Mon auberge espagnole

 Six poèmes de JLK / Seis poemasVersión de Mario Martín GijónLueurs audiblesLa porte est grand ouverte:on voit le gisement de lucioles de loin…Le cœur de la ville engloutiebat calmement dans l’onde,et le silence se souvient…Je navigue à l’étoilesur le clavier muetoù, dès enfant, je m’exerçaisà l’écart de l’écart,au milieu juste du milieu…Tenir alors la notedans la clairière du sommeilm’aidait à voir, de loin,ce qui là-bas semble en éveil…Luces audiblesLa puerta de par en par:a lo lejos, un yacimiento de luciérnagas…El corazón de la ciudad sumergidalate con calma entre las ondas,y el silencio recuerda…Navego bajo las estrellassobre el piano mudodonde, de niño, me ejercitabaal margen del margenjusto en medio del medio…Mantener entonces la notaen el claro del sueñome ayudaba a ver, de lejos,lo que allí parece despierto…À l’instant qui s’éveilleLes morts, en moi, ne le sont pas...Derrière vos yeux fermésje nous revois dans les grands bois,derrière l’ancien quartier…Tu m’attends encore quelque partoù nous nous attardionsdans la lumière du soir -sur ton visage un doux rayonm’éclairait et m’éclaire encore…Le temps n’est plus depuis longtempsdans nos cœurs isolés:chacun de vos noms m’est présent,à chaque battementde votre sang remémoréje revis et revoisle cœur muet du temps secret…Clairière en ceux qui s’émerveillent,à jamais cet instantinstaure en nous ce doux éveilqu’est celui du présent.Al instante que se despiertaLos muertos, en mí, no lo están...Detrás de vuestros ojos cerradosos veo de nuevo, de pie, en los grandes bosques,detrás del casco antiguo…Tú me esperas aún en alguna partedonde nos demorábamosen la luz del atardecer -sobre tu rostro un dulce rayome iluminaba y me ilumina aún…El tiempo que no hay desde hace tiempoen nuestros corazones aislados:cada uno de vuestros nombres está presente,a cada latidode vuestra sangre recordadaveo y revisoel corazón mudo del tiempo secreto…Un claro en aquellos que se maravillan,para siempre este instanteinstaura en nosotros esta dulce vigiliaque es la del presente...Comme un rêve éveilléJ’ai vu passer le lent cortègedes âmes aux lèvres grises,j'étais avec elles et sans elles:je portais des valisespleines de mes diverses vies;je regardais le défilédes foules aux longs visagespassant et bientôt dépasséspar leurs ombres sans âge...Immobile je me tenaisaux mains déjà tenuesdes vivants qui ne l’étaient plus,que je reconnaissaissans parvenir à les nommertant ils étaient les mêmes,tant ils étaient sous tant de masques,tant ils me fuyaient du regard...Ne nous oublie jamais,jeunesse à jamais fantasque,semblaient chanter en litanieaffligée et très pureleurs voix comme sorties des mursde mon rêve éveillé -n’oublie jamais ta douce enfance,ta mortelle innocence...Como un sueño despiertoHe visto pasar el lento cortejode almas de labios grises,estaba con ellas y sin ellas:llevaba maletasllenas de mis vidas diversas;miraba el desfilede una multitud de rostros largospasando y en seguida superadospor sus sombras sin edad...Inmóvil me aferrabaa las manos ya tenuesde los vivos,que reconocíasin llegar a poder nombrarlosde tanto que eran los mismos,de tantas máscaras como llevaban,de tanto cómo me rehuían la mirada...No nos olvides jamás,juventud siempre caprichosa,parecían cantar en una litaníaafligida pero muy purasus voces como salidas de los murosde mi sueño despierto -no olvides jamás tu dulce infancia,tu mortal inocencia...Hors les mursLe Temps est une île au trésor…Chaque instant se résumeà des océans déployéspar delà les brumes -dès l’aube la rue est à nous,qui descend jusqu’aux quaispar delà les tours d’illusionoù tout devient travail,où tout devient enfantement...Le Temps est cette île des mortsen nous depuis le jourdes brumeuses journées d’enfanceoù tout nous apparutcomme jamais ensuite:tout ce bleu par delà les toits,ce roux des lointains volcans,ce tintamarre des machinessuant l’huile odorantedans les grands bâtiments en partancepar delà la première chambre…Le temps est le bel oxymoreignorant tout remords,de l’immobile mouvementet de tous les essors...ExtramurosEl Tiempo es una isla del tesoro…Cada instante se resumeen océanos desplegadosmás allá de las brumas -desde el alba, es nuestra la calleque desciende hasta los muellesmás allá de las torres de ilusionesdonde todo se vuelve trabajo,o todo se vuelve parto...El Tiempo es esta isla de los muertosque hay en nosotros desde el díade las brumosas mañanas de la infanciacuando todo nos parecíacomo nunca más después:todo ese azul encima de los tejados,ese rojizo de los volcanes lejanos,El estrépito de las máquinassudando aceite aromáticoen los grandes edificios que partenmás allá de la primera habitación…El tiempo es un bello oxímoronignorando todo remordimiento,del movimiento inmóvily de todos los apogeos...Ce qui fut sera(Pour L.)Je voudrais tout recommencer,et que tout soit pareil :mon enfance aux tempes vermeilles,à beaucoup s’ennuyerdurant les pluies d’été;puis au seul de l’adolescence,nouer des amitiésjurées pour toutes les vacances…Mon amour m’attendra làdans le bar que tu te rappelles,et par les allées des annéesje ne reviendrai que pour toi;et pour elles et pour eux,et pour les tendres heuresà parler jamais de retour -nous allons tout recommencer…Lo que fue será(Para L.)Quisiera empezar todo de nuevo,y que todo fuera igual:mi infancia de sienes bermejas,aburriéndonos como ostrasdurante las lluvias del verano;luego el umbral de la adolescencia,anudar amistadescon juramentos de vacaciones…Mi amor me esperará ahíen el bar que tan bien recuerdas,y por las avenidas de los añosno volveré sino por ti;y por ellas y por ellos,y por las horas tiernassin hablar jamás de retorno -vamos a empezar todo de nuevoLe silence des arbresTu ne pèses pas lourd,mais ces os empilés,ces mains qui décapitent,ces fosses refermées,ces murs dynamitésdisent ce que tu es...Nous qui n'avons de motsque ceux que tu nous prêtes,nous t'écoutons pleurer,te plaindre, tempêter,geindre puis menacer;comme l'ange et la bête,faire ce que tu hais…Comme la femme au puitsou le poète hagard,nous restons éveillés,mais nous ne disons motqui ajoute à tes crisle vacarme du sang…Cependant tu le sais:tu sais notre clairière,ton poids n'est qu'un refus,le silence t'attend -il n'est point de barrièrepour ce qui souffle en toi...El silencio de los árbolesNo pesas mucho,pero esta pila de huesos,estas manos que decapitan,estas fosas cerradas,estos muros dinamitados,dicen lo que eres...Nosotros que no tenemos palabrassalvo las que nos prestas,te escuchamos llorar,quejarte, atormentarte,gemir y amenazar luego;como el ángel y la bestia,hacer lo que odias…Como la mujer de los pozoso el poeta aturdido,permanecemos despiertos,pero no decimos palabraque vaya a sumarse a los gritosal escándalo de la sangre…Sin embargo tú lo sabes :sabes nuestro claro en el bosque,tu peso no es sino un rechazo,el silencio te espera -ya no hay barrerapara lo que sopla en ti.Young MemoriesNous avions vingt ans d'âgeet le vent jeune aussi,la nuit au sommet de l'îlenous décoiffait et sculptait nos visagesde demi- dieux que partageaitl'amoureuse hésitation,sans poids ni liens que nosombres dansantesenivrées au vin de Samos,les dauphins surgis de l'eau claire,nos impatiences enlacées,un consul ivre sous le volcanet le feu du ciel par delà le dix-septième parallèle...Et partout, et déjà,défiant toute innocence,les damnés de la terreplus que jamais déniés;et si vaine la nostalgiede nos vingt ans,en l'insolente injonction de nos rebellions...C'était hier et c'est demain,et nos vieilles mains sur le sableretracent en tremblant les motsqui se prononcent les yeux fermésau secret des clairières.(San Francisco, Nobhill, ce 21 avril 2017)Young MemoriesTeníamos veinte añosy el aire también joven,la noche sobre la islanos despeinaba y esculpía nuestros rostrosde semidioses que compartíanla duda enamorada,sin peso ni lazos salvo nuestrassombras danzantesborrachos del vino de Samos,los delfines surgidos de las aguas transparentes,nuestras impaciencias enlazadas,un cónsul ebrio bajo el volcány el fuego celeste más allá del paralelo diecisiete...Y por todas partes, y ya,desafiando toda inocencia,los condenados de la tierranegados más que nunca;y tan vana la nostalgiade nuestros veinte años,en el insolente requerimiento de nuestras rebeliones...Era ayer y es mañana,y nuestras manos ancianas sobre la arenavuelven a trazar temblando las palabrasque se pronuncian con los ojos cerradosen el secreto de los claros del bosque.(San Francisco, Nobhill, 21 de abril de 2017)Jean-Louis Kuffer (Lausana, 1947) es un escritor, periodista y crítico literario suizo. Durante medio siglo ha ejercido la crítica literaria en diarios como La Tribune de Lausanne, La Liberté de Fribourg, la Gazette de Lausanne, o Le Matin. Entre 1976 y 1994 dirigió la colección « Contemporains » en L’Âge d’Homme, la editorial más importante de la Suiza francófona, en estrecha colaboración con su director, Vladimir Dimitrijevic. Fue uno de los fundadores, en 1992, de la revista Le Passe-Muraille, que sigue viva en formato electrónico. Asimismo mantiene desde 2005 dos blogs literarios, Carnets de JLK y Lectures du monde. Entre sus más de treinta libros pueden destacarse las novelas cortas Le Pain de coucou (Premio Schiller, 1983) y Par les temps qui courent (Premio Edouard-Rod, 1986), los poemarios Le Sablier des étoiles. Fugues helvètes (1999) o La Fée Valse (2017), así como la novela Le Viol de l’ange (1977). Jean-Louis Kuffer es asimismo un notable autor de diarios, donde refleja a la vez el bullicioso mundo literario de la Suiza romanda, su amistad con poetas como Georges Haldas o Jacques Chessex, o su rico mundo interior, en constante evolución. Entre sus volúmenes de diarios y crónicas destacan L’Ambassade du Papillon. Carnets 1993-1999 (2000), Les Passions partagées: Lectures du monde, carnets 1973-1992 (Premio Boudry, 2004), Les jardins suspendus, lectures et rencontres 1968-2018 (2018). Su último libro se titula, irónicamente, Nous sommes tous des zombies sympas (2019).Images: JLK dans la librairie mythique City Light Books, à San Francisco, en 2017. Mario Martin Gijon de passage en Lavaux, en 2022.
Six poèmes de JLK / Seis poemasVersión de Mario Martín GijónLueurs audiblesLa porte est grand ouverte:on voit le gisement de lucioles de loin…Le cœur de la ville engloutiebat calmement dans l’onde,et le silence se souvient…Je navigue à l’étoilesur le clavier muetoù, dès enfant, je m’exerçaisà l’écart de l’écart,au milieu juste du milieu…Tenir alors la notedans la clairière du sommeilm’aidait à voir, de loin,ce qui là-bas semble en éveil…Luces audiblesLa puerta de par en par:a lo lejos, un yacimiento de luciérnagas…El corazón de la ciudad sumergidalate con calma entre las ondas,y el silencio recuerda…Navego bajo las estrellassobre el piano mudodonde, de niño, me ejercitabaal margen del margenjusto en medio del medio…Mantener entonces la notaen el claro del sueñome ayudaba a ver, de lejos,lo que allí parece despierto…À l’instant qui s’éveilleLes morts, en moi, ne le sont pas...Derrière vos yeux fermésje nous revois dans les grands bois,derrière l’ancien quartier…Tu m’attends encore quelque partoù nous nous attardionsdans la lumière du soir -sur ton visage un doux rayonm’éclairait et m’éclaire encore…Le temps n’est plus depuis longtempsdans nos cœurs isolés:chacun de vos noms m’est présent,à chaque battementde votre sang remémoréje revis et revoisle cœur muet du temps secret…Clairière en ceux qui s’émerveillent,à jamais cet instantinstaure en nous ce doux éveilqu’est celui du présent.Al instante que se despiertaLos muertos, en mí, no lo están...Detrás de vuestros ojos cerradosos veo de nuevo, de pie, en los grandes bosques,detrás del casco antiguo…Tú me esperas aún en alguna partedonde nos demorábamosen la luz del atardecer -sobre tu rostro un dulce rayome iluminaba y me ilumina aún…El tiempo que no hay desde hace tiempoen nuestros corazones aislados:cada uno de vuestros nombres está presente,a cada latidode vuestra sangre recordadaveo y revisoel corazón mudo del tiempo secreto…Un claro en aquellos que se maravillan,para siempre este instanteinstaura en nosotros esta dulce vigiliaque es la del presente...Comme un rêve éveilléJ’ai vu passer le lent cortègedes âmes aux lèvres grises,j'étais avec elles et sans elles:je portais des valisespleines de mes diverses vies;je regardais le défilédes foules aux longs visagespassant et bientôt dépasséspar leurs ombres sans âge...Immobile je me tenaisaux mains déjà tenuesdes vivants qui ne l’étaient plus,que je reconnaissaissans parvenir à les nommertant ils étaient les mêmes,tant ils étaient sous tant de masques,tant ils me fuyaient du regard...Ne nous oublie jamais,jeunesse à jamais fantasque,semblaient chanter en litanieaffligée et très pureleurs voix comme sorties des mursde mon rêve éveillé -n’oublie jamais ta douce enfance,ta mortelle innocence...Como un sueño despiertoHe visto pasar el lento cortejode almas de labios grises,estaba con ellas y sin ellas:llevaba maletasllenas de mis vidas diversas;miraba el desfilede una multitud de rostros largospasando y en seguida superadospor sus sombras sin edad...Inmóvil me aferrabaa las manos ya tenuesde los vivos,que reconocíasin llegar a poder nombrarlosde tanto que eran los mismos,de tantas máscaras como llevaban,de tanto cómo me rehuían la mirada...No nos olvides jamás,juventud siempre caprichosa,parecían cantar en una litaníaafligida pero muy purasus voces como salidas de los murosde mi sueño despierto -no olvides jamás tu dulce infancia,tu mortal inocencia...Hors les mursLe Temps est une île au trésor…Chaque instant se résumeà des océans déployéspar delà les brumes -dès l’aube la rue est à nous,qui descend jusqu’aux quaispar delà les tours d’illusionoù tout devient travail,où tout devient enfantement...Le Temps est cette île des mortsen nous depuis le jourdes brumeuses journées d’enfanceoù tout nous apparutcomme jamais ensuite:tout ce bleu par delà les toits,ce roux des lointains volcans,ce tintamarre des machinessuant l’huile odorantedans les grands bâtiments en partancepar delà la première chambre…Le temps est le bel oxymoreignorant tout remords,de l’immobile mouvementet de tous les essors...ExtramurosEl Tiempo es una isla del tesoro…Cada instante se resumeen océanos desplegadosmás allá de las brumas -desde el alba, es nuestra la calleque desciende hasta los muellesmás allá de las torres de ilusionesdonde todo se vuelve trabajo,o todo se vuelve parto...El Tiempo es esta isla de los muertosque hay en nosotros desde el díade las brumosas mañanas de la infanciacuando todo nos parecíacomo nunca más después:todo ese azul encima de los tejados,ese rojizo de los volcanes lejanos,El estrépito de las máquinassudando aceite aromáticoen los grandes edificios que partenmás allá de la primera habitación…El tiempo es un bello oxímoronignorando todo remordimiento,del movimiento inmóvily de todos los apogeos...Ce qui fut sera(Pour L.)Je voudrais tout recommencer,et que tout soit pareil :mon enfance aux tempes vermeilles,à beaucoup s’ennuyerdurant les pluies d’été;puis au seul de l’adolescence,nouer des amitiésjurées pour toutes les vacances…Mon amour m’attendra làdans le bar que tu te rappelles,et par les allées des annéesje ne reviendrai que pour toi;et pour elles et pour eux,et pour les tendres heuresà parler jamais de retour -nous allons tout recommencer…Lo que fue será(Para L.)Quisiera empezar todo de nuevo,y que todo fuera igual:mi infancia de sienes bermejas,aburriéndonos como ostrasdurante las lluvias del verano;luego el umbral de la adolescencia,anudar amistadescon juramentos de vacaciones…Mi amor me esperará ahíen el bar que tan bien recuerdas,y por las avenidas de los añosno volveré sino por ti;y por ellas y por ellos,y por las horas tiernassin hablar jamás de retorno -vamos a empezar todo de nuevoLe silence des arbresTu ne pèses pas lourd,mais ces os empilés,ces mains qui décapitent,ces fosses refermées,ces murs dynamitésdisent ce que tu es...Nous qui n'avons de motsque ceux que tu nous prêtes,nous t'écoutons pleurer,te plaindre, tempêter,geindre puis menacer;comme l'ange et la bête,faire ce que tu hais…Comme la femme au puitsou le poète hagard,nous restons éveillés,mais nous ne disons motqui ajoute à tes crisle vacarme du sang…Cependant tu le sais:tu sais notre clairière,ton poids n'est qu'un refus,le silence t'attend -il n'est point de barrièrepour ce qui souffle en toi...El silencio de los árbolesNo pesas mucho,pero esta pila de huesos,estas manos que decapitan,estas fosas cerradas,estos muros dinamitados,dicen lo que eres...Nosotros que no tenemos palabrassalvo las que nos prestas,te escuchamos llorar,quejarte, atormentarte,gemir y amenazar luego;como el ángel y la bestia,hacer lo que odias…Como la mujer de los pozoso el poeta aturdido,permanecemos despiertos,pero no decimos palabraque vaya a sumarse a los gritosal escándalo de la sangre…Sin embargo tú lo sabes :sabes nuestro claro en el bosque,tu peso no es sino un rechazo,el silencio te espera -ya no hay barrerapara lo que sopla en ti.Young MemoriesNous avions vingt ans d'âgeet le vent jeune aussi,la nuit au sommet de l'îlenous décoiffait et sculptait nos visagesde demi- dieux que partageaitl'amoureuse hésitation,sans poids ni liens que nosombres dansantesenivrées au vin de Samos,les dauphins surgis de l'eau claire,nos impatiences enlacées,un consul ivre sous le volcanet le feu du ciel par delà le dix-septième parallèle...Et partout, et déjà,défiant toute innocence,les damnés de la terreplus que jamais déniés;et si vaine la nostalgiede nos vingt ans,en l'insolente injonction de nos rebellions...C'était hier et c'est demain,et nos vieilles mains sur le sableretracent en tremblant les motsqui se prononcent les yeux fermésau secret des clairières.(San Francisco, Nobhill, ce 21 avril 2017)Young MemoriesTeníamos veinte añosy el aire también joven,la noche sobre la islanos despeinaba y esculpía nuestros rostrosde semidioses que compartíanla duda enamorada,sin peso ni lazos salvo nuestrassombras danzantesborrachos del vino de Samos,los delfines surgidos de las aguas transparentes,nuestras impaciencias enlazadas,un cónsul ebrio bajo el volcány el fuego celeste más allá del paralelo diecisiete...Y por todas partes, y ya,desafiando toda inocencia,los condenados de la tierranegados más que nunca;y tan vana la nostalgiade nuestros veinte años,en el insolente requerimiento de nuestras rebeliones...Era ayer y es mañana,y nuestras manos ancianas sobre la arenavuelven a trazar temblando las palabrasque se pronuncian con los ojos cerradosen el secreto de los claros del bosque.(San Francisco, Nobhill, 21 de abril de 2017)Jean-Louis Kuffer (Lausana, 1947) es un escritor, periodista y crítico literario suizo. Durante medio siglo ha ejercido la crítica literaria en diarios como La Tribune de Lausanne, La Liberté de Fribourg, la Gazette de Lausanne, o Le Matin. Entre 1976 y 1994 dirigió la colección « Contemporains » en L’Âge d’Homme, la editorial más importante de la Suiza francófona, en estrecha colaboración con su director, Vladimir Dimitrijevic. Fue uno de los fundadores, en 1992, de la revista Le Passe-Muraille, que sigue viva en formato electrónico. Asimismo mantiene desde 2005 dos blogs literarios, Carnets de JLK y Lectures du monde. Entre sus más de treinta libros pueden destacarse las novelas cortas Le Pain de coucou (Premio Schiller, 1983) y Par les temps qui courent (Premio Edouard-Rod, 1986), los poemarios Le Sablier des étoiles. Fugues helvètes (1999) o La Fée Valse (2017), así como la novela Le Viol de l’ange (1977). Jean-Louis Kuffer es asimismo un notable autor de diarios, donde refleja a la vez el bullicioso mundo literario de la Suiza romanda, su amistad con poetas como Georges Haldas o Jacques Chessex, o su rico mundo interior, en constante evolución. Entre sus volúmenes de diarios y crónicas destacan L’Ambassade du Papillon. Carnets 1993-1999 (2000), Les Passions partagées: Lectures du monde, carnets 1973-1992 (Premio Boudry, 2004), Les jardins suspendus, lectures et rencontres 1968-2018 (2018). Su último libro se titula, irónicamente, Nous sommes tous des zombies sympas (2019).Images: JLK dans la librairie mythique City Light Books, à San Francisco, en 2017. Mario Martin Gijon de passage en Lavaux, en 2022. -
Quand Max Lobe dit le Bantou s’en va goûter chez Gustave Roud…
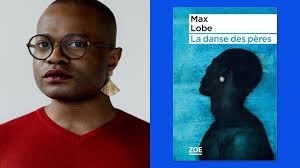 La Danse des pères, septième opus de l’écrivain camerounais naturalisé suisse, est d’abord et avant tout une danse avec les mots, joyeuse et triste à la fois. La « chose blanche » romande saura-t-elle accueillir l’extravagant dans sa paroisse littéraire ? C’est déjà fait et que ça dure ! Au goûter imaginaire où le convient cette semaine le centenaire Jaccottet et compagnie, la « ressemblance humaine » est de la partie…Le bourg de Moudon, dit le « pot de chambre du canton » en vaudois popu, célèbre ces jours, au musée, le centenaire de la naissance (ce 30 juin) de Philippe Jaccottet, dont l’ami poète non moins vénérable, Gustave Roud, aurait fêté ses 128 ans en avril dernier. Quel rapport entre ces deux dates et le 19 janvier 2026 où Max Lobe fêtera ses quarante ans ? Quelle connivence éventuelle entre ces trois-là ? Aucun, aucune en apparence, et l’énormité des contrastes pourrait exclure tout rapprochement, si les mots n’en décidaient autrement. Comme les poètes se ressemblent par les mots, voilà qu’ils s’assemblent !Or c’est à cette enseigne qu’une idée pour le moins saugrenue vous serait venue, lecteur de La Danse des pères imaginant la tête qu’eussent fait nos poètes sagement cravatés, découvrant certaines pages très « explicites » de cet ouvrage à la langue extraordinairement exotique - on dirait souvent électrique par ses vibrations, et non moins éclectique par ses inclusions pour ainsi dire poétiques, au point parfois de nécessiter une véritable traduction, sans parler des dérives à la fois historiques et politiques du roman – l’idée donc d’un goûter imaginaire en ce lieu devenu mythique de la paisible ferme vaudoise de Carrouge où maints jeunes écrivains romands de jadis et naguère, montés là-haut par le « tram des prés », allaient s’incliner devant le poète et lui serrer la papatte. Max Lobe chez Gustave Roud ? Et pourquoi pas ? Mais que se diraient-ils, ces deux gars-là ? A chacune et chacun de l’imaginer…De la différence et du rejetSi le rapprochement d’un (relativement) jeune auteur black & gay à la dégaine déjantée et d’un vieil homme de lettres vénéré par la « chose blanche », selon l’expression du descendant de colonisés, vous paraît incongrue, c’est que vous aurez mal lu ou pas perçu ce qui sue à la fois des lignes du Journal de Gustave Roud et des pages de La Danse des pères, à savoir la cuisante conscience d’être différent des autres, laquelle découle du regard de ces autres et du ton de la voix de ces même autres quand il te voient juste marcher, ou juste danser, juste être là à les regarder à la douche des soldats (Gustave) ou juste là (Benjamin, le double fictif de Max) à passer près de la fontaine aux femmes qui rigolent et ricanent à le voir avec sa drôle de démarche, comme ricanent et rigolent les garçons devant cette espèce de fille manquée que son père dirait un « neuf mois pour rien ».Les mots ont changé, sans perdre rien de leur possible cruauté, mais les choses restent aussi têtues que les faits, et lisant le Journal de Gustave Roud, ou quasiment rien n’est dit de ce qui est réellement enduré sous le regard des autres et par le désir refoulé, et lisant ensuite La Danse des pères, où tout est balancé avec ici et là des éclats qui déchirent, vous vous dites que le rejet muet d’un village, au début du XXe siècle, ou le rejet d’un père au «Cameloun», en ces années où tout est supposé normalisé par l’acronyme LGBT, relèvent d’une histoire commune que les mots ne sauraient jamais tout à fait pacifier ni exorciser.Avec la muflerie tranquille de l’Alémanique de souche terrienne, le formidable Fritz Dürrenmatt parlait de la littérature romande comme adonnée au culte de la « rose bleue », et probablement raillait-il certain esthétisme spiritualisant frotté de sensualité vague que les proses hyper-allusives de Gustave Roud portaient au niveau de sublime sublimation, tout cela ramenant assez mesquinement à un aspect congru de nos lettres, mais non sans vigueur peut-être salutaire – après tout pourquoi ne pas cesser de parler à mots si couverts, pourquoi ces chattemites et ces sous- entendus, ce silence gêné devant la souffrance (prononcez souffronce dans nos réunions de prière littéraire) présumée d’un Crisinel dont le drame était aussi lié à l’amour « qui n’ose dire son nom » ? Pourquoi ne pas « casser le morceau », comme s’y emploie Max Lobe pour lequel « ces choses » ne sont qu’un aspect d’une réalité combien plus riche et complexe, même si un seul regard ou un seul mot méchant conservent leur pouvoir dévastateur.De ma petite histoire à votre grande HacheVous vous rappelez maintenant votre seule visite à Gustave Roud, avec le docteur M. et l’abbé V. vos amis plus âgés, la sœur du poète et celui-ci, si terriblement gentil et contraint ; et l’on insistait pour que vous repreniez du gâteau de Madeleine. Mais tout cela si convenu…Sur quoi vous êtes revenu, ces derniers temps, au coffret des œuvre rééditées du poète, et comme tout revivait ; et comme tout revivrait si les braves gens du goûter mal barré découvraient ce que Max Lobe raconte dans La Danse des pères. Miracle de la Littérature !Et miracle de la filiation « malgré tout », tant il est vrai que le roman du Bantou, dédié à son père Ndjock, est à la fois l’histoire d’un père conteur de belle verve racontant la story de son pays à ses enfants, dont Benjamin est le double évident de Max, la «grande histoire» d’une indépendance devenue mascarade dans les embrouilles de la politique, et la « petite histoire » d’une relation plombée par le rejet d’un fils tôt « deviné » par son père horrifié, rejeté comme il l’a été par un oncle adoptif suisse quand il s’est retrouvé à Genève et que ledit oncle, indiscret, est tombé sur des messages homo-amoureux « explicites » sur son ordinateur, le chassant alors en affirmant que le Diable n’avait point de place dans un foyer chrétien.Max Lobe presse la plaie où elle fait le plus mal, et vous repensez alors aux drames innombrables liés à l’homophobie, vous avez lu le terrifiant roman du Sénégalais Moahammed Mbougar Sarr, De purs hommes, et l’autre jour encore vous regardiez, sur Netflix, le docu évoquant la vie du chanteur-danseur brésilien Ney Matogrosso, battu comme plâtre en son enfance par un père militaire impatient d'en faire un homme « vrai », et devenant une « idole » locale aux tenues de scène plus voyantes encore que celles de Max le Bantou à la télé romande (cf. RTS du 15 février 2025) , avec sa crêpelure jaune, ses lèvres rouges carmin, ses ongles peints en bleu et sa chemise perroquet – histoire de faire pièce à la tristesse et d’éclater du large rire de ce même Max esquissant sur le plateau une zumba d’enfer…La plaie de la vie, et le rire du BantouQuant à la plaie qui fait mal, c’est la vie même, mais tout en nuances, pas du tout le genre pleurard ou seulement accusateur, avec des scènes d’anthologie comme celle d’un baptême carabiné ou d’une scène qui en dit long sur les rapports de l’écrivain avec certains bonne conscience politique (pp.146-149) lorsque Benjamin, pressé d’accompagner son amant toubib (et chose blanche ) Clovis Martin à une marche anti-Bya, en 2016, éclate soudain, alors que son compagnon critique la mollesse des descendants d’indépendantistes, en lui crachant sa rage et sa détresse, ses galères personnelles et son rejet de tout le barnum militant, avec « le souffle d’un buffle enragé ».Après celle de Lovay, la langue « fourrée » de Lobe…Au petit jeu incongru des situations imaginaires à valeur révélatrice, vous évaluez la place réelle de Max Lobe dans le biotope littéraire romand ou francophone – on l’a dit « star » de la jeune littérature africaine, en effet gratifié du prestigieux Prix Kourouma – et son impact public réel. Dans la filière courant de Rousseau à Ramuz (que Max apprécie entre tous), d’Amiel à Haldas, d’Alice Rivaz à Charles-Albert Cingria, de Chappaz à Chessex, comment intégrer ce drôle d’oiseau de Lobe ? Et « les gens » là-dedans ?Pour l’édition et les médias : parcours parfait, choyé chez Zoé, jamais « descendu » par les confrères. Mais encore ? Tout va-t-il vraiment de soi ? Et s’il n’y avait pas comme une complaisance convenue d’époque envers cet auteur à ménager forcément selon l’esprit du temps, au dam du vrai sérieux de son propos ?On ne va certes pas oublier que le Bantou est noir et gay, puisque ça fait partie de son identité, mais au-delà ? Ce qu’il dit entre les lignes, au fil entortillé des signes de sa langue plus insolite voire déroutante que ne l’est celle d’un Jean-Marc Lovay (autre poulain du paddock Zoé), sa réflexion réellement incarnée, bruitée à bouche maquillée que veux-tu , charnellement entraînée par la danse des vocables, sur la réalité qu’il aborde de tous les côtés en fils de divers « pères » biologiques ou littéraires (de James Baldwin à Mongo Beti, que lui révèle d’ailleurs son paternel), mais aussi en protégé de diverses bienveillances féminines, et la base éthique de tout ça, la base émotionnelle et affective de ce fatras (où le cœur bat le tam-tam dans le corps qui ondule comme une flamme), la somme poétique que représente son œuvre en chantier – sûrement l’une des plus originales et conséquentes en train de s’élaborer dans nos contrées - est-elle vraiment prise en compte ?À chacune et chacun de répondre en toute liberté (qui se dit Kundè en bassa, nom du père alias « le Lion guerrier ») en le lisant vraiment et en se réjouissant peut-être du fait que le goûter des poètes ne soit pas que de spectres…Max Lobe. La Danse des pères. Zoé, 170p.
La Danse des pères, septième opus de l’écrivain camerounais naturalisé suisse, est d’abord et avant tout une danse avec les mots, joyeuse et triste à la fois. La « chose blanche » romande saura-t-elle accueillir l’extravagant dans sa paroisse littéraire ? C’est déjà fait et que ça dure ! Au goûter imaginaire où le convient cette semaine le centenaire Jaccottet et compagnie, la « ressemblance humaine » est de la partie…Le bourg de Moudon, dit le « pot de chambre du canton » en vaudois popu, célèbre ces jours, au musée, le centenaire de la naissance (ce 30 juin) de Philippe Jaccottet, dont l’ami poète non moins vénérable, Gustave Roud, aurait fêté ses 128 ans en avril dernier. Quel rapport entre ces deux dates et le 19 janvier 2026 où Max Lobe fêtera ses quarante ans ? Quelle connivence éventuelle entre ces trois-là ? Aucun, aucune en apparence, et l’énormité des contrastes pourrait exclure tout rapprochement, si les mots n’en décidaient autrement. Comme les poètes se ressemblent par les mots, voilà qu’ils s’assemblent !Or c’est à cette enseigne qu’une idée pour le moins saugrenue vous serait venue, lecteur de La Danse des pères imaginant la tête qu’eussent fait nos poètes sagement cravatés, découvrant certaines pages très « explicites » de cet ouvrage à la langue extraordinairement exotique - on dirait souvent électrique par ses vibrations, et non moins éclectique par ses inclusions pour ainsi dire poétiques, au point parfois de nécessiter une véritable traduction, sans parler des dérives à la fois historiques et politiques du roman – l’idée donc d’un goûter imaginaire en ce lieu devenu mythique de la paisible ferme vaudoise de Carrouge où maints jeunes écrivains romands de jadis et naguère, montés là-haut par le « tram des prés », allaient s’incliner devant le poète et lui serrer la papatte. Max Lobe chez Gustave Roud ? Et pourquoi pas ? Mais que se diraient-ils, ces deux gars-là ? A chacune et chacun de l’imaginer…De la différence et du rejetSi le rapprochement d’un (relativement) jeune auteur black & gay à la dégaine déjantée et d’un vieil homme de lettres vénéré par la « chose blanche », selon l’expression du descendant de colonisés, vous paraît incongrue, c’est que vous aurez mal lu ou pas perçu ce qui sue à la fois des lignes du Journal de Gustave Roud et des pages de La Danse des pères, à savoir la cuisante conscience d’être différent des autres, laquelle découle du regard de ces autres et du ton de la voix de ces même autres quand il te voient juste marcher, ou juste danser, juste être là à les regarder à la douche des soldats (Gustave) ou juste là (Benjamin, le double fictif de Max) à passer près de la fontaine aux femmes qui rigolent et ricanent à le voir avec sa drôle de démarche, comme ricanent et rigolent les garçons devant cette espèce de fille manquée que son père dirait un « neuf mois pour rien ».Les mots ont changé, sans perdre rien de leur possible cruauté, mais les choses restent aussi têtues que les faits, et lisant le Journal de Gustave Roud, ou quasiment rien n’est dit de ce qui est réellement enduré sous le regard des autres et par le désir refoulé, et lisant ensuite La Danse des pères, où tout est balancé avec ici et là des éclats qui déchirent, vous vous dites que le rejet muet d’un village, au début du XXe siècle, ou le rejet d’un père au «Cameloun», en ces années où tout est supposé normalisé par l’acronyme LGBT, relèvent d’une histoire commune que les mots ne sauraient jamais tout à fait pacifier ni exorciser.Avec la muflerie tranquille de l’Alémanique de souche terrienne, le formidable Fritz Dürrenmatt parlait de la littérature romande comme adonnée au culte de la « rose bleue », et probablement raillait-il certain esthétisme spiritualisant frotté de sensualité vague que les proses hyper-allusives de Gustave Roud portaient au niveau de sublime sublimation, tout cela ramenant assez mesquinement à un aspect congru de nos lettres, mais non sans vigueur peut-être salutaire – après tout pourquoi ne pas cesser de parler à mots si couverts, pourquoi ces chattemites et ces sous- entendus, ce silence gêné devant la souffrance (prononcez souffronce dans nos réunions de prière littéraire) présumée d’un Crisinel dont le drame était aussi lié à l’amour « qui n’ose dire son nom » ? Pourquoi ne pas « casser le morceau », comme s’y emploie Max Lobe pour lequel « ces choses » ne sont qu’un aspect d’une réalité combien plus riche et complexe, même si un seul regard ou un seul mot méchant conservent leur pouvoir dévastateur.De ma petite histoire à votre grande HacheVous vous rappelez maintenant votre seule visite à Gustave Roud, avec le docteur M. et l’abbé V. vos amis plus âgés, la sœur du poète et celui-ci, si terriblement gentil et contraint ; et l’on insistait pour que vous repreniez du gâteau de Madeleine. Mais tout cela si convenu…Sur quoi vous êtes revenu, ces derniers temps, au coffret des œuvre rééditées du poète, et comme tout revivait ; et comme tout revivrait si les braves gens du goûter mal barré découvraient ce que Max Lobe raconte dans La Danse des pères. Miracle de la Littérature !Et miracle de la filiation « malgré tout », tant il est vrai que le roman du Bantou, dédié à son père Ndjock, est à la fois l’histoire d’un père conteur de belle verve racontant la story de son pays à ses enfants, dont Benjamin est le double évident de Max, la «grande histoire» d’une indépendance devenue mascarade dans les embrouilles de la politique, et la « petite histoire » d’une relation plombée par le rejet d’un fils tôt « deviné » par son père horrifié, rejeté comme il l’a été par un oncle adoptif suisse quand il s’est retrouvé à Genève et que ledit oncle, indiscret, est tombé sur des messages homo-amoureux « explicites » sur son ordinateur, le chassant alors en affirmant que le Diable n’avait point de place dans un foyer chrétien.Max Lobe presse la plaie où elle fait le plus mal, et vous repensez alors aux drames innombrables liés à l’homophobie, vous avez lu le terrifiant roman du Sénégalais Moahammed Mbougar Sarr, De purs hommes, et l’autre jour encore vous regardiez, sur Netflix, le docu évoquant la vie du chanteur-danseur brésilien Ney Matogrosso, battu comme plâtre en son enfance par un père militaire impatient d'en faire un homme « vrai », et devenant une « idole » locale aux tenues de scène plus voyantes encore que celles de Max le Bantou à la télé romande (cf. RTS du 15 février 2025) , avec sa crêpelure jaune, ses lèvres rouges carmin, ses ongles peints en bleu et sa chemise perroquet – histoire de faire pièce à la tristesse et d’éclater du large rire de ce même Max esquissant sur le plateau une zumba d’enfer…La plaie de la vie, et le rire du BantouQuant à la plaie qui fait mal, c’est la vie même, mais tout en nuances, pas du tout le genre pleurard ou seulement accusateur, avec des scènes d’anthologie comme celle d’un baptême carabiné ou d’une scène qui en dit long sur les rapports de l’écrivain avec certains bonne conscience politique (pp.146-149) lorsque Benjamin, pressé d’accompagner son amant toubib (et chose blanche ) Clovis Martin à une marche anti-Bya, en 2016, éclate soudain, alors que son compagnon critique la mollesse des descendants d’indépendantistes, en lui crachant sa rage et sa détresse, ses galères personnelles et son rejet de tout le barnum militant, avec « le souffle d’un buffle enragé ».Après celle de Lovay, la langue « fourrée » de Lobe…Au petit jeu incongru des situations imaginaires à valeur révélatrice, vous évaluez la place réelle de Max Lobe dans le biotope littéraire romand ou francophone – on l’a dit « star » de la jeune littérature africaine, en effet gratifié du prestigieux Prix Kourouma – et son impact public réel. Dans la filière courant de Rousseau à Ramuz (que Max apprécie entre tous), d’Amiel à Haldas, d’Alice Rivaz à Charles-Albert Cingria, de Chappaz à Chessex, comment intégrer ce drôle d’oiseau de Lobe ? Et « les gens » là-dedans ?Pour l’édition et les médias : parcours parfait, choyé chez Zoé, jamais « descendu » par les confrères. Mais encore ? Tout va-t-il vraiment de soi ? Et s’il n’y avait pas comme une complaisance convenue d’époque envers cet auteur à ménager forcément selon l’esprit du temps, au dam du vrai sérieux de son propos ?On ne va certes pas oublier que le Bantou est noir et gay, puisque ça fait partie de son identité, mais au-delà ? Ce qu’il dit entre les lignes, au fil entortillé des signes de sa langue plus insolite voire déroutante que ne l’est celle d’un Jean-Marc Lovay (autre poulain du paddock Zoé), sa réflexion réellement incarnée, bruitée à bouche maquillée que veux-tu , charnellement entraînée par la danse des vocables, sur la réalité qu’il aborde de tous les côtés en fils de divers « pères » biologiques ou littéraires (de James Baldwin à Mongo Beti, que lui révèle d’ailleurs son paternel), mais aussi en protégé de diverses bienveillances féminines, et la base éthique de tout ça, la base émotionnelle et affective de ce fatras (où le cœur bat le tam-tam dans le corps qui ondule comme une flamme), la somme poétique que représente son œuvre en chantier – sûrement l’une des plus originales et conséquentes en train de s’élaborer dans nos contrées - est-elle vraiment prise en compte ?À chacune et chacun de répondre en toute liberté (qui se dit Kundè en bassa, nom du père alias « le Lion guerrier ») en le lisant vraiment et en se réjouissant peut-être du fait que le goûter des poètes ne soit pas que de spectres…Max Lobe. La Danse des pères. Zoé, 170p. -
Comme en souriant drôlement
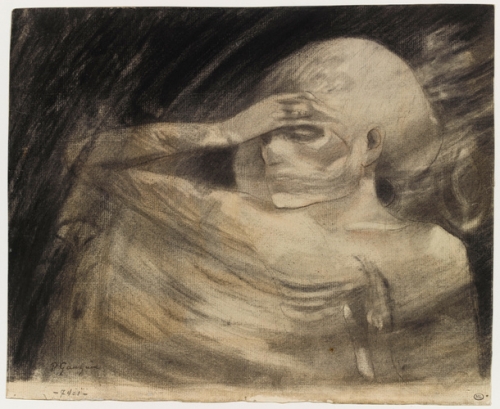 (Sarcasme)La dame ne serait n’est pas loin:l’ombre de la rôdeuse,qu’on appelle aussi la faucheuse,fait silence à dessein;mais en se taisant elle te parle:je te connais, dit-ellesans un autre mot pour le direque de ses yeux mortels,la condamnation d’un sourire…Tu en parlais les yeux baissés,mais ne tremblant jamais,et moi je retenais mes larmes:on fait semblant de partager,mais le corps à son cri -cela que toi seule entendait …Et pourtant nous en aurons ri,de la Dame aux alarmes:il n’y aura pas de vacarmeau jour de l’enterrer:elle est seule et nous la plaignons,seule à côté de Dieu ,très seul aussi de par son sortà la place du mort…Fusain de Paul Gauguin: Figure de spectre.
(Sarcasme)La dame ne serait n’est pas loin:l’ombre de la rôdeuse,qu’on appelle aussi la faucheuse,fait silence à dessein;mais en se taisant elle te parle:je te connais, dit-ellesans un autre mot pour le direque de ses yeux mortels,la condamnation d’un sourire…Tu en parlais les yeux baissés,mais ne tremblant jamais,et moi je retenais mes larmes:on fait semblant de partager,mais le corps à son cri -cela que toi seule entendait …Et pourtant nous en aurons ri,de la Dame aux alarmes:il n’y aura pas de vacarmeau jour de l’enterrer:elle est seule et nous la plaignons,seule à côté de Dieu ,très seul aussi de par son sortà la place du mort…Fusain de Paul Gauguin: Figure de spectre. -
Comme une consolation
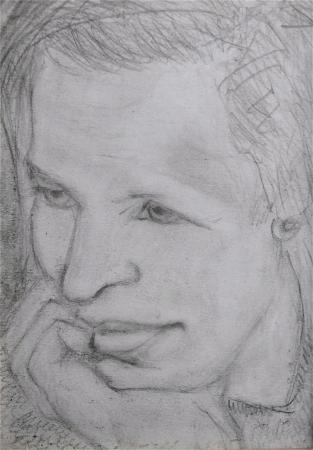 (Pour L. qui aurait sa fête ce dimanche)Je l’écoute se taire en moi :son absence me pèse,mais sa présence est une voixqui me revient parfoisdans le murmure des journéesoù le clair et l’obscurse mêlent aux années –une voix et c’était la tienneen sa douceur de soie…Nous n’avons pas su nous parlerde ce que tu vivais :nous n’avons pas trouvé les mots ;on ne sait pas pourquoile poids soudain se fait si lourdOn y peut quoi ? On n’y peut rien,on aimerait montrer le poing,mais à qui ? mais à quoi ?Tu es en moi tant que je vis :triste, je te souris ;le miroir entre nous s’efface,et c’est comme une grâceque d’être là sans toicomme enlacée en moi…Dessin JLK: Portrait de Lady L, à Vienne, en 1995.
(Pour L. qui aurait sa fête ce dimanche)Je l’écoute se taire en moi :son absence me pèse,mais sa présence est une voixqui me revient parfoisdans le murmure des journéesoù le clair et l’obscurse mêlent aux années –une voix et c’était la tienneen sa douceur de soie…Nous n’avons pas su nous parlerde ce que tu vivais :nous n’avons pas trouvé les mots ;on ne sait pas pourquoile poids soudain se fait si lourdOn y peut quoi ? On n’y peut rien,on aimerait montrer le poing,mais à qui ? mais à quoi ?Tu es en moi tant que je vis :triste, je te souris ;le miroir entre nous s’efface,et c’est comme une grâceque d’être là sans toicomme enlacée en moi…Dessin JLK: Portrait de Lady L, à Vienne, en 1995. -
Le présent cadeau
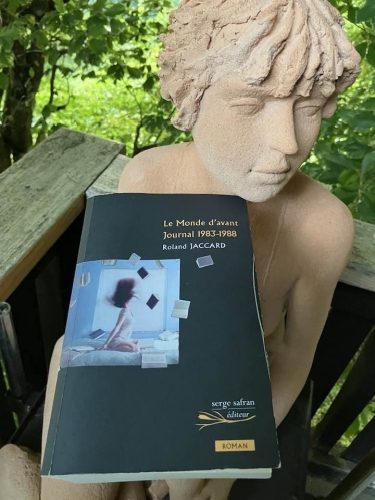 Le fil invisible (92)L’autre soir il disait à sa soeur aînée, qu’il appelle maintenant l’octogénéreuse, revenue aux Asturies et se préparant au débarquement des petits vacanciers fous de surf, que, lisant tous ces jours des fragments du journal monumental de son ami Roland J. (un pavé de 834 ages intitulé Le Monde d’avant et qu’il lui a offert au Lausanne-Palace après lui avoir fait croire qu’il allait lui confier un grand chien), il se dit que décidément il ne se sent pas vraiment de ce monde d’avant, ou du moins qu’ il n’en reconnaît pas la prévalence et suppose que sa sœur non plus, d’ailleurs elle confirme à l’instant en l’assurant de ça que bien sûr elle reste attachée au monde d’avant puisque c’est celui qu’elle a partagé avec l’Hidalgo, mais qu’enfin si celui-ci lui faisait la grâce angélique de reparaître ce serait au présent, et tous deux s’accordent à reconnaître que c’est manquer d’égard pour le présent (au sens d’un cadeau que la vie te fait tous les jours même si la vie en question manque elle aussi d’égards comme elle et lui en ont eu la preuve cuisante), et puis elle ni lui ne sont du genre à tirer l’échelle derrière eux, c’est même les kids qui nous tirent à présent, lance-t-elle alors, tu sais que notre fille aînée est en train de comploter un truc géant avec un sien collègue, un méga projet qui va les propulser au top des applis, ce sera du genre Google Plus à l’européenne mais finalisée en Inde, figure-toi, elle et son complice ont souqué dur pendant des mois et là ça touche au bout en attendant le retour d’Inde et le déboulé des followers, voilà bien un exemple de ce qu’y a plus de jeunesse et qu’y zont plus d’idées, lui assène la mère de l’ingénieuse dont les deux fils sont du même genre entreprenant, l’un dans la médecine de demain à nano-performances, et l’autre on ne sait pas encore mais c’est de la même bonne branche - et le frère puîné abonde évidemment vu que sans ignorer les vertiges posibles du monde d’après il a lu les Anciens et connaît la litanie des désabusés - c’est pour ainsi dire de nature, qu’il relève alors, moi je n’en viendrai à la ciguë, comme l’ami Roland, que si la vie me la joue extrémiste à outrance du style je te retire la vue et la flexibilité mobile, je t’enlève la mémoire et te condamne à la dépendance absolue, là je ne dis pas que je refuserai le sirop mexicain de l’ami Roland, et rien de métaphysique là-dedans, juste ma réponse à l’injustice si la vie est si moche que plus rien n'accroche, etc.
Le fil invisible (92)L’autre soir il disait à sa soeur aînée, qu’il appelle maintenant l’octogénéreuse, revenue aux Asturies et se préparant au débarquement des petits vacanciers fous de surf, que, lisant tous ces jours des fragments du journal monumental de son ami Roland J. (un pavé de 834 ages intitulé Le Monde d’avant et qu’il lui a offert au Lausanne-Palace après lui avoir fait croire qu’il allait lui confier un grand chien), il se dit que décidément il ne se sent pas vraiment de ce monde d’avant, ou du moins qu’ il n’en reconnaît pas la prévalence et suppose que sa sœur non plus, d’ailleurs elle confirme à l’instant en l’assurant de ça que bien sûr elle reste attachée au monde d’avant puisque c’est celui qu’elle a partagé avec l’Hidalgo, mais qu’enfin si celui-ci lui faisait la grâce angélique de reparaître ce serait au présent, et tous deux s’accordent à reconnaître que c’est manquer d’égard pour le présent (au sens d’un cadeau que la vie te fait tous les jours même si la vie en question manque elle aussi d’égards comme elle et lui en ont eu la preuve cuisante), et puis elle ni lui ne sont du genre à tirer l’échelle derrière eux, c’est même les kids qui nous tirent à présent, lance-t-elle alors, tu sais que notre fille aînée est en train de comploter un truc géant avec un sien collègue, un méga projet qui va les propulser au top des applis, ce sera du genre Google Plus à l’européenne mais finalisée en Inde, figure-toi, elle et son complice ont souqué dur pendant des mois et là ça touche au bout en attendant le retour d’Inde et le déboulé des followers, voilà bien un exemple de ce qu’y a plus de jeunesse et qu’y zont plus d’idées, lui assène la mère de l’ingénieuse dont les deux fils sont du même genre entreprenant, l’un dans la médecine de demain à nano-performances, et l’autre on ne sait pas encore mais c’est de la même bonne branche - et le frère puîné abonde évidemment vu que sans ignorer les vertiges posibles du monde d’après il a lu les Anciens et connaît la litanie des désabusés - c’est pour ainsi dire de nature, qu’il relève alors, moi je n’en viendrai à la ciguë, comme l’ami Roland, que si la vie me la joue extrémiste à outrance du style je te retire la vue et la flexibilité mobile, je t’enlève la mémoire et te condamne à la dépendance absolue, là je ne dis pas que je refuserai le sirop mexicain de l’ami Roland, et rien de métaphysique là-dedans, juste ma réponse à l’injustice si la vie est si moche que plus rien n'accroche, etc. -
Comme une illusion féconde
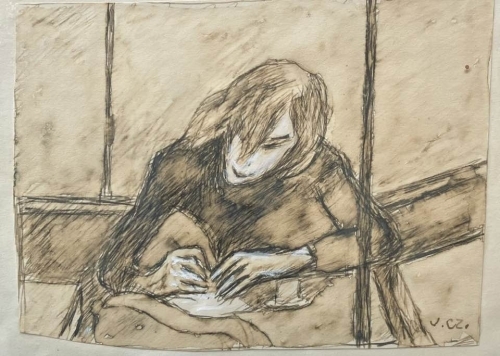 L’écriture serait comme un voeu:en vous comme une grâcevous ferait reconnaîtreque vous êtes vivantset que cela requiert alorscomme d'aucun effortl'abandon absolumentde marquer une trace ardentedans l'orbe insignifiant…Ils s’adonnent aux répugnances:il sourit au néant,elle jouit comme si le ventabouché au vide du tempsla comblait en la dévastant -tout mentalement s’entend ,quand tout au monde immonde,et virtuel, devenait mental et mortel…Le vœu de silence au momentoù tu écris dans l’innocencede qui ferait juste semblantde ne rien savoir de tout ça -ce vœu seul est comme un accueil,et comme au seuil une présenceque tu savais en toiet que relancent ces mots-là…Joseph Czapski: La Lettre - dessin préparatoire.
L’écriture serait comme un voeu:en vous comme une grâcevous ferait reconnaîtreque vous êtes vivantset que cela requiert alorscomme d'aucun effortl'abandon absolumentde marquer une trace ardentedans l'orbe insignifiant…Ils s’adonnent aux répugnances:il sourit au néant,elle jouit comme si le ventabouché au vide du tempsla comblait en la dévastant -tout mentalement s’entend ,quand tout au monde immonde,et virtuel, devenait mental et mortel…Le vœu de silence au momentoù tu écris dans l’innocencede qui ferait juste semblantde ne rien savoir de tout ça -ce vœu seul est comme un accueil,et comme au seuil une présenceque tu savais en toiet que relancent ces mots-là…Joseph Czapski: La Lettre - dessin préparatoire.