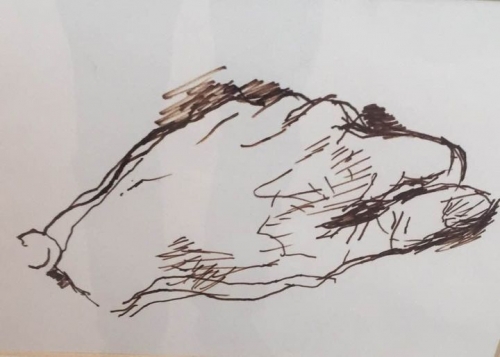
Carnets de JLK - Page 11
-
Lorsque les mains écoutent
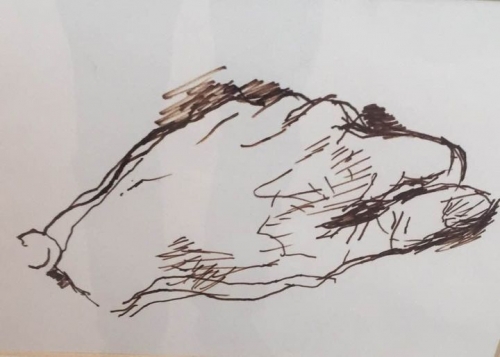 Ils en auront beaucoup parlé :noirci d’entiers camionsde papier à conditionner;Maître Merleau jusqu’au Japona sondé la question :revenons aux fondamentaux,dit-il d’un ton sérieuxaux Nippons scrupuleux ;et la sonate de Vinteuilau seuil d’une autre nuitmodule cette mélodieoublieuse du deuild’un luthier rêvant d’infini…Chacun sait ce que son autre mainignore si l’autre dort:la main du peintre est ingénuequand l’autre reste nue,alors que le corps sans voixrepose comme un seulaux seuil des eaux à mille morts;et deux mains à la nageferont le geste de prierou d’écarter les ailesles appelant à s’envolerdans le ciel inversé…Le tangible n’a pas tout dit,murmure la geishaque la lecture délivrequand les mains nouées un peu lassesse délassent des corps,et la diva sans vanitétout à l’aria du seul toucher,se laisse aller à l’avenantà l’absolu bercement…Dessin: Joseph CzapskiDessin: Joseph Czapski.
Ils en auront beaucoup parlé :noirci d’entiers camionsde papier à conditionner;Maître Merleau jusqu’au Japona sondé la question :revenons aux fondamentaux,dit-il d’un ton sérieuxaux Nippons scrupuleux ;et la sonate de Vinteuilau seuil d’une autre nuitmodule cette mélodieoublieuse du deuild’un luthier rêvant d’infini…Chacun sait ce que son autre mainignore si l’autre dort:la main du peintre est ingénuequand l’autre reste nue,alors que le corps sans voixrepose comme un seulaux seuil des eaux à mille morts;et deux mains à la nageferont le geste de prierou d’écarter les ailesles appelant à s’envolerdans le ciel inversé…Le tangible n’a pas tout dit,murmure la geishaque la lecture délivrequand les mains nouées un peu lassesse délassent des corps,et la diva sans vanitétout à l’aria du seul toucher,se laisse aller à l’avenantà l’absolu bercement…Dessin: Joseph CzapskiDessin: Joseph Czapski. -
De la liberté ou presque
 Ils se sentaient tous égarés:c’est ce qu’ils vous auront dità la montée agressivedes injonctions collectivesaffolées par tous les relaiset réseaux en mêlée -la meute hurlait dans le vortex:tel était le contexte…Mais le contexte n’est qu’un mot,ou peut-être un prétexteà tout réduire en unitéde douteuse simplicité,par les slogans et les formulesincessamment publicitairesdans l’oubli concertédes évitements solitairesaux fructueux émules…Nous entrons en opposition,déclarent les fileuses,là-bas, du plus joyeux coton,vous défilerez mais sans nous,vous vous alignerez,vous vous lamenterez,à genoux et les yeux baissés,vous vous direz perdus,comme si vous l’aviez voulu…La planète est comme un vaisseaudans les flots étoilésoù nous tissons les destinéeset le juste et l’injustese faufilent à l’avenant;la partition vous est fournie,et libre à vous d'en disposer,enfin libres ou presque,quand tout est presque hors le néant...Image: les trois moires.
Ils se sentaient tous égarés:c’est ce qu’ils vous auront dità la montée agressivedes injonctions collectivesaffolées par tous les relaiset réseaux en mêlée -la meute hurlait dans le vortex:tel était le contexte…Mais le contexte n’est qu’un mot,ou peut-être un prétexteà tout réduire en unitéde douteuse simplicité,par les slogans et les formulesincessamment publicitairesdans l’oubli concertédes évitements solitairesaux fructueux émules…Nous entrons en opposition,déclarent les fileuses,là-bas, du plus joyeux coton,vous défilerez mais sans nous,vous vous alignerez,vous vous lamenterez,à genoux et les yeux baissés,vous vous direz perdus,comme si vous l’aviez voulu…La planète est comme un vaisseaudans les flots étoilésoù nous tissons les destinéeset le juste et l’injustese faufilent à l’avenant;la partition vous est fournie,et libre à vous d'en disposer,enfin libres ou presque,quand tout est presque hors le néant...Image: les trois moires. -
Masque de chair
 Qui écrit ça quand j’écris ça ?C’est la question du jour:la question qui te reviendrapar delà ton oubli,quand soudain l’écrit sera signed’on ne saura trop quoi,d’on ne sait qui non plus,car tu n’y seras plus…Qu’auras-tu donc été pour moi ?Telle est la vraie questioncar le miroir ne m’apprend rienque la fragile partde ce que de mon en deçàmon regard seul perçoit ,vers ton si fragile au-delà,d'ou me revient ta voix,quand tes yeux m’étaient si précieux …Je ne sais si je t’ai déçu (e),c’est la question qui tue,je me sens partout étranger,tout est neuf et à moi,à moi la vue, à moi l’emoi;je suis votre double à jamais,et je ne suis pas là:je vous parle au delà du trouble -je vous parle d’ailleurs,je ne suis pas ce que tu vois ...Peinture: Francis Bacon.
Qui écrit ça quand j’écris ça ?C’est la question du jour:la question qui te reviendrapar delà ton oubli,quand soudain l’écrit sera signed’on ne saura trop quoi,d’on ne sait qui non plus,car tu n’y seras plus…Qu’auras-tu donc été pour moi ?Telle est la vraie questioncar le miroir ne m’apprend rienque la fragile partde ce que de mon en deçàmon regard seul perçoit ,vers ton si fragile au-delà,d'ou me revient ta voix,quand tes yeux m’étaient si précieux …Je ne sais si je t’ai déçu (e),c’est la question qui tue,je me sens partout étranger,tout est neuf et à moi,à moi la vue, à moi l’emoi;je suis votre double à jamais,et je ne suis pas là:je vous parle au delà du trouble -je vous parle d’ailleurs,je ne suis pas ce que tu vois ...Peinture: Francis Bacon. -
Avatars de la menterie
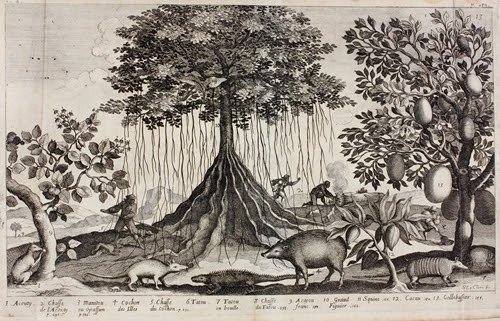 Mon ignorance est un océandont l’oreiller me berce:je grandis de ne pas savoir:je vague et je divague;de port en port, de porte en porte :partout je suis ailleurs,ignorant tout,ignorant l’heure…Je porte en moi comme une idéequi me fait supporterd’être tant en n’étant que rienqu’un infini qui flotte,mais cette idée n’a pas de nom,et qui veut le savoirporte l’épée au fond de grottesoù tout reste secret...Au demeurant le va et vientd’Ulysse et de sa bandem’enchante quand je dorset comme l’antilope rêveen oubliant Pénélopeet ses fileuses de feuilletoncampant sur les rivagesarrimés à vos illusions,je reste du voyage ...L’océan est une fuméedont l’Éternel partout,au nom qui vous reste ignoréplus que le rêve du tatou -l’Éternel à vue de nezsavoure les yeux fermésles parfums éventés;et Mnémosyne au pédalo,loin des serpents, près des oiseaux ,nourrit les mêmes songeriesfleuries de menteries…Image: animaux imaginaires, du sphinx à la chimère.
Mon ignorance est un océandont l’oreiller me berce:je grandis de ne pas savoir:je vague et je divague;de port en port, de porte en porte :partout je suis ailleurs,ignorant tout,ignorant l’heure…Je porte en moi comme une idéequi me fait supporterd’être tant en n’étant que rienqu’un infini qui flotte,mais cette idée n’a pas de nom,et qui veut le savoirporte l’épée au fond de grottesoù tout reste secret...Au demeurant le va et vientd’Ulysse et de sa bandem’enchante quand je dorset comme l’antilope rêveen oubliant Pénélopeet ses fileuses de feuilletoncampant sur les rivagesarrimés à vos illusions,je reste du voyage ...L’océan est une fuméedont l’Éternel partout,au nom qui vous reste ignoréplus que le rêve du tatou -l’Éternel à vue de nezsavoure les yeux fermésles parfums éventés;et Mnémosyne au pédalo,loin des serpents, près des oiseaux ,nourrit les mêmes songeriesfleuries de menteries…Image: animaux imaginaires, du sphinx à la chimère. -
Voyants et voyeurs
 "Voyants et voyeurs vont voir ailleurs" (la Rumeur)Le quelqu’un qu’il voit au miroirn’est pas tout à fait lui,mais il se garde de le dire;il vaut mieux l’écouter:il dit Je en parlant de soi,mais la soie du discoursflotte bien au-delà de lui -qui est-il pour oser dire moise demandera-t-on,mais on ne signifie personneet lui n’est que question…Quand revient en lui la lumière,il ne voit plus que soi:ce moi que marquent tous les traitsd’un visage apaisé -la guerre même n’aura pu,la guerre et la misère,dans le temps accordé n'ont pudémentir le présage …La voyante aveugle là-bas,en sourirait encoreà voir aux yeux de cet enfantcomme un ciel étoilé:ce gars-là ne dormira pas:je vois de la visiondans la foison de son regard -ma prédiction vaut un dollar…
"Voyants et voyeurs vont voir ailleurs" (la Rumeur)Le quelqu’un qu’il voit au miroirn’est pas tout à fait lui,mais il se garde de le dire;il vaut mieux l’écouter:il dit Je en parlant de soi,mais la soie du discoursflotte bien au-delà de lui -qui est-il pour oser dire moise demandera-t-on,mais on ne signifie personneet lui n’est que question…Quand revient en lui la lumière,il ne voit plus que soi:ce moi que marquent tous les traitsd’un visage apaisé -la guerre même n’aura pu,la guerre et la misère,dans le temps accordé n'ont pudémentir le présage …La voyante aveugle là-bas,en sourirait encoreà voir aux yeux de cet enfantcomme un ciel étoilé:ce gars-là ne dormira pas:je vois de la visiondans la foison de son regard -ma prédiction vaut un dollar… -
Le matin quand on est abeille
 Il faut repartir de tout près:il faudrait revenirau zéro du proche infini,c’est cela : il faudrait,et la faux tranche dans le vifdu geste de beautéqui d’un premier matin délieenfin le décisif -il faut changer l’eau des lapins !L’éclat de rire à l’aube pureest le plus beau défiqu’au repli de tous les dénisl’heureux imbécile que je suisbalance en insoumis ;telle la bille de mercure,le lapin n’en a cure,qui a jailli de la Nature…Nature, berce-nous follementet que l’eau ruisselantsur nos corps soudain ajeunispar la fraîcheur de son aversenous mette le cœur en perce;il faut falloir, il le faudrait,la faux signe le vrai,dira le beau, dira le blé -et l'abeille consigne...("Le matin quand on est abeille, pas d'histoires, il faut aller butiner". Henri Michaux)
Il faut repartir de tout près:il faudrait revenirau zéro du proche infini,c’est cela : il faudrait,et la faux tranche dans le vifdu geste de beautéqui d’un premier matin délieenfin le décisif -il faut changer l’eau des lapins !L’éclat de rire à l’aube pureest le plus beau défiqu’au repli de tous les dénisl’heureux imbécile que je suisbalance en insoumis ;telle la bille de mercure,le lapin n’en a cure,qui a jailli de la Nature…Nature, berce-nous follementet que l’eau ruisselantsur nos corps soudain ajeunispar la fraîcheur de son aversenous mette le cœur en perce;il faut falloir, il le faudrait,la faux signe le vrai,dira le beau, dira le blé -et l'abeille consigne...("Le matin quand on est abeille, pas d'histoires, il faut aller butiner". Henri Michaux) -
Nouvelle du jour
 (Au Cantor en son Magnificat)Je mens en toute véritéà l’heure sans pareilleoù mon cœur tout à la musiqueau sommeil se sent allégéde son ombre vermeille;mon corps est comme un samovaroù les idées affluent,mon âme sera l’avenuedéfiant tout hasard …Prenez les mots à la légère:ils ont à dire des chosessi tendres et passagèresqu’ils en deviennent susceptibles,les mots tout comme des fougèresoù ces formes éphémèresque prennent parfois les femmes -les mots vous attirent et s’échappentcomme à la trappe vontsoupirs et sanglots de violons…Défiez-vous des mots cruels,soyez un peu morals:comme un petit cheval dressétachez de mieux parler:brossez les mots et les tressez ,fourbissez moi tout çacomme un décret de général :Dourakine a parlé,répètent les enfants,simplement signifiant:que les mots ainsi signifient…La pierre t’attend là-basinsoucieuse et patiente,au silence de son secret -la faire parler sera ton job:jamais ne te dérobe,et fais circuler la nouvelle:que la grammaire la plus belleest capable du ciel…(Lecture conseillée ce matin: Apprendre à parler à une pierre, d'Annie Dillard. Editions Christian Bourgois, 2017)
(Au Cantor en son Magnificat)Je mens en toute véritéà l’heure sans pareilleoù mon cœur tout à la musiqueau sommeil se sent allégéde son ombre vermeille;mon corps est comme un samovaroù les idées affluent,mon âme sera l’avenuedéfiant tout hasard …Prenez les mots à la légère:ils ont à dire des chosessi tendres et passagèresqu’ils en deviennent susceptibles,les mots tout comme des fougèresoù ces formes éphémèresque prennent parfois les femmes -les mots vous attirent et s’échappentcomme à la trappe vontsoupirs et sanglots de violons…Défiez-vous des mots cruels,soyez un peu morals:comme un petit cheval dressétachez de mieux parler:brossez les mots et les tressez ,fourbissez moi tout çacomme un décret de général :Dourakine a parlé,répètent les enfants,simplement signifiant:que les mots ainsi signifient…La pierre t’attend là-basinsoucieuse et patiente,au silence de son secret -la faire parler sera ton job:jamais ne te dérobe,et fais circuler la nouvelle:que la grammaire la plus belleest capable du ciel…(Lecture conseillée ce matin: Apprendre à parler à une pierre, d'Annie Dillard. Editions Christian Bourgois, 2017) -
Mémoire des anges

ANGELUS NOVUS. - Tout entretien sur les anges paraît une lubie frivole en ces temps de plat utilitarisme où la futilité massive, précisément, fausse tous les critères. Il est vrai que l'ange paraît s'éloigner de ce monde, comme l'avait conclu Walter Benjamn au terme de sa traversée des enfers du XXe siècle, mais la figure même de ce penseur étrange, épars, à la fois incarné et désincarné, et prenant beaucoup sur lui de l'égarement du monde, laisse bel et bien, à son lecteur d'aujourd'hui, le sentiment diffus et lancinant qu'un ange a passé.
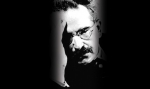 Walter Benjamin appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, la perte et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.
Walter Benjamin appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, la perte et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.DIVAGATION. - Je passe, aujourd'hui, le cap des soixante-six ans. Deux fois l'âge du Christ. Un an de plus que Faulkner à sa mort. Un de moins que mon père et que Céline à la leur. Onze de plus que mon frère. Trois de moins que Ramuz. Simone Weil meurt à 34 ans. Che Guevara à 39 ans. Tolstoï à 82 ans. Tchékhov à 44 ans. Dostoïevski à 60 ans pile. Mon grand-père paternel à 71 ans, mon autre grand-mère à 90 ans. Ceci noté juste par curiosité. Ma bonne amie, à qui je fais part de cette liste, trouve cela déprimant. Moi pas du tout, au contraire.
(À La Désirade, ce vendredi 14 juin)
 LE DESIR DES ANGES . - Si la discussion sur le sexe des anges paraît vaine, la question du désir reste très riche de sens et de sensations à leur évocation puisqu'ils en sont l'incarnation désincarnée mais hyper-consciente, où cohabitent l'innocence candide d'avant le sang et le sperme, et la mélancolie de l'âge.
LE DESIR DES ANGES . - Si la discussion sur le sexe des anges paraît vaine, la question du désir reste très riche de sens et de sensations à leur évocation puisqu'ils en sont l'incarnation désincarnée mais hyper-consciente, où cohabitent l'innocence candide d'avant le sang et le sperme, et la mélancolie de l'âge.L'ange en manteau de pluie Columbo, dans Les ailes du désir, figure bien cette incarnation désincarnée, qui traverse les scènes de crime de l'Histoire avec l'air pensif de celui que la découverte du coupable ne fera jamais triompher.
Surtout je revois Bruno Ganz, dans le taxi du même film, murmurant à son compagnon de mission sur terre: " C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois moi je me sens fatigué de n'être qu'un esprit, j'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pouvoir dire: "et maintenant, et maintenant, et maintenant, au lieu de dire "depuis toujours" ou "à jamais". S'asseoir à une table ou des personnes jouent aux cartes, pour être salué d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche, comme on feint d'attraper le poisson avec eux, comme on feint de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie, quand on fait rôtir les agneaux, quand on sert du vin dans les tente du désert, enfin, on simule"...
Celui qui demande son âge au Temps / Celle qui demande l’heure au Tage / Ceux qui se sentent otages du Temps mais c’est peut-être l’âge, etc.
 À LA MORT, À LA VIE. - À l'angélisme béat, voire inepte, limite obscène (genre "nos petits anges" des mères couveuses) de l'imagerie sulpicienne, s'oppose évidemment le fracas du monde, de corridas en crucifixions, dont la peinture de Francis Bacon tire sa dramaturgie sanglante et féerique à la fois. Or Bacon relève lui aussi, je crois, de cette angéologie poétique, en sa face sombre, qui a succédé à l'angéologie dogmatique voire militaire des Docteurs ès théologie et autres visionnaires mystiques tels Jacob Boehme ou Angelus Silesius.
À LA MORT, À LA VIE. - À l'angélisme béat, voire inepte, limite obscène (genre "nos petits anges" des mères couveuses) de l'imagerie sulpicienne, s'oppose évidemment le fracas du monde, de corridas en crucifixions, dont la peinture de Francis Bacon tire sa dramaturgie sanglante et féerique à la fois. Or Bacon relève lui aussi, je crois, de cette angéologie poétique, en sa face sombre, qui a succédé à l'angéologie dogmatique voire militaire des Docteurs ès théologie et autres visionnaires mystiques tels Jacob Boehme ou Angelus Silesius. Francis Bacon entre en peinture avec une crucifixion blasphématoire (une espèce de spectre blanc de volaille clouée, datant de 1933) qui prélude à son émancipation d'avec son mentor de l'époque, le peintre Roy de Maistre, bientôt rallié au catholicisme traditionnel. Par la suite, l'ange de la mort ne cessera de danser autour de la chaise électrique sur laquelle Bacon assied ses modèles, souvent très beaux selon le canon conventionnel, pour en tirer des figures déformées voire monstrueuses sur fond de couleurs extatiques.
Le même ange de la mort patrouille aux horizons du Voyage au bout de la nuit de Céline, scellant la même beauté noire et le même caractère électrique de sa prose. Enfin, chez Louis Soutter, l'ange des douleurs est partout.
GATSBY. - Il ne m'a fallu que le retour à quelques pages du Great Gatsby pour me rappeler cette évidence: que ce qui nous touche vraiment en littérature, et donc dans la vie, ou inversement, est une affaire d'anges. Je me le disais déjà hier en relisant un récit de Tchékhov intitulé Ceux qui sont de trop, et cela m'est encore plus clair à la lecture de Scott Fitzgerald: que nous crèverions sans les anges.
Cela n'a rien à voir avec ce qu'on décrie justement comme angélisme, au sens d'une idéaliste suavité ou d'une innocence fantasmée de bambins béats: cette bimbeloterie n'a rien de commun avec les anges de tous âges et conditions que je dis, qui en bavent le plus souvent plus que les autres et sont parfois teigneux, voire affreux.
L'affreux et teigneux Charles Bukowski, par exemple, est de ces anges au même titre que ce snob gigolo de Rainer Maria Rilke ou que cette cinglée de Simone Weil ou que cette harpie de Patty Higsmith ou que le calamiteux Rimbaud - tous ayant en commun le même don d'illumination et la même grâce diffusée par Scott Fitzgerald quand il capte la douleur sous le lipstick.
LES SIMULACRES. - L'obstacle majeur à la diffusion lumineuse de l'ange - ce qui revient à parler de l'art ou de la poésie -, est l'agitation imbécile, laquelle procède de la vanité et de l'envie, qui participent elles-mêmes des composants de la basse passion de posséder ou de soumettre ou de s'en mettre pleine la panse ou de s'éclater, comme on dit.
 Les Anges de la télé figurent cette agitation au pinacle de la stupidité médiatique. Cependant le rejet vertueux ou la moquerie me semblent insuffisants. Je me disais même, hier soir, que les girls et les boys "élus" sur le plateau de cette émission d'une débilité extrême, sont peut-être, quand même, quelque part, des anges - je me disais que chacun de ces pantins laqués ne ferait pas de vieilles osses dans cette arène du Rien, et dans l'immédiat je remarquai avec espoir un rien de panique enfantine dans l'expression de la pauvre Nabila changeant de culotte à vue, je guettais chez les boys un rien de gouaille ou de bonne vulgarité sous la dégaine à la coule de celui qui assure avec la conviction (voix off) de vivre quelque chose de géant, pour ne pas dire d'Historique comme le martèlent les hystériques du TJ - bref je cherchais à ces zombies programmés une échappée en les imaginant revenus dans leur banlieue avec de subits sanglots de lucidité: je souhaitais secrètement a Nabila & Co de se retrouver un de ces soirs largués et perdus, jetés éperdus loin des spots et des macs de la télé, se frottant enfin les paupières au lever du jour et se sentant des ailes...
Les Anges de la télé figurent cette agitation au pinacle de la stupidité médiatique. Cependant le rejet vertueux ou la moquerie me semblent insuffisants. Je me disais même, hier soir, que les girls et les boys "élus" sur le plateau de cette émission d'une débilité extrême, sont peut-être, quand même, quelque part, des anges - je me disais que chacun de ces pantins laqués ne ferait pas de vieilles osses dans cette arène du Rien, et dans l'immédiat je remarquai avec espoir un rien de panique enfantine dans l'expression de la pauvre Nabila changeant de culotte à vue, je guettais chez les boys un rien de gouaille ou de bonne vulgarité sous la dégaine à la coule de celui qui assure avec la conviction (voix off) de vivre quelque chose de géant, pour ne pas dire d'Historique comme le martèlent les hystériques du TJ - bref je cherchais à ces zombies programmés une échappée en les imaginant revenus dans leur banlieue avec de subits sanglots de lucidité: je souhaitais secrètement a Nabila & Co de se retrouver un de ces soirs largués et perdus, jetés éperdus loin des spots et des macs de la télé, se frottant enfin les paupières au lever du jour et se sentant des ailes... LE SECRET. - T’as quelque chose à me dire : je t’entends bien - je m’entends bien avec toi et je m’entends mieux avec moi quand t’es là, partout où je te retrouve sur mon chemin je me retrouve en même temps, j'sais pas pourquoi mais c’est comme ça, même quand y a pas de lumière y en a quand t’es là…
LE SECRET. - T’as quelque chose à me dire : je t’entends bien - je m’entends bien avec toi et je m’entends mieux avec moi quand t’es là, partout où je te retrouve sur mon chemin je me retrouve en même temps, j'sais pas pourquoi mais c’est comme ça, même quand y a pas de lumière y en a quand t’es là…MESSAGERS.- La grâce n'est pas toujours où les spécialistes en la matière la situent, même si les saintes et les saints homologués dans les cultes divers ne sont pas sans mérites avérés, mais la percevoir suppose d'abord qu'on se calme, qu'on se taise, qu'on écoute, qu'on se montre plus attentif même en pleine disco ou dans la tonitruance du stade en folie après un but de rêve: les messagers sont parmi nous mais nous ne savons point les voir ni les accueillir. Or il importe de discerner plus clairement ce qui nous en empêche, et ensuite cela pourrait aller mieux.
L'obsession en tout genre est un obstacle sérieux. L'obsession apoplectique du Pouvoir me semble pour ainsi dire rédhibitoire, j'entends: politique, financier et symbolique. Devant ces obstacles, l'ange se sent flagada. Mais il faut se méfier du pire qui use parfois de la parure du Bien. L'obsession de la vertu ou de la pureté peut aussi contrevenir au passage du messager, qu'une certaine tradition spirituelle a raison de voir préférer les mauvais lieux aux tea-rooms proprets. Une certaine obsession de la bonne santé ou de la belle humeur peuvent s'opposer aussi à la libre circulation des personnes angéliques. On n'imagine pas Notre Seigneur dans un fitness ou les poètes Novalis, Baudelaire, Dylan Thomas, Emily Dickinson dans un jacuzzi, alors que leur vocation les porte à s'incarner en douleur et en douceur.
L'incarnation de la douceur est la marque de l'ange.
MON MEILLEUR SOUVENIR. - Ma bonne amie fête aujourd'hui ses 65 ans. Elle vient de finir une nouvelle toile dont l'atmosphère de bord de mer, dans l'esprit de Hopper, est prenante. J'ai vu hier soir un film japonais intitulé After life, qui m'a beaucoup touché. Fondé sur le témoignage de centaines de personnes de toutes conditions, interrogées après leur mort supposée, le film se concentre sur le souvenir unique que chacun aimerait emporter dans l'au-delà. Or j'ai tout de suite pensé au soir de janvier 1982 où j'ai retrouvé ma bonne amie dans un bar, dix-huit ans après notre premier flirt. Mais la naissance de nos deux infantes exigerait au moins trois souvenirs à emporter. Du moins suis-je rassuré par le fait que nos deux grâces s'entendent, avec leur mère, comme des luronnes, aussi bien qu'avec leurs lurons...
(À La Désirade, ce samedi 22 juin)
 L'ANGE DE VERRE. - Je me retrouve ce matin à Shangai. Le désir de Shangai m'a souvent effleuré, ces derniers temps, mais à l'état encore vague d'aspiration à la ville-monde, tandis que ce matin c'est du solide: dès les premiers mots écrits par la main de verre je m'y suis reconnu sans y avoir jamais été: "Shangai n'est pas une ville. Ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit. Rien ne vient. Puis une stupeur face au bruit. Un bruit d'océan ou de machine de guerre. Un tumulte, un infini de perspectives, d'angles et de surface amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se recoupent ici, se heurtent et se multiplient, fuient à l'horizon ou s'enroulent autour des points fixes (kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons). Des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radiocentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés, flux de chairs et de choses, flux d'essence giclant de vitrine en vitrine, grasses pattes, filoches de doigts, odeurs. L'espace grandit encore. Des foules béantes s'étirent à perte de vue, disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de milliers de grues. Des foules-miroir, enfin, se font face sur les boulevards, étrangement statiques, mastiquées, balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs, chacune hypnotisant sa moitié complémentaire. Shangai est à la fois mangouste et cobra".
L'ANGE DE VERRE. - Je me retrouve ce matin à Shangai. Le désir de Shangai m'a souvent effleuré, ces derniers temps, mais à l'état encore vague d'aspiration à la ville-monde, tandis que ce matin c'est du solide: dès les premiers mots écrits par la main de verre je m'y suis reconnu sans y avoir jamais été: "Shangai n'est pas une ville. Ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit. Rien ne vient. Puis une stupeur face au bruit. Un bruit d'océan ou de machine de guerre. Un tumulte, un infini de perspectives, d'angles et de surface amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se recoupent ici, se heurtent et se multiplient, fuient à l'horizon ou s'enroulent autour des points fixes (kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons). Des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radiocentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés, flux de chairs et de choses, flux d'essence giclant de vitrine en vitrine, grasses pattes, filoches de doigts, odeurs. L'espace grandit encore. Des foules béantes s'étirent à perte de vue, disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de milliers de grues. Des foules-miroir, enfin, se font face sur les boulevards, étrangement statiques, mastiquées, balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs, chacune hypnotisant sa moitié complémentaire. Shangai est à la fois mangouste et cobra".La main de verre descendue du ciel a la mémoire des fractures. "Cinquante au total", écrit-elle. Et reconnaît d'expérience: "C'est peu. D'autres malades s'en font des centaines. J'ai de la chance dans mon malheur".
 La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, l'ange de verre !
La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, l'ange de verre !Dans un rêve récent un messager spécial me conviait au coin d'un jardin municipal au nom difficile à prononcer, aux abords duquel je retrouverais Le Rameau d'Or. Mais voici que la main de verre précisait maintenent le lieu: Porte Nord du parc Zhongshan. Et l'Objet se trouvait là: "Un rameau d'acacia gît au milieu du chemin. Ce morceau de bois est comme la langue chinoise. Sa couleur, son parfum, ses premiers frémissements de bourgeon, ses fruits, ses fleurs, et jusqu'aux bourrasques qui l'ont arraché à son arbre, jusqu'aux pluies qui le font aujourd'hui pourrir sur le sol, appelleraient une description sans fin. Mais ce trésor de nuances est raboté par l'usage. Comme le chinois classique s'est appauvri dans la langue du peuple, la branche, hier florissante, est piétinée par les passants. Au lieu de siffler dans le vent, elle n'émet plus que quatre tons sous la semelle: un ton descendant,un ton descendant-montant, un ton montant, un ton plat. Quand une chaussure l'écrase, un large talon d'homme, le craquement est impératif et plongeant. La pression molle d'un pneu de vélo en tire une plainte offusquée mêlée de surprise. L'attaque nerveuse d'un escarpin fait jaillir une série de bruits qui grimpent le long de la jambe. Enfin, une ixième procession de vieillards réduit en poussière ce reste d'écorce dans un frottement de pantoufles".
Je sentais ces jours que j'avais besoin d'une dernière transfusion d'énergie pour achever mon propre livre, où il est pas mal question aussi d'anges stigmatisés. Or Béton armé m'est arrivé comme une grâce. C'est un livre d'une douce violence dont chaque mot de verre sonne vrai, qui me renvoien aux miens: "Je voudrais raconter la ville telle que la vivent ceux qui la bâtissent. Aboutir à quelque chose qui ressemble à l'idée du travail bien fait, une espèce de point fixe. Un emblème dont on pourrait dire qu'il est beau et surtout qu'il permet à d'autres de vivre mieux, comme un pont, par exemple, qui symbolise différentes qualités poussant les individus à se surpasser sans trop savoir pourquoi, peut-être par fierté ou simplement parce qu'ils ne sont jamais plus heureux que lorsqu'ils adoptent les réflexes du singe qui défie la pesanteur en se balançant de liane en liane".
 NOCTUELLE. - De par ma qualité de papillon de nuit je bénéficie de certains privilèges en termes de transit urbain, mais ce n’est pas dire que je passe à travers les murs, que non point, en revanche les vols à basse altitude me sont permis même dans les rues à risques et c’est là qu’il m’est donné certains soirs à la sortie de certains bars de humer la tendre chair humaine sur le bitume – c’est énorme le malheur humain, c’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain, mais ce malheur humain me justifie en somme, moi le messager, et tout est bien…
NOCTUELLE. - De par ma qualité de papillon de nuit je bénéficie de certains privilèges en termes de transit urbain, mais ce n’est pas dire que je passe à travers les murs, que non point, en revanche les vols à basse altitude me sont permis même dans les rues à risques et c’est là qu’il m’est donné certains soirs à la sortie de certains bars de humer la tendre chair humaine sur le bitume – c’est énorme le malheur humain, c’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain, mais ce malheur humain me justifie en somme, moi le messager, et tout est bien… RETOUR À SHANGAI. - Au lendemain des extrordinaires agapes d'anniversaire offertes par son frère à ma bonne amie pour ses soixante-cinq ans, je me retrouve à Shangai. Sans exagérer: d'extraordinaires agapes à La Châ, nouveau restau des hauteurs à un coup d'aile de pic noir des Pléiades et donnant, à 1300 mètres, sur le lac immense et l'arrière-pays jusqu'au Jura bleuté et plus loin encore.. Le lieu conjugue saveurs et sapience, avec un goût parfait dénué de tout chiqué d'artifice, plats exquis et vins divins, amen. Philippe Rahmy rappelle, dans Béton armé, le proverbe sicilien selon lequel un peuple s'identifie au contenu de son assiette. Or je lui recommande le peuple de La Châ: c'est un bon peuple.
RETOUR À SHANGAI. - Au lendemain des extrordinaires agapes d'anniversaire offertes par son frère à ma bonne amie pour ses soixante-cinq ans, je me retrouve à Shangai. Sans exagérer: d'extraordinaires agapes à La Châ, nouveau restau des hauteurs à un coup d'aile de pic noir des Pléiades et donnant, à 1300 mètres, sur le lac immense et l'arrière-pays jusqu'au Jura bleuté et plus loin encore.. Le lieu conjugue saveurs et sapience, avec un goût parfait dénué de tout chiqué d'artifice, plats exquis et vins divins, amen. Philippe Rahmy rappelle, dans Béton armé, le proverbe sicilien selon lequel un peuple s'identifie au contenu de son assiette. Or je lui recommande le peuple de La Châ: c'est un bon peuple.Non moins extraordinaire est en outre ce livre de sapience au mille saveurs détaillées par la main de verre. Par exemple au zoo de Shangai devant Cinder le singe nu: "Aucune créature ne ressemble davantage à Dieu qu'un singe sans fourrure". Ou bien au fitness Will's Gym: "Le sportif chinois est tout en épaules". Face à la destruction de la personne caractéristique de la société communiste: "En Chine, l'amour ne se fait qu'en absence d'amour". Ou faisant écho à ce pêcheur fils de pilote américain qui affirme que les States ont lâché douze bombes atomiques sur le Japon qu'ils ont ensuite repeuplé en important un nouveau peuple dans l'archipel. Ainsi de suite: comme unesespèce d'acupuncture excitante et roborative, tour à tour poétique et polémique.
(À La Désirade, ce 23 juin)
DU FANTASTIQUE SOCIAL. - C'est Guido Ceronetti, lors de notre visite à Cetona où m'avait accompagné la Professorella, qui m'a soufflé la formule de "fantastique social" à propos de Céline, qui me revient en lisant Béton armé et par exemple à cette page me rappelant l'Amérique du Voyage: "Apple Store. 282 Huaihai Zhong Road. 21 heures. Vigiles Matrix, lunettes fumées, oreillettes. Vendeurs gravures de mode, volubiles et montées sur ressorts. Le mien s'appelle Link. Il a un doctorat en informatique, un long métrage en cours, un roman sur le feu, il rédige une grammaire chinoise pour étrangers et il enregistre un CD de rap, parmi d'autres projets. Dehors, la pluie frappe les cloisons transparentes. Les écrans 27 pouces diffusent une lueur d'outre-tombe sur les dizaines d'enfants massés dans le Genius Corner, une garderie aux allures de bloc opératoire. Les gamins y traînent leurs parents. La plupart ont moins de dix ans. Ils ne sont pas ici pour s'amuser. Ils manipulent des logiciels de programmation, juchés sur des tabourets de bar qui leur font des queues de métal. Leurs doigts crépitent. Pattes de mouche. Ils façonnent un monde dont celui-ci est l'ébauche. Comme les scorpions, ils survivront à la pollution, aux catastrophes nucléaires, au réchauffement climatique, à la chute des météores."
Celui qui résiste au déferlement du n’importe quoi / Celle qui assiste à l’orgie de la consommation en se demandant ce qui va l’interrompre / Ceux qui voient la foule se diriger comme une seul vers l’Objet de la convoitise, etc.
 BAUDELAIRE MIGRANT. -Moi tu vois j’ai pas connu ni mère ni père, j’ai jamais eu d’amis, mais pas un, on m’a dit que je venais de là-bas mais j’ai pas ça de souvenir, donc je peux même pas dire que j’ai un pays, et comment je me trouve ici, je sais pas, si je trouve beau, je sais pas, je sais pas trop ce qui est beau ou pas beau, j’ai pas appris, mais ce que je sais, tout ce que je sais, mec, et ça je le sais: c’est que je kiffe les nuages, les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages…
BAUDELAIRE MIGRANT. -Moi tu vois j’ai pas connu ni mère ni père, j’ai jamais eu d’amis, mais pas un, on m’a dit que je venais de là-bas mais j’ai pas ça de souvenir, donc je peux même pas dire que j’ai un pays, et comment je me trouve ici, je sais pas, si je trouve beau, je sais pas, je sais pas trop ce qui est beau ou pas beau, j’ai pas appris, mais ce que je sais, tout ce que je sais, mec, et ça je le sais: c’est que je kiffe les nuages, les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages…DE LA BONTE. - Le nom de l'enfant Declan, qui signifie en Irlande terrienne: que la tranquille bonté soit, sied bien à ce solide garçon d'un an et des poussières dont le regard intense annonce la vitale énergie et le goût des spéculations stellaires.
 Sa mère à la dégaine de punkette est fiérote de me le présenter. Son petit parc est installé au milieu des livres formant alentour des piles, des monceaux, des tours et des murailles, il y en a de toutes les couleurs selon les auteurs, mais pour l'instant la plus vive est celle du livre-fétiche que Declan tient en main avec un dispositif lui permettant, d'une pression du pouce, de déclencher les premières mesures de la Symphonie du Nouveau Monde.
Sa mère à la dégaine de punkette est fiérote de me le présenter. Son petit parc est installé au milieu des livres formant alentour des piles, des monceaux, des tours et des murailles, il y en a de toutes les couleurs selon les auteurs, mais pour l'instant la plus vive est celle du livre-fétiche que Declan tient en main avec un dispositif lui permettant, d'une pression du pouce, de déclencher les premières mesures de la Symphonie du Nouveau Monde.La jeune Andonia n'a qu'un seul regret: que Geneviève, sa mère trop tôt disparue, n'ait pu partager ce qu'elle lui annonçait elle-même comme le plus grand bonheur de la vie. De son vivant sa fille ne voulait pas en entendre parler. Mais l'existence est toujours surprenante: j'en sais quelque chose. À qui m'aurait dit ainsi, avant la venue au monde de notre premier enfant, que bientôt ma vie de bohème solitaire et farouche se poursuivrait à deux puis à trois sans compter le clebs bleu de ma bonne amie, j'eusse souri au nez. Mais non: la vie réalise parfois vos plus secrets désirs. De fait à ce moment-là, pour dire vrai, j'en avais marre de n'être qu'un, et la jeune mère de Declan, Andonia la nouvelle timonière de L'Age d'Homme, fille de Geneviève et de Vladimir, ne l'a pas vécu autrement crois-je savoir, avec Jonathan son compagnon...
BAZAR AUX SOUVENIRS. - Or le nouvel Âge d'Homme, que symbolise à l'instant cet enfant, déploie son bazar de livres et de dossiers, de cartons et de papiers dans un seul vaste entresol au soubassement de l'ancien Uniprix lausannois jouxtant le mythique cinéma Capitole, à la devanture duquel irradie une immense affiche de l'Amarcord de Fellini, mon film préféré dans le registre du "je me souviens"...
Je me souviens de la petite Andonia trottinant sur le tapis d'Orient de la maison sous les arbres, après la joie de Geneviève à nous la présenter, et voici trente ans plus tard de nouveaux sourires pallier la douleur des séparations.
Et partout ici: que d'objets de mémoire, que de vestiges, que de chères reliques. Donc voici, dans une vitrine genre balkanique: la toute petite machine à écrire Corona de Charles-Abert Cingria, que Dimitri m'avait offert mais que jamais je n'ai osé emporter, et qui se trouve si bien là, comme ça. Ou voilà la collection des éditions de tête de L'Âge d'Homme, fabuleux objets de bibliophilie conçus dans les ateliers du maître imprimeur Ganguin; et tant d'autres portraits d'écrivains aimés et de tableaux, de dessins m'évoquant tant de belles heures que revivifient aujourd'hui le présent et l'avenir relancé.
 LA MAISON SOUS LES ARBRES. - Andonia ma raconte que la maison sous les arbres de hauts de Lausanne où nous avons passé tant de soirées à parler et à nous lire des merveilles (ah le souvenir de la lecture intégrale que j'ai faite un soir en quelques heures de La bouche pleine de terre, à la fin de laquelle nous avions tous les yeux embués...) a récemment été investie par des Roms, qu'elle n'a pas eu le coeur de chasser. La police était prête à les évacuer, mais elle a usé de son droit d'héritière et "comme ça la maison est habitée" en attendant que ses futurs acquéreurs la rasent pour y bâtir du neuf de meilleur rapport.
LA MAISON SOUS LES ARBRES. - Andonia ma raconte que la maison sous les arbres de hauts de Lausanne où nous avons passé tant de soirées à parler et à nous lire des merveilles (ah le souvenir de la lecture intégrale que j'ai faite un soir en quelques heures de La bouche pleine de terre, à la fin de laquelle nous avions tous les yeux embués...) a récemment été investie par des Roms, qu'elle n'a pas eu le coeur de chasser. La police était prête à les évacuer, mais elle a usé de son droit d'héritière et "comme ça la maison est habitée" en attendant que ses futurs acquéreurs la rasent pour y bâtir du neuf de meilleur rapport.Or c'est tout à fait de l'enfant du Gitan que d'accueillir ainsi des errants rejetés de partout, nous défiant tranquillement de leurs yeux suppliants et malins. Folie de penser que cette maison hantée par tant de présences magiques, cette demeure qui m'évoque, par sa forme de grand chalet de bois, la maison sur la hauteur de Witkiewicz à Zakopane, hypothéquée par Dimitri afin de payer la première édition des Hauteurs béantes d'Alexandre Zinoviev - folie de penser que ce havre de tant de samedis soirs et tant de fin d'années festive soit aujourd'hui le bivouac de sans feux ni lieux. Folie de la vie de Dimitri qu'apaisait ici la douce et lumineuse présence de Geneviève - folie de nos vies folles et sages...
Vladimir Dimitrijevic, Le Mystère ultime: "La littérature, comme toute forme d'art, a une limite. À celle-ci, nous sommes confrontés par le mystère de la souffrance. Cette incroyable évidence: que les sentiments puissent faire souffrir...
Il y a, pour chaque être, un mystère dernier. Je le ressens comme une lutte: nous ne serons jamais tout à fait sûrs de notre immortalité.
Mais c'est aussi la gloire de la littérature que de chercher à percer ce mystère avec ses formules, ses coups de sonde, ses tâtonnements - toutes ces traces laissées dans un langage commun".
 À L'enfant qui vient
À L'enfant qui vientPour Declan, Nata, Lucie et les autres...
Je ne sais pas qui tu es, toi qui viens là, ni toi non plus n'es pas censé le savoir.
Ce que je sais que tu ne sais pas, c'est que tu es porteur de joie. Tu ne sais pas ce que tu donnes, que nous recevons. Après quoi nous te donnerons ce que nous savons, que tu recevras ou non.
Du point de vue de l'ange on pourrait dire que tu sais déjà tout, sans avoir rien appris. C'est une vision très simple que celle de l'ange, toute claire comme le jour où tu es venu, et qui se trouble au fil des jours, mais qu'un premier sourire, puis un rire suffisent à éclaircir.
On ne s'y attendait pas: on avait oublié, ou bien on ne se doutait même pas de ce que c'est qu'un enfant qui éclate de rire pour la première fois; plus banal tu meurs mais ils en pleurent sur le moment, à vrai dire l'enfant qui rit pour la première fois recrée le monde à lui seul: c'est l'initial étonnement et tout revit alors - tout est béni de l'ici-présent.
Tu vas nous apprendre beaucoup, l'enfant, sans t'en douter. Ta joie a été notre joie dès ton premier sourire, et mourir sera plus facile de te savoir en vie.
Du point de vue de l'ange, on pourrait dire que nous ne savons rien, sauf un peu de chemin. C'est l'ange en nous qui a tracé, un peu partout, ces chemins.
Ensuite il t'incombera de choisir entre savoir et ne pas savoir, rester dans le vague ou donner à chaque chose ton souffle et son nom, leur demander ce qu'elles ont à te dire et les colorier, les baguer comme des oiseaux, puis les renvoyer aux nuées.
Les mots te savent un peu plus qu'hier, ce premier matin du monde où tu viens, et c'est cela que nous appelons le temps, je crois, ce n'est que cela: ce qu'ils feront de toi aux heures qui viennent, ce que fera de toi le temps qui t'est imparti sous ton nom - les mots sont derrière la porte de ce premier jour et ils attendent de toi que tu les accueilles et leur apprennes à s'écrire, les mots ont confiance en toi, qui leur apprendras ta douceur.
(À La Désirade, ce 30 juin 2013)
(Ces pages constituent la fin de Mémoire des anges, Lectures du monde 2008-2013, dont le tapuscrit de 420 feuillets a été déposé aux éditions L'Age d'Homme)
-
Un regard à partager

À propos de Vallotton est inadmissible, de Maryline Desbiolles.
Pas mal de gens ne voient en la peinture qu'un élément de décoration (on dit aujourd'hui déco, et ça cartonne à la télé), qu'il s'agisse de prairies fleuries à la Monet pour faire ambiance champêtre, en consonance avec les rideaux à ramages du salon, ou de motifs abstraits à la Mondrian pour la cuisine ou la salle de bain. Il n'y a d'ailleurs rien de mal à cela: les musées croulent de peinture décorative, et Monet, ou Bonnard, restent de merveilleux jardiniers-ensembliers.
Mais la peinture-peinture est aussi autre chose, qui nous cloue, et c'est ce qu'exprime immédiatement Maryline Desbiolles dans le petit livre dense qu'elle consacre à se fréquentation de longue date avec la peinture de Félix Vallotton, immédiatement appariée à l'univers de Proust.
 La première expérience dont elle témoigne n'a pas à voir directement avec la peinture, plutôt liée à une expérience plus fondamentale, qu'on pourrait dire pompeusement ontologique, découlant en effet du saisissement que tout un chacun peut éprouver en constatant soudain l'unicité plus ou moins vertigineuse de son être (je suis moi et pas un autre...), comme Maryline Desbiolles l'a vécu en son enfance, du côté d'Antibes, en voyant soudain un olivier au bord d'une route (cet olivier et pas un autre). Cette expérience fondamentale de notre présence au monde qui donne à certains la nausée (suivez le regard de Sartre) et en fait léviter d'autres (Cingria n'a pas son pareil pour chanter "l'être qui se reconnaît) relève aussi bien de la métaphysique ou de la poésie, et l'art en cristallise les vertiges d'angoisse ou les "minutes heureuses". Plus précisément, certains artistes nous font revivre ce qui n'a souvent été qu'un ébranlement passager et nous illuminent ou nous clouent.
La première expérience dont elle témoigne n'a pas à voir directement avec la peinture, plutôt liée à une expérience plus fondamentale, qu'on pourrait dire pompeusement ontologique, découlant en effet du saisissement que tout un chacun peut éprouver en constatant soudain l'unicité plus ou moins vertigineuse de son être (je suis moi et pas un autre...), comme Maryline Desbiolles l'a vécu en son enfance, du côté d'Antibes, en voyant soudain un olivier au bord d'une route (cet olivier et pas un autre). Cette expérience fondamentale de notre présence au monde qui donne à certains la nausée (suivez le regard de Sartre) et en fait léviter d'autres (Cingria n'a pas son pareil pour chanter "l'être qui se reconnaît) relève aussi bien de la métaphysique ou de la poésie, et l'art en cristallise les vertiges d'angoisse ou les "minutes heureuses". Plus précisément, certains artistes nous font revivre ce qui n'a souvent été qu'un ébranlement passager et nous illuminent ou nous clouent. 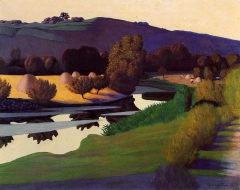 L'olivier solitaire de Marylin Desbiolles lui est apparu soudain comme "en trop", non sans lui faire éprouver un choc: "C'était violent. D'une violence qui faisait crisser les dents". Or elle a retrouvé cette même violence dans la peinture de Vallotton, même si le premier tableau dont elle croit se souvenir est le fameux Ballon de 1899, figurant un petit garçon à chapeau de paille - un "garçon-soleil",écrit-elle -, qui lui évoquera plus tard le petit Marcel, dans La Recherche, jouant avec Gilberte dans les jardins des Champs-Elysées.
L'olivier solitaire de Marylin Desbiolles lui est apparu soudain comme "en trop", non sans lui faire éprouver un choc: "C'était violent. D'une violence qui faisait crisser les dents". Or elle a retrouvé cette même violence dans la peinture de Vallotton, même si le premier tableau dont elle croit se souvenir est le fameux Ballon de 1899, figurant un petit garçon à chapeau de paille - un "garçon-soleil",écrit-elle -, qui lui évoquera plus tard le petit Marcel, dans La Recherche, jouant avec Gilberte dans les jardins des Champs-Elysées. C'est alors qu'il faut regarder, plus attentivement, cette toile que Maryline Desbiolles découvrit sur une carte postale, avant de la revoir au musée d'Orsay en grandeur nature, pour en déchiffrer la profondeur cachée sous la scène apparemment anodine. Violence de Vallotton ? Certes pas au premier regard, dans cette toile apparemment candide. Mais en voit-on assez l'ombre ? A-t-on bien regardé ? Que nous dit cet enfant vu du ciel ? Voit-on assez le poids de ce vert lesté de noir; et ces deux minuscules personnages blanc et bleu, au fond de la toile, semblant se parler comme Dante et son guide, ne participent-ils pas eux aussi à l'étrangeté de la scène. Ce n'est pas, à proprement parler, ce que dit Maryline Desbiolles: c'est mon sentiment que j'exprime, à travers ce que je perçois de ce tableau, comme elle exprime son sentiment à elle en regardant avec Vallotton.
De même Maryline Desbiolles évoque-telle les intérieurs de Vallotton (dans lesquels ses personnages ne semblent jamais se fondre tout à fait, jamais à l'aise, contrairement à ceux de Vuillard), ou les nus féminins de Vallotton, soit endormis soit mal consentants. Mais a-t-on assez regardé ces chambres et ces corps ? A-t-on été assez attentif à la terrible confrontation de ses rouges et de ses verts ? A-t-on assez regardé ce que profèrent ou vocifèrent les couleurs de ses paysages ? A-t-on assez vu la beauté sidérante de la nature vue par Vallotton, dont le regard croise souvent ceux de Munch ou de Nolde, comme sa conception de la guerre des sexes (dans son roman La vie meurtrière) rencontre celle de Strindberg ou d'Ibsen ?
"J'ai beau regarder le monde avec Vallotton", écrit Maryline Desbiolles, "j'ai beau le regarder tout crûment, je ne peux me résoudre, pas plus que Vallotton, à ce que le monde soit désenchanté. Car, en vérité, il ne l'est pas."
Evidemment, l'enchantement du monde vu par Vallotton n'a rien d'une romance: c'est un saisissement. "Vallotton me cloue le bec", écrit encore Maryline Desbiolles. Francis Bacon prétendra, plus tard, toucher "directement le système nerveux" par ses couleurs, elle aussi acérées comme des clous. Or, en marge de l'expressionnisme, par delà le projet nabi, Vallotton frôle souvent le fantastique sans céder jamais à ses convulsions (comme dans les paysages de Schiele ou Soutine) ni perdre de sa force expressive.
Maryline Desbiolles est venue à Lausanne et, devant le Léman, n'a pas vu l'aimable lac bleu-vert ou gris-sabre à l'étendue placide, mais "un gouffre". C'est voir avec les yeux de Vallotton...
"Regarder Vallotton", écrit-elle encore, "regarder un Vallotton, regarder est violent. Il faut sans doute jouer le jeu, consentir à sa propre violence pour seulement commencer de voir un de ses tableaux. "Nous sommes au bord du paysage, au bord dune falaise ou d'un champ de betteraves, nous ne reconnaissons rien, nous sommes dépossédés, mais nous nous sentons fortement étreints".
 La fin de cet indispensable petit livre (on court l'acheter et la file d'attente au Grand Palais en permettra la lecture en moins d'une heure) évoque une pêche nocturne au lamparo du côté de Cagnes-sur-Mer, où Vallotton a peint et où a vécu Maryline Desbiolles. Mais avant cette conclusion, il faut citer encore ce que l'auteure écrit à propos de La Mare, paysage Honfleur, où elle détaille "une étreinte d'autant plus brusque qu'on ne s'y attendait pas": "La nuit est tombée à présent. Le trou noir de la mare a été découpée au rasoir sur la nappe des lentilles d'eau d'un vert jaune acidulé. Nous serrons les dents. Au bord, sur l'herbe rase, une tignasse ébouriffée de joncs. Dans le fond, on devine un bosquet. Mais surtout, à gauche, un grand sureau dont les ombelles blanches poudroient. Me revient inopinément, une nouvelle fois, le conte de Perrault, Barbe-bleue, "Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie", dit Anne, ma soeur Anne. Il se pourrait que Vallotton ait attendu la nuit et l'éclairage de la lune pour débusquer la mare du conte, son entaille trop précise, affolante dans la verdure. La mare est une découpe de ténèbres, elle se casse le nez sur le bord droit du tableau où apparaissent des ondes que je vois tout à coup. Est-ce là le dessin d'une source ou, plus inquiétant, d'un tourbillon qui achèverait de nous entraîner dans le noir, de nous perdre ?"
La fin de cet indispensable petit livre (on court l'acheter et la file d'attente au Grand Palais en permettra la lecture en moins d'une heure) évoque une pêche nocturne au lamparo du côté de Cagnes-sur-Mer, où Vallotton a peint et où a vécu Maryline Desbiolles. Mais avant cette conclusion, il faut citer encore ce que l'auteure écrit à propos de La Mare, paysage Honfleur, où elle détaille "une étreinte d'autant plus brusque qu'on ne s'y attendait pas": "La nuit est tombée à présent. Le trou noir de la mare a été découpée au rasoir sur la nappe des lentilles d'eau d'un vert jaune acidulé. Nous serrons les dents. Au bord, sur l'herbe rase, une tignasse ébouriffée de joncs. Dans le fond, on devine un bosquet. Mais surtout, à gauche, un grand sureau dont les ombelles blanches poudroient. Me revient inopinément, une nouvelle fois, le conte de Perrault, Barbe-bleue, "Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie", dit Anne, ma soeur Anne. Il se pourrait que Vallotton ait attendu la nuit et l'éclairage de la lune pour débusquer la mare du conte, son entaille trop précise, affolante dans la verdure. La mare est une découpe de ténèbres, elle se casse le nez sur le bord droit du tableau où apparaissent des ondes que je vois tout à coup. Est-ce là le dessin d'une source ou, plus inquiétant, d'un tourbillon qui achèverait de nous entraîner dans le noir, de nous perdre ?"Maryline Desbiolles, Vallotton est inadmissible. Seuil, coll. Fiction & Cie, 43p.
-
Petite maison
 Frères et sœurs(Chronique des tribus)60Avant l’apéro ses deux sœurs étaient apparues , ce jour-là où ils s’étaient retrouvés tous quatre, avec le conjoint de la puînée qu’on appellera Bob le débonnaires, coiffées l’une et l’autre avec un même chic dans le finish du brushing qu’on les eût dit apprêtées pour un concours, toutes deux pimpantes et rajeunies sous leur bref gazon capillaire - coupées courtes à la garçon mais à fines boucles sur le devant et nuances de teintures presque dorées chez la blonde aînée aux yeux verts et presque bleutées chez la plus brune mais sans rien de trop sophistiqué chez aucune des deux, disons sainement élégantes voire sport chic mais en douceur et comme en vraies sœurs complices quelques part, et tout le repas, bœuf bourguignon du bon Bob fin échanson par ailleurs, se passerait ainsi dans la même convivialité sans apprêt à parler d’un peu tout et d’un peu tous, des plus anciens aux plus jeunes de la smala se voyant de loin en loin sans trop de mariages ou d’enterrements à vue de nez proche et tant de souvenirs partagés partis de la maison et y revenant, casa plutôt heureuse en somme à l’image de leurs enfance de boomers de milieu moyen le plus souvent laissés libres de folâtrer par les près et les bois d’alentour - et tu te souviens de cette bedoume de Marijo ? Que oui lance Bob elle se prétendait mon béguin, et le grand Polo ? Ah l’actuaire Il a fait fortune ! Et le frère de Simon qui s’est pendu, ? Devenu prof de latin son père sevère prof de grec, et celle-la qui nous a fait un cancer, et l’autre voisin tout gentil qu’on ne savait pas homo comme ça s'est découvert, et la maraude dans les cerisiers, et le délire tout autour de tout ce nouveau bâti n'importe comment, j’te dis pas le prix de l’immobilier, mais t’as vu là-bas la petite maison dans la folie de béton - on dirait qu’elle tient bon mais jusqu’à quand ça faut pas rêver... Eh mais quoi ça va pas, toi, tu deviendrais pas rabat-joie ?
Frères et sœurs(Chronique des tribus)60Avant l’apéro ses deux sœurs étaient apparues , ce jour-là où ils s’étaient retrouvés tous quatre, avec le conjoint de la puînée qu’on appellera Bob le débonnaires, coiffées l’une et l’autre avec un même chic dans le finish du brushing qu’on les eût dit apprêtées pour un concours, toutes deux pimpantes et rajeunies sous leur bref gazon capillaire - coupées courtes à la garçon mais à fines boucles sur le devant et nuances de teintures presque dorées chez la blonde aînée aux yeux verts et presque bleutées chez la plus brune mais sans rien de trop sophistiqué chez aucune des deux, disons sainement élégantes voire sport chic mais en douceur et comme en vraies sœurs complices quelques part, et tout le repas, bœuf bourguignon du bon Bob fin échanson par ailleurs, se passerait ainsi dans la même convivialité sans apprêt à parler d’un peu tout et d’un peu tous, des plus anciens aux plus jeunes de la smala se voyant de loin en loin sans trop de mariages ou d’enterrements à vue de nez proche et tant de souvenirs partagés partis de la maison et y revenant, casa plutôt heureuse en somme à l’image de leurs enfance de boomers de milieu moyen le plus souvent laissés libres de folâtrer par les près et les bois d’alentour - et tu te souviens de cette bedoume de Marijo ? Que oui lance Bob elle se prétendait mon béguin, et le grand Polo ? Ah l’actuaire Il a fait fortune ! Et le frère de Simon qui s’est pendu, ? Devenu prof de latin son père sevère prof de grec, et celle-la qui nous a fait un cancer, et l’autre voisin tout gentil qu’on ne savait pas homo comme ça s'est découvert, et la maraude dans les cerisiers, et le délire tout autour de tout ce nouveau bâti n'importe comment, j’te dis pas le prix de l’immobilier, mais t’as vu là-bas la petite maison dans la folie de béton - on dirait qu’elle tient bon mais jusqu’à quand ça faut pas rêver... Eh mais quoi ça va pas, toi, tu deviendrais pas rabat-joie ? -
J'te dis que ça...
 Frères et sœurs(Chronique des tribus)59Nous sommes convenus l’autre jour au téléphone, avec l’abbé V., de ne pas nous attarder à dauber sur l’état du monde, je lui dis que, lisant et annotant ces jours les 33 chants du Purgatoire de la Commedia d e Dante, je constate une fois de plus que notre sembable et notre frère est une canaille possible depuis la nuit des siècles, et lui me répète que partout en effet, où il y a de l’homme il y a de l’hommerie, c’est Montaigne qui l’a écrit à l’époque des guerres de religion autrement mortelles qu’aujourd’hui, et des pestes et des colères politiques, et bien sûr je souris d’entendre mon ecclésiastique préféré citer le vieil éclairé de la Montagne, nous tombons d’accord sur le fait qu’il faut laisser l’expertise de la situation aux experts des plateaux de télé, nous apprécions tous deux pas mal les généraux en retraite franco-français qui viennent faire chorus avec le Président, soldat d’opérette impatient d’envoyer se faire bouchoyer les jeunes gens dans les plaines d’Ukraine aux drones meurtriers omniprésents, nous sommes épatés par le savoir militaro-stratégique des présentatrices à brushing guerrier n’en finissant plus de commenter les moindres mouvements du front avec l’alacrité des dames du faubourg Saint-Germain jugeant des menées de la Grande Guerre en longs téléphonages, au dire de Marcel Proust, bref nous regardons ailleurs quoique restant l’un et l’autre au courant de l’état général des choses, lui continuant malgré tout de regarder la télé et recevant des précisions par sa sœur, et moi grappillant mes propres infos chez les adversaires déclarés des médiamensonges tel le colonel émérite suisse Jacques Baud taxé de russophilie et donc écarté des plateaux bien pensants, telle la redoutable Caroline Galactéros, elle aussi rangée des armées mais ferraillant dur en matière géopolitique, tel Régis Le Sommier du site Omertà revenant des divers fronts en reporter de guerre doublé d’un analyste non aligné, tel encore le briscard Alain Juillet, et quelques autres dont je ne parle pas à l’AB mais que je recommande à mes sœurs ne dédaignant pas tout à fait mes avis, à mes quelques amis éveillés tels Jackie et Tonio (lui étant d’ailleurs tout acquis aux thèses rompant avec l’irresponsable poussée belliciste), tout cela drainant sur Youtube des centaines de milliers de followers écoeurés par les imbécillités de l’Europe bureaucratique et de sa cheftaine de guerre brushée à la prusienne de salon et faisant l'impasse sur les millions de morts inutiles en Ukraine, alors que les victimes civiles de la vengeance israélienne, après l’épouvantable pogrom qu’on sait, dépassent désormais les plus de 100.000 morts rien qu’à Gaza - bref les gars nous ne nous mêlons pas de ça mais faut pas exagérer, j’te dis que ça - enfin honte à ceux qui taxent de traîtrise les pacifistes...
Frères et sœurs(Chronique des tribus)59Nous sommes convenus l’autre jour au téléphone, avec l’abbé V., de ne pas nous attarder à dauber sur l’état du monde, je lui dis que, lisant et annotant ces jours les 33 chants du Purgatoire de la Commedia d e Dante, je constate une fois de plus que notre sembable et notre frère est une canaille possible depuis la nuit des siècles, et lui me répète que partout en effet, où il y a de l’homme il y a de l’hommerie, c’est Montaigne qui l’a écrit à l’époque des guerres de religion autrement mortelles qu’aujourd’hui, et des pestes et des colères politiques, et bien sûr je souris d’entendre mon ecclésiastique préféré citer le vieil éclairé de la Montagne, nous tombons d’accord sur le fait qu’il faut laisser l’expertise de la situation aux experts des plateaux de télé, nous apprécions tous deux pas mal les généraux en retraite franco-français qui viennent faire chorus avec le Président, soldat d’opérette impatient d’envoyer se faire bouchoyer les jeunes gens dans les plaines d’Ukraine aux drones meurtriers omniprésents, nous sommes épatés par le savoir militaro-stratégique des présentatrices à brushing guerrier n’en finissant plus de commenter les moindres mouvements du front avec l’alacrité des dames du faubourg Saint-Germain jugeant des menées de la Grande Guerre en longs téléphonages, au dire de Marcel Proust, bref nous regardons ailleurs quoique restant l’un et l’autre au courant de l’état général des choses, lui continuant malgré tout de regarder la télé et recevant des précisions par sa sœur, et moi grappillant mes propres infos chez les adversaires déclarés des médiamensonges tel le colonel émérite suisse Jacques Baud taxé de russophilie et donc écarté des plateaux bien pensants, telle la redoutable Caroline Galactéros, elle aussi rangée des armées mais ferraillant dur en matière géopolitique, tel Régis Le Sommier du site Omertà revenant des divers fronts en reporter de guerre doublé d’un analyste non aligné, tel encore le briscard Alain Juillet, et quelques autres dont je ne parle pas à l’AB mais que je recommande à mes sœurs ne dédaignant pas tout à fait mes avis, à mes quelques amis éveillés tels Jackie et Tonio (lui étant d’ailleurs tout acquis aux thèses rompant avec l’irresponsable poussée belliciste), tout cela drainant sur Youtube des centaines de milliers de followers écoeurés par les imbécillités de l’Europe bureaucratique et de sa cheftaine de guerre brushée à la prusienne de salon et faisant l'impasse sur les millions de morts inutiles en Ukraine, alors que les victimes civiles de la vengeance israélienne, après l’épouvantable pogrom qu’on sait, dépassent désormais les plus de 100.000 morts rien qu’à Gaza - bref les gars nous ne nous mêlons pas de ça mais faut pas exagérer, j’te dis que ça - enfin honte à ceux qui taxent de traîtrise les pacifistes... -
Vitalie
 (En mémoire de nos mères)La mère toute cousue de noirveille sur le sommeilde ses garçons sans discipline,la mère contre la ruine,sévère envoyée des Seigneursse débat très énormémentpour ses deux garnementsdont les rêves hélassont marqués au sceau de Satan …Cependant jamais rien ne lassela gendarme éternelleaux arrêts redoutés des rebelles -ces deux-là se prélassentmais en elle comme une grâcebrandit là sa chandelle…Le grand Caïn est un violentqui l’emporte à tout coupquand Abel tout à l’enversse perd les yeux au cieldont le bleu n’est pas du Vrai Dieu;et voici que son frère aîné,que sa douceur excèdeva pour lever la main sur lui,mais le Livre ne dira pasque Mother était là…Chaque fois qu’Arthur lui revient ,Vitalie se souvientqu’en amour tout s’oublie,et que je te rouvre mes braset qu’avec l’autre filleet le grand frère scélérat,jouant à la famille,nous fassions meilleure figurequ’en vos littératures…Au vrai Rimbaud était un saint,confiera Vitalie aux médiasd'estomacs à jamais friandsde ces révélations qu’on avaleet publie à l’avalde tout philistin qui ne voiten la satanée poésiequ’une divine catin...Image: Vitalie Cuif, Madame Rimbaud.
(En mémoire de nos mères)La mère toute cousue de noirveille sur le sommeilde ses garçons sans discipline,la mère contre la ruine,sévère envoyée des Seigneursse débat très énormémentpour ses deux garnementsdont les rêves hélassont marqués au sceau de Satan …Cependant jamais rien ne lassela gendarme éternelleaux arrêts redoutés des rebelles -ces deux-là se prélassentmais en elle comme une grâcebrandit là sa chandelle…Le grand Caïn est un violentqui l’emporte à tout coupquand Abel tout à l’enversse perd les yeux au cieldont le bleu n’est pas du Vrai Dieu;et voici que son frère aîné,que sa douceur excèdeva pour lever la main sur lui,mais le Livre ne dira pasque Mother était là…Chaque fois qu’Arthur lui revient ,Vitalie se souvientqu’en amour tout s’oublie,et que je te rouvre mes braset qu’avec l’autre filleet le grand frère scélérat,jouant à la famille,nous fassions meilleure figurequ’en vos littératures…Au vrai Rimbaud était un saint,confiera Vitalie aux médiasd'estomacs à jamais friandsde ces révélations qu’on avaleet publie à l’avalde tout philistin qui ne voiten la satanée poésiequ’une divine catin...Image: Vitalie Cuif, Madame Rimbaud. -
L'AB
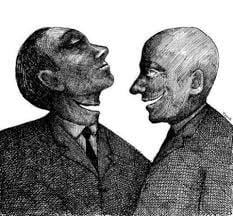 Frères et sœurs(Chronique des tribus)58.Au début du téléphone des deux cardiopathes, les voix grelottent un peu, on dirait que ça ne va pas fort et peut-être pire, on dirait qu’ils tremblotent un peu de se parler après tant de semaines et de mois à ne plus se donner de nouvelles, l’AB t’avait dit qu’il te rappelait donc tu attendais que pour une fois il tienne parole, tu lui en voulais du fait que c’était toujours toi qui le relançait, tu avais l’impression que, comme son ami Jaccottet, il n’en avait plus rien à faire des gens même si tu savais qu’il voyait sa sœur et Dieu sait qui, Jaccottet lui-même t’avait écrit qu’il faudrait désormais le tenir pour défunté, et ça t’avait paru de la pose de vieille peau morose avec quelque chose d’aigre que tu t’efforçais pour ta part de ne pas te permettre (maigrir volontiers mais ne jamais s’aigrir était ta devise), et voilà que l’AB te laisse un message chevrotant comme quoi il a appris par notre ami commun le Marquis qu’après son opération du cœur à lui c’est toi qui a failli y passer, comme on dit, mais mais mais que vous arrive-t-il, mais mais mais comme je pense à vous, et surtout ne vous fatiguez pas à me rappeler, donc je le rappelle fissa vu que c’est lui qui a fait le pas et le début de l’échange se fait donc entre deux vieilles ganaches amoindries, à ce qui semble, hélas je suis bien fatigué se lamente L’AB qui a l’excuse d’avoir passé le cap des nonante-deux ans, et toi tu te plains de tes jambes qui auront huitante ans dans deux ans alors que tu te sens le cœur d’un enfant de sept ans et l’esprit d’un bravache de seize à vingt ans, et rien que d'entendre ça le fait réagir et sa voix s’éclaire, voilà mon Gilbert qui repique et me demande des nouvelles de la tribu et des petits, ça c’est tout à fait lui, plus tard il te demanderas si tu écris toujours des poèmes et si tu voudrais bien lui en envoyer un de sept en quatorze, mais pour l’instant c’est des petits, de tes filles et des petits qu’il réclame des nouvelles, et c’est d’autant plus curieux que jamais il n’a vu ni les unes ni les autres, ça reste comme s’il te demandait des nouvelles des anges ou des mésanges de vos jardins, il est comme ça l’AB, il reste le fils de la vieille paysanne du Jorat ne voyant pas plus loin que son enclos et répétant à tout moment que tout est vanité des vanité dans ce monde vaniteux sauf la santé des enfants, et plus vous parlez plus vos deux voix se réveillent et s’affermissent, à un moment vous vous mettez carrément en colère en désignant ces fous de Trump et Poutine, comme deux fichus saligots, vous convenez que tout va de travers de par le monde mais décidez bientôt de revenir à ce qui vous a rapproché il y a tellement d’années, n’est-ce pas, les livres et les tableaux, toute une petite société civilisée d’artistes et de poètes, et là vos deux voix retrouvent plus encore de lumière, tu te rappelles la belle lettre que tu as reçue à propos de ton premier livre, et c’était l’AB, et lui se souvient que tu avais à cette époque de longs cheveux d’Indien et des pantalons rouges qui avaient éberlué le cher Gustave Roud quand vous vous étiez pointés ensemble dans sa cuisine où sa sœur vous avait fait goûter de sa tarte aux pruneaux, et de fil en fuseau vous repartez pour un de ces téléphones à n’en plus finir où vous allez parler de tout et de rien en évitant les thèmes assommants de l’Être étant et du Non-être n’étant pas, vos deux voix se font de plus en plus légères, vous radotez un peu et en serez bientôt aux ragots revigorants, vous vous sentez fringants, puis ça redevient plus intime et plus grave, à un moment donné l’AB te dit que l’avantage du grand âge est de te faire de la mort une idée plus aimable, alors tu lui dis comme ça qu’à la voix il fait plus jeune que son âge, et là vous pressentez que ça va tourner aux trop définitives pensées et vous y allez donc decrescendo avant de conclure sans pontifier : on se rappelle, promis-juré, etc.Dessin: Roland Topor.
Frères et sœurs(Chronique des tribus)58.Au début du téléphone des deux cardiopathes, les voix grelottent un peu, on dirait que ça ne va pas fort et peut-être pire, on dirait qu’ils tremblotent un peu de se parler après tant de semaines et de mois à ne plus se donner de nouvelles, l’AB t’avait dit qu’il te rappelait donc tu attendais que pour une fois il tienne parole, tu lui en voulais du fait que c’était toujours toi qui le relançait, tu avais l’impression que, comme son ami Jaccottet, il n’en avait plus rien à faire des gens même si tu savais qu’il voyait sa sœur et Dieu sait qui, Jaccottet lui-même t’avait écrit qu’il faudrait désormais le tenir pour défunté, et ça t’avait paru de la pose de vieille peau morose avec quelque chose d’aigre que tu t’efforçais pour ta part de ne pas te permettre (maigrir volontiers mais ne jamais s’aigrir était ta devise), et voilà que l’AB te laisse un message chevrotant comme quoi il a appris par notre ami commun le Marquis qu’après son opération du cœur à lui c’est toi qui a failli y passer, comme on dit, mais mais mais que vous arrive-t-il, mais mais mais comme je pense à vous, et surtout ne vous fatiguez pas à me rappeler, donc je le rappelle fissa vu que c’est lui qui a fait le pas et le début de l’échange se fait donc entre deux vieilles ganaches amoindries, à ce qui semble, hélas je suis bien fatigué se lamente L’AB qui a l’excuse d’avoir passé le cap des nonante-deux ans, et toi tu te plains de tes jambes qui auront huitante ans dans deux ans alors que tu te sens le cœur d’un enfant de sept ans et l’esprit d’un bravache de seize à vingt ans, et rien que d'entendre ça le fait réagir et sa voix s’éclaire, voilà mon Gilbert qui repique et me demande des nouvelles de la tribu et des petits, ça c’est tout à fait lui, plus tard il te demanderas si tu écris toujours des poèmes et si tu voudrais bien lui en envoyer un de sept en quatorze, mais pour l’instant c’est des petits, de tes filles et des petits qu’il réclame des nouvelles, et c’est d’autant plus curieux que jamais il n’a vu ni les unes ni les autres, ça reste comme s’il te demandait des nouvelles des anges ou des mésanges de vos jardins, il est comme ça l’AB, il reste le fils de la vieille paysanne du Jorat ne voyant pas plus loin que son enclos et répétant à tout moment que tout est vanité des vanité dans ce monde vaniteux sauf la santé des enfants, et plus vous parlez plus vos deux voix se réveillent et s’affermissent, à un moment vous vous mettez carrément en colère en désignant ces fous de Trump et Poutine, comme deux fichus saligots, vous convenez que tout va de travers de par le monde mais décidez bientôt de revenir à ce qui vous a rapproché il y a tellement d’années, n’est-ce pas, les livres et les tableaux, toute une petite société civilisée d’artistes et de poètes, et là vos deux voix retrouvent plus encore de lumière, tu te rappelles la belle lettre que tu as reçue à propos de ton premier livre, et c’était l’AB, et lui se souvient que tu avais à cette époque de longs cheveux d’Indien et des pantalons rouges qui avaient éberlué le cher Gustave Roud quand vous vous étiez pointés ensemble dans sa cuisine où sa sœur vous avait fait goûter de sa tarte aux pruneaux, et de fil en fuseau vous repartez pour un de ces téléphones à n’en plus finir où vous allez parler de tout et de rien en évitant les thèmes assommants de l’Être étant et du Non-être n’étant pas, vos deux voix se font de plus en plus légères, vous radotez un peu et en serez bientôt aux ragots revigorants, vous vous sentez fringants, puis ça redevient plus intime et plus grave, à un moment donné l’AB te dit que l’avantage du grand âge est de te faire de la mort une idée plus aimable, alors tu lui dis comme ça qu’à la voix il fait plus jeune que son âge, et là vous pressentez que ça va tourner aux trop définitives pensées et vous y allez donc decrescendo avant de conclure sans pontifier : on se rappelle, promis-juré, etc.Dessin: Roland Topor. -
Kitsch et kitsch
 Frères et sœurs(Chronique des tribus)57Lorsque l’Amico se met en peine, imaginant qu’une Italienne d’adoption en jugera mieux que lui, de parler à l’Amica du film à la fois tape-à-l’œil, séduisant et provocateur sur les bords, voulu riche de symboles et de connotations, mais sonnant le creux, que Paolo Sorrentino a signé sous le titre de Parthenope (le prénom éponyme de Naples évoquant une sirène virginale), l’Amica l’interrompt en lui avouant qu’elle en est restée à la 55e minute du film visionné sur Netflix, et pas sur grand écran comme son interlocuteur, mais le même qualificatif leur vient à propos de cet étalage d’esthétisme léché et de figures convenues, à savoir le mot kitsch, et l’Amica convient, par rapport à l’élan enthousiastique du jeune Corentin se déclarant illico amoureux de la belle Celeste della porta, qu’une femme réagit différemment d’un mec devant la beauté féminine même aussi indéniable en l’occurrence, mais la beauté qui se pavane, la beauté juste intelligente comme une étudiante à la coule mais d’une arrogance pédante, la beauté sans faille ni tendresse, la beauté juste belle n’est qu’un cliché de beauté et sans humour, sans recul sur elle-même (sauf à la toute fin du film il est vrai), et l’Amico, à propos de cette notion de kitsch, en vient à comparer celui de Parthenope à celui, candide et délicieux dans sa modulation de naïveté populaire, d’un des premiers films de Fellini intitulé Le Sheik blanc, avec un Alberto Sordi kitschissime et une visée visant précisément à « retourner » le cliché des fumetti, ces romans-photos de notre jeunesse ruisselant de sentimentalité et de romantisme à la flan. Autant dire qu’il y a kitsch et kitsch, et que distinguer l’un de l’autre revient en somme à distinguer le beau du joli, en se rappelant la sentence selon laquelle le bourgeois, et plus encore le petit bourgeois, trouve beau ce qui est joli (le chevreuil au bois ou le poulbot de la Butte) et joli ce qui est beau (disons la Joconde pour mettre le cliché en abyme), et l’on verra dans le film de Sorrentino Parthenope « casser le code » en trouvant de la beauté au prêtre libidineux à gueule de porc et à l’enfant monstre à corps de pachyderme et tête de souriceau… Or le kitsch artificieux, le kitsch de la pensée qui pose, le kitsch de la charge satirique sans humour prédominent hélas dans Parthenope, alors que le kitsch du Sheik blanc, comme le kitsch du Satyricon du même Fellini, voire le kitsch de La Mort à Venise de Visconti, et celui du magnifique Senso, touchent à la vraie beauté par delà le cliché…
Frères et sœurs(Chronique des tribus)57Lorsque l’Amico se met en peine, imaginant qu’une Italienne d’adoption en jugera mieux que lui, de parler à l’Amica du film à la fois tape-à-l’œil, séduisant et provocateur sur les bords, voulu riche de symboles et de connotations, mais sonnant le creux, que Paolo Sorrentino a signé sous le titre de Parthenope (le prénom éponyme de Naples évoquant une sirène virginale), l’Amica l’interrompt en lui avouant qu’elle en est restée à la 55e minute du film visionné sur Netflix, et pas sur grand écran comme son interlocuteur, mais le même qualificatif leur vient à propos de cet étalage d’esthétisme léché et de figures convenues, à savoir le mot kitsch, et l’Amica convient, par rapport à l’élan enthousiastique du jeune Corentin se déclarant illico amoureux de la belle Celeste della porta, qu’une femme réagit différemment d’un mec devant la beauté féminine même aussi indéniable en l’occurrence, mais la beauté qui se pavane, la beauté juste intelligente comme une étudiante à la coule mais d’une arrogance pédante, la beauté sans faille ni tendresse, la beauté juste belle n’est qu’un cliché de beauté et sans humour, sans recul sur elle-même (sauf à la toute fin du film il est vrai), et l’Amico, à propos de cette notion de kitsch, en vient à comparer celui de Parthenope à celui, candide et délicieux dans sa modulation de naïveté populaire, d’un des premiers films de Fellini intitulé Le Sheik blanc, avec un Alberto Sordi kitschissime et une visée visant précisément à « retourner » le cliché des fumetti, ces romans-photos de notre jeunesse ruisselant de sentimentalité et de romantisme à la flan. Autant dire qu’il y a kitsch et kitsch, et que distinguer l’un de l’autre revient en somme à distinguer le beau du joli, en se rappelant la sentence selon laquelle le bourgeois, et plus encore le petit bourgeois, trouve beau ce qui est joli (le chevreuil au bois ou le poulbot de la Butte) et joli ce qui est beau (disons la Joconde pour mettre le cliché en abyme), et l’on verra dans le film de Sorrentino Parthenope « casser le code » en trouvant de la beauté au prêtre libidineux à gueule de porc et à l’enfant monstre à corps de pachyderme et tête de souriceau… Or le kitsch artificieux, le kitsch de la pensée qui pose, le kitsch de la charge satirique sans humour prédominent hélas dans Parthenope, alors que le kitsch du Sheik blanc, comme le kitsch du Satyricon du même Fellini, voire le kitsch de La Mort à Venise de Visconti, et celui du magnifique Senso, touchent à la vraie beauté par delà le cliché… -
Au revoir tristesse
 Frères et sœurs(Chronique des tribus)56Pour lui, qui a parfois rêvé de s’établir sur les hauts de Positano, pas loin du palazzo suspendu du terrible Gore Vidal au port de prince lettré à longs tifs argentés - il a fantasmé les formidables échanges qu’ils eussent alors pu avoir sur fond de ciels marins - , la tonalité majeure de Naples a quelque chose d’africain plus que de baroque, que lui évoquent les cantilènes sauvages de la Nuova Compagnia di Canto popolare, et c’est donc une sorte de sous-produit édulcoré que lui paraissent les flatteuse images paysagères du film que lui a recommandé la veille son veriPote Corentin, tombé raide amoureux de l’actrice principale au nom (dans le film) de Parthenope (Celeste della Porta au générique) , indéniable princesse de magazine mais qui n’a pas l’heur de le troubler, lui, le moins du monde, alors que Monica Vitti, n’est-ce pas, que la Magnani ou la Mangano, que l’Alida Valli de Senso, et quelques autres, vivaient du regard et bougeaient de façon tellement plus mémorable que cette beauté toute de grâce et de fluidité, certes, mais sans beaucoup de consistance et parlant comme un recueil de sentences et ne se trouvant jamais, pas plus d’ailleurs que les autres personnages, développée en tant que figure féminine à réelles dimensions psychologiques et affectives, guère plus qu’une surface n’était sa façon de se dérober et de jouer parfois de paradoxes insolents plus abrupts et attirants ou, au fil des confrontations (d’abord avec la diva Greta Cool insultant à bon escient les Napolitains à en perdre ses cheveux postiches, puis avec la théâtreuse masquée, puis avec le prêtre « démoniaque », enfin avec le monstrueux enfant handicapé à l’aspect de baby pachydermique caché par son père le prof d’anthropologie de Parthenope – figure paternelle échappant aux paresses du scénario qui plombent en revanche le frère suicidé et l’écrivain américain de passage John Cheever campé par Gary Oldman et qui eût pu faire un si surprenant protagoniste... bref l’enthousiasme de Corentin n’est pas vraiment partagé même si la fin du film, comme en perspective cavalière, dégage un certain relent de mélancolie sonnant plus juste et ressortissant à ce que Luc Dietrich appelait le « bonheur des tristes » - et voilà que le jeune auteur annonce le projet de titre de son prochain livre à paraître à la fin de l’été, vraiment très bien trouvé lui dit son veriPote qui en déjà lu (et très prisé) le premier jet, à savoir La fin de la tristesse…
Frères et sœurs(Chronique des tribus)56Pour lui, qui a parfois rêvé de s’établir sur les hauts de Positano, pas loin du palazzo suspendu du terrible Gore Vidal au port de prince lettré à longs tifs argentés - il a fantasmé les formidables échanges qu’ils eussent alors pu avoir sur fond de ciels marins - , la tonalité majeure de Naples a quelque chose d’africain plus que de baroque, que lui évoquent les cantilènes sauvages de la Nuova Compagnia di Canto popolare, et c’est donc une sorte de sous-produit édulcoré que lui paraissent les flatteuse images paysagères du film que lui a recommandé la veille son veriPote Corentin, tombé raide amoureux de l’actrice principale au nom (dans le film) de Parthenope (Celeste della Porta au générique) , indéniable princesse de magazine mais qui n’a pas l’heur de le troubler, lui, le moins du monde, alors que Monica Vitti, n’est-ce pas, que la Magnani ou la Mangano, que l’Alida Valli de Senso, et quelques autres, vivaient du regard et bougeaient de façon tellement plus mémorable que cette beauté toute de grâce et de fluidité, certes, mais sans beaucoup de consistance et parlant comme un recueil de sentences et ne se trouvant jamais, pas plus d’ailleurs que les autres personnages, développée en tant que figure féminine à réelles dimensions psychologiques et affectives, guère plus qu’une surface n’était sa façon de se dérober et de jouer parfois de paradoxes insolents plus abrupts et attirants ou, au fil des confrontations (d’abord avec la diva Greta Cool insultant à bon escient les Napolitains à en perdre ses cheveux postiches, puis avec la théâtreuse masquée, puis avec le prêtre « démoniaque », enfin avec le monstrueux enfant handicapé à l’aspect de baby pachydermique caché par son père le prof d’anthropologie de Parthenope – figure paternelle échappant aux paresses du scénario qui plombent en revanche le frère suicidé et l’écrivain américain de passage John Cheever campé par Gary Oldman et qui eût pu faire un si surprenant protagoniste... bref l’enthousiasme de Corentin n’est pas vraiment partagé même si la fin du film, comme en perspective cavalière, dégage un certain relent de mélancolie sonnant plus juste et ressortissant à ce que Luc Dietrich appelait le « bonheur des tristes » - et voilà que le jeune auteur annonce le projet de titre de son prochain livre à paraître à la fin de l’été, vraiment très bien trouvé lui dit son veriPote qui en déjà lu (et très prisé) le premier jet, à savoir La fin de la tristesse…
-
Abjection à la vaudoise
 Frères et sœurs(Chronique des tribus)55Quand l’Amico raconte, à l’Amica, l’épisode des tags antisémites qui ont souillé les vitrines de la ville vaudoise de Payerne, lors de la récente célébration de la fête locale dite des Brandons, il parle évidemment à une convaincue puisque la Professorella a signé un livre tout consacré à Maître Jacques, lui-même auteur d’ Un juif pour l’exemple, dans lequel est relaté l’abominable exécution du marchand de bestiaux Arthur Bloch, en 1942, et plus encore du fait que, dans un essai documentaire composé avec son ami Fabio Ciaralli, elle a étudié les multiples aspects de l’antisémitisme « historique », des Pères de l’Eglise à Luther entre autres fourriers de la haine pour les « déicides », mais elle tombe des nues quand l’Amico détaille la pleutrerie des réactions « officielles » devant l’indignation de ceux qu’ont choqué les infâmes inscriptions, comme s’il était en somme admissible, au titre du « flou de la satire » et des « sensibilités différentes », de laisser l’espace public salopé par des ordures cautionnées par autant d’imbéciles - la vitrine de tel commerce payernois appartenant à un juif ayant droit aux mots « liquidation finale » et tel autre évoquant les blattes qu’on gaze !Mais aussi révoltante que l’initiative des tagueurs « masqués » (sic) paraît la réaction quasi débonnaire des responsables locaux avouant qu’ils ont « hésité » avant de se dire qu’en somme « ça pouvait passer », suscitant du moins la réaction de quelques élus locaux, mais à peu près rien de plus que « pas grand-chose à voir » dans les médias cantonaux, à croire vois-tu qu’on avait « comme que comme » l’habitude avec ces nez crochus – l’abjection à la bonne vaudoise fait d’ailleurs partie de nos traditions : l’Amico rappelle à l’Amica la page pleine intitulée Défie-toi du Juif parue en 1932 sous la signature du bâtonnier Regamey dans la très vaudoise Nation, mais voici que notre cher Corentin, pourtant Vaudois de souche, s’agite sur Facebook et que des commentaires virulents lui faisant écho rappellent bel et bien la gravité scandaleuse de l’incident - eh voilà que « ça ne passe pas »…
Frères et sœurs(Chronique des tribus)55Quand l’Amico raconte, à l’Amica, l’épisode des tags antisémites qui ont souillé les vitrines de la ville vaudoise de Payerne, lors de la récente célébration de la fête locale dite des Brandons, il parle évidemment à une convaincue puisque la Professorella a signé un livre tout consacré à Maître Jacques, lui-même auteur d’ Un juif pour l’exemple, dans lequel est relaté l’abominable exécution du marchand de bestiaux Arthur Bloch, en 1942, et plus encore du fait que, dans un essai documentaire composé avec son ami Fabio Ciaralli, elle a étudié les multiples aspects de l’antisémitisme « historique », des Pères de l’Eglise à Luther entre autres fourriers de la haine pour les « déicides », mais elle tombe des nues quand l’Amico détaille la pleutrerie des réactions « officielles » devant l’indignation de ceux qu’ont choqué les infâmes inscriptions, comme s’il était en somme admissible, au titre du « flou de la satire » et des « sensibilités différentes », de laisser l’espace public salopé par des ordures cautionnées par autant d’imbéciles - la vitrine de tel commerce payernois appartenant à un juif ayant droit aux mots « liquidation finale » et tel autre évoquant les blattes qu’on gaze !Mais aussi révoltante que l’initiative des tagueurs « masqués » (sic) paraît la réaction quasi débonnaire des responsables locaux avouant qu’ils ont « hésité » avant de se dire qu’en somme « ça pouvait passer », suscitant du moins la réaction de quelques élus locaux, mais à peu près rien de plus que « pas grand-chose à voir » dans les médias cantonaux, à croire vois-tu qu’on avait « comme que comme » l’habitude avec ces nez crochus – l’abjection à la bonne vaudoise fait d’ailleurs partie de nos traditions : l’Amico rappelle à l’Amica la page pleine intitulée Défie-toi du Juif parue en 1932 sous la signature du bâtonnier Regamey dans la très vaudoise Nation, mais voici que notre cher Corentin, pourtant Vaudois de souche, s’agite sur Facebook et que des commentaires virulents lui faisant écho rappellent bel et bien la gravité scandaleuse de l’incident - eh voilà que « ça ne passe pas »… -
VeriPote
 Frères et sœurs(Chronique des tribus)54L’autre soir sur Whatsapp, l’Amico demande à l’Amica d’évaluer, sur une échelle de 100, ce qu’elle estime le chiffre juste qui puisse situer le niveau de qualité de leur amitié, et l’Amica sans réfléchir lui balance la réponse de 77, correspondant à son âge actuel, avant de lui demander ce qui diable lui passe par la tête, et l’Amico lui dit alors qu’il est en train de lire un roman américain traitant de l’emprise du numérique sur nos vies et d’un application particulière établie à partir du constat de certains scientifique avérant le fait que les personnes qui ont de vrais amis de longue date vivent en meilleure santé et sont plus heureuses, étant entendu que ce n’est pas le nombre d’amis qu’il faut prendre en compte (l’Amico se garderait bien de se vanter qu’il a 5000 amis sur Facebook), donc la quantité, mais la qualité de ces amitiés qui peut s’évaluer avec le soutien de l’IA (pour ce qui concerne les expressions faciales et les intonations vocales de chaque interaction), et là on entend l’Amica soupirer sur Whatsapp et se féliciter de n’être pas connectée à l’appli AuthenticAmi qui serait en mesure de tester exactement son amitié pour l’Amico avec ses capteurs de réelle franchise, de réelle sincérité et de réelle sympathie, et l’Amico rit sous cape en se figurant la perplexité vieux jeu de l’Amica, dont il estime le chiffre bien supérieur au 77 annoncé (il voit en elle une sorte de grande sœur à qui il peut tout dire même le pire qu’il n'oserait déballer à ses sœurs biologiques aînée et puînée), sur quoi l’Amica lui demande de la rassurer en l’assurant de cela qu’il n’accorde aucune importance réelle à ces estimations et autres statistiques à la mords-moi, et l’Amico se rappelle alors les récits que lui faisait l’Amica de ses observations à la faculté où elle enseignait, constatant l’incapacité des ses étudiants en littérature fine à définir, précisément les notions et nuances distinguant les réalités de l’amitié et de la dilection sympathique, de la passion ou de l’émotivité compulsive, sans parler des degrés (au sens shakespearien de degree subtilement hiérarchisé ) de l’Amour avec un petit ou un grand A - et quels rires ils avaient alors partagés, comme ce soir il rit de tout ça avec son ami Corentin, le seul jeune écrivain de sa connaissance avec lequel, comme avec l’Amica, il puisse parler tout librement, et sur la base d’une expérience déjà crédible en termes de psychologie scientifique – le lascar est un amoureux avéré depuis sa treizième année et sa connaissance en matière de rupture en fait notamment une sorte d’expert, ses romans traitent plus particulièrement du thème de ce qu’on peut dire l’Amour qui n’est pas aimé, la passion vive mais sans vraie réciprocité, Corentin passe parfois pour un jeune cynique désabusé alors qu’il est un cœur tendre et limite romantique, et en amitié un mec fiable qui passerait tous les tests de qualité, et là l’Amico en revient aux critères détaillés par le roman américain qui situe la soirée qu’ils viennent de passer, au bien nommé Café des Amis, au top niveau de l’appli VeriPote…Image JLK: Corentin au Café des amis, l'autre soir.
Frères et sœurs(Chronique des tribus)54L’autre soir sur Whatsapp, l’Amico demande à l’Amica d’évaluer, sur une échelle de 100, ce qu’elle estime le chiffre juste qui puisse situer le niveau de qualité de leur amitié, et l’Amica sans réfléchir lui balance la réponse de 77, correspondant à son âge actuel, avant de lui demander ce qui diable lui passe par la tête, et l’Amico lui dit alors qu’il est en train de lire un roman américain traitant de l’emprise du numérique sur nos vies et d’un application particulière établie à partir du constat de certains scientifique avérant le fait que les personnes qui ont de vrais amis de longue date vivent en meilleure santé et sont plus heureuses, étant entendu que ce n’est pas le nombre d’amis qu’il faut prendre en compte (l’Amico se garderait bien de se vanter qu’il a 5000 amis sur Facebook), donc la quantité, mais la qualité de ces amitiés qui peut s’évaluer avec le soutien de l’IA (pour ce qui concerne les expressions faciales et les intonations vocales de chaque interaction), et là on entend l’Amica soupirer sur Whatsapp et se féliciter de n’être pas connectée à l’appli AuthenticAmi qui serait en mesure de tester exactement son amitié pour l’Amico avec ses capteurs de réelle franchise, de réelle sincérité et de réelle sympathie, et l’Amico rit sous cape en se figurant la perplexité vieux jeu de l’Amica, dont il estime le chiffre bien supérieur au 77 annoncé (il voit en elle une sorte de grande sœur à qui il peut tout dire même le pire qu’il n'oserait déballer à ses sœurs biologiques aînée et puînée), sur quoi l’Amica lui demande de la rassurer en l’assurant de cela qu’il n’accorde aucune importance réelle à ces estimations et autres statistiques à la mords-moi, et l’Amico se rappelle alors les récits que lui faisait l’Amica de ses observations à la faculté où elle enseignait, constatant l’incapacité des ses étudiants en littérature fine à définir, précisément les notions et nuances distinguant les réalités de l’amitié et de la dilection sympathique, de la passion ou de l’émotivité compulsive, sans parler des degrés (au sens shakespearien de degree subtilement hiérarchisé ) de l’Amour avec un petit ou un grand A - et quels rires ils avaient alors partagés, comme ce soir il rit de tout ça avec son ami Corentin, le seul jeune écrivain de sa connaissance avec lequel, comme avec l’Amica, il puisse parler tout librement, et sur la base d’une expérience déjà crédible en termes de psychologie scientifique – le lascar est un amoureux avéré depuis sa treizième année et sa connaissance en matière de rupture en fait notamment une sorte d’expert, ses romans traitent plus particulièrement du thème de ce qu’on peut dire l’Amour qui n’est pas aimé, la passion vive mais sans vraie réciprocité, Corentin passe parfois pour un jeune cynique désabusé alors qu’il est un cœur tendre et limite romantique, et en amitié un mec fiable qui passerait tous les tests de qualité, et là l’Amico en revient aux critères détaillés par le roman américain qui situe la soirée qu’ils viennent de passer, au bien nommé Café des Amis, au top niveau de l’appli VeriPote…Image JLK: Corentin au Café des amis, l'autre soir. -
Pater noster
 Frères et sœurs(Chronique des tribus)53Sa sœur puînée lui ayant rappelé, l’autre soir, que la date du 6 mars coïncidait, 42 ans après, avec le dernier dimanche qu’ils avaient passé, la petite tribu, autour de leur père, le fils cardiopathe, écrivain à ses heures, retrouve l’évocation qu’il a faite de ce jour d’entre les jours, intitulée Tous les jours mourir, tout en se rappelant la fin de vie de son paternel, entre parties de tennis et séjour à deux dans la petite maison de la Costa Brava, ou comme une amitié s’était fortifiée entre eux sans beaucoup de confidences pour autant - sans être taiseux, le cher homme était à la fois réservé, timide et discret -, et plus que jamais, aujourd’hui, le fils mesure et apprécie combien la personne de son père, quasiment sans aucune injonction morale ou autre directive explicite, l’a marqué par ses vertus de modestie et d’intégrité, de mesure et de sens commun, mais aussi, comme par défaut, par l’excessive soumission à la conformité qui l’a sans doute empêché de se réaliser plus entièrement - lui qui rêvait de devenir architecte et que la volonté paternelle a écarté d’études trop onéreuses pour le contraindre à accomplir un apprentissage de commerce -, avant d’endosser des responsabilités familiales tôt marquées par la nécessité, l’économie dont sa conjointe serait la gardienne sourcilleuse, les contraintes extérieures aussi (la guerre, la mobilisation aux frontières, etc.) et les années passant, une accession au poste d’inspecteur de sinistres représentant à la fois une promotion notable et un accroissement de son stress personnel par l’obligation de lutter pied à pied, quotidiennement, avec des assurés neuchâtelois connus pour leur rapacité et leur mauvaise foi légendaire, puis avec des assurés valaisans non moins connus pour leur mauvaise foi et leur rapacité tutélaire, bref la retraite aura représenté pour leur cher père une délivrance idéale lui permettant de s’adonner plus tranquillement à ses diverses occupations de jardinage et de peinture sur porcelaine, et, plus que tout, d’accomplir avec leur mère de longs et fructueux voyages pleins d’enseignements divers avant les atteintes de l’âge et de la maladie qui ne l’auront jamais aigri ni éloigné non plus de ses enfants et autres rejetons auxquels il aura voué, toujours, la même bienveillante attention…Peinture: Robert Indermaur.
Frères et sœurs(Chronique des tribus)53Sa sœur puînée lui ayant rappelé, l’autre soir, que la date du 6 mars coïncidait, 42 ans après, avec le dernier dimanche qu’ils avaient passé, la petite tribu, autour de leur père, le fils cardiopathe, écrivain à ses heures, retrouve l’évocation qu’il a faite de ce jour d’entre les jours, intitulée Tous les jours mourir, tout en se rappelant la fin de vie de son paternel, entre parties de tennis et séjour à deux dans la petite maison de la Costa Brava, ou comme une amitié s’était fortifiée entre eux sans beaucoup de confidences pour autant - sans être taiseux, le cher homme était à la fois réservé, timide et discret -, et plus que jamais, aujourd’hui, le fils mesure et apprécie combien la personne de son père, quasiment sans aucune injonction morale ou autre directive explicite, l’a marqué par ses vertus de modestie et d’intégrité, de mesure et de sens commun, mais aussi, comme par défaut, par l’excessive soumission à la conformité qui l’a sans doute empêché de se réaliser plus entièrement - lui qui rêvait de devenir architecte et que la volonté paternelle a écarté d’études trop onéreuses pour le contraindre à accomplir un apprentissage de commerce -, avant d’endosser des responsabilités familiales tôt marquées par la nécessité, l’économie dont sa conjointe serait la gardienne sourcilleuse, les contraintes extérieures aussi (la guerre, la mobilisation aux frontières, etc.) et les années passant, une accession au poste d’inspecteur de sinistres représentant à la fois une promotion notable et un accroissement de son stress personnel par l’obligation de lutter pied à pied, quotidiennement, avec des assurés neuchâtelois connus pour leur rapacité et leur mauvaise foi légendaire, puis avec des assurés valaisans non moins connus pour leur mauvaise foi et leur rapacité tutélaire, bref la retraite aura représenté pour leur cher père une délivrance idéale lui permettant de s’adonner plus tranquillement à ses diverses occupations de jardinage et de peinture sur porcelaine, et, plus que tout, d’accomplir avec leur mère de longs et fructueux voyages pleins d’enseignements divers avant les atteintes de l’âge et de la maladie qui ne l’auront jamais aigri ni éloigné non plus de ses enfants et autres rejetons auxquels il aura voué, toujours, la même bienveillante attention…Peinture: Robert Indermaur. -
À jamais les toujours
 Ils s’étaient perdus en chemin,cela faisait du temps,de longues années quand,avant de se retrouver seuls,ils allaient par les prés,en bandes de petits banditschasser les abrutisdes quartiers ennemis jurés -les jurements de par le sangles liaient à jamais -enfin le jamais des enfants…D’aucuns ne comprendront jamaisla magie d’une fois :cette foi qu’on avaiten murmures sous le toit des draps:il était une fois…C’est une société cachéesous le couvert des mots.à demi-mot je te connais ,toi la sincérité,toi le bienveillant accueil ,toi le vieux camarade,toi la secrète confidencedéfiant la camarde,toi la chance donnée,toi le plus tendre conseiller,vous tous et vos toujours -enfin le toujours des vivants…
Ils s’étaient perdus en chemin,cela faisait du temps,de longues années quand,avant de se retrouver seuls,ils allaient par les prés,en bandes de petits banditschasser les abrutisdes quartiers ennemis jurés -les jurements de par le sangles liaient à jamais -enfin le jamais des enfants…D’aucuns ne comprendront jamaisla magie d’une fois :cette foi qu’on avaiten murmures sous le toit des draps:il était une fois…C’est une société cachéesous le couvert des mots.à demi-mot je te connais ,toi la sincérité,toi le bienveillant accueil ,toi le vieux camarade,toi la secrète confidencedéfiant la camarde,toi la chance donnée,toi le plus tendre conseiller,vous tous et vos toujours -enfin le toujours des vivants… -
Le plus doux parfum
 La vieille Rose s’en ira:c’est le plan général,les rosiers premiers affligésseront le plus à mal,mais pas un sanglot ne sourdralà-bas de leurs allées,ni des rangées de fraisiers,ni des halliers ni des ronciers -pas une larme-là,fors celle du jeune jardinierau regard d’épervieret au dehors tout parfumé -Céleste fleurant la rose …Céleste est un garçon modesteignorant l’Internet:sa mère l’a reçu comme un dondu surnommé Frelonbientôt reparti sous bannières’en mourir à la guerre -et tel est bien le plan fatalque Céleste dormant au valdéplore que ça fout mal -c’était sa mère et l’amertumele tue sur son enclume…Mais voici qu'à présent Roseau jardin se repose,se dit, en aparté,Céleste le doux jardinier,et le printemps dans le jardins’occupe à autre chose;il y a de la guerre au loinoù s’enivrent les pères,or Céleste s’en tientà jardiner loin des misères -Céleste est au parfum,et nulle rose n'a de fin…
La vieille Rose s’en ira:c’est le plan général,les rosiers premiers affligésseront le plus à mal,mais pas un sanglot ne sourdralà-bas de leurs allées,ni des rangées de fraisiers,ni des halliers ni des ronciers -pas une larme-là,fors celle du jeune jardinierau regard d’épervieret au dehors tout parfumé -Céleste fleurant la rose …Céleste est un garçon modesteignorant l’Internet:sa mère l’a reçu comme un dondu surnommé Frelonbientôt reparti sous bannières’en mourir à la guerre -et tel est bien le plan fatalque Céleste dormant au valdéplore que ça fout mal -c’était sa mère et l’amertumele tue sur son enclume…Mais voici qu'à présent Roseau jardin se repose,se dit, en aparté,Céleste le doux jardinier,et le printemps dans le jardins’occupe à autre chose;il y a de la guerre au loinoù s’enivrent les pères,or Céleste s’en tientà jardiner loin des misères -Céleste est au parfum,et nulle rose n'a de fin… -
Bacon
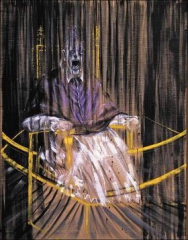
Leur cri dit une telle horreur
qu’aucun espace circonscrit,
chapelle vaticane ou palais babylonien,
ne peut le contenir sans la folle beauté
de la couleur à l’état pur.
Sur sa chaise électrique
le pape hurle à la vie,
tout à fait seul là-haut
dans ses marbres hallucinés,
et le chien martyrisé lui fait écho.
La mort n’est jamais invitée.
L’alcool fort et l’orgie de chair
illuminent le tableau.
L’atelier creuset de tout ça
est un bordel immonde,
mais de cette gadoue
est né l’enfant du monde. -
Jeunesse ne passe
 Je me sens tout amenuisé :considérant mes piedsétrangement plus près qu’hier,je flaire comme un rétractionde mon proche univers,et mes bras brassent plus étroit,et les murs étrécis,et l’énergie comme en sursis,les lointains s’éloignantà l’avenant des trainsqu’on entendra de moins en moins -les trains et les avions…Le vieux camelot me pince :il voudrait négocier :que je le douche et le rince,que je rende à ses piedsson ancienne élasticité,que je lui masse la férule,et l’aide à fausser les calculsalors que le pauvre se tassesous le poids de la guerre lasse,et voit sa vue comme embrumée,ses bras embrasser les nuéestandis que le sage ressasse :tout passe nom de Dieu…Mais à la fin vous m’ennuyezchante le beau ménestrel,à l’orée des bois écartésoù vont les demoiselleset les ardents déculottés,malicieux rebellesarrogants, infidèles,défiant les arrêts du Tempset souriant à Dieule voyeur féru d'anathèmes,adonnés à la seule Chosequi de la prose fait poème…
Je me sens tout amenuisé :considérant mes piedsétrangement plus près qu’hier,je flaire comme un rétractionde mon proche univers,et mes bras brassent plus étroit,et les murs étrécis,et l’énergie comme en sursis,les lointains s’éloignantà l’avenant des trainsqu’on entendra de moins en moins -les trains et les avions…Le vieux camelot me pince :il voudrait négocier :que je le douche et le rince,que je rende à ses piedsson ancienne élasticité,que je lui masse la férule,et l’aide à fausser les calculsalors que le pauvre se tassesous le poids de la guerre lasse,et voit sa vue comme embrumée,ses bras embrasser les nuéestandis que le sage ressasse :tout passe nom de Dieu…Mais à la fin vous m’ennuyezchante le beau ménestrel,à l’orée des bois écartésoù vont les demoiselleset les ardents déculottés,malicieux rebellesarrogants, infidèles,défiant les arrêts du Tempset souriant à Dieule voyeur féru d'anathèmes,adonnés à la seule Chosequi de la prose fait poème… -
L'art en Suisse ne fait pas le mort...

Dans L’Art suisse n’existe pas, l’historien de l’art Michel Thévoz va bien au-delà du paradoxe, en critique virulent des «vieux» poncifs académiques qui soumettent l’art aux idéologies religieuses ou politiques. Mais lui-même sature son discours de pieuses références aux dogmes du freudo-marxisme pimentés de citations de divers pontifes «modernes», de Bourdieu à Lacan. Ce qui n’empêche pas son livre d’être passionnant et de susciter la réflexion – même contradictoire.

Autant par son titre que par l’illustration de sa couverture, représentant une Étude de fesses signée Félix Vallotton, le dernier livre de Michel Thévoz se veut provocateur, appelant une réaction au premier degré de ceux qui se piquent de culture «nationale», voire nationaliste, Christoph Blocher en tête.
Les présumés Bons Suisses s’étrangleront ainsi d’indignation à la seule idée qu’on puisse dire que l’art suisse n’existe pas, comme en 1992, à l’occasion de l’Exposition universelle de Séville, le slogan lancé par le plasticien publicitaire Ben, La Suisse n’existe pas, les révulsa.
Enfin quoi, s’exclameront-ils: Albert Anker, Ferdinand Hodler, Félix Vallotton, Alberto Giacometti ne sont-ils pas la preuve que l’art suisse existe? Et, selon les cantons, les noms des Vaudois Alexandre Calame ou René Auberjonois, du symboliste grison Giovanni Segantini ou du gymnopédiste lucernois Hans Erni seront invoqués, entre cent autres, sans qu’on sache trop dire pour autant ce qu’il y a de spécifiquement suisse chez les uns et les autres, à part leur lieu de naissance et, pour certains, la représentation de tel paysage «typique» ou de telle «image du quotidien», etc.
Dans la même optique, si l’on excepte telle période significative (la Renaissance italienne ou le Siècle d’or espagnol) ou tel mouvement pictural particulier (l’abstraction lyrique américaine ou la trans-avant-garde italienne), qui dirait que l’art français ou allemand, autrichien ou portugais existent aujourd’hui plus que l’art suisse ?
 Giacometti rime-t-il avec Betty Bossi ?
Giacometti rime-t-il avec Betty Bossi ?Pour en revenir à celui-ci, quel rapport peut-il y avoir entre l’effigie toute souriante et positive de Betty Bossi, représentant par excellence la Suisse tip-top propre-en-ordre, et l’œuvre d’un Albert Giacometti fumant comme un turc dans son atelier parisien mal balayé?
Les seuls termes d’Art, synonyme de liberté créatrice plus ou moins anarchisante, et de Suisse, exemple mondial de discipline et d’honnête labeur, ne sont-ils pas incompatibles voire opposés à la base ? Et de telles questions ont-elles le moindre sens, aujourd’hui, au pays des nains de jardins consuméristes à outrance et des œuvres d’art planquées dans des safes bancaires zurichois ?
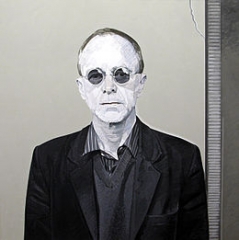
C’est du moins à les poser que Michel Thévoz s’affaire dès l’introduction de son dernier recueil d’essais aussi intéressant que souvent exaspérant par son jargon psychanalysant ou sociologisant et son esprit parfois réducteur.
S’agissant de l’apparente contradiction dans les termes que présente l’expression «l’art suisse», Thévoz constate d’abord qu’il est discutable d’affirmer que l’art, non conformiste par essence, ne peut être suisse au motif que ce qualificatif désigne tout le contraire, pour autant qu’on s’en tienne au cliché de cette Suisse-là, blanchie comme un paradis fiscal et fermée à toute folie créatrice.

Parce que celle-ci est bel et bien présente en Suisse, avec pas mal d’artistes et autant d’écrivains dont très peu se veulent porte-drapeaux, du génial Louis Soutter (dont Michel Thévoz est le spécialiste cantonal, voire national et même mondial) au non moins irrécupérable Robert Walser, entre autres.
Donc on pourrait dire que l’art suisse n’existe pas en tant que valeur nationale spécifique à marque identifiable, mais qu’il y a de l’art en Suisse. Belle découverte n’est-ce pas?! De la même façon, le dernier panorama de la littérature helvétique de langue française ne s’intitule pas Histoire de la littérature romande mais Histoire de la littérature en Suisse romande, etc.
Vivacité de la pulsion de mort…
Michel Thévoz, ensuite, cherchant tout de même un dénominateur commun entre les artistes de ce pays, croit en déceler un dans leur rapport avec la pulsion de mort, au sens freudo-lacanien, dont le premier exemple serait le très fameux cadavre du Christ au tombeau de Hans Holbein – maître ancien à vrai dire plus allemand que suisse si l’on se fie à son passeport –, et qui fit dire à Dostoïevski que cette figure cadavérique si terriblement réaliste – d’une mort si vivante pourrait-on dire – était propre à susciter l’athéisme plus que la foi…

L’exemple est assez probant dans le «discours» de Michel Thévoz, comme il le sera devant La Nuit non moins célèbre de Ferdinand Hodler, dont l’évocation de la mort est elle aussi artistiquement tellement «vivante», comme le seront aussi les portraits de sa maîtresse Valentine mourante, d’une si lancinante beauté.
Mais où est la «pulsion de mort» dans tant d’autres œuvres d’Holbein ou chez le dernier Hodler, libéré des carcans de la représentation historique ou «littéraire», quand il exulte dans la couleur de ses derniers paysages, quasiment abstraits et si merveilleusement vibrants et vivants?
Tel le critique évoqué par Julien Gracq dans La littérature à l’estomac, pamphlet mémorable, Michel Thévoz, pour se convaincre que la pulsion de mort est le «motif dans le tapis» de l’art suisse selon ses critères, me semble forger une clef et s’affaire ensuite à forcer les œuvres pour en faire des serrures adéquates.
Ainsi, de Charles Gleyre à Félix Vallotton, ou de Jean Lecoultre à Suzanne Auber, réduit-il volontiers les œuvres à leur aspect le plus «frigide» ou le plus funèbrement «absolu», surtout bon à étayer son discours.
Cependant il convient de noter que rien n’est aussi simple, et que l’intelligence très poreuse, et la grande érudition de Michel Thévoz en matière esthétique et littéraire, à quoi s’ajoutent une vraie passion et une certaine folie personnelle, une mauvaise foi d’époque et une expérience non moins appréciable «sur le terrain» en tant que conservateur (ex) de la collection de l’Art brut, nous valent des pages très pertinentes sur ce qu’on pourrait dire le «noyau» de l’art dégagé des mimétismes sociaux ou de toute «littérature».
Donc allons-y pour le critère «pulsion de mort», même s’il relève lui aussi, d’une littérature d’époque, avec ses énormités fleurant parfois la jobardise intellectuelle, pour le moins risibles.
 Anker pré-pédophile et Hodler «obscène» militariste?
Anker pré-pédophile et Hodler «obscène» militariste?Ainsi pouffera-t-on en lisant, dans le chapitre consacré à Albert Anker, que celui-ci, avec ses petites filles ravissantes et ses petits garçons aux joues roses, préfigurerait les lendemains pervers de la pédophilie, ou, à propos du dormeur éveillé de La Nuithodlérienne, que la noire figure de la mort serait en train de sucer le gisant barbu «sous le manteau».
Michel Thévoz se demande à plusieurs reprises, en intellectuel typique de notre temps, comment un Holbein, homme à femmes notoire, peut être crédible quand il «fait» dans l’art religieux, ou comment un Charles Gleyre, socialiste en ses idées, s’y retrouve dans sa peinture de pompier au tour si «réactionnaire»? De la même façon, Il lui semble surprenant qu’Hodler, « doué d’une prodigieuse intelligence visuelle», puisse illustrer une «phraséologie spiritualiste» et célébrer de façon «obscène» les vaillants mercenaires helvétiques de La Retraite de Marignan.

Autant se demander pourquoi le grand Rousseau fut un gigolo de bas étage dans sa vie privée, Marx le révolutionnaire un despote familial sordide et Ibsen, chantre du féminisme, un misogyne avéré dans ses rapports amoureux! Mais là encore Thévoz est plus fin que le philistin parfait, en matière d’art, que reste un Pierre Bourdieu, notamment à propos de l’immense Ferdinand Hodler.
Rétif, en artiste indomptable, à la notion nouvelle de progrès préfigurant le futur conformisme des avant-gardes acclimatées de la seconde moitié du XXe siècle, Hodler joue avec les poncifs de l’académisme, selon Thévoz, pour les «retourner» à sa façon. Ainsi, souligne le critique, «une référence passéiste retorse peut avoir des effets «objectivement» plus contestataires que des professions de foi révolutionnaires. Or, bien avant Hodler, des générations de génies picturaux ont déjoué la «littérature» idéologique, religieuse ou politique, par le langage irrécupérable de l’art.
De la langue «fasciste» à la vérité des poètes
Dans la foulée de Roland Barthes, qui voyait en la langue une réalité «fasciste» en cela qu’elle «formate» notre pensée et qu’elle discrimine, Michel Thévoz pousse le bouchon plus loin en affirmant que la langue est «structurellement capitaliste» et qu’on n’en sortira que par des «moyens d’expression moins catégoriaux», du côté des arts plastiques. Et de nous balancer cette pseudo-vérité combien rassurante selon laquelle le langage verbal, «de par sa nature assertive», serait moins à même d’exprimer la complexité du réel que les arts visuels.
Pourtant c’est bel et bien à un poète, Léon-Paul Fargue, que Thévoz emprunte une pensée valable et pour l’artiste et pour l’écrivain: «L’artiste contient l’intellectuel. La réciproque est rarement vraie». Du moins l’intellectuel Michel Thévoz a-t-il, parfois, le mérite d’écouter vraiment les artistes et d’en parler, ici et là, en homme sensible plus qu’en pion jargonnant.
Une Suisse, une Europe, un monde à réinventer…
Dans l’introduction de son livre, Michel Thévoz cite le plus artiste des philosophes contemporains, en la personne du penseur allemand Peter Sloterdijk. Quarante ans après la parution de L’Avenir est notre affaire de Denis de Rougemont, qui me dit alors en interview que la seule Europe en laquelle il croyait était l’Europe des cultures, Sloterdijk plaide lui aussi, comme son ami français Bruno Latour, pour une Europe des petites unités requalifiées dont la fédération s’opposerait aux grands ensembles des empires, où la culture de toutes les régions se revivifierait.

Dans un texte de 1914 intitulé Raison d’être, Ramuz, qui récusait l’idée même d’une «littérature suisse», invoquait son lieu d’élection et de possible expression dans la courbe d’un rivage, entre Cully et Rivaz, pour toucher peut-être à l’universel. À Saint-Saphorin, à un coup d’aile de Rivaz, se rencontrèrent Ramuz et Stravinski ou Charles-Albert Cingria et Paul Budry, mais aussi la flamboyante Lélo Fiaux et le poète vaudois anarchisant Jean-Vilard Gilles – bref, une flopée d’artistes et d’écrivains plus ou moins Suisses et plus ou moins bohèmes que Michel Thévoz aurait pu citer sur son tableau d’honneur, où le Lausannois Olivier Charles et le Genevois Thierry Vernet auraient fait aussi éclatante figure qu’un Karl Landolt prolongeant le lyrisme hodlérien au bord du lac de Zurich, ou que le Grison Robert Indermaur déployant, sur son coin de terre, tout proche du château de Blocher, sa fresque fellinienne d’une humanité américanisée en quête de nouvelles racines.
Tout cela qui n’a que peu à voir avec ce qu’est devenu l’art contemporain multinational du Grand Marché, qui trouve en Suisse son épicentre avec seize ports-francs hors douane. «On peut échanger une valise d’argent sale (pléonasme?) contre un Modigliani ou un Soutine qu’on prétendra avoir trouvé dans un grenier», commente Michel Thévoz avant d’ajouter en toute lucidité prosaïque: «Le marché de l’art, à l’instar du marché de la drogue, avec lequel il a d’ailleurs des accointances, a de quoi faire rêver les investisseurs: dégrevé de toute taxe et de toute réglementation, c’est l’application quintessenciée du néolibéralisme».
Autant dire alors que si l'art suisse n'existe pas, c'est tant mieux pour ces citoyens du monde que sont les artistes...
Michel Thévoz. L’Art suisse n’existe pas. Les Cahiers dessinés – Les écrits, 230p. 2018.
-
Soutine
Elle coule dans la maille d’un ocre rose veiné de bleu et ses lèvres sont déjà là comme un souvenir de baiser retenu d’une main molle.
Je lui sens le sexe partout, elle n’aurait pas eu besoin d’ôter son béret de surveillante d’internat ni son caraco, je lui sais les mollets d’une marcheuse et les chevilles des gardiennes de chèvres dans la montagne aux loups.
Je lui fais face comme le Signor Dottor Pirandello à sa chère démente, comme au groom de l’Excelsior que des messieurs invitent à des apartés dans les fourrures des hauts étages.
Je fais face à l’Humanité. Je me tiens au pied de la croix du Juif bouchoyé. Je prends naturellement, en ma paresse agitée, le parti des chiens errants et des enfants inquiets. A mon passage les paysages s’affolent. A mon apparition les maisons se disloquent et les couleurs flambent. Je reste du moins le scribe fidèle des visages et des livres de chair.
Tout est fixé, de fait, par mon regard aimant. J’aurais tout mis en place avant d’être déporté, mais Dieu n’a pas voulu de moi. J’avais la gueule de finir à Auschwitz et c’est par hasard seulement que mes croûtes ont échappé aux incendies.
-
Giton
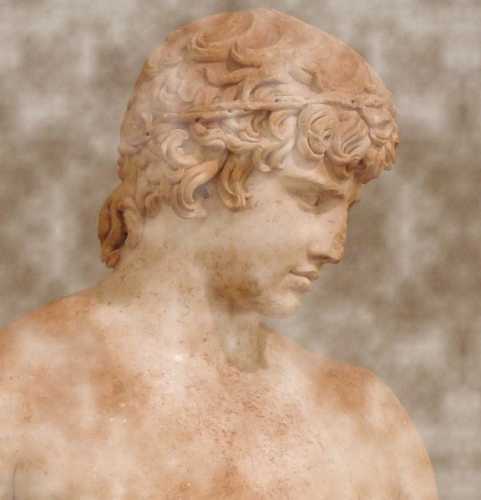
C'est typiquement les années 70 dans cet appart bohème de rêve du Square du Roule où la mère de Nora a planqué des Juifs. Il y a dans toutes les chambres des danseurs du Ballet du XXe siècle qui parlent Karma et se foutent de la vaisselle sale. Ils ont adopté celui que j'ai voituré à Paris, qu'on appelle Giton et qui adore se montrer à poil. Incontestablement un corps sublime, le profil du favori de l'empereur Hadrien, assez d'instinct pour ne pas trop déconner quand on parle politique ou philo, mais Béjart lui a déjà fait comprendre qu'il lui faudrait trimer dur pour devenir ce qui s'appelle un danseur.
Giton est en principe la chose de Nora, qui me fait comprendre à la cuisine qu'elle ne voit pas ça durer longtemps. Devant l'évier croûté de tartre on parle aussi de Gurdjieff et des groupes de Chandolin, puis du dernier festival d'Avignon où Germinal et Jorge ont fait merveille - entre autres trips.
Dans le métro le lendemain Giton me la joue bardache, mais son narcissisme me tue à la fin. Le dernier soir nous allons fumer du H dans une baignoire de l'Opéra (Die Walkyrie) et nous rentrons si claqués que je m'endors au volant à la hauteur d'Auxerre. Mon ange gardien reptilien me fait juste éviter le crash, et quelque temps après Giton se met à boire, se laisse pousser la barbe et se lance dans le commerce.
(Extrait de La Fée Valse)
-
Le stoppeur

De toute façon, c’est sûr, le stoppeur n’était qu’un prétexte.
Quand elle l’a fait monter, j’ai très bien senti que c’était pour me mettre à l’épreuve; et c’est vrai que ça m’a superexcitée de voir les épaules nues du mec dans le rétroviseur.
- Si tu t’étais vue le mater, qu’elle m’a fait le soir de son ton de sale bête d’intello ravagée, si t’avais vu ta gueule d’esclave hétéro. Non mais c’est vrai, ma pauvre toi: t’as encore vachement de travail sur toi question libération.
N’empêche que c’est moi que ça libérait, cette crise de jalousie. Je ne me le suis pas fait dire deux fois; et rien n’y a fait quand elle a senti que son plan se retournait contre elle: le soir même je retournais chez Bob qui ne s’est pas fait prier pour me laisser revoir ses épaules et tout le toutim.(Extrait de La Fée Valse)
-
Les Justes

…Et comme il y a une Trinité, nous sommes là, les Préférées du Seigneur, face à Lui, en pleine Lumière, tandis que les autres, celles qui Le regardent de biais, ou qui Lui tournent carrément le dos, ne sont encore que de pauvres chaises cannées qui se cherchent, ma foi…
Image : Philip Seelen -
Le noyau doux

Shakespeare en traversée
27. Henry VI /1
Au tout début de Shakespeare notre contemporain, son essai certes référentiel consacré au Barde, Ian Kott affirme que c'est par les drames historiques qu'il faut aborder Shakespeare, et cela se justifie sans doute dans l'optique d'une découverte progressive accordée au progrès chronologique de l'œuvre, du début à la fin.
De fait, on n'imagine pas le jeune Will écrire La Tempête à moins de trente ans, et le fait est que la structure dramatique et le contenu des premiers drames n'a pas la complexité ni la profondeur des chefs-d'œuvre de la maturité. N'empêche: finir là traversée de Shakespeare en abordant la première tétralogie historique, après les tragédies et les comédies, peut nous faire découvrir un fait essentiel: à savoir que, dès Henry VI se perçoit à la fois un noyau dur, qui est plus exactement un noyau doux, et cette voix sans pareille, basse continue ou mélodie pure , qui caractérisent le génie du Big Will.
Ian Kott établit, par manière de préambule à son approche des pièces historiques (il s'arrête essentiellement à Richard III), un inventaire généalogique de tous les meurtres royaux, trahisons et assassinats d'enfants au berceau ou de vénérables monarques des deux sexes, empoisonnements ou décapitations qui ont ensanglanté la chronique des dynasties anglaises au XVe siècle sur fond de guerres et d'épidémies affreuses, de crimes commis au nom du même Dieu, de rivalités éternelles et de sempiternelles délices.
La première partie d'Henry VI s'ouvre sur une querelle véhémente devant le cercueil d'Henry V, opposant divers grands personnages, dont le très retors évêque de Winchester, futur cardinal.
La pièce, comme tous les drames historiques de Shakespeare, joue très librement avec faits ou personnages réels et recomposition dramatique. Une querelle entre jeunes lords préfigure la guerre des deux roses. Le nouveau roi apparaît en jeune homme pieux et pacifique attaché à ses livres comme le futur Prospero, et le personnage de Jeanne d'Arc cristallise la violence de droit prétendu divin sous des traits caricaturaux, reniant son père de la plus vile façon et se prétendant enceinte pour couper au bûcher ! Mais la verve satirique du jeune Will n'épargne pas ses compatriotes, alors que bouffons malicieux et vieux sages détaillent déjà les causes du mal rongeant nations et individus.
Un irrésistible effet comique, magnifiquement rendu par la mise en scène de la présente version de la BBC, est lié à la bascule incessante entre victoires et défaites des Anglais contre les Français et vice versa, les uns se précipitant au combat par une porte avec des cris de guerre et en revenant tout cabossés, avant que les autres n'entrent par la même porte qui les voit s'enfuir aussitôt après. Le chaos du monde en sa face risible...
Mais la guerre est aussi une horreur absolue que figure John Talbot - héros des batailles sur sol français, véritable Achille anglais (auquel Trevor Peacock prête sa carrure de géant nain et son faciès de brute bouleversante) enjoignant son fils Jean de fuir la bataille, au scandale de celui-ci, puis mourant avec le cadavre du jeune héros dans ses bras - cette suite de scènes relevant déjà de l'immense Shakespeare chantre de la vraie noblesse de cœur et de la compassion, de la lucidité la plus cinglante et de l'appel pacificateur. -
Adorons le Veau d'or
Le Poète l’a dit tout haut:assommons donc les pauvres !Foulons au pied les innocents,et l’abjection du Présidentà tête de veau d’orexulte au charnier de Gaza…La Honte sur nous tous !Que des voiles de cendreabolissent l’instant présentoù des monstres agissentforts de nos consentements;les masques de suavitéfaussent tout et trahissentles peuples piétinés …Mais hurler dans le bruit du mondeet résister à l’immondea-t-il donc plus de sensqu’adhérer à l’Histoire des violences ?La question seule est la question… -
Par les prés et les villes
(Pour L. la nuit venue)Le silence n'a pas duré:nous nous parlons la nuit:dès que je me suis endormi,elle est là dans le préle grand pré d'herbe sous la luneoù nous restons pieds nusseulement à nous écouter...La nuit, l'autre vie continue,l'air a fraîchi la-bas,tous deux revenant sur nos pasembrassés comme au souvenir,nous sourions à la lumièrede la ville endormiede l'autre coté des rivièresoù des gens vivants vont mourir...Peinture: Félix Vallotton




