
Carnets de JLK - Page 13
-
Ce qu'étaient nos étés
 Les soirées d’été s’allongeaient,nous nous couchions plus tard,nos corps étaient abandonnés ;la mer, en vieux seigneurrêvait de nous envelopperde ses vagues langueurs…Tu marcherais au bout du sable,ce serait ton désert :tu tracerais ta propre piste,tu aurais seize ans maintenant,tu lèverais le tendre voilede tes timidités –tu te ferais artiste…Les étés restent déposésen nous comme de l’or ;il peut se faire qu’on nous dérobenotre sang passager,mais les étés en nous demeurent,à nous bronzer le cœur,semblant d’éternité…Peinture: Cézanne.
Les soirées d’été s’allongeaient,nous nous couchions plus tard,nos corps étaient abandonnés ;la mer, en vieux seigneurrêvait de nous envelopperde ses vagues langueurs…Tu marcherais au bout du sable,ce serait ton désert :tu tracerais ta propre piste,tu aurais seize ans maintenant,tu lèverais le tendre voilede tes timidités –tu te ferais artiste…Les étés restent déposésen nous comme de l’or ;il peut se faire qu’on nous dérobenotre sang passager,mais les étés en nous demeurent,à nous bronzer le cœur,semblant d’éternité…Peinture: Cézanne. -
Poussière d'étoiles
 (Pour Anne Marie, dite la Professorella,ce soir de la Saint Sébastien, au téléphone)Au reflux des larmes tu restesun peu comme hébété,comme sonné par le vacarmedu silence esseulé ;oui ce seront comme des criste déchirant à vifcomme des lames de canifau fond du ciel indifférent…Malgré l’Absence une illusionte dit que tout parle encorequ’en toi tout reprend corps,et de tout un concert de voix,la sienne comme aucunesemble écouter en toi la tienne -mais tu sais qu’il n’y a personne…À cela près qu’on ne sait pas :si jamais on saura :ce qui était, ce qui es,ce qui sera sous la Grand’ Voile :poussière d’étoiles que tout cela -téléphone-moi de là bas…Image: Philip Seelen, portrait astral de JLK.
(Pour Anne Marie, dite la Professorella,ce soir de la Saint Sébastien, au téléphone)Au reflux des larmes tu restesun peu comme hébété,comme sonné par le vacarmedu silence esseulé ;oui ce seront comme des criste déchirant à vifcomme des lames de canifau fond du ciel indifférent…Malgré l’Absence une illusionte dit que tout parle encorequ’en toi tout reprend corps,et de tout un concert de voix,la sienne comme aucunesemble écouter en toi la tienne -mais tu sais qu’il n’y a personne…À cela près qu’on ne sait pas :si jamais on saura :ce qui était, ce qui es,ce qui sera sous la Grand’ Voile :poussière d’étoiles que tout cela -téléphone-moi de là bas…Image: Philip Seelen, portrait astral de JLK. -
Gracias a la vida
 (À nos sœurs d’ici-bas)J’ai peu de lettres de sa main,comme si tout écritqui ne fût pas texte sacrélui eût paru peu dignede simplement nous raconter,ainsi se parait-elleen costume et queue d’hirondellepour se poser au clavecinà jouer du Chopin…Le carnage entre gens qui s’aimentne sera pas de miseaprès l’ouverture des valisesà l’arrivée là-basdevant la mer ouvrant ses brassous la lune de miel;il n’y aura pas de fieldans le premier ciel des auras,et plus haut le septièmede son œil de lune à la feuille,clignera son conseil…C’est dans le Psaume et loin de Job,bien accrochés au mâtdes misaines ourdiespar le Grand Océan qui bat,que nous écrirons la storyde notre humble détour,et nous clignons aussi,dans l’herbe noire où tout scintille,payant ainsi à l’œilcette maudite vie qu’on aime…Y en el alto cielo su fondo estrelladoY en las multitudes la hombre que yo amo(Violeta Parra, 1966)
(À nos sœurs d’ici-bas)J’ai peu de lettres de sa main,comme si tout écritqui ne fût pas texte sacrélui eût paru peu dignede simplement nous raconter,ainsi se parait-elleen costume et queue d’hirondellepour se poser au clavecinà jouer du Chopin…Le carnage entre gens qui s’aimentne sera pas de miseaprès l’ouverture des valisesà l’arrivée là-basdevant la mer ouvrant ses brassous la lune de miel;il n’y aura pas de fieldans le premier ciel des auras,et plus haut le septièmede son œil de lune à la feuille,clignera son conseil…C’est dans le Psaume et loin de Job,bien accrochés au mâtdes misaines ourdiespar le Grand Océan qui bat,que nous écrirons la storyde notre humble détour,et nous clignons aussi,dans l’herbe noire où tout scintille,payant ainsi à l’œilcette maudite vie qu’on aime…Y en el alto cielo su fondo estrelladoY en las multitudes la hombre que yo amo(Violeta Parra, 1966) -
Sebastiano
 Le pauvre garçon doit terriblement souffrir, mais j’ai ce qu’il faut pour le soulager quand les soldats nous laisseront seuls.
Le pauvre garçon doit terriblement souffrir, mais j’ai ce qu’il faut pour le soulager quand les soldats nous laisseront seuls.
Pour l’instant le supplice continue.
 Chaque flèche qui le pénètre me pénètre. Ils ne visent que la chair pleine, en évitant les os et les organes vitaux, de sorte que cela pourrait se prolonger des heures, mais je sais que ce sont eux qui flancheront les premiers et que pendant leur sieste je pourrai m’approcher de lui.
Chaque flèche qui le pénètre me pénètre. Ils ne visent que la chair pleine, en évitant les os et les organes vitaux, de sorte que cela pourrait se prolonger des heures, mais je sais que ce sont eux qui flancheront les premiers et que pendant leur sieste je pourrai m’approcher de lui.
Je me demande parfois si Dieu s’ombrage de la douceur de mes caresses. Je ne sais exactement qui a ordonné le supplice, et je me soumets à la volonté supérieure comme Sebastiano lui-même s’y soumet, mais comment Dieu ressent-Il la chose à ce moment-là ?
La réponse que je donne pour ma part est une caresse plus douce encore, qui fait soupirer le jeune homme et lui tire ses dernières larmes, juste avant la conclusion.
 Personne ne me voit lui planter le couteau de cuisine au coeur. Personne ne l’a entendu me supplier de lui donner le coup de grâce. Sa queue se libère enfin du pagne quand ma lame s’enfonce en lui, mais le bleu de ma robe de pucelle se confond à celui du ciel et personne n’y verra la tache.
Personne ne me voit lui planter le couteau de cuisine au coeur. Personne ne l’a entendu me supplier de lui donner le coup de grâce. Sa queue se libère enfin du pagne quand ma lame s’enfonce en lui, mais le bleu de ma robe de pucelle se confond à celui du ciel et personne n’y verra la tache. -
Les enfants de l'été
5.
Les beaux enfants jouent à la balle brûlée sur la pelouse du Grand Pré d’après le regain. Foin de foins dans lesquels on se jette avant d’éternuer dans les nuées d’herbe sèche comme le vieil Amsterdamer crissant du père Maillefer: tout est soudain tout gazon comme un golf et déjà les corps ont commencé de bronzer comme du bois flotté.
Or la vraie sensation qui compte à mes yeux est celle du jeu ; le summum du sensationnel restera toujours, à mes yeux d’enfant de sept ans, cette liesse absolue qu’est le jeu, consistant premièrement à tomber tout entier dans le mot JEU.
Ne pas tomber tout entier dans le mot JEU revient à cesser d’être à mes yeux. Jouer ne peut se faire à moitié. On peut vivre à moitié ou sourire à moitié, mentir à moitié, se pendre à moitié et finir par se dépendre, mais jouer à moitié : niet.
Quand l’étudiant russe Illia Illitch dit niet, ce n’est pas à moitié : c’est niet. Nos mères et nos tantes taxent l’étudiant russe de langueur molle et de paresse, mais elles n’ont aucune idée de la capacité de décision et de fermeté du pensionnaire de la villa La Pensée dès lors qu’il a dit niet. Le mot NIET a des angles que le NON des plus obtuses douairières, le NEIN souriant de l’oncle Fabelhaft ou le NO vaguement désolé du professeur Barker n’ont pas plus qu’ils n’ont la consistance du niet prononcé par le doux Illia Illitch, lequel trompe son monde comme je tromperai le mien en disparaissant, au jeu de se cacher, en me postant et me tenant immobile et silencieux à découvert, où personne ne se serait risqué. D’une façon analogue, c’est dans l’abandon absolu au jeu que j’ai réellement rencontré l’étudiant russe de mes sept ans alors que mon grand frère de douze ans déjà ne voyait dans le jeu qu’une façon de gagner ou de se désennuyer.
Nous n’avons même pas besoin d’échanger nos sangs, Illia Illitch et moi, nous ne nous dirons jamais hello ni goodbye: il nous suffira de tomber en même temps dans le mot JEU et que ce soit Pierre Noir ou le damier des Dames, Mikado ou le Noble Jeu, sans parler de nos voyages au stéréoscope et de ses menteries, tout ne consistera jamais pour nous qu’à nous tenir là sans besoin même de nous sourire puisque nous serons le sourire absolu du jeu.
De fait il n’est pas concevable de rire au jeu, mais le sourire est licite, qui flotte doucement au-dessus du jeu sans le perturber, comme je me rappelle Illia Illitch flottant sur son canapé, mollement alangui en apparence alors qu’il prépare son imparable prochain coup ; cependant on relèvera la dérogation tenant à faire du rire pur le moyen et la fin du jeu.
Le mot RIRE est un entonnoir dans lequel il nous arrive de nous précipiter en bande, tous membres confondus, entre deux parties de balle brûlée sur le Grand Pré ou trois expéditions dans le Bois du Pendu. Après la tension parfois extrême du jeu, où chacun reste pour soi, le rire pour soi devient un délire de tous où les corps se laissent aller au grand tournis des derviches, au risque de mourir de rire, selon l’expression de ce filou de Pilou, le plus porté d’entre nous à rire comme un fou sans se douter évidemment que jamais il n’atteindra ce qu’on dit l’âge de raison.
L’été 1954 sera celui des rires à mort de mes sept ans, sur le Grand Pré où se retrouvent, les fins d’après-midi et jusque tard, souvent, dans la soirée, la bande du quartier comptant alors une trentaine de filles et de garçons, où Pilou fait figure de bouffon.
On a joué longtemps, on ne joue plus, on est fourbu, vidé, tout le monde se tait et soudain Pilou pète, et puis s’excuse, pouffe et se répète, arguant alors qu’il pète et pue comme une trompette que ferait son cul sans qu’il l’eût voulu, et la bande alors, quoique la facétie de Pilou soit éculée comme une vieille savate, se jette dans le rire en se tapant sur les cuisses et chacun se met à tourner à la lisière du Grand Pré et de la nuit, le rire nous gagne et nous prend, tous tant que nous sommes, jusqu’au grand Carlos qu’un trouble ardent commence à tirer loin de nous et qui ne saura bientôt plus rire sans rime ni raison, Carlos qui tourne lui aussi à ce moment là - Carlos qui se sent homme déjà et n’en peut plus de rire peut-être pour la dernière fois, comme ça, pour rien, hors du temps et des lois.
Le jeu que je vivrai toujours, pour ma part, et plus que jamais dans ces moments où je répéterai, à qui voudra l’entendre, que je ne joue plus, se réduira d’ailleurs à ces mots liés l’un à l’autre comme des foulards de magicien : pour rien, comme ça, hors du temps et des lois…
Entretemps le Grand Pré s’est couvert d’un semis préfabriqué de villas Chez Moi. J’y repasse à l’instant en fermant les yeux comme au jeu de l’Aveugle et je cherche les enfants à tâtons, peinant même à sourire au jour qui vient. Et comment rire de tout ça ? mais je ris pourtant bel et bien…
Image: une scène de Jeux interdits, de René Clément.
-
Au Café des années bohème
En lisant Dans le café de la jeunesse perdue, de Patrick Modiano, qui nous plonge dans une rêverie existentielle dont Paris est le décor magique.
On croit avoir saisi l’essence des romans de Patrick Modiano en évoquant les airs de la nostalgie qui s’en dégagent, avec une atmosphère très particulière, à la fois nette et vaguement mélancolique, propice à la rêverie comme le sont certains lieux écartés qui « diffusent », et qu’on retrouve avec des variations depuis La place de l’étoile, premier ouvrage remontant à 1968, dans Villa triste et Rue des boutiques obscures, notamment, et dans une vingtaine d’autres livres de la même eau claire-obscure, quelque part entre les ciels mouillés de Simenon et le pavé sec (comme le scotch) de Sagan, avec quelque chose de proustien dans le choix des noms et la musique des titres.
Dans le café de la jeunesse perdue en est un nouvel exemple, dont l’exergue parodiant les premiers vers de la Divine comédie de Dante est emprunté à Guy Debord : « A la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant de mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse perdue ».
Ladite mélancolie s’incarne ici dès l’apparition au Condé, café situé dans le quartier de l’Odéon, fermant tard et réunissant la clientèle « la plus étrange », d’une femme semblant « fuir quelque chose » et pénétrant toujours dans l’établissement par sa porte la plus étroite dite « la porte de l’ombre ». Le premier portrait de cette créature encore jeune, se tenant d’abord à l’écart puis se mêlant à la table la plus animée pour s’y taire ou lire Horizons perdus, bientôt surnommée Louki par la compagnie, se trouve esquissé par un étudiant de l’Ecole supérieure des Mines plus ou moins impatient de s’entendre recommander de s’en carapater sous peine d’assommante carrière, témoin réservé, voire timide, du petit théâtre bohème où se croisent des traîne-patins et des écrivains, tel le dramaturge Adamov au « regard de chien tragique », ce Bowing dit Le Capitaine qui tient un livre d’or de tous les déplacements de la clientèle, ou ce soi-disant « éditeur d’art » qui va le relayer dans l’office de la narration avec la précision maniaque d’un détective, ce qui lui va comme un gant puisque détective il est en effet, enquêtant sur la disparition d’une certaine Jacqueline Delanque, épouse d’un certain Choureau, enfuie de ce bref malentendu conjugal pour devenir Louki…
Comme le plus souvent chez Modiano, le semblant d’enquête policière en cache une autre, plus essentielle ou exactement : plus existentielle. Loin de s’en tenir à tel cliché de la nostalgie des sixties, style jeunesse « existentialiste » finissante, le roman nous entraîne ainsi, de la rive gauche « artiste », en d’autres lieux de solitude et de dèche moins décorative d’où viennent aussi bien Jacqueline, sa mère et sa camarade Jeannette Gaul dite Tête de mort et se roulant volontiers dans la « neige »…
N’en disons pas plus, car il faut laisser le lecteur « écouter » Modiano, entre Schubert et Tchékhov, avant la noire conclusion de ce livre doux et dur, fluide et poreux, dans lequel on entre par une porte sombre et qui nous laisse au seuil d’un « ailleurs » éperdu…
Patrick Modiano. Dans le café de la jeunesse perdue. Gallimard, 148p.
-
De géniales «Incandescentes», fées et sourcières

Le Rêveur solidaire (33)
Au sommet de la pensée poétique, Simone Weil, Maria Zambrano et Cristina Campo revivent ainsi par la grâce d’un admirable triptyque d’Elisabeth Bart.
Comme il y a des danseurs et des danseuses, il sera question, dans cette chronique du 14 juin, de penseuses autant que de penseurs, et de mutuelle reconnaissance, d’expériences parfois proches et de visées communes, de passions terrestres et d’aspirations dépassant les fantasmes de puissance et de domination - et ces trois danseuses de la pensée ont un nom et de profondes affinités conjuguant les mouvements du corps et de l’esprit, du cœur et de l’âme. Voici donc Simone Weil (1909-1943), Maria Zambrano (1904-1991) et Cristina Campo (1923-1977).

J’ai commencé de lire Les incandescentes à la veille de mes septante-deux ans, venu au monde un 14 juin par le train de 8h 47 (titre d’un vaudeville de Georges Courteline, ainsi que l’accoucheur l’apprit à ma chère petite mère qui ne fit pas la grève ce jour-là), je connaissais déjà les noms de Simone Weil la Française et de Maria Zambrano l’Andalouse, et j’avais été touché plus récemment par l’incomparable beauté des livres traduits de Cristina Campo l’Italienne, mais voici qu’une dame d’à peu près mon âge, donc une jeune fille de certaine expérience, lumineuse d’intelligente pénétration et d’écriture, au nom d'Elisabeth Bart, m’a embarqué dans une nouvelle traversée vers quels mondes et merveilles dans ce triple sillage des «incandescentes». Je suis loin, pour le moment, d’avoir absorbé la substance extrêmement riche de ce livre, mais je ne laisserai pas passer le 14 juin sans le recommander vivement.
Ce qui ne peut que s’écrire...
Un autre «danseur» rompu aux exercices les plus exigeants de la pensée, en la personne de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) , reste connu d’un peu tout le monde pour une sentence devenue «culte» dans les cafés philosophiques, voire même «bateau» dans la jactance la plus courante, jusque sur les réseaux sociaux, à savoir que «ce qui ne peut se dire il faut le taire».

Bonne idée, n’est-ce pas ? que d’en appeler à l’humilité du silence dans un monde brassant les opinions dans le chaos de l’universel caquetage. Sur quoi Maria Zambrano propose une variante à valeur éventuelle de rebond : «Ce qui ne peut se dire, c’est ce qu’il faut écrire», que la lectrice et le lecteur entendront au sens d’une écriture à la fois exigeante et limpide, tout à fait à l’écart de la graphomanie actuelle.
Wittgenstein achoppait aux limites extrêmes du langage et de l’intelligibilité, en logicien proche, par ses intuitions et autres illuminations, des poètes et des mystiques. Or Simone Weil, Maria Zambrano et Cristina Campo auront, chacune selon sa complexion et son expérience «sur le terrain» et dans les épreuves de la maladie ou de l’exil, vécu la même quête de l’indicible Vérité.Et le féminisme là dedans ? J’y viendrai , et pas seulement au motif que je partage le privilège d’être né un 14 juin, le même jour que le camarade Che Guevara, ce probable macho devenu l’icône du tout et n’importe quoi.

Or la quête commune de Ludwig, Simone, Maria et Cristina impliquait bel et bien une autre «révolution», mais qui était avant tout affaire de pensée dansée, de langage et donc de relation entre les personnes, et donc d’apprentissage et de filiation, et donc d’admiration et de reconnaissance, et donc donc d’amitié et d’amour - et d’abord d’attention et de silence autour d’un noyau «secret» qu’on dira l’absolu pour faire court. Cela pour le «fond de la question».
Cependant une révolte incarnée contre le faux, contre l’injuste, contre la volonté de puissance portant la pensée occidentale à l’opposé de la mesure grecque jusqu’aux pics de l’hybris actuelle, un commun refus de ce qui «nous» a menés à Auschwitz et à Hiroshima fondent la quête de nos «incandescentes» et de leurs alliés présents ou passés, qu’il s’agisse de Gustave Thibon pour Simone Weil ou d’Ortega Y Gasset - premier maître de Maria Zambrano -, d’Elemire Zolla et des grands écrivains (Tchekhov, Borges ou John Donne) qu’elle a commentés ou traduits, pour Cristina Campo - et la « famille » s’étend dans l’espace et le temps, de Platon aux conteurs des Mille et une nuits, ou de Baudelaire à Jean de La Croix, etc.
Blessures de chair et de guerres
 La force égale du verbe et d’une même pensée hors norme se retrouve chez les «incandescentes » à proportion de leur exigence et de ce qu’elles ont enduré dans leur chair (maladie et déracinement) ou leur âme (cœur et esprit) devant la terrible condition humaine.
La force égale du verbe et d’une même pensée hors norme se retrouve chez les «incandescentes » à proportion de leur exigence et de ce qu’elles ont enduré dans leur chair (maladie et déracinement) ou leur âme (cœur et esprit) devant la terrible condition humaine.De même que Ludwig Wittgenstein, génie de la logique mondialement reconnu qui eût pu se claquemurer dans les murs de l’Université, a multiplié les engagements militaires ou civils, la fragile Simone Weil travailla en usine et pesta de ne pouvoir rejoindre les résistants français, puis rencontra Maria Zambano, l’anti-franquiste, au front de la guerre civile espagnole; sur quoi la philosophe espagnole vécut de longues années en exil, au cours desquelles elle se lia à Cristina Campo, luttant elle-même contre la maladie qui l’emporta prématurément - comme Simone Weil...
 Tribulations physiques ou morales à l’avenant, avec des accès d’extrême conscience politique ou compassionnelle, notamment chez Simone Weil que la seule représentation d’une injustice accablait, au point que certains (un Claudel, notamment) en ricanèrent en invoquant une sorte de sainte folie. Et Cristina Campo de s’identifier aux «sans langue» qui souffrent sans pouvoir l’exprimer…
Tribulations physiques ou morales à l’avenant, avec des accès d’extrême conscience politique ou compassionnelle, notamment chez Simone Weil que la seule représentation d’une injustice accablait, au point que certains (un Claudel, notamment) en ricanèrent en invoquant une sorte de sainte folie. Et Cristina Campo de s’identifier aux «sans langue» qui souffrent sans pouvoir l’exprimer…Une écriture purifiée
« Écrire, c’est le contraire de parler » affirmait Maria Zambrano. « Parler, c’est lâcher les mots, écrire, c’est les retenir ». Et l’auteur des Incandescentes de préciser : « Cette mystérieuse activité, écrire, dans sa plus haute acception, ne se confond pas entièrement avec un travail, quoiqu’en dise le lieu commun qui assimile l’écrivain à un artisan. Se rejoignant dans le même désir de vérité, Maria Zambrano, Simone Weil et Cristina Campo la conçoivent comme une expérience spirituelle qui exige une purification».

 Celle-ci aura été vécue dans le retrait, voire l’anonymat par Simone Weil et Cristina Campo restées inconnues de leur vivant. L’œuvre immense de la première est aujourd’hui largement reconnue, et celle de Maria Zambrano a été couronnée par le prestigieux prix Cervantès, mais demeure peu traduite en français alors qu’Elisabeth Bart situe sa réflexion au sommet de la pensée européenne. Quant aux livres, d’une étincelante beauté, de Cristina Campo, le moins qu’on puisse dire est qu’ils n’ont jamais connu de grands tirages. Nul hasard en un temps où la production massive du livre vise essentiellement au divertissement et à l’évasion.
Celle-ci aura été vécue dans le retrait, voire l’anonymat par Simone Weil et Cristina Campo restées inconnues de leur vivant. L’œuvre immense de la première est aujourd’hui largement reconnue, et celle de Maria Zambrano a été couronnée par le prestigieux prix Cervantès, mais demeure peu traduite en français alors qu’Elisabeth Bart situe sa réflexion au sommet de la pensée européenne. Quant aux livres, d’une étincelante beauté, de Cristina Campo, le moins qu’on puisse dire est qu’ils n’ont jamais connu de grands tirages. Nul hasard en un temps où la production massive du livre vise essentiellement au divertissement et à l’évasion.D’Antigone à Baudelaire
Guère plus que Simone Weil, Maria Zambrano et Cristina Campo ne sont des penseuses «à systèmes», pas plus d’ailleurs qu’aucune philosophe femme de ma connaissance. Aucune des trois non plus n’est une idéologue malgré leur enracinement respectif dans la tradition judéo-chrétienne.
Avec une connaissance parfaite des trois œuvres, Elisabeth Bart en détaille les particularités à partir de thèmes peu «conceptuels» comme l’attention chez Simone Weil, l’exil chez Maria Zambrano et l’autre monde chez Cristina Campo. Une réflexion très développée sur la figure d’Antigone associe les trois « incandescentes » autant que la référence centrale à Baudelaire ; enfin, un fil d’or court à travers le triptyque qui relie également les trois œuvres sous l’égide des liturgies et de la poésie mystique, là encore à l’écart des idéologies.
«Le critique est un écho, sans contredit», note Cristina Campo dans Les impardonnables, «mais n’est-il pas aussi la voix de la montagne, de la nature, à laquelle s’adresse la voix du poète ? Le critique ne se tient-il pas devant le poète comme le poète se tient devant les appels de son propre cœur ?»Ainsi Elisabeth Bart fait-elle écho à la fois aux trois « incandescentes » et aux multiples voix que celles-ci écoutent, du jeune Homère aux doigts de rose (Simone Weil) aux fous de Shakespeare (Maria Zambrano) ou aux sans-voix de la Salle 6 de Tchekhov (Cristina Campo), et chaque lectrice et lecteur de ce ce livre admirable devraient à leur tour lui faire écho.
Des femmes contre l’amnésie
Quel rapport entre ces «incandescentes» et la grève des femmes de 14 juin ? Bien plus profond qu’on ne croirait. D’abord parce que les trois penseuses s’inscrivent dans le temps long de la réflexion et de l’expression créatrice, symbolisé par exemple, chez Cristina Campo, par l’analogie qu’elle fait entre le conte populaire et l’art du tapis.
Alors que l’esprit de revanche et de «table rase» anime certains mouvements féministes radicaux (Elisabeth Bart cite en passant les intempestives Femen), le recours à la tradition et aux filiations créatrices multiples peut aider les femmes à résister à la plus vaste entreprise de nivellement et d’indifférenciation que porte l’idéologie mortifère du Management, dûment brocardé par l'auteure en verve.
Antimodernes dans leur refus de souscrire à l’idéologie du Progrès marquant l’aboutissement d’une philosophie dominée par la volonté de puissance, les Incandescentes ne sont en rien « réactionnaires » en cela, conclut Elisabeth Bart, qu’elles «ne veulent pas la restauration d’un pseudo-passé», alors qu’elles «ouvrent le chemin d’une renaissance : renaissance de la poésie, d’une pensée poétique, renaissance de la vie spirituelle sans laquelle il n’est pas de vraie vie».
Elisabeth Bart. Les Incandescentes. Simone Weil, Maria Zambrano, Cristina Campo. Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 236p. 2019.
Dessin: Matthias Rihs.
-
Miguel Bonnefoy enlumine la légende vécue des siens
 Fabuleuse reconnaissance en filiation, Le rêve du jaguar, dernier roman du jeune Franco-Vénézuélien déjà couvert de prix, est à la fois un grand roman familial à la Garcia Marquez (ou à la Cendrars) et un cadeau princier à la langue française, dont l’écriture chatoie de mille feux poétiques accordés à mille histoires d’amour. À lire illico presto !Un bonheur de lecture à peu près sans pareil de nos jours marque la découverte du dernier roman de Miguel Bonnefoy, intitulé Le Rêve du jaguar et gratifié l’automne passé de deux grands prix littéraires, lesquels s’ajoutent à ceux qui ont marqué la reconnaissance immédiate de ses ouvrages précédents. À ceux- là nul doute que vous reviendrez fissa si vous les avez loupés jusque-là, comme c’est le pendable cas du soussigné. On en veut plus, en attendant le probable chef-d’œuvre à venir, car ce gars-là, se dit-on en pariant sur l’avenir (comme lui d’ailleurs le reconnaît avec modestie dans ses interviouves) a l’étoffe d’un grand écrivain.Dès les premières pages, ainsi, de ce roman à la fois picaresque et poétique, son jaguar nous prend par la gueule et ne nous lâchera pas avant le dernier paragraphe de la saga nous ramenant au premier, sur le parvis d’une église dédiée à San Antonio où une mendiante muette au prénom de Teresa découvre un nouveau-né enveloppé dans un lange contenant, comme un premier message de repentance et de recours à un possible amour à venir, une petite rouleuse à cigarettes de métal argenté aux jolies gravures…Mais où nous emmène donc ce galopant galopiau avec son début de feuilleton à la Dickens ? Où l’auteur a-t-il déniché l’histoire de ce gosse mendiant à deux ans, apprenant tôt à se défendre et dont nous savons déjà qu’il aura plus tard en ces lieux une rue à son nom, d’abord mal aimé par sa mère d’adoption qui l’armera pourtant mieux qu’aucune autre contre les aléas de la vie, lui offrira son premier cadeau (la petite machine à se rouler des cibiches) et son premier conseil après un vol de pirogue à ses dix ans : ne vole pas alors que tu as des ailes pour devenir quelqu’un, travaille !Quand les clichés et le kitsch valdinguent…Vais-je pécher par « spoiling » en dévoilant ici, avec plus de détails, la « story » d’Antonio Borjas Romero, premier grand personnage du Rêve du jaguar ? Se poser la question revient à penser que « raconter l’histoire » suffirait à la gâcher en lui ôtant l’effet de surprise. Or la surprise de la vraie littérature est-elle là ? Le « pitch » d’un roman, ou le résumé plus étoffé de ses épisodes, suffisent-ils à en rendre compte ? Essayez donc de proposer le « scénar » de ce roman à ChatGPT et vous verrez le résultat…Or, si l’on pourrait dire que tous les ingrédients d’un feuilleton à stéréotypes et clichés « téléphonés » sont réunis a priori dans l’histoire du petit Antonio, nous savons (par Youtube) que le grand-père de Miguel Bonnefoy, cardiologue et chirurgien illustre, fait pratiquement partie du domaine public vénézuélien, l’extraordinaire personnage offert sur un plateau à son petit-fils plumitif ayant déjà fait l’objet de deux bios documentées.Est-ce dire alors que cette histoire relève d’une resucée opportuniste ? Et s’agissant de la non moins fascinante moitié d’Antonio, Ana Maria Rodriguez, devenue première femme médecin de sa région, en quoi relève-t-elle de la littérature et pas du documentaire journalistique à nuance féministe ? Toute la question de l’alchimie romanesque est là, et sans celle-ci, «raconter l’histoire » d’Antonio et d’Ana Maria, puis de leur fille Venezuela et de leur petit-fils Cristobal (double narratif de l’auteur) aurait pu se limiter à de la romance au goût du jour comme il en ruisselle sur Netflix et consorts.À ce propos, comme j’aurai regardé les huit premiers épisodes de la série colombienne tirée de Cent ans de solitude qui vient d’être programmée sur la plateforme en question en même temps que je lisais Le Rêve du jaguar, je n’ai pu m’empêcher de me demander ce qu’elle ajoutait au roman, ou ce qui lui manquait pour l’égaler ; et à l’inverse, ce qui fait du roman de Miguel Bonnefoy bien plus qu’un canevas de série télé…Pour en revenir au Rêve du jaguar, il faudrait à vrai dire, idéalement, « oublier » que sa base est fondée sur des « faits réels », et lire le roman comme nous avons lu L’île au trésor dans l’enchantement de nos lectures d’enfance ou de jeunesse, en toute innocence, comme les livres dont le jeune Cristobal va lui-même se gaver avec passion.Reste à préciser encore, en quelques mots, ce qui fait valdinguer les stéréotypes de genre et les clichés dans ce roman dont l’auteur ose évoquer la scène de son jeune protagoniste installé sur un tabouret, dans une gare routière, et priant les passants de lui raconter la plus belle histoire d’amour qu’ils connaissent, pour en remplir un carnet – plus kitsch tu meurs ? Mais pas du tout !Vous y croirez comme à la transformation du crapaud en prince, dans les contes, ou comme au miracle qui empêche Michel Strogoff de devenir aveugle, comme au Transsibérien de Cendrars qui répond, à l’impudent lui demandant s’il l’a vraiment pris : que t’importe, si mon poème te l’a fait prendre !Car tout est là : les mots de Michel Bonnefoy, ou plus exactement son art de trouver un mot pour un autre (règle des trouvères), son véritable génie de la formule, de la métaphore inattendue, et la beauté sidérante qui se dégage de ses phrases. Et sous les mots, le sens, le savoir et la saveur qui en est le fruit.Tout au long du roman, sans trace de pédantisme, documentée mais mine de rien, la lecture du monde opérée par Miguel Bonnefoy en appelle à tous les sens, autant qu’à tous les «instituteurs » et tutrices de passage, conformément à la lecon d’Ana Maria à son petit-fils : Ah bon, tu veux écrire ? Mais « si tu veux devenir écrivain, écoute ceux qui ne le sont pas ». Ce que le fiston a si bien entendu qu’il en tirera une mélodie à lui et sans pareille.Du cendrier à l’étoile, de l’individuel au collectifFriedrich Dürrenmatt disait qu’il faut écrire « entre le cendrier et l’étoile », et c’est ce qu’on pourrait dire aussi de la position du romancier Bonnefoy, sensible également à « l’effet papillon » qui fait que des événements apparemment infimes peuvent déclencher des tornades.Côté « cendrier », le romancier pratique un art constant du détail révélateur, qui caractérise les objets autant que les personnages de l’épique traversé des années et des lieux, du village-dépotoir lacustre à palafittes où pataugent les enfants nus (alors que des panneaux volés le long d’une route proclament « Pas de bonheur sans Chevrolet ») à ce qui deviendra, au temps de la ruée vers l’or noir, la cité tentaculaire de Maracaibo ; et pour les étoiles, il suffit de lever les yeux au ciel immense des Caraïbes dont les pluies diluviennes laissent sur les prés des myriades de perroquets morts tandis qu’affluent les langoustes comme les sauterelles de la Bible…La plupart des personnages de ce roman sont hauts en couleurs, non moins qu’en douleurs, alors que le thème de la résilience marque les destinées personnelles d’Antonio et d’Ana Maria, pour la première des trois générations évoquées, et le transit des années va de pair avec celui lui de l’ascension sociale des protagonistes, jusqu’aux plus hautes sphères de la médecine, mais ni l’un ni l’autre ne seront des mandarins coupés de la vie des gens, au contraire : tous deux seront sympathisants des révoltes sociales marquant les décennies, dont l’instabilité est symbolisée par la succession de 32 constitutions…Fils lui-même d’un ancien militant de l’extrême-gauche chilienne soumis à la torture sous Pinochet, Miguel Bonnefoy ne s’exprime jamais, dans Le Rêve du jaguar, en idéologue partisan, qu’il s’agisse de la cause des femmes (l’une de ses priorité déclarées) ou des révolutions successives, dont il tire un bilan où pèse lourdement la corruption des uns et des autres.Qu’il évoque l’accession du jeune Antonio à la maturité sexuelle, dans la maison de passe au beau titre de Majestic, le retour subit de son père disparu dont il ne découvrira l’identité que bien plus tard, sa rencontre d’Ana Maria et leurs études communes, l’oncle avocat au soutien « sévère mais juste », la venue au monde de Venezuela et le refus de la jeune fille de suivre les traces prévues par les siens, rêvant de Paris avant de s’exiler en France, entre autres tribulations liées parfois aux soubresauts de la politique, le romancier parvient à concilier l’observation nuancée et sympathique de tous les personnages du premier plan, dans le mouvement général d’une société en mutation. Des pages particulièrement remarquables sont ainsi consacrées aux révoltes et aux réformes du monde agricole et à la succession des gâchis et autres avancées, sur fond d’instabilité chronique combien actuelle…Le souffle d’une fable picaresqueAu demeurant, jamais le roman ne cesse d’être porté par une sorte de souffle de légende qui l’arrache à l’anecdote seulement sociale ou politique, sans se désincarner pour autant. Par delà le probable « mentir vrai » du romancier jouant de malice inventive, la vérité poétique du romancier vaut sans doute celle des biographes « pour l’essentiel ».Il y a là, sous l'effet d'une espèce de grâce unificatrice (« Le poète est celui qui unifie », me disait un jour Pierre Jean Jouve), une fusion de l’affectif personnel et de la tendresse collective, de la conscience tragique et de l’élan vital, de l’éthique religieuse quoique sans référence confessionnelle aucune, et de l’esthétique littéraire la plus poreuse et le plus généreuse, dans la filiation évidente du réalisme magique cher à Garcia Marquez, un vrai miracle que scelle finalement la musique tout à fait originale et combien prometteuse encore de Miguel Bonnefoy .Miguel Bonnefoy. Le Rêve du jaguar. Editions Rivages, 2024. 294p. Prix Femina et Grand Prix du roman de l’Académie française.
Fabuleuse reconnaissance en filiation, Le rêve du jaguar, dernier roman du jeune Franco-Vénézuélien déjà couvert de prix, est à la fois un grand roman familial à la Garcia Marquez (ou à la Cendrars) et un cadeau princier à la langue française, dont l’écriture chatoie de mille feux poétiques accordés à mille histoires d’amour. À lire illico presto !Un bonheur de lecture à peu près sans pareil de nos jours marque la découverte du dernier roman de Miguel Bonnefoy, intitulé Le Rêve du jaguar et gratifié l’automne passé de deux grands prix littéraires, lesquels s’ajoutent à ceux qui ont marqué la reconnaissance immédiate de ses ouvrages précédents. À ceux- là nul doute que vous reviendrez fissa si vous les avez loupés jusque-là, comme c’est le pendable cas du soussigné. On en veut plus, en attendant le probable chef-d’œuvre à venir, car ce gars-là, se dit-on en pariant sur l’avenir (comme lui d’ailleurs le reconnaît avec modestie dans ses interviouves) a l’étoffe d’un grand écrivain.Dès les premières pages, ainsi, de ce roman à la fois picaresque et poétique, son jaguar nous prend par la gueule et ne nous lâchera pas avant le dernier paragraphe de la saga nous ramenant au premier, sur le parvis d’une église dédiée à San Antonio où une mendiante muette au prénom de Teresa découvre un nouveau-né enveloppé dans un lange contenant, comme un premier message de repentance et de recours à un possible amour à venir, une petite rouleuse à cigarettes de métal argenté aux jolies gravures…Mais où nous emmène donc ce galopant galopiau avec son début de feuilleton à la Dickens ? Où l’auteur a-t-il déniché l’histoire de ce gosse mendiant à deux ans, apprenant tôt à se défendre et dont nous savons déjà qu’il aura plus tard en ces lieux une rue à son nom, d’abord mal aimé par sa mère d’adoption qui l’armera pourtant mieux qu’aucune autre contre les aléas de la vie, lui offrira son premier cadeau (la petite machine à se rouler des cibiches) et son premier conseil après un vol de pirogue à ses dix ans : ne vole pas alors que tu as des ailes pour devenir quelqu’un, travaille !Quand les clichés et le kitsch valdinguent…Vais-je pécher par « spoiling » en dévoilant ici, avec plus de détails, la « story » d’Antonio Borjas Romero, premier grand personnage du Rêve du jaguar ? Se poser la question revient à penser que « raconter l’histoire » suffirait à la gâcher en lui ôtant l’effet de surprise. Or la surprise de la vraie littérature est-elle là ? Le « pitch » d’un roman, ou le résumé plus étoffé de ses épisodes, suffisent-ils à en rendre compte ? Essayez donc de proposer le « scénar » de ce roman à ChatGPT et vous verrez le résultat…Or, si l’on pourrait dire que tous les ingrédients d’un feuilleton à stéréotypes et clichés « téléphonés » sont réunis a priori dans l’histoire du petit Antonio, nous savons (par Youtube) que le grand-père de Miguel Bonnefoy, cardiologue et chirurgien illustre, fait pratiquement partie du domaine public vénézuélien, l’extraordinaire personnage offert sur un plateau à son petit-fils plumitif ayant déjà fait l’objet de deux bios documentées.Est-ce dire alors que cette histoire relève d’une resucée opportuniste ? Et s’agissant de la non moins fascinante moitié d’Antonio, Ana Maria Rodriguez, devenue première femme médecin de sa région, en quoi relève-t-elle de la littérature et pas du documentaire journalistique à nuance féministe ? Toute la question de l’alchimie romanesque est là, et sans celle-ci, «raconter l’histoire » d’Antonio et d’Ana Maria, puis de leur fille Venezuela et de leur petit-fils Cristobal (double narratif de l’auteur) aurait pu se limiter à de la romance au goût du jour comme il en ruisselle sur Netflix et consorts.À ce propos, comme j’aurai regardé les huit premiers épisodes de la série colombienne tirée de Cent ans de solitude qui vient d’être programmée sur la plateforme en question en même temps que je lisais Le Rêve du jaguar, je n’ai pu m’empêcher de me demander ce qu’elle ajoutait au roman, ou ce qui lui manquait pour l’égaler ; et à l’inverse, ce qui fait du roman de Miguel Bonnefoy bien plus qu’un canevas de série télé…Pour en revenir au Rêve du jaguar, il faudrait à vrai dire, idéalement, « oublier » que sa base est fondée sur des « faits réels », et lire le roman comme nous avons lu L’île au trésor dans l’enchantement de nos lectures d’enfance ou de jeunesse, en toute innocence, comme les livres dont le jeune Cristobal va lui-même se gaver avec passion.Reste à préciser encore, en quelques mots, ce qui fait valdinguer les stéréotypes de genre et les clichés dans ce roman dont l’auteur ose évoquer la scène de son jeune protagoniste installé sur un tabouret, dans une gare routière, et priant les passants de lui raconter la plus belle histoire d’amour qu’ils connaissent, pour en remplir un carnet – plus kitsch tu meurs ? Mais pas du tout !Vous y croirez comme à la transformation du crapaud en prince, dans les contes, ou comme au miracle qui empêche Michel Strogoff de devenir aveugle, comme au Transsibérien de Cendrars qui répond, à l’impudent lui demandant s’il l’a vraiment pris : que t’importe, si mon poème te l’a fait prendre !Car tout est là : les mots de Michel Bonnefoy, ou plus exactement son art de trouver un mot pour un autre (règle des trouvères), son véritable génie de la formule, de la métaphore inattendue, et la beauté sidérante qui se dégage de ses phrases. Et sous les mots, le sens, le savoir et la saveur qui en est le fruit.Tout au long du roman, sans trace de pédantisme, documentée mais mine de rien, la lecture du monde opérée par Miguel Bonnefoy en appelle à tous les sens, autant qu’à tous les «instituteurs » et tutrices de passage, conformément à la lecon d’Ana Maria à son petit-fils : Ah bon, tu veux écrire ? Mais « si tu veux devenir écrivain, écoute ceux qui ne le sont pas ». Ce que le fiston a si bien entendu qu’il en tirera une mélodie à lui et sans pareille.Du cendrier à l’étoile, de l’individuel au collectifFriedrich Dürrenmatt disait qu’il faut écrire « entre le cendrier et l’étoile », et c’est ce qu’on pourrait dire aussi de la position du romancier Bonnefoy, sensible également à « l’effet papillon » qui fait que des événements apparemment infimes peuvent déclencher des tornades.Côté « cendrier », le romancier pratique un art constant du détail révélateur, qui caractérise les objets autant que les personnages de l’épique traversé des années et des lieux, du village-dépotoir lacustre à palafittes où pataugent les enfants nus (alors que des panneaux volés le long d’une route proclament « Pas de bonheur sans Chevrolet ») à ce qui deviendra, au temps de la ruée vers l’or noir, la cité tentaculaire de Maracaibo ; et pour les étoiles, il suffit de lever les yeux au ciel immense des Caraïbes dont les pluies diluviennes laissent sur les prés des myriades de perroquets morts tandis qu’affluent les langoustes comme les sauterelles de la Bible…La plupart des personnages de ce roman sont hauts en couleurs, non moins qu’en douleurs, alors que le thème de la résilience marque les destinées personnelles d’Antonio et d’Ana Maria, pour la première des trois générations évoquées, et le transit des années va de pair avec celui lui de l’ascension sociale des protagonistes, jusqu’aux plus hautes sphères de la médecine, mais ni l’un ni l’autre ne seront des mandarins coupés de la vie des gens, au contraire : tous deux seront sympathisants des révoltes sociales marquant les décennies, dont l’instabilité est symbolisée par la succession de 32 constitutions…Fils lui-même d’un ancien militant de l’extrême-gauche chilienne soumis à la torture sous Pinochet, Miguel Bonnefoy ne s’exprime jamais, dans Le Rêve du jaguar, en idéologue partisan, qu’il s’agisse de la cause des femmes (l’une de ses priorité déclarées) ou des révolutions successives, dont il tire un bilan où pèse lourdement la corruption des uns et des autres.Qu’il évoque l’accession du jeune Antonio à la maturité sexuelle, dans la maison de passe au beau titre de Majestic, le retour subit de son père disparu dont il ne découvrira l’identité que bien plus tard, sa rencontre d’Ana Maria et leurs études communes, l’oncle avocat au soutien « sévère mais juste », la venue au monde de Venezuela et le refus de la jeune fille de suivre les traces prévues par les siens, rêvant de Paris avant de s’exiler en France, entre autres tribulations liées parfois aux soubresauts de la politique, le romancier parvient à concilier l’observation nuancée et sympathique de tous les personnages du premier plan, dans le mouvement général d’une société en mutation. Des pages particulièrement remarquables sont ainsi consacrées aux révoltes et aux réformes du monde agricole et à la succession des gâchis et autres avancées, sur fond d’instabilité chronique combien actuelle…Le souffle d’une fable picaresqueAu demeurant, jamais le roman ne cesse d’être porté par une sorte de souffle de légende qui l’arrache à l’anecdote seulement sociale ou politique, sans se désincarner pour autant. Par delà le probable « mentir vrai » du romancier jouant de malice inventive, la vérité poétique du romancier vaut sans doute celle des biographes « pour l’essentiel ».Il y a là, sous l'effet d'une espèce de grâce unificatrice (« Le poète est celui qui unifie », me disait un jour Pierre Jean Jouve), une fusion de l’affectif personnel et de la tendresse collective, de la conscience tragique et de l’élan vital, de l’éthique religieuse quoique sans référence confessionnelle aucune, et de l’esthétique littéraire la plus poreuse et le plus généreuse, dans la filiation évidente du réalisme magique cher à Garcia Marquez, un vrai miracle que scelle finalement la musique tout à fait originale et combien prometteuse encore de Miguel Bonnefoy .Miguel Bonnefoy. Le Rêve du jaguar. Editions Rivages, 2024. 294p. Prix Femina et Grand Prix du roman de l’Académie française. -
Comme une alliance
 (All'Amica cara)Le type au bord du ciel vacille:il ne voit plus la terrenoyée là-bas dans le brouillard,et c’est aussi sa vieque son regard à l’instant perd…Où êtes vous jeunes amants,hier encore immortels,craignez-vous aussi ce présentqui nous brûle les ailes ?Nulle tristesse au demeurant,à l’instant ne me vienne:que votre joie reste la mienne,à la grâce du Temps…Affresca: al Duomo di Orvieto, da Luca Signorelli.
(All'Amica cara)Le type au bord du ciel vacille:il ne voit plus la terrenoyée là-bas dans le brouillard,et c’est aussi sa vieque son regard à l’instant perd…Où êtes vous jeunes amants,hier encore immortels,craignez-vous aussi ce présentqui nous brûle les ailes ?Nulle tristesse au demeurant,à l’instant ne me vienne:que votre joie reste la mienne,à la grâce du Temps…Affresca: al Duomo di Orvieto, da Luca Signorelli. -
Une langue à venir
 (En mémoire de Charles Du Bos)Lire, alors serait une prière,une porte qui s’ouvre,un chemin comme une rivière,une étoile qu’on découvredans l’aube des profonds miroirs;une voix qu’on entend,seule dans le grand bruit du noir,votre voix retrouvée -la seule d'entre les voies qui tienne…Les paysages sont exquisà qui regarde bien:ils sont le lieu, ils sont le lien,le lien entre les lieux,de la muraille des forêtsau secret que recèlentles ombres au front levédes vanités et de leurs failles -reviens donc au plus simplete suggère le doux lecteur…La médiocrité ne voit rien,satisfaite de soi,ne reçoit rien que le jour donne,et nul écho n’en vientque les idioties qu’on fredonnesur les mornes cheminsoù tout est déjà tracé -mais là-bas d’autres mots t’appellentque tu liras les yeux fermés...(Peinture: Georges de La Tour, Enfant de choeur, vers 1645)
(En mémoire de Charles Du Bos)Lire, alors serait une prière,une porte qui s’ouvre,un chemin comme une rivière,une étoile qu’on découvredans l’aube des profonds miroirs;une voix qu’on entend,seule dans le grand bruit du noir,votre voix retrouvée -la seule d'entre les voies qui tienne…Les paysages sont exquisà qui regarde bien:ils sont le lieu, ils sont le lien,le lien entre les lieux,de la muraille des forêtsau secret que recèlentles ombres au front levédes vanités et de leurs failles -reviens donc au plus simplete suggère le doux lecteur…La médiocrité ne voit rien,satisfaite de soi,ne reçoit rien que le jour donne,et nul écho n’en vientque les idioties qu’on fredonnesur les mornes cheminsoù tout est déjà tracé -mais là-bas d’autres mots t’appellentque tu liras les yeux fermés...(Peinture: Georges de La Tour, Enfant de choeur, vers 1645) -
Lettre à Jean Ziegler

À La Désirade, ce samedi 22 septembre 2012
Mon cher Jean, Comment vas-tu, comment vis-tu, comment survis-tu en ces temps où tu dois éprouver, autant ou plus que d’autres, le terrible poids du monde ?
Je pense tous les jours à toi, ces jours précisément où je te sais miné par les tribulations des pauvres Syriens alors que je me trouve à la veille, pour ma part, d’un voyage en Afrique noire où je vais débarquer lundi prochain pour la première fois ; et tout naturellement je pense à tout ce que tu as vécu et partagé de l’Afrique depuis tes premiers voyages et tes premiers livres, témoignant de ton attention à ce pauvre continent autant qu’à notre pauvre Suisse. Or je fais ce pauvre rapprochement sans aucun sanglot d’homme blanc dans la voix, mon cher Jean, je me le dis sans aucune crainte de faire insulte aux damnés de la terre du vrai pauvre monde : je le dis en constatant autour de nous la pauvreté d’esprit et de cœur du monde nanti et repu dans lequel nous vivons et crevons de bien-être. Note que je ne crache même pas sur celui-ci. Je ne vais pas ajouter, à l’obscénité de nos privilèges, celle d’une mauvaise conscience à trop bon marché. Mais le sentiment-sensation d’accablement, dans la profusion et le superflu qui nous submergent, n’en est pas moins réel et jusqu’au dégoût – jusqu’à en vomir.
 J’ai lu beaucoup de livres, ces derniers temps, et vu beaucoup de films relatifs à l’Afrique. Plus précisément, je viens de revoir trois fois de suite Hyènes, le film du Sénégalais Djbril Diop Mambety, inspiré par La Visite de la vieille dame de Dürrematt. Je me rappelle, comme d’hier, notre rencontre au Centre Dürrenmatt, cher Jean, et la façon dont un ponte d’Economie suisse s’y est moqué de toi en te reléguant parmi les vieilles lunes. Je me rappelle avoir pris ta défense, moi qui ne suis pas plus de gauche que de droite, comme l’était je crois Dürrenmatt, au nom de la révolte plus radicale de celui-ci. Et ce matin je me dis que le vieux Fritz est plus que jamais plus jeune que nous tous en sa protestation fondamentale de diabétiqe gand buveur et grand fumeur de cigares, dont la vieille carne n’en finit pas de répéter, en Suisse néolibérale autant qu’en Afrique pillée et mondialisée : « Vous avez fait de moi une putain. Je vais faire du monde un bordel ».
J’ai lu beaucoup de livres, ces derniers temps, et vu beaucoup de films relatifs à l’Afrique. Plus précisément, je viens de revoir trois fois de suite Hyènes, le film du Sénégalais Djbril Diop Mambety, inspiré par La Visite de la vieille dame de Dürrematt. Je me rappelle, comme d’hier, notre rencontre au Centre Dürrenmatt, cher Jean, et la façon dont un ponte d’Economie suisse s’y est moqué de toi en te reléguant parmi les vieilles lunes. Je me rappelle avoir pris ta défense, moi qui ne suis pas plus de gauche que de droite, comme l’était je crois Dürrenmatt, au nom de la révolte plus radicale de celui-ci. Et ce matin je me dis que le vieux Fritz est plus que jamais plus jeune que nous tous en sa protestation fondamentale de diabétiqe gand buveur et grand fumeur de cigares, dont la vieille carne n’en finit pas de répéter, en Suisse néolibérale autant qu’en Afrique pillée et mondialisée : « Vous avez fait de moi une putain. Je vais faire du monde un bordel ». C’est entendu : le poète exagère. C’est son job. Lorsque Dürrenmatt compare la Suisse à une prison sans murs dont chaque prisonnier serait son propre gardien et celui du voisin, il exagère. Le grand imprécateur Thomas Bernhard, qui affirmait que l’Autriche actelle était restée nazie pour l’essentiel, se disait également « un artiste de l’exagération ». Et toi aussi, mon cher Jean, tu as souvent exagéré et m’as souvent souvent exaspéré en réduisant la Suisse à un pays de receleurs, comme m’exaspère souvent ma propre façon de tout pousser au noir…
C’est entendu : le poète exagère. C’est son job. Lorsque Dürrenmatt compare la Suisse à une prison sans murs dont chaque prisonnier serait son propre gardien et celui du voisin, il exagère. Le grand imprécateur Thomas Bernhard, qui affirmait que l’Autriche actelle était restée nazie pour l’essentiel, se disait également « un artiste de l’exagération ». Et toi aussi, mon cher Jean, tu as souvent exagéré et m’as souvent souvent exaspéré en réduisant la Suisse à un pays de receleurs, comme m’exaspère souvent ma propre façon de tout pousser au noir…L’un de tes confrères sociologues, mon cher Jean, un vrai Suisse pur de pur celui-là, m’a fait un jour de toi le portrait le plus sévère, dans le bureau jouxtant le tien, conspuant à la fois tes idées et tes positions politiques, tes livres scientifiquement si peu rigoureux et tes étudiants africains académiquement si foireux, t’appelant simplement « le fou ». Or j’ai repris à mon compte cette appellation, toute négative évidemment chez ton pair au-dessus de tout soupçon, mais se parant à mes yeux d’une aura toute positive en son ensauvagement, et voici que je t’appelle Jean le fou, notre dingue providentiel, notre héros national à dégaine de missionnaire des Nations Unies mandaté pour enquêter sur la destruction massive des nations désunies. Ta folie est d’une espèce de poète. En lisant et relisant tes livres je vois de mieux en mieux, sous le langage du sociologue et de l’idéologue qui m’exaspère parfois, le geste humain de celui qui s’engage à corps perdu avec la conviction, par-delà toutes les désillusions, qu’« il ne faut pas se rendre », et ce regard lucide et blessé sur le personnage que tu joues dans tes pérégrinations autour du monde, dans l’insoutenable Destruction massive…
 Je ne sais ai tu as vu le film Hyènes de Djibril Diop Mambety, mon cher Jean, mais je suis sûr que toute ton Afrique est là, humiliée et magnifique. La beauté défigurée, la jeunesse bafouée, l’amour trahi, la colère vengeresse, la solitude et la mélancolie : tout cela cohabite dans les expressions de la fasinante actrice incarnant la vieille dame de tous les âges aux multiples masques fragiles ou implacables. Or il se dégage de ce personnage, bonnement réinventé par le réalisateur noir, une noblesse et une dignité qui participe de ce qu’on peut dire l’universelle ressemblance humaine. Sony Labou Tasi disait écrire « pour qu’il fasse plus homme » en lui, et c’est exactement ce qu’on se dit en « vivant » ce film à la fois si beau et si triste, et tellement généreux et joyeux, qui nous rend plus humains aussi. Rarement j’ai vu les femmes africaines aussi belles que que dans ce filmenoutre traversé de figures muettes et immobiles, décalées dans le champ, qui ont l’air de se demander ce qui diable est en train d’arriver dans leur bled ? Rien n’est dit là qui procède directement de la pièce de Dürrenmatt, mais l’image, et les cadrages, et le montage, permettent cette sorte d’aparté taiseux des sans-langage, comme on le percevrait chez des paysans du Valais ou de l’Afghanistan. Mais qu’est-ce que cet affolement ? ont-ils l’air de se demander. Mais où ces hyènes courent-elles donc ? Mais est-ce ainsi qu’on va réellement survivre ?
Je ne sais ai tu as vu le film Hyènes de Djibril Diop Mambety, mon cher Jean, mais je suis sûr que toute ton Afrique est là, humiliée et magnifique. La beauté défigurée, la jeunesse bafouée, l’amour trahi, la colère vengeresse, la solitude et la mélancolie : tout cela cohabite dans les expressions de la fasinante actrice incarnant la vieille dame de tous les âges aux multiples masques fragiles ou implacables. Or il se dégage de ce personnage, bonnement réinventé par le réalisateur noir, une noblesse et une dignité qui participe de ce qu’on peut dire l’universelle ressemblance humaine. Sony Labou Tasi disait écrire « pour qu’il fasse plus homme » en lui, et c’est exactement ce qu’on se dit en « vivant » ce film à la fois si beau et si triste, et tellement généreux et joyeux, qui nous rend plus humains aussi. Rarement j’ai vu les femmes africaines aussi belles que que dans ce filmenoutre traversé de figures muettes et immobiles, décalées dans le champ, qui ont l’air de se demander ce qui diable est en train d’arriver dans leur bled ? Rien n’est dit là qui procède directement de la pièce de Dürrenmatt, mais l’image, et les cadrages, et le montage, permettent cette sorte d’aparté taiseux des sans-langage, comme on le percevrait chez des paysans du Valais ou de l’Afghanistan. Mais qu’est-ce que cet affolement ? ont-ils l’air de se demander. Mais où ces hyènes courent-elles donc ? Mais est-ce ainsi qu’on va réellement survivre ?La hyène, tu le sais, mon cher Jean, est l’animal symbolisant, dans les contes africains, la survie et le savoir habile qu’elle appelle naturellement, la connaissance empirique mais à ras les herbes, l’intelligence toute matérielle en somme inférieure à la sagesse plus spirituelle et sereine du lion.
Lorsque Linguère Ramatou, la vieille dame du film, annonce la venue du « temps des hyènes », c’est évidemment le temps de la rapacité plus que de la survie, le temps de la ruée aux produits, le temps du nouveau culte des objets et de l’argent qu’elle proclame amèrement en ricanant à la face de ceux qui l’ont poussée à se vendre. Or que voyons-nous tous les jours autour de nous, mon cher Jean ? Et n’est-ce pas revigorant, pourtant, de voir qu’un poète de cinéma africain, reprenne à son compte la fable théatrale la plus apte à figurer, sans se limiter à la dimension économique ou politique, la fuite en avant du monde actuel en proie aux crises mimétiques collectives et que menace collectivement la perte de son âme ?
Ces confrontations et ces enrichissements réciproques ont été le sel des siècles et des cultures en dépit de tous les replis tribaux ou nationaux, et je suis sûr, en ces temps de nouvelles crispations identitaires parfois très compréhensibles, voire légitimes, que la culture vivante à venir passera par ces échanges.
 Je pars demain au Congo avec un jeune écrivain camerounais établi à Genève du nom de Max Lobe, dont le regard sur notre réalité suisse ne cesse de recentrer le mien par décentrage, si j’ose dire. C’est lui qui m’a fait découvrir Hyènes et je lui ai filé l’autre jour les romans africains de Simenon dont il ignorait tout. Il a publié l’an dernier un premier récit intitulé L’Enfant du miracle, où son expérience d’étudiant à Lausanne alterne avec ses souvenirs d’enfant de Douala. Il en publiera un deuxième en janvier prochain qui fait alterner les scènes africaines et celles des bas-fonds des Pâquis. Ce garçon qui a l’âge de nos filles, disposant d’un master de management, est en quête d’un job digne de ses compétences comme beaucoup de jeunes gens actuels, et je suis très reconnaissant aux éditions Zoé de l’avoir accueilli. En attendant ce sera passionnant, je crois, de confronter nos observations à Lubumbashi…
Je pars demain au Congo avec un jeune écrivain camerounais établi à Genève du nom de Max Lobe, dont le regard sur notre réalité suisse ne cesse de recentrer le mien par décentrage, si j’ose dire. C’est lui qui m’a fait découvrir Hyènes et je lui ai filé l’autre jour les romans africains de Simenon dont il ignorait tout. Il a publié l’an dernier un premier récit intitulé L’Enfant du miracle, où son expérience d’étudiant à Lausanne alterne avec ses souvenirs d’enfant de Douala. Il en publiera un deuxième en janvier prochain qui fait alterner les scènes africaines et celles des bas-fonds des Pâquis. Ce garçon qui a l’âge de nos filles, disposant d’un master de management, est en quête d’un job digne de ses compétences comme beaucoup de jeunes gens actuels, et je suis très reconnaissant aux éditions Zoé de l’avoir accueilli. En attendant ce sera passionnant, je crois, de confronter nos observations à Lubumbashi… De notre terrasse de La Désirade, mon cher Jean, je devine les hauts de Caux où s’achève un autre roman africain, au titre de Mosso, signé par un autre de mes amis, le Tchadien Nétonon Noël Ndjékéry, qui décrit, avec une truculence incisive, les tribulations d’une jeune femme en rupture de communauté par insoumission à des règles qu’elle juge dépassées, se débrouille comme elle peut dans son pays en proie à l’abritraire et à la corruption, et finit en Lémanie dans les pattes d’un Vaudois brasseur d’affaires et se piquant d’humanitarisme. Cela ne manque de rappeler, évidemment, l’humanitarisme de façade du couple de stars hollywoodiennes qui adoptent le jeune Noir de L’Amour nègre, dans le roman de Jean-Michel Olivier dont tu viens de lire la suite d’Après l’orgie passant, elle aussi, par nos contrées enchanteresses.
De notre terrasse de La Désirade, mon cher Jean, je devine les hauts de Caux où s’achève un autre roman africain, au titre de Mosso, signé par un autre de mes amis, le Tchadien Nétonon Noël Ndjékéry, qui décrit, avec une truculence incisive, les tribulations d’une jeune femme en rupture de communauté par insoumission à des règles qu’elle juge dépassées, se débrouille comme elle peut dans son pays en proie à l’abritraire et à la corruption, et finit en Lémanie dans les pattes d’un Vaudois brasseur d’affaires et se piquant d’humanitarisme. Cela ne manque de rappeler, évidemment, l’humanitarisme de façade du couple de stars hollywoodiennes qui adoptent le jeune Noir de L’Amour nègre, dans le roman de Jean-Michel Olivier dont tu viens de lire la suite d’Après l’orgie passant, elle aussi, par nos contrées enchanteresses.  Du cinéma aux romans je pourrais rebondir sur scène avec Ndongo revient, la pièce de ton fils Dominique, ou avec celle de mon compère René Zahnd, Bab et Sane qui a épaté les publics de toutes couleurs de France en Afrique et d’Allemagne en Suisse. Avec deux comédiens irrésistibles, dont Hassane Kouyaté qu’on retrouvera dans la prochaine pièce de René inspirée par latragédie de Thomas Sankara, ce dialogue mêle l’humour le plus caustique à une réflexion sur le pouvoir et la soumission qui traverse elle aussi les cultures et les époques.
Du cinéma aux romans je pourrais rebondir sur scène avec Ndongo revient, la pièce de ton fils Dominique, ou avec celle de mon compère René Zahnd, Bab et Sane qui a épaté les publics de toutes couleurs de France en Afrique et d’Allemagne en Suisse. Avec deux comédiens irrésistibles, dont Hassane Kouyaté qu’on retrouvera dans la prochaine pièce de René inspirée par latragédie de Thomas Sankara, ce dialogue mêle l’humour le plus caustique à une réflexion sur le pouvoir et la soumission qui traverse elle aussi les cultures et les époques.Or chaque fois que je passe par les hauts de Lausanne, à proximité de l’ancienne villa princière de Mobutu, il me semble entendre le dialogue de ses deux gardiens dont l’auteur a si bien rendu la psychologie, me rappelant d’autres pièces réellement africaines. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que René Zahnd, compagnon de route de René Gonzalez au merveilleux théâtre de Vidy, dont j’espère qu’on le reconduira à la direction de celui-ci alors que les médiocres le snobent comme le milieu littéraire et théâtral local l’a toujours fait - que René donc serait cent fois plus habilité que moi à représenter la Suisse au Congrès des écrivains francophones qui s’ouvre lundi à Lubumbashi. Du moins parlerai-je là-bas de sa démarche d’écrivain-voyageur passionné d’Afrique noire, comme je parlerai de Dürrenmatt et de L’Amour nègre, de Mosso ou encore de cet autre complice qu’est devenu depuis quelques années mon ami Bona Mangangu, jamais rencontré ailleurs que sur la Toile mais que je connais par ses livres et sa peinture et dont j’essaie de faire publier le nouveau roman évoquant la dernière nuit du Caravage…
 À lire ces derniers jours un essai récent de Richard Millet qui a fait trop de bruit pour trop peu de chose, intitulé Langue fantôme et augmenté d’un chapitre annonçant sans vergogne un Eloge littéraire d’Andres Breivik, j’ai ressenti ce profond malaise, mélange de dégoût et de tristesse, que j’ai toujours éprouvé devant les égarements de l’intelligence fascinée par la force. On a vu ça au XXe siècle à l’extrême-droite autant qu’à l’extrême gauche. Un roman russe méconnu, L’Envie de Iouri Olécha, montre cela très bien dans les milieux révolutionnaires du début des Soviets. À droite je me rappelle les textes de Gonzague de Reynold, notre nationaliste helvétiste à poitrine creuse et bréchet de poulet à particule, célébrant la rutilance fringante des soldats allemands, mais à gauche je me rappelle aussi les hymnes aux activistes voire aux terroristes d’esthètes non moins fascinés à la Jean Genet. Et je sens cela aussi entre les lignes parfois pertinentes de Richard Millet: je sens que cela bande là-desous pour la Force comme on le sent aussi chez un Dantec et comme je l’ai senti chez mon ami Dimitri quand il exaltait la pureté des escadrons de Serbes où je ne voyais pour ma part que des brutes ivres violeuses et tueuses.
À lire ces derniers jours un essai récent de Richard Millet qui a fait trop de bruit pour trop peu de chose, intitulé Langue fantôme et augmenté d’un chapitre annonçant sans vergogne un Eloge littéraire d’Andres Breivik, j’ai ressenti ce profond malaise, mélange de dégoût et de tristesse, que j’ai toujours éprouvé devant les égarements de l’intelligence fascinée par la force. On a vu ça au XXe siècle à l’extrême-droite autant qu’à l’extrême gauche. Un roman russe méconnu, L’Envie de Iouri Olécha, montre cela très bien dans les milieux révolutionnaires du début des Soviets. À droite je me rappelle les textes de Gonzague de Reynold, notre nationaliste helvétiste à poitrine creuse et bréchet de poulet à particule, célébrant la rutilance fringante des soldats allemands, mais à gauche je me rappelle aussi les hymnes aux activistes voire aux terroristes d’esthètes non moins fascinés à la Jean Genet. Et je sens cela aussi entre les lignes parfois pertinentes de Richard Millet: je sens que cela bande là-desous pour la Force comme on le sent aussi chez un Dantec et comme je l’ai senti chez mon ami Dimitri quand il exaltait la pureté des escadrons de Serbes où je ne voyais pour ma part que des brutes ivres violeuses et tueuses.Hélas c’est plus fort que moi, mon cher Jean, et je n’y ai aucun mérite en digne fils de mon père le très doux démocrate et bon paroissien protestant : je hais la force des marioles et j’incarne bonnement ce que Richard Millet taxe de décadence en vitupérant le mélange des cultures et le « petit nègre » des hordes insoumises à la pure tradition littéraire française. J’ai presque honte d’aimer la littérature si cet amour va comme chez lui de pair avec la morgue des Maîtres, et puis je me dis que non : que sa façon d’adouber Thomas Bernhard ou Sebald, comme les derniers purs de purs, est assi douteuse que sa façon de taxer d’impurs ou de dégénérés tous les Américains et les Français, de placer Claude Simon au pinacle et de dégommer Le Clézio, bref de tout soumettre à son goût parfois excellent et parfois exécrable. Enfin, lui qui ne jure que par le style se montre ici souvent confus et empesé, sans aucun panache si je le compare au magistral Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire aux envolées, aux traits et aux piques, aux portraits et aux envois dignes des grands pamphlétaires de gauche ou de droite à la Vallès ou à la Bloy !
Richard Millet vomit la multiculturalisme et mélange tout, son exécration des immigrés et du politiquement correct – où je le suis volontiers -, son mépris de la démocratie et sa haine de la gauche, dans une suite de généralisation abusives qui se diluent bel et bien dans l’insignifiance pointée par Le Clézio, dont on comprend au passage qu’il lui ait rivé son clou après avoir subi son fiel vipérin.
Nous autres Suisses, qui avons émigré plus souvent qu’à notre tour au début du XXe siècle, quittant un pays sans ressources pour survivre et revenant sur nos terres avec des savoirs acquis dans le monde entier, nous avons appris à cohabiter après des siècles de conflits à n’en plus finir, et je suis triste de voir souvent que nous le désapprenons. Or ce que j’aime chez toi, qui me disais que ta grand-mère la démocrate des collines bernoises était plus révolutionnaire que toi, c’est ton vieux fonds de paysan catholique au cœur généreux et à l’esprit civique.
 L’an dernier au début de l’été, mon cher Jean, nous nous trouvions en Tunisie avec notre ami l’écrivain Rafik Ben Salah, neveu du ministre socialiste Ahmed que tu as bien connu, et je n’ai cessé de m’évertuer de calmer la fureur anti-islamiste de celui qui, dans tous ses livres, n’a cessé de stigmatiser la triple tyrannie des pères, des imams et du pouvoir. Or ce voyage a été, pour ma bonne amie et moi autant que pour Rafik, ses frères et sœurs établis dans leur pays, ou pour les amis que nous y avons rencontrés – cette romancière,ce médecin très engagé dans le mouvement de libération, le frère avocat de bon conseil, telle autre universaitaire –, une formidable expérience de simple humanité. Devant les palaces vides de la Tunisie vendue au tourisme, je me suis rappelé les reproches du Rafik de vingt ans à son oncle ministre : comme quoi le pouvoir allait faire de la Tunisie une putain ! Là encore quelle exagération. Mais la vieille dame de Dürrenmatt n’a pas fini de voyager. Avec ou sans les islamistes, elle aurait encore tant des choses à dire là-bas autant que chez nous, avec ou sans populistes.
L’an dernier au début de l’été, mon cher Jean, nous nous trouvions en Tunisie avec notre ami l’écrivain Rafik Ben Salah, neveu du ministre socialiste Ahmed que tu as bien connu, et je n’ai cessé de m’évertuer de calmer la fureur anti-islamiste de celui qui, dans tous ses livres, n’a cessé de stigmatiser la triple tyrannie des pères, des imams et du pouvoir. Or ce voyage a été, pour ma bonne amie et moi autant que pour Rafik, ses frères et sœurs établis dans leur pays, ou pour les amis que nous y avons rencontrés – cette romancière,ce médecin très engagé dans le mouvement de libération, le frère avocat de bon conseil, telle autre universaitaire –, une formidable expérience de simple humanité. Devant les palaces vides de la Tunisie vendue au tourisme, je me suis rappelé les reproches du Rafik de vingt ans à son oncle ministre : comme quoi le pouvoir allait faire de la Tunisie une putain ! Là encore quelle exagération. Mais la vieille dame de Dürrenmatt n’a pas fini de voyager. Avec ou sans les islamistes, elle aurait encore tant des choses à dire là-bas autant que chez nous, avec ou sans populistes.Enfin je te laisse, cher fou. Je t’embrasse fraternellement et te remercie encore pour tout.
P.S. Au nombre des 33 livres de la bibliothèque volante que j'emporte au Congo, je relève la nouvelle édition en poche de La haine de l'Occident , avec ta préface sans illusions ni désespoir, un roman de Mongo Beti qui a plus d'un demi-siècle, Le pauvre Christ de Bomba, le livre tout récent d'un jeune Haïtien, Mackenzie Orcel, intitulé Les immortelles, et un autre roman de ces dernières années, Mathématiques congolaises, d'un auteur du nom d'In Koli Jean Bofane. Tout ça, plus le whisky et le chocolat fourré, va faire tanguer les zingues...
-
Ce que la nuit dit au silence

Le secret fait baisser les voix,
et l’on voit les regards
se détourner - on préfère ne pas savoir;
je vous le dis tout bas,
murmure une voix là-bas,
et la rumeur comme une vague
remontée de l’aigreur
se répand en laideurs…
Vous ne savez rien de mes jours,
dit la la nuit au silence,
son vieil ami dont la décence
infiniment sourit
aux paisibles tant qu’aux ardents,
le sourire et le feu
se liguant volontiers en nous
pour faire pièce aux méchants
faussaires de vérités qui blessent…
Les jours ne veulent rien savoir:
ce sont de trop vieux sages
pour se repaitre encore d’images
aux écrans avilis
par toute les simulations -
venez à nous gentils enfants
des secrets bien gardés,
et tout vous sera révélé…
Peinture: Thierry Vernet, conversation nocturne. -
Frères et soeurs
(Chronique des tribus)
 1. En mémoire de l'HidalgoLe frère dit à la sœur que sa vie tient à un fil : que vraiment il se sent en fin de partie, que le souffle lui manque, qu’il marche comme un vieux alors qu’il se sent l’esprit encore tout vif, mais la carcasse ne suit plus, il est évident que tout se déglingue, qu’il se réveille fatigué et qu’ensuite il se traîne ; mais elle, octogénaire pimpante qui a ce soir un sac avec elle, sort de celui-ci une ample vareuse de cuir fauve comme neuve, et des gants noirs genre ecclésiastique tout confort et sept paires de lunettes de lecture, et lui dit sans relever rien de ce qu’il lui a déclaré : je t’ai mis ça de côté, t’auras l’air comme lui d’un Hidalgo, tu vas voir le style, et le frère de se récrier : ah merci frangine mais les gants pas question, pas du tout le genre de la maison, et elle replongeant la main dans son sac : et ça encore, tu ne vas pas refuser, et voici qu’elle lui sort encore un pull sport chic gris à chevrons, un longue belle écharpe de matière noble et de couleur chaude, puis encore trois paires de bas de belle épaisseur et doux au toucher, et la voilà qui insiste pour les lunettes avec lesquelles il lira et écrira en pensant au cher disparu – de fait c’est comme ça, comme un transit visible et une digne passation de signes extérieurs d'élégance hispano-latino que le frère voit le geste impérieusement généreux de la sœur de lui confier les vêtements chics et autres objets usuels de l’Hidalgo dont elle vient de célébrer la première année du deuil : ce besoin de transmettre qui l’obsède lui-même de la même façon en ces jours où se pose pour lui la question de la cession de son propre legs personnel, à savoir le Corpus (« ceci est mon corps », sans majuscules) d’une vingtaine de milliers de livres ainsi qu'une bonne centaine de tableaux de maîtres moyens et modestes ou autres objets curieux dont un Bouddha séculaire aux flancs rongés par les termites et telle figure votive du peuple Inuit taillée au canif à manche de corne dans un os de baleine…
1. En mémoire de l'HidalgoLe frère dit à la sœur que sa vie tient à un fil : que vraiment il se sent en fin de partie, que le souffle lui manque, qu’il marche comme un vieux alors qu’il se sent l’esprit encore tout vif, mais la carcasse ne suit plus, il est évident que tout se déglingue, qu’il se réveille fatigué et qu’ensuite il se traîne ; mais elle, octogénaire pimpante qui a ce soir un sac avec elle, sort de celui-ci une ample vareuse de cuir fauve comme neuve, et des gants noirs genre ecclésiastique tout confort et sept paires de lunettes de lecture, et lui dit sans relever rien de ce qu’il lui a déclaré : je t’ai mis ça de côté, t’auras l’air comme lui d’un Hidalgo, tu vas voir le style, et le frère de se récrier : ah merci frangine mais les gants pas question, pas du tout le genre de la maison, et elle replongeant la main dans son sac : et ça encore, tu ne vas pas refuser, et voici qu’elle lui sort encore un pull sport chic gris à chevrons, un longue belle écharpe de matière noble et de couleur chaude, puis encore trois paires de bas de belle épaisseur et doux au toucher, et la voilà qui insiste pour les lunettes avec lesquelles il lira et écrira en pensant au cher disparu – de fait c’est comme ça, comme un transit visible et une digne passation de signes extérieurs d'élégance hispano-latino que le frère voit le geste impérieusement généreux de la sœur de lui confier les vêtements chics et autres objets usuels de l’Hidalgo dont elle vient de célébrer la première année du deuil : ce besoin de transmettre qui l’obsède lui-même de la même façon en ces jours où se pose pour lui la question de la cession de son propre legs personnel, à savoir le Corpus (« ceci est mon corps », sans majuscules) d’une vingtaine de milliers de livres ainsi qu'une bonne centaine de tableaux de maîtres moyens et modestes ou autres objets curieux dont un Bouddha séculaire aux flancs rongés par les termites et telle figure votive du peuple Inuit taillée au canif à manche de corne dans un os de baleine… 2. Le pull sport chic. – Leur frère aîné lui reprochait à tout coup de se poser trop de questions, mais ça ne l’a pas empêché, en déballant le pull gris à chevrons très classe que lui a offert sa sœur, de se lancer dans une suite vertigineuse d’interrogations liées aux données du donner et du recevoir, au fait d’offrir de tout cœur un objet chargé de significations inattendues, au cadeau devenant objet transitionnel sans que le donneur (ou la donneuse de l’occurrence) ni le receveur ne le réalisent peut-être, à moins que celui-ci le saisisse aussitôt et réagisse peut-être à fleur de nerfs (ce cousin recevant un lot de cravates de la veuve de l’oncle longtemps emprisonné pour une sale affaire), mais pas de quoi s’affoler dans le cas du pull sport chic à chevrons que la sœur a cru bon de lui offrir en toute générosité sororale un rien maternante (« ca le changera de ses pulls troués »), et qui malgré tout « l’interroge », comme on dit aujourd’hui, l’évidence lui sautant soudain aux yeux que sa sœur l’a choisi lui alors qu’il eût été exclu qu’elle le proposât à leur frère aîné (vraiment trop corpulent passé la quarantaine) ou au plus grand de ses petits-fils (trop svelte et peut-être trop large d’épaules), la question renvoyant alors incidemment à celle de l’identification physique (mais peut-être aussi psychologique, affective ou esthétique), d’un vêtement et d’une personne, qui ferait de ce pull sport chic gris à chevrons l’emblème de telle personnalité (ici l’Hidalgo hors de ses heures de travail, ne sortant pas à l’air du soir sans « une petite laine » ou se pointant à l’apéro de fin de matinée sur le Paseo de Benidorm), incompatible avec la « dégaine » de tel autre personnage supposé a priori le porter sans problème, comme la sœur en a jugé de son frère puîné…La question élargie serait donc, exacerbée par l’esprit d’escalier du frère en question – ce coupeur de cheveux en quatre, selon le frère aîné hélas décédé il y a une vingtaine d’années -, de savoir ce qui fait, d’un vêtement personnel même « à l’état de neuf », un objet-cadeau effectivement transmissible et à qui, précisément selon quels critères objectifs ou quel ressenti « au pif », étant entendu que la transmission gracieuse d’un pull genre sport chic convenant à un mâle blanc portant encore beau dans sa soixantaine apparente d'octogénaire ne peut se faire qu’à un individu à peu près de la même taille et de la même prestance sociale (et là ça coince un peu, songe le frère puîné) et du même goût (moi et les chevrons, ça fait deux…) , sans minimiser le fait du ventre plus ou moins plat…Ergo : le frère se dit ce soir qu’il va garder le pull sport chic à chevrons en souvenir de l’Hidalgo, quitte à le revêtir lors de la prochaine visite de sa sœur, histoire de lui faire plaisir vu que c’est pour lui faire plaisir qu’elle l’a pour ainsi dire « élu »…
2. Le pull sport chic. – Leur frère aîné lui reprochait à tout coup de se poser trop de questions, mais ça ne l’a pas empêché, en déballant le pull gris à chevrons très classe que lui a offert sa sœur, de se lancer dans une suite vertigineuse d’interrogations liées aux données du donner et du recevoir, au fait d’offrir de tout cœur un objet chargé de significations inattendues, au cadeau devenant objet transitionnel sans que le donneur (ou la donneuse de l’occurrence) ni le receveur ne le réalisent peut-être, à moins que celui-ci le saisisse aussitôt et réagisse peut-être à fleur de nerfs (ce cousin recevant un lot de cravates de la veuve de l’oncle longtemps emprisonné pour une sale affaire), mais pas de quoi s’affoler dans le cas du pull sport chic à chevrons que la sœur a cru bon de lui offrir en toute générosité sororale un rien maternante (« ca le changera de ses pulls troués »), et qui malgré tout « l’interroge », comme on dit aujourd’hui, l’évidence lui sautant soudain aux yeux que sa sœur l’a choisi lui alors qu’il eût été exclu qu’elle le proposât à leur frère aîné (vraiment trop corpulent passé la quarantaine) ou au plus grand de ses petits-fils (trop svelte et peut-être trop large d’épaules), la question renvoyant alors incidemment à celle de l’identification physique (mais peut-être aussi psychologique, affective ou esthétique), d’un vêtement et d’une personne, qui ferait de ce pull sport chic gris à chevrons l’emblème de telle personnalité (ici l’Hidalgo hors de ses heures de travail, ne sortant pas à l’air du soir sans « une petite laine » ou se pointant à l’apéro de fin de matinée sur le Paseo de Benidorm), incompatible avec la « dégaine » de tel autre personnage supposé a priori le porter sans problème, comme la sœur en a jugé de son frère puîné…La question élargie serait donc, exacerbée par l’esprit d’escalier du frère en question – ce coupeur de cheveux en quatre, selon le frère aîné hélas décédé il y a une vingtaine d’années -, de savoir ce qui fait, d’un vêtement personnel même « à l’état de neuf », un objet-cadeau effectivement transmissible et à qui, précisément selon quels critères objectifs ou quel ressenti « au pif », étant entendu que la transmission gracieuse d’un pull genre sport chic convenant à un mâle blanc portant encore beau dans sa soixantaine apparente d'octogénaire ne peut se faire qu’à un individu à peu près de la même taille et de la même prestance sociale (et là ça coince un peu, songe le frère puîné) et du même goût (moi et les chevrons, ça fait deux…) , sans minimiser le fait du ventre plus ou moins plat…Ergo : le frère se dit ce soir qu’il va garder le pull sport chic à chevrons en souvenir de l’Hidalgo, quitte à le revêtir lors de la prochaine visite de sa sœur, histoire de lui faire plaisir vu que c’est pour lui faire plaisir qu’elle l’a pour ainsi dire « élu »… 3. À la chasseAu moment d’endosser l’ample vareuse à profondes poches que sa sœur lui a offert en mémoire de l’Hidalgo, le frère, trouvant au vêtement le tour d’une veste de chasse, s’est aussitôt rappelé la partie mémorable qu’il aura vécue, quarante ans plus tôt, avec le fameux écrivain Vladimir Volkoff, monté en notoriété durant ces années, et qui surgit ce matin-là, à la porte du motel de Macon (Georgia) qu’il avait réservé à son invité, vêtu d’un véritable déguisement de chasseur de comédie, le costume à motifs de camouflage et le chapeau qu’on dira typique chapeau de chasse solognac, ou chapeau bob à larges bords rappelant les chapeaux de brousse et que le romancier portait légèrement de côté par coquetterie héritée de ses années de militaire en Algérie, comme le fusil de chasse apparié...Le frère, lui, n’avait point d’arme et s’était récrié la veille avec véhémence à la seule idée de tuer un animal, ni bécasse à la Maupassant ni même bécassine, pas une mouche, pas un pou – enfin en principe, et Volkoff, un rien piqué, avait admis la réserve de cette espèce d’objecteur de conscience qu’il emmènerait tout de même en forêt, en espérant le convertir un peu après avoir renoncé à le persuader de la noble nécessité, non seulement de la chasse mais de la guerre, et de son occasionnelle sainteté...Que la partie de chasse de ce jour-là ait été un fiasco total pour l’écrivain tueur, le frère s’en félicitait, Volkoff le présentant volontiers, revenu en France, comme son « porte-poisse », mais la sœur voulut savoir ce qu’il avait fait, lui, le rabat-joie, pendant que le chasseur chassait, alors le frère de faire le crâne : j’étais couché au pied d’un sycomore, en mon innocence rêveuse de déserteurs virtuel, et je songeais à ces vers de Victor Hugo inspirés par une sorcière de l'ile de Man qui, ayant recueilli un pigeon blessé par un chasseur, murmurait en sa magique tendresse : «N’est-ce pas Nature, / que tu hais les semeurs de trépas / Qui dans l'air frappent l'aigle et sur l'eau la sarcelle, / Et font partout saigner la vie universelle ? »
3. À la chasseAu moment d’endosser l’ample vareuse à profondes poches que sa sœur lui a offert en mémoire de l’Hidalgo, le frère, trouvant au vêtement le tour d’une veste de chasse, s’est aussitôt rappelé la partie mémorable qu’il aura vécue, quarante ans plus tôt, avec le fameux écrivain Vladimir Volkoff, monté en notoriété durant ces années, et qui surgit ce matin-là, à la porte du motel de Macon (Georgia) qu’il avait réservé à son invité, vêtu d’un véritable déguisement de chasseur de comédie, le costume à motifs de camouflage et le chapeau qu’on dira typique chapeau de chasse solognac, ou chapeau bob à larges bords rappelant les chapeaux de brousse et que le romancier portait légèrement de côté par coquetterie héritée de ses années de militaire en Algérie, comme le fusil de chasse apparié...Le frère, lui, n’avait point d’arme et s’était récrié la veille avec véhémence à la seule idée de tuer un animal, ni bécasse à la Maupassant ni même bécassine, pas une mouche, pas un pou – enfin en principe, et Volkoff, un rien piqué, avait admis la réserve de cette espèce d’objecteur de conscience qu’il emmènerait tout de même en forêt, en espérant le convertir un peu après avoir renoncé à le persuader de la noble nécessité, non seulement de la chasse mais de la guerre, et de son occasionnelle sainteté...Que la partie de chasse de ce jour-là ait été un fiasco total pour l’écrivain tueur, le frère s’en félicitait, Volkoff le présentant volontiers, revenu en France, comme son « porte-poisse », mais la sœur voulut savoir ce qu’il avait fait, lui, le rabat-joie, pendant que le chasseur chassait, alors le frère de faire le crâne : j’étais couché au pied d’un sycomore, en mon innocence rêveuse de déserteurs virtuel, et je songeais à ces vers de Victor Hugo inspirés par une sorcière de l'ile de Man qui, ayant recueilli un pigeon blessé par un chasseur, murmurait en sa magique tendresse : «N’est-ce pas Nature, / que tu hais les semeurs de trépas / Qui dans l'air frappent l'aigle et sur l'eau la sarcelle, / Et font partout saigner la vie universelle ? » 4. La belle noyeuseLe frère, transi sous le ciel bas, l’air glacial comme réfracté par les flancs des monts noirs enneigés jusqu’au bord du lac où il se trouve à mater le manège de la cinglée, se félicite d’avoir accepté la veste de cuir de l’Hidalgo que lui a offert sa sœur l’avant-veille au soir, plus lourde à ses épaules lui semble-t-il, ses mains dans les profondes poches (il se maudit d’avoir refusé les gants) et se les gelant juste mentalement à voir vraiment, à l’instant, la silhouette à capuche noire se désaper sur le rivage.Cette folle a-t-elle résolu de se noyer le lendemain de Noel ? Le frère décrira la scène à sa sœur par Whatsapp, quitte à ce que ça lui donne froid (elle doit être arrivée à Marbella), comment il a vu le personnage à capuche se rapprocher de l’eau nanti d’un sac noir, comment il lui a semblé d’abord que c’était un mec à l’invisible visage, lequel a surgi soudain après la dépose du sac, et l’ouverture du sac, l’apparition d’un long limaçon rouge qui ne pouvait être qu’un caleçon de naïade, et c’est là que le frère à pensé nageuse plus que supposée noyée, et que le néologisme lui est venu en concluant, au vu de la splendide nudité glorieusement féminine de l’énergumène, qu’il s’agissait là d’une noyeuse.Tout cela relevant bonnement de l’Apparition, la noyeuse nageant maintenant là-bas comme si de rien n’était, sa seule tête au bonnet noir émergeant des flots transis comme d'une ondulante otarie, le frère, juste après s’être fait un selfie prouvant à sa sœur qu’il avait bel et bien endossé la veste de cuir de l’Hidalgo sans laquelle il eût canné de froid, s’interdit en revanche de fixer l’image de la belle noyeuse, comme s’il eût voulu se la garder rien que pour lui, telle étant la chair: faible et ravie...
4. La belle noyeuseLe frère, transi sous le ciel bas, l’air glacial comme réfracté par les flancs des monts noirs enneigés jusqu’au bord du lac où il se trouve à mater le manège de la cinglée, se félicite d’avoir accepté la veste de cuir de l’Hidalgo que lui a offert sa sœur l’avant-veille au soir, plus lourde à ses épaules lui semble-t-il, ses mains dans les profondes poches (il se maudit d’avoir refusé les gants) et se les gelant juste mentalement à voir vraiment, à l’instant, la silhouette à capuche noire se désaper sur le rivage.Cette folle a-t-elle résolu de se noyer le lendemain de Noel ? Le frère décrira la scène à sa sœur par Whatsapp, quitte à ce que ça lui donne froid (elle doit être arrivée à Marbella), comment il a vu le personnage à capuche se rapprocher de l’eau nanti d’un sac noir, comment il lui a semblé d’abord que c’était un mec à l’invisible visage, lequel a surgi soudain après la dépose du sac, et l’ouverture du sac, l’apparition d’un long limaçon rouge qui ne pouvait être qu’un caleçon de naïade, et c’est là que le frère à pensé nageuse plus que supposée noyée, et que le néologisme lui est venu en concluant, au vu de la splendide nudité glorieusement féminine de l’énergumène, qu’il s’agissait là d’une noyeuse.Tout cela relevant bonnement de l’Apparition, la noyeuse nageant maintenant là-bas comme si de rien n’était, sa seule tête au bonnet noir émergeant des flots transis comme d'une ondulante otarie, le frère, juste après s’être fait un selfie prouvant à sa sœur qu’il avait bel et bien endossé la veste de cuir de l’Hidalgo sans laquelle il eût canné de froid, s’interdit en revanche de fixer l’image de la belle noyeuse, comme s’il eût voulu se la garder rien que pour lui, telle étant la chair: faible et ravie... 5. Sous le manteauFace au lac froid, sous le ciel noir, la veste de chasse de l’Hidalgo est devenue caban d’ombre sous lequel le frère se sentait chaste et pur, non pas soumis au don’t touch ( noli tangere) de la pudeur conventionnelle ni moins encore interdit de contact comme au temps du confinement totalitaire, mais retenu de surprise en somme de haut comique comme en enfance quand on découvre derrière le bosquet le bouc bougrant la bique ou que le piton du grand frère, le nichon de la sœur pointent du pigeonnier ou au balcon.De fait, autant l’apparition de la belle noyeuse excluait toute songerie sensuelle tant l’atmosphère tendait à la frigidité tactile, autant elle exaltait l’aspect drolatique de l’exhibition de chair fraîche – c’est le moins qu’on pût dire – dans sa tournure à la fois hardie et platement sportive voire hygiénique relevant du seul souci de « garder la forme ». Et quelle expression sérieuse elle avait ! Quel air de défi quand se redressant sur les cailloux durs elle l’avait aperçu la regardant mine de rien du bord du quai. concluant peut-être au voyeur vicieux ou même au potentiel harceleur, se détournant impatiemment sans remarquer le petit signe amical qu’il lui avait adressé en pensant à ses filles à peu près du même âge, retrouvées la veille avec les enfants petits et toute la smala fêtant la naissance miraculeuse du divin hippie.« Par ailleurs tu te souviens que notre mère aussi allait se la jouer sirène du lac passé 80 ans, le jour même où sa dernière attaque l’a terrassée », texte le frère à la sœur qui répond illico par le même canal numérique de Whatsapp : «Mais c’était en été… ».Et demain ils reprendront leurs échanges relatifs aux redoutables pudeurs de leurs aïeules, qui eussent peut-être désapprouvé l’exhibition de la belle noyeuse, mais est-ce si sûr en ce monde où, sous le manteau, la vie continue de ménager ses surprises ?
5. Sous le manteauFace au lac froid, sous le ciel noir, la veste de chasse de l’Hidalgo est devenue caban d’ombre sous lequel le frère se sentait chaste et pur, non pas soumis au don’t touch ( noli tangere) de la pudeur conventionnelle ni moins encore interdit de contact comme au temps du confinement totalitaire, mais retenu de surprise en somme de haut comique comme en enfance quand on découvre derrière le bosquet le bouc bougrant la bique ou que le piton du grand frère, le nichon de la sœur pointent du pigeonnier ou au balcon.De fait, autant l’apparition de la belle noyeuse excluait toute songerie sensuelle tant l’atmosphère tendait à la frigidité tactile, autant elle exaltait l’aspect drolatique de l’exhibition de chair fraîche – c’est le moins qu’on pût dire – dans sa tournure à la fois hardie et platement sportive voire hygiénique relevant du seul souci de « garder la forme ». Et quelle expression sérieuse elle avait ! Quel air de défi quand se redressant sur les cailloux durs elle l’avait aperçu la regardant mine de rien du bord du quai. concluant peut-être au voyeur vicieux ou même au potentiel harceleur, se détournant impatiemment sans remarquer le petit signe amical qu’il lui avait adressé en pensant à ses filles à peu près du même âge, retrouvées la veille avec les enfants petits et toute la smala fêtant la naissance miraculeuse du divin hippie.« Par ailleurs tu te souviens que notre mère aussi allait se la jouer sirène du lac passé 80 ans, le jour même où sa dernière attaque l’a terrassée », texte le frère à la sœur qui répond illico par le même canal numérique de Whatsapp : «Mais c’était en été… ».Et demain ils reprendront leurs échanges relatifs aux redoutables pudeurs de leurs aïeules, qui eussent peut-être désapprouvé l’exhibition de la belle noyeuse, mais est-ce si sûr en ce monde où, sous le manteau, la vie continue de ménager ses surprises ? 7. Comme un sac de charbon !Dans le fragment de récit de vie de leur père, rédigé pour le frère qui l’a transmis à sa sœur aînée en pièce attachée, il est question d’une enfance petitement heureuse dont quelques images bien concrètes frisent le misérabilisme sans le chercher (le père est trop timide pour exagérer), comme celle des enfants jouant dans la cour de l’immeuble miteux de l’avenue de France, soudain surpris par le bruit sourd quoique violent de ce qu’ils croient d’abord un paquet de tapis jeté d’un des hauts balcons par quelque ménagère de mauvaise humeur, et qui se révèle le corps d’un vieillard impatient d’en finir avec sa pauvre vie, tombé là comme un sac de charbon…La sœur dira à son frère qu’elle ne s’attendait pas à la noirceur de ces épisodes familiaux, ce qu’il y apparaît de poisseux et de sordide, typique en somme des quartiers de l’Ouest suburbain, vers Renens et Crissier où cela « sent l’ouvrier », le dégoût de l’alcool sale et du sexe banalisé au lieu mal famé dudit Chalet vert où paressent les oncles du « deuxième lit », tout cela raconte un entre-deux guerres local dont on n’avait pas idée, relève la sœur, et le frère abonde en se rappelant, par tendre contraste, ses aïeux gentils de la période suivante où l’on passait du noir et blanc vicié à un semblant de couleurs...« Notre père, à son aveu, était un garçon trop adipeux, économiquement faible au milieu des fils de nantis du collège, que ceux-ci harcelaient à merci, et sa langue ne se déliait en insolences qu’auprès de sa mère qui le boudait alors pendant des semaines, à ce qu’il dit, et son père à lui se taisait - tout cela faisant de lui le futur empêché qui a trop subi sans oser envoyer promener son monde », commente le frère, et la sœur : « comme toi je découvre tout ça et ça me rapproche un peu plus de lui avec, dans son récit ce bruit épouvantable de sac de charbon qui tombe, non mais j’ai mal pour lui »
7. Comme un sac de charbon !Dans le fragment de récit de vie de leur père, rédigé pour le frère qui l’a transmis à sa sœur aînée en pièce attachée, il est question d’une enfance petitement heureuse dont quelques images bien concrètes frisent le misérabilisme sans le chercher (le père est trop timide pour exagérer), comme celle des enfants jouant dans la cour de l’immeuble miteux de l’avenue de France, soudain surpris par le bruit sourd quoique violent de ce qu’ils croient d’abord un paquet de tapis jeté d’un des hauts balcons par quelque ménagère de mauvaise humeur, et qui se révèle le corps d’un vieillard impatient d’en finir avec sa pauvre vie, tombé là comme un sac de charbon…La sœur dira à son frère qu’elle ne s’attendait pas à la noirceur de ces épisodes familiaux, ce qu’il y apparaît de poisseux et de sordide, typique en somme des quartiers de l’Ouest suburbain, vers Renens et Crissier où cela « sent l’ouvrier », le dégoût de l’alcool sale et du sexe banalisé au lieu mal famé dudit Chalet vert où paressent les oncles du « deuxième lit », tout cela raconte un entre-deux guerres local dont on n’avait pas idée, relève la sœur, et le frère abonde en se rappelant, par tendre contraste, ses aïeux gentils de la période suivante où l’on passait du noir et blanc vicié à un semblant de couleurs...« Notre père, à son aveu, était un garçon trop adipeux, économiquement faible au milieu des fils de nantis du collège, que ceux-ci harcelaient à merci, et sa langue ne se déliait en insolences qu’auprès de sa mère qui le boudait alors pendant des semaines, à ce qu’il dit, et son père à lui se taisait - tout cela faisant de lui le futur empêché qui a trop subi sans oser envoyer promener son monde », commente le frère, et la sœur : « comme toi je découvre tout ça et ça me rapproche un peu plus de lui avec, dans son récit ce bruit épouvantable de sac de charbon qui tombe, non mais j’ai mal pour lui » 8. Déchirons la Vieille !Ni l’une ni l’autre de ses deux sœurs n’étant ferrée en théologie, moins encore en exégèse patristique, le frère n’insistera pas sur une façon de parler de l’Apôtre qui va en somme de soi quand il dit qu’il faut « dépouiller le vieil homme », l’une et l’autre ayant assez de bon sens pour comprendre qu’il ne s’agit pas de faire les poches des seniors, mais en ce dernier jour de l’an c’est au parler du populo, plutôt qu’aux métaphores bibliques, qu’il se réfère quand il se fait fort de leur révéler à toutes deux, par messages numériques séparés accompagnant ses meilleurs vœux, cela qu’elles ignorent très probablement: à savoir que les charivaris populaires d’antan précédant le réveillon de la Saint-Sylvestre étaient assortis de danses et de cris destinés à « chasser la Vieille », qu’en certaines régions l’on disait plus férocement « déchirer la Vieille », et pis encore chez les enfants basques de naguère brandissant des chiffons en feu qui s’exclamaient en troupes : « brûlons le cul de la Vieille ! ».Or l’Hidalgo lui-même, Asturien de souche et lui aussi sorti d’une tribu populaire à coutumes anciennes et dictons à foison, pourrait-il y ajouter quelque souvenir évoquant à sa façon l’impatience du commun de tourner le dos aux jours passés déjà ridés ou juste bons à jeter aux oubliettes du temps, quitte à les en ressortir plus tard et à les embellir au gré d’une nostalgie croissant avec les années ?Trop tard pour le lui demander, mais ce soir nous en convenons autant en levant nos verres: que la veille est décidément une Vieille et que demain matin, même avec un an de plus, nous chanterons Forever young avec Bob Dylan et nos bons amis et amies, nos sœurs et nos kids en chœur ainsi que d’ailleurs ils apparaissent à l’instant sur les deux photos de groupes instagrammés que le frère reçoit de ses deux sœurs…
8. Déchirons la Vieille !Ni l’une ni l’autre de ses deux sœurs n’étant ferrée en théologie, moins encore en exégèse patristique, le frère n’insistera pas sur une façon de parler de l’Apôtre qui va en somme de soi quand il dit qu’il faut « dépouiller le vieil homme », l’une et l’autre ayant assez de bon sens pour comprendre qu’il ne s’agit pas de faire les poches des seniors, mais en ce dernier jour de l’an c’est au parler du populo, plutôt qu’aux métaphores bibliques, qu’il se réfère quand il se fait fort de leur révéler à toutes deux, par messages numériques séparés accompagnant ses meilleurs vœux, cela qu’elles ignorent très probablement: à savoir que les charivaris populaires d’antan précédant le réveillon de la Saint-Sylvestre étaient assortis de danses et de cris destinés à « chasser la Vieille », qu’en certaines régions l’on disait plus férocement « déchirer la Vieille », et pis encore chez les enfants basques de naguère brandissant des chiffons en feu qui s’exclamaient en troupes : « brûlons le cul de la Vieille ! ».Or l’Hidalgo lui-même, Asturien de souche et lui aussi sorti d’une tribu populaire à coutumes anciennes et dictons à foison, pourrait-il y ajouter quelque souvenir évoquant à sa façon l’impatience du commun de tourner le dos aux jours passés déjà ridés ou juste bons à jeter aux oubliettes du temps, quitte à les en ressortir plus tard et à les embellir au gré d’une nostalgie croissant avec les années ?Trop tard pour le lui demander, mais ce soir nous en convenons autant en levant nos verres: que la veille est décidément une Vieille et que demain matin, même avec un an de plus, nous chanterons Forever young avec Bob Dylan et nos bons amis et amies, nos sœurs et nos kids en chœur ainsi que d’ailleurs ils apparaissent à l’instant sur les deux photos de groupes instagrammés que le frère reçoit de ses deux sœurs… 9. L'Art d'être grand-pèreCe premier jour de l’an qui est dédié à sainte Marie, l’octave de la Nativité, naguère fête de la circoncision de Notre Seigneur, étant désormais consacré à la Vierge, on ne sait trop (pense le frère de confession protestante par fatalité familiale) selon quelle décision conciliaire, reste dans la mémoire latente de l‘humanité occidentale comme le jour où le président des Etats-Unis Abraham Lincoln, le 1er janvier 1863, a proclamé l’émancipation des esclaves, mais c’est de toute autre chose que le frère a envie de parler ce matin à sa sœur aînée se royaumant, ces jours, dans une urbanisation chic de Marbella en compagnie de son deuxième petit-fils et de la mère de celui-ci, l’aîné s’exerçant au ski freestyle dans les Alpes du Bas-Valais, non : ce qu’aimerait savoir le frère est quel genre d’abuelito était l’Hidalgo, et sa sœur lui répond qu’il n’en avait pas vraiment l’air, si tu le compares à nos propre aïeux toujours vêtus de gris ou de noir, mais qu'il avait bel et bien sa dignité, ça c’est sûr, et les garçons ne lui dansaient pas sur le ventre, alors le frère le prend pour lui avec ses cheveux toujours trop longs et ses jeans mal repassés, songeant maintenant à l’esseulement probable de ses deux grands-pères aux tournants des nouvelles années qu’ils ont connus à son âge actuel : chacun dans son coin et sans dindes ni feux d’artifice – tant le « pépé de Lausanne » que le « pépé de Lucerne » à peu près oubliés par leurs tribus respectives en train de fêter le réveillon, et le frère ignore à vrai dire à quel moment exactement, où et comment chacun d’eux « s’en est allé », comme on le dit par euphémisme, et la sœur non plus n’aura pas assisté à leurs enterrements respectifs, le second ayant « tenu » vingt ans de plus que son ancien collègue de l’Hôtel Royal du Caire…Le soir le frère, à la table de ses amis Jackie et Tonio, aussi vieux de la vieille que lui, en vient à parler de ce statut d’aïeux dignes qu’ils ne lui semblent pas mieux incarner que lui, et l’on en vient à conclure que c’est affaire de génération : tous trois sont des boomers et se voient en ados décatis plus qu’en vénérables aînés prodigues de conseils et autres sagesses, mais de parler de tout ça les rapproche à l’intime et ça réchauffe leur début d’année de vieilles peaux effleurées par la nostalgie…
9. L'Art d'être grand-pèreCe premier jour de l’an qui est dédié à sainte Marie, l’octave de la Nativité, naguère fête de la circoncision de Notre Seigneur, étant désormais consacré à la Vierge, on ne sait trop (pense le frère de confession protestante par fatalité familiale) selon quelle décision conciliaire, reste dans la mémoire latente de l‘humanité occidentale comme le jour où le président des Etats-Unis Abraham Lincoln, le 1er janvier 1863, a proclamé l’émancipation des esclaves, mais c’est de toute autre chose que le frère a envie de parler ce matin à sa sœur aînée se royaumant, ces jours, dans une urbanisation chic de Marbella en compagnie de son deuxième petit-fils et de la mère de celui-ci, l’aîné s’exerçant au ski freestyle dans les Alpes du Bas-Valais, non : ce qu’aimerait savoir le frère est quel genre d’abuelito était l’Hidalgo, et sa sœur lui répond qu’il n’en avait pas vraiment l’air, si tu le compares à nos propre aïeux toujours vêtus de gris ou de noir, mais qu'il avait bel et bien sa dignité, ça c’est sûr, et les garçons ne lui dansaient pas sur le ventre, alors le frère le prend pour lui avec ses cheveux toujours trop longs et ses jeans mal repassés, songeant maintenant à l’esseulement probable de ses deux grands-pères aux tournants des nouvelles années qu’ils ont connus à son âge actuel : chacun dans son coin et sans dindes ni feux d’artifice – tant le « pépé de Lausanne » que le « pépé de Lucerne » à peu près oubliés par leurs tribus respectives en train de fêter le réveillon, et le frère ignore à vrai dire à quel moment exactement, où et comment chacun d’eux « s’en est allé », comme on le dit par euphémisme, et la sœur non plus n’aura pas assisté à leurs enterrements respectifs, le second ayant « tenu » vingt ans de plus que son ancien collègue de l’Hôtel Royal du Caire…Le soir le frère, à la table de ses amis Jackie et Tonio, aussi vieux de la vieille que lui, en vient à parler de ce statut d’aïeux dignes qu’ils ne lui semblent pas mieux incarner que lui, et l’on en vient à conclure que c’est affaire de génération : tous trois sont des boomers et se voient en ados décatis plus qu’en vénérables aînés prodigues de conseils et autres sagesses, mais de parler de tout ça les rapproche à l’intime et ça réchauffe leur début d’année de vieilles peaux effleurées par la nostalgie… 10. L'abuelito de la chansonCe matin la sœur était en train de procéder à d’intenses élongations de stretching sur sa terrasse des Mimosas face à la mer étale et sous le soleil slurpant la rosée de la pelouse du golf en pente jouxtant l’urbanisation de Carbopino, dans les environs proches de Marbella où le compère Julio Iglesias coule ses vieux jours en sussurant son Oh la la l'amour, mais c’est d'un autre début de chanson que le frère, l’interrompant dans son exercice hygiénique, lui a fredonné les paroles sur Whatsapp, du poète Goytisolo mis en mélodie par notre cher vieux Paco Ibanez,Me lo decía mi abuelito,me lo decía mi papá,me lo dijeron muchas vecesy lo olvidaba muchas más...Et le nom du baladin, autant que le mot abuelito, leur a rappelé à tous deux, et avec l’Hidalgo en pensée, lequel restait alors d’une gauche naturelle de fils d’ouvrier des Asturies quand ils écoutaient ensemble les inoubliables adaptations des Lorca et autres Bergamin (et Machado et tant d’autres) par le vieil anar dans sa nonante et unième année depuis la veille, et la sœur de remarquer alors que sa belle-mère communiste en était fan folle elle aussi, avant de raconter au frère l’anecdote corsée de ladite mère de l’Hidalgo planquant quelque temps chez elle, par pure compassion faisant fi de ses idées, un commandant fasciste alors menacé physiquement par ses adversaires politiques qui, plus tard, par manière de reconnaissance, quand son pouvoir militaire local fut rétabli, protégea le fils conscrit en le gratifiant du titre d’ordonnance au dam des autres jeunes troufions fils à papas franquistes briguant le poste en question…Naturellement très à gauche à vingt ans, comme le frère d’ailleurs, l’Hidalgo, débarqué en Helvétie xénophobe, aura transité en un peu plus de six décennies vers la droite conséquente des capitaine d’entreprise, au gré de sa montée en grade de grand travailleur sur le terrain – le frère se rappelle son récit de surveillant-chef des chantiers vénézuéliens donnant ses ordres à cheval, avant son retour au pays où il devint une sorte de ponte de l’immobilier catalan puis asturien…Traître à sa classe d’origine ? Bien plutôt Asturien pure et dur, quoique très doux abuelito au dire de la sœur, et Paco ne lui en voudra pas , qui connaît trop bien les arnaques de l’idéologie et les opportunistes se la jouant amis du peuple.…Trabaja niño, no te piensesque sin dinero vivirás.Junta el esfuerzo y el ahorroábrete paso, ya verás,como la vida te deparabuenos momentos, te alzarássobre los pobres y mezquinosque no han sabido descollar…Travaille mon enfant, ne pense pasque sans argent tu vivras.Combine efforts et économiespasse ton chemin, tu verras,comment la vie t'apportede bons moments, tu verrasà propos des pauvres et des méchantsqu'ils n'ont pas su y faire...
10. L'abuelito de la chansonCe matin la sœur était en train de procéder à d’intenses élongations de stretching sur sa terrasse des Mimosas face à la mer étale et sous le soleil slurpant la rosée de la pelouse du golf en pente jouxtant l’urbanisation de Carbopino, dans les environs proches de Marbella où le compère Julio Iglesias coule ses vieux jours en sussurant son Oh la la l'amour, mais c’est d'un autre début de chanson que le frère, l’interrompant dans son exercice hygiénique, lui a fredonné les paroles sur Whatsapp, du poète Goytisolo mis en mélodie par notre cher vieux Paco Ibanez,Me lo decía mi abuelito,me lo decía mi papá,me lo dijeron muchas vecesy lo olvidaba muchas más...Et le nom du baladin, autant que le mot abuelito, leur a rappelé à tous deux, et avec l’Hidalgo en pensée, lequel restait alors d’une gauche naturelle de fils d’ouvrier des Asturies quand ils écoutaient ensemble les inoubliables adaptations des Lorca et autres Bergamin (et Machado et tant d’autres) par le vieil anar dans sa nonante et unième année depuis la veille, et la sœur de remarquer alors que sa belle-mère communiste en était fan folle elle aussi, avant de raconter au frère l’anecdote corsée de ladite mère de l’Hidalgo planquant quelque temps chez elle, par pure compassion faisant fi de ses idées, un commandant fasciste alors menacé physiquement par ses adversaires politiques qui, plus tard, par manière de reconnaissance, quand son pouvoir militaire local fut rétabli, protégea le fils conscrit en le gratifiant du titre d’ordonnance au dam des autres jeunes troufions fils à papas franquistes briguant le poste en question…Naturellement très à gauche à vingt ans, comme le frère d’ailleurs, l’Hidalgo, débarqué en Helvétie xénophobe, aura transité en un peu plus de six décennies vers la droite conséquente des capitaine d’entreprise, au gré de sa montée en grade de grand travailleur sur le terrain – le frère se rappelle son récit de surveillant-chef des chantiers vénézuéliens donnant ses ordres à cheval, avant son retour au pays où il devint une sorte de ponte de l’immobilier catalan puis asturien…Traître à sa classe d’origine ? Bien plutôt Asturien pure et dur, quoique très doux abuelito au dire de la sœur, et Paco ne lui en voudra pas , qui connaît trop bien les arnaques de l’idéologie et les opportunistes se la jouant amis du peuple.…Trabaja niño, no te piensesque sin dinero vivirás.Junta el esfuerzo y el ahorroábrete paso, ya verás,como la vida te deparabuenos momentos, te alzarássobre los pobres y mezquinosque no han sabido descollar…Travaille mon enfant, ne pense pasque sans argent tu vivras.Combine efforts et économiespasse ton chemin, tu verras,comment la vie t'apportede bons moments, tu verrasà propos des pauvres et des méchantsqu'ils n'ont pas su y faire... 11. TéléphonagesL’expression vient au frère de la Recherche proustienne, probablement dans Sodome et Gomorrhe, à l’évocation de la Grande Guerre obscurcissant le ciel de Paris, ou plus exactement l’animant dramatiquement avec des aéroplanes allemands suivis par les longs pinceaux lumineux de la défense aérienne, et dans les salons du faubourg Saint Germain les duchesses et les marquises, inquiètes de l’avancée stratégique des opérations à la fois terrestres et célestes, se répandent en longs téléphonages – et la sœur avoue qu’elle n’a jamais supporté les trop longues phrases de Proust, mais l’image des élégantes de la haute qui se posent en expertes militaires la ravit, et plus encore quand son frère lui révèle que la guerre, alors, a été l’occasion de lancer déjà de nouvelles modes vestimentaire parisiennes, comme aujourd’hui le treillis Sonia Rykiel ou la tenue d’assaut Dolce Gabbana…Le frère fait cependant attention, dans ses téléphonages, de ne pas interrompre les activités diurnes ou nocturnes de son hermana grande, soit le matin quand elle procède à ses exercices de yoga ou de stretching suédois, soit le soir quand elle se retrouve seule devant son écran King Size à regarder l’une ou l’autres des séries multinationales dont ils se refilent les titres préférentiels.Hier c’était le tendre One Day, pour elle et, ce soir, pour lui, c’est ce film norvégien qui le scotche, évoquant la résistance antinazie des jeunes rebelles d’Oslo au temps de la Collaboration dont le jeune rebelle, aujourd’hui vieux birbe de mémoire, apparaît aux kids d’aujourd’hui – il leur parle dans une université quelconque - comme une image du parfait héros à la dégaine la plus ordinaire.Le père téléphone à sa fille aînée qui revient de Toscane, à sa fille puînée qui revient de skier avec ses jeunes gens, à son ami le Marquis revenu hier soir de Paris où il gère ses affaires de rentier, , à l’oiseleur son autre compère de tant d’années; de son côté la sœur aînée prend des nouvelles de sa puînée par WhatsApp; le frère se rappelle ses interminables téléphonages avec tel ami mort en telle année et avec tel autre, se rappelle aussi ses notes de téléphone de ces temps passés et se dit qu’avec Whatsapp il n'y a plus de distance ni de dépense exagérée; mais quoi, la vie n’est elle pas exagération par définition, en tout cas c’est ce que dira tout à l’heure le frère à sa sœur en son prochain téléphonage : qu’il y a trop de tout, que c'est too much et que c’est « trop bien » comme s'exclame le petit-fils Angelito resté là-bas auprès de son abuelita, et caetera.(À suivre)
11. TéléphonagesL’expression vient au frère de la Recherche proustienne, probablement dans Sodome et Gomorrhe, à l’évocation de la Grande Guerre obscurcissant le ciel de Paris, ou plus exactement l’animant dramatiquement avec des aéroplanes allemands suivis par les longs pinceaux lumineux de la défense aérienne, et dans les salons du faubourg Saint Germain les duchesses et les marquises, inquiètes de l’avancée stratégique des opérations à la fois terrestres et célestes, se répandent en longs téléphonages – et la sœur avoue qu’elle n’a jamais supporté les trop longues phrases de Proust, mais l’image des élégantes de la haute qui se posent en expertes militaires la ravit, et plus encore quand son frère lui révèle que la guerre, alors, a été l’occasion de lancer déjà de nouvelles modes vestimentaire parisiennes, comme aujourd’hui le treillis Sonia Rykiel ou la tenue d’assaut Dolce Gabbana…Le frère fait cependant attention, dans ses téléphonages, de ne pas interrompre les activités diurnes ou nocturnes de son hermana grande, soit le matin quand elle procède à ses exercices de yoga ou de stretching suédois, soit le soir quand elle se retrouve seule devant son écran King Size à regarder l’une ou l’autres des séries multinationales dont ils se refilent les titres préférentiels.Hier c’était le tendre One Day, pour elle et, ce soir, pour lui, c’est ce film norvégien qui le scotche, évoquant la résistance antinazie des jeunes rebelles d’Oslo au temps de la Collaboration dont le jeune rebelle, aujourd’hui vieux birbe de mémoire, apparaît aux kids d’aujourd’hui – il leur parle dans une université quelconque - comme une image du parfait héros à la dégaine la plus ordinaire.Le père téléphone à sa fille aînée qui revient de Toscane, à sa fille puînée qui revient de skier avec ses jeunes gens, à son ami le Marquis revenu hier soir de Paris où il gère ses affaires de rentier, , à l’oiseleur son autre compère de tant d’années; de son côté la sœur aînée prend des nouvelles de sa puînée par WhatsApp; le frère se rappelle ses interminables téléphonages avec tel ami mort en telle année et avec tel autre, se rappelle aussi ses notes de téléphone de ces temps passés et se dit qu’avec Whatsapp il n'y a plus de distance ni de dépense exagérée; mais quoi, la vie n’est elle pas exagération par définition, en tout cas c’est ce que dira tout à l’heure le frère à sa sœur en son prochain téléphonage : qu’il y a trop de tout, que c'est too much et que c’est « trop bien » comme s'exclame le petit-fils Angelito resté là-bas auprès de son abuelita, et caetera.(À suivre) -
Notre guerre en douce
 Dans les battements de nos cœursse perçoit au lointainle bruit de la guerre qui revient,mais faisons semblant d’être mortspour aimer sans remordscette vie qu’on nous envie…Dans les ruines là-bas dès l’aube,les amants se relèvent ,et défiant toutes les trêveset les fauves qui rôdents’étreignent en pleine lumière…Telle est la bataille du tendre,la funéraille amèredes violents qui là-bas se pendentau gré d'affreuse fêtes -tel est en toi le front de guerredes cruautés défaites …
Dans les battements de nos cœursse perçoit au lointainle bruit de la guerre qui revient,mais faisons semblant d’être mortspour aimer sans remordscette vie qu’on nous envie…Dans les ruines là-bas dès l’aube,les amants se relèvent ,et défiant toutes les trêveset les fauves qui rôdents’étreignent en pleine lumière…Telle est la bataille du tendre,la funéraille amèredes violents qui là-bas se pendentau gré d'affreuse fêtes -tel est en toi le front de guerredes cruautés défaites … -
Noëls pour mémoire

A La Désirade, ce 25 décembre 2024. – Je suis retombé ce matin sur ces notes d’il y a cinquante ans, de mes carnets de l’époque :
La maison de mon enfance avait une bouche, des yeux, un chapeau. En hiver, quand elle se les gelait, elle en fumait une.
 Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)
Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)C'étaient de vieilles cartes postales dans un grenier. Des mains inconnues les avaient écrites. L'une d'entre elles disait: “Je ne vous oublie pas”.
 Or voici que plus tard, dans la maison de notre enfance, tant d’années après la mort de nos parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits enfants de ceux-là ont perpétué à leur façon le rite ancien, quitte à esquinter la moindre les sempiternels chants de Noël. Si la ferveur candide et la stricte observance des formes n’y est plus, l’esprit demeure et j’ai été touché par la joie commune retrouvée autour du dernier tout petit, les yeux bien brillants comme les nôtres à son âge et comme ceux hier de notre vénérable arrière-grand-tante, bonnement aux anges.Il y a de plus en plus de gens, dans nos sociétés d’abondance inégalitaire, que la période des fêtes pousse à la déprime. Tel n’a pas été notre cas, si j’excepte pour ma part quelques années noires. Mais Noël reste le moment privilégié de ces retrouvailles et de ces signes – de ce reste de chaleur dans le froid du monde.Or je tiens à la faire rayonner, cette calorie bonne, à la veille de Noël selon nos dates.
Or voici que plus tard, dans la maison de notre enfance, tant d’années après la mort de nos parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits enfants de ceux-là ont perpétué à leur façon le rite ancien, quitte à esquinter la moindre les sempiternels chants de Noël. Si la ferveur candide et la stricte observance des formes n’y est plus, l’esprit demeure et j’ai été touché par la joie commune retrouvée autour du dernier tout petit, les yeux bien brillants comme les nôtres à son âge et comme ceux hier de notre vénérable arrière-grand-tante, bonnement aux anges.Il y a de plus en plus de gens, dans nos sociétés d’abondance inégalitaire, que la période des fêtes pousse à la déprime. Tel n’a pas été notre cas, si j’excepte pour ma part quelques années noires. Mais Noël reste le moment privilégié de ces retrouvailles et de ces signes – de ce reste de chaleur dans le froid du monde.Or je tiens à la faire rayonner, cette calorie bonne, à la veille de Noël selon nos dates.Donc :
 Joyeux Noël à toutes et à tous qui passez et laissez ici, de loin en loin, un prénom, un sourire ou un pied de nez. Joyeuses fêtes et très belle année 2016, avec tous les Bonus possibles !
Joyeux Noël à toutes et à tous qui passez et laissez ici, de loin en loin, un prénom, un sourire ou un pied de nez. Joyeuses fêtes et très belle année 2016, avec tous les Bonus possibles ! -
Cārtārescu le visionnaire se la joue archange de roman
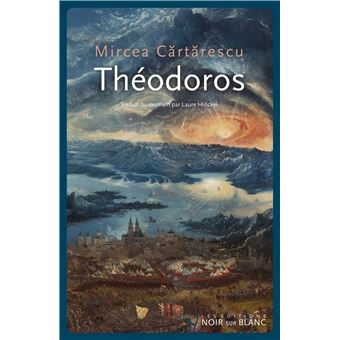 Avec Théodoros, roman historico-poétique d’une fascinante splendeur verbale, combinant une épopée conquérante marquée par autant de faits glorieux que de crimes sanglants commis au nom de Dieu comme il continue d’en proliférer, et le récit d’une destinée aux multiples dédoublements, Mircea Cārtārescu signe un chef-d’œuvre porté par un souffle irrépressible, avec un art de l’évocation sans pareil. Poème romanesque d’une beauté saisissante dans ses grandes largeurs autant que dans la polyphonie profuse et savoureuse de ses détails, cette saga à l’orientale, frottée de théologie parfois déroutante, voire délirante, paraît dans une traduction française, signée Laure Hinckel, d’une merveilleuse musicalité.Fabuleux : tel est Théodoros. Relevant alors de la fable autant que de l’affabulation, où le talent de romancier et de poète de l’auteur roumain Mircea Cārtārescu, très fécond (plus de trente livres parus ) et largement consacré par de multiples prix littéraires, fusionne ici dans un (pseudo) roman historique aux fondements partiellement «réels» mais aux développements aussi extravagants que la vie du protagoniste-modèle, à savoir : Téwodros IIDans l’immédiat, à propos de cet extraordinaire personnage, l’on ne peut que recommander, à la lectrice et au lecteur non moins probablement ignorants en la matière que le soussigné, de consulter, sur Internet, la longue notice consacrée à Téwodros II à l’enseigne de Wikipédia, comme ils gagneront en assises documentaires à l’écoute des explications, sur Youtube, de l’écrivain lui-même. Ces précautions ne risquent en aucune façon de « spoiler », comme on dit aujourd’hui, leur intérêt et leur plaisir de lire : disons que baliser le fonds documentaire de Théodoros permettra de mieux apprécier, dès ses premières pages, l’envolée de la narration, en admettant d’emblée que l’auteur prend toutes les libertés avec la « vérité » historique.Pour celle et celui qui ne peut accéder à Wikipédia d’un clic, précisons vite fait : que le « vrai » Téwodros II, né Kassa Hailou en 1818 à Charghe (province du Qwara, en Ethiopie très morcelée à l’époque par les guerres des seigneurs locaux), a marqué l'Histoire, au point de fasciner un certain Arthur Rimbaud, par sa fulgurante ascension de chef de guerre et fin stratège visant à l’unification d’un pays déchiré, puis s’efforçant d’appliquer des réformes de modernisation tous azimuts : contre l’esclavage et la corruption des élites politiques et religieuses, pour une redistribution des terres aux paysans, avec l’appui d’une armée elle-même réorganisée selon des normes plus « occidentales », tout cela bel et beau et qui lui vaudra la stature posthume d’un héros, mais autant de déboires de son vivant, à peu près tenu pour un macaque déguisé par la reine Victoria, contesté par les seigneuries locales et combattu, malgré le Christ qu’il adore, par les hiérarques de la « douce orthodoxie » aux dents acérées. Et le roi des rois d’Éthiopie, le negusse negest, de se donner finalement la mort avec le pistolet que lui a offert la « grand-mère de l’Europe ». Cela pour l’Histoire et ses faits avérés d’ores et déjà magnifiés par moult légendes et « narratifs », selon l’expression chic du moment.Or, laissant là la «vérité » selon Wikipédia, voici qu’une autre histoire se raconte, commencée par la fin, dont l’idée est venue au jeune Mircea Cāstārescu il y a quatre décennies de ça (il le raconte dans la note finale concluant le roman), jusqu’au moment où, en deux ans, sur fond de dépression, de confusion, de pandémie et de guerres, il a trouvé la force de nouer la gerbe de trente ans de notes prises dans son Journal - et voilà le job, le travail d’une vie pourrait-on dire, avec la transmutation d’une lointaine histoire de « sauvage africain qui singeait son titre sur un trône usurpé », comme le voyait Sa Gracieuse Majesté britannique, en épopée européenne, voire eurasienne, englobant la Grèce des archipels et la Valachie natale de l’auteur, l’Éthiopie et la Judée de la Bible – en attendant la Jérusalem céleste...Je est un autre, ici ou ailleurs…L’idée, dans sa version poétique, aurait pu venir au vélocipédiste Einstein (prénom Albert) au cours de ses virées dans la campagne argovienne : à savoir qu’un garçon qui rêve de devenir empereur dans les neiges de Valachie, disparu tel jour pour motif de rêverie, pourrait réapparaître au même instant dans la peau d'un Juif errant, à San Francisco, après avoir partagé la condition des pirates dans les eaux frémissantes de l’Hellade ou environs.Entre les âges de trois et sept ans, le jeune Tudor (variante valaque du prénom de Téwodros, anticipant le Théodoros du roman) a entendu, modulées par la bouche de sa mère Sofiana, ces histoires qui vous ont tous fait rêver en enfance en vous ouvrant avec le sésame fameux d’il était une fois, les portes du multivers.En affirmant que « Je est un autre », un gamin mal élevé au prénom d’Arthur ne faisait que formuler une vérité vieille comme la nuit des temps, rompant avec les évidences et nous ouvrant, avec transfusion de sang ou non, à tous les dédoublements. Cette histoire du sang, autant que l’histoire du sperme qu’on dit parfois le sang de l’espèce, comptera pour beaucoup dans les motifs métaphoriques du roman Théodoros, comme l’histoire du double. Réclamez-vous du sang du roi Salomon, avec documents à l’appui même trafiqués, et vous verrez l’effet.Le petit Tudor, à sept ans, s’est identifié au grand Alexandre dont sa mère lui lisait les faits et gestes : détail courant de la vie, mais qui peut devenir destin ; tout dépend de notre façon de vivre la lecture. La poésie suppose cette identification et ce dédoublement. Et c’est ainsi que, dès les premières pages de Théodoros, nous sommes littéralement pris par la gueule sans bien savoir qui parle au protagoniste, si c’est sa conscience, le double valaque de Téwodros ou un ange – voire sept archanges d’Apocalypse…« Au commencement était le Verbe », dit l’apôtre, et c’est reparti en forme de question initiale à laquelle tout un roman tâchera de répondre: « Si tu te signes avec trois doigts poisseux de sang, en te marquant le front au-dessus des sourcils (une goutte glisse le long de ton nez bistre et aquilin jusqu’à ta moustache nouée du côté gauche avec un fil d’or, et tombe sur les dalles de malachite de la forteresse royale) en déposant ensuite une tache au bas de ta chemise d’un atlas si blanc qu’il semble doré, et deux autres sous tes épaulettes en opale, d’abord à droite, puis à gauche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, ton signe de croix sera-t-il reçu ? »La question est posée à lui-même par celui qu’on tient pour « une croix de preux », croix d’orgueil et de désir (« tu as crucifié en tout premier ta pauvre âme »), homme de sang qui a transformé la croix en un char de guerre, qui s’est toujours prosterné à ses propres pieds, mais qu’on ne s’attende pas à une autoflagellation de la part de ce possédé de l’Hybris, car le roman n’est pas un confessionnal mais le lieu aux parfums suaves de l’impureté même et des délices, des péchés très affreusement délicieux, de la Vitalité et du Verbe incarnés. « Sans couilles pas de chef-d’œuvre », écrivait Albert Cohen…Un livre à vivre plus qu’à comprendre…Théodoros ne se raconte pas : il se mérite, ou disons, en moins moralisant qu’il se vit, une page après l’autre, et ça fera 600 feuillets à savourer, obstacles compris, surtout si vous cherchez à tout comprendre.Le roman d’aventures est revigorant au possible, comme si vous y étiez, comme au bon jeune temps de Long John Silver, dans L’Ile au trésor, ou comme dans les soieries des Mille et une Nuits. Je pourrais vous raconter les épisodes de la fringante piraterie sur le bateau joyeusement bordélique des forbans auxquels les filles tiennent la dragée haute, dans une espèce de phalanstère sexuel flottant , ou je pourrais vous raconter la terrifiante bataille menée par le guerrier présomptueux contre le Gel valaque, ou encore l’inénarrable mine de sel aux immenses statues souterraines, mais non : c’est à vous de vous y coller, pour le plaisir, et quel !Plus délicate en revanche, mais à prendre le pied léger : la théologie dans tout ça. L’on sait que le vrai Téwodros était un homme religieux, et son double romanesque ne le lui cède en rien, avec un même séjour monacal et des relations pour le moins problématiques avec les religions voisines ou adverses et les confessions et sectes chrétiennes de tout acabit. Calvinistes et papistes ? Tous des chiens ! God soit leur copilote, mais notre seul et unique chef est le Christ. Pantocrator cela va de soi.Ceci dit, faut-il être catholique pour comprendre La Divine Comédie de Dante ? La connaissance de la pensée du docte Thomas d’Aquin, substrat dogmatique du poème, est-elle nécessaire pour apprécier celui-ci ? Faut-il comprendre, et d’abord connaître le Kebra Nagast, livre saint de l’église orthodoxe d’Éthiopie, pour démêler les « signifiés » subtils de Théodoros ? Je n’en crois rien, ni ne crois d’ailleurs que Mircea Cāstārescu le croie. L’humour soit plutôt notre guide, et l’amour de la Littérature. Enfin l’amour de l’Amour, par quoi tout aurait dû commencer, et les lettres de Théodoros à sa mère en sont le fil rouge – rouge sang sublimé -, le fil d’or de pure poésie.Mircea Cāstārescu. Théodoros. Traduit du roumain par Laure Hinckel. Éditions Noir sur blanc, 599p. 2024
Avec Théodoros, roman historico-poétique d’une fascinante splendeur verbale, combinant une épopée conquérante marquée par autant de faits glorieux que de crimes sanglants commis au nom de Dieu comme il continue d’en proliférer, et le récit d’une destinée aux multiples dédoublements, Mircea Cārtārescu signe un chef-d’œuvre porté par un souffle irrépressible, avec un art de l’évocation sans pareil. Poème romanesque d’une beauté saisissante dans ses grandes largeurs autant que dans la polyphonie profuse et savoureuse de ses détails, cette saga à l’orientale, frottée de théologie parfois déroutante, voire délirante, paraît dans une traduction française, signée Laure Hinckel, d’une merveilleuse musicalité.Fabuleux : tel est Théodoros. Relevant alors de la fable autant que de l’affabulation, où le talent de romancier et de poète de l’auteur roumain Mircea Cārtārescu, très fécond (plus de trente livres parus ) et largement consacré par de multiples prix littéraires, fusionne ici dans un (pseudo) roman historique aux fondements partiellement «réels» mais aux développements aussi extravagants que la vie du protagoniste-modèle, à savoir : Téwodros IIDans l’immédiat, à propos de cet extraordinaire personnage, l’on ne peut que recommander, à la lectrice et au lecteur non moins probablement ignorants en la matière que le soussigné, de consulter, sur Internet, la longue notice consacrée à Téwodros II à l’enseigne de Wikipédia, comme ils gagneront en assises documentaires à l’écoute des explications, sur Youtube, de l’écrivain lui-même. Ces précautions ne risquent en aucune façon de « spoiler », comme on dit aujourd’hui, leur intérêt et leur plaisir de lire : disons que baliser le fonds documentaire de Théodoros permettra de mieux apprécier, dès ses premières pages, l’envolée de la narration, en admettant d’emblée que l’auteur prend toutes les libertés avec la « vérité » historique.Pour celle et celui qui ne peut accéder à Wikipédia d’un clic, précisons vite fait : que le « vrai » Téwodros II, né Kassa Hailou en 1818 à Charghe (province du Qwara, en Ethiopie très morcelée à l’époque par les guerres des seigneurs locaux), a marqué l'Histoire, au point de fasciner un certain Arthur Rimbaud, par sa fulgurante ascension de chef de guerre et fin stratège visant à l’unification d’un pays déchiré, puis s’efforçant d’appliquer des réformes de modernisation tous azimuts : contre l’esclavage et la corruption des élites politiques et religieuses, pour une redistribution des terres aux paysans, avec l’appui d’une armée elle-même réorganisée selon des normes plus « occidentales », tout cela bel et beau et qui lui vaudra la stature posthume d’un héros, mais autant de déboires de son vivant, à peu près tenu pour un macaque déguisé par la reine Victoria, contesté par les seigneuries locales et combattu, malgré le Christ qu’il adore, par les hiérarques de la « douce orthodoxie » aux dents acérées. Et le roi des rois d’Éthiopie, le negusse negest, de se donner finalement la mort avec le pistolet que lui a offert la « grand-mère de l’Europe ». Cela pour l’Histoire et ses faits avérés d’ores et déjà magnifiés par moult légendes et « narratifs », selon l’expression chic du moment.Or, laissant là la «vérité » selon Wikipédia, voici qu’une autre histoire se raconte, commencée par la fin, dont l’idée est venue au jeune Mircea Cāstārescu il y a quatre décennies de ça (il le raconte dans la note finale concluant le roman), jusqu’au moment où, en deux ans, sur fond de dépression, de confusion, de pandémie et de guerres, il a trouvé la force de nouer la gerbe de trente ans de notes prises dans son Journal - et voilà le job, le travail d’une vie pourrait-on dire, avec la transmutation d’une lointaine histoire de « sauvage africain qui singeait son titre sur un trône usurpé », comme le voyait Sa Gracieuse Majesté britannique, en épopée européenne, voire eurasienne, englobant la Grèce des archipels et la Valachie natale de l’auteur, l’Éthiopie et la Judée de la Bible – en attendant la Jérusalem céleste...Je est un autre, ici ou ailleurs…L’idée, dans sa version poétique, aurait pu venir au vélocipédiste Einstein (prénom Albert) au cours de ses virées dans la campagne argovienne : à savoir qu’un garçon qui rêve de devenir empereur dans les neiges de Valachie, disparu tel jour pour motif de rêverie, pourrait réapparaître au même instant dans la peau d'un Juif errant, à San Francisco, après avoir partagé la condition des pirates dans les eaux frémissantes de l’Hellade ou environs.Entre les âges de trois et sept ans, le jeune Tudor (variante valaque du prénom de Téwodros, anticipant le Théodoros du roman) a entendu, modulées par la bouche de sa mère Sofiana, ces histoires qui vous ont tous fait rêver en enfance en vous ouvrant avec le sésame fameux d’il était une fois, les portes du multivers.En affirmant que « Je est un autre », un gamin mal élevé au prénom d’Arthur ne faisait que formuler une vérité vieille comme la nuit des temps, rompant avec les évidences et nous ouvrant, avec transfusion de sang ou non, à tous les dédoublements. Cette histoire du sang, autant que l’histoire du sperme qu’on dit parfois le sang de l’espèce, comptera pour beaucoup dans les motifs métaphoriques du roman Théodoros, comme l’histoire du double. Réclamez-vous du sang du roi Salomon, avec documents à l’appui même trafiqués, et vous verrez l’effet.Le petit Tudor, à sept ans, s’est identifié au grand Alexandre dont sa mère lui lisait les faits et gestes : détail courant de la vie, mais qui peut devenir destin ; tout dépend de notre façon de vivre la lecture. La poésie suppose cette identification et ce dédoublement. Et c’est ainsi que, dès les premières pages de Théodoros, nous sommes littéralement pris par la gueule sans bien savoir qui parle au protagoniste, si c’est sa conscience, le double valaque de Téwodros ou un ange – voire sept archanges d’Apocalypse…« Au commencement était le Verbe », dit l’apôtre, et c’est reparti en forme de question initiale à laquelle tout un roman tâchera de répondre: « Si tu te signes avec trois doigts poisseux de sang, en te marquant le front au-dessus des sourcils (une goutte glisse le long de ton nez bistre et aquilin jusqu’à ta moustache nouée du côté gauche avec un fil d’or, et tombe sur les dalles de malachite de la forteresse royale) en déposant ensuite une tache au bas de ta chemise d’un atlas si blanc qu’il semble doré, et deux autres sous tes épaulettes en opale, d’abord à droite, puis à gauche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, ton signe de croix sera-t-il reçu ? »La question est posée à lui-même par celui qu’on tient pour « une croix de preux », croix d’orgueil et de désir (« tu as crucifié en tout premier ta pauvre âme »), homme de sang qui a transformé la croix en un char de guerre, qui s’est toujours prosterné à ses propres pieds, mais qu’on ne s’attende pas à une autoflagellation de la part de ce possédé de l’Hybris, car le roman n’est pas un confessionnal mais le lieu aux parfums suaves de l’impureté même et des délices, des péchés très affreusement délicieux, de la Vitalité et du Verbe incarnés. « Sans couilles pas de chef-d’œuvre », écrivait Albert Cohen…Un livre à vivre plus qu’à comprendre…Théodoros ne se raconte pas : il se mérite, ou disons, en moins moralisant qu’il se vit, une page après l’autre, et ça fera 600 feuillets à savourer, obstacles compris, surtout si vous cherchez à tout comprendre.Le roman d’aventures est revigorant au possible, comme si vous y étiez, comme au bon jeune temps de Long John Silver, dans L’Ile au trésor, ou comme dans les soieries des Mille et une Nuits. Je pourrais vous raconter les épisodes de la fringante piraterie sur le bateau joyeusement bordélique des forbans auxquels les filles tiennent la dragée haute, dans une espèce de phalanstère sexuel flottant , ou je pourrais vous raconter la terrifiante bataille menée par le guerrier présomptueux contre le Gel valaque, ou encore l’inénarrable mine de sel aux immenses statues souterraines, mais non : c’est à vous de vous y coller, pour le plaisir, et quel !Plus délicate en revanche, mais à prendre le pied léger : la théologie dans tout ça. L’on sait que le vrai Téwodros était un homme religieux, et son double romanesque ne le lui cède en rien, avec un même séjour monacal et des relations pour le moins problématiques avec les religions voisines ou adverses et les confessions et sectes chrétiennes de tout acabit. Calvinistes et papistes ? Tous des chiens ! God soit leur copilote, mais notre seul et unique chef est le Christ. Pantocrator cela va de soi.Ceci dit, faut-il être catholique pour comprendre La Divine Comédie de Dante ? La connaissance de la pensée du docte Thomas d’Aquin, substrat dogmatique du poème, est-elle nécessaire pour apprécier celui-ci ? Faut-il comprendre, et d’abord connaître le Kebra Nagast, livre saint de l’église orthodoxe d’Éthiopie, pour démêler les « signifiés » subtils de Théodoros ? Je n’en crois rien, ni ne crois d’ailleurs que Mircea Cāstārescu le croie. L’humour soit plutôt notre guide, et l’amour de la Littérature. Enfin l’amour de l’Amour, par quoi tout aurait dû commencer, et les lettres de Théodoros à sa mère en sont le fil rouge – rouge sang sublimé -, le fil d’or de pure poésie.Mircea Cāstārescu. Théodoros. Traduit du roumain par Laure Hinckel. Éditions Noir sur blanc, 599p. 2024 -
À corps perdu
 Le corps ne voulait plus, alors:plus rien qu’une autre vie,le corps n’avait plus d’autre envieque d’aller voir un peu dehorsle temps qu’il fait là-bas…Le corps ne voulait plus de toi:il fuyait comme un ratqu’un bruit effraie comme un remords,le corps comme une ortie,te brûlerait comme aux lisièresdes forêts de l’enfancequand, jambes nues, tout innocence,vous traversiez les rivières...Le corps s’en va, là-bas, tout seul,ignorant les écueils,on dirait qu’il a des nageoires,il semble avoir le souffle neuf,il lui vient un savoirqui lui fait traverser les mursqu’une sorte de nuit emporte -on dirait qu’on est plus léger,l’âme enfin délivréede toute autre sorte de bluff…
Le corps ne voulait plus, alors:plus rien qu’une autre vie,le corps n’avait plus d’autre envieque d’aller voir un peu dehorsle temps qu’il fait là-bas…Le corps ne voulait plus de toi:il fuyait comme un ratqu’un bruit effraie comme un remords,le corps comme une ortie,te brûlerait comme aux lisièresdes forêts de l’enfancequand, jambes nues, tout innocence,vous traversiez les rivières...Le corps s’en va, là-bas, tout seul,ignorant les écueils,on dirait qu’il a des nageoires,il semble avoir le souffle neuf,il lui vient un savoirqui lui fait traverser les mursqu’une sorte de nuit emporte -on dirait qu’on est plus léger,l’âme enfin délivréede toute autre sorte de bluff… -
Plus terrible sera la chute

Un Prince d’orchestre
à valeur de grand roman
Après Le Turquetto, gratifié de cinq prix, Metin Arditi revient en force avec le portrait dur et tendre d’un ange déchu du gotha musical. Lecture et rencontre.
« Il dominait tout », lit-on illico à propos d’Alexis Kandilis, chef d’orchestre mondialement connu et protagoniste du douzième livre de Metin Arditi. La cinquantaine fringante et l’insolente beauté d’un macho grec à la Delon, Kandilis se considère lui-même comme le plus grand chef du moment et le meilleur « coup » auprès des femmes. Pour toucher à la « gloire absolue », il lui manque juste de décrocher enfin l’enregistrement du « coffret du siècle », dit le B16, à savoir l’essentiel de Beethoven dont la vente estimée à un million de disques s’ajoutera à celle de la trentaine de CD que le Maître a déjà à son actif. En attendant enchaînant les concerts de prestige aux quatre coins du monde, il savoure sa réussite sous l’œil férocement attentif de Clio, son indomptable mère enfin sortie des galères. Or le présumé Titan n’est pas sans failles ni faiblesses. L’air obsédant du Chant des enfants morts de Mahler lui revient ainsi à tout moment, rappel d’un accident en son enfance. Et puis son orgueil ombrageux lui joue des tours. Ainsi a-t-il, lors d’un concert récent à Paris, humilié un percussionniste de façon grossière. Ainsi, alors même que tout semble lui réussir et qu’un club de milliardaires l’accueille même dans ses parties de poker, tout vacille soudain, avant la chute. Un premier article accusateur dans Le Monde, la fronde des musiciens, d’autres papiers vengeurs, l’échec du B16, le rejet de ses riches amis vont faire du prince un paria. Dont Metin Arditi, Président de l’Orchestre de la Suisse romande comme on sait, se défend absolument d’avoir trouvé le modèle chez les chefs qu’il a fréquentés. Le germe du roman est à chercher, à son dire, à d’autres profondeurs.
« Pourquoi détruit-on si souvent, et si bêtement, d’un mot ou d’un geste, ce que l’on a mis tant de temps et d’efforts à construire ? Je crois que nous sommes tributaires de nos blessures d’enfance, du moins de celles que l’on s’est refusé à confronter, précisément parce qu’elles étaient trop douloureuses ». Ainsi le romancier éclaire-t-il les dérapages successifs de son prince d’orchestre, qui perd sa capacité de raisonnement et sa maîtrise de soi en se rappelant la mort tragique de son jeune frère et la terrible humiliation qu’il a subie dans son adolescence, dont le lecteur découvrira le secret.
Connaisseur éprouvé du milieu musical et du « Système » économique auquel sont soumis les plus grands interprètes, Metin Arditi se défend aussi de pointer, à travers l’affirmation de puissance méprisante de son protagoniste un défaut de la profession à son plus haut niveau : « Vraiment pas ! Les grands chefs sont des personnes hautement contrôlées et intelligentes, lucides sur leurs propres intérêts. Je n’ai jamais vu de chef se comporter de cette manière… »
Autant que le milieu des musiciens, de leurs agents ou des critiques en vue, le romancier montre, dans Prince d’orchestre, une connaissance approfondie de la musique elle-même. Ainsi se met-il littéralement dans la peau du chef défié par son orchestre, lors d’une interprétation de la 9e Symphonie de Beethoven au Royal Albert Hall de Londres, au point de faire vivre au lecteur un concert menacé par une débâcle absolue, miraculeusement sauvé par l’émotion. Or, à ses connaissances de mélomane, Metin Arditi a ajouté de sûres informations : « J’ai beaucoup travaillé avec les partitions, les enregistrements, deux spécialistes du travail d’orchestre et des plateaux, une agente de chef d’orchestre à Londres, un bibliothécaire et un compositeur ».
Ingénieur-romancier, l’auteur de Prince d’orchestre impressionne en outre par la construction, en brèves séquences à multiples points de vue, d’un récit choral extrêmement poreux quant à la psychologie des personnages, tous finement dessinés. Là encore, un travail de minutieux agencement sous-tend ce qui semble la vie spontanée. «Je ne commence pas une écriture avant d’avoir noirci plusieurs cahiers de plans très précis qui, bien sûr, évoluent au fil des recherches préalables à l’écriture, puis au fil de l’écriture elle-même ».
Par delà ses composantes sociales, artistiques ou purement techniques, c’est à un autre niveau, pourtant, que se situent le plus grand intérêt et l’émotion de Prince d’orchestre, tendus entre l’intensité passionnelle et le défi orgueilleux d’un homme dont l’effondrement rappelle la trajectoire de certains personnages de Georges Simenon, auteur vénéré par Metin Arditi.
Se disant lui-même bourgeois, et contraint à ce titre de « lutter sans cesse contre la facilité », le self made man a aussi du « métèque » en lui, comme Alexis Kandilis et comme le protagoniste du Turquetto. Le fait que son prince d’orchestre ait été placé par sa mère dans un certain internat de la région lausannoise, après la déchéance du père, renvoie au roman autobiographique Loin des bras (Actes Sud, 2008) dont on retrouve plusieurs personnages dans ce nouveau roman. En outre, quatre personnages importants pourraient participer à la rédemption éventuelle de Kandilis, qui la fuit avec une sorte de furieuse et suicidaire obstination. Il s’agit du Juif Menahem Keller, lui aussi passionné de musique et cherchant dans la Kabbale des réponses aux paradoxes de l’existence et, plus précisément, au coup du sort qui l’a frappé en plaçant son fils sur la trajectoire d’un kamikaze, à Jérusalem, plongé depuis lors dans le coma. Il s’agit en outre de Sacha, le jeune flûtiste russe, homosexuel, qui continue de témoigner de l’admiration à Kandilis après que tous l’ont lâché. Et, enfin, de Tatiana et Pavlina, les deux femmes éprouvées par la vie qui se sont réfugiées dans les bras l’une de l’autre, associant bientôt Alexis à leurs jeux érotiques.
À propos de ces trois derniers personnages, le lecteur remarquera que le romancier leur donne des airs d’enfants abandonnés plus que de «déviants » au sens conventionnel. Et de préciser : « Oui, j’ai pour eux beaucoup de tendresse, car ils subissent l’ostracisme. Il y a là une forme de racisme sourd, de la part de la société, malgré les progrès réalisés depuis, disons, une génération ».
Tout cela pourrait sembler « téléphoné » dans un sens politiquement correct, et pourtant non : Prince d’orchestre module, bel et bien, une vision du monde, des individus et des mécanismes sociaux, marquée par la générosité et le bon sens. Aucun des personnages du roman n’est épinglé comme le serait un insecte froidement observé et jugé. Comme le disait Henry James des meilleurs romans, chaque personnage y a en somme raison. Si Prince d’orchestre bascule finalement dans une extrême violence, celle-ci fait en somme écho, avec son aspect de fait divers aussi scabreux que tragique, au chaos bruyant d’une vie sans musique, dominé par les pulsions les plus obscures – tout un monde que nous découvrons tous les jours dans les journaux. Le paradoxe est que l’être le plus raffiné en apparence s’y laisse entraîner. Il y trouve la force insensée de se défenestrer aptès avoir massacré ses amantes. Telle est sa folie, tandis que Beethoven « triomphe » au Victoria Hall. Or le magnifique roman de cette déchéance par orgueil est, à la fois, un hymne à la musique et à la tendresse.
Metin Arditi. Prince d’orchestre. Actes Sud, 2012, 372p.
-
L’ami Roland boit la ciguë ou la mort d’un moineau perdu…
 A la veille de ses 80 ans, le chroniqueur et polygraphe Roland Jaccard, qui avait publié deux nouveaux livres depuis le début de l’année, dont son journal 1983-1988 comptant 834 pages et intitulé Le Monde d’avant, a choisi de mettre fin à ses jours, à l’imitation de sa mère autrichienne et de son père vaudois. Esprit libre s’il en fut, hédoniste posant au cynique désabusé en dépit de sa vibrante porosité sensible et de son humour jamais en défaut, notre ami Roland laisse, par delà son important travail de passeur-éditeur, une œuvre personnelle d’une rare vivacité, qui fera date par son style.Mais que fut donc son «monde d’avant» ?
A la veille de ses 80 ans, le chroniqueur et polygraphe Roland Jaccard, qui avait publié deux nouveaux livres depuis le début de l’année, dont son journal 1983-1988 comptant 834 pages et intitulé Le Monde d’avant, a choisi de mettre fin à ses jours, à l’imitation de sa mère autrichienne et de son père vaudois. Esprit libre s’il en fut, hédoniste posant au cynique désabusé en dépit de sa vibrante porosité sensible et de son humour jamais en défaut, notre ami Roland laisse, par delà son important travail de passeur-éditeur, une œuvre personnelle d’une rare vivacité, qui fera date par son style.Mais que fut donc son «monde d’avant» ? La première image que je conserve de Roland, en usant du JE comme il le faisait lui-même sans se gêner, est celle, dans notre «monde d’avant» lausannois, d’un long personnage en «calosse» de bain à la piscine de Montchoisi, maigre comme un héron et la mèche un peu canaille bon chic, au milieu d’un quarteron de filles en bikinis, visiblement en train de draguer alors que nous, les garçons, bien cinq ans de moins que lui, nous attendons le moment de l’annonce par haut-parleur: «Attention, on va faire les vagues !» et là nous nous jetterons à l’eau comme des sauvages tandis que le tombeur, là-haut, restera planté bien snob sur ses longues pattes à faire sa cour aux minettes.Cela dit, je n’aimais pas Montchoisi, trop fils à papas pour moi, qui préférais les bains popus du port de Pully où nous dévalions en vélo des hauts de la ville avant de plonger dans l'eau verte et ensuite de reluquer les entraîneuses du Tabaris ou du Brummel; et cette fois c’est moi qui ai snobé Roland, au moins soixante ans plus tard chez Yushi, quand je lui ai raconté comment, chatouillant les pieds des belles endormies à plat ventre sans soutifs, nous les faisions se cambrer, sauter en l’air et montrer leur lolos débridés... de Dieu la vue ! Et lui : comme dans Amarcord, mon cher, nous aurons été les ragazzi…Ce qui nous fait revenir au centre-ville, un mercredi après-midi au Bio, le cinéma du western-spaghetti par excellence, où la meute à grands cris met en garde John Wayne quand un Indien va lui lancer son tomahouac, et je ne sais pas si Roland est de la bande vu la différence d’âge, mais on lira bientôt ses chroniques de cinéma dans la feuille socialo du coin, et Freddy Buache en personne m’en signera le certificat plus tard : que le même Roland le côtoyait souvent au premier rang dans les salles noires du «monde d’avant», disons au tout début des années 60. Un peu plus tard, j’étais moi-même placeur au Colisée où j’ai vu 25 fois Juliette des esprits de Fellini, auquel je préférais à vrai dire Les Vitelloni en m’identifiant au doux Moraldo. De là comme un début de complicité...Ensuite notre Lausanne du «monde d’avant» sera, dans la foulée et pour résumer, celui du bar à café Le Barbare au pied de la cathédrale et de la cité genre Montmartre avec ateliers des Beaux-arts et autres nids d’étudiants, la librairie anar de Claude Frochaux aux escaliers du Marché, ou L’Escale, de l’autre côté du pont Bessières propice aux suicides urbains, avec ses filles de pensionnats huppés célébrées par Godard ; et dans ce monde d’avant les jeunes discutent beaucoup et fument beaucoup et baisent plus librement que leurs parents, et tout ce monde d’avant se politise et se subdivise, il y a plein de groupes et de troupes de théâtre, plein de cafés très enfumés et l’on «toraille» aussi dans les rédactions, enfin il y a là tout un habitus et sa faune des années 60-70 que Roland retrouvera plus ou moins à Paris, diplômé de je ne sais plus quelle faculté, quand il débarquera dans le Quartier latin et se fera un nom au journal Le Monde en tant que chroniqueur freudien jouxtant le sartrien Michel Contat, autre transfuge de nos douces périphéries lémaniques.
La première image que je conserve de Roland, en usant du JE comme il le faisait lui-même sans se gêner, est celle, dans notre «monde d’avant» lausannois, d’un long personnage en «calosse» de bain à la piscine de Montchoisi, maigre comme un héron et la mèche un peu canaille bon chic, au milieu d’un quarteron de filles en bikinis, visiblement en train de draguer alors que nous, les garçons, bien cinq ans de moins que lui, nous attendons le moment de l’annonce par haut-parleur: «Attention, on va faire les vagues !» et là nous nous jetterons à l’eau comme des sauvages tandis que le tombeur, là-haut, restera planté bien snob sur ses longues pattes à faire sa cour aux minettes.Cela dit, je n’aimais pas Montchoisi, trop fils à papas pour moi, qui préférais les bains popus du port de Pully où nous dévalions en vélo des hauts de la ville avant de plonger dans l'eau verte et ensuite de reluquer les entraîneuses du Tabaris ou du Brummel; et cette fois c’est moi qui ai snobé Roland, au moins soixante ans plus tard chez Yushi, quand je lui ai raconté comment, chatouillant les pieds des belles endormies à plat ventre sans soutifs, nous les faisions se cambrer, sauter en l’air et montrer leur lolos débridés... de Dieu la vue ! Et lui : comme dans Amarcord, mon cher, nous aurons été les ragazzi…Ce qui nous fait revenir au centre-ville, un mercredi après-midi au Bio, le cinéma du western-spaghetti par excellence, où la meute à grands cris met en garde John Wayne quand un Indien va lui lancer son tomahouac, et je ne sais pas si Roland est de la bande vu la différence d’âge, mais on lira bientôt ses chroniques de cinéma dans la feuille socialo du coin, et Freddy Buache en personne m’en signera le certificat plus tard : que le même Roland le côtoyait souvent au premier rang dans les salles noires du «monde d’avant», disons au tout début des années 60. Un peu plus tard, j’étais moi-même placeur au Colisée où j’ai vu 25 fois Juliette des esprits de Fellini, auquel je préférais à vrai dire Les Vitelloni en m’identifiant au doux Moraldo. De là comme un début de complicité...Ensuite notre Lausanne du «monde d’avant» sera, dans la foulée et pour résumer, celui du bar à café Le Barbare au pied de la cathédrale et de la cité genre Montmartre avec ateliers des Beaux-arts et autres nids d’étudiants, la librairie anar de Claude Frochaux aux escaliers du Marché, ou L’Escale, de l’autre côté du pont Bessières propice aux suicides urbains, avec ses filles de pensionnats huppés célébrées par Godard ; et dans ce monde d’avant les jeunes discutent beaucoup et fument beaucoup et baisent plus librement que leurs parents, et tout ce monde d’avant se politise et se subdivise, il y a plein de groupes et de troupes de théâtre, plein de cafés très enfumés et l’on «toraille» aussi dans les rédactions, enfin il y a là tout un habitus et sa faune des années 60-70 que Roland retrouvera plus ou moins à Paris, diplômé de je ne sais plus quelle faculté, quand il débarquera dans le Quartier latin et se fera un nom au journal Le Monde en tant que chroniqueur freudien jouxtant le sartrien Michel Contat, autre transfuge de nos douces périphéries lémaniques. Je raconte ça pêle-mêle, de mémoire, comme on se le racontait l’an dernier au Palace ou chez Yushi, en zappant une longue période durant laquelle, perçu de Lausanne, le nom de Roland Jaccard flottait un peu dans les marées montantes de la rentrée littéraire, un bout de journal chez Grasset (L’ombre d'une frange) par ci, un extrait de journal chez Zulma par là (Le rire du diable) , et chaque fois que je lui consacrais un papier il me répondait amicalement même quand je l’avais égratigné, bref les années passèrent et tel jour on apprit que les bains Deligny s’étaient noyés dans la Seine, ce qui me sembla le comble de l’humour à la Jaccard avant que j’apprenne, dans son Journal d’un homme perdu, que ce naufrage avait marqué la rupture de son amitié avec Gabriel Matzneff pour quelques années…De Stefan Zweig à Cyril Hanouna, suivez la courbe…Le titre du Monde d’avant fait écho, de toute évidence, au Monde d’hier de Stefan Zweig, et vous n’aurez rien compris à Roland Jaccard si vous ne passez pas par Vienne, vu que l’Autriche le tient par sa mère dont une amie l’a dépucelé à 15 ans, comme il me l’a confié non sans fierté, tant il est vrai que ce «viol», selon son expression, et comme pour défier l’esprit de Me-too, le flattait, lui joli personnage d’une nouvelle de Zweig ou d’Arthur Schnitzler, autre auteur de ses préférences…Dans Le Monde d’hier, Stefan Zweig évoque sa rencontre ratée avec un de ses condisciples, proprement génial, du nom d’Otto Weininger et suicidé à l’âge de 23 ans après avoir publié un essai sulfureux intitulé Sexe et caractère, succès européen de l’époque dont la version française a paru à Lausanne, aux éditions L’Âge d’Homme, préfacée par un certain… Roland Jaccard.Otto Weininger, juif antisémite et homosexuel, homophobe et misogyne, ne pouvait que plaire à l’ami Roland, car Otto se psychanalysait lui-même en théorisant la guerre des sexes et les aléas de la bisexualité de manière combien plus hardie que ne le ferait Sigmund Freud, alors que les nouvelles de Zweig et les pièces de théâtre de Schnitzler ou de Strindberg brassaient le même matériau psycho-sexuel avec la même rage iconoclaste d’époque.Et Roland Jaccard retrouvera le même genre de défi intellectuel dans l’œuvre fascinante d’Albert Caraco, philosophe juif méconnu publiant à compte d'auteur à Neuchâtel et Lausanne, maître altier d’une langue admirablement anachronique, nihiliste en apparence et visant en réalité une réorganisation future de l’écosystème démographique et spirituel mondial (!) pour se suicider en 1971 à 52 ans comme il l’avait annoncé, quasiment sur le cadavre de son père…Univers de cinglés que ce «monde d’avant» ? Sans doute, aux yeux des anges sanitaires de la nouvelle censure mondiale, mais c’était à la fois le monde de Socrate (cet affreux pédéraste) et d’Aristote (ce misogyne avéré), plus récemment d’Emil Cioranescu dit Cioran (ce facho recyclé) et d’Albert Caraco (ce raciste prophétisant le retour triomphal des Juifs) ou enfin de Roland Jaccard lui-même, déclaré «infréquentable» par tel folliculaire lausannois une semaine avant sa dernière révérence…
Je raconte ça pêle-mêle, de mémoire, comme on se le racontait l’an dernier au Palace ou chez Yushi, en zappant une longue période durant laquelle, perçu de Lausanne, le nom de Roland Jaccard flottait un peu dans les marées montantes de la rentrée littéraire, un bout de journal chez Grasset (L’ombre d'une frange) par ci, un extrait de journal chez Zulma par là (Le rire du diable) , et chaque fois que je lui consacrais un papier il me répondait amicalement même quand je l’avais égratigné, bref les années passèrent et tel jour on apprit que les bains Deligny s’étaient noyés dans la Seine, ce qui me sembla le comble de l’humour à la Jaccard avant que j’apprenne, dans son Journal d’un homme perdu, que ce naufrage avait marqué la rupture de son amitié avec Gabriel Matzneff pour quelques années…De Stefan Zweig à Cyril Hanouna, suivez la courbe…Le titre du Monde d’avant fait écho, de toute évidence, au Monde d’hier de Stefan Zweig, et vous n’aurez rien compris à Roland Jaccard si vous ne passez pas par Vienne, vu que l’Autriche le tient par sa mère dont une amie l’a dépucelé à 15 ans, comme il me l’a confié non sans fierté, tant il est vrai que ce «viol», selon son expression, et comme pour défier l’esprit de Me-too, le flattait, lui joli personnage d’une nouvelle de Zweig ou d’Arthur Schnitzler, autre auteur de ses préférences…Dans Le Monde d’hier, Stefan Zweig évoque sa rencontre ratée avec un de ses condisciples, proprement génial, du nom d’Otto Weininger et suicidé à l’âge de 23 ans après avoir publié un essai sulfureux intitulé Sexe et caractère, succès européen de l’époque dont la version française a paru à Lausanne, aux éditions L’Âge d’Homme, préfacée par un certain… Roland Jaccard.Otto Weininger, juif antisémite et homosexuel, homophobe et misogyne, ne pouvait que plaire à l’ami Roland, car Otto se psychanalysait lui-même en théorisant la guerre des sexes et les aléas de la bisexualité de manière combien plus hardie que ne le ferait Sigmund Freud, alors que les nouvelles de Zweig et les pièces de théâtre de Schnitzler ou de Strindberg brassaient le même matériau psycho-sexuel avec la même rage iconoclaste d’époque.Et Roland Jaccard retrouvera le même genre de défi intellectuel dans l’œuvre fascinante d’Albert Caraco, philosophe juif méconnu publiant à compte d'auteur à Neuchâtel et Lausanne, maître altier d’une langue admirablement anachronique, nihiliste en apparence et visant en réalité une réorganisation future de l’écosystème démographique et spirituel mondial (!) pour se suicider en 1971 à 52 ans comme il l’avait annoncé, quasiment sur le cadavre de son père…Univers de cinglés que ce «monde d’avant» ? Sans doute, aux yeux des anges sanitaires de la nouvelle censure mondiale, mais c’était à la fois le monde de Socrate (cet affreux pédéraste) et d’Aristote (ce misogyne avéré), plus récemment d’Emil Cioranescu dit Cioran (ce facho recyclé) et d’Albert Caraco (ce raciste prophétisant le retour triomphal des Juifs) ou enfin de Roland Jaccard lui-même, déclaré «infréquentable» par tel folliculaire lausannois une semaine avant sa dernière révérence… À ce propos, je laisse aux vertueux de cet acabit la tâche de taxer Roland Jaccard d'idéologiquement suspect, estimant personnellement que l'idéologie est un virus mortel pour l'Esprit et n'étant jamais entré, avec Roland, dans aucun débat, ni sur la droite française, dont je me foutais quoique publiant deux livres chez Pierre-Guillaume de Roux, classé par les bien-pensants à l'extrême-droite alors que jamais nous n'avons parlé politique ensemble, et je souriais quand Roland traitait mon ami Jean Ziegler d'arnaqueur, estimant que l'un et l'autre valaient mieux que leurs postures idéologiques respectives.Un texte assez déchirant, sur son blog, où il est question de la mort d'un moineau, dit assez le peu d'estime, à mon sens injustifié, que Roland se portait. D'aucuns prétendront l'avoir compris, sûrement à trop bon compte, mais moi qui ne croyais ni à son cynisme ni à sa misogynie affichée, ni à ses rodomontades de pro-Trump (juste pour contredire les bien-pensants), ni à son prétendu nihilisme, aussi relatif que celui de Caraco et de Cioran (qu'on lise le journal de celui-ci pour découvrir quel farceur était au naturel le prétendu Maître du néant...), je n'aurai pas le prétention d'avoir compris cet être si superficiel et si complexe à la fois, si vaniteux et si humble, si puant en son parisianisme et si fraternel, si généreux en éditeur de Clément Rosset et de Frédéric Pajak, de Comte-Sponville et de tant d'autres alors qu'il se reprochait son manque de générosité, si gentil au moment même où il se la jouait méchant de cinéma - comme s'il fallait comprendre la vie...Et le «monde d’après» ? Le nom de Cyril Hanouna le résumera, bien insuffisamment certes mais lié à une émission auquel Roland participa un soir, consacré à la prostitution. Devait-il y participer ? m’avait-il demandé au téléphone avant de s’y pointer, et comme j’avais assisté peu de temps auparavant, moi qui ne regarde jamais la télé, à l’atroce spectacle ordonné par le monstre en question, je lui dis que même payé (il le serait de 60 euros) jamais je ne m’infligerais une telle torture.Mais Roland était joueur (ce que je ne suis aucunement détestant le ping-pong et nul en échecs) et toujours un peu frimeur (comme tout écrivain), et c’est en joueur frimeur qu’il aura touché à tous les aspects du «monde d’après» en restant scotché au monde d’hier. Là-dessus, c’est sur le pauvre Hanouna qu’il conclut son dernier blog d’avant le lundi fatal, comme s’il avait tiré la chasse.Mais qu'en est-il du vrai Cyril Hanouna ? Et le monde d'après ne sera-t-il pas aussi habitable que le monde d'avant taxé de décadence absolue par Platon ou Juvénal ? Roland a tiré l'échelle derrière lui et moi je vais retrouver tout à l'heure mes petits-kids Anthony (4 ans) et Timothy (2 ans). Poil aux dents...De la plume d’oie de Léautaud au smartphone de Roland…Roland Jaccard est sans doute le lecteur d’Amiel qui a fait le plus pour la défense et l’illustration du plus extraordinaire Journal intime de l’histoire de la littérature de langue française, jusqu’à se couler dans la peau du pusillanime prof genevois, et de même était-il «fan» des journaux de Benjamin Constant - dont l’esprit sous-tend Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel - de Jules Renard et de Paul Léautaud en son Journal littéraire rédigé à la plume d’oie…
À ce propos, je laisse aux vertueux de cet acabit la tâche de taxer Roland Jaccard d'idéologiquement suspect, estimant personnellement que l'idéologie est un virus mortel pour l'Esprit et n'étant jamais entré, avec Roland, dans aucun débat, ni sur la droite française, dont je me foutais quoique publiant deux livres chez Pierre-Guillaume de Roux, classé par les bien-pensants à l'extrême-droite alors que jamais nous n'avons parlé politique ensemble, et je souriais quand Roland traitait mon ami Jean Ziegler d'arnaqueur, estimant que l'un et l'autre valaient mieux que leurs postures idéologiques respectives.Un texte assez déchirant, sur son blog, où il est question de la mort d'un moineau, dit assez le peu d'estime, à mon sens injustifié, que Roland se portait. D'aucuns prétendront l'avoir compris, sûrement à trop bon compte, mais moi qui ne croyais ni à son cynisme ni à sa misogynie affichée, ni à ses rodomontades de pro-Trump (juste pour contredire les bien-pensants), ni à son prétendu nihilisme, aussi relatif que celui de Caraco et de Cioran (qu'on lise le journal de celui-ci pour découvrir quel farceur était au naturel le prétendu Maître du néant...), je n'aurai pas le prétention d'avoir compris cet être si superficiel et si complexe à la fois, si vaniteux et si humble, si puant en son parisianisme et si fraternel, si généreux en éditeur de Clément Rosset et de Frédéric Pajak, de Comte-Sponville et de tant d'autres alors qu'il se reprochait son manque de générosité, si gentil au moment même où il se la jouait méchant de cinéma - comme s'il fallait comprendre la vie...Et le «monde d’après» ? Le nom de Cyril Hanouna le résumera, bien insuffisamment certes mais lié à une émission auquel Roland participa un soir, consacré à la prostitution. Devait-il y participer ? m’avait-il demandé au téléphone avant de s’y pointer, et comme j’avais assisté peu de temps auparavant, moi qui ne regarde jamais la télé, à l’atroce spectacle ordonné par le monstre en question, je lui dis que même payé (il le serait de 60 euros) jamais je ne m’infligerais une telle torture.Mais Roland était joueur (ce que je ne suis aucunement détestant le ping-pong et nul en échecs) et toujours un peu frimeur (comme tout écrivain), et c’est en joueur frimeur qu’il aura touché à tous les aspects du «monde d’après» en restant scotché au monde d’hier. Là-dessus, c’est sur le pauvre Hanouna qu’il conclut son dernier blog d’avant le lundi fatal, comme s’il avait tiré la chasse.Mais qu'en est-il du vrai Cyril Hanouna ? Et le monde d'après ne sera-t-il pas aussi habitable que le monde d'avant taxé de décadence absolue par Platon ou Juvénal ? Roland a tiré l'échelle derrière lui et moi je vais retrouver tout à l'heure mes petits-kids Anthony (4 ans) et Timothy (2 ans). Poil aux dents...De la plume d’oie de Léautaud au smartphone de Roland…Roland Jaccard est sans doute le lecteur d’Amiel qui a fait le plus pour la défense et l’illustration du plus extraordinaire Journal intime de l’histoire de la littérature de langue française, jusqu’à se couler dans la peau du pusillanime prof genevois, et de même était-il «fan» des journaux de Benjamin Constant - dont l’esprit sous-tend Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel - de Jules Renard et de Paul Léautaud en son Journal littéraire rédigé à la plume d’oie… Or c’est via Youtube que Roland, il y a deux ans de ça, m’a relancé, ou plus exactement par Facebook, où nous avions fait ami-ami, quand il me transmit une vidéo de son ami Olivier François, réalisée dans le bureau de Dominique de Roux (le premier écrivain français, proche de L’Âge d’Homme dès les débuts de la maison de Vladimir Dimitrijevic et que j’avais interviewé en 1970, à mes débuts de critique littéraire), dans laquelle il détaillait ses découvertes et préférences en matière cinématographique : un grand moment de passion partagée !Et ce n’était pour moi qu’un début, ce premier contact aboutissant bientôt à la rencontre de Pierre-Guillaume de Roux, fils de Dominique et bientôt l’éditeur de mes Jardins suspendus, ceci grâce à l’entregent amical de Roland connu de tous ceux qui se sont assis à sa table de chez Yushi.C’est ainsi là que j’ai rencontré Denis Grozdanovitch, son compère aux échecs, Jean-François Braunstein, magistral contempteur de La Philosophie devenue folle, les délicieux Pierre Mari et Mark Greene dont j’ai lu par la suite et commenté les livres par estime réelle et non par copinage de bistrot nippon…Se taxant parfois lui-même de «réactionnaire», notre ami Roland, social et sociable en diable, n’en usait pas moins des multiples moyens de communiquer que nous offre aujourd’hui la technologie subtile, rédigeant ses carnets à la main et jouant du podcast et des applis avec la souplesse d’un geek – il n’y a pas d’équivalent dans la langue de Caraco ni de Cioran.Joueur et frimeur, Roland Jaccard a fui Paris et le « monde d’après » au commencement du cauchemar sanitaire que nous vivons, réalisant en partie les prédictions d’Albert Caraco, précisément. Il raconte ce dernier épisode dans On ne se remet jamais d’une enfance heureuse, son chant du cygne en quelque sorte, que je l’imagine composer dans sa suite à 800 francs la nuit du Lausanne-Palace, à 33 bornes de la crèche non moins luxueuse de feu Nabokov.
Or c’est via Youtube que Roland, il y a deux ans de ça, m’a relancé, ou plus exactement par Facebook, où nous avions fait ami-ami, quand il me transmit une vidéo de son ami Olivier François, réalisée dans le bureau de Dominique de Roux (le premier écrivain français, proche de L’Âge d’Homme dès les débuts de la maison de Vladimir Dimitrijevic et que j’avais interviewé en 1970, à mes débuts de critique littéraire), dans laquelle il détaillait ses découvertes et préférences en matière cinématographique : un grand moment de passion partagée !Et ce n’était pour moi qu’un début, ce premier contact aboutissant bientôt à la rencontre de Pierre-Guillaume de Roux, fils de Dominique et bientôt l’éditeur de mes Jardins suspendus, ceci grâce à l’entregent amical de Roland connu de tous ceux qui se sont assis à sa table de chez Yushi.C’est ainsi là que j’ai rencontré Denis Grozdanovitch, son compère aux échecs, Jean-François Braunstein, magistral contempteur de La Philosophie devenue folle, les délicieux Pierre Mari et Mark Greene dont j’ai lu par la suite et commenté les livres par estime réelle et non par copinage de bistrot nippon…Se taxant parfois lui-même de «réactionnaire», notre ami Roland, social et sociable en diable, n’en usait pas moins des multiples moyens de communiquer que nous offre aujourd’hui la technologie subtile, rédigeant ses carnets à la main et jouant du podcast et des applis avec la souplesse d’un geek – il n’y a pas d’équivalent dans la langue de Caraco ni de Cioran.Joueur et frimeur, Roland Jaccard a fui Paris et le « monde d’après » au commencement du cauchemar sanitaire que nous vivons, réalisant en partie les prédictions d’Albert Caraco, précisément. Il raconte ce dernier épisode dans On ne se remet jamais d’une enfance heureuse, son chant du cygne en quelque sorte, que je l’imagine composer dans sa suite à 800 francs la nuit du Lausanne-Palace, à 33 bornes de la crèche non moins luxueuse de feu Nabokov. Roland m’a vu, de se yeux vu, dérober un ouvrage doré sur tranche intitulé La Désirade, dans la bibliothèque du Lausanne-Palace, il m’a promis de n’en rien dire et je lui sais gré de sa discrétion. En revanche, il m’a autorisé à répandre le bruit, que j’ai fantasmé, selon lequel il séjournerait à l’année dans l’hôtel le plus cher de la ville de Lausanne grâce à sa double vie de casseur, les soirées d’hiver, braquant les villas de la Côte d’azur avec son ami Alain Caillol, ancien complice de Jacques Mesrine et gravement impliqué dans l’enlèvement brutal du baron belge Empain, condamné pour cela à plus de vingt ans de prison qu’il mit à profit pour étudier les œuvres complètes de George Sand - donc le nihiliste conséquent et compétent à tous égards.J’aurai vu ça de mon vivant : Alain Caillol chez Yushi. Cela vaut bien Mitterrand débarquant en hélico chez Michel Tournier. Et cela reste le « monde d’avant ».Après, Mademoiselle et Monsieur les Millenials, vous lirez Confession d’un gentil garçon ou De l’influence des intellectuels sur les talons aiguilles, vous lirez Une liaison dangereuse avec Marie Céhère ou Cioran et compagnie, vous lirez le Dictionnaire du parfait cynique ou Dis-moi la vérité sur l’amour…C’est ça, Roland, dis-moi la vérité sur l’amour, et je ferai semblant de te croire, mais surtout restons amis par delà les eaux sombres…Roland Jaccard. Le Monde d’avant. Journal 1983-1988, Serge Safran éditeur, 2021.
Roland m’a vu, de se yeux vu, dérober un ouvrage doré sur tranche intitulé La Désirade, dans la bibliothèque du Lausanne-Palace, il m’a promis de n’en rien dire et je lui sais gré de sa discrétion. En revanche, il m’a autorisé à répandre le bruit, que j’ai fantasmé, selon lequel il séjournerait à l’année dans l’hôtel le plus cher de la ville de Lausanne grâce à sa double vie de casseur, les soirées d’hiver, braquant les villas de la Côte d’azur avec son ami Alain Caillol, ancien complice de Jacques Mesrine et gravement impliqué dans l’enlèvement brutal du baron belge Empain, condamné pour cela à plus de vingt ans de prison qu’il mit à profit pour étudier les œuvres complètes de George Sand - donc le nihiliste conséquent et compétent à tous égards.J’aurai vu ça de mon vivant : Alain Caillol chez Yushi. Cela vaut bien Mitterrand débarquant en hélico chez Michel Tournier. Et cela reste le « monde d’avant ».Après, Mademoiselle et Monsieur les Millenials, vous lirez Confession d’un gentil garçon ou De l’influence des intellectuels sur les talons aiguilles, vous lirez Une liaison dangereuse avec Marie Céhère ou Cioran et compagnie, vous lirez le Dictionnaire du parfait cynique ou Dis-moi la vérité sur l’amour…C’est ça, Roland, dis-moi la vérité sur l’amour, et je ferai semblant de te croire, mais surtout restons amis par delà les eaux sombres…Roland Jaccard. Le Monde d’avant. Journal 1983-1988, Serge Safran éditeur, 2021. « Que dire de cet été qui s’achève avec quelques mesures sanitaires de plus, sinon que je l’ai traversé comme un mauvais rêve ? J’en garderai l’image de ce moineau égaré dans la cage de mon escalier, tentant frénétiquement de s’en échapper, frappant les vitres closes avec son bec et mourant d’épuisement ou de panique sur mon paillasson. Quand j’ai entrepris de le délivrer, il était trop tard. Il est toujours trop tard d’ailleurs quand j’entreprends quelque chose. La lâcheté, la paresse, le sentiment profond de l’inutilité de tout acte me conduisent à cette abstention qu’ensuite je me reproche. Ce n’est que quand le drame s’achève que je comprends qu’il s’agissait d’un drame.J’aurais certes pu me dire : qu’importe qu’il y ait à Paris un moineau de plus ou de moins ? Mais son cadavre encore chaud là devant ma porte, m’interdisait toute esquive.Ma compagne, qui ne manquait pas de mordant, me dit que l’histoire de ce moineau résumait à elle seule l’histoire de toutes les femmes qui m’avaient aimé. Je n’eus même pas le courage de prendre ce petit cadavre encore doux et palpitant dans mes mains et de le descendre dans la cour. Ce fut mon amie qui s’en chargea. Ce qui lui traversa l’esprit pendant qu’elle descendait les six étages, je l’imagine sans peine : je vis avec un irresponsable doublé d’un couard. Mais comme les femmes savent d’instinct que l’irresponsabilité et l’égoïsme sont les deux vertus majeures des hommes, l’affaire en resta là.Confortablement installé sur mon lit à écouter des slows, j’en arrivai à cette conclusion : tous ceux qui me laissent tomber ont raison; tous ceux qui me démolissent ont raison; tous ceux qui me dépouillent ont raison. Pourquoi ? Parce que j’ai gâché mes chances. Parce que mes ambitions étaient risibles – et que je ne les ai même pas réalisées. Parce que…..mais tous ces « parce que » sont également dérisoires et inutiles face à cette évidence : le manque de générosité est ce qui se paie le plus cher dans la vie. »
« Que dire de cet été qui s’achève avec quelques mesures sanitaires de plus, sinon que je l’ai traversé comme un mauvais rêve ? J’en garderai l’image de ce moineau égaré dans la cage de mon escalier, tentant frénétiquement de s’en échapper, frappant les vitres closes avec son bec et mourant d’épuisement ou de panique sur mon paillasson. Quand j’ai entrepris de le délivrer, il était trop tard. Il est toujours trop tard d’ailleurs quand j’entreprends quelque chose. La lâcheté, la paresse, le sentiment profond de l’inutilité de tout acte me conduisent à cette abstention qu’ensuite je me reproche. Ce n’est que quand le drame s’achève que je comprends qu’il s’agissait d’un drame.J’aurais certes pu me dire : qu’importe qu’il y ait à Paris un moineau de plus ou de moins ? Mais son cadavre encore chaud là devant ma porte, m’interdisait toute esquive.Ma compagne, qui ne manquait pas de mordant, me dit que l’histoire de ce moineau résumait à elle seule l’histoire de toutes les femmes qui m’avaient aimé. Je n’eus même pas le courage de prendre ce petit cadavre encore doux et palpitant dans mes mains et de le descendre dans la cour. Ce fut mon amie qui s’en chargea. Ce qui lui traversa l’esprit pendant qu’elle descendait les six étages, je l’imagine sans peine : je vis avec un irresponsable doublé d’un couard. Mais comme les femmes savent d’instinct que l’irresponsabilité et l’égoïsme sont les deux vertus majeures des hommes, l’affaire en resta là.Confortablement installé sur mon lit à écouter des slows, j’en arrivai à cette conclusion : tous ceux qui me laissent tomber ont raison; tous ceux qui me démolissent ont raison; tous ceux qui me dépouillent ont raison. Pourquoi ? Parce que j’ai gâché mes chances. Parce que mes ambitions étaient risibles – et que je ne les ai même pas réalisées. Parce que…..mais tous ces « parce que » sont également dérisoires et inutiles face à cette évidence : le manque de générosité est ce qui se paie le plus cher dans la vie. » -
Le monde est un grand hôpital où l’on soigne toujours à tâtons
 Tout dire sur la médecine vécue au quotidien, où cauchemar est plus fréquent que victoire, il y a un siècle comme ce matin : c’est le propos de Vikenti Veressaïev dans ses Notes d’un médecin, prisées par le public (et Tolstoï et Tchékhov à l’unisson) mais suscitant la fureur de certains de ses confrères. Tantôt accusateur implacable, et tantôt défenseur des inévitables pratiques à risques de la médecine, incessamment déchiré par le doute et les limites de sa propre compétence, horrifié par le charlatanisme et la morgue de certains, tant que par l’omertà du milieu, l’auteur laisse, en écrivain sensible, un témoignage d’une exceptionnelle honnêteté, laquelle rime avec humanité.À en croire l’écrivain russe Dimitri Bortnikov, de mère « chirurgienne-née » et qui lui mit, la première, les Notes d’un médecin entre les mains, il y a deux espèces de médecins : « Ceux qui, comme les garagistes, veulent comprendre comment ce corps-voiture fonctionne. Ils se fichent de celui qui le conduit. Et puis ceux qui veulent soigner. Et ce sont d’eux que nous gardons la mémoire. Ce sont eux qui souvent deviennent écrivains. En soignant les pauvres…Amoureux de l’humanité, ces médecins soignent ceux qui n’ont rien à donner au médecin, rien, sinon la guérison. Ces médecins-là brûlent d’amour pour le vivant, deviennent fous d’amour pour l’humanité. Mais l’amour trop grand est exigeant, et comment ! Plus l’amour est grand, plus la déception est immense… »Et Bortnikov, écrivain largement reconnu et préfacier de ces Notes d’un médecin, de se rappeler qu’il a toujours voulu être médecin comme sa mère et son grand-père maternel et qu’il a travaillé en ses jeunes années dans une maternité où la première chose qu’on lui a dit se réduisait à cet ordre : « D’abord, tu laveras le sol ». Comme Thérèse d’Avila aux novices de son couvent impatientes de flirter avec le Seigneur : « D’abord, vous laverez le sol »…C’est aussi la première expérience pratique de la médecine vécue par Vikenti Veressaïev, après la théorie ressassée pendant des années d’études: assister à un premier accouchement sans y toucher , assister à sa première dissection sans y toucher, et ensuite mettre la main à la pâte vivante et vivre la mort de son premier patient après une première erreur de diagnostic, vivre cette horreur de prendre une vie qu’on était supposé sauver, douter absolument de soi, et douter bientôt de la médecine même, avant de découvrir, par la grâce d’un aîné, que l’expérience et la compétence sont aussi de ce monde et que c’est à travailler, travailler et travailler à cette acquisition qu’il faut se consacrer – « soigner la nuit jusqu’à l’aube », dit encore Dimitri Bortnikov, qui rappelle dans la foulée les noms de ces médecins-écrivains amoureux de l’humanité qu’ont été Anton Tchékhov – lequel admirait Veressaïev « pour le courage de son écriture », mais aussi Mikhail Boulgakov, génial auteur du Maître et Marguerite à qui l’on doit également de fameux Carnets d’un jeune médecin, d’André Breton et de Louis Aragon et jusqu’à Rabelais…Un livre brûlant, et surtout éclairant…« Lecteur, tu tiens dans les mains un livre brûlant », écrit encore Dimitri Bortnikov, qui souligne que « son auteur n’a jamais perdu confiance en l’homme ni son amour pour lui en dépit de ce qu’il ressentait : « Parfois, je voyais le monde comme un immense hôpital »…Mais quoi de commun, objectera-t-on, entre l’«hôpital» des dernières années du XIXe siècle – les notes de Veressaïev courent entre 1895 et 1900 -, et la médecine actuelle aux transformations vertigineuses, quoi de commun au temps où l’on inoculait la syphilis à des patients-victimes en bonne santé pour en observer « scientifiquement » les effets, et celui des protocoles sophistiqués de l’éthique médicale, en attendant les dernières avancées de l’intelligence artificielle !Eh bien justement, à propos de l’IA : les débats actuels sur la nécessité de préserver le facteur humain et la relation personnelle du médecin et du patient sont au cœur, déjà, des observations et des mises en garde de Veressaïev, immédiatement en rupture d’omertà. Ah bon, le milieu médical de l’époque pratiquait déjà l’omertà ? Pas que !Plus on avance dans la lecture de ces Notes d’un médecin, plus on constate en effet l’actualité « brûlante » de ses observations, où il s’implique souvent lui-même. Cela commence par deux diagnostic erronnés qu’il formule, étudiant en troisième année, en se croyant atteint d’un sarcome (un grain de beauté irrité par sa chemise), puis en croyant identifier les symptômes d’une « diabète insipide » en interprétant (mal) un ouvrage de référence du célèbre Adolf von Strümpeli - à relever alors au passage que Veressaïev ne cesse de citer la pléthorique littérature médicale de l’époque dont il se gave comme un fou pour compléter son savoir.Or dès ses débuts de médecin « sur le terrain », le jeune diplômé constate le malentendu : qu’il est censé désormais faire partie des « augures », alors qu’il ne sait rien. Qu’il ne pourra progresser sans expérience, laquelle le confronte à des pratiques qui le choquent comme les autopsies automatiques, sans consentement des familles, ou l’inoculation de maladies vénériennes aux fins d’observation, et de constater que les femmes subissent un traitement particulièrement humiliant, autant que les patients démunis ; après quoi le thème de la médecine « à deux vitesses » ressurgit - tout cela qui devrait rester « entre nous », relève un éminent patron, lequel aura de quoi fulminer contre ce fâcheux cassant « le morceau ».Là-dessus, pas besoin d’insister dur le caractère éminemment actuel de ce qui sépare la médecine « de parade », la « médecine-business », et celle qui vise essentiellement à soulager et guérir le patient. Plusieurs séries « médicales » sud-coréennes en donnent aujourd’hui une illustration critique éloquente, où des « hommes de l’art », qui sont souvent des femmes, résistent à la tentation du gain et de la rentabilité au profit de soins égaux pour tous.Au demeurant, s’il lui arrive de désigner explicitement des « bourreaux », Veressaïev n’en rend pas moins hommage aux vrais « héros » travaillant honnêtement, comme il s’y est lui-même employé.Riche de nombreux épisodes émouvants, voire parfois déchirants, Notes d’un médecin aborde aussi la question de la vivisection animale, où l’auteur, après avoir « sacrifié » un adorable macaque sur l’autel de ses recherches, s’interroge sur la légitimité de cette pratique « au nom de quel droit »…L’on a appris récemment que le sinistre Bachar el-Assad se réjouissait de bénéficier, à Moscou, des meilleurs soins, à l’enseigne d’une médecine de haute qualité, sans comparaisons avec celle des provinces russes...Or la troisième partie du livre de Vikenti Veressaïev , où il parle de la survie difficile de beaucoup de ses confrères honnêtes pratiquant ce qu’on peut dire la « médecine des gens », est un véritable tableau chiffré des conditions matérielles de la profession en Russie du début du XXe siècle, avec de forts contrastes entre capitales et campagnes – comme l’illustrent de leur côté tant de récits de Tchékhov - avec des aperçus latéraux sur la situation en Europe, nous renvoyant finalement à la situation de nos jours.Pour conclure cependant, le bilan plutôt sombre qu’il tire des conditions de travail de ses confrères lui semble moins alarmant que l’état général de l’« hôpital» de l’époque : « Les honoraires des médecins sont minimes, et cependant ils restent trop élevés pour beaucoup trop de leurs patients », écrit-il en 1900, un lustre après avoir fait ce constat de jeune carabin déjà lucide : « Non aucun doute n’était permis. Un être humain normal, c’est un être humain malade ! L’être humain en bonne santé n’est qu’une heureuse anomalie».Alors santé, frères humains, un coup de vodka et prenez soin de vous…Vikenti Veressaïev. Notes dun médecin. Traduit du russe oar Julie Bouvard. Préface de Dimitri Bortnikov. Editions soir sur Blan, La Bibliothèque de Dimitri, 261p.
Tout dire sur la médecine vécue au quotidien, où cauchemar est plus fréquent que victoire, il y a un siècle comme ce matin : c’est le propos de Vikenti Veressaïev dans ses Notes d’un médecin, prisées par le public (et Tolstoï et Tchékhov à l’unisson) mais suscitant la fureur de certains de ses confrères. Tantôt accusateur implacable, et tantôt défenseur des inévitables pratiques à risques de la médecine, incessamment déchiré par le doute et les limites de sa propre compétence, horrifié par le charlatanisme et la morgue de certains, tant que par l’omertà du milieu, l’auteur laisse, en écrivain sensible, un témoignage d’une exceptionnelle honnêteté, laquelle rime avec humanité.À en croire l’écrivain russe Dimitri Bortnikov, de mère « chirurgienne-née » et qui lui mit, la première, les Notes d’un médecin entre les mains, il y a deux espèces de médecins : « Ceux qui, comme les garagistes, veulent comprendre comment ce corps-voiture fonctionne. Ils se fichent de celui qui le conduit. Et puis ceux qui veulent soigner. Et ce sont d’eux que nous gardons la mémoire. Ce sont eux qui souvent deviennent écrivains. En soignant les pauvres…Amoureux de l’humanité, ces médecins soignent ceux qui n’ont rien à donner au médecin, rien, sinon la guérison. Ces médecins-là brûlent d’amour pour le vivant, deviennent fous d’amour pour l’humanité. Mais l’amour trop grand est exigeant, et comment ! Plus l’amour est grand, plus la déception est immense… »Et Bortnikov, écrivain largement reconnu et préfacier de ces Notes d’un médecin, de se rappeler qu’il a toujours voulu être médecin comme sa mère et son grand-père maternel et qu’il a travaillé en ses jeunes années dans une maternité où la première chose qu’on lui a dit se réduisait à cet ordre : « D’abord, tu laveras le sol ». Comme Thérèse d’Avila aux novices de son couvent impatientes de flirter avec le Seigneur : « D’abord, vous laverez le sol »…C’est aussi la première expérience pratique de la médecine vécue par Vikenti Veressaïev, après la théorie ressassée pendant des années d’études: assister à un premier accouchement sans y toucher , assister à sa première dissection sans y toucher, et ensuite mettre la main à la pâte vivante et vivre la mort de son premier patient après une première erreur de diagnostic, vivre cette horreur de prendre une vie qu’on était supposé sauver, douter absolument de soi, et douter bientôt de la médecine même, avant de découvrir, par la grâce d’un aîné, que l’expérience et la compétence sont aussi de ce monde et que c’est à travailler, travailler et travailler à cette acquisition qu’il faut se consacrer – « soigner la nuit jusqu’à l’aube », dit encore Dimitri Bortnikov, qui rappelle dans la foulée les noms de ces médecins-écrivains amoureux de l’humanité qu’ont été Anton Tchékhov – lequel admirait Veressaïev « pour le courage de son écriture », mais aussi Mikhail Boulgakov, génial auteur du Maître et Marguerite à qui l’on doit également de fameux Carnets d’un jeune médecin, d’André Breton et de Louis Aragon et jusqu’à Rabelais…Un livre brûlant, et surtout éclairant…« Lecteur, tu tiens dans les mains un livre brûlant », écrit encore Dimitri Bortnikov, qui souligne que « son auteur n’a jamais perdu confiance en l’homme ni son amour pour lui en dépit de ce qu’il ressentait : « Parfois, je voyais le monde comme un immense hôpital »…Mais quoi de commun, objectera-t-on, entre l’«hôpital» des dernières années du XIXe siècle – les notes de Veressaïev courent entre 1895 et 1900 -, et la médecine actuelle aux transformations vertigineuses, quoi de commun au temps où l’on inoculait la syphilis à des patients-victimes en bonne santé pour en observer « scientifiquement » les effets, et celui des protocoles sophistiqués de l’éthique médicale, en attendant les dernières avancées de l’intelligence artificielle !Eh bien justement, à propos de l’IA : les débats actuels sur la nécessité de préserver le facteur humain et la relation personnelle du médecin et du patient sont au cœur, déjà, des observations et des mises en garde de Veressaïev, immédiatement en rupture d’omertà. Ah bon, le milieu médical de l’époque pratiquait déjà l’omertà ? Pas que !Plus on avance dans la lecture de ces Notes d’un médecin, plus on constate en effet l’actualité « brûlante » de ses observations, où il s’implique souvent lui-même. Cela commence par deux diagnostic erronnés qu’il formule, étudiant en troisième année, en se croyant atteint d’un sarcome (un grain de beauté irrité par sa chemise), puis en croyant identifier les symptômes d’une « diabète insipide » en interprétant (mal) un ouvrage de référence du célèbre Adolf von Strümpeli - à relever alors au passage que Veressaïev ne cesse de citer la pléthorique littérature médicale de l’époque dont il se gave comme un fou pour compléter son savoir.Or dès ses débuts de médecin « sur le terrain », le jeune diplômé constate le malentendu : qu’il est censé désormais faire partie des « augures », alors qu’il ne sait rien. Qu’il ne pourra progresser sans expérience, laquelle le confronte à des pratiques qui le choquent comme les autopsies automatiques, sans consentement des familles, ou l’inoculation de maladies vénériennes aux fins d’observation, et de constater que les femmes subissent un traitement particulièrement humiliant, autant que les patients démunis ; après quoi le thème de la médecine « à deux vitesses » ressurgit - tout cela qui devrait rester « entre nous », relève un éminent patron, lequel aura de quoi fulminer contre ce fâcheux cassant « le morceau ».Là-dessus, pas besoin d’insister dur le caractère éminemment actuel de ce qui sépare la médecine « de parade », la « médecine-business », et celle qui vise essentiellement à soulager et guérir le patient. Plusieurs séries « médicales » sud-coréennes en donnent aujourd’hui une illustration critique éloquente, où des « hommes de l’art », qui sont souvent des femmes, résistent à la tentation du gain et de la rentabilité au profit de soins égaux pour tous.Au demeurant, s’il lui arrive de désigner explicitement des « bourreaux », Veressaïev n’en rend pas moins hommage aux vrais « héros » travaillant honnêtement, comme il s’y est lui-même employé.Riche de nombreux épisodes émouvants, voire parfois déchirants, Notes d’un médecin aborde aussi la question de la vivisection animale, où l’auteur, après avoir « sacrifié » un adorable macaque sur l’autel de ses recherches, s’interroge sur la légitimité de cette pratique « au nom de quel droit »…L’on a appris récemment que le sinistre Bachar el-Assad se réjouissait de bénéficier, à Moscou, des meilleurs soins, à l’enseigne d’une médecine de haute qualité, sans comparaisons avec celle des provinces russes...Or la troisième partie du livre de Vikenti Veressaïev , où il parle de la survie difficile de beaucoup de ses confrères honnêtes pratiquant ce qu’on peut dire la « médecine des gens », est un véritable tableau chiffré des conditions matérielles de la profession en Russie du début du XXe siècle, avec de forts contrastes entre capitales et campagnes – comme l’illustrent de leur côté tant de récits de Tchékhov - avec des aperçus latéraux sur la situation en Europe, nous renvoyant finalement à la situation de nos jours.Pour conclure cependant, le bilan plutôt sombre qu’il tire des conditions de travail de ses confrères lui semble moins alarmant que l’état général de l’« hôpital» de l’époque : « Les honoraires des médecins sont minimes, et cependant ils restent trop élevés pour beaucoup trop de leurs patients », écrit-il en 1900, un lustre après avoir fait ce constat de jeune carabin déjà lucide : « Non aucun doute n’était permis. Un être humain normal, c’est un être humain malade ! L’être humain en bonne santé n’est qu’une heureuse anomalie».Alors santé, frères humains, un coup de vodka et prenez soin de vous…Vikenti Veressaïev. Notes dun médecin. Traduit du russe oar Julie Bouvard. Préface de Dimitri Bortnikov. Editions soir sur Blan, La Bibliothèque de Dimitri, 261p. -
Ce don que tu reçois
 (Pour Aliocha)Je ne suis pas ce qu’ils disent une fille facile, mais je me donne volontiers, et je m’adonne, aussi me suis-je souvent abandonnée entre divers bras, diverses années, jusqu’à me retrouver là, seule mais jamais désenchantée, à sourire en vous qui vous souvenez de moi…C’est ainsi que je me suis adonnée au piano, après m’être donnée une première fois et avoir été abandonnée - les amants passent et le piano reste, me disais-je en jouant des sonates ou n’importe quoi que je savais par cœur - ma sœur exquise disait que c’était un don de recevoir ainsi la musique en soi, notamment dédiée à certaine Élise…C’est en effet un don que de bien recevoir ce qui est offert, donner va de soi mais recevoir est une autre affaire qui suppose qu’on abandonne les préventions ordinaires et qu’on se laisse faire sans penser à maldonne - un doux génie y pourvoit sans qu’on s’en doute, et surtout pour qui n’aura pas redouté les secondes fois, la musique est faite aussi de toutes nos déroutes et c’est pourquoi le génie sourit…Image: Les mains de Martha A.
(Pour Aliocha)Je ne suis pas ce qu’ils disent une fille facile, mais je me donne volontiers, et je m’adonne, aussi me suis-je souvent abandonnée entre divers bras, diverses années, jusqu’à me retrouver là, seule mais jamais désenchantée, à sourire en vous qui vous souvenez de moi…C’est ainsi que je me suis adonnée au piano, après m’être donnée une première fois et avoir été abandonnée - les amants passent et le piano reste, me disais-je en jouant des sonates ou n’importe quoi que je savais par cœur - ma sœur exquise disait que c’était un don de recevoir ainsi la musique en soi, notamment dédiée à certaine Élise…C’est en effet un don que de bien recevoir ce qui est offert, donner va de soi mais recevoir est une autre affaire qui suppose qu’on abandonne les préventions ordinaires et qu’on se laisse faire sans penser à maldonne - un doux génie y pourvoit sans qu’on s’en doute, et surtout pour qui n’aura pas redouté les secondes fois, la musique est faite aussi de toutes nos déroutes et c’est pourquoi le génie sourit…Image: Les mains de Martha A. -
Ceux dont la passion est obscure
Celui qui se méfie de lui-même / Celle qui aimerait effacer les péripéties de la nuit passée / Ceux qui dorment dans la salle d’attente de la gare de Sienne / Celui qui se demande ce qu’il fait au bord de la rivière noire / Celle que la voix d’Adolf Hitler incite à se signer / Ceux qui ne savent comment parler à leur cousin néonazi / Celui que son impuissance sexuelle a rendu plus attentif dans ses entretiens de formateur en chef / Celle qui ne prêtera jamais son stylo Mont-Blanc / Ceux qui écoulent les derniers exemplaires des Œuvres complètes de Lénine aux Editions sociales / Celui qui en mai 68 s’est fait choper chez Maspéro en train de piquer Le bleu du ciel de Bataille sur grand papier / Celle qui n’ose pas rire à cause de son nouvel appareil / Ceux qui estiment qu’il est politiquement répréhensible de regarder TF1 / Celui qui recommande la lecture de ses propres livres / Celle qui croit encore que le DJ Fabrice est le meilleur coup de la place de Neuchâtel / Ceux qui estiment qu’ils valent le DJ Fabrice / Celui qui ne parle que de Dieu et de cul / Celle qui reste des heures à sa fenêtre / Ceux qui font peser leur réprobation silencieuse / Celui qui serine aux amoureux que tout à une fin / Celle qui estime que faire des enfants aujourd’hui est irresponsable / Ceux qui se sont pacsés le jour de la Libération / Celui qui injurie les internautes sous le pseudo de Tatie Beurk / Celle qui épie sa voisine nympho / Ceux qui boivent du Nesquick / Celui qui se sait condamné / Celle qui exerce son violoncelle à minuit pour faire chier les Borcard d’à côté ces nuls / Ceux qui dénoncent le travesti Molly au concierge Semedo pour les bouteilles de Pet qu’il/elle balance dans le vide-ordures / Celui qui affirme avoir mal à l’équipe de France / Celle qui porte le maillot de Zidane pour bluffer sa cheffe de projet / Ceux qui vomissent leur pays d’accueil / Celui qui se trouve lui-même au top / Celle qui estime que son compagnon de vie Onésime ferait mieux d’admettre son homosexualité inconsciente / Ceux qui se flattent de leur cynisme immonde / Celui qui distingue sans peine le chant de la fauvette de celui de la mésange huppée / Celle qui a les règles les plus douloureuses de l’atelier de couture de Madame Dupanloup / Ceux qui préfèrent les chiens virtuels du Nintendo / Celui qui rêve de se faire un Coréen / Celle dont la vie a été transformée par la rencontre du représentant des aspirateurs Dyson / Ceux qui estiment que la réputation des aspirateurs Dyson est surfaite / Celui qui limite son ambition prochaine à l’acquisition d’un aspirateur Dyson / Ceux qui raptent les chiens de prix / Celui qui sifflote dans sa Twingo / Celle qui conçoit un logiciel bancaire à l’insu de ses proches / Ceux qui se ramasseront un mélanome à Lanzarote, etc.
Obscure est ma passion. Dessin à la plume de Louis Soutter
-
Les napperons
...Cette maison c’est l’enfer, se dit-on d’abord: on ne peut plus faire trois pas sans que Maman nous colle un napperon, toute la journée elle est à son crochet, à la moindre remarque ce sont des larmes : vous n’aimez pas mes napperons, je sens que vous avez quelque chose contre mes napperons, vous allez encore faire du chagrin à Maman; et puis, à la longue on devient plus cool, on se dit qu'il y a pire, on fait avec, on peut aussi se dire qu’avec les napperons on échappe aux patins et aux housses, et cela, mon amour, je ne le supporterais pas: les patins et les housses, je serais capable de devenir mauvais, il ne serait pas exclu que je la trucide grave si ta mère nous imposait des patins et des housses...
Image: Philip Seelen
-
Deux ombres claires
 Elle est là partout où il va,on pourrait dire son ombreà cela près que son air sombrene lui ressemble pas...Songeuse au café du matin,dans le jour si légerqu’on le dirait fait de satin,elle se tient en retrait,accoudée au comptoir,invisible dans le miroir,mais lui la reconnaîtet l’emmène bientôt la basà la table que vous savez...Lui demandez-vous des nouvellesqu’il répond: elle repose,et l’on fait celui qui comprend,celle qui croit savoir les choses -on la croyait mortelle...Les apparences ont des ruses,et lorsque ces deux-làque toute évidence récusesans raisons ni tracas,plaisantent au fond de ce café,l’on reste médusé...Le mystère n’est pas ailleursque dans cette lumièreétrange et pourtant familière,hors du bruit et des heures...(Peinture: Jacques Truphémus)
Elle est là partout où il va,on pourrait dire son ombreà cela près que son air sombrene lui ressemble pas...Songeuse au café du matin,dans le jour si légerqu’on le dirait fait de satin,elle se tient en retrait,accoudée au comptoir,invisible dans le miroir,mais lui la reconnaîtet l’emmène bientôt la basà la table que vous savez...Lui demandez-vous des nouvellesqu’il répond: elle repose,et l’on fait celui qui comprend,celle qui croit savoir les choses -on la croyait mortelle...Les apparences ont des ruses,et lorsque ces deux-làque toute évidence récusesans raisons ni tracas,plaisantent au fond de ce café,l’on reste médusé...Le mystère n’est pas ailleursque dans cette lumièreétrange et pourtant familière,hors du bruit et des heures...(Peinture: Jacques Truphémus) -
Le disciple

…Toi chais pas mais moi je me fais un peu yéchi en montagne, d’abord t’es trop seul, ensuite ça sait faire que monter la montagne, et plus tu montes et plus tu vois pas où ça va, tu fais que monter et tu te dis : tu vas voir, le Maître l'a dit, mais tu vois que tes pieds et les pieds des arbres, et bientôt t’es plus haut que les arbres et après que t’as plus que tes pieds au sommet tu marches dans le vide et là t’as Bouddha qui te dit : continue ! Bouddha qu’est là-bas sous l’arbre, cool le Bouddha et toi qu’as oublié ta fiole de grappa…
Image : Samivel. -
Médium des ténèbres

En lisant Le Chasseur de Têtes, de Timothy Findley.
Les pouvoirs magiques du romancier sont souvent réduits à moins que rien dans la littérature contemporaine, tandis qu'ils se trouvent réinvestis dès la première page du Chasseur de Têtes, à la faveur d'un événement redoutable. Le lecteur y apprend en effet que le fameux Kurtz, héros d'Au Coeur des Ténèbres - fascinant récit de Joseph Conrad qui inspira Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now, où ledit Kurtz est incarné par Marlon Brando - s' échappe de la page 181 du livre qu'est en train de lire la bibliothécaire schizophrène Lilah Kemp, une «spirite aux pouvoirs considérables mais indisciplinés», tandis que la tempête fait rage dans les rues de Toronto.
Dans la foulée, nous ne saurions trop nous étonner du fait que Rupert Kurtz réapparaisse sous les traits d'un éminent psychiatre régnant sur l'univers d'un institut de recherche en psychiatrie, maître occulte d'une véritable manipulation des êtres et des esprits (sans parler des fortunes qu'il capte pour financer ses menées de démiurge), pas plus que ne nous surprend l'apparition de Charlie Marlow, lui aussi «sorti» du récit de Conrad et qui enquêtera, en l'occurrence, sur les choses effrayantes qui se passent dans les coulisses de l'Institut Parkin qu'on pourrait dire l'asile d'aliénés de la société contemporaine.
C'est, de fait, un voyage au bout de la folie (et donc au bout de la raison) que ce roman mêlant admirablement les observations les plus aiguës d'une peinture de moeurs enracinée (Toronto y est présent avec ses grandes familles friquées et déchirées par la haine à la manière de Dallas, ses artistes décadents et ses clubs de débauche très smart, ses paumés de tous niveaux sociaux, mais aussi son architecture et ses espaces, son brouillard jaune et ses ravins lugubres) et les composantes d'une plus vaste fresque évoquant la dérive des sociétés dites les plus évoluées vers leur autodestruction. Dans la même poussée, le roman accumule les notations hallucinantes d'une plongée au coeur des ténèbres de la psychologie humaine, qui débouche sur une réflexion morale des plus actuelles.
Jusqu'où ira l'homme dans son obscure volonté de puissance, et pourquoi éprouve-t-il le besoin de souiller les incarnations même de l'innocence? Telles sont les questions que nous nous posons à la lecture du Chasseur de Têtes, notamment, en traversant tel laboratoire d'expériences sur des animaux où le sentiment d'horreur est rendu comme à l'état pur, au-delà de toute sensiblerie, en parcourant les salles d'un établissement psychiatrique réservé à des gosses ou en découvrant, avec Marlow, tel réseau de réalisateurs de snuff-pictures, ces photographies de mises à mort d'enfants où le plaisir sexuel, la torture et la mort trouvent leur accomplissement abject et lucratif...
Timothy Findley n'a pas attendu l'affaire Dutroux, et les multiples tragédies contemporaines impliquant des viols et des meurtres d'enfants, pour intégrer ce thème dans Le Chasseur de Têtes. Au demeurant, ce n'est là qu'un des «cercles» de l'enfer exploré par l'auteur-médium dans ce roman hanté par de nombreux personnages zigzaguant sans discontinuer d'une fiction à l'autre.
Voici par exemple Emma Berry, qui s'est refait un prénom à la lecture de Madame Bovary, et qui traîne sa mélancolie nymphomane dans une limousine à silhouette de grande baleine blanche, voici Amy Wylie la poétesse aux oiseaux dont la «folie» paraît tellement moins monstrueuse que la «raison» du Dr Shelley, expérimentatrice glaciale à laquelle la Science semble tout permettre, voici les réincarnations de Pierre Lapin ou de Gatsby le Magnifique, ou encore de telle romancière qui a bien connu Dickens et communique avec Lilah Kemp par voie spirite, ou enfin, comme une présence obsédante, voici les Escadrons M sillonnant les rues de Toronto à la chasse des étourneaux porteurs du virus de la sturnucémie, ce nouveau sida dont on apprendra finalement qu'il participe lui aussi d'une manipulation démoniaque...
Or, ce qui saisit le plus, à la lecture de ce roman comme saturé par l'horreur, est la poésie étrange et la lancinante tendresse qui s'en dégagent, les constantes ressources d'humour de l'auteur et la beauté de l'objet littéraire, d'une modernité profondément irriguée de savoir et de mémoire. Visionnaire comme l' était Conrad, témoin de l'innocence martyrisée (où les figures faulknériennes de l'enfant et du fou cohabitent avec celle de l'animal blessé), Timothy Findley pétrit à pleines mains la pâte d'une grande oeuvre contemporaine.
Dès Le Dernier des Fous (Le Serpent à Plumes, 1993), son premier roman, évoquant le dernier été en enfance d'un garçon confronté à diverses destinées catastrophiques, nous avions flairé l'auteur d'envergure. Après Guerres (Le Serpent à Plumes, 1993), saisissante évocation de la première tuerie du siècle, et surtout avec Le Chasseur de Têtes, l'évidence de son génie littéraire nous paraît appeler la plus large reconnaissance.
Timothy Findley, Le Chasseur de Têtes. Traduit de l'anglais par Nésida Loyer. Editions Le Serpent à Plumes, 1996. 570 p. Personnage hors du commun
Personnage hors du commun
Encore méconnu dans les pays de langue française, Timothy Findley est considéré, après la disparition de Robertson Davies, comme le plus grand écrivain canadien de langue anglaise.
Né en 1930 à Toronto, dans le quartier chic de Rosedale, quoique de famille ruinée (son père était employé de banque, très porté sur la bouteille et la poésie), il fut d'abord acteur (Alec Guinness le fit venir à Londres, où il travailla notamment avec Sir John Gielguld et Peter Brook). Il continua, en 1957, à rouler sa bosse en Californie, vivant de petits métiers, avant d'entreprendre une oeuvre considérable d'auteur dramatique (cinq pièces), de romancier (neuf romans, dont six traduits en français), de nouvelliste, d'essayiste et de scénariste. Monument national au Canada, Timothy Findley est traduit en quinze langues. La complicité singulière avec le monde animal, qui transparaît dans ses livres, a une base existentielle avérée: il vit en effet avec quatorze chats, deux chiens, trois cents carpes japonaises et un rat musqué... -
Où tu t'en vas...
 (En lisant Jour de glace d’Anton Pavlovitch Tchekhov)Pour NicolasHélas il ne fera plus froid,dans le monde où tu vas:plus de larmes, plus de tracas,plus de mal au cœur -plus de coeur…C’était si bien , vous dites-vous,de souffrir comme un chien,comme un mendiant qu’on humilie,ou comme l’enfant,là, tout seul au froid qui l’engourdit -mais quelle chance il a !Tu t’en iras le cœur transi:chance de regretterles ombres sombres de ta vie;tu te rappelles la pénombreet la beauté des chosespar les allées où tu t’en vas,dans le parfum des roses;tu souriras aux jours de glacequi t’attendent là-bas…(Ce dimanche 8 décembre 2024)Image: Philip Seelen
(En lisant Jour de glace d’Anton Pavlovitch Tchekhov)Pour NicolasHélas il ne fera plus froid,dans le monde où tu vas:plus de larmes, plus de tracas,plus de mal au cœur -plus de coeur…C’était si bien , vous dites-vous,de souffrir comme un chien,comme un mendiant qu’on humilie,ou comme l’enfant,là, tout seul au froid qui l’engourdit -mais quelle chance il a !Tu t’en iras le cœur transi:chance de regretterles ombres sombres de ta vie;tu te rappelles la pénombreet la beauté des chosespar les allées où tu t’en vas,dans le parfum des roses;tu souriras aux jours de glacequi t’attendent là-bas…(Ce dimanche 8 décembre 2024)Image: Philip Seelen -
Au bord du ciel
 (En mémoire de Lady L., trois ans après...)Tu l’ignorais, mais ce beau jourdu quatorze décembre,il y aura trois ans de ca,serait ton tout dernier,mais je le dis surtout pour nous,car tu flottais,déjà,sur la barque de ton coma,le souffle ralenti,et la main ne tenant plus rien...Plus rien alors que cette Absencecomme une mer aux seuls reflets;ce n’est pas Dieu qui l’a voulu,disait l’enfant en toi,dont l’enfant à venir dirait,en vous fixant aux yeuxet le prénom de Dieu, c’est quoi?À leur Très-Haut tu opposaisle Très-Bas un peu lasqui dit-on parlait aux oiseaux,ou ta mère aux vieilles sagesses,ou ton frère ce parfait vaurien,ou ton poète en sa faiblesse,et tes enfants et autres chiens...À de tels moments, à la fin,tout sourit dans le tempsdont les eaux comme en un soupirse retirent lentementet la nuit t’engloutit,et vous voici sur l'autre rivede ce ciel au bord de la terre,où tout n'est plus rien que lumière...(À La Maison Bleue, ce 14 décembre 2024)Image: Lucia K. alias Lady L.
(En mémoire de Lady L., trois ans après...)Tu l’ignorais, mais ce beau jourdu quatorze décembre,il y aura trois ans de ca,serait ton tout dernier,mais je le dis surtout pour nous,car tu flottais,déjà,sur la barque de ton coma,le souffle ralenti,et la main ne tenant plus rien...Plus rien alors que cette Absencecomme une mer aux seuls reflets;ce n’est pas Dieu qui l’a voulu,disait l’enfant en toi,dont l’enfant à venir dirait,en vous fixant aux yeuxet le prénom de Dieu, c’est quoi?À leur Très-Haut tu opposaisle Très-Bas un peu lasqui dit-on parlait aux oiseaux,ou ta mère aux vieilles sagesses,ou ton frère ce parfait vaurien,ou ton poète en sa faiblesse,et tes enfants et autres chiens...À de tels moments, à la fin,tout sourit dans le tempsdont les eaux comme en un soupirse retirent lentementet la nuit t’engloutit,et vous voici sur l'autre rivede ce ciel au bord de la terre,où tout n'est plus rien que lumière...(À La Maison Bleue, ce 14 décembre 2024)Image: Lucia K. alias Lady L. -
Passagers de l'émouvance
 À mon ami Richard DindoOn se fie à l'étoile:on croit que l'ange à fait son job;tu te tais en silence,seul et nu devant l'épilobe...On ne sait rien quand on distinguel'ortie du barbelé,le crépuscule de la rumeurdes bambins de nursery,ou les haïkus des gens stressés...Je devine ce que je saurairevenant en forêtde nos enfances en alléesoù tel jour je devinsce qu'à la fin je devais être,au conditionnel de la danse...Demain sur le tarmacun vent de nulle part soufflera,nous rappelant les hamacsdes villages japonais,et l'échappée de ce voyagedans le temps des visages...(À La Désirade, ce 11 avril 2017, en relisant Bashô
À mon ami Richard DindoOn se fie à l'étoile:on croit que l'ange à fait son job;tu te tais en silence,seul et nu devant l'épilobe...On ne sait rien quand on distinguel'ortie du barbelé,le crépuscule de la rumeurdes bambins de nursery,ou les haïkus des gens stressés...Je devine ce que je saurairevenant en forêtde nos enfances en alléesoù tel jour je devinsce qu'à la fin je devais être,au conditionnel de la danse...Demain sur le tarmacun vent de nulle part soufflera,nous rappelant les hamacsdes villages japonais,et l'échappée de ce voyagedans le temps des visages...(À La Désirade, ce 11 avril 2017, en relisant Bashô -
Ceux qui restent tendance

Celui qui sacrifierait sa mère à sa renommée sans état d’âme / Celle que le taux de testostérone du Patron met en confiance / Ceux qui investissent dans leur image / Celui qui pèse sur la touche FEMME pour rebondir socialement / Celle qui jauge le candidat à son langage corporel non maîtrisé / Ceux qui sont nettement au-dessus de la taille moyenne fixée par l’anthropométrie hollandaise / Celui dont la chemise diffuse une fragrance de citron bon marché non appropriée à la marque qu’il défend / Celle qui a toujours un rouleau d’essuie-tout à portée de main / Ceux qui ne sont pas invités au vernissage de Lula / Celui qui remodèlise les images de cadavres décapités que Lula Serena recycle dans ses sérigraphies très recherchées sur le marché / Celle qui établit des bilans de réputation pour la firme HopeWorld / Ceux qui passent d’un club omnisports à un club omnisexes / Celui qui considère son physique comme une victoire de la Nouvelle Fiction Esthétique / Celle qui assume son rôle de domestique oisive d’un sexa plein aux as à petites attentions d’époux infidèle / Ceux qui se considèrent comme le sang vif du tertiaire / Celui que son mètre soixante-trois empêchera toujours de percer dans les milieux qui comptent à ses yeux / Celle que la nature a dessinée dans le style manga / Ceux que la méchanceté stupide rend de plus en plus amènes et distants / Celui qui est sincèrement préoccupé de métaphysique classique en dépit de sa dégaine à la Clooney / Celle que son sens de l’humour autorise à dissimuler son intelligence extrême et sa sensibilité plutôt fleur bleue / Ceux qui abordent les femmes qu’ils désirent le plus comme à un entretien d’embauche / Celui qui resplendit comme un soleil de plastique laqué de neuf / Celle qui a percé à jour le plan rantanplan de son ex connu pour sa cupidité proportionnée à ses capacités quelque part / Ceux que leurs fautes d’orthographe rendent presque émouvants / Celui qui sait cligner de l’œil comme un smiley mutin probablement annonciateur de plans d’enfer / Celle qui fait croire à son actuel que rien ne lui fait plus plaisir que son cadeau très onéreux qui va grever le budget qu’elle-même compense avec l’argent de la mère de son ex / Ceux qui n’achètent que des chaussures à semelles surcompensées pour se rendre aux vernissages de Lula Serena / Celui qui pense que les vrais grands artistes sont visibles par leur taille et leur lèvre inférieure / Celle qui fait semblant de raffoler de Damien Hirst / Ceux qui ont décidé d’un commun accord de consacrer une pièce absolument vide de leur Loft de 350m2 à l’âme de Rothko / Celui qui croit compenser les avortements qu’il impose au moyen d’invocations mystiques assorties de versements mensuels / Celle qui change d’amant en fonction des pertes de sa galerie branchée / Ceux qui sont de tous les afters de Lula / Celui dont les fringues classes ne compensent pas tout à fait le QI de colibri affolé / Celle qui ne prolonge jamais la poignée de main de trois secondes et demi que conseille le protocole / Ceux qui vont droit au but par des détours qui leur permettent de ferrer le requin / Celui qui ressent tout en termes d’extension de la lutte alors qu’il ne cesse de dénigrer le Produit / Celle qui a appris que sans un minimum de funding une entreprise même légère reste délicate à manier sans recours aux plans limites / Ceux qui passent au tu avant de passer au lit ou parfois après ça dépend / Celui qui engage des ouvriers polonais qu’il paie comme des clandestins colombiens / Celle qui invite volontiers les actuelles de ses ex pour les bluffer / Ceux qui restent plus ou moins les actuels de Lula au dam de son dernier ex qu'elle punit encore pour la galerie, etc.
Image: Damien Hirst



