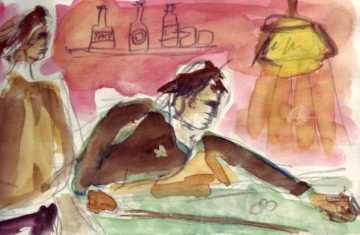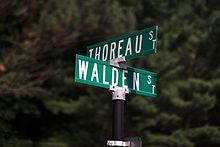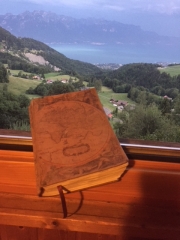Carnets de JLK - Page 16
-
Éloge du brouillard
 D’aucuns vont prétendant que le brouillard est l’ennemi Numéro Deux, après la pluie givrante, de la déambulation radieuse. Or je m’inscris en faux contre cette vision des choses. Le brouillard, que Gustave Roud disait le Seigneur de l’Automne, et qui agit à vrai dire quand il veut et partout où il veut, jusqu’à Salamanque - le brouillard est un révélateur de visions précisément.De ma fenêtre haute de Sent, en basse-Engadine, d’où se déploie ordinairement la vue du val splendide à tendres gazons jusqu’au château de Tarasp, sous le promontoire duquel l’Inn descend en gracieux méandres dont les multiples S annoncent Scuol et Seraplana et Sbruck en Autriche, on ne voyait ce matin-là qu’une grande présence de velours de suie aux reflets d’anthracite et j’étais comblé : je me revoyais en Cornouailles et à Salamanque.Le brouillard de Cornouailles est aussi remarquable, on le sait, que celui qui remonte soudain le long des flancs du Machu Pichu, mais le brouillard le plus étonnant au monde (in the World) est le brouillard à Salamanque, qui flotte à moyenne hauteur de passants et coupe ceux-ci à la taille, au tronc ou à fleur de tête, produisant dans ses meilleurs moments d’intéressantes variations à la Magritte...A Sent, ce matin-là, le brouillard était également inventif, traversé de longues grandes formes inquiètes cheminant comme des âmes en peine, sans doute sortie des légendes du Trentin voisin, peut-être montées des contes de Dino Buzzati, soudain dissipées par un coup de dague de la lumière matinale ouvrant une faille vers les hauteurs de Guarda, à trois coups d’ailes de choucas, et de nouveau plus rien, autant dire : tout à imaginer…
D’aucuns vont prétendant que le brouillard est l’ennemi Numéro Deux, après la pluie givrante, de la déambulation radieuse. Or je m’inscris en faux contre cette vision des choses. Le brouillard, que Gustave Roud disait le Seigneur de l’Automne, et qui agit à vrai dire quand il veut et partout où il veut, jusqu’à Salamanque - le brouillard est un révélateur de visions précisément.De ma fenêtre haute de Sent, en basse-Engadine, d’où se déploie ordinairement la vue du val splendide à tendres gazons jusqu’au château de Tarasp, sous le promontoire duquel l’Inn descend en gracieux méandres dont les multiples S annoncent Scuol et Seraplana et Sbruck en Autriche, on ne voyait ce matin-là qu’une grande présence de velours de suie aux reflets d’anthracite et j’étais comblé : je me revoyais en Cornouailles et à Salamanque.Le brouillard de Cornouailles est aussi remarquable, on le sait, que celui qui remonte soudain le long des flancs du Machu Pichu, mais le brouillard le plus étonnant au monde (in the World) est le brouillard à Salamanque, qui flotte à moyenne hauteur de passants et coupe ceux-ci à la taille, au tronc ou à fleur de tête, produisant dans ses meilleurs moments d’intéressantes variations à la Magritte...A Sent, ce matin-là, le brouillard était également inventif, traversé de longues grandes formes inquiètes cheminant comme des âmes en peine, sans doute sortie des légendes du Trentin voisin, peut-être montées des contes de Dino Buzzati, soudain dissipées par un coup de dague de la lumière matinale ouvrant une faille vers les hauteurs de Guarda, à trois coups d’ailes de choucas, et de nouveau plus rien, autant dire : tout à imaginer… -
Au théâtre des sensibles
 En mémoire du Maestro Guido Ceronetti, mort le 13 septembre 2018 à Cetona. Grazie al filosofo ignoto !Guido Ceronetti, grand écrivain italien tout menu d’apparence, subit le poids du monde sur ses frêles épaules de nonagénaire sans cesser de perpétuer le chant du monde.En mémoire de son ami Cioran, auquel Fabio Ciaralli a consacré un essai intitulé «Odyssée de la lucidité», et en présence d’Anne Marie Jaton dont le dernier livre célèbre «le mariage miraculeux des contraires» chez Albert Cohen, le Maestro présidait l’autre soir une mémorable rencontre en son fief toscan de Cetona...Les ors et la pourpre d’automne jetaient leurs derniers feux, ces jours, sur les collines de haute Toscane, où Nature et Culture n’en finissent pas de se fondre et de survivre au fracas des batailles séculaires.De Florence à Pérouse, en passant par les collines lunaires des crêtes siennoises, ou en fonçant sur les autoroutes démentes, la double nature infernale et «capable du ciel» de notre terrible espèce a trouvé sa plus mémorable illustration dans La Divine Comédie de Dante, que les livres joyeusement désespérés de Guido Ceronetti relancent à leur façon dualiste.Miel et fiel, festival local de la truffe et champignon blanc de la hantise mondiale d’une Apocalypse nucléaire, subite apparition de trois biches à ma fenêtre sur fond d’oliviers argentés et de cyprès en immobiles flammes noires, et sempiternelle jactance de la télé de Berlusconi & Co relayant les Fake News du twitteur ubuesque de la Maison-Blanche: tel est le monde qu’on dirait aux mains d’un marionnettiste tantôt démoniaque et tantôt angélique, dont le Teatro dei Sensibili, fondé par Elena et Guido Ceronetti, a été l’avatar artistique salué par leur ami Fellini et toujours animé par les jeunes disciples du Maestro.Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes...Révélations de la douleurFabio Ciaralli a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené à plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.Paradoxalement, c’est avec deux maîtres contemporains du pessimisme philosophique qu’il a trouvé la force de survivre: Guido Ceronetti, qu’il a lu avec passion et avec lequel il a entretenu une longue correspondance, pour devenir son ami. Et Cioran, penseur d’origine roumaine devenu l’un des plus purs stylistes en langue française, dans la tradition des moralistes, dont il aime à dire qu’il lui a sauvé la vie et auquel il a consacré un livre paru récemment sous le titre combien explicite d’Une Odyssée de la lucidité.Parallèlement, l’amitié partagée de Ceronetti a permis la rencontre de Ciaralli et de la Vaudoise Anne Marie Jaton, alors titulaire de la chaire de littérature française à l’Universite de Pise, auteure de livres consacrés à Blaise Cendrars, Nicolas Bouvier, Charles-Abert Cingria, Jacques Chessex et tout récemment Albert Cohen, et qui l’aida à acquérir des titres universitaires en marge du cursus habituel.Ainsi, mon amie que j’appelle la Professorella, et Fabio Ciaralli, ont-il signé ensemble un premier ouvrage consacré à la littérature concentrationnaire au titre (je traduis) d’Aller (sans) retour, et c’est également avec l’aide du Maestro Ceronetti et de sa «mentoresse» que Ciaralli a réalisé ce nouveau livre tenant à la fois de l’aperçu approfondi de l’œuvre et de la vie d’Emil Cioran (1911-1995) et un reflet plus personnel et vibrant de ses lectures. Cioran «a nourri mes veilles», écrit Fabio Ciaralli, «il m’a tenu en vie», lui qui disait qu’il n’y a pas tant à «se contraindre à une œuvre» qu’à «dire quelque chose qui se puisse murmurer à l’oreille d’un ivrogne ou d’un mourant»…Le moins qu’on puisse dire,dans la foulée, est que Cioran ne dore pas la pilule à la manière de ceux qui «positivent» à bon marché. Cependant, constater la souffrance et les noirceurs de la vie peut aussi nous en révéler plus clairement l’indicible beauté. Et de même qu’on peut être frappé par l’extraordinaire vitalité des Cahiers de Cioran, dont la substance quotidienne est souvent pimentée d’humour, Fabio Ciaralli a-t-il trouvé dans son oeuvre les mêmes contre-poisons toniques que chez Ceronetti.Dans l’église « polyvalente »Or ce fut un bonheur tout simple, sans flafla mondain ni paparazzi accroché aux angelots en stuc 3D, que cette rencontre tricéphale en présence d’un public de tous les âges, au milieu des fresques polychromes de l’église dédiée à Santa Annunziata et transformée en «salle polyvalente» selon l’expression plaisante du Maestro.Guido Ceronetti est lui-même un drôle de paroissien ! Traducteur de plusieurs livres de l'Ancien Testament et longtemps chroniqueur-polémiste dans les colonnes de la Stampa, immensément érudit et curieux de toutes les dernières trouvailles des graffiti muraux, l’auteur du phénoménal Voyage en Italie et de La patience du brûlé, est aussi un témoin de la tragédie quotidienne, un fulminant opposant à la robotisation et au culte satanique de l’argent et du pétrodollar, un poète délicat, un végétarien et un cannibale mangeur d’imbéciles.N’oublions pas la mémoire !Le monde actuel est une espèce d’église polyvalente en déficit redoutable de mémoire, et c’était d’autant plus émouvant d’entendre le Maestro égrener ses souvenirs de Cioran, avec quelle précision malicieuse, que son hypermnésie se troue parfois comme les chaussettes des pèlerins au long cours...Or ça nous arrive à tous, nous qui aurons vécu plus longtemps que Mozart ou le rabbi Ieshouah, mais le titre d’un des derniers petits livres du Maestro m’a sauté l’autre jour aux yeux, sur un rayon d’une petite librairie de San Quirico d’Orcia, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, entre vestiges étrusques et chapiteaux romans, avec ce titre indicatif que je traduis dans la langue d’adoption de Cioran: Pour ne pas oublier la mémoire...Fabio Ciaralli. Emil Cioran, Odissea della lucidità. La scuola di Pitagora editrice, 167p. 2017.Anne Marie Jaton et Fabio Ciaralli. Andata e (non) ritorno; la letteratura dello sterminio fra storia e narrazione. Edizioni ETS. 200p, 2016.Anne Marie Jaton. Albert Cohen, le mariage miraculeux des contraires. Presses polytechniques et universitaires romandes. coll. Le Savoir suisse,121p. 2017.Guido Ceronetti, Le silence du corps, Voyage en Italie, La patience du brûlé, etc. Albin Michel et Livre de poche.Per non dimenticare la memoria. Adelphi, 2016, et Messia, Adelphi, 2017.Image JLK: Guido Ceronetti en 2011, à Cetona.
En mémoire du Maestro Guido Ceronetti, mort le 13 septembre 2018 à Cetona. Grazie al filosofo ignoto !Guido Ceronetti, grand écrivain italien tout menu d’apparence, subit le poids du monde sur ses frêles épaules de nonagénaire sans cesser de perpétuer le chant du monde.En mémoire de son ami Cioran, auquel Fabio Ciaralli a consacré un essai intitulé «Odyssée de la lucidité», et en présence d’Anne Marie Jaton dont le dernier livre célèbre «le mariage miraculeux des contraires» chez Albert Cohen, le Maestro présidait l’autre soir une mémorable rencontre en son fief toscan de Cetona...Les ors et la pourpre d’automne jetaient leurs derniers feux, ces jours, sur les collines de haute Toscane, où Nature et Culture n’en finissent pas de se fondre et de survivre au fracas des batailles séculaires.De Florence à Pérouse, en passant par les collines lunaires des crêtes siennoises, ou en fonçant sur les autoroutes démentes, la double nature infernale et «capable du ciel» de notre terrible espèce a trouvé sa plus mémorable illustration dans La Divine Comédie de Dante, que les livres joyeusement désespérés de Guido Ceronetti relancent à leur façon dualiste.Miel et fiel, festival local de la truffe et champignon blanc de la hantise mondiale d’une Apocalypse nucléaire, subite apparition de trois biches à ma fenêtre sur fond d’oliviers argentés et de cyprès en immobiles flammes noires, et sempiternelle jactance de la télé de Berlusconi & Co relayant les Fake News du twitteur ubuesque de la Maison-Blanche: tel est le monde qu’on dirait aux mains d’un marionnettiste tantôt démoniaque et tantôt angélique, dont le Teatro dei Sensibili, fondé par Elena et Guido Ceronetti, a été l’avatar artistique salué par leur ami Fellini et toujours animé par les jeunes disciples du Maestro.Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes...Révélations de la douleurFabio Ciaralli a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené à plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.Paradoxalement, c’est avec deux maîtres contemporains du pessimisme philosophique qu’il a trouvé la force de survivre: Guido Ceronetti, qu’il a lu avec passion et avec lequel il a entretenu une longue correspondance, pour devenir son ami. Et Cioran, penseur d’origine roumaine devenu l’un des plus purs stylistes en langue française, dans la tradition des moralistes, dont il aime à dire qu’il lui a sauvé la vie et auquel il a consacré un livre paru récemment sous le titre combien explicite d’Une Odyssée de la lucidité.Parallèlement, l’amitié partagée de Ceronetti a permis la rencontre de Ciaralli et de la Vaudoise Anne Marie Jaton, alors titulaire de la chaire de littérature française à l’Universite de Pise, auteure de livres consacrés à Blaise Cendrars, Nicolas Bouvier, Charles-Abert Cingria, Jacques Chessex et tout récemment Albert Cohen, et qui l’aida à acquérir des titres universitaires en marge du cursus habituel.Ainsi, mon amie que j’appelle la Professorella, et Fabio Ciaralli, ont-il signé ensemble un premier ouvrage consacré à la littérature concentrationnaire au titre (je traduis) d’Aller (sans) retour, et c’est également avec l’aide du Maestro Ceronetti et de sa «mentoresse» que Ciaralli a réalisé ce nouveau livre tenant à la fois de l’aperçu approfondi de l’œuvre et de la vie d’Emil Cioran (1911-1995) et un reflet plus personnel et vibrant de ses lectures. Cioran «a nourri mes veilles», écrit Fabio Ciaralli, «il m’a tenu en vie», lui qui disait qu’il n’y a pas tant à «se contraindre à une œuvre» qu’à «dire quelque chose qui se puisse murmurer à l’oreille d’un ivrogne ou d’un mourant»…Le moins qu’on puisse dire,dans la foulée, est que Cioran ne dore pas la pilule à la manière de ceux qui «positivent» à bon marché. Cependant, constater la souffrance et les noirceurs de la vie peut aussi nous en révéler plus clairement l’indicible beauté. Et de même qu’on peut être frappé par l’extraordinaire vitalité des Cahiers de Cioran, dont la substance quotidienne est souvent pimentée d’humour, Fabio Ciaralli a-t-il trouvé dans son oeuvre les mêmes contre-poisons toniques que chez Ceronetti.Dans l’église « polyvalente »Or ce fut un bonheur tout simple, sans flafla mondain ni paparazzi accroché aux angelots en stuc 3D, que cette rencontre tricéphale en présence d’un public de tous les âges, au milieu des fresques polychromes de l’église dédiée à Santa Annunziata et transformée en «salle polyvalente» selon l’expression plaisante du Maestro.Guido Ceronetti est lui-même un drôle de paroissien ! Traducteur de plusieurs livres de l'Ancien Testament et longtemps chroniqueur-polémiste dans les colonnes de la Stampa, immensément érudit et curieux de toutes les dernières trouvailles des graffiti muraux, l’auteur du phénoménal Voyage en Italie et de La patience du brûlé, est aussi un témoin de la tragédie quotidienne, un fulminant opposant à la robotisation et au culte satanique de l’argent et du pétrodollar, un poète délicat, un végétarien et un cannibale mangeur d’imbéciles.N’oublions pas la mémoire !Le monde actuel est une espèce d’église polyvalente en déficit redoutable de mémoire, et c’était d’autant plus émouvant d’entendre le Maestro égrener ses souvenirs de Cioran, avec quelle précision malicieuse, que son hypermnésie se troue parfois comme les chaussettes des pèlerins au long cours...Or ça nous arrive à tous, nous qui aurons vécu plus longtemps que Mozart ou le rabbi Ieshouah, mais le titre d’un des derniers petits livres du Maestro m’a sauté l’autre jour aux yeux, sur un rayon d’une petite librairie de San Quirico d’Orcia, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, entre vestiges étrusques et chapiteaux romans, avec ce titre indicatif que je traduis dans la langue d’adoption de Cioran: Pour ne pas oublier la mémoire...Fabio Ciaralli. Emil Cioran, Odissea della lucidità. La scuola di Pitagora editrice, 167p. 2017.Anne Marie Jaton et Fabio Ciaralli. Andata e (non) ritorno; la letteratura dello sterminio fra storia e narrazione. Edizioni ETS. 200p, 2016.Anne Marie Jaton. Albert Cohen, le mariage miraculeux des contraires. Presses polytechniques et universitaires romandes. coll. Le Savoir suisse,121p. 2017.Guido Ceronetti, Le silence du corps, Voyage en Italie, La patience du brûlé, etc. Albin Michel et Livre de poche.Per non dimenticare la memoria. Adelphi, 2016, et Messia, Adelphi, 2017.Image JLK: Guido Ceronetti en 2011, à Cetona. -
Hors des ombres
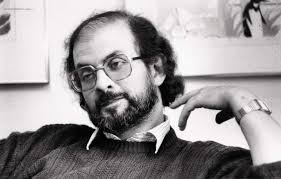 Le récit inédit de Salman Rushdie, en février 1993. Une publication exclusive du Passe-Muraille solidaire...Quatre ans. Quatre ans ont passé et je suis toujours là. Etrange comme cela ressemble simultanément à une victoire et à une défaite.Pourquoi une victoire ?Lorsque, le 14 février 1989, j’ai entendu les nouvelles provenant de Téhéran, ma réaction instantanée fut: je suis un homme mort. Je me souvins alors du poème de mon ami, l’écrivain américain Raymond Carver, à qui son docteur venait d’apprendre qu’il avait un cancer du poumon:«Il dit êtes-vous un homme religieux, vous agenouillez- vous dans les forêts et demandez- vous de l’aide...J’ai dit pas encore mais j’ai l’intention de commencer aujourd’hui»Mais je ne suis pas un homme religieux, je ne me suis pas mis à genoux. Je suis allé à une interview télévisée et j’y ai dit que j’aurais souhaité avoir écrit un livre encore plus critique. Pourquoi ai-je dit cela ? Parce que lorsque le leader d’un Etat terroriste annonce son intention de vous assassiner au nom de Dieu, vous pouvez soit tempêter, soit bredouiller. Je ne voulais pas bredouiller.Ensuite je me suis dit: si Dieu existe, je ne pense pas qu’il soit très tourmenté par Les Versets sataniques, parce que cela ne ressemble pas beaucoup à un dieu d’être ébranlé sur son trône par un livre. D’autre part, si Dieu n’existe pas, il n’est pas tourmenté du tout. Donc la dispute n’a pas lieu entre moi et Dieu, mais entre moi et ceux qui pensent – comme Bob Dylan nous l’ a rappelé autrefois – qu’ ils peuvent faire n’ importe quoi sous prétexte qu’ ils ont Dieu avec eux.La police vint me voir et me dit: restez tranquille, n’ allez nulle part, on est en train de faire des plans. Cette nuit-là, des officiers de police en patrouille réduite veillèrent sur moi. Couché sans pouvoir trouver le sommeil, je guettais l’ange de la mort. Un de mes films favoris était, et reste, L’ Ange exterminateur de Luis Bunuel. Il montre des gens qui ne peuvent pas sortir d’une pièce.Le lendemain après-midi, tandis que la télévision grondait, pleine de haine et assoiffée de sang, la Special Branch m’offrit sa protection. Des officiers vinrent me dire que je devais aller quelque part pendant plusieurs jours, le temps que les politiques règlent cette affaire.Vous rappelez-vous ? Il y a quatre ans, nous pensions tous que la crise serait résolue en quelques jours. Qu’à la fin du XXe siècle un homme puisse être menacé de meurtre pour avoir écrit un livre... que le chef d’ un Etat clérico-fasciste puisse menacer le citoyen libre d’ un pays très éloigné du sien... c’ était trop fou. Cela allait cesser.La police le pensait. Vous le pensiez. Je le pensais aussi.Alors nous sommes partis, non pas dans quelque repaire protégé et secret, mais dans un hôtel des alentours. Il y avait, dans la chambre d’à côté, un reporter du Daily Mirror en compagnie d’une femme qui n’ était pas la sienne. Nos che- mins ne se sont pas croisés. Et cette nuit-là, alors que chaque journaliste de ce pays tentait de découvrir où j’étais allé, ce gentleman – comment dire – a raté un scoop.T out serait fini d’ ici quelques jours. Quatre ans après, cela continue. Et on me dit que le «degré de menace contre ma vie» n’a pas diminué du tout. On me dit aussi qu’il n’y a personne sous la protection de la Special Branch dont l’existence soit plus en danger que la mienne.Une victoire et une défaite: une victoire parce que je suis vivant, en dépit d’avoir été décrit par un «ami» comme un mort en sursis. Une défaite, parce que je suis toujours dans cette prison.«Les murs de pierre ne font pas une prison, ni les barreaux d’acier une cage.»Cette prison va où je vais. Elle n’a pas de murs, pas de toit, pas de menottes, mais en quatre ans je n’en ai pas trouvé la sortie.Quand il devint évident que le problème prendrait plus de temps à résoudre que nous l’avions d’abord pensé, je plongeai plus profondément dans ce monde clandestin que j’ habite maintenant, et que par nécessité je ne peux décrire.J’étais sous pression politique. Je ne pense pas qu’on mesure le poids de cette pression. Le sort des otages britanniques restait en suspens. On me demanda de faire des excuses publiques: sinon, quelque chose aurait pu arriver à un otage britannique et cela, sous-entendu, aurait été ma faute.La déclaration que j’acceptai de faire ne fut pas écrite par moi, mais par le regretté John Lyttle, chargé par l’archevêque de Canterbury du cas des otages, ainsi que par d’autres notables et éminences. Je changeai deux mots, et je dus lutter même pour cette retouche. Cette déclaration ne fit de bien à personne. Elle aurait dû aider les otages; son échec fut interprété comme mon premier échec à sauver ma pauvre tête. Khomeiny réitéra sa fatwa. On offrit plusieurs mil- lions de dollars de prime.Désormais, on faisait officiellement pression pour que je dis- paraisse. L’argument était que j’avais déjà causé assez d’ennuis. Je ne devais plus parler publiquement de mon sort, ni me défendre moi-même. Il y avait déjà un assez gros problème d’ordre public, et du moment que les autorités faisaient tant pour me protéger, je ne devais pas leur rendre la vie plus difficile. N’ allez nulle part, ne voyez personne, ne dites rien. Soyez une non-personne et soyez content d’être vivant. Ecoutez les vilenies, les calomnies, les discours meurtriers, les appels au calme, et fermez-la.«Les murs de pierre ne font pas une prison...»Durant presque un an et demi, je n’ eus de contact avec aucun membre du gouverne- ment britannique, pas plus qu’ avec les fonctionnaires du ministère de l’ Intérieur ou du Foreign Office. J’ étais dans les limbes. On m’informa que le ministère de l’Intérieur avait opposé son veto à toute rencontre avec moi parce que cela, prétendait-on, pouvait détériorer les relations entre communautés ethniques. A la fin, je téléphonai à William Waldegrave, alors au Foreign Office, et lui demandai s'il ne serait pas bon que nous nous rencontrions.Il n’était pas habilité – autorisé, je pense – à me rencontrer. Mais j’obtins finalement une entrevue avec un diplomate du Foreign Office, et une autre avec Douglas Hurd lui-même. Ces rencontres eurent lieu à la condition de rester entièrement secrètes, «pour que les otages n’aient pas à en souffrir».Soit dit en passant, je ne me rappelle pas que Téhéran ou que les preneurs d’otages du Liban aient jamais fait le lien. Mais je me trompe peut-être. Si je révèle ces détails aujourd’hui, c’est parce qu’il n’ y a plus de risque à le faire. Jusqu’au jour où Terry Waite a été relâché, je fus en quelque sorte l’otage des otages. J’avais accepté que leur cas soit résolu d’ abord et que, dans une certaine mesure, mes droits soient mis de côté pour favoriser les leurs.J’espérais seulement qu’une fois les otages libérés, mon tour viendrait; que le gouvernement britannique et la communauté internationale chercheraient une solution à cette crise aussi. L’attente fut longue, pleine de moments bizarres.Un film pakistanais, me dépeignant comme un tortionnaire, un meurtrier et un ivrogne portant une variété effrayante de costumes safari multicolores, n’obtint pas son visa en Grande- Bretagne. Je vis une cassette vidéo du film; c’ était horrible. Cela se finissait sur mon «exécution» par le pouvoir de Dieu. L’horreur de ces images me poursuivit longtemps.J’ écrivis à la commission de contrôle britannique, en leur promettant de ne rien faire contre eux ni contre le film, et en leur demandant de l’autoriser. Je leur disais que je ne voulais pas de la protection douteuse de la censure. Le film fut autorisé et disparut promptement des écrans. Une tentative de le montrer à Bradford se solda par des rangées vides. C’ était une par- faite illustration de la justesse de la liberté d’ expression: les gens sont réellement capables de se forger leur propre opinion. Tout de même, c’ était curieux d’ être satisfait de la sortie d’ un film dont le sujet était ma mort.Parfois je séjournais dans de confortables maisons. Parfois je n’avais rien de plus qu’une petite chambre dont je ne pouvais approcher la fenêtre de crainte d’être aperçu. Parfois on me per- mettait de sortir un peu. A d’autres moments, il m’était difficile de le faire. J’ ai essayé d’aller aux Etats-Unis et en France, mais les gouvernements de ces pays ont rendu ma visite impossible.Une fois je dus me rendre à l’ hôpital pour me faire arracher les dents de sagesse. J’ ai appris plus tard que la police avait fait des plans catastrophe pour «m’arracher» moi. Je devais être anesthésié et transporté dans un sac mortuaire à l’ intérieur d’ un corbillard.Je nouai des relations amicales avec les équipes chargées de ma protection et j’ en appris beaucoup sur les fonctionnements de la Special Branch. J’appris à repérer si l’on est suivi sur l’autoroute; je m’accoutumai au matériel qui traînait sans cesse alentour; j’appris l’argot des forces de police – les chauffeurs, par exemple, sont connus comme les OFD, abréviation de Only Fucking Drivers. Les policiers de l’autoroute sont les «Rats noirs». Mon propre nom n’était jamais utilisé. J’ appris à répondre à d’ autres noms, j’étais «le Principal».Je me suis familiarisé avec beaucoup de choses qui m’étaient totalement étrangères il y a quatre ans, mais je ne m’y suis jamais habitué. Je savais dès le début que l’accoutumance serait une reddition. Ce qui est arrivé à ma vie est une chose grotesque. C’ est un crime. Je n’ accepterai jamais que cela devienne ma condition normale.«Qu’est-ce qui est blonde, a de gros seins et vit en Tasmanie ?»«Salman Rushdie.» J’ ai reçu des lettres, j’en reçois encore, disant: laissez tomber, changez de nom, faites-vous opérer, démarrez une nouvelle vie. C’est une éventualité que je n’ai jamais envisagée. Ce serait pire que la mort. Je ne veux pas de la vie d’une autre personne. Je veux la mienne.Mes gardes du corps ont fait preuve envers moi d’ une grande compréhension et m’ ont aidé à traverser les pires moments. Je leur en serai toujours reconnais- sant. Ce sont des hommes coura- geux. Ils exposent leur vie pour me protéger. Jamais personne auparavant n’a fait cela pour moi.Une chose est à souligner: puisque je n’ai pas été tué, beau- coup de gens doivent penser que personne n’ essaie de le faire. Ils croient probablement que tout cela est un peu théorique. Ce n’est pas le cas.Dans les premiers mois, un terroriste arabe se fit sauter dans un hôtel de Paddington. Par la suite, un journaliste qui avait visité les camps du Hezbollah, dans la vallée de la Bekaa au Liban, m’apprit qu’il avait vu la photographie de cet homme sur un «mur des martyrs» dans un bureau, avec une légende disant que j’étais sa cible. Pendant la guerre du Golfe, j’ entendis dire que le gouvernement iranien avait payé pour qu’ on m’ assassine. Après des mois d’extrême précaution, on m’a annoncé que les tueurs avaient été «frustrés» – pour utiliser le langage par euphémismes des services secrets. J’ai préféré ne pas m’ enquérir des raisons de leur frustration.En 1992, trois Iraniens furent expulsés de Grande-Bretagne. Deux d’ entre eux travaillaient à la mission iranienne de Londres, le troisième était «étudiant». Le Foreign Office me dit que c’étaient des espions et que leur présence en Grande-Bretagne était indubitablement liée à l’ accomplissement de la fatwa. Le traducteur italien des Versets sataniques a failli être tué et le traducteur japonais l’a été. En 1992, la police japonaise a annoncé les résultats de douze mois d’ enquête. Selon eux, les assassins étaient des terroristes professionnels du Moyen-Orient ayant transité par la Chine.Dans le même temps, un commando iranien assassina l’ancien Premier ministre Bakhtiar à Paris. On l’égorgea. Un autre commando tua un chanteur iranien dissident en Allemagne. Ils le dépecèrent et en jetèrent les morceaux dans un sac. Rien de très théorique à cela.L’Angleterre est un petit pays, très peuplé, et beaucoup de gens sont curieux. Il n’est guère facile d’ y disparaître. Une fois j’ étais dans un immeuble que je devais quitter, mais une conduite de chauffage central venait d’exploser juste dans l’ entrée et un plombier était là. Un officier de police eut à dis- traire son attention pour que je puisse m’éclipser.Moins une.Une autre fois j’étais dans une cuisine lorsqu’un voisin surgit à l’improviste. Je dus plonger derrière un meuble et rester là, accroupi, jusqu’à ce qu’il parte.Moins une.Une autre fois je fus pris dans un embouteillage devant la mosquée de Regent’s Park, juste au moment où les fidèles sortaient de la prière de l’ Aïd. J’étais assis à l’arrière d’une Jaguar blindée, le nez enfoui dans le Daily Telegraph. Mes gardes du corps dirent en plaisantant que c’était la première fois qu’ils me voyaient aussi intéressé par le Telegraph.Vivre ainsi c’est éprouver une dégradation quotidienne, c’est sentir peu à peu l’ humiliation vous tordre le cœur. Vivre ainsi, c’est permettre à des gens – y compris votre femme – de vous traiter de couard à la une des journaux. Cette sorte de gens ferait sans doute de beaux éloges à mes funérailles. Mais vivre, éviter les tueurs, est une plus grande victoire que d’ être assassiné. Seuls les fanatiques recherchent le martyre.J’ai quarante-cinq ans et je ne peux pas quitter mes lieux de résidence sans permission. Je ne possède pas les clés de l’ entrée principale. Quelquefois il y a des «mauvaises passes». Pendant une de ces «mauvaises passes» – je ne peux pas expliquer de quoi il s’ agissait –, j’ ai dormi en vingt nuits dans treize lits différents. En de telles circonstances, une grande et sauva- ge cacophonie envahit votre corps. En de telles circonstances, vous commencez à être coupé de vous-même.J’ai appris à accepter. Accepter la colère et l’amertume. Cela recommencera, je le sais. Quand les choses iront mieux, il faudra régler le problème. En ce moment, ma victoire réside dans le fait de ne pas m’être laissé briser, de ne pas m’ être perdu moi-même. Elle réside dans le fait de continuer à travailler. Il n’y a plus d’otages. Pour la première fois depuis des années, je peux défendre ma cause sans être accusé de porter préjudice aux intérêts d’ autrui. J’ ai combattu du mieux que je pouvais.* * *Comme chacun, je me suis réjoui de la fin de la terrible épreuve des otages du Liban. Mais les personnes les plus actives dans la campagne pour ma défense, Frances d’Souza et Carmel Bedford de l’ association Article 19, savaient que l’ immense soulagement ressenti par tous à la fin de cet horrible chapitre était aussi un danger. Peut-être que les gens ne voudraient plus prêter attention à quelqu’ un disant: excusez-moi, il y a tout de même encore un problème. Peut-être que je serais considéré comme une sorte de cause perdue. D’ un autre côté, selon des rumeurs persistantes, le gouvernement britannique était sur le point de normaliser ses relations avec l’Iran et d’oublier entièrement le «cas Rushdie». Que faire ? Se taire et compter sur la «diplomatie silencieuse» ou parler haut et fort ?De mon point de vue, il n’y avait pas de choix. La libération des otages m’avait enfin délié la langue. Il eût été absurde de combattre pour la liberté de parole en demeurant silencieux. Nous avons décidé de mener une campagne aussi bruyante que possible, pour persuader le gouvernement britannique qu’ il ne pouvait se permettre d’ignorer le cas, et pour ranimer le sou- tien international, de façon à démontrer à l’Etatterreur iranien que la fatwa nuisait à ses propres intérêts autant qu’ aux miens.En décembre 1991, quelques jours après la libération du der- nier otage américain, Terry Anderson, on me permit finalement d’entrer aux Etats-Unis pour prendre la parole à l’ occasion de la célébration, par l’ uni- versité de Columbia, du 200e anniversaire de la Déclaration des Droits. Les préparatifs du voyage furent un cauchemar. Vingt-quatre heures avant de partir je ne savais pas si j’aurais l’autorisation. J’étais censé voyager dans un avion militaire, une grande faveur dont j’ étais très reconnaissant. (Cela devait rester entièrement secret, sauf qu’un tabloïd anglais trouva bon de publier l’ information et de m’ accuser de mettre en danger la Royal Air Force !)Le moment du départ fut bouleversant. C’était la première fois que je quittais la Grande- Bretagne depuis presque trois ans. Pour un instant, la cage me sembla un peu plus grande. A New York, un cortège d’auto- mobiles vint me chercher, renforcé par des motards. On m’ installa dans une limousine blanche et on fonça dans Manhattan à toute allure. «C’est ce que nous ferions avec Arafat», expliqua le chef des opérations. Je m’enquis timidement: «Et pour le Président ?» Pour le Président, ils fermeraient davantage de rues latérales. «Mais dans votre cas, nous avons pensé que ce serait un peu trop voyant.» Cela sans la moindre ironie. Le Département de Police de New York est très consciencieux mais il plaisante peu.Je passai la journée dans une suite au quatorzième étage, avec au moins vingt hommes armés. Les fenêtres étaient obstruées par des matelas à l’ épreuve des balles. Devant la porte il y avait plein d’autres hommes armés avec des muscles et une artillerie à la Schwarzenegger. Dans cette suite j’eus une série d’ entrevues qui doivent rester secrètes, à l’ exception peut-être de l’ une d’ elles. Je pus rencontrer le poète Allen Ginsberg durant vingt minutes. Dès son arrivée, il retira les coussins du sofa et les disposa sur le sol. «Enlevez vos chaussures et asseyez-vous par terre, dit-il. Je vais vous apprendre quelques exercices simples de méditation. Ils devraient vous aider à vivre votre terrible situation.» Notre agent littéraire commun, Andrew Wylie, était présent et je l’invitai à faire de même, ce qu’il fit, maugréant quelque peu. Pendant que nous faisions notre respiration et nos psalmodies, je pensais combien il était extraordinaire pour un Indien de naissance d’ être initié au bouddhisme par un poète américain assis en tailleur, dans une pièce pleine d’hommes armés jusqu’aux dents. La vie est unique; ça ne s’invente pas.Cette nuit-là, l’énorme cortège m’ amena à Columbia et je pus faire ma conférence. Je me souviens d’avoir dit que la liberté d’ expression est la vie elle- même. Le lendemain, la presse américaine fut très sympathique et positive. Il était clair que les Américains voyaient la situation comme moi: une vieille liberté fondamentale était devenue une question de vie ou de mort. De retour chez moi, ce fut une autre affaire. Je rentrais en Angleterre pour être confronté à des titres comme «RUSHDIE ENFLAMME À NOUVEAU LA COLERE DES MUSULMANS» (parce que j’avais demandé la publication en édition de poche des Versets sataniques).L ’ année suivante, tandis que je visitais de plus en plus de pays, cette dichotomie devint encore plus évidente. Dans le reste du monde libre, le «cas Rushdie» concerne la liberté d’expression et le terrorisme d’Etat. En Grande-Bretagne, cela semble être l’ histoire d’ un homme que l’ on doit protéger des conséquences de ses propres actes. Partout ailleurs, les gens savent que l’ outrage n’ a pas été commis par moi, mais contre moi. Dans certaines parties de mon propre pays, on se figure le contraire.Savoir cela, c’est transporter, où que j’ aille, une blessure qui ne cicatrise pas. Elle m’ ôte mes forces. Je ne sais pas si qui- conque s’en soucie, mais c’est le cas.* * *L’édition de poche des Versets sataniques fut publiée au printemps 1992, non par Penguin, qui refusa de le faire, mais par un consortium. Je pus aller à Washington pour son lancement et, au cours d’ une nouvelle conférence sur la liberté d’expression, j’en exhibai le premier exemplaire. Et soudain l’émotion me submergea. Tout ce que je pus faire fut de retenir mes larmes.J’étais surtout venu à Washington pour m’ adresser à des membres des deux chambres du Congrès. Le soir de la réunion, on m’ informa que le Secrétaire d’ Etat James Baker avait téléphoné personnellement aux présidents des deux chambres pour leur dire qu’il ne souhaitait pas que cette rencontre ait lieu. L ’ administration Bush fit des remarques déplacées sur ma présence. Marlin Fitzwater justifia ainsi le refus de l’ Administration de me voir: «C’est juste un auteur en tournée de promotion.»En dépit des «performances» de l’ équipe Bush, je parvins à voir un groupe, de sénateurs distingués – conduit par Daniel Patrick Moynihan de New Y ork et Richard Leahy du Vermont –, ils m’ invitèrent à déjeuner au Capitole et, à ma grande stupéfaction, apportèrent un grand nombre d’ exemplaires de mon livre pour que je les dédicace. Après le déjeuner, nous avons donné une conférence de presse. Moynihan et les autres s’ exprimèrent avec passion en ma faveur. Ce fut pour moi un moment crucial. Il devenait désormais possible d’ approcher les parlementaires et les gouvernements de toute l’Europe et des Amériques. Je fus même invité à la Chambre des communes bri- tannique devant une délégation de tous les partis, après quoi le Parlement iranien exigea sur-le- champ l’ exécution de la fatwa. (Je dois mentionner ici que la publication en poche des Versets sataniques s’ est déroulée sans incident, en dépit de nombreuses appréhensions et de quelques lâchages. Je me suis souvenu, et je me rappelle souvent, le fameux mot de Roosevelt selon lequel c’ est de la peur qu’ il faut avoir le plus peur.)* * *En été 1992, il me fut possible d’ aller au Danemark. Une fois encore, le dispositif de sécurité était très lourd. Il y avait même une petite canonnière dans le port de Copenhague, dont on me dit qu’elle était «des nôtres». Cela provoqua force blagues sur la nécessité de pré- venir une attaque de la flotte iranienne dans la Baltique, voire d’ hommes-grenouilles fonda- mentalistes.Durant mon séjour au Danemark, le gouvernement se tint à distance (du moins, en rendant ma visite possible et en assurant ma protection, avait-il clairement manifesté son soutien). La menace planant sur l’ exportation du fromage danois vers l’ Iran fut citée comme l’ une des raisons de cette réserve. Quoi qu’ il en soit, j’ obtins le soutien enthousiaste de politiciens de tous les autres partis, spécialement d’ Anker Jørgenson, l’ancien et probablement futur Premier Ministre travailliste, avec qui je donnai une conférence de presse commune à bord d’un bateau. Jørgenson promit d’ entamer des discussions avec le parti au pouvoir afin de développer une politique concertée en ma faveur. C’était moins que je n’ espérais, mais c’ était une étape.Je fis un bref voyage en Espagne. (Je m’ étends sur les immenses difficultés d’organisation, mais croyez-moi, aucun de ces voyages ne fut aisé.) Là-bas, une offre de médiation me fut faite par Gustavo Villapalos, le recteur de l’université de Madrid, un homme très proche du gouvernement espagnol mais aussi très bien introduit en Iran. Il me rapporta bientôt qu’il avait reçu des signes encourageants de la part de personnalités haut placées dans le régime iranien: c’était un excellent moment pour résoudre l’affaire, lui avait- on dit. L ’ Iran savait que cette histoire était le principal obstacle à sa stratégie économique. Toutes sortes de personnes honorables laissaient entendre qu’elles voulaient une solution: les noms de la veuve de Khomeiny et de son frère aîné furent mentionnés.Quelques semaines plus tard, toutefois, des journaux européens affirmèrent, citant Villapalos, que j’étais disposé à réécrire certaines parties des Versets sataniques. Je n’avais rien dit de tel. Villapalos m’affirma qu’il avait été mal compris et me demanda un rendez-vous à Londres. J’y consentis. Depuis, je n’ai plus entendu parler de lui.La brèche se produisit l’été suivant, en Norvège. Mes hôtes furent le P .E.N.-club et mes courageux éditeurs Aschehoug. Une fois encore, les media et les gens du pays me témoignèrent une grande chaleur et un fantastique soutien. Et cette fois, j’obtins des rendez-vous avec les ministres de la Culture et de l’ Education, et le Premier ministre en personne, Mme Gro Harlem Brundtland, m’adressa un message d’amitié. Au moment du départ, j’ arrachai de fermes promesses de soutien gouvernemental auprès des Nations unies et d’ autres forums internationaux, aussi bien que dans des contacts bilatéraux entre la Norvège et l’ Iran.Les pays nordiques, traditionnellement préoccupés par les droits de l’homme, commençaient à réagir. En octobre, je fus invité à prononcer une conférence au Conseil nordique à Helsinki: un grand honneur, et une opportunité de promouvoir une initiative nordique commune. De fait, le Conseil nordique adopta une ferme résolution de soutien, et beaucoup de délégués à la conférence s’ engagèrent à porter l’affaire devant leurs parlements et gouvernements respectifs.Il y eut une fausse note. L’ambassadeur britannique, convié par le Conseil nordique, refusa de se rendre à la séance au cours de laquelle je devais m’exprimer. Les organisateurs me firent savoir qu’ ils avaient été choqués par la rudesse de son refus.A mon retour, j’appelai mon contact au Foreign Office, qui m’ avait toujours assuré que mes voyages se déroulaient avec la «bénédiction» du gouvernement. Selon lui le ministère serait reconnaissant de tout ce que j’entreprendrais afin de raminer l’intérêt pour cette affaire. Je lui demandai comment diable je pouvais attendre des autres pays qu’ils croient que les Britanniques étaient derrière moi, quand mon propre ambassadeur ne l’était pas. Après Helsinki, les ambassadeurs britanniques m’ont magnifiquement soutenu partout où je suis allé.A vrai dire, la position globale du gouvernement britannique à ce propos est plus résolue que jamais. Il y eut un moment affolant pendant la campagne électorale, lorsque je fus soudaine- ment informé par le commissaire principal (visiblement embarrassé) que ma protection allait cesser rapidement, bien qu’ il n’ y ait aucune raison de croire que ma situation soit plus sûre.«Beaucoup de gens risquent leur vie en Grande-Bretagne, me dit- il, et quelques-uns meurent, vous savez.» Cependant, après que l’association Article 19 eut discuté avec le 10, Downing Street [l’adresse du Premier ministre, ndlr], cette politique s’inversa, et mon comité de défense reçut une lettre du cabinet du Premier ministre, assurant sans la moindre équivoque que la protection durerait aussi longtemps que la menace.La position vis-à-vis de l’Iran s’est également raffermie. Le régime iranien a été informé qu’il n’y aurait aucune normalisation des relations tant que la fatwa ne serait pas levée. La balle est formellement dans le camp du gouvernement de Rafsandjani.Je suis – je le répète – très reconnaissant à la fois de la protection et de la fermeté du gouvernement. Mais je sais aussi qu’ une pression plus puissante sera nécessaire pour forcer l’ Iran à changer de politique, et le but de mes voyages à l’étranger a été de donner de l’impulsion à ce mouvement.Le 25 octobre, je me suis rendu dans la capitale allemande, Bonn. L ’ Allemagne est le partenaire commercial numéro un de l’Iran. Je croyais que je n’arriverais à rien. Ce qui se produisit en Allemagne prit, par conséquent, des allures de petit miracle.Ma visite fut arrangée par un petit miracle de femme, une députée du SPD, nommée Thea Bock. Son anglais était aussi rudimentaire que mon allemand, et bien que nous ayons souventcommuniqué par signes, nous nous sommes sacrément bien entendus. Au prix de cajoleries, de bras-de-fer et de ruse, et avec l’ aide d’ autres députés, notamment Norbert Gansel, elle parvint à m’ arranger des rendez- vous avec la plupart des notabilités de l’ Etat allemand: la très puissante et populaire porte- parole du Bundestag, Rita Süssmuth; des officiels de haut rang au ministère des Affaires étrangères; des membres influents du comité des Affaires étrangères; et enfin le chef du SPD lui-même, Bjorn Engholm, qui me stupéfia en posant à mes côtés pour la télévision et en m’ appelant son «frère d’ esprit». Il engagea le soutien total du SPD à ma cause, et n’a cessé depuis lors d’ y travailler sans relâche.Aux plus hauts niveaux de l’Etat, on m’ a promis le soutien de l’ Allemagne. Depuis lors, ce soutien s’ est concrétisé. «Nous protégerons Monsieur Rushdie», a annoncé le gouvernement allemand. Le Bundestag a voté une résolution de tous les partis déclarant que l’ Allemagne tiendrait l’ Iran pour légalement responsable de ma sécurité, et qu’il en subirait des conséquences économiques et politiques s’ il m’arrivait quoi que ce fût. (Les parlements canadien et suédois envisagent des résolutions similaires.) De plus, l’ énorme accord culturel germano-iranien a été mis en veilleuse. Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Klaus Kinkel, a dit qu’on ne le rétablirait pas avant l’ annulation de la fatwa.La détermination allemande à actionner des leviers tant économiques que culturels en ma faveur, poussa l’Iran à réaffirmer la fatwa et à renouveler les offres de prime. C’était un geste stupide qui n’a fait que raffermir la résolution d’ un nombre croissant de gouvernements acquis à ma cause.Après l’ Allemagne, vint le tour de la Suède. Le gouvernement et le P .E.N.-club suédois me décernèrent conjointement le prestigieux prix Kurt Tucholsky, traditionnellement attribué à des écrivains victimes d’atteintes aux droits de l’homme. Le Premier ministre suédois Bengt Westerberg me remit le prix et fit une déclaration passionnée à la presse, promettant le soutien complet et vigoureux du gouvernement. La pierre avait commencé à rouler.Le leader du parti travailliste suédois, Ingvar Carlsson, eut un long entretien avec moi, au cours duquel il me promit de travailler à ma cause avec d’ autres partis socialistes européens. Je sais que lui et Bjorn Engholm ont pris l’affaire en mains avec le parti travailliste britannique, qu’ils pressent d’ agir davantage. Au moment où j’écris ces lignes, ni moi ni l’association Article 19 n’ avons été contactés par la direction du parti travailliste pour qu’ elle nous communique sa position et ses intentions. J’invite John Smith ou Jack Cunningham à rectifier cela aussi vite que possible.* * *Un diplomate, spécialiste des affaires du Moyen-Orient, m’a dit: «Le secret de la diplomatie est d’être à la gare quand le train arrive. Si vous n’y êtes pas, ne vous plaignez pas de manquer le train. Le problème est qu’il peut arriver dans plusieurs gares, assurez-vous par conséquent d’être dans chacune d’elles.»En novembre, le chef de la justice iranienne, Morteza Moqtadaei, déclara que tous les musulmans étaient obligés de me tuer, contredisant ainsi les déclarations de l’ Iran selon lesquelles la fatwa n’ aurait rien à voir avec le gouvernement iranien. L’ayatollah Sanei, l’ initiateur de la mise à prix, affirma que des commandos volontaires étaient sur le point d’ être dépêchés.Ensuite, au début décembre, je traversai à nouveau l’Atlantique: à destination du Canada, au titre d’ invité du P .E.N.-club. (Quel écrivain fut mieux soute- nu par ses pairs ? Si jamais je m’en sors, je passerai ma vie à essayer de rendre un peu de l’aide, de la passion et de l’affection qu’on m’a témoignées.) Au cours d’une soirée donnée au bénéfice du P .E.N.-club à Toronto, les écrivains intervinrent en si grand nombre que quelqu’un me glissa, «C’est pour vous une sacrée barmistvah !»; et cela l’était. Le Premier ministre de l’ Ontario, Bob Rae, bondit sur l’ estrade et m’ étreignit. Il devint ainsi le premier chef de gouvernement à s’ afficher avec moi en public.Le lendemain, à Ottawa, je rencontrai, entre autres, le ministre canadien des Affaires étrangères, Barbara Macdougall, et le leader de l’opposition, Jean Chrétien. Je témoignai également devant la sous-commission parlementaire des droits de l’homme. L’effet de tout cela était électrisant. En quarante- huit heures, des résolutions exigeant que le gouvernement du Canada soulève la question aux Nations unies et ailleurs, comme à la Cour internationale de justice, avaient été adoptées par le Parlement canadien avec l’accord de tous les partis, et le gouvernement accepta de s’y conformer.Un autre train dans une autre gare. Depuis lors, j’ai eu une série d’entretiens amicaux à Dublin avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, Dick Spring, et deux autres membres du cabinet; et, à son invitation, avec la présidente Mary Robinson, à Phœnix Park. Prochaine étape, peut-être, le président Clinton.* * *J’ ai toujours su que ce serait un long combat; mais au moins, à présent, il y a comme un réel mouvement. En Norvège, un ancien accord projeté avec l’Iran a été bloqué par des politiciens sympathisants de la campagne contre la fatwa; au Canada, une ligne de crédit d’ un milliard de dollars qui avait été promise à l’ Iran a aussi été bloquée. En coulisses, il y a davantage d’ activités qu’ il faudra révéler en temps utile.Je sais aussi – et je le dis partout où je vais – que ce combat ne me concerne pas seul. Mon cas personnel n’ est même pas prioritaire. Les grands enjeux en sont la liberté d’ expression et la souveraineté nationale. En outre, le cas des Versets sataniques n’ est que le plus connu des cas d’écrivains et d’intellectuels progressistes et dissidents qui sont harcelés, emprisonnés, bannis et assassinés à travers le monde musulman. Des artistes et des intellectuels d’Iran le savent, et c’est pourquoi ils m’ ont si courageusement et si continuellement affirmé leur soutien sans réserve. Des intellectuels, à travers le monde musulman – le poète Adonis, le romancier Tahar Ben Jelloun, et bien d’autres – ont appelé à faire cesser les menaces de l’ Iran, non seulement par souci de ma per- sonne, mais parce qu’ ils savent que ce combat est aussi le leur. Gagner ce combat, c’ est gagner une escarmouche dans une guerre beaucoup plus grande. Le perdre aurait des conséquences fâcheuses pour moi; mais ce serait également une défaite dans ce plus large conflit.Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. C’est pourquoi nous devons gagner. C’est aussi simple que cela.On ne tue pas des gens pour avoir écrit des livres. C’est clair. Au moment où j’achève ce texte, j’apprends que Yasser Arafat a dénoncé la fatwa comme étant contraire à l’Islam, tandis qu’ici, en Grande- Bretagne, même l’infâme démagogue, le Dr Kalim Siddiqui (représentant la ligne la plus dure des musulmans britanniques), croit «l’heure venue pour les deux parties de pardonner et d’oublier». Après quatre ans d’ intimidation et de violence, il y a certainement beaucoup à pardonner. Au demeurant, j’accueille même cet improbable rameau d’olivier.Quoi qu’il en soit, la crise ne sera pas terminée tant que les menaces du terrorisme international sponsorisé par un Etat ne seront pas formellement et sans la moindre équivoque rétractées. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’ est que le gouvernement britannique tire parti de la bonne volonté internationale émanant de tant de gens travaillant pour moi et à ma cause dans une douzaine de pays, et se place lui- même en première ligne des efforts de la communauté internationale pour que cesse ce scandale.Je remercie le gouvernement britannique de tout ce qu’il a fait pour moi. Mais je dois lui demander de faire plus maintenant; et plus énergiquement, de telle façon qu’ avec un peu de chance, et avant longtemps, il en ait bientôt moins à faire.S. R.© Salman Rushdie© pour cette traduction française Jacques-Michel Pittier & René Zahnd avec le concours de Jean-Louis Kuffer Le Passe-Muraille, Lausanne, 1993.
Le récit inédit de Salman Rushdie, en février 1993. Une publication exclusive du Passe-Muraille solidaire...Quatre ans. Quatre ans ont passé et je suis toujours là. Etrange comme cela ressemble simultanément à une victoire et à une défaite.Pourquoi une victoire ?Lorsque, le 14 février 1989, j’ai entendu les nouvelles provenant de Téhéran, ma réaction instantanée fut: je suis un homme mort. Je me souvins alors du poème de mon ami, l’écrivain américain Raymond Carver, à qui son docteur venait d’apprendre qu’il avait un cancer du poumon:«Il dit êtes-vous un homme religieux, vous agenouillez- vous dans les forêts et demandez- vous de l’aide...J’ai dit pas encore mais j’ai l’intention de commencer aujourd’hui»Mais je ne suis pas un homme religieux, je ne me suis pas mis à genoux. Je suis allé à une interview télévisée et j’y ai dit que j’aurais souhaité avoir écrit un livre encore plus critique. Pourquoi ai-je dit cela ? Parce que lorsque le leader d’un Etat terroriste annonce son intention de vous assassiner au nom de Dieu, vous pouvez soit tempêter, soit bredouiller. Je ne voulais pas bredouiller.Ensuite je me suis dit: si Dieu existe, je ne pense pas qu’il soit très tourmenté par Les Versets sataniques, parce que cela ne ressemble pas beaucoup à un dieu d’être ébranlé sur son trône par un livre. D’autre part, si Dieu n’existe pas, il n’est pas tourmenté du tout. Donc la dispute n’a pas lieu entre moi et Dieu, mais entre moi et ceux qui pensent – comme Bob Dylan nous l’ a rappelé autrefois – qu’ ils peuvent faire n’ importe quoi sous prétexte qu’ ils ont Dieu avec eux.La police vint me voir et me dit: restez tranquille, n’ allez nulle part, on est en train de faire des plans. Cette nuit-là, des officiers de police en patrouille réduite veillèrent sur moi. Couché sans pouvoir trouver le sommeil, je guettais l’ange de la mort. Un de mes films favoris était, et reste, L’ Ange exterminateur de Luis Bunuel. Il montre des gens qui ne peuvent pas sortir d’une pièce.Le lendemain après-midi, tandis que la télévision grondait, pleine de haine et assoiffée de sang, la Special Branch m’offrit sa protection. Des officiers vinrent me dire que je devais aller quelque part pendant plusieurs jours, le temps que les politiques règlent cette affaire.Vous rappelez-vous ? Il y a quatre ans, nous pensions tous que la crise serait résolue en quelques jours. Qu’à la fin du XXe siècle un homme puisse être menacé de meurtre pour avoir écrit un livre... que le chef d’ un Etat clérico-fasciste puisse menacer le citoyen libre d’ un pays très éloigné du sien... c’ était trop fou. Cela allait cesser.La police le pensait. Vous le pensiez. Je le pensais aussi.Alors nous sommes partis, non pas dans quelque repaire protégé et secret, mais dans un hôtel des alentours. Il y avait, dans la chambre d’à côté, un reporter du Daily Mirror en compagnie d’une femme qui n’ était pas la sienne. Nos che- mins ne se sont pas croisés. Et cette nuit-là, alors que chaque journaliste de ce pays tentait de découvrir où j’étais allé, ce gentleman – comment dire – a raté un scoop.T out serait fini d’ ici quelques jours. Quatre ans après, cela continue. Et on me dit que le «degré de menace contre ma vie» n’a pas diminué du tout. On me dit aussi qu’il n’y a personne sous la protection de la Special Branch dont l’existence soit plus en danger que la mienne.Une victoire et une défaite: une victoire parce que je suis vivant, en dépit d’avoir été décrit par un «ami» comme un mort en sursis. Une défaite, parce que je suis toujours dans cette prison.«Les murs de pierre ne font pas une prison, ni les barreaux d’acier une cage.»Cette prison va où je vais. Elle n’a pas de murs, pas de toit, pas de menottes, mais en quatre ans je n’en ai pas trouvé la sortie.Quand il devint évident que le problème prendrait plus de temps à résoudre que nous l’avions d’abord pensé, je plongeai plus profondément dans ce monde clandestin que j’ habite maintenant, et que par nécessité je ne peux décrire.J’étais sous pression politique. Je ne pense pas qu’on mesure le poids de cette pression. Le sort des otages britanniques restait en suspens. On me demanda de faire des excuses publiques: sinon, quelque chose aurait pu arriver à un otage britannique et cela, sous-entendu, aurait été ma faute.La déclaration que j’acceptai de faire ne fut pas écrite par moi, mais par le regretté John Lyttle, chargé par l’archevêque de Canterbury du cas des otages, ainsi que par d’autres notables et éminences. Je changeai deux mots, et je dus lutter même pour cette retouche. Cette déclaration ne fit de bien à personne. Elle aurait dû aider les otages; son échec fut interprété comme mon premier échec à sauver ma pauvre tête. Khomeiny réitéra sa fatwa. On offrit plusieurs mil- lions de dollars de prime.Désormais, on faisait officiellement pression pour que je dis- paraisse. L’argument était que j’avais déjà causé assez d’ennuis. Je ne devais plus parler publiquement de mon sort, ni me défendre moi-même. Il y avait déjà un assez gros problème d’ordre public, et du moment que les autorités faisaient tant pour me protéger, je ne devais pas leur rendre la vie plus difficile. N’ allez nulle part, ne voyez personne, ne dites rien. Soyez une non-personne et soyez content d’être vivant. Ecoutez les vilenies, les calomnies, les discours meurtriers, les appels au calme, et fermez-la.«Les murs de pierre ne font pas une prison...»Durant presque un an et demi, je n’ eus de contact avec aucun membre du gouverne- ment britannique, pas plus qu’ avec les fonctionnaires du ministère de l’ Intérieur ou du Foreign Office. J’ étais dans les limbes. On m’informa que le ministère de l’Intérieur avait opposé son veto à toute rencontre avec moi parce que cela, prétendait-on, pouvait détériorer les relations entre communautés ethniques. A la fin, je téléphonai à William Waldegrave, alors au Foreign Office, et lui demandai s'il ne serait pas bon que nous nous rencontrions.Il n’était pas habilité – autorisé, je pense – à me rencontrer. Mais j’obtins finalement une entrevue avec un diplomate du Foreign Office, et une autre avec Douglas Hurd lui-même. Ces rencontres eurent lieu à la condition de rester entièrement secrètes, «pour que les otages n’aient pas à en souffrir».Soit dit en passant, je ne me rappelle pas que Téhéran ou que les preneurs d’otages du Liban aient jamais fait le lien. Mais je me trompe peut-être. Si je révèle ces détails aujourd’hui, c’est parce qu’il n’ y a plus de risque à le faire. Jusqu’au jour où Terry Waite a été relâché, je fus en quelque sorte l’otage des otages. J’avais accepté que leur cas soit résolu d’ abord et que, dans une certaine mesure, mes droits soient mis de côté pour favoriser les leurs.J’espérais seulement qu’une fois les otages libérés, mon tour viendrait; que le gouvernement britannique et la communauté internationale chercheraient une solution à cette crise aussi. L’attente fut longue, pleine de moments bizarres.Un film pakistanais, me dépeignant comme un tortionnaire, un meurtrier et un ivrogne portant une variété effrayante de costumes safari multicolores, n’obtint pas son visa en Grande- Bretagne. Je vis une cassette vidéo du film; c’ était horrible. Cela se finissait sur mon «exécution» par le pouvoir de Dieu. L’horreur de ces images me poursuivit longtemps.J’ écrivis à la commission de contrôle britannique, en leur promettant de ne rien faire contre eux ni contre le film, et en leur demandant de l’autoriser. Je leur disais que je ne voulais pas de la protection douteuse de la censure. Le film fut autorisé et disparut promptement des écrans. Une tentative de le montrer à Bradford se solda par des rangées vides. C’ était une par- faite illustration de la justesse de la liberté d’ expression: les gens sont réellement capables de se forger leur propre opinion. Tout de même, c’ était curieux d’ être satisfait de la sortie d’ un film dont le sujet était ma mort.Parfois je séjournais dans de confortables maisons. Parfois je n’avais rien de plus qu’une petite chambre dont je ne pouvais approcher la fenêtre de crainte d’être aperçu. Parfois on me per- mettait de sortir un peu. A d’autres moments, il m’était difficile de le faire. J’ ai essayé d’aller aux Etats-Unis et en France, mais les gouvernements de ces pays ont rendu ma visite impossible.Une fois je dus me rendre à l’ hôpital pour me faire arracher les dents de sagesse. J’ ai appris plus tard que la police avait fait des plans catastrophe pour «m’arracher» moi. Je devais être anesthésié et transporté dans un sac mortuaire à l’ intérieur d’ un corbillard.Je nouai des relations amicales avec les équipes chargées de ma protection et j’ en appris beaucoup sur les fonctionnements de la Special Branch. J’appris à repérer si l’on est suivi sur l’autoroute; je m’accoutumai au matériel qui traînait sans cesse alentour; j’appris l’argot des forces de police – les chauffeurs, par exemple, sont connus comme les OFD, abréviation de Only Fucking Drivers. Les policiers de l’autoroute sont les «Rats noirs». Mon propre nom n’était jamais utilisé. J’ appris à répondre à d’ autres noms, j’étais «le Principal».Je me suis familiarisé avec beaucoup de choses qui m’étaient totalement étrangères il y a quatre ans, mais je ne m’y suis jamais habitué. Je savais dès le début que l’accoutumance serait une reddition. Ce qui est arrivé à ma vie est une chose grotesque. C’ est un crime. Je n’ accepterai jamais que cela devienne ma condition normale.«Qu’est-ce qui est blonde, a de gros seins et vit en Tasmanie ?»«Salman Rushdie.» J’ ai reçu des lettres, j’en reçois encore, disant: laissez tomber, changez de nom, faites-vous opérer, démarrez une nouvelle vie. C’est une éventualité que je n’ai jamais envisagée. Ce serait pire que la mort. Je ne veux pas de la vie d’une autre personne. Je veux la mienne.Mes gardes du corps ont fait preuve envers moi d’ une grande compréhension et m’ ont aidé à traverser les pires moments. Je leur en serai toujours reconnais- sant. Ce sont des hommes coura- geux. Ils exposent leur vie pour me protéger. Jamais personne auparavant n’a fait cela pour moi.Une chose est à souligner: puisque je n’ai pas été tué, beau- coup de gens doivent penser que personne n’ essaie de le faire. Ils croient probablement que tout cela est un peu théorique. Ce n’est pas le cas.Dans les premiers mois, un terroriste arabe se fit sauter dans un hôtel de Paddington. Par la suite, un journaliste qui avait visité les camps du Hezbollah, dans la vallée de la Bekaa au Liban, m’apprit qu’il avait vu la photographie de cet homme sur un «mur des martyrs» dans un bureau, avec une légende disant que j’étais sa cible. Pendant la guerre du Golfe, j’ entendis dire que le gouvernement iranien avait payé pour qu’ on m’ assassine. Après des mois d’extrême précaution, on m’a annoncé que les tueurs avaient été «frustrés» – pour utiliser le langage par euphémismes des services secrets. J’ai préféré ne pas m’ enquérir des raisons de leur frustration.En 1992, trois Iraniens furent expulsés de Grande-Bretagne. Deux d’ entre eux travaillaient à la mission iranienne de Londres, le troisième était «étudiant». Le Foreign Office me dit que c’étaient des espions et que leur présence en Grande-Bretagne était indubitablement liée à l’ accomplissement de la fatwa. Le traducteur italien des Versets sataniques a failli être tué et le traducteur japonais l’a été. En 1992, la police japonaise a annoncé les résultats de douze mois d’ enquête. Selon eux, les assassins étaient des terroristes professionnels du Moyen-Orient ayant transité par la Chine.Dans le même temps, un commando iranien assassina l’ancien Premier ministre Bakhtiar à Paris. On l’égorgea. Un autre commando tua un chanteur iranien dissident en Allemagne. Ils le dépecèrent et en jetèrent les morceaux dans un sac. Rien de très théorique à cela.L’Angleterre est un petit pays, très peuplé, et beaucoup de gens sont curieux. Il n’est guère facile d’ y disparaître. Une fois j’ étais dans un immeuble que je devais quitter, mais une conduite de chauffage central venait d’exploser juste dans l’ entrée et un plombier était là. Un officier de police eut à dis- traire son attention pour que je puisse m’éclipser.Moins une.Une autre fois j’étais dans une cuisine lorsqu’un voisin surgit à l’improviste. Je dus plonger derrière un meuble et rester là, accroupi, jusqu’à ce qu’il parte.Moins une.Une autre fois je fus pris dans un embouteillage devant la mosquée de Regent’s Park, juste au moment où les fidèles sortaient de la prière de l’ Aïd. J’étais assis à l’arrière d’une Jaguar blindée, le nez enfoui dans le Daily Telegraph. Mes gardes du corps dirent en plaisantant que c’était la première fois qu’ils me voyaient aussi intéressé par le Telegraph.Vivre ainsi c’est éprouver une dégradation quotidienne, c’est sentir peu à peu l’ humiliation vous tordre le cœur. Vivre ainsi, c’est permettre à des gens – y compris votre femme – de vous traiter de couard à la une des journaux. Cette sorte de gens ferait sans doute de beaux éloges à mes funérailles. Mais vivre, éviter les tueurs, est une plus grande victoire que d’ être assassiné. Seuls les fanatiques recherchent le martyre.J’ai quarante-cinq ans et je ne peux pas quitter mes lieux de résidence sans permission. Je ne possède pas les clés de l’ entrée principale. Quelquefois il y a des «mauvaises passes». Pendant une de ces «mauvaises passes» – je ne peux pas expliquer de quoi il s’ agissait –, j’ ai dormi en vingt nuits dans treize lits différents. En de telles circonstances, une grande et sauva- ge cacophonie envahit votre corps. En de telles circonstances, vous commencez à être coupé de vous-même.J’ai appris à accepter. Accepter la colère et l’amertume. Cela recommencera, je le sais. Quand les choses iront mieux, il faudra régler le problème. En ce moment, ma victoire réside dans le fait de ne pas m’être laissé briser, de ne pas m’ être perdu moi-même. Elle réside dans le fait de continuer à travailler. Il n’y a plus d’otages. Pour la première fois depuis des années, je peux défendre ma cause sans être accusé de porter préjudice aux intérêts d’ autrui. J’ ai combattu du mieux que je pouvais.* * *Comme chacun, je me suis réjoui de la fin de la terrible épreuve des otages du Liban. Mais les personnes les plus actives dans la campagne pour ma défense, Frances d’Souza et Carmel Bedford de l’ association Article 19, savaient que l’ immense soulagement ressenti par tous à la fin de cet horrible chapitre était aussi un danger. Peut-être que les gens ne voudraient plus prêter attention à quelqu’ un disant: excusez-moi, il y a tout de même encore un problème. Peut-être que je serais considéré comme une sorte de cause perdue. D’ un autre côté, selon des rumeurs persistantes, le gouvernement britannique était sur le point de normaliser ses relations avec l’Iran et d’oublier entièrement le «cas Rushdie». Que faire ? Se taire et compter sur la «diplomatie silencieuse» ou parler haut et fort ?De mon point de vue, il n’y avait pas de choix. La libération des otages m’avait enfin délié la langue. Il eût été absurde de combattre pour la liberté de parole en demeurant silencieux. Nous avons décidé de mener une campagne aussi bruyante que possible, pour persuader le gouvernement britannique qu’ il ne pouvait se permettre d’ignorer le cas, et pour ranimer le sou- tien international, de façon à démontrer à l’Etatterreur iranien que la fatwa nuisait à ses propres intérêts autant qu’ aux miens.En décembre 1991, quelques jours après la libération du der- nier otage américain, Terry Anderson, on me permit finalement d’entrer aux Etats-Unis pour prendre la parole à l’ occasion de la célébration, par l’ uni- versité de Columbia, du 200e anniversaire de la Déclaration des Droits. Les préparatifs du voyage furent un cauchemar. Vingt-quatre heures avant de partir je ne savais pas si j’aurais l’autorisation. J’étais censé voyager dans un avion militaire, une grande faveur dont j’ étais très reconnaissant. (Cela devait rester entièrement secret, sauf qu’un tabloïd anglais trouva bon de publier l’ information et de m’ accuser de mettre en danger la Royal Air Force !)Le moment du départ fut bouleversant. C’était la première fois que je quittais la Grande- Bretagne depuis presque trois ans. Pour un instant, la cage me sembla un peu plus grande. A New York, un cortège d’auto- mobiles vint me chercher, renforcé par des motards. On m’ installa dans une limousine blanche et on fonça dans Manhattan à toute allure. «C’est ce que nous ferions avec Arafat», expliqua le chef des opérations. Je m’enquis timidement: «Et pour le Président ?» Pour le Président, ils fermeraient davantage de rues latérales. «Mais dans votre cas, nous avons pensé que ce serait un peu trop voyant.» Cela sans la moindre ironie. Le Département de Police de New York est très consciencieux mais il plaisante peu.Je passai la journée dans une suite au quatorzième étage, avec au moins vingt hommes armés. Les fenêtres étaient obstruées par des matelas à l’ épreuve des balles. Devant la porte il y avait plein d’autres hommes armés avec des muscles et une artillerie à la Schwarzenegger. Dans cette suite j’eus une série d’ entrevues qui doivent rester secrètes, à l’ exception peut-être de l’ une d’ elles. Je pus rencontrer le poète Allen Ginsberg durant vingt minutes. Dès son arrivée, il retira les coussins du sofa et les disposa sur le sol. «Enlevez vos chaussures et asseyez-vous par terre, dit-il. Je vais vous apprendre quelques exercices simples de méditation. Ils devraient vous aider à vivre votre terrible situation.» Notre agent littéraire commun, Andrew Wylie, était présent et je l’invitai à faire de même, ce qu’il fit, maugréant quelque peu. Pendant que nous faisions notre respiration et nos psalmodies, je pensais combien il était extraordinaire pour un Indien de naissance d’ être initié au bouddhisme par un poète américain assis en tailleur, dans une pièce pleine d’hommes armés jusqu’aux dents. La vie est unique; ça ne s’invente pas.Cette nuit-là, l’énorme cortège m’ amena à Columbia et je pus faire ma conférence. Je me souviens d’avoir dit que la liberté d’ expression est la vie elle- même. Le lendemain, la presse américaine fut très sympathique et positive. Il était clair que les Américains voyaient la situation comme moi: une vieille liberté fondamentale était devenue une question de vie ou de mort. De retour chez moi, ce fut une autre affaire. Je rentrais en Angleterre pour être confronté à des titres comme «RUSHDIE ENFLAMME À NOUVEAU LA COLERE DES MUSULMANS» (parce que j’avais demandé la publication en édition de poche des Versets sataniques).L ’ année suivante, tandis que je visitais de plus en plus de pays, cette dichotomie devint encore plus évidente. Dans le reste du monde libre, le «cas Rushdie» concerne la liberté d’expression et le terrorisme d’Etat. En Grande-Bretagne, cela semble être l’ histoire d’ un homme que l’ on doit protéger des conséquences de ses propres actes. Partout ailleurs, les gens savent que l’ outrage n’ a pas été commis par moi, mais contre moi. Dans certaines parties de mon propre pays, on se figure le contraire.Savoir cela, c’est transporter, où que j’ aille, une blessure qui ne cicatrise pas. Elle m’ ôte mes forces. Je ne sais pas si qui- conque s’en soucie, mais c’est le cas.* * *L’édition de poche des Versets sataniques fut publiée au printemps 1992, non par Penguin, qui refusa de le faire, mais par un consortium. Je pus aller à Washington pour son lancement et, au cours d’ une nouvelle conférence sur la liberté d’expression, j’en exhibai le premier exemplaire. Et soudain l’émotion me submergea. Tout ce que je pus faire fut de retenir mes larmes.J’étais surtout venu à Washington pour m’ adresser à des membres des deux chambres du Congrès. Le soir de la réunion, on m’ informa que le Secrétaire d’ Etat James Baker avait téléphoné personnellement aux présidents des deux chambres pour leur dire qu’il ne souhaitait pas que cette rencontre ait lieu. L ’ administration Bush fit des remarques déplacées sur ma présence. Marlin Fitzwater justifia ainsi le refus de l’ Administration de me voir: «C’est juste un auteur en tournée de promotion.»En dépit des «performances» de l’ équipe Bush, je parvins à voir un groupe, de sénateurs distingués – conduit par Daniel Patrick Moynihan de New Y ork et Richard Leahy du Vermont –, ils m’ invitèrent à déjeuner au Capitole et, à ma grande stupéfaction, apportèrent un grand nombre d’ exemplaires de mon livre pour que je les dédicace. Après le déjeuner, nous avons donné une conférence de presse. Moynihan et les autres s’ exprimèrent avec passion en ma faveur. Ce fut pour moi un moment crucial. Il devenait désormais possible d’ approcher les parlementaires et les gouvernements de toute l’Europe et des Amériques. Je fus même invité à la Chambre des communes bri- tannique devant une délégation de tous les partis, après quoi le Parlement iranien exigea sur-le- champ l’ exécution de la fatwa. (Je dois mentionner ici que la publication en poche des Versets sataniques s’ est déroulée sans incident, en dépit de nombreuses appréhensions et de quelques lâchages. Je me suis souvenu, et je me rappelle souvent, le fameux mot de Roosevelt selon lequel c’ est de la peur qu’ il faut avoir le plus peur.)* * *En été 1992, il me fut possible d’ aller au Danemark. Une fois encore, le dispositif de sécurité était très lourd. Il y avait même une petite canonnière dans le port de Copenhague, dont on me dit qu’elle était «des nôtres». Cela provoqua force blagues sur la nécessité de pré- venir une attaque de la flotte iranienne dans la Baltique, voire d’ hommes-grenouilles fonda- mentalistes.Durant mon séjour au Danemark, le gouvernement se tint à distance (du moins, en rendant ma visite possible et en assurant ma protection, avait-il clairement manifesté son soutien). La menace planant sur l’ exportation du fromage danois vers l’ Iran fut citée comme l’ une des raisons de cette réserve. Quoi qu’ il en soit, j’ obtins le soutien enthousiaste de politiciens de tous les autres partis, spécialement d’ Anker Jørgenson, l’ancien et probablement futur Premier Ministre travailliste, avec qui je donnai une conférence de presse commune à bord d’un bateau. Jørgenson promit d’ entamer des discussions avec le parti au pouvoir afin de développer une politique concertée en ma faveur. C’était moins que je n’ espérais, mais c’ était une étape.Je fis un bref voyage en Espagne. (Je m’ étends sur les immenses difficultés d’organisation, mais croyez-moi, aucun de ces voyages ne fut aisé.) Là-bas, une offre de médiation me fut faite par Gustavo Villapalos, le recteur de l’université de Madrid, un homme très proche du gouvernement espagnol mais aussi très bien introduit en Iran. Il me rapporta bientôt qu’il avait reçu des signes encourageants de la part de personnalités haut placées dans le régime iranien: c’était un excellent moment pour résoudre l’affaire, lui avait- on dit. L ’ Iran savait que cette histoire était le principal obstacle à sa stratégie économique. Toutes sortes de personnes honorables laissaient entendre qu’elles voulaient une solution: les noms de la veuve de Khomeiny et de son frère aîné furent mentionnés.Quelques semaines plus tard, toutefois, des journaux européens affirmèrent, citant Villapalos, que j’étais disposé à réécrire certaines parties des Versets sataniques. Je n’avais rien dit de tel. Villapalos m’affirma qu’il avait été mal compris et me demanda un rendez-vous à Londres. J’y consentis. Depuis, je n’ai plus entendu parler de lui.La brèche se produisit l’été suivant, en Norvège. Mes hôtes furent le P .E.N.-club et mes courageux éditeurs Aschehoug. Une fois encore, les media et les gens du pays me témoignèrent une grande chaleur et un fantastique soutien. Et cette fois, j’obtins des rendez-vous avec les ministres de la Culture et de l’ Education, et le Premier ministre en personne, Mme Gro Harlem Brundtland, m’adressa un message d’amitié. Au moment du départ, j’ arrachai de fermes promesses de soutien gouvernemental auprès des Nations unies et d’ autres forums internationaux, aussi bien que dans des contacts bilatéraux entre la Norvège et l’ Iran.Les pays nordiques, traditionnellement préoccupés par les droits de l’homme, commençaient à réagir. En octobre, je fus invité à prononcer une conférence au Conseil nordique à Helsinki: un grand honneur, et une opportunité de promouvoir une initiative nordique commune. De fait, le Conseil nordique adopta une ferme résolution de soutien, et beaucoup de délégués à la conférence s’ engagèrent à porter l’affaire devant leurs parlements et gouvernements respectifs.Il y eut une fausse note. L’ambassadeur britannique, convié par le Conseil nordique, refusa de se rendre à la séance au cours de laquelle je devais m’exprimer. Les organisateurs me firent savoir qu’ ils avaient été choqués par la rudesse de son refus.A mon retour, j’appelai mon contact au Foreign Office, qui m’ avait toujours assuré que mes voyages se déroulaient avec la «bénédiction» du gouvernement. Selon lui le ministère serait reconnaissant de tout ce que j’entreprendrais afin de raminer l’intérêt pour cette affaire. Je lui demandai comment diable je pouvais attendre des autres pays qu’ils croient que les Britanniques étaient derrière moi, quand mon propre ambassadeur ne l’était pas. Après Helsinki, les ambassadeurs britanniques m’ont magnifiquement soutenu partout où je suis allé.A vrai dire, la position globale du gouvernement britannique à ce propos est plus résolue que jamais. Il y eut un moment affolant pendant la campagne électorale, lorsque je fus soudaine- ment informé par le commissaire principal (visiblement embarrassé) que ma protection allait cesser rapidement, bien qu’ il n’ y ait aucune raison de croire que ma situation soit plus sûre.«Beaucoup de gens risquent leur vie en Grande-Bretagne, me dit- il, et quelques-uns meurent, vous savez.» Cependant, après que l’association Article 19 eut discuté avec le 10, Downing Street [l’adresse du Premier ministre, ndlr], cette politique s’inversa, et mon comité de défense reçut une lettre du cabinet du Premier ministre, assurant sans la moindre équivoque que la protection durerait aussi longtemps que la menace.La position vis-à-vis de l’Iran s’est également raffermie. Le régime iranien a été informé qu’il n’y aurait aucune normalisation des relations tant que la fatwa ne serait pas levée. La balle est formellement dans le camp du gouvernement de Rafsandjani.Je suis – je le répète – très reconnaissant à la fois de la protection et de la fermeté du gouvernement. Mais je sais aussi qu’ une pression plus puissante sera nécessaire pour forcer l’ Iran à changer de politique, et le but de mes voyages à l’étranger a été de donner de l’impulsion à ce mouvement.Le 25 octobre, je me suis rendu dans la capitale allemande, Bonn. L ’ Allemagne est le partenaire commercial numéro un de l’Iran. Je croyais que je n’arriverais à rien. Ce qui se produisit en Allemagne prit, par conséquent, des allures de petit miracle.Ma visite fut arrangée par un petit miracle de femme, une députée du SPD, nommée Thea Bock. Son anglais était aussi rudimentaire que mon allemand, et bien que nous ayons souventcommuniqué par signes, nous nous sommes sacrément bien entendus. Au prix de cajoleries, de bras-de-fer et de ruse, et avec l’ aide d’ autres députés, notamment Norbert Gansel, elle parvint à m’ arranger des rendez- vous avec la plupart des notabilités de l’ Etat allemand: la très puissante et populaire porte- parole du Bundestag, Rita Süssmuth; des officiels de haut rang au ministère des Affaires étrangères; des membres influents du comité des Affaires étrangères; et enfin le chef du SPD lui-même, Bjorn Engholm, qui me stupéfia en posant à mes côtés pour la télévision et en m’ appelant son «frère d’ esprit». Il engagea le soutien total du SPD à ma cause, et n’a cessé depuis lors d’ y travailler sans relâche.Aux plus hauts niveaux de l’Etat, on m’ a promis le soutien de l’ Allemagne. Depuis lors, ce soutien s’ est concrétisé. «Nous protégerons Monsieur Rushdie», a annoncé le gouvernement allemand. Le Bundestag a voté une résolution de tous les partis déclarant que l’ Allemagne tiendrait l’ Iran pour légalement responsable de ma sécurité, et qu’il en subirait des conséquences économiques et politiques s’ il m’arrivait quoi que ce fût. (Les parlements canadien et suédois envisagent des résolutions similaires.) De plus, l’ énorme accord culturel germano-iranien a été mis en veilleuse. Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Klaus Kinkel, a dit qu’on ne le rétablirait pas avant l’ annulation de la fatwa.La détermination allemande à actionner des leviers tant économiques que culturels en ma faveur, poussa l’Iran à réaffirmer la fatwa et à renouveler les offres de prime. C’était un geste stupide qui n’a fait que raffermir la résolution d’ un nombre croissant de gouvernements acquis à ma cause.Après l’ Allemagne, vint le tour de la Suède. Le gouvernement et le P .E.N.-club suédois me décernèrent conjointement le prestigieux prix Kurt Tucholsky, traditionnellement attribué à des écrivains victimes d’atteintes aux droits de l’homme. Le Premier ministre suédois Bengt Westerberg me remit le prix et fit une déclaration passionnée à la presse, promettant le soutien complet et vigoureux du gouvernement. La pierre avait commencé à rouler.Le leader du parti travailliste suédois, Ingvar Carlsson, eut un long entretien avec moi, au cours duquel il me promit de travailler à ma cause avec d’ autres partis socialistes européens. Je sais que lui et Bjorn Engholm ont pris l’affaire en mains avec le parti travailliste britannique, qu’ils pressent d’ agir davantage. Au moment où j’écris ces lignes, ni moi ni l’association Article 19 n’ avons été contactés par la direction du parti travailliste pour qu’ elle nous communique sa position et ses intentions. J’invite John Smith ou Jack Cunningham à rectifier cela aussi vite que possible.* * *Un diplomate, spécialiste des affaires du Moyen-Orient, m’a dit: «Le secret de la diplomatie est d’être à la gare quand le train arrive. Si vous n’y êtes pas, ne vous plaignez pas de manquer le train. Le problème est qu’il peut arriver dans plusieurs gares, assurez-vous par conséquent d’être dans chacune d’elles.»En novembre, le chef de la justice iranienne, Morteza Moqtadaei, déclara que tous les musulmans étaient obligés de me tuer, contredisant ainsi les déclarations de l’ Iran selon lesquelles la fatwa n’ aurait rien à voir avec le gouvernement iranien. L’ayatollah Sanei, l’ initiateur de la mise à prix, affirma que des commandos volontaires étaient sur le point d’ être dépêchés.Ensuite, au début décembre, je traversai à nouveau l’Atlantique: à destination du Canada, au titre d’ invité du P .E.N.-club. (Quel écrivain fut mieux soute- nu par ses pairs ? Si jamais je m’en sors, je passerai ma vie à essayer de rendre un peu de l’aide, de la passion et de l’affection qu’on m’a témoignées.) Au cours d’une soirée donnée au bénéfice du P .E.N.-club à Toronto, les écrivains intervinrent en si grand nombre que quelqu’un me glissa, «C’est pour vous une sacrée barmistvah !»; et cela l’était. Le Premier ministre de l’ Ontario, Bob Rae, bondit sur l’ estrade et m’ étreignit. Il devint ainsi le premier chef de gouvernement à s’ afficher avec moi en public.Le lendemain, à Ottawa, je rencontrai, entre autres, le ministre canadien des Affaires étrangères, Barbara Macdougall, et le leader de l’opposition, Jean Chrétien. Je témoignai également devant la sous-commission parlementaire des droits de l’homme. L’effet de tout cela était électrisant. En quarante- huit heures, des résolutions exigeant que le gouvernement du Canada soulève la question aux Nations unies et ailleurs, comme à la Cour internationale de justice, avaient été adoptées par le Parlement canadien avec l’accord de tous les partis, et le gouvernement accepta de s’y conformer.Un autre train dans une autre gare. Depuis lors, j’ai eu une série d’entretiens amicaux à Dublin avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, Dick Spring, et deux autres membres du cabinet; et, à son invitation, avec la présidente Mary Robinson, à Phœnix Park. Prochaine étape, peut-être, le président Clinton.* * *J’ ai toujours su que ce serait un long combat; mais au moins, à présent, il y a comme un réel mouvement. En Norvège, un ancien accord projeté avec l’Iran a été bloqué par des politiciens sympathisants de la campagne contre la fatwa; au Canada, une ligne de crédit d’ un milliard de dollars qui avait été promise à l’ Iran a aussi été bloquée. En coulisses, il y a davantage d’ activités qu’ il faudra révéler en temps utile.Je sais aussi – et je le dis partout où je vais – que ce combat ne me concerne pas seul. Mon cas personnel n’ est même pas prioritaire. Les grands enjeux en sont la liberté d’ expression et la souveraineté nationale. En outre, le cas des Versets sataniques n’ est que le plus connu des cas d’écrivains et d’intellectuels progressistes et dissidents qui sont harcelés, emprisonnés, bannis et assassinés à travers le monde musulman. Des artistes et des intellectuels d’Iran le savent, et c’est pourquoi ils m’ ont si courageusement et si continuellement affirmé leur soutien sans réserve. Des intellectuels, à travers le monde musulman – le poète Adonis, le romancier Tahar Ben Jelloun, et bien d’autres – ont appelé à faire cesser les menaces de l’ Iran, non seulement par souci de ma per- sonne, mais parce qu’ ils savent que ce combat est aussi le leur. Gagner ce combat, c’ est gagner une escarmouche dans une guerre beaucoup plus grande. Le perdre aurait des conséquences fâcheuses pour moi; mais ce serait également une défaite dans ce plus large conflit.Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. C’est pourquoi nous devons gagner. C’est aussi simple que cela.On ne tue pas des gens pour avoir écrit des livres. C’est clair. Au moment où j’achève ce texte, j’apprends que Yasser Arafat a dénoncé la fatwa comme étant contraire à l’Islam, tandis qu’ici, en Grande- Bretagne, même l’infâme démagogue, le Dr Kalim Siddiqui (représentant la ligne la plus dure des musulmans britanniques), croit «l’heure venue pour les deux parties de pardonner et d’oublier». Après quatre ans d’ intimidation et de violence, il y a certainement beaucoup à pardonner. Au demeurant, j’accueille même cet improbable rameau d’olivier.Quoi qu’il en soit, la crise ne sera pas terminée tant que les menaces du terrorisme international sponsorisé par un Etat ne seront pas formellement et sans la moindre équivoque rétractées. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’ est que le gouvernement britannique tire parti de la bonne volonté internationale émanant de tant de gens travaillant pour moi et à ma cause dans une douzaine de pays, et se place lui- même en première ligne des efforts de la communauté internationale pour que cesse ce scandale.Je remercie le gouvernement britannique de tout ce qu’il a fait pour moi. Mais je dois lui demander de faire plus maintenant; et plus énergiquement, de telle façon qu’ avec un peu de chance, et avant longtemps, il en ait bientôt moins à faire.S. R.© Salman Rushdie© pour cette traduction française Jacques-Michel Pittier & René Zahnd avec le concours de Jean-Louis Kuffer Le Passe-Muraille, Lausanne, 1993. -
Ceux qui boostent leur storytelling
 Celui qui te parle de son narratif / Celle qui optimise les données de son vécu partagé / Ceux qui modélisent les procédures de l’échange du ressenti / Celui qui distingue nettement récit contraint et récit spontané en vue d’un récit utile / Celle qui encode les composants de l’aveu latent / Ceux qui rappellent au séminaire sur la marque que celle-ci est le récit surdéterminé du logo / Celui qui pense marketing dans son développement personnel / Celle qui se positionne au niveau de la mise en fiction de son vécu sexuel / Ceux qui parlent des effets napoléoniens de la Maison Blanche dans son formatage rhétorique du réel / Celui qui vise l’immersif dans la simulation / Celle qui conceptualise la notion d’immersion par le toucher des arrosoirs et des paniers exposés dans sa galerie / Ceux qui recourent à des effets spéciaux dans leur approche de l’autre / Celui qui gère le flux des microrécits / Celle qui assimile les techniques du néomanagement afin de clouer le bec de son beau-père / Ceux qui se disent experts en persuasion dans la mouvance évangélique / Celui qui lance une mode managériale de type zen / Celle qui mise sur les performances narratives de son fils mytho / Ceux qui estiment que le succès du récit de la story de leur réussite relève du win-win, etc.Peinture: Pierre Lamalattie.
Celui qui te parle de son narratif / Celle qui optimise les données de son vécu partagé / Ceux qui modélisent les procédures de l’échange du ressenti / Celui qui distingue nettement récit contraint et récit spontané en vue d’un récit utile / Celle qui encode les composants de l’aveu latent / Ceux qui rappellent au séminaire sur la marque que celle-ci est le récit surdéterminé du logo / Celui qui pense marketing dans son développement personnel / Celle qui se positionne au niveau de la mise en fiction de son vécu sexuel / Ceux qui parlent des effets napoléoniens de la Maison Blanche dans son formatage rhétorique du réel / Celui qui vise l’immersif dans la simulation / Celle qui conceptualise la notion d’immersion par le toucher des arrosoirs et des paniers exposés dans sa galerie / Ceux qui recourent à des effets spéciaux dans leur approche de l’autre / Celui qui gère le flux des microrécits / Celle qui assimile les techniques du néomanagement afin de clouer le bec de son beau-père / Ceux qui se disent experts en persuasion dans la mouvance évangélique / Celui qui lance une mode managériale de type zen / Celle qui mise sur les performances narratives de son fils mytho / Ceux qui estiment que le succès du récit de la story de leur réussite relève du win-win, etc.Peinture: Pierre Lamalattie. -
Mon voyage en Occirient
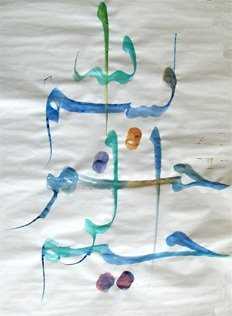
Par Jalel El Gharbi
Il n’est pas très confortable d’être passionné d’Occident quand on est oriental et il n’est pas confortable d’être épris d’Orient quand on est occidental. Dans un cas on passe pour être à la solde des puissances étrangères et dans l’autre cas, on est estimé victime de ce prisme déformant qu’est l’exotisme.
Il n’est pas très confortable d’être. Peut-être est-il doublement difficile d’être lorsque on porte en soi cette double appartenance qu’on peut délibérément avoir choisi de cultiver.
Sans le vouloir, j’ai usurpé un nom (El Gharbi, en arabe : l’occidental) et pour rien au monde je ne le changerais.
Où commence l’Orient commence l’Occident. Mais ce singulier me gêne. On devrait dire les Orients et les Occidents. Dans le Coran, ces mots se déclinent au duel et au pluriel. Puis, à la réflexion, qu’importent Orient et Occident ? J’essaie par là de paraphraser le grand poète Ibn Arabi (né à Murcie, cet Occident de l’Orient en 1165 et mort à Damas cet Orient de l’Occident en 1241). J’aime à citer ces vers du poète :
«L’éclair venant d’Orient, il y aspira
S’il était apparu en Occident, il y eut aspiré
Quant à moi, je suis épris du petit éclair et de sa perception
Je ne suis épris d’aucun lieu, d’aucune terre»
Et il me plait de gloser ces vers ainsi : j’aime tous les lieux où se réalisent ces renversantes épiphanies du beau. Ce sont les mosaïques du Bardo, de Sienne, de Damas, les sculptures de Rome, les colonnes de Baalbek, une peinture à Paris ou à Londres, un manuscrit enluminé à Istanbul. Je cherche à dire que le beau exige un cheminement, des voyages et une spiritualité. Un pèlerinage. Une spiritualité du beau demande à naître. Une autre logique demande à naître dont j’esquisse pour vous quelques traits, vous verrez que ce sont les canons même de la poésie : Pour affirmer mon arabité, je la renie ; pour renier mon occidentalité je la cultive. Ni l’un ni l’autre, c'est-à-dire et l’un et l’autre. Aujourd’hui, il s’agit d’être à l’image de l’olivier coranique, ni oriental ni occidental c’est-à-dire tout à la fois oriental et occidental.
Je suis ce que je nie ! Un autre cogito est à inventer qui ferait dépendre l’être du non être, qui dirait la contiguïté entre l’être et le néant et qui serait abolition des frontières entre l’affirmation et la négation.
Les frontières ne sont pas les limites d’un monde ; elles sont appel au franchissement, appel à la transgression, tentation de l’ailleurs. Les frontières attisent mon désir de les franchir. Les frontières sont un adjuvant du désir.
C’est à la faveur de cette rêverie que je m’adonne souvent à un brouillage des cartes pour entretenir ce rêve de ce que j’ai appelé un jour « Orcident » ou « Occirient ». Donc : où commence l’Orient commence le rêve, l’onirisme. Où commence l’Orient commence l’Occident, ses rêves, son onirisme: la frénésie exotique du XIXè était avant tout frénésie d’images venues d’ailleurs, ou frénésie d’images du même travesti sous les signes de l’autre, surdéterminé par la distance. Delacroix peignait des bains qui tiennent des boudoirs. Baudelaire cherchait ses rêves d’Orient du côté de la Hollande. On est tous l’Orient de l’autre, l’occident de l’autre. L’autre revient au même. L’autre n’est pas. Il n’est même pas autre. Plus les cartes géographiques comportent d’erreurs, plus elles sont belles. Je préfère les portulans historiés aux cartes d’aujourd’hui dont l’exactitude est affligeante.
Un éloge de l’erreur est à écrire.
Il me reste à dire que je ne perds pas de vue le caractère foncièrement utopique de cette rêverie. Je n’oublie pas que nous nous sommes installés depuis les Croisades et les entreprises coloniales dans une logique de rapport de force et d’occultation de l’apport de l’autre. Dans la rive Sud de la Méditerranée, ce rapport de force trouve son illustration la plus douloureuse dans la question palestinienne qui exige une solution équitable, il peut être illustré également par l’abîme qui sépare le Nord et le Sud. Aujourd’hui les nouveaux manichéens, ceux pour qui le monde est divisible par deux (nous/les autres autrement dit les forces du bien et l’axe du mal) ont plus d’un argument qui leur permettent de recruter leurs adeptes. Ces arguments ce sont l’injustice, l’absence de démocratie et la misère. Notre nombre est-il en train de décroître nous qui pensons que le monde n’est pas divisible par deux ?
Dans ce monde qui a retrouvé le confort des dichotomies manichéennes, il convient de saluer
ceux qui par leur naissance brouillent les identités !
ceux qui par leur culture brouillent les pistes !
ceux qui par leurs amours ont choisi d’autres contrées !
ceux qui par leur désir, leur rêve ont un jour aspiré à une altérité sans laquelle le monde serait inhabitable !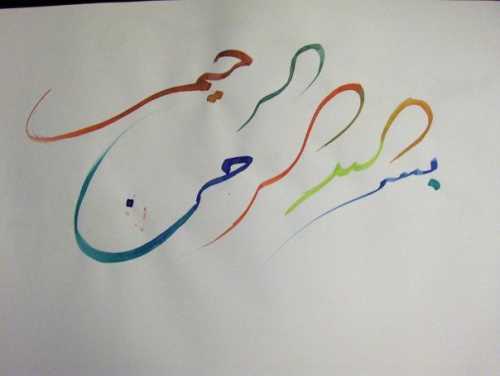
Cette chronique a poaru dans la livraison du Passe-Muraille d'avril 2009, No 77.Commandes et abonnements : Passemuraille.admin@gmail.com
Calligraphies: le maître et l'élève.
1) Ghani Alani, Bism Illah al-Rahman al-Rahim, style ottoman.
2) Ghani Alani, style andalous.
3) Sophie Kuffer, style persan.
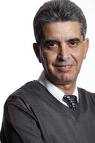 Jalel El Gharbi est critique littéraire, poète et professeur de littérature à l’université de Tunis. Il a publié, chez Maisonneuve et Larose, un ouvrage intitulé Le poète que je cherche à lire et, aux mêmes éditions, Le cours Baudelaire. Il a consacré une monographie au poète Claude Michel Cluny, sous intitulée Des figures et des masques et publiée aux éditions de La Différence.
Jalel El Gharbi est critique littéraire, poète et professeur de littérature à l’université de Tunis. Il a publié, chez Maisonneuve et Larose, un ouvrage intitulé Le poète que je cherche à lire et, aux mêmes éditions, Le cours Baudelaire. Il a consacré une monographie au poète Claude Michel Cluny, sous intitulée Des figures et des masques et publiée aux éditions de La Différence.Attaché aux échanges transversaux entre langues et cultures, il a également introduit et commenté l’œuvre de la poétesse luxembourgeoise José Ensch (disparue en 2008) dans son Glossaire d’une œuvre publié aux éditions de l’Institut Grand-Ducal du Luxembourg.
Jalel El Gharbi oeuvre pour une utopie qu’il appelle Orcident ou Occirient, cultivant une posture intellectuelle et sensible qui fait de la connaissance une raison d’être. Il anime un blog littéraire (http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com) de haute tenue où une pensée humaniste confronte quotidiennement les aléas de la violence (notamment pendant la tragédie récente de Gaza) aux enseignements de nos diverses traditions littéraires et spirituelles, dont la poésie serait le filtre cristallin.
Le dernier livre de Jalel El Gharbi, Prière du vieux maître soufi le lendemain de la fête, a paru en 2010 aux éditions du Cygne. (jlk)
-
Le chemin sur la mer
 «Qui sait, il se peut que la vie soit la mort,et que la mort soit la vie » (Euripide)Tu ne sais pas où ils s’en vont,ou tu ferais semblant:tu le saurais très bien, au fond,mais faire l’ignorantdu lieu qui n’aura plus de nomconnu de leurs expertsdu vivant juste vécucomme la plus banale affairete semblait élégant...Vous ne vous inquiéterez pasoù vous êtes à présent -mais ce mot-là ne convient pasoù vous êtes là -bas -non plus que cette expression là !Vous n’y penserez même pas,mais nous sommes iciparfois moins vivants que vous autres,à croire encore que vous pouvezfaire de nous l’un des vôtres...L’invisible passage est lisibleau cœur de chacun d’eux:d’un imperceptible coup d’aileelles retrouvent ce lieudont le nom jamais prononcédans l’obscure lumièreseul fait de nous les passagersdu chemin sur la mer...Peinture: Odilon Redon
«Qui sait, il se peut que la vie soit la mort,et que la mort soit la vie » (Euripide)Tu ne sais pas où ils s’en vont,ou tu ferais semblant:tu le saurais très bien, au fond,mais faire l’ignorantdu lieu qui n’aura plus de nomconnu de leurs expertsdu vivant juste vécucomme la plus banale affairete semblait élégant...Vous ne vous inquiéterez pasoù vous êtes à présent -mais ce mot-là ne convient pasoù vous êtes là -bas -non plus que cette expression là !Vous n’y penserez même pas,mais nous sommes iciparfois moins vivants que vous autres,à croire encore que vous pouvezfaire de nous l’un des vôtres...L’invisible passage est lisibleau cœur de chacun d’eux:d’un imperceptible coup d’aileelles retrouvent ce lieudont le nom jamais prononcédans l’obscure lumièreseul fait de nous les passagersdu chemin sur la mer...Peinture: Odilon Redon -
Par les allées profondes

Le sentier derrière la maison
s’en allait dans les bois .Pour aller tout là-bas,
il fallait se fier
au seul sentier de ces régions
qui remontait du haut en bas
à travers les fourrés,
par les ravins et les ruisseaux,
les combes ombragées,
et les trouées de ciel bleu clair
au-dessus de la canopée -
le sentier conduisant
jusques au souterrain secrets.Le monde à l’envers m’accueillait
dans son ombre éclairée ;
je voyais en ce temps d’enfance
à peine prolongée
entre chiens et loups ces longs soirs
où je revins errer
en mon acide adolescence –
je voyais les années profondes
que je vois aujourd’hui
reflétées comme en un miroir,
et la maison, et le sentier
qui s’en allait de par les bois…Peinture: Chaïm Soutine
-
Ceux qui se paient de mots
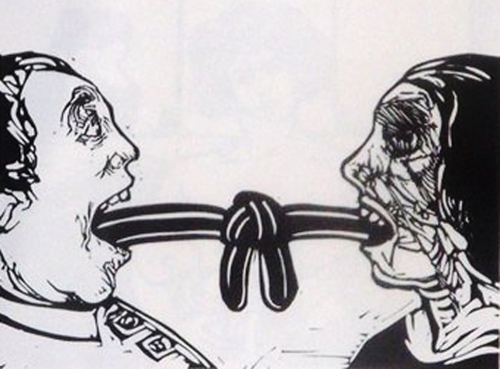
Celui qui écrit que la mort de l’écrivain culte voire cultissime est un événement historique qui ne se reproduira pas / Celle qui explose les attentes de son sponsor au niveau du maquillage / Ceux qui affirment que la skieuse aux yeux verts va sublimer la fameuse descente du Pic noir / Celui qui voit en Michel Houellebecq le nouveau Pascal conjuguant l’esprit de géométrie de Descartes et la radicalité d’un djihadiste platonique / Celle qui se dit la Kim Kardashian des cantons de l’Est / Ceux qui déconstruisent les apories du minimalisme dans leurs théories subventionnées par les États du Golfe / Celui qui n’a pas de mots pour dire ce qu’il ressent entre les jambes relevant du subcortex et de la lecture attentive des sourates relatives au Combat / Celle qui répète que le Prophète a un plan d’enfer pour les filles qui se donnent à lui pendant le ramadan / Ceux qui pensent en majuscules en visant l’Académie / Celui qui pense même en dormant et rêve que ses étudiants en philo l’écoutent en pianotant sur leurs smarties / Celle qui vocifère au micro de l’émission néo-féministe que tous les mecs sont des fachos embusqués derrière leurs braguettes à barreaux flexibles / Ceux qui caressent les truies dans le sens du poil / Celui qui s’exclame Oh m’y gode quand le jour se lève / Celle qui a enregistré toutes ses analyses de la grande époque du structuralisme aujourd’hui récusées par les révisionnistes de tous bords / Ceux qui se sont spécialisés dans l’approche objective du sous-signifié des tirets ponctuant la poésie de l’immense Dickinson / Celui qui estime qu’après le salubre nettoyage de la déconstruction plus rien de signifiant ne se manifeste même en termes postmodernes à l’exception éventuelle de la génétique textuelle purement matérialiste / Celle dont le fonds de commerce était le Nouveau Roman jusqu’à sa prise de conscience du caractère crypto-réactionnaire de cette école au sens archaïque dont elle a entrepris de casser les concepts dans ses aphorismes complètement rebelles / Ceux qui ont reconnu la relativité des choses surdéterminant la portée des mots déjà plus ou moins pipés à la base vus qu’il sont imposés de haut en bas - et ça jeunes gens fera l’objet de mon prochain séminaire sur la décolonisation du langage et ses dégâts collatéraux dans les zones à risques, etc.
-
Ceux qui ne font pas le poids
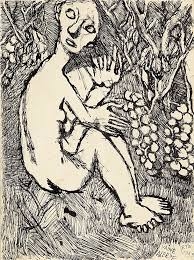
Celui qui se prétend battant et qui est juste cloche / Celle qui se dit la vamp du virtuel / Ceux qui voudraient vouloir s’ils pouvaient pouvoir / Celui qui dit à son miroir : à présent mon petit René tu vas déchirer / Celle qui mise tout sur sa beauté intérieure / Ceux qui ont renoncé faute de mieux / Celui qui dit vivre à cent à l’heure à Janine qui opine / Celle qui attend d’Alphonse qu’il se défonce / Ceux qui osent l’excès pour en jeter aux petits rats de l’Opéra / Celui qui intitule son premier sonnet Premier Sonnet et cherche à le publier sous pseudo dans une revue confidentielle de qualité attentive à ceux qui débutent / Celle qui demande à l’influenceur connu comment faire pour se faire reconnaître des followers même méconnus / Ceux qui affirment que le succès ne les attire pas mais leur cousine Josyane attachée de presse aux éditions du Brochet leur objecte : et pourquoi pas ? / Celui qui menace ses lectrices de disparaître et ça va le faire tu verras / Celle qui soutient la thèse selon laquelle la renaissance de Baudelaire date de juste après sa mort comme il l’avait prévu dans une lettre à un collègue qu’elle se propose de citer par ailleurs aux experts / Ceux qui ont si peu d’estime de soi qu’ils le reconnaissent en petit comité / Celui qui était poids moyen avant sa transition / Celle qui se repent puis se reprend / Ceux qui prennent conscience de leurs limites genre Einstein au pied du mur de Planck, etc.
Dessin à la plume: Louis Soutter
-
Le joaillier, les grappilleurs et l'alouette

Des écrivains voyageurs aux voyageurs-écrivants.
Il n’est pas, me semble-t-il, de véritable premier voyage qui ne s’ancre dans la première enfance, je veux dire : dans l’odieux emmaillotement de la première enfance et dans son immobilité forcée, dans la première impatience de l’enfance et son premier trépignement après son premier cri, dans les premiers regards effarés de la prime enfance sur tous ces murs et tous ces yeux et toutes ces serrures, dans le premier effroi de l’enfance qui vous a fourré dans ce corps et dans ces couches et dans ces entrelacs de bras et de barreaux de prison, dont il faut absolument s’arracher.
La première enfance, il faut bien le dire, est tellement contraignante qu’elle appelle immédiatement au voyage. On ne peut rester là. On droit partir, on doit se casser, on n’en peut plus : de l’air ! Cependant pour l’instant – la vie est dure, mais c’est comme ça -, on ne peut aller nulle part ailleurs, sinon par l’imagination, et même cela sera pour plus tard.
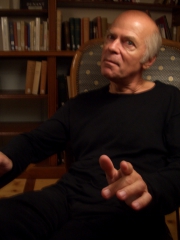 Pascal Quignard raconte, dans La barque silencieuse, le retour des nourrissons parisiens confiés aux femmes de Corbeil, connues pour leur bon lait campagnard et forestier, sur de longs coches d’eau appelés aussi corbeillats (dont le mot corbillard découlera), glissant le long de la Seine, et les terribles hurlements des nourrissons emmaillotés.
Pascal Quignard raconte, dans La barque silencieuse, le retour des nourrissons parisiens confiés aux femmes de Corbeil, connues pour leur bon lait campagnard et forestier, sur de longs coches d’eau appelés aussi corbeillats (dont le mot corbillard découlera), glissant le long de la Seine, et les terribles hurlements des nourrissons emmaillotés. Pascal Quignard n’est pas vraiment ce qu’on peut dire un écrivain du voyage, mais on voyage beaucoup, à travers ses livres, dans les mots qu’il ne cesse de sonder pour en dire mieux le transit. Ainsi écrit-il à propos de la prime enfance : « Quel qu’il soit, quel que soit le siècle, quelle que soit la nation, tout enfant est d’abord un inconnu.Tout destin humain est : l’inconnu de la mise au monde confié à l’inconnu de la mort. »
Ensuite l’enfant se fait au monde, comme on dit. L’enfant s’acclimate et s’habitue. L’enfant s’avachit, en tout cas en apparence. L’enfant déchoit-il ? Minute ! Car l’enfant entend aussi des contes et commence bientôt à lire, et c’est alors un nouvel appel d’air et le possible sursaut du voyage, d’abord imaginaire, avec les livres et par les oncles.
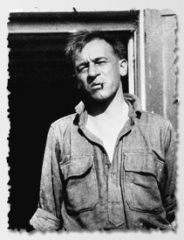 Une enfance sans oncles voyageurs, comme les sept oncles de Blaise Cendrars, une enfance sans tantes un peu aventurières, à l’image de l’institutrice bernoise Lina Bögli, est une pauvre enfance, convenons-en. Pourtant les premières nouvelles du monde rapportées de vives voix par les oncles et les tantes à l’enfant lui arriveront, tout aussi bien et parfois mieux, par les livres.
Une enfance sans oncles voyageurs, comme les sept oncles de Blaise Cendrars, une enfance sans tantes un peu aventurières, à l’image de l’institutrice bernoise Lina Bögli, est une pauvre enfance, convenons-en. Pourtant les premières nouvelles du monde rapportées de vives voix par les oncles et les tantes à l’enfant lui arriveront, tout aussi bien et parfois mieux, par les livres.Par les oncles l’enfant apprend qu’il y a des pirates en Malaisie et des mines à Sonora, les noms des oncles et des tantes diffusent une première magie que les livres prolongent les jours de pluie ou sous la lampe. L’enfant lit ainsi : « Le thé des caravanes existe », et le monde existe autour de lui. Puis l’enfant se cabre et se busque en adolescent farouche et lit alors : « Il y a dans l’intérieur de la Chine quelques dizaines de gros marchands, des espèce de princes nomades », et l’enfant se reconnaît évidemment et le voyage n’en finira plus désormais, il reçoit d’un de ses oncles Vol à voile de Cendrars et bientôt Bourlinguer et plus tard Moravagine et voici ce qu’il lit à douze ou quinze ans : «Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière. » Ces mots précis, ces mots comme des musiques et des sculptures, ces mots comme du cinéma ont marqué la pâte tendre de l’enfance et de l’adolescence, dont tous les voyages découleront ensuite plus ou moins.
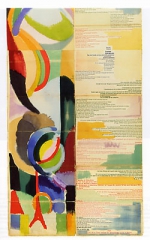
De fait les mots précis des poètes, et je pense maintenant à Nicolas Bouvier, en disent plus que les récits plus ou moins ressassés, voire éventés, des oncles voyageurs, comme on verra que les écrivains qui voyagent en disent plus, dans le précis et le durable, des voyageurs qui écrivent, avec de notables exceptions.
Lina Bögli en est une. Avant Nicolas Bouvier, mais sans l’intention poétique de celui-ci, Lina Bögli incarne une curiosité voyageuse assez typiquement helvétique, avec une façon de capter et de restituer ses observations, frottées de bon naturel, qui rappelle immédiatement Ma vie de Thomas Platter, le candide chevrier des hauts gazons devenu grand humaniste de la Renaissance européenne, Le pauvre homme du Toggenburg d’Uli Bräker, l’érudit paysan traducteur de Shakespeare, ou encore les merveilleuses lettres de voyage de Thierry Vernet, constituant un pendant foisonnant et primesautier de L’Usage du monde.
Or, le rapprochement des écrits de Nicolas Bouvier et des lettres de son compagnon de voyage, représentant désormais près de mille pages, devrait permettre au lecteur de mieux faire la distinction entre ceux qu’on dit des écrivains voyageurs et ceux qui, voyageurs eux aussi, n’ont pas pour autant de prétention littéraire. La distinction n’est ni polémique ni académique non plus : elle vise au rapport de celui qui écrit avec la langue, elle marque la nuance entre l’écrivain accomplissant sur la langue un travail de joaillier, et celui, plus modeste, et délié, qu’on pourrait dire écrivant ou grappilleur.
D’aucuns tendent à penser, peut-être par rejet de toute une mode actuelle des « étonnants voyageurs » devenue fonds de commerce, que, de la littérature du voyage, il n’y a de bon précisément que LA littérature, à savoir : les œuvre surfines d’écrivains surfins, stylistes parfaits, dont Nicolas Bouvier serait l’un des maîtres. Mais cette distinction ne tiendrait pas longtemps. Elle ne tiendrait même pas longtemps à comparer la prose étincelante de L’Usage du monde ou du Poisson-scorpion et certains récits de voyage de Bouvier, d’un éclat et d’une densité moindres. Il y a, de toute évidence, un incomparable joaillier chez Nicolas Bouvier, mais le grappilleur compte aussi, et la lecture de sa correspondance avec Thierry Vernet, loin de ternir son image, ne laissera au contraire de l’enrichir et de mieux montrer aussi l’entier du voyage, en deça et au-delà de la seule joaillerie. De la même façon, l’on pourrait distinguer chez un Cendrars ou un Charles-Albert Cingria, autre poète itinérant, les composantes du joaillier taillant, polissant et sertissant les mots comme des bijoux, et celles du grappilleur plus débonnaire. Mais revenons, un instant, à notre charmant tendron.

À trente ans, en 1892, craignant de s’encroûter dans la famille polonaise qui l’emploie à Cracovie, l’institutrice Lina Bögli décide d’accomplir un tour du monde dont elle fixe la durée à une dizaine d’années : « Je ne suis nécessaire à personne, je n’ai point de parents qui pourraient se tourmenter pour moi, donc je pars ! »
Embaquée à brindisi à bord du bateau Vorwärts (En avant !, dont elle se rappelle que ce fut la devise de l’explorateur Nansen), la jeune femme, petite provinciale encore farouche, va gagner Colombo par Aden (« trop de degrés de chaleur, trop de serpents et trop de mendiants »…), avant de pousser jusqu’en Australie où elle s’installera plusieurs années à Sydney, toute dévouée aux variantes diverses de la jeune fille mondiale. Or, tout au long de son périple, Lina Bögli écrit à son amie Lisa des lettres épatantes d’ingénuité malicieuse et de franchise, mais aussi de précision réaliste dans ses observations, dont le ton et la sagacité pourraient être d’un Candide curieux de notre temps ou d’un Huron en jupon. Il y a chez elle en effet du petit reporter, qui soumettra tel vieux Maori cannibale à l’interview et se rendra chez les Mormons polygames de l’Utah en s’inquiétant d’abord de leur mœurs, avant de reconnaître les agréments inattendus de leurs arrangements. Et quant à la vraie douceur de vivre, notre probable vierge la découvrira aux îles Samoa où tel bel indigène la tentera bel et bien de s’installer en ce paradis avant de la faire se récrier : « Hélas, j’ai besoin de toutes les choses qui font mon tourment ! ».
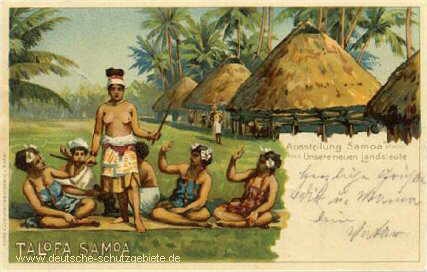
Le récit épistolaire de Lina Bögli n’est à vrai dire ni d’un joaillier ni d’un grappilleur, mais il n’en participe pas moins d’une lecture de monde à la fois limpide et cousue de préjugés bientôt remis en question, typique en somme de l’approche du touriste contemporain le mieux intentionné, le moins prédateur, le plus sincèrement intéressé par le monde et les gens. Il est émouvant, ainsi, de la voir compatir, en Helvète démocrate, avec les Hawaïens humiliés par l’annexion américaine, et plus touchant encore de la voir bouleversée par l’arrivée des émigrants européens à New York, comme si cet exode exprimait toute la misère du Vieux Monde.
Maints écrivains voyageurs sont plus brillants qu’elle, maints voyageurs-écrivants ont plus de choses à raconter, mais Lina Bögli nous ramène à une sorte d’enfance du voyage qui nous rappelle Tintin, Robinson ou les jeunes gens entreprenants de mark Twain ou de Jacl London, avec une fraîcheur, une capacité d’émerveillement, mais aussi d’indignation, que nous retrouvons également dans les lettres de Nicolas Bouvier et de Thierry Vernet en leur jeunesse impatiente de s’arracher à l’emmaillottement calviniste et bourgeois de leurs familles.
À la fin de son tour du monde, fatiguée mais contente, retrouvant la vieille Europe et Cracovie dix ans après son départ, ponctuelle comme un coucou suisse, Lina Bögli formule cette humble conclusion pleine de reconnaissance : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrance et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est arrivé ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ou insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire. »
Et tel pourrait être, aussi, le bilan d’un bon usage du monde, aussi légitime en somme que celui des joailliers ou des grappilleurs de la littérature voyageuse.
Nicolas Bouvier, maître joaillier s’il en fut, n’est pas pour autant, non plus, l’artisan suprême de la poésie du voyage, évidemment incarnée par Dante Alighieri dont la Commedia représente le périple initiatique par excellence, ressaisissant le parcours symbolique de l’homme en ce bas monde dans une langue à la fois fondatrice et de radieuse portée, bonnement universelle.
Or, au vingtième chant du Paradis, Dante trouve une image adaptée au démaillottement du mondial poupon cousu dans sa camisole de force, exprimant le plaisir divin d’être au monde dans la pureté du soir : « Comme l’alouette qui s’élance dans l’air / chantant d’abord, et puis se tait, contente de la dernière douceur qui la comble, elle me sembla l’image de l’empreinte/ du plaisir éternel, au désir de qui /toute chose devient ce qu’elle est… »
Pascal Quignard. La Barque silencieuse. Seuil, 2009.
Lina Bögli. En avant ! Bernard Campicjhe, postface de JLK, 2007.
Thomas Platter. Ma vie. L’Age d’homme, Poche suisse no 20. 1982.
Uli Bräker, Le pauvre homme du Tiggenbourg. L’Age d’homme. Poche suisse, 1995.
Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Correspondance 1945-1964. Zoé.
Dante, La Divine comédie. Texte bilingue, traduit par Jacqueline Risset. GF Flammarion, 1992.
-
Le pessimiste radieux
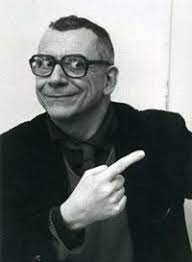
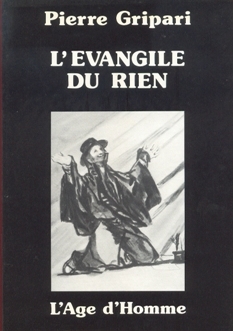 À propos de L’Évangile du rien, anthologie de Pierre Gripari
À propos de L’Évangile du rien, anthologie de Pierre GripariPierre Gripari rêvait depuis longtemps d’écrire ce livre, qui n’est cependant pas de lui… De fait, L’Évangile du rien rassemble des fragments de grands textes littéraire de tous les temps est de toutes les cultures, choisis en fonction de leur apport à un certaine sagesse désespéré, qu’on pourrait qualifier aussi de mystique sans Dieu.
À en croire Pierre Gripari, « la Vérité c’est d’abord le Désespoir ». Ce n’est pas aux portes de l’enfer ainsi que nous y invite Dante, qu’il faut laisser toute espérance, mais devant celle de la sagesse, car « le sage est celui qui apprend à vivre, et à bien vivre, ici et maintenant, dans cet univers et non dans un autre», respectueux des deux vertus cardinales que sont « le refus de croire, et le refus d’espérer ».
Au commencement fut le scandale, pour l’homme, seul animal conscient de cela, de se découvrir mortel, ce dont se fond écho, dans la première partie de l’ouvrage intitulée La question du malheur est posée,quatre morceaux brefs empruntés à Hérodote, àune chanson babylonienne d’une étonnante fraîcheur, au Livre de Job, et à Macbeth.
À partir de cette expérience primordiale du tragique de la condition humaine, chacun va s’efforcer de répondre en son âme et conscience et selon ses fibres – « sa tripe », dirait Gripari – à la question de savoir « comment vivre ».
Il y a d’abord celui qui ne voit en l’existence qu’un cadeau empoisonné, une sale farce, Pour ne pas dire une sombre trappe, et qui trouve le néant préférable finalement à l’affreuse vie.
Telle n’est certes pas l’attitudes du sage ou du mystique, même négatif, mais du moins faut-il se garder de mépriser ce dégoût d’exister, propre aux hommes de tous les temps, ainsi que l’illustre la deuxième partie de l’ouvrage, réservé aux Amoureux du néant, et où voisinent un texte égyptien de toute beauté datant du troisième millénaire avant Jésus-Christ, un extrait du Second Faust de Goethe et l’admirable À moi-mêmede Leopardi, la fameuse strophe du Silence d’Alfred de Vigny est un passage des Démonsde Dostoïevski - où il est question du suicide philosophique vu par l’ingénieur Kirilov - , un fragment de La Nauséede Sartre et le testament en noir de l’humoriste Chaval, notamment.
À celui qui a choisi de vivre, même désillusionné, s’offrent alors deux voies : celle de l’abstention, et celle de l’engagement.
La première correspond à un raisonnement tout simple, consistant à se préserver de toute souffrance inutile, la réalité et les hommes étant ce qu’elles sont. « Cette attitude et noble chez les natures nobles, commente Gripari, vulgaire chez les gens vulgaires. Elle est basse où elle est héroïque. Elle est, suivant les caractères, dure ou sentimentale, souriante et indulgente ou, au contraire méprisante, agressive».
Sans s’arrête aux présocratiques, qu’il eût sans doute u inclure dans son anthologie, l’auteur réunit, à l’enseigne de Ceux qui s’abstiennent, des extraits de L’Apologie de Socrate,de la Lttre à Ménécie d’Epicure - chez lequel il se plaide d’ailleurs à saluer la sagesse « toute nue, sans aucun mélange de dogmes religieux, d’humanisme sentimental ou de préoccupations idéologique, chimiquement pure, si l’on ose dire », du Manueld’Épictète et de sentences des soufis, pour finir par quatre fables de La Fontaine.
Si la doctrine de l’abstention peut séduire, force eet pourtant de reconnaître qu’elle ne prend en compte ni les incessantes transformations du monde, ni ce qu’il y a tout de même excitant dans les activités de l’homme. D’où la nécessité de trouver, pour Ceux qui luttent, « une formule qui concilie l’hygiène mentale d’un Epicure avec le besoin de réalisation qui fait partie de la nature humaine ».
Et ce sont enfin, fort différentes les unes des autres, mais accordées au même bon sens réaliste de L’Évangile du rien(pour l’auteure duquel l’homme « n’est pas gentil » non plus que l’Histoire mais qui affirme néanmoins que « nous en sommes pourtant de cette race et de ce monde ») des citations de règles et autres relevés d’observation se rapportant à la façon de se comporter dans le monde tirés de Lao-Tseu et de L’Ecclésiaste, de Marc-Aurèle est de Jean-Paul Richter, de Staline (eh oui : quatre lois de la dialectique dont, philosophiquement Gripari enregistre le bien-fondé), de Nietzsche est de Kipling (une nouvelle excellente version du poème If...) ou de Montherlant, entre autres.
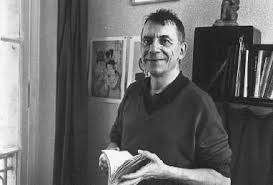
À relever enfin que le présent recueil ne réserve pas aux lecteurs que la découverte de superbes morceaux choisis émerveiller par leur qualité littéraire avant que de faire réfléchir, mais également une suite de gloses de haute tenue où nous retrouvons Pierre Gripari tel qu’en lui-même, avec son sens de la clarification et sa remarquable capacité de synthèse, sa verve et son franc-parler – sa parfaite sincérité de pessimiste radieux.
Editions L’Âge d’Homme, 1980.
-
Léon Bloy contre le Bourgeois
En relisant l’Exégèse des lieux communs

Avec la même sainte fureur que Pascal en mettait à vitupérer les athées, Léon Bloy s’en prend à celui qui lui semble incarner par excellence l’avatar contemporain du mort spirituel: ce Bourgeois représentant à ses yeux “l’homme qui ne fait aucun usage de la faculté de penser et qui vit ou paraît vivre sans avoir été sollicité, un seul jour, par le besoin de comprendre quoi que ce soit”.Encore l’athée de Pascal pensait-il. Tandis que le Bourgeois selon Bloy se contente de répéter quelques formules lui tenant lieu de sagessse.mLe langage de l’athée est sans équivoque. Je ne crois pas en votre Dieu, déclare ce contempteur de la foi et des cultes, ce ne sont là que fables et simagrées. Point n’est besoin de ruser avec lui, sinon par devoir de le convaincre “pour son bien”, et Pascal l’eût exhorté de la même charitable non moins qu’inflexible façon s’il s’était appelé Bertrand Russell ou Jean-Paul Sartre.Mais comment parler au Bourgeois ? Comment se faire seulement entendre de ce juste auquel son formulaire donne réponse à tout ? L’athée de Pascal était encore une individualité, et nous dénombrons autant de formes d’athéismes qu’il y a d’athées. En revanche, on dirait qu’il n’y a personne derrière l’écran que forme le langage du Bourgeois, où grouille cependant une multitude anonyme, confondue dans le même culte du stéréotype.L’athée de Pascal disait encore “je pense que...”, tandis que le Bourgeois selon Bloy se borne à répéter qu’”à ce qu’on dit...”La lecture de Léon Bloy ne cesse de me partager. Tantôt je lui donne pleinement raison, passant sur son absolutisme et sa sainte fureur, tantôt aussi je me sens me cabrer contre sa façon de s’en prendre à la vie même. Je sais bien qu’il s’inscrit dans la lignée du christianisme le plus radical, mais celui-ci naboutit-il pas à une forme de nihihlisme ? Et n’y aurait- pas du pharisaïsme dans cet acharnement de Pur, ainsi que le pensait le tranquille agnostique Léautaud, à vrai dire le contraire d'un Bourgeois ?
Bloy se justifie de tout porter à l’extrême au nom de l’Absolu: “Dans l’Absolu, il ne peut y avoir d’exagération”, écrit-il dans son “et, dans l’Art qui est la recherche de l’Absolu, il n’y en a pas davantage”. A l’inverse, le Bourgeois constate que “rien n’est absolu”, et tout est dit de sa philosophie à la petite semaine et de la délimitation de son royaume du relatif, à savoir qu’“on est ce qu’on est”. Or cette feinte humilité n’est que le voile trompeur d’une massive arrogance. De fait, cet accroupissement résigné camoufle le grand refus du Bourgeois de se poser la moindre question, et par exemple celle de son origine ou de ses fins. Par voie de conséquence, “toutes les identités succombent”, souligne Léon Bloy, étant entendu que le hasard seul nous a faits ce que nous sommes, et nullement uniques ou irremplaçables, mais fils de notaire ou de marchande de nouilles comme nous eussions pu naître pieuvre ou punaise.Dès lors, foin d’interrogations oiseuses et qu’on se borne, au lieu de “chercher midi à quatorze heures”, à “faire son trou”. Tel étant le fondement du credo du Bourgeois, dont le premier article recensé par Bloy est que “Dieu n’en demande pas tant”.
Vers les nouveaux lieux communs
Désormais tout un chacun vomit le Bourgeois: tel est le nouveau lieu commun qui annonce l’homme de la Modernité.Le Bourgeois du début du siècle incarnait par excellence le philistin. Même s’il se disait parfois “poète à ses heures”, il se moquait au fond des arts et de la littérature, à l’exclusion des feuilletons boursiers ou légers.En revanche, l’homme nouveau se déclare par avance tout acquis à la cause du poète maudit. Autant le Bourgeois regimbait devant toute forme de nouveauté, autant l’homme de la Modernité la renifle voluptueusement. Matérialiste à tout crin, le Bourgeois chantait des hymnes aux biens de ce monde, tandis que l’homme de la Modernité, quoique connaissant l’adresse des meilleurs traiteurs, se répand volontiers en lacérantes litanies contre le bien-être. Le Bourgeois ne rougissait pas de proclamer qu’on ne peut pas vivre sans argent”, tandis que l’homme de la Modernité se dit le frère des pauvres et le rappelle à tout moment en signant force manifestes surabondant en nouveaux lieux communs dont Jacques Ellul a relancé l’exégèse...
Léon Bloy, Exégèse des lieux communs. Rivages Poche.
Jacques Ellul. Exégèse des nouveaux lieux communs. Calmann-Lévy.
Portrait de Léon Bloy, par Marc-Edouard Nabe.
-
Une chienne d’enfance

Un épatant petit livre de Claude Duneton
« A l’âge où la raison m’accable, pour être devenu un homme dont le poil est gris, il arrive, dans mes rêves, que je caresse des chiens morts », écrit ClaudeDuneton au terme de ce petit livre d’amour vache où, dans la foulée dératée d’une chienne aussi mal coiffée que dressée à la diable, se presse une enfance de souvenirs en troupe débridée, au temps du Maréchal nous voilà.
Elle s’appelait Rita, une chienne qui était « du scandale à l’état pur », en tout cas au juger de la mère qui s’impatientait qu’on lui fît la peau, Rita se trouvant infoutue de servir à quoi que ce fût et rappelant par sa seule présence, à ladite mère, le péché originel d’avoir coûté la vie à la petite Mimiss, sa chienne à elle « bête comme ses pieds » qu’on lui avait offerte à Paris et point faite pour la dure vie de campagne, qu’un homme révolvérisa pour faire place à Rita qu’il offrait à la famille.
Or le père ne fit jamais la peau de Rita, qui avait le fait de tuer en horreur depuis Verdun, et ce fut à l’unique enfant de le faire des chiots de Rita, une portée après l’autre, « han » contre le mur pour les assommer, puis à la rivière, avec la seule consolation que « ces petits aveugles n’avaient rien vu de leur destin ».
On pense à La Belle Lurette d’Henri Calet, en plus succinct mais en aussi vrai de ton et de son, à la lecture de ce livre à la fois dur et doux, évoquant une époque noire et une enfance de « blessé profond », entre des parents se blessant l’un l’autre à proportion des duretés de la vie paysanne exaltée par le Maréchal (le fameux Retour à la Terre) et subie à contrecoeur par le père pour qui « les travaux, les entraves, les bêtes à soigner, les foins, les agnelages, les semailles, les crève-corps, n’arrêtaient jamais ». Cela étant précisé: « Pétain était aimé surtout par les paysans rassurants, ceux qui marchent encore gravement dans les pâturages sous la lune avec leurs sabots ferrés, dans les livres de l’école ».
Or Claude Duneton, berger de mots avant l’heure, apprend à son corps défendant ce qui distingue les choses de la vie et celles des livres, mais c’est avec autant de tendresse que d’exactitude mordante et de bonheurs d’écriture qu’il retrace ces chiennes d’années Rita…
Claude Duneton. La chienne de ma vie. Buchet-Chastel, 74p. -
Vocabillard
Académinable. - Se dit, chez les gens de lettres envieux ou non conformistes, de tout candidat à l'Académie.
Ambiglu. - Substance physiopsychique indéfinissable, dont on ne saurait établir le genre non plus que la fonction, qui explique cependant certain état, ou qualité d'indétermination chez le sujet. "Où en est Dominique ? Va-t-il (elle) enfin se décider entre la jupe et le pantalon, ou marinera-t-il (elle) encore longtemps dans cette espèce d'ambigu ?
Amorosité. - Etat de prostration lancinante que connaissent les jeunes gens en proie au malheur d'aimer.
Amouroir. – Maison de retraite destinée aux séducteurs décatis et aux courtisanes chenues.
Anarchevêque. – Dignitaire ecclésiastique prônant la libération sexuelle dans les couvents et les jardins d’enfants, l’abolition des dogmes et l’hostie à la mescaline.
Barthouse. – Partie fine rassemblant de jeunes sémiologues et de vieux lotophages. Par extension: sauterie durant laquelle des individus des trois sexes échangent force propos sémiorotiques en toute alacrité ludique.Bigotoir. - Lieu clos dans lequel on entreprend de déligoter une dame des liens trop étroits de sa bégueulerie.
Biseauter. - Embrasser, dans la langue du Moyen Âge. "Sa gente Dame étant de glace, il la biseauta".
Boudisme. – Religion faite de bouderie et de quiétisme, où se sont réfugiés certains chrétiens déçus de leur Eglise.
Bourdieusard. – Variété germanopratine et / ou provinciale du bondieusard, également signalée dans les universités d’Amérique du Nord et du Japon urbain.
Chalumette. - Bergère pleine de grâce.Chaordre. - Etat dans lequel s'est trouvé le monde après que la première paire humaine eut fauté "Les événements ne sont jamais absolus, leurs résultats dépendent entièrement des individus. Le malheur est un marchepied pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l'homme habile, pour les faibles un abîme. Tantôt nous nous croyons au ciel, et tantôt en enfer. En réalité, nous sommes en plein chaordre." (Joseph de Maistre in Rien n'est à sa place)
Chômerie. - Situation sociale endémique et perdurante de chômage et de mômerie.
Confessoir. - Antichambre où les dames se déshabillent et se rhabillent avant et après la confessée.
Courtoiseau. - Jeune gandin gourmé qui s'essaie à la séduction: "Où sont les gentils damoiseaux ?/ Gente saillies et joie passées / Plus ne voit -on que courtoiseaux / Enflant paroles compassées".
Crédole. - À la fois créole et crédule. "Toutes les femmes ont un charme spécial et particulier qui leur convient en propre. Pour Mahaut d'Orgel, c'est le charme crédole". (Raymond Radiguet)
Crédulerie. - "L'oisiveté de certains peuples n'a d'égale que leur crédulerie". (Guizot, Le Protestantisme en Navarre)
Crinoline (sainte). - Aux jours de sainte Crinoline, les femmes, entraînées dans un tourbillon de plaisirs, vont de bal en bal et de souper en souper, vivant vite,ne restant jamais chez elles, se donnant beaucoup. Hélas, quand la fête est finie, peu d'entre elles ont l'art de bien vieillir, cet art exquis d'achever de vivre à la façon des damnes de jadis qui, sages enfin, mais toujours coquettes, abritaient pieusement, sous la dentelle, les débris de leur beauté fanée et souriaient, doucement souriaient à la jeunesse dans laquelle elles retrouvaient les figures de leurs souvenirs.
Croulettes (patins à) .- Escarpins munis de talons à ressorts et dispositif roulant, qui accélèrent les successions en régime monarchique.
Dandillero. – Jeune élégant de naissance bourgeoise, très soucieux de sa chère personne et poussant néanmoins le raffinement pervers jusqu’à faire croire, dans les salons où il fréquente, que rien ne lui importe tant que le sort des damnés de la terre.
Dégauche. - Excès pendable dans la déliquescence égalitaire. Saturnales vérolutionnaires. "Le grand plaisir du dégauché est d'entraîner dans la dégauche" (André Gide, Mes Autocritiques, encore inédit).
Démophilie. - Maladie de langueur qui atteint les principautés exsangues.Égalitière. - Couche de paille grossière destinées aux joncherie de l'intelligentsia dégauchée.
Érotaille. - Libidinage prolongé, confinant au métier. "Monsieur vécut dans l'érotaille et mourut dans le cognac". (Saint-Simon, Mémoires apocryphes)
Freudaine. – Ecart de conduite d’un genre à la fois ancillaire et scabreux, quoique sans conséquence connue.Frisqueton. - Archaïque. N'est plus usité que dans la locution: prendre un frisqueton. Chez les dames de l'entourage des reines: s'enrhumer en prenant son plaisir sur de la neige, ce qu'on appelle de nos jours un chaud-froid. "Le vieux Duc d'Alençon, averti de ce que sa femme s'estoit amourachée d'un postillon, feignit de se faire conduire aux eaux pour s'en retourner sitôt après et la surprendre. Mais elle,le devinant, s'en alla aux champs avec son amy au risque de prendre un frisquet on". (Le Nonaméron, scènes de la vie des provinces).
Funébricité. - Lubricité inspirée par le voisinage des tombeaux.
Funérailler. - Brocarder aux services funéraires.
Gobiner. - Cultiver les différences, les inégalités, les cloisonnements; redresse les barrières de classes et de races.
Groupustule. - Cellule pathogène du tissu social à laquelle est imputable partie du processus vérolutionnaire. Par extension: symptôme inflammatoire et purulent qui apparaît à la surface des sujets atteints de vérolution.
Happy Fuel. – Appellation dont s’affublent les parvenus de l’or noir. « L’arrogance des ces happy fuel nous fait sourire de commisération, nous autres, quand la véritable aristocratie ne se chauffe qu’à l’antique bûche ». (Mémoires de Monsieur du Foyer).
Informer. - Rendre les populations informes et leur ôter toute jugeote personnelle par contamination massive de l'opinion.
Kafkan. – Grand manteau d’ombre.Lacancaner. - Se dit d'une façon de clabauder en termes à la fois précieux et obscurs, dans les milieux où se distille le snobisme intellectuel.
Laitudiant. - Variété de légume qui pullule sans croître dans les démocraties avachies par le bien-être.
Lapidonder. - Redoubler de lapidité. ""En lisant les Philippiques, le roi de Macédoine disait à ses courtisans que ses cailloux l'auront fait lapidonder" (Plutarque)
Larmiller. - Garder les yeux humides afin d'en obtenir plus d'éclat séducteur. "Elle (la Reine) larmillait à tout ce qu'on lui disait, s'attachant le monde par ce procédé-là". (Perrault)
Léninifier. – Endormir par de belles paroles. Dorer la pilule. Faire passer les lendemains qui déchantent pour des lanternes vénitiennes, etc.Luthernaire. - Lucarne si étroite qu'elle ne permet pas même de deviner la couleur diu ciel. "L'Eglise réformée, outre qu'elle doit s'élever sur une roche aride et darder vers les cieux un clocher tout sec de l'allure d'une trique, sans le moindre ornement, n'aura la toiture percée que de luthernaires afin que les fidèles s'exercent à distinguer le Bien du Mal dans la ténèbre. (Calvin, De l'esprit de clocher).
Orgastule. - Cellule très rembourrée dedans quoi se laissent volontiers enfermer gentes dames et damoiseaux, tourbe rurale et patriciat tout emmêlés. "Jouxte la rivière estoit le beau jardin de plaisance; au milieu d'icelluy le beau labyrinthe et l'orgastule". (Rabelais, Comment estoit le le manoir des Thélémites)
Pierrlotter: - Grelotter sur des mers inconnues.
Pieuvrer. - 1) Violer après avoir ligoté solidement les quatre membre de la victime. "L'attirance des contraires entre si fort dans l'esprit humain qu'il n'est pas une femme, menue et gracile, qui ne rêve de pieuvrer un Hercule". (La Bruyère).
2) Sucer les pendus. "Pie III créa l'ordre religieux des filles de la Pie Oeuvre, chargées de consoler les condamnés, mais cet ordre tomba dans les relâchements que vous savez, dont nous vient le verbe pieuvrer". (Furetière)
Pinochet. - Sorte de petit hochet en forme d'épingle grâce auquel l'empereur Domitien torturait ses esclaves.
Pompoiseux. - Pompier dans le genre vaniteux, à un degré qui navre l'honnête homme. "Pour donner une idée du ton pompoiseux du prince de Kaunitz sans cesse en galanterie envers lui-même, il dit un jour à un Russe que je lui présentai: - Je vous conseille d'acheter mon portrait, Monsieur, parce que dans votre pays on sera bien aise de connaître la figure admirable d'un homme qui sait tout, s'entend à tout." (Prince de Ligne, Fragments)
Pontifidence. - Défiance particulière à la cour de Rome.
Pornicieux. - "Le Bienheureux Julien, celui-là même qui souffrit le martyre parmi les onze mille vierges, ne haïssait rien tant que les arguments pornicieux". (Voragine, La Légende dorée)
Pornoir. - Vêtement d'intérieur ajusté, ordinairement de velours noir et brodé des scènes suggestives, parfois aussi ajouré en de surprenants endroits. "Elle était coiffée à la garçonne et vêtue d'un pornoir. Deux caméristes tenues en laisse par un nègre lui suçaient les doigts pour les effiler, et ses regards alanguis tournaient autour d'un vase imité de la Grèce antique". (Elémir Bourges, Venise toxique)
Prince-sans-rire. – Monarque souriant en permanence lors même qu’il se distingue par la rigueur souveraine de sa justice et de son gouvernement. Jules Renard, dans son Journal, donne un exemple démocratique de certaine mesure typiquement prince-sans-rire : « Au moment où le condamné a la tête dans la guillotine, il devrait y avoir un silence avant que le couteau ne tombe. Un garde républicain sortirait des rangs et remettrait au bourreau une enveloppe et celui-ci dirait au condamné : « C’est ta grâce » ! » Et il ferait tomber le couteau. Ainsi le condamné mourrait dans la joie ».
Puteau. – Adolescent vierge encore, en lequel sommeille un gigolo.Putine. - "Oui, répondit Julie, avec cette grâce putine qui ne la quittait point". (Marcel Schwob, Julie jolie)
Rococotte. - Courtisane aux atours tarabiscotés, et posant à la sainte flagellée de bonbonnière, qui se rencontre parfois, encore, dans certains salons de thé de province et, à l'étrat de représentation idéale, sur la jaquette des romans à l'eau de rose se distillant dans les kiosques du Levant.
Sartrose. – Dégénérescence des articulations cérébrales de l’entendement diurne.
Sauciologie (ou sotciologie). - Procédé de réduction culinaire des conflits sociaux.
Sensuline. - Médicament qui fait palpiter les coeurs et s'animer les sens
Sodomythe. – Théorie nouvelle selon laquelle l’homoparentalité masculine serait une résurgence naturelle des pratiques arcadiennes décrites dans les mémoires perdus du Béotarque Epaminondas.Stucre. - Variété de stupre dans sa version édulcorée.
Suceau, sucelle. – Jeunes gens qui ont encore un peu d’innocence.
Théophobe. - "Elle était à ce point théophobe que de gros boutons verts lui venaient au nez si quelqu'un, devant elle, en arrivait à parler de la Vierge, voire de l'Enfant", (Marquis de Sade)Torticoler. Séduire par des oeillades répétées quelque belle fidèle se trouvant derrière soi à l'office religieux. Torticoler ne doit être confondu en aucun cas avec le verbe torticuler, qui proprement signifie forniculer à l'instar de la tortue. Ainsi dira-t-on qu'Octave voulait torticuler, et non torticoler en compagnie de Cléopâtre, sans quoi sa mort ne ferait point sens.
Turchidée. - Nom vulgaire de la Vanilla vallaca, petite fleur originaire de Transylvanie. La manière dont les pétales de la turchidée s'écartèlent sur sa tige rappelle les supplices infligés aux Infidèles par Baldus Dracula, grand Hospodar de Valachie.
Tyranarchie. - Mode de gouvernement qui consiste à tout balayer d'autorité. Après leur séjour en Macédoine, les janissaires acquis à la tyranarchie firent de Constantinople une salade.
Tolérance. – « Nous n’aimons rien de ce qui est rance ». (Monsieur de Rancé, confidences inédites).
Urbanité. - "Il y a deux formes d'urbanité: celle qui creuse les distances et celle qui les diminue" (Ninon de l'Enclos).
Valliconne. - Antonyme de monticule. Petit vallon aux ombrages imprégnés d'humidité.
Ventripotence. - Gibet tout spécialement dévolu à la pendaison des ventripotentats.
Vérolution. - Maladie honteuse affectant les sociétés. "Les meurtres juridiques, les entreprises hasardées, les choix extravagants, et surtout les guerres civiles fondées sur l'envie d'un chacun sont éminemment l'apanage des vérolutions (Joseph de Maistre, Propos de table d'un réactionnaire savoyard).
Zanzibougre. - Athlète du libidinage à l'africaine.
Image: Le billard de Bilbao, aquarelle de JLK.
-
Chroniques de Chaminadour
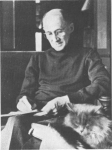

Marcel Jouhandeau pour le meilleur
On ne pouvait imaginer plus belle et bonne façon d’arracher l’œuvre de Marcel Jouhandeau à son purgatoire, un quart de siècle après la mort de ce très grand écrivain (1888-1979), qu’en publiant, en un volume, l’essentiel de l’immense chronique qu’il a consacrée, sous la forme de récits, de contes et de nouvelles, à la ville de Guéret dont il est natif et qui lui a inspiré une fresque provinciale extraordinairement vivante et savoureuse, où défilent quantité de personnages inoubliables, sous le regard mobile des trois avatars de l’auteur lui-même, à savoir Théophile dont le récit de la jeunesse inaugure le cycle, Juste Binche qui figure le Jouhandeau jeune homme et Monsieur Godeau en son aura sulfureuse de mystique pas très orthodoxe.
Pas loin du Jules Renard aux champs des Frères farouches, en beaucoup plus ample par son spectre d’observation, et proche aussi d’un Marcel Aymé peignant les familles franc-comtoises, le Marcel Jouhandeau de Chaminadour ajoute, à ces regards naturalistes de sceptiques peu portés sur la religion et ses dramaturgies, un sens du tragique et une passion des vices et des vertus qui le rapprocheraient plutôt des inépuisables curiosités proustiennes, dans un rapport tout différent au Temps il est vrai. Mais il y a du paysan chez Jouhandeau le fils du boucher, autant qu’il y a du prêtre manqué chez le fils de sa mère bien aimante et brave (leur correspondance tenue pendant trois décennies et une merveille qui fut illustrée au théâtre par Marcel Maréchal, notamment), de l’humaniste citant Augustin dans le texte et du sybarite très porté sur le péché de chair (on l’imagine se flageller voluptueusement en sortant du bordel de garçons de Madame Made où il fréquentait) jusque tard dans sa vieillesse, tiraillée entre les vacheries de la terrible Elise, son acariâtre épouse, l’éducation de Marc son fils adoptif, ses élans de perpétuel amoureux et ses téléphones particuliers à Dieu et (moins souvent) à son Fils…
Le Jouhandeau de Chaminadour est le moins encombré de narcissisme et de démonstrations mystico-érotiques, qui lassent à la lecture des pléthoriques Journaliers et de maints autres livres où la confession tourne parfois à la complaisance en dépit de pages sublimes. Le Jouhandeau de Chaminadour est essentiellement conteur, moraliste « en situation », peintre de mœurs à la Saint-Simon de bourgade, chroniqueur aux ressources comiques rares en littérature française.
La présentation des 1534 pages de ce formidable volume est le fait de Richard Millet, qui s’en acquitte en sept fortes pages enthousiastes (lesquelles ne font pas l’économie d’un bémol lié à l’antisémitisme de l’écrivain et à son malheureux voyage en Allemagne nazie en compagnie d’autre idiots utiles) dont il faut citer ceci : « Chaminadour, c’est la vie spectrale et irradiée, il y a cent ans, d’une grise petite ville peuplée d’artisans, de fonctionnaires et de ruraux. Chaminadour est un « arbre de visages ». Un bouquet d’âmes pures, un roncier d’âmes damnées, un foisonnement de faits et gestes cocasses ou tragiques, éclatants, infâmes, arrachés au secret, des esprits traqués jusque dans leur ténèbre, et des noms par dizaines, à eux seuls déclencheurs de vérités autant que de rêverie : des noms souvent extraordinaires, à eux seuls des personnages et dont l’importance faisait qu’un Balzac pouvait passer toute une journée à courir dans Paris afin d’en trouver un qui sonnât juste ».
Quels noms alors ? Les Brinchanteau et les Pincengrain, Prudence Hautechaume et Tite-le-long, Monsieur et Madame Sarciret, Ximènès Malinjoude, les soeurs Eulalie et Barberine du Parricide imaginaire, Madeleine la taciturne du Journal du coiffeur, les Jéricho-Loreille enrichis par la guerre, j’en passe et de tant d’autres…
Et ceci encore de Richard Millet qui célèbre « l’extraordinaire bonheur de lecture donné par cette œuvre : une phrase sèche, coupante, irisée, comme du verre qu’on brise au soleil, et dont l’éclat garde quelque chose de la nuit éternelle : une phrase classique tendue à l’extrême et néanmoins baroque, au sens où Ponge dit du classicisme qu’il est la corde la plus tendue du baroque; une écriture de la mesure dans l’excès et de l’excès dans l’apparente mesure, nourrie des classiques français autant que des mystiques chrétiens, de la littérature gréco-latine et de la Bible.
« Lire Jouhandeau, c’est entrer dans un chemin d’orties et de lis ; c’est aller de l’enfer au ciel et inversement, sourire et prendre en pitié ceux qui passent ou meurent dans cette comédie en réduction. Cest aussi accepter que le traique et la vérité sur soi puissent être saisi par le rire (…), le rire étant ici moins de l’humour ou un surcroît de grotesque qu’une manière de rendre les créatures à leur humanité (…) ».Marcel Jouhandeau. Chaminadour. Edition établie par Antoine Jaccottet sous la direction de Richard Millet. Ce volume contient (1921-1961): La jeunesse de Théophile - Les Pincengrain - Les Térébinthe - Prudence Hautechaume - Ximénès Malinjoude - Le parricide imaginaire - Le journal du coiffeur - Tite-le-long - Binche-Ana - Chaminadour - Chaminadour II - Le saladier - L'arbre de visages - L'Oncle Henri - Les funérailles d'Adonis - Un monde (2e partie) Cocu, pendu et content (2e artie) - Descente aux enfers. Et encore: Vie et oeuvre, illustré de photographies et de pages des albums composés et légendés par Marcel Jouhandeau. Gallimard, collection Quarto, 1534p.
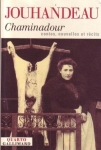
-
Michel Onfray sur un arbre perché


Thoreau le ronchon magnifique, dont on fête le bicentenaire alors que son Journal pléthorique « cartonne », est de nouveau tendance. Gourou (malgré lui) de la contre-culture américaine des années 60-70, Henry David Thoreau (1817-1862), alias « le philosophe dans les bois », pacifiste et prônant la résistance civile, individualiste, anti-raciste et écolo avant l’heure, fait figure de nouvelle star à l’heure du triomphant développement personnel. Libertaire comme moi ! s’exclame Michel Onfray, qui le récupère pour lui faire dire tout et son contraire. Jim Harrison et Annie Dillard l’ont fréquenté avec plus d’humilité et de réserve tendre, opposant la lenteur lucide de leur lecture à la précipitation et à la jactance.
Thoreau est le super-héros de la philosophie dans les bois. Ce n’est pas moi qui le claironne, mais Michel Onfray qui est lui-même le super-héros de la philo dans le bocage.

À en croire le grappilleur de la pensée pour tous, Thoreau était plus sympa avec les loutres qu’avec ses sœurs et frères humains, car il pensait comme un Indien. D’une façon à peu près analogue, Michel Onfray est plus sympa avec la culture indienne ou tzigane qu’avec vingt siècles de civilisation judéo-chrétienne, mais son rêve de prendre des leçons du castor ou du rossignol ne l’empêche pas d’être aussi pesamment sermonnant que Thoreau l’eût été si on l’avait trainé sur un plateau de télé, à quoi Michel Onfray -la chair est faible-, consent et plus souvent qu’à son tour.
Mais pourquoi donc associer les noms de Henry David Thoreau (qui ne se prononce pas comme Taureau ni comme Sorrow, mais un peu entre les deux) et de Michel Onfray ?
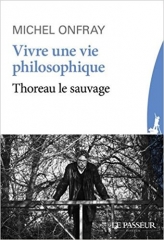
Pour la simple raison que celui-ci vient de consacrer son huitante-quatrième livre à celui-là, intitulé Vivre une vie philosophique et sous-intitulé Thoreau le sauvage, avec photo de Michel Onfray en couverture, posant modestement (!) dans un fouillis arboré évoquant une forêt de studio.
On a bien lu: huitante-quatre ouvrages au compteur du super-héros de la philosophie-pour-tous, distillée tous les lundis à l’université populaire de Caen devant plus de mille personnes, et rien d’étonnant alors que ce vulgarisateur stakhanoviste, prêcheur mégalo se posant en opposant démago du prêchi-prêcha, entonne son hymne à Thoreau sur une envolée à la gloire des grands hommes («tu en seras un, mon fils», espère-t-il sans doute que son papa ouvrier agricole lui murmure du haut de son nuage) et de la volonté de puissance, pour mieux célébrer ensuite l’humble bouleau qui fait son job et la preste alouette, le doux murmure du ruisseau sous la fougère et la désobéissance civile dans les allées du pouvoir.
Mode binaire et dégomme
«Vivre la philosophie» au lieu de lire platement Platon ou de citer Lao-tseu dans les cocktails ? On est pour ! Comme disait en effet Lao-tseu, il n’y a que les imbéciles qui citent Lao-tseu! Ainsi vous qui citez Deleuze pour faire bien, vous ne vivez pas la philosophie, tandis que moi, je vous enjoins de la vivre comme Thoreau la vivait, nous dit en somme Michel Onfray, mais qu’en est-il de sa crédibilité ?
«J’estime un philosophe dans la mesure où il est capable de donner un exemple», écrivait Nietzsche dans ses Considérations inactuelles, et c’est Onfray qui le cite en exergue de Vivre une vie philosophique. Or le même Onfray, à propos de Thoreau, affirme que «la corporation philosophante ne saurait apprécier un homme qui a écrit un jour que nous avions pléthore de professeurs de philosophie, mais nulle part des philosophes», tâchant ainsi de nous faire oublier qu’il est lui-même prof de philo, de même que ses anathèmes contre les médias ne l’empêchent pas de recourir à ceux-ci à tout moment.

Imagine-t-on le «philosophe dans les bois» se pointer chez Ruquier ? Et le nouvel apôtre de la décroissance et de la frugalité, inspiré par Thoreau, est-il conséquent lorsqu’il exige 2000 euros pour participer à une émission de télé ? Ah mais trêve de mesquinerie :qui le lui reprocherait, alors qu’il assure le show autant que les bateleurs qui l’invitent? En revanche, qui verra là l’exemple d’une vie philosophique à la Thoreau?
À vrai dire, le pire n’est pas dans ces contradictions, comme on en trouve chez tout un chacun, mais plutôt dans la façon systématique de Michel Onfray de dénigrer, voire d’exclure, selon le système binaire Bonus/Malus, tout ce qui déroge à sa simplification «libertaire». Bel exemple qui renvoie à la plaie des réseaux sociaux sur la distinction de ce qui est cool ou pas, du «bon bord» ou pas, émoticônes à l’appui.
Cette façon de dégommer, on la constate ainsi dans le pavé amphigourique de Cosmos, quand Michel Onfray exalte la merveilleuse culture tzigane, si proche de la nature et si «libertaire» sans le savoir, si cool en somme, au détriment de vingt siècle d’oppression judéo-chrétienne rabat-joie. De fait, le Dieu du judéo-christianisme est exclusivement «jaloux et vengeur, punisseur et méchant», selon Michel Onfray, tandis que «les Indiens les plus frustes savent beaucoup plus de choses que les philosophes européens les plus aguerris».
Il est certes vrai que Thoreau montrait une véritable passion pour la culture indienne, mais là encore Onfray déraille quand il conclut : « Thoreau invite donc à laisser tomber Platon & Aristote, Cicéron & Sénèque pour leur préférer ces antiquités indiennes », alors que le philosophe dans les bois célèbre à tout moment les bienfaits de la lecture, Anciens compris, avec la même attention qu’il voue à ses plants de «fiers haricots».
 Jim Harrison et Annie Dillard, après Bob Dylan et les beatniks
Jim Harrison et Annie Dillard, après Bob Dylan et les beatniksÀ ce propos, Jim Harrison, dans la chaleureuse préface de la traduction française de Walden, remarque que «ceux qui se réfugient dans le monde naturel croient malin d’endosser une panoplie anti-intellectuelle, une pose que Thoreau n’a jamais eu l’intention d’adopter. Pour lui, la vie de l’esprit était aussi naturelle qu’un arbre».
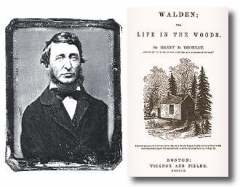 La lecture de Walden, chef-d’œuvre homologué de Thoreau, est souvent un bonheur primesautier, mais pas que. Plus précisément, il s’agit d’une sorte de montage de textes épars, retravaillés en sept versions successives, relevant à la fois de l’autobiographie et du carnet de naturaliste, de la méditation poétique et du commentaire social ou politique, dont les têtes de chapitres (Economie, Lire, Bruits, Solitude, Visiteurs, Le champ de haricots, Le village, Les lacs, Des lois plus élevées, Voisins animaux, etc.) annoncent la couleur.
La lecture de Walden, chef-d’œuvre homologué de Thoreau, est souvent un bonheur primesautier, mais pas que. Plus précisément, il s’agit d’une sorte de montage de textes épars, retravaillés en sept versions successives, relevant à la fois de l’autobiographie et du carnet de naturaliste, de la méditation poétique et du commentaire social ou politique, dont les têtes de chapitres (Economie, Lire, Bruits, Solitude, Visiteurs, Le champ de haricots, Le village, Les lacs, Des lois plus élevées, Voisins animaux, etc.) annoncent la couleur. De façon plus spontanée, le Journal de Thoreau, à peine moins surabondant (7.000 pages) que celui de notre cher Amiel - super-héros de l’introspection sur 12.000 pages -, est parfois aussi rasant que celui-ci, en son puritanisme moralisant, qu’éclairant sur la vie de l’auteur et de son époque ; surtout attachant par ses rêveries ou ses épiphanies quotidiennes, son observation rapprochée de la nature ou l’expression de sa révolte combien justifiée.
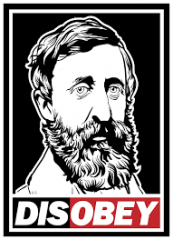
On sait, aussi bien, que Thoreau, fils spirituel de Ralph Waldo Emerson, grande figure du transcendantalisme américain, développa des idées explosives de désobéissance civile qui allaient marquer un Gandhi ou un Martin Luther King, notamment. De même refusa-t-il de payer ses impôts par manière de protestation contre l’invasion du Mexique, et milita-t-il pour l’abolition de l’esclavage jusqu’à défendre la violence politique dans son Plaidoyer pour John Brown.
Ceci rappelé, comme s’y emploie d’ailleurs très bien Michel Onfray, Thoreau n’est lui-même ni un citoyen très engagé ni moins encore un activiste. Toujours resté en marge de la société, assez mal vu de ses concitoyens, vivant de peu, plus ou moins isolé durant deux ans dans une cabane, marchant beaucoup et contemplant la nature à n’en plus finir, c’est essentiellement un rêveur et un poète et, de loin en loin, un aussi merveilleux écrivain qu’Amiel.
Pas étonnant que l’opposant radical ait été redécouvert par les contestataires américains des sixties choqué par la guerre au Vietnam et luttant pour les droits civiques. Mais une influence plus profonde, à caractère poétique et spirituel, aura marqué des artistes et des écrivains tels Bob Dylan ou Jack Kerouac, et Jim Harrison rappelle combien Thoreau a compté en son enfance de fils d’agent agricole du gouvernement confronté à la condition des paysans « esclaves », selon l’expression de Thoreau lui-même, autant que par les hymnes de celui-ci à la nature.

Et l’on retrouve l’inspiration profonde de l’auteur de Walden dans l’œuvre géniale d’Annie Dillard, qui lui a consacré sa thèse d’université et dont les livres développent d’incomparables méditations « devant la nature », comme dans Apprendre à parler à une pierre tout récemment réédité.
Une vision réductrice
C’est cependant le modèle de celui qu’il appelle un «Diogène de l’ère industrielle» que privilégie Michel Onfray le libertaire, tirant de l’exemple de Thoreau une première série de «paroles d’Indien» édifiantes au possible, avant d’établir un catalogue de règles de vie dont l’appel à la simplicité relève bonnement du simplisme.
À l’image du philosophe dans les bois, sœurs et frères, simplifiez donc le logement, simplifiez le vêtement, simplifiez l’alimentation, simplifiez vos activités, simplifiez vos lectures - lisez peu de livres, mais les bons, «qui sont ceux qui contribuent au projet d’édification de soi», etc.
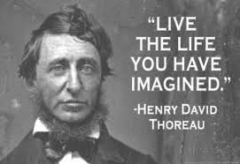
La «vie philosophique» selon Thoreau le sauvage consistera donc en l’application d’une sorte de nouveau catéchisme, pas loin de préceptes d’un développement personnel à la sauce gauchiste, qui me semble la façon la plus conventionnelle d’aborder une œuvre aussi dense et ouverte, à mille chemins de traverse, que le grand livre de la nature ou la Bibliothèque universelle multiple et chatoyante.
Faut-il jeter le livre de Michel Onfray avec l’eau de son bain moussant ? Pas forcément, vu qu’on y trouve aussi des pages intéressantes, voire caractéristiques des confusions de notre drôle d’époque.

Par exemple quand il cite l’éloge funèbre peu complaisant d’Emerson, mentor de Thoreau, devant la tombe de son disciple : «Il y avait dans sa nature quelque chose de militaire et d’irréductible, toujours viril, toujours apte, mais tendre rarement, comme s’il ne se sentait bien lui-même qu’en opposition». Or cette dernière phrase pourrait convenir aussi à Onfray, qui ne trouve rien à redire, humainement parlant, au fait qu’après avoir provoqué l’incendie des terres d’un voisin, Thoreau contemple le feu du haut d’un monticule sans aucune empathie pour le paysan dont il a dévasté les terres. «La beauté du spectacle, son caractère sublime, voilà qui compte plus, pour lui, que les dommages et les dégâts». Parole d’Indien ?
Il y a, finalement, comme une persistante niaiserie chez Michel Onfray, ado romantique prolongé, quand il écrit : «Thoreau grimpe en haut des arbres : c’est là qu’il voit bien et mieux le monde, de là qu’il comprend ce qu’aucun livre ne permet de comprendre. Au sommet des frondaisons, loin du monde et des gens, loin des livres et des bibliothèques, il est vraiment « en sympathie avec l’intelligence».
Or, entre seize et vingt ans, nous aussi nous montions «en haut des arbres» pour mieux fuir les « chiens de garde » de la philosophie académique, ces poussiéreux idéalistes honnis par le communiste Paul Nizan dans son fameux essai éponyme. Mais dire, aujourd’hui, que c’est Michel Onfray qui recommande à Emmanuel Macron, disciple lui-même de Paul Ricoeur, de grandir !
«Vivre une vie philosophique» en s’inspirant de «Thoreau le sauvage» ? Et pourquoi pas, mais à condition de pratiquer à notre tour l’opposition aux simplifications abusives et au n’importe quoi pseudo-philosophique...
Michel Onfray. Vivre une vie philosophique ; Thoreau le sauvage, Le Passeur, 105p.
Henry David Thoreau. Walden, Traduit de l’américain par Brice Matthieussent. Préface de Jim Harrison. Le Mot et le reste, 381p.
La désobéissance civile. Gallmeister, 2017.
Le Journal de Thoreau, à paraître en quinze volumes, est accessible en quatre premiers tomes, aux éditions Finirude.
Annie Dillard. Apprendre à parler à une pierre. Traduit par Béatrice Durand. Christian Bourgois, 2017.
Cette chronique a paru sur le média indocile Bon Pour la Tête, avec ce dessin de Matthias Rihs.

-
La France de Marcel Aymé
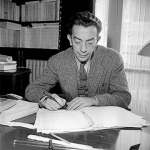
J’ai conservé comme une relique la liste de lectures conseillées de Marcel Aymé que Pierre Gripari m’avait griffonnée dans le métro lors de nos premières rencontres de 1974, et c’est maintenant en connaissance de cause, après avoir à peu près tout lu de cette oeuvre à la fois connue et méconnue, que je puis apprécier, à sa valeur, le travail de défense et d’illustration auquel s’est livré Michel Lécureur dans La comédie humaine de Marcel Aymé.
D’entrée de jeu, l’auteur précise l’orientation de son essai en affirmant que le rire, si souvent déclenché par Marcel Aymé, n’est jamais d’un amuseur complaisant mais d’un observateur ironique dont les moeurs du temps et les faits sociaux ou historiques les plus significatifs constituent, comme chez Molière, le matériau de base. “En fait, écrit Lécureur, c’est tout un siècle d’histoire que Marcel Aymé met en scène, du Second Empire (La jument verte) aux débuts de la Ve République (Les tiroirs de l’inconnu). Et de montrer comment, des petits détails de la vie quotidienne aux chamboulements qui ont transformé la société de ce siècle, l’oeuvre de Marcel Aymé déploie toute une fresque où le moraliste le dispute au conteur.
Issu de la petite bourgeoisie provinciale franc-comtoise, Marcel Aymé est resté proche de la terre en dépit de son installation parisienne, mais ce qui le distingue à la fois des écrivains du terroir autant que des romanciers bourgeois, ou antibourgeois, tient à son point de vue détaché de toute idéologie religieuse ou politique et au mélange d’objectivité et de sympathie douce-amère avec lequel il observe ses semblables. A l’opposé du partisan ou de l’homme de foi, il apparaît comme “un être de bonté et de douceur qui souffre de ne pas observer un monde à son image”, et nul hasard enfin si ce franc-tireur, qui a invité un Président de la République le menaçant de la Légion d’honneur à se la “carrer dans le train”, s’est montré si gentiment attentif envers les animaux et les enfants, et tellement indulgent pour les fille perdues et les pauvres hères. -
Impressions d'un lecteur

Entretien de Serge Molla avec JLK
Si Lausanne ne fut jamais un haut-lieu de littérature, la capitale vaudoise n’en a pas moins été, du Moyen Age à nos jours, le cadre d’une constante activité du point de vue de l’édition et de la vie intellectuelle et littéraire, avec des échappées sur l’Europe entière.
- Vous publiez un essai intitulé Impressions d’un lecteur à Lausanne. Serait-ce à dire que vos impressions sont liées précisément à cette ville ? En outre, vous avez donné pour sous-titre à vos pages « Une seconde jeunesse », pourriez-vous l’expliciter ?
- L’ancrage lausannois de ce livre, dont j’ai passablement débordé, est essentiellement lié au projet de la collection dans lequel il paraît, intitulée Lausanne, scène culturelle, et qui visait, dans l’esprit de ses initiateurs (notamment Marie-Claude Jequier et René Zahnd) à documenter l’effervescence de la culture à Lausanne depuis la fin des années soixante. Mes impressions de lecteur sont de partout, mais je savais trouver à Lausanne, et surtout au XXe siècle, une matière littéraire abondante et de qualité. Le titre est un clin d’œil aux Impressions d’un passant à Lausanne de Charles-Albert Cingria, qui a été l’un de mes premiers « maîtres » à sentir et à écrire, et qui a évoqué Lausanne comme personne alors qu’il ne faisait qu’y passer. Quant à la « seconde jeunesse », elle désigne précisément, après ce qu’on pourrait dire la naissance d’une littérature romande consciente d’elle-même, autour des Cahiers Vaudois fondés vers 1914 par Ramuz, Budry, Gilliard et quelques autres, le deuxième souffle qu’ont marqué, autour de Bertil Galland, d’une part, et de Vladimir Dimitrijevic, fondateur de L’Age d’Homme, d’autre part, les foisonnantes dernières décennies du XXe siècle, jusqu’aujourd’hui.
- Existe-il véritablement, à vos yeux, une littérature romande, ou seulement une littérature en Romandie ?
- Quand on veut esquiver le débat, on se contente de dire qu’ « il y a de la littérature en Suisse romande », mais je suis de plus en plus convaincu que la littérature de ce pays n’est en rien un « bricolage identitaire », même s’il est réducteur ou stérilisant de la typer comme elle l’a été à l’enseigne d’une sorte de spiritualisme esthétisant. Je me suis souvent élevé, pour ma part, contre la notion d’« âme romande », qu’Etienne Barilier a raillée lui aussi dans un pamphlet au titre explicite de Soyons médiocres. Cela étant, il y a bel et bien une complexion romande, absolument distincte et souvent incomprise de l’esprit français, que je me suis attaché à décrire dans la première partie de ce livre. Cette idiosyncrasie composite est liée autant à nos sources protestantes qu’à notre façon de vivre la latinité, à l’influence du romantisme, au nomadisme de nos pères, à notre enracinement terrien, à nos pratiques de la démocratie – toutes choses distinctes du goût français qui nous guide pourtant lui aussi…
- Quel est aux yeux du lecteur l’influence du protestantisme sur la littérature romande ? Hier ? Aujourd’hui ? Ne faut-il le percevoir que d’un point de vue moral, jusqu’à ne le considérer qu’à travers l’adjectif « calviniste » ?
- Elle est encore considérable, jusque chez ceux qui s’en croient « libérés », n’y voyant souvent qu’un poids ou qu’une entrave. Issu d’une génération qui n’a justement vu du « calvinisme » que la contrainte morale, de type puritain, et qui a fait de la transgression une règle, j’ai moi aussi réagi contre cette « oppression », sans me rendre compte que c’était encore une forme de protestantisme que de s’y opposer, sans voir non plus le ferment puissant du puritanisme en littérature, comme l’illustre un Jacques Chessex. J’ai bien tenté, dans mes jeunes années, de me rapprocher du catholicisme, mais je me sens essentiellement un protestant, à savoir un individualiste peu soucieux des dogmes et guère attiré par la magie, en phase avec la nature, qui tutoie Dieu et le Christ et dont la religion relève de l’éthique et de la poésie, voire de la mystique contemplative, plus que de l’Eglise, de ses rites et de ses liens. Or cette complexion morale, de Viret à Vinet et d’Amiel à Philippe Jaccottet, me paraît caractéristique de la littérature romande.
- Que représente pour vous la lecture, aujourd’hui où de plus en plus d’ouvrages sont édités, qu’au même moment ferment de nombreuses librairies et que l’avenir de nombreuses maisons d’édition en Suisse romande est incertain ?
- Quatre questions en une ! Mais je dirai d’abord que la lecture est multiple, et que l’essentiel tient à instaurer ou restaurer un lien vivant avec le monde, les autres et soi-même. Dès qu’il y a une conscience éveillée, une attention, une lecture du monde au sens le plus large, je dirais que la moitié du chemin est faite. La seconde moitié passe par la relation à l’autre, le partage et l’échange. De lecteur, je deviens libraire ou éditeur en transmettant ce que j’ai reçu. C’est comme une respiration : recevoir et donner, lire et en parler ou en écrire. C’est comme l’amour aussi, et c’est rare. La Qualité est rare. Dans un monde courant de plus en plus derrière le Chiffre, qui est plutôt de l’ordre de la Quantité, la Qualité en pâtit souvent, mais pas toujours. Je ne suis pas contre le commerce du livre, si celui-ci me ramène au foyer intime de la Qualité. Reste à discerner celle-ci et à lui permettre de survivre, qui implique alors une politique - et là je deviens pessimiste…
- Vous dirigez une revue littéraire intitulée Le Passe-Muraille ? Quelles murailles sont aujourd’hui à passer, voire à faire tomber ?
- Muraille de la Masse et du Chiffre. Muraille de la saturation. Muraille de l’indifférence et du blasement. Muraille du conformisme et de l’agitation grégaire. Muraille des idéologies et des préjugés. Muraille de la stupidité et de la vulgarité. L’inventaire est loin d’être exhaustif. Passons à travers…
- Vous êtes critique littéraire depuis bien des années et probablement l’un des plus libres, aussi comment jugez-vous l’état de santé de la littérature francophone ? Et secondement de la littérature publiée en Suisse romande ? Et la critique précisément ?
- J’ai de la peine à donner des notes par « cantons ». La francophonie littéraire est un archipel littérairement foisonnant, mais je suis de moins en moins porté à la séparer de la « littérature-monde », pour citer une nouvelle notion intéressante lancée par Michel Le Bris et Jean Rouaud. En ce qui concerne la périphérie helvétique francophone, j’y vois une quantité d’œuvres fortes ou originales, mais complètement inaperçues de la « centrale » française. Voyez Georges Haldas, Maurice Chappaz, Alexandre Voisard, Jean-Marc Lovay, Corinne Desarzens, Anne-Lise Grobéty, bien d’autres : inexistants à Paris ! Dans les grandes largeurs, tous pays confondus, je constate un évident étiolement de la littérature européenne, dont la relève est plus encore sporadique. Quant à la critique en Suisse romande, je me contenterai de rappeler qu’il y a trente ans, lorsqu’un livre d’un auteur paraissait, il avait des chances d’être lu et commenté par une quinzaine de critiques suivant fidèlement la production. Actuellement, ce chiffre est tombé à moins du tiers. L’attention réelle à la littérature romande est devenue rare, tant d’ailleurs chez les libraires que chez les critiques, sans parler des enseignants…
- Parallèlement à votre engagement de critique, vous écrivez vous-même (de la fiction), une chance ou un handicap ?
- Les deux activités relèvent de la même démarche, mais à des niveaux d’implication très différents. Le critique travaille à l’explication, dans un langage visant à l’immédiate communication. L’écrivain, romancier ou poète, s’approprie pour ainsi dire le langage et le travaille, le malaxe, le rêve, le féconde en s’engageant plus entièrement dans l’écriture. Du point de vue de l’approche critique, l’engagement dans l’écriture peut être un handicap (« mon verbe contre le tien ») comme il peut être une chance : d’apprécier l’ouvrage de l’intérieur, en humble ouvrier ou en maître artisan, mais non en juge ou en pion. Les meilleurs critiques littéraires sont souvent des écrivains, mais ceux-ci font parfois de piètres critiques. Actuellement, la critique cède hélas le pas au bavardage ou à la glose pseudo-scientifique, en Suisse romande comme partout ailleurs. Enfin, je dirais qu’être critique ne vous garantit pas, si vous êtes aussi écrivain, la bienveillance de vos pairs : bien au contraire…
- Si vous recommandiez trois ouvrages récents, un roman, un recueil de poèmes et un essai, quels seraient-ils ?
- Je ne saurais vous recommander moins de trois romans (Lignes de faille de Nancy Huston, Fracas de Pascale Kramer et La corde de mi d’Anne-Lise Grobéty), trois recueils de poèmes (Partie de neige de Paul Celan, La part des anges de Jean-Luc Sarré et Partition rouge – anthologie des poèmes et chants des Indiens d’Amérique du Nord) et trois essais (La littérature en péril de Tzvetan Todorov, La construction de soi d’Alexandre Jollien et Tous les enfants sauf un de Philippe Forest) mais je vous en proposerai trois fois trois autres demain…Propos recueillis par Serge Molla
 Jean-Louis KUFFER. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campoche, 2007, 223p.
Jean-Louis KUFFER. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campoche, 2007, 223p.Cet entretien a paru dans Le Protestant, No 5, mai 2007.
-
Le cimetière
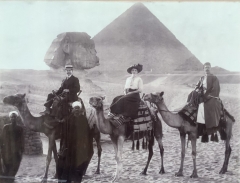 Dans le foulée de Julien Green...Dans Adrienne Mesurat, le fameux roman de Julien Green, le cimetière représente la galerie de photos de famille dont les défunts font peser leurs regards sur les vivants. Et chacun de nous de l'invoquer à sa façon...Voici donc, dans le haut escalier de la Désirade, en photos bleutées et sépia, mes grands-parents maternels sur leurs chameaux devant les pyramides égyptiennes, au temps où ils espéraient reprendre là-bas un hôtel avec notre grand père paternel, ou voilà notre grand-mère Agatha au fin vieux visage harmonieusement ridé, mon grand-père Heinrich dont j’ai tiré le personnage du Grossvater dans mon deuxième livre , des vieux comme on disait alors sans se gêner de parler d’ «asiles de vieux » et non pas d’ «établissements médico-sociaux », des personnes qui même avant notre âge actuel avaient l’air bien plus vieilles que nous aujourd'huiLe cimetière est mon surmoi, ma conscience et mon tribunal moral que je défie tous les jours, mais il est là. Notre Grossvater lisait sa Bible tous les soirs et parlait sept langues, nous assommait de ses litanies édifiantes (« Une cigarette tue un lapin, dix cigarettes tuent un cheval », etc.), se faisait traiter comme un grand enfant maladroit par sa digne épouse et ses deux filles célibataires dont l’une avait un bec-de-lièvre (la moralisante Tante Greta), la Grossmutter tricotait pour les missions et tous les miséreux des hauts de Lucerne la tenaient pour une quasi sainte, etc.
Dans le foulée de Julien Green...Dans Adrienne Mesurat, le fameux roman de Julien Green, le cimetière représente la galerie de photos de famille dont les défunts font peser leurs regards sur les vivants. Et chacun de nous de l'invoquer à sa façon...Voici donc, dans le haut escalier de la Désirade, en photos bleutées et sépia, mes grands-parents maternels sur leurs chameaux devant les pyramides égyptiennes, au temps où ils espéraient reprendre là-bas un hôtel avec notre grand père paternel, ou voilà notre grand-mère Agatha au fin vieux visage harmonieusement ridé, mon grand-père Heinrich dont j’ai tiré le personnage du Grossvater dans mon deuxième livre , des vieux comme on disait alors sans se gêner de parler d’ «asiles de vieux » et non pas d’ «établissements médico-sociaux », des personnes qui même avant notre âge actuel avaient l’air bien plus vieilles que nous aujourd'huiLe cimetière est mon surmoi, ma conscience et mon tribunal moral que je défie tous les jours, mais il est là. Notre Grossvater lisait sa Bible tous les soirs et parlait sept langues, nous assommait de ses litanies édifiantes (« Une cigarette tue un lapin, dix cigarettes tuent un cheval », etc.), se faisait traiter comme un grand enfant maladroit par sa digne épouse et ses deux filles célibataires dont l’une avait un bec-de-lièvre (la moralisante Tante Greta), la Grossmutter tricotait pour les missions et tous les miséreux des hauts de Lucerne la tenaient pour une quasi sainte, etc.
-
Lumières du coeur
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce 10 juillet . – Il faisait tout gris ce matin dans le vert exultant de nos hautes prairies, et la fraîcheur m’a réjoui autant que la lumière dans les mots que j’ai trouvée dans le recueil de poèmes d’Estives que le compère Alain Allemand, féru de Vialatte et de poésie, m’a envoyé il y a quelque temps; et tout suite j'y ai grappillé en douce «le simple du sourire» et «le doux de quelques regrets », le « prisme paillette du déjà-vu » où « l’exquis est grand ouvert », alors que « parfois le temps a la cheville fine », quelque chose de sereinement naturel à la Jaccottet quand «le ciel lave – là-bas - / une nichée de lointains», tandis que « l’embellie rossignole - hors d'attente – maintient l’orée précoce »...Toute de lumière et de légèreté précieuse, cette suite d’Estives, comme on appelle chez nous les vacances travailleuses de nos armaillis à l’alpage (titre éponyme, par ailleurs, d’un récit de Blaise Hofmann) m’a tout de suite parlé de près en renvoyant très loin les arguties rhétoriques de Messieurs Jordan Mélanchon et Jean-Luc Bardella, me prouvant une fois de plus que le Verbe poétique échappe à la jactance ou au discours utilitaire du Politique...
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce 10 juillet . – Il faisait tout gris ce matin dans le vert exultant de nos hautes prairies, et la fraîcheur m’a réjoui autant que la lumière dans les mots que j’ai trouvée dans le recueil de poèmes d’Estives que le compère Alain Allemand, féru de Vialatte et de poésie, m’a envoyé il y a quelque temps; et tout suite j'y ai grappillé en douce «le simple du sourire» et «le doux de quelques regrets », le « prisme paillette du déjà-vu » où « l’exquis est grand ouvert », alors que « parfois le temps a la cheville fine », quelque chose de sereinement naturel à la Jaccottet quand «le ciel lave – là-bas - / une nichée de lointains», tandis que « l’embellie rossignole - hors d'attente – maintient l’orée précoce »...Toute de lumière et de légèreté précieuse, cette suite d’Estives, comme on appelle chez nous les vacances travailleuses de nos armaillis à l’alpage (titre éponyme, par ailleurs, d’un récit de Blaise Hofmann) m’a tout de suite parlé de près en renvoyant très loin les arguties rhétoriques de Messieurs Jordan Mélanchon et Jean-Luc Bardella, me prouvant une fois de plus que le Verbe poétique échappe à la jactance ou au discours utilitaire du Politique... Sur quoi j’ai retrouvé Georges Nivat dans la revue Kometa que m’a fait découvrir la Dame aux livres en sa boutique de L’Imprudence, vieux compagnon de route de la grande époque de L’Âge d’Homme dont il fut une des figures majeures, perdu de vue depuis tant d'années et s’attachant ici, véritable révélation pour moi, à la présentation d’un philosophe mythique du XVIIIe ukrainien du nom de Grigori Skovoroda (1722-1794), ignoré de la plupart de nous autres et vénéré dans son pays.DANS LES BOIS. – La figure du philosophe errant avec sa flûte, ses poèmes et sa gourde d’eau claire, savant et sage jaloux de son indépendance - il a envoyé promener la grande Catherine de Russie qui l’avait convoqué pour le décorer d'autorité - m’a tout de suite fait penser, dans l’évocation qu’en fait Georges Nivat, au penseur libertaire Thoreau dans sa cabane en forêt et à l’humaniste Thomas Platter descendu de nos vallées perchées pour sillonner l’Europe en homme de bonne volonté, et je ne suis guère étonné d’apprendre que Tolstoï lui-même s'est réclamé de ce sage prônant la «philosophie du cœur», me rappelant alors ce jour où, devant me présenter à mon premier examen universitaire, dont la matière était l’économie politique, à laquelle je ne comprenais rien et n’avait pas fait le moindre effort pour m’y préparer – au point qu’il était absolumet inimaginable que je comparaisse devant le vénérable professeur S.- j’ai quitté, ce matin-là, la maison de mes bons parents et, au lieu de me diriger vers la ville, ai bifurqué en direction des bois où, au bord de la rivière dite Chandelard, au pied d’un grand bloc erratique baptisé Rocher du Diable, je passai ma matinée d’examen à lire Je ne joue plus du romancier croate Miroslav Karleja...Or l’étudiant Skovoroda était d’un autre sérieux que le petit fumiste de dix-huit ans que j’étais, ayant fait de sérieuses études supérieures lui permettant de lire la Bible en hébreu et de rédiger ses propres textes en latin ou en vieux slave…
Sur quoi j’ai retrouvé Georges Nivat dans la revue Kometa que m’a fait découvrir la Dame aux livres en sa boutique de L’Imprudence, vieux compagnon de route de la grande époque de L’Âge d’Homme dont il fut une des figures majeures, perdu de vue depuis tant d'années et s’attachant ici, véritable révélation pour moi, à la présentation d’un philosophe mythique du XVIIIe ukrainien du nom de Grigori Skovoroda (1722-1794), ignoré de la plupart de nous autres et vénéré dans son pays.DANS LES BOIS. – La figure du philosophe errant avec sa flûte, ses poèmes et sa gourde d’eau claire, savant et sage jaloux de son indépendance - il a envoyé promener la grande Catherine de Russie qui l’avait convoqué pour le décorer d'autorité - m’a tout de suite fait penser, dans l’évocation qu’en fait Georges Nivat, au penseur libertaire Thoreau dans sa cabane en forêt et à l’humaniste Thomas Platter descendu de nos vallées perchées pour sillonner l’Europe en homme de bonne volonté, et je ne suis guère étonné d’apprendre que Tolstoï lui-même s'est réclamé de ce sage prônant la «philosophie du cœur», me rappelant alors ce jour où, devant me présenter à mon premier examen universitaire, dont la matière était l’économie politique, à laquelle je ne comprenais rien et n’avait pas fait le moindre effort pour m’y préparer – au point qu’il était absolumet inimaginable que je comparaisse devant le vénérable professeur S.- j’ai quitté, ce matin-là, la maison de mes bons parents et, au lieu de me diriger vers la ville, ai bifurqué en direction des bois où, au bord de la rivière dite Chandelard, au pied d’un grand bloc erratique baptisé Rocher du Diable, je passai ma matinée d’examen à lire Je ne joue plus du romancier croate Miroslav Karleja...Or l’étudiant Skovoroda était d’un autre sérieux que le petit fumiste de dix-huit ans que j’étais, ayant fait de sérieuses études supérieures lui permettant de lire la Bible en hébreu et de rédiger ses propres textes en latin ou en vieux slave… Bref, il y un jour encore je ne savais RIEN de Skovoroda, dont le musée a été bombardé en 2022 par les Russes, sa statue ayant été épargnée à ce que précise Georges Nivat, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre me dis-je après avoir pris acte, hier soir surYoutube, du fait que 10.000 soldats ukrainiens meurent chaque semaine dans la guerre fratricide qui a déjà couté la vie à 500.000 Ukrainiens, à quoi s’ajoute plus d’un million de blessés – contre 50.000 morts russes morts eux aussi pour rien à la satisfaction des va-t-en-guerre maudits, des marchands d'armes et de leurs laquais cravatés...
Bref, il y un jour encore je ne savais RIEN de Skovoroda, dont le musée a été bombardé en 2022 par les Russes, sa statue ayant été épargnée à ce que précise Georges Nivat, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre me dis-je après avoir pris acte, hier soir surYoutube, du fait que 10.000 soldats ukrainiens meurent chaque semaine dans la guerre fratricide qui a déjà couté la vie à 500.000 Ukrainiens, à quoi s’ajoute plus d’un million de blessés – contre 50.000 morts russes morts eux aussi pour rien à la satisfaction des va-t-en-guerre maudits, des marchands d'armes et de leurs laquais cravatés... -
Le sel des jours
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2020)DIVINES IDÉES. Ce matin clair me vient l’idée de couper court à toute forme d’amiélisation consistant à noter chaque jour ce qui se passe et ce qui passe ou ne passe pas, avec force détails privés et autres notations météorologiques, comment tout s’enfuit ou perdure, se répète ou pas, la marquise sortie tout à l’heure et moi qui la guette à la fenêtre en me grattant l’omphale - assez de ces selfies à n’en plus finir et de cette littérature tautologique de photomaton, plutôt viser le pot commun et la transmutation des métaux, foin d’idéologie rassurante et tout pour les divines idées… (À La Désirade, ce lundi 8 juin)DU VAGUE ET DES SENTIMENTS PRÉCIS. - À ses camarades qui s’invectivaient au nom d’idéologies opposées, les latinistes maurrassiens que figuraient les frères Cingria contre les germanistes fascisants à la Gonzague de Reynold et consorts, Ramuz, invoquant ce qui au contraire rapprochait les uns et les autres, à savoir la sensibilité littéraire et le gout du beau ou du vrai, affirmait que le monde des assertions idéologiquees était celui du vague, pulsions et opinions mêlées en nuages et vapeurs, alors que celui des sentiments imposait naturellement la clarté de l’analyse et la précision des nuances ; et c’est exactement ce que j’observe à tout moment, à l’heure actuelle des théories les plus fumeuses suscitées par la pandémie, où les uns et les autres criant au complot de la partie adverse en appelant spécialistes et scientifiques à la rescousse, lesquels experts brandissent autant d’arguments pour ou contre ; et l’on pourrait étendre l’observation à l’analyse critique des œuvres littéraires ou artistiques, souvent bien plus précise et pénétrante quand elle relève de l’intuition et de la sensibiité, du goût et des associations comparatives, que sous couvert d’autorité supposée scientifique réduisant les objets à la textualité du texte eou à la matérialité du matériau plastique, etc.DE L’ENCHANTEMENT. – Il n’y a pas de formule chimique ni d’équation physique de la joie, me dis-je en écoutant, sur Youtube, six jeunes chanteurs de la compagnie King’singers interpréter a cappella cet extrait de la liturgie de saint Jean de Nicolaï Kedrov (1871-1940) d’une puzreté de ligne mélodique et d’une densité polyphonique à tirer des larmes à une statue de pierre les yeux fermés. Le bond et les rebonds de nos petits lascars d’un et trois ans dans l’herbe, sur la terrasse ensoleillée où leurs parents leur ont installé un joli toboggan et une caisse à sable, ou la lecture de quelques pages alertes de Colette, de Roussel ou d’Audiberti, me semble ressortir à la même nature « divine » que je ressens à vrai dire sans guillemets en mon tréfonds.ÉCOUTER LIRE. – J’ai « lu » des centaines de pages de la Recherche proustienne, ces dernières années, en roulant seul à bord de notre Honda Jazz Hybrid, et c’est avec un bonheur tout particulier que j’y reviens sur le papier, comme si les personnages y trouvaient une nouvelle dimension, et la modulation diverse des voix des lecteurs (le moelleux Michel Lonsdale ou le précieux Guillaume Galienne, notamment) y aura sans doute ajouté un quelque chose qui me revient en redécouvrant les dialogues inouïs de ce prodigieux théâtre. Car c’est surtout cela, en effet qui ressort de ces lectures variées : c’est le théâtre, la comédie, la drôlerie, la plasticité en quasi 3D des situations qui fait bel et bien de la chronique proustienne un roman projeté dans l’espace, bien plus que Saint-Simon et parfois supérieur, dans sa profondeur de champ et ses variations de voix, au roman de Céline.AD PERSONAM. – X. me signifie son mécontentement à la lecture des pages de ce journal où je fais allusion à lui même sans le citer nommément, et je ne parlerai donc plus de lui (je vais me gêner, tiens…) que sous X. en lui conservant son identié complète dans la partie non publiée de ce même journal.Julien Green a très bien fait la part du privé et du publiable, et je conçois tout à fait le caractère importun de toute mention publique de choses personnelles – j’en serais le premier agacé. Mais l’écrivain est un pillard. Si le cher X. m’invitait chez lui, je m’empresserais de fouiner dans ses affaires dès qu’il aurait le dos tourné, j’ouvrirais ses placards et se tiroirs, je ferais la liste de ses lectures et si je trouve une chemise à mon goût dans son dressing, en douce je la lui chaparderais. Il paraît que ce genre de kleptomanie relève de la pulsion sexuelle. Tant mieux : c’est avec ça qu’on fait des livres, et X. lui-même, dans ses écrits, ne s’en prive pas quand il pille les cœurs et les secrets de ceux qui l’entourent, etc.L’INSTIT HELVÈTE. – La figure de l’instituteur au savoir bonnement universel, incluant la botanique et l’astronomie, la vie des continents ou des plantes et la survie des monuments, l’enseignement du chant et de la gymnastique me semble l’incarnation par excellence du génie helvétique, et j’y vois soudain un personnage de roman hors d’âge qui pourrait avoir fréquenté Anton Pavlovitch Tchekhov sur le tard, fait du vélo avec le jeune Albert Einstein, conversé à Pétersbourg avec Léon Chestov et Andréi Biély ou partagé un lunch avec Carl Gustav Jung. Pourquoi se gêner dans un roman ouvert à la fantaisie et au merveilleux ? De là aussi mon idée de revenir au Cantique des cantiques autant qu’au Livre de Job...CONCRET ET ABSTRAIT. - Alain Gerber trouvait singulière, dans mon écriture, la constante alternance du concret et de l’abstrait, sans rien de voulu de ma part mais signalant peut-être l’un des divers aspects de ma dualité de natif des Gémeaux partagée entre l’apollinien et le dionysiaque, l’animus et l’anima, le diurne épris de clarté et le nocturne à l’écoute des grandes ombres – et me revient alors cette page de Sodome et Gomorrhe où le Narrateur, à propos de la mort de sa grand-mère, évoque l’univers du sommeil : « Monde du sommeil, où la connaissance interne, placée sous la dépendance des troubles de nos organes, accélère le rythme du cœur ou de la respiration, parce qu’une même dose d’effroi, de tristesse, de remords agit, avec une puissance centuplée si elle est ainsi injectée dans nos veines ; dès que pour y parcorir les artères de la cité souterraine, nous nous somms embarqués sur les flots noirs de notre propre sang comme un Léthé intérieur aux sextuples replis, de grandes figures solennelles nous apparaissent, nous abordent et nous quittent, nous laissant en larmes », etc.Il y a là-dedans une forme de délire contrôlé qui me semble procéder du noyau pur de ce qu’on appelle la poésie, ou de ce qu’on appelle plus largement la littérature, ou de ce qu’est la vraie pensée en lien avec ce qu’on appelle le corps, l’esprit, le cœur et l’âme.OECUMÈNE. - Nous avons assisté ce matin au baptême du petit Timothy, à l’église catholique de Bellevaux, célébré selon le rite par le curé vietnamien de la paroisse, tout à fait dans son rôle à la fois digne et débonnaire, présent et transparent. Trois générations et diverses confessions se trouvaient réunies dans la belle lumière du grand cube de béton aux baies immenses donnant sur les arbres et les frondaisons, et la cérémonie m’a paru simple et vraie, comme une île de sérénité dans l’océan de l’actuel chaos. Le môme emmailloté dans les bras de la religieuse noire en costume de missionnaire de la Charité conforme à l’ordre fondé par Teresa la sainte albanais sujette à toutes les controverses, notre beau-fils à moitié français mitraillant les séquences avec son appareil japonais, son homologue père du bambin à moitié irlandais et notre Julie aux yeux embués de larmes sincères composaient un tableau d’époque bigarré à souhait et non moins radieux. (Ce samedi 21 juin)NOTRE JOIE. – Ma bonne amie passe aujourd’hui le cap de se 72 ans. 38 ans de partage « globalement positif » avec cette belle vieille ado, me disais-je ce matin en pensant aux deux sortes de vieilles peaux de notre génération : les vieux croûtons rassis et les vieux ados demeurés à mèches rebelles.Je viens de retrouver en outre, en feuilletant L’Ambassade du papillon auquel je suis revenu pour me rappeler diverses choses précises de notre vie commune, ces mots de Hofmannstahl plus que jamais de notre actualité : « La joie exige toujours plus d’abandon, plus de courage que la douleur ».Sacré livre au demeurant que L’Ambassade du papillon, où subsistent tant de traces de nos « minutes heureuses » à travers les années et un peu partout, avec les enfants et dans « la société », de nos voyages et rencontres, des heures parfaites et des moments plus troublés ou tourmentés - par ma seule faute il me semble, si tant est qu’il s’agisse de faute d’être ce que je suis ; or j’en étais presque à envier ces jours, en reprenant la lecture du Journal de Julien Green, la qualité de sérénité et de plénitude qu’il y a dans celui-ci, et puis je me dis que le mien vaut tout autant par sa qulité de sincérité et de fidélité par rapport à ce que nous vivons, toute vie étant digne d’être rapportée et l’important étant alors, dans un journal, de le rapporter bien – ce que je fais avec autant de soin et de précision que le cher nonagénaire. Bref, ces observations m’incitent, ce matin, à poursuivre la dernière tranche de mes Lectures du monde, intitulée Journal des Quatre Vérités et qui courra de mars 2019 à Dieu sait quand…QUENTIN DE CONFINEMENT.– Reprenant ce matin ma Fée Valse, je suis ravi par la plasticité de ces petits tableaux et la verdeur, l’humour de leur esprit ; et cet autre sujet de satisfaction : la lecture, dans Le Persil dont mon texte intitulé Journal sans date des premières quinzaines d’une quarantaine constitue l’ouverture sur trois pleines pages, d’un poème de Quentin Mouron qui m’épate par sa vivacité tout actuelle et sa découpe rythmique : Il y a là comme une ballade médiévale relookée qui me touche dès sa première strophe :« La chevelure d’or des contes fait désormais l’objetDe prescriptionsOn interdit au princeD’y passer la mainSous peineDe trahir Son royaume »Et la chute de la sixième strophe est à l’avenant mélancolique :« Il n’y a plus de boudours lascifs où l’orSe mêle aux reflets écarlates. Il n’y a plusQue des living rooms gluants et de platsCongelés qui collent sur le sol.l y a des sous-vêtements Calvin Klein salesSous la table basse en verre et la console de jeuNe s’éteint que la nuit et nous la désinfectionsAvec du gel hydro-alcoolique. Et tes cheveuxEt ta bouche me manquent, parfois », etc.Oui, c’est bien cette odeur de gel hydro-alcoolique et sa gluance sanitaire que nous rappelleront ces temps étranges,à la fois hors du temps et des lieux et hyper-réels.Je lui envoie donc aussitôt un texto amical sur Messenger. Ensuite de quoi, relisant les vingt premières pages de Mémoire vive, sixième volume de mes Lectures du monde (2013-2019) prêt à l’édition, je me dis que, décidément, je n’ai plus rien à prouver et me lance crânement comme nous lançait notre cher et maudit Dimitri. « On continue »… (Ce mardi 23 juin)ORGUEIL ET VANITÉ. – Un auteur ou un artiste – un « créateur » quelconque, ou une « créatrice », sont-ils habilités à s’enchanter de leurs propres productions sans faire preuve de la plus douteuse vanité ? J’ose le croire, comme le pensait tranquillement une Flannery O’Connor prête à défendre becs et ongles l’excellence de ses écrits, comme elle l‘aurait fait des qualités de ses enfants si elle en avait eus au lieu d’oies et de paons.Faut-il alors parler de légitime orgueil, au lieu de vaine vanité, et quelle différence d’ailleurs entre celle-ci et celui là ? C’est ce que j’ai demandé un jour, en notre adolescence, à notre bon pasteur Pierre Volet qui m’a répondu, sous sa moustache de crin noir, que l’orgueil se justifiait quand « il y a de quoi » tandis que la vanité consiste à se flatter quand il n y a pas « de quoi »…Mais l’écrivain et l’artiste sont-ils à même de juger s’ils ont « de quoi » être fiers des produits de leurs firmes ? Là encore j’en suis convaincu, et Maître Jacques partageait cette conviction. « Nous sommes , toi et moi, de ceux qui savent ce qu’ils font », me dit-il un jour, et cela valait en somme autant pour ce que nous faisions que pour ce que font les autres, etc.MES PENSEURS. – Depuis ma seizième année je ne suis sensible qu’à des pensées cristallisées par le verbe ou le style et donc à des penseurs qui tous, d’Albert Camus à Simone Weil, de Charles-Albert Cingria à Stanislaw Ignacy Witkiewicz et Vassily Rozanov, de Léon Chestov et Nicolas Berdiaev à Annie Dillard, de Pascal et Montaigne à Peter Sloterdijk ou René Girard, entre tant d’autres, sont aussi, voire surtout, des écrivains ou des poètes à leur façon, à l’exclusion des philosophes à systèmes ou des idéologues.LES ENFANTS. – Le pauvre Robert Poulet, éminent critique littéraire et misérable idéologue d’extrême-droite, me dit un jour qu’il fallait se défier absolument de la perversité cachée des petits enfants, me recommandant en outre de ne pas « entrer dans le XXIe siècle » en procréant, alors que le « mal » était déjà fait – notre première petite fille se trouvant sur la bonne voie d’une prochaine venue au monde. Je ne sais pourquoi la fille de ce prophète de malheur, dont les jugements critiques souvent pénétrants vont de pair ave une sorte de morgue supérieure (même à propos de Céline ou de Bernanos, il y va de jugements à la limite de la condescendance), s’est donné la mort, et je présume que sa douleur est pour beaucoup dans son amertume absolue, et je ne le juge donc pas d’avoir été pour moi un si mauvais conseiller, comme l’a été le plus proche mentor de ma vingtaine, mais ce que je sais, fort de cette expérience, c’est qu’on est redevable des erreurs des autres autant que de leurs bons exemples ; et voyant les petits enfants de notre seconde fille, je me dis que rien n’est meilleur ni plus beau dans la vie que leurs yeux qui brillent.
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2020)DIVINES IDÉES. Ce matin clair me vient l’idée de couper court à toute forme d’amiélisation consistant à noter chaque jour ce qui se passe et ce qui passe ou ne passe pas, avec force détails privés et autres notations météorologiques, comment tout s’enfuit ou perdure, se répète ou pas, la marquise sortie tout à l’heure et moi qui la guette à la fenêtre en me grattant l’omphale - assez de ces selfies à n’en plus finir et de cette littérature tautologique de photomaton, plutôt viser le pot commun et la transmutation des métaux, foin d’idéologie rassurante et tout pour les divines idées… (À La Désirade, ce lundi 8 juin)DU VAGUE ET DES SENTIMENTS PRÉCIS. - À ses camarades qui s’invectivaient au nom d’idéologies opposées, les latinistes maurrassiens que figuraient les frères Cingria contre les germanistes fascisants à la Gonzague de Reynold et consorts, Ramuz, invoquant ce qui au contraire rapprochait les uns et les autres, à savoir la sensibilité littéraire et le gout du beau ou du vrai, affirmait que le monde des assertions idéologiquees était celui du vague, pulsions et opinions mêlées en nuages et vapeurs, alors que celui des sentiments imposait naturellement la clarté de l’analyse et la précision des nuances ; et c’est exactement ce que j’observe à tout moment, à l’heure actuelle des théories les plus fumeuses suscitées par la pandémie, où les uns et les autres criant au complot de la partie adverse en appelant spécialistes et scientifiques à la rescousse, lesquels experts brandissent autant d’arguments pour ou contre ; et l’on pourrait étendre l’observation à l’analyse critique des œuvres littéraires ou artistiques, souvent bien plus précise et pénétrante quand elle relève de l’intuition et de la sensibiité, du goût et des associations comparatives, que sous couvert d’autorité supposée scientifique réduisant les objets à la textualité du texte eou à la matérialité du matériau plastique, etc.DE L’ENCHANTEMENT. – Il n’y a pas de formule chimique ni d’équation physique de la joie, me dis-je en écoutant, sur Youtube, six jeunes chanteurs de la compagnie King’singers interpréter a cappella cet extrait de la liturgie de saint Jean de Nicolaï Kedrov (1871-1940) d’une puzreté de ligne mélodique et d’une densité polyphonique à tirer des larmes à une statue de pierre les yeux fermés. Le bond et les rebonds de nos petits lascars d’un et trois ans dans l’herbe, sur la terrasse ensoleillée où leurs parents leur ont installé un joli toboggan et une caisse à sable, ou la lecture de quelques pages alertes de Colette, de Roussel ou d’Audiberti, me semble ressortir à la même nature « divine » que je ressens à vrai dire sans guillemets en mon tréfonds.ÉCOUTER LIRE. – J’ai « lu » des centaines de pages de la Recherche proustienne, ces dernières années, en roulant seul à bord de notre Honda Jazz Hybrid, et c’est avec un bonheur tout particulier que j’y reviens sur le papier, comme si les personnages y trouvaient une nouvelle dimension, et la modulation diverse des voix des lecteurs (le moelleux Michel Lonsdale ou le précieux Guillaume Galienne, notamment) y aura sans doute ajouté un quelque chose qui me revient en redécouvrant les dialogues inouïs de ce prodigieux théâtre. Car c’est surtout cela, en effet qui ressort de ces lectures variées : c’est le théâtre, la comédie, la drôlerie, la plasticité en quasi 3D des situations qui fait bel et bien de la chronique proustienne un roman projeté dans l’espace, bien plus que Saint-Simon et parfois supérieur, dans sa profondeur de champ et ses variations de voix, au roman de Céline.AD PERSONAM. – X. me signifie son mécontentement à la lecture des pages de ce journal où je fais allusion à lui même sans le citer nommément, et je ne parlerai donc plus de lui (je vais me gêner, tiens…) que sous X. en lui conservant son identié complète dans la partie non publiée de ce même journal.Julien Green a très bien fait la part du privé et du publiable, et je conçois tout à fait le caractère importun de toute mention publique de choses personnelles – j’en serais le premier agacé. Mais l’écrivain est un pillard. Si le cher X. m’invitait chez lui, je m’empresserais de fouiner dans ses affaires dès qu’il aurait le dos tourné, j’ouvrirais ses placards et se tiroirs, je ferais la liste de ses lectures et si je trouve une chemise à mon goût dans son dressing, en douce je la lui chaparderais. Il paraît que ce genre de kleptomanie relève de la pulsion sexuelle. Tant mieux : c’est avec ça qu’on fait des livres, et X. lui-même, dans ses écrits, ne s’en prive pas quand il pille les cœurs et les secrets de ceux qui l’entourent, etc.L’INSTIT HELVÈTE. – La figure de l’instituteur au savoir bonnement universel, incluant la botanique et l’astronomie, la vie des continents ou des plantes et la survie des monuments, l’enseignement du chant et de la gymnastique me semble l’incarnation par excellence du génie helvétique, et j’y vois soudain un personnage de roman hors d’âge qui pourrait avoir fréquenté Anton Pavlovitch Tchekhov sur le tard, fait du vélo avec le jeune Albert Einstein, conversé à Pétersbourg avec Léon Chestov et Andréi Biély ou partagé un lunch avec Carl Gustav Jung. Pourquoi se gêner dans un roman ouvert à la fantaisie et au merveilleux ? De là aussi mon idée de revenir au Cantique des cantiques autant qu’au Livre de Job...CONCRET ET ABSTRAIT. - Alain Gerber trouvait singulière, dans mon écriture, la constante alternance du concret et de l’abstrait, sans rien de voulu de ma part mais signalant peut-être l’un des divers aspects de ma dualité de natif des Gémeaux partagée entre l’apollinien et le dionysiaque, l’animus et l’anima, le diurne épris de clarté et le nocturne à l’écoute des grandes ombres – et me revient alors cette page de Sodome et Gomorrhe où le Narrateur, à propos de la mort de sa grand-mère, évoque l’univers du sommeil : « Monde du sommeil, où la connaissance interne, placée sous la dépendance des troubles de nos organes, accélère le rythme du cœur ou de la respiration, parce qu’une même dose d’effroi, de tristesse, de remords agit, avec une puissance centuplée si elle est ainsi injectée dans nos veines ; dès que pour y parcorir les artères de la cité souterraine, nous nous somms embarqués sur les flots noirs de notre propre sang comme un Léthé intérieur aux sextuples replis, de grandes figures solennelles nous apparaissent, nous abordent et nous quittent, nous laissant en larmes », etc.Il y a là-dedans une forme de délire contrôlé qui me semble procéder du noyau pur de ce qu’on appelle la poésie, ou de ce qu’on appelle plus largement la littérature, ou de ce qu’est la vraie pensée en lien avec ce qu’on appelle le corps, l’esprit, le cœur et l’âme.OECUMÈNE. - Nous avons assisté ce matin au baptême du petit Timothy, à l’église catholique de Bellevaux, célébré selon le rite par le curé vietnamien de la paroisse, tout à fait dans son rôle à la fois digne et débonnaire, présent et transparent. Trois générations et diverses confessions se trouvaient réunies dans la belle lumière du grand cube de béton aux baies immenses donnant sur les arbres et les frondaisons, et la cérémonie m’a paru simple et vraie, comme une île de sérénité dans l’océan de l’actuel chaos. Le môme emmailloté dans les bras de la religieuse noire en costume de missionnaire de la Charité conforme à l’ordre fondé par Teresa la sainte albanais sujette à toutes les controverses, notre beau-fils à moitié français mitraillant les séquences avec son appareil japonais, son homologue père du bambin à moitié irlandais et notre Julie aux yeux embués de larmes sincères composaient un tableau d’époque bigarré à souhait et non moins radieux. (Ce samedi 21 juin)NOTRE JOIE. – Ma bonne amie passe aujourd’hui le cap de se 72 ans. 38 ans de partage « globalement positif » avec cette belle vieille ado, me disais-je ce matin en pensant aux deux sortes de vieilles peaux de notre génération : les vieux croûtons rassis et les vieux ados demeurés à mèches rebelles.Je viens de retrouver en outre, en feuilletant L’Ambassade du papillon auquel je suis revenu pour me rappeler diverses choses précises de notre vie commune, ces mots de Hofmannstahl plus que jamais de notre actualité : « La joie exige toujours plus d’abandon, plus de courage que la douleur ».Sacré livre au demeurant que L’Ambassade du papillon, où subsistent tant de traces de nos « minutes heureuses » à travers les années et un peu partout, avec les enfants et dans « la société », de nos voyages et rencontres, des heures parfaites et des moments plus troublés ou tourmentés - par ma seule faute il me semble, si tant est qu’il s’agisse de faute d’être ce que je suis ; or j’en étais presque à envier ces jours, en reprenant la lecture du Journal de Julien Green, la qualité de sérénité et de plénitude qu’il y a dans celui-ci, et puis je me dis que le mien vaut tout autant par sa qulité de sincérité et de fidélité par rapport à ce que nous vivons, toute vie étant digne d’être rapportée et l’important étant alors, dans un journal, de le rapporter bien – ce que je fais avec autant de soin et de précision que le cher nonagénaire. Bref, ces observations m’incitent, ce matin, à poursuivre la dernière tranche de mes Lectures du monde, intitulée Journal des Quatre Vérités et qui courra de mars 2019 à Dieu sait quand…QUENTIN DE CONFINEMENT.– Reprenant ce matin ma Fée Valse, je suis ravi par la plasticité de ces petits tableaux et la verdeur, l’humour de leur esprit ; et cet autre sujet de satisfaction : la lecture, dans Le Persil dont mon texte intitulé Journal sans date des premières quinzaines d’une quarantaine constitue l’ouverture sur trois pleines pages, d’un poème de Quentin Mouron qui m’épate par sa vivacité tout actuelle et sa découpe rythmique : Il y a là comme une ballade médiévale relookée qui me touche dès sa première strophe :« La chevelure d’or des contes fait désormais l’objetDe prescriptionsOn interdit au princeD’y passer la mainSous peineDe trahir Son royaume »Et la chute de la sixième strophe est à l’avenant mélancolique :« Il n’y a plus de boudours lascifs où l’orSe mêle aux reflets écarlates. Il n’y a plusQue des living rooms gluants et de platsCongelés qui collent sur le sol.l y a des sous-vêtements Calvin Klein salesSous la table basse en verre et la console de jeuNe s’éteint que la nuit et nous la désinfectionsAvec du gel hydro-alcoolique. Et tes cheveuxEt ta bouche me manquent, parfois », etc.Oui, c’est bien cette odeur de gel hydro-alcoolique et sa gluance sanitaire que nous rappelleront ces temps étranges,à la fois hors du temps et des lieux et hyper-réels.Je lui envoie donc aussitôt un texto amical sur Messenger. Ensuite de quoi, relisant les vingt premières pages de Mémoire vive, sixième volume de mes Lectures du monde (2013-2019) prêt à l’édition, je me dis que, décidément, je n’ai plus rien à prouver et me lance crânement comme nous lançait notre cher et maudit Dimitri. « On continue »… (Ce mardi 23 juin)ORGUEIL ET VANITÉ. – Un auteur ou un artiste – un « créateur » quelconque, ou une « créatrice », sont-ils habilités à s’enchanter de leurs propres productions sans faire preuve de la plus douteuse vanité ? J’ose le croire, comme le pensait tranquillement une Flannery O’Connor prête à défendre becs et ongles l’excellence de ses écrits, comme elle l‘aurait fait des qualités de ses enfants si elle en avait eus au lieu d’oies et de paons.Faut-il alors parler de légitime orgueil, au lieu de vaine vanité, et quelle différence d’ailleurs entre celle-ci et celui là ? C’est ce que j’ai demandé un jour, en notre adolescence, à notre bon pasteur Pierre Volet qui m’a répondu, sous sa moustache de crin noir, que l’orgueil se justifiait quand « il y a de quoi » tandis que la vanité consiste à se flatter quand il n y a pas « de quoi »…Mais l’écrivain et l’artiste sont-ils à même de juger s’ils ont « de quoi » être fiers des produits de leurs firmes ? Là encore j’en suis convaincu, et Maître Jacques partageait cette conviction. « Nous sommes , toi et moi, de ceux qui savent ce qu’ils font », me dit-il un jour, et cela valait en somme autant pour ce que nous faisions que pour ce que font les autres, etc.MES PENSEURS. – Depuis ma seizième année je ne suis sensible qu’à des pensées cristallisées par le verbe ou le style et donc à des penseurs qui tous, d’Albert Camus à Simone Weil, de Charles-Albert Cingria à Stanislaw Ignacy Witkiewicz et Vassily Rozanov, de Léon Chestov et Nicolas Berdiaev à Annie Dillard, de Pascal et Montaigne à Peter Sloterdijk ou René Girard, entre tant d’autres, sont aussi, voire surtout, des écrivains ou des poètes à leur façon, à l’exclusion des philosophes à systèmes ou des idéologues.LES ENFANTS. – Le pauvre Robert Poulet, éminent critique littéraire et misérable idéologue d’extrême-droite, me dit un jour qu’il fallait se défier absolument de la perversité cachée des petits enfants, me recommandant en outre de ne pas « entrer dans le XXIe siècle » en procréant, alors que le « mal » était déjà fait – notre première petite fille se trouvant sur la bonne voie d’une prochaine venue au monde. Je ne sais pourquoi la fille de ce prophète de malheur, dont les jugements critiques souvent pénétrants vont de pair ave une sorte de morgue supérieure (même à propos de Céline ou de Bernanos, il y va de jugements à la limite de la condescendance), s’est donné la mort, et je présume que sa douleur est pour beaucoup dans son amertume absolue, et je ne le juge donc pas d’avoir été pour moi un si mauvais conseiller, comme l’a été le plus proche mentor de ma vingtaine, mais ce que je sais, fort de cette expérience, c’est qu’on est redevable des erreurs des autres autant que de leurs bons exemples ; et voyant les petits enfants de notre seconde fille, je me dis que rien n’est meilleur ni plus beau dans la vie que leurs yeux qui brillent. -
Mémoire vive (122)
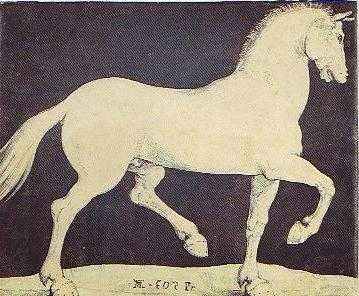
« La poésie n’est pas dans l’émotion qui nous étreint dans quelque circonstance donnée – car elle n’est pas une passion. Elle est même le contraire d’une passion. Elle est un acte. Elle n’est pas subie, elle est agie. Elle peut être dans l’expression particulière suscitée par une passion, une fois fixée dans l’œuvre qu’on appelle un poème et seulement dans l’émotion que cette œuvre pourra, à son tour, provoquer. En dehors de l’œuvre poétique accomplie, il n’y a nulle part de poésie. Elle est un fait nouveau, certainement relié aux circonstances qui peuvent émouvoir le poète dans la nature, mais ce n’est que formé par les moyens dont dispose le poète que ce fait, chargé de poésie, viendra prendre la place qui lui revient dans la réalité. Ce n’est pas l’art que la nature imite, c’est la poésie, parce que la poésie nous a appris à y voir ce qu’elle y a mis ». (Pierre Reverdy, En vrac)
Ce dimanche 1er juillet. - La poésie qui se veut poétique est à mes yeux la négation de la poésie, laquelle ne veut rien par définition si ce n’est apparaître par surprise. La poésie poétique pose, et la plupart de celles et ceux qui se disent ou se veulent poètes posent. À vrai dire les pires poseurs, parmi les gens de lettres, qui la plupart posent, sont les poètes et plus gravement souvent : les poétesses. Poètes et poétesses se tiennent cependant les coudes et se déclarent volontiers frères et sœurs, comme les membres d’une secte, se flattant les uns les autres et parfois se rejetant comme les membres de sectes concurrentes ou adverses, se jugeant et parfois s’anathématisant comme ce fut la pratique des églises rivales des premiers jours ou comme cela se voit encore dans les congrégations cultuelles ou culturelles de toute sorte, jusqu’aux grouillements tribaux des sectateurs de poésie pseudo-poétique des réseaux sociaux, etc.
Ce lundi 2 juillet. - La (re)lecture de Langue fantôme[1] de Richard Millet m’enchante par sa lucidité, même si son catastrophisme me semble exagéré; mais il y a chez lui de l’artiste de l’exagération comme chez Thomas Bernhard.
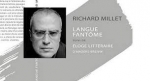
D’ailleurs son texte me rappelle à tout moment Maîtres anciens et la présence du vieil homme de Tintoret, figurant l’héritage présent du Maître incontestable, m’a rappelé nos longues stations, avec François F., au Kunstmuseum de Vienne, devant cette figure et, plus longues encore, devant la Vierge de Mondsee.

Or je vais y revenir dans une réflexion que je voudrais développer sur l’art suisse et la littérature en prolongement de la lecture du livre de Michel Thevoz, L’Art suisse n’existe pas.
Parler de l’inexistence de l’art suisse ne peut que déboucher sur l’inexistence de l’art contemporain, que Thévoz se garde bien de pointer, et sur l’inexistence proliférante de la littérature mondialisée où tout un chacun se pose en écrivain dans l’hébétude ravie des collectifs sympas.
°°°
Depuis hier je suis revenu à la peinture avec la reprise d’un premier état du Cervin resté en rade pendant des mois. Or j’ai une quinzaine d’ébauches du même acabit que je vais reprendre et améliorer ces prochains temps – autre façon de dire que le temps ne chôme pas.

Ce mardi 3 juillet. –Après avoir accompagné ma bonne amie à la clinique de La Prairie, je me suis arrêté ce matin au Rubis, sur la place de l’Hôtel de ville de Vevey, pour y prendre mon café au lait et y savourer la prose délectablement solennelle consacrée au match de qualification de la Suisse au huitième de finale du Mundial , cet après-midi, où l’on parle de l’Histoire en train de s’écrire et autres fadaises de circonstances…
Ce mercredi 4 juillet. – J’aborde la lecture de Reconquêtes de Fabrice Pataut, que PG m’a dit un roman remarquable. Et ça part en effet très fort, brillant et concentrique, cinglant et de la même poésie corsée que les nouvelles d’Un Jeudi parfait ou le roman Valet de trèfle. Richard Millet, autre auteur de PG, proclame la fin du roman français, mais FB en est l’heureux contre-exemple et je m’en réjouis. Mais qui parlera de Fabrice Pataut ? Moi, justement !
°°°
À l’école, à chaque retour du jour, de la nature. Là que ça respire, pour autant que je respire.
°°°
Je suis frappé, et de plus en plus, de constater l’incapacité des auteurs de moins de trente ans, ou même de quarante ans, de prendre en considération le legs de leurs aînés, si l’on excepte quelques auteurs « cultes » adulés pour de plus ou moins bonnes raisons, tels Cendrars ou Nicolas Bouvier, dont l’usage relève le plus souvent du mimétisme folklorique.
Ce jeudi 12 juillet. – La publication, sur Facebook, de la couverture du livre de Michel Thévoz, représentant une étude de fesses de Félix Vallotton, m’a valu d’être bloqué par le censeur automatique du réseau social, dont je ne sais trop comment il fonctionne mais qui m’a fait réagir avec véhémence, comme s’il s’agissait d’une personne, en remarquant que cette image est visible aux devantures des meilleures librairies. Mais à quoi bon argumenter ? Je m’étais déjà fait «attraper» en publiant une image de poitrine féminine dénudée, dont le haut était une burqa masquant le visage de la femme, et je présume que l’on ne sort pas de la logique du téton de la miss Jackson provoquant un émoi national dans ce même pays dont le budget de l’industrie pornographique dépasse celui de la NASA. Donc au temps pour moi, et jusqu’à la prochaine !
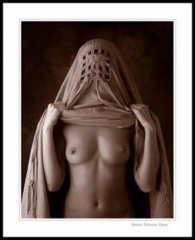
Ce lundi 16 juillet. – Après mon ordinaire quart d’heure de désespérance, je repique. Pour me dire que ce qui est à proscrire, s’agissant de la série prétendument pousse-au-suicide que représente 13 reasons why, est, bien plus que le sujet de la série (le suicide d’une ado stupide), l’image que la série donne de la société en ramassant tous les poncifs relatifs au mal-être des adolescents, en flattant ceux-ci au lieu de dire ce qui est en réalité. Et du coup c’est reparti pour une chronique que j’espère tonique.
Ce mardi 17 juillet. – Me viennent aujourd’hui deux poèmes, comme ça, l’un après l’autre, venus d’on ne sait où – comme toujours.
Le premier s’intitule Rêverie en forêt, et tous mes thèmes sont là, et le second Dans le bleu, qui me semble également couler de source, un peu malgré moi…
Rêverie en forêt
Le vieux flûtiste est mort.
On n’entendra plus dans les bois,
le temps de le pleurer,
les roulades de Rossignol.
La douleur oubliée
sous les arches d’un long silence,
par le temps qui s’en va,
nous fera retrouver l’enfant
d’une autre vie rêvée
dans ces années d’avant le temps,
quand nous n’y pensions pas.
Le souvenir en attendant
des jardins suspendus
de Byzance, par les chemins
d’un infini perdu -
le souvenir nous reviendra.Dans le bleu
De multiples récits
adviendront à n’en plus finir
d’étages en étages,
au nuancier de tous les bleus.
Là-bas dans ses grandes largeurs
au miroir de ses fosses
s’ouvre le lac de nos mémoires,
et le pic noir s’élance
entre les sourdes pulsations
d’un cœur qui ne dit pas
s’il est d’ici ou des ailleurs
ignorés des saisons.
Le jour se lève un peu partout;
et tout à coup quelqu’un s’en va.

Ce mercredi 18 juillet. - Simplicité et frugalité. L’étoile ascétique cligne de l’œil. Une chose après l’autre en toute sérénité, sans peur et sans tricher. La façon de travailler de notre aide jardinier népalais Buddha m’impressionne et m’enchante. Voici l’humanité bonne : consciencieuse, respectueuse, travailleuse, joyeuse !
Ce jeudi 19 juillet. - Deux nouveaux poèmes ce matin, que je trouve pas mal après en avoir liquidé deux autres.
Le premier :
Tout n’est pas dit
J’aime bien aller le matin,
les pieds dans la rosée,
flairer l’odeur des derniers feux
dont les fumées s’éventent
là-bas où les gens se reposent
encore à fleur de songes.
Le silence et moi sommes seuls
à déplier le premier rose
de l’aube dans le bleu
du temps retrouvé et des choses.
J’aime aussi te savoir au monde,
mais ça reste secret...
Et le second :
Atelier de réparation
L’enfant n’est pas content:
ce jouet qu’on lui a donné
sans le lui demander
n’est pas conforme au règlement;
cela ne vole pas
comme les oiseaux de papier;
cela ne marche pas
la tête en bas sans un viseur;
cela n’obéit pas
au dormeur dûment établi
dans l’ancienne institution
de la vie aux abris –
cela tire n’importe où .
L’enfant ne sourit pas
au n’importe quoi qui agite
la meute des parleurs;
l’enfant ne souscrit
pas aux arguments spécieux
des émeutiers avides;
l’enfant récuse tout avocat
qui ne sache danser
sur la corde des étonnés.
Au labo de l’enfant j’entends
la chanson douce des instruments.
°°°
La plupart des poètes actuels ne me parlent pas. Aucun (enfin presque) ne me semble avoir résolu le problème fondamental de la poésie (je parle de la langue fraçaise) qui touche à la fois (en même temps) au rythme et à la mélodie, à la fluidité et aux angles vifs, au sens manifeste et à tout l’obscur qui le prècède ou lui succède, au fruit et à la bête, etc.
Sans doute y en a-t-il quelques-uns qui me parlent, de Jacques Réda à William Cliff ou de Franck Venaille à James Sacré, notamment, mais aucun ne m’éclaire autant que l’obscur Reverdy dont chaque page (ou presque) fait agir en moi ce que j’estime la poésie…
Ce vendredi 20 juillet. – L’humiliation est bonne. C’est l’expérience qui m’a délimité, avec l’aspiration à la lumière. Je présume que mon écriture claire ou plus obscure en procède. Mon goût pour celles de Cingria et de Witkiewicz, que tout oppose, vient en tout cas de là.
°°°
Je reçois ce matin ce message réconfortant de Fabrice Pataud, à propos de La Fée Valse.
« Cher JLK, Je souris et ris et réfléchis mélancoliquement à la lecture de La Fée Valse, dont j’apprécie plus chaque jour les masseurs, les polonais et les incestueux décontractés.
Il y a des perles rares dans ces brèves. Je ne sais comment les appeler, nouvelles ? soties ?
Ce sont des brèves je crois, pour lesquelles je tenais à vous dire non pas bêtement BRAVO, ni fastidieusement CHAPEAU, mais sincèrement mon admiration. Cordialement. Fabrice Pataut ».
°°°
Mon poème Apories et marteaux concrétise, il me semble, une pointe. C’est la combinaison parfaite, à mes yeux, d’une intuition flottante et d’un redressement par la pensée et la grammaire, qui aboutit à une forme – et cela seul compte en poésie…
Apories et marteaux
En langue originale
on ne peut vraiment tout dire:
tanka ni lingala
n’y suffiront quand se dément
le plus clair des clairières,
et que l’ombre sévit
en feignant de se dévoiler.
Seule la publicité
semble alors à même de traduire
ce qui ne se peut dire.
Quant au grand langage oublié,
même en langue il se tait.
On attend le génie
à construire la machinerie
des machines à déconstruire
le secret des machines.
Ce samedi 21 juillet. – La lecture du roman de Barilier m’en impose et me conforte dans l’idée que non seulement rien n’est perdu, mais que tout reste à relancer et vivifier dans l’esprit de ce qui doit être transmis, et d’abord absorbé et transformé comme le roman le permet ici, etc.
Ce dimanche 22 juillet. – Beethoven dans la nuit. La IXe au-dessus du lac et des forêts, sous un ciel crépitant de vieilles étoiles silencieuses. Que l’ode à la Joie, ce chant de la terre habitée, prière d’un sourd reprise par toutes les voix des vivants - que ce chœur émouvant soit ce soir notre doux linceul.
Ce lundi 23 juillet. – J’ai composé ce matin une liste dédiée à Ceux qui se conforment, visant les nouveaux formels de mise au pas des réseaux sociaux, à commencer par Facebook et le mot d’ordre : souriez ! Et dans la foulée : échangez ! partagez votre chat et votre cancer !
Ce mardi 24 juillet. – Beethoven, Rembrandt et Proust d’un côté (que j’écoute sans discontinuer sur l’audiophone de ma Honda Jazz en allant et venant de Valmont tous les soirs), et de l’autre les journaux, les éructations de la gauche et de la droite contre Macron - d’un côté la lumière et la liberté, et de l’autre la meute aux paupières de plomb…
Ce mercredi 25 juillet. – En descendant ce soir à Valmont par la route étroite des Avants à Glion, j’ai pensé à une chronique sur le temps perdu par les vacanciers coincés dans les files d’attente au portail nord du Gotthard, entre autres lieux de supplice, auxquels je propose diverses formes d’échappatoires ludiques et conviviales (le jeu Hâte-toi lentement sorti des valises, par exemple, ou la conversation familiale retrouvée), et remontant ensuite par le col de Jaman j’ai noté les premiers paragraphes de ladite chronique sur mon portable :
« En ces jours de migrations routières et autoroutières vers le sud, marquées à longueur d’heures par de récurrentes annonces radio relatives aux engorgements, ralentissements et autres attentes plus ou moins longues prévues (notamment) aux portails des tunnels alpins ou s’obstinent crânement à se présenter les vacanciers , il est stimulant, pour les esprits positifs et confiants en le génie humain, d’imaginer toute les parades aux situations ordinairement considérées comme des pertes de temps ou des motifs de mauvaise humeur voire de franche agressivité dans les habitacles et parfois même d’un véhicule à l’autre, etc. »
Ce jeudi 26 juillet. – Le roman de Barilier, sans doute son meilleure, a eu droit, dans Le Temps, à ce qu’on peut dire un aplatissement caractéristique de la manière des éteignoirs du milieu littéraire et médiatico-universitaire romand, dont Isabelle R., qui signe cette pauvre prose, est le triste parangon sans entrailles et sans la moindre capacité de sortir de sa posture pédante et de manifester le moindre enthousiasme proportionné à un tel livre…
Ce vendredi 27 juillet. – Le jeune Népalais au prénom de Buddha, qui s’est occupé ces jours des travaux de bois et de jardin autour de La Désirade, m’a enchanté par sa façon d’être et de travailler, aussi sérieuse que souriante, inventive et compétente. Nous nous sommes entendus sans vaines explications, je lui ai fait à manger et il a fait plus et mieux que ce que nous attentions de lui, et reconnaissant avec ça - bref c’est ce que j’aime chez les gens qui pensent avec les mains, selon l’expression de Rougemont, et ce fut une bonne rencontre, de surcroît, avec des échanges de musiques et de paysages…
Ce dimanche 29 juillet. – Je me suis lancé, en vue de présenter trois livres récents des éditions d’autre part dans ma prochaine chronique, dans la lecture d’Hériter du silence de Mathias Howald, dont c’est le premier roman, qui m’a immédiatement touché par sa façon, à partir de photographies prises par son père défunt, de parler de celui-ci et d’évoquer tout un univers familial avec un mélange d’acuité objective et de sensibilité plus douloureuse qui m’a impressionné par sa justesse, me renvoyant à nos relations et à nos souvenirs. En outre, l’auteur capte bien les intonations du parler local et rend, sans peser, l’atmosphère particulière, tissée de pudeur et de gêne qui préside souvent aux relations dans nos familles.
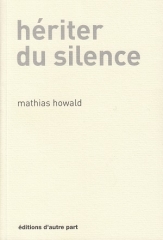
°°°
Au cours d’une longue conversation téléphonique, cet après-midi, Pierre-Guillaume me dit qu’il apprécie beaucoup la refonte des Jardins suspendus, où il voit maintenant un fil rouge, qui en fait un vrai livre et pas seulement un recueil de textes juxtaposés. Or ce constat me touche beaucoup en cela qu’il me prouve que PGDR est un lecteur attentif et qu’il ne va pas se contenter de publier mon livre «comme une lettre à la poste» mais qu’il va s’engager en lecteur et éditeur autant que je m’engage en lecteur et en auteur.
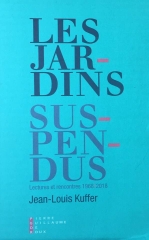
Ce lundi 30 juillet. - Passé la soirée d’hier sur la terrasse de l’Évêché en compagnie de Roland Jaccard et de Steven Sampson que j’étais allé cueillir au Palace où Roland a sa suite depuis douze ans…
Très bonne conversation, bonne chère aussi (pour Steven et moi un gaspacho andalou et une vitello tonnato parfaits) arrosé d’Humagne non moins apprécié de mes amis.

La discussion a d’abord roulé sur une question de Steven, me demandant si je me situais à gauche ou à droite, à quoi j’ai répondu que, loin de n’être ni de gauche ni de droite comme c’est la tendance dans la France de Macron, je me considérais comme étant à la fois de gauche et de droite, selon les objets, mais surtout rétif à toute forme d’idéologie, politique ou religieuse.
Ensuite nous nous sommes assez nettement opposés, Steven et moi, à propos du premier best-seller de Joël Dicker, en lequel il ne voit qu’un pillage des auteurs américains, alors que j’y ai trouvé plutôt un hommage à ceux-là (John Irving, Salinger ou Philip Roth, notamment) et le roman diablement bien construit d’un jeune homme de vingt-cinq ans, aux thèmes tout de même intéressants, etc. Mais je vois bien qu’il y a chez notre ami, «sorti de Harvard», pas mal de préjugés littéraires ou culturels qui ont resurgi en fin de soirée quand nous avons, Roland et moi, défendu l’usage de Facebook en lequel il voit une aliénation qui altère tout ce qui y est produit, reprenant la thèse de McLuhan selon laquelle le message va de pair avec le massage, ou vice versa, etc.
Nos échanges, parfois vifs, n’ont cependant pas été altérés par aucune agressivité, même quand Roland, jamais à court de vues paradoxales, s’est mis à faire l’éloge de la scientologie, au bord évidemment de nous faire grincer les dents…
Plus amusante encore : la relation, par Roland, de ses relations avec la pègre dont certains membre éminents fréquentent le Yushi, tel Alain Caillol, supposé avoir coupé le doigt du baron Empain lors du rapt de celui-ci, devenu l’ami de sa victime après des années d’incarcération et avouant à notre commensal que l’ex play-boy, abandonné de tous, l’ennuie un peu par son manque de conversation. Dans la bouche de l’auteur de Penseurs et tueurs, ces anecdotes relèvent de la légende dorée sur tranche, que je prolonge à ma façon en révélant, à qui veut l’entendre, que l’hôte du Lausanne-Palace revient régulièrement en Suisse pour préparer de nouveaux casses avec ses amis artistes de la cambriole, etc.
°°°
Revenir à la notion de degree telle que la module Shakespeare par la bouche d’Ulysse, dans Troïlus et Cressida, qui vaut plus que jamais dans notre époque d’indifférenciation croissante, où l’on exalte à n’en plus finir la différence pour mieux se fondre dans la troupe grise et la jactance de la multitude. Le degree marque la gradation de toute hiérarchie, dont la reconnaissance et l’évaluation ne peuvent se faire que sur la base de l’expérience personnelle. Ce n’est pas une valeur abstraite mais une déduction réaliste. Il n’est d’apprentissage et de connaissance avérée que par l’expérience du chaos, au sens large, ou du désordre plus personnel, et plus l’expérience est cuisante, mieux on peut en déduire les degrés d’un ordre incarné.
°°°
S’agissant de mes carnets – qui ont en somme valeur de journal intime ou extime -, il y a ce qu’on note sur le moment et ce qu’on ne reprend que deux ou trois jours après, ce qu’on se rappelle plus tard et ce qu’on a écrit entretemps en marge ou ce qu’on rajoute parfois pour embellir à tort ou préciser à raison, plus tout ce qu’on corrige, ou qu’on ne note pas, ou qu’on oublie de relever et qui ressurgira d’une autre façon ailleurs, peut-être dans quelque écrit de fiction, etc.
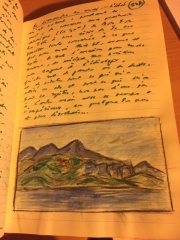
Ce mardi 31 juillet. – Brume de beau temps caniculaire ce matin. Tard levé (vers 10 heures) après un cauchemar faisant écho au film Abattoir 5, vu hier soir, où il est question du monstrueux bombardement de la ville de Dresde, en 1945 - film composite et plutôt raté quoique intéressant en cela (notamment) qu’il incrimine le «geste» punitif des Alliés devenus ici, comme à Hiroshima, criminels de guerre.
°°°
Repris ce matin la lecture d’Hériter du silence de Mathias Howald dont bien des pages, relevant du roman familial et de la relation père-fils, me touchent beaucoup et suscitent en moi bien des échos, me donnant envie de reprendre de vieux albums ou les deux cahiers rédigés par mes parents à mon intention.
…
J’arrive ici au bout des 404 pages manuscrites de l’épais livre-cahier, dont la couverture représente une mappemonde, acquis l’an dernier à San Diego, chez Barnes & Noble, et commencé le 14 juin 2017, jour de mes septante ans. Enrichi d’une quarantaine d’aquarelles ou de gouaches, ce carnet d’une année sera déposé dans mes archives bernoises de mon vivant ou à titre posthume – Dieu le sait comme on dit sans savoir ce qu’on dit…
A la fin de l’évocation, dans Penseurs et tueurs[2], de sa rencontre avec Michel Foucault, qui vient de lui parler d’un jeune étudiant très intelligent et sensé, mais sujet parfois à des accès de violence qui le faisaient enfermer, et qui finit par subir une lobotomie frontale, Roland Jaccard écrit ceci qui m’a beaucoup touché : « Je sentais Michel Foucault, par ailleurs si pudique dans l’expression de ses sentiments, encore ému. Nous nous tûmes. Il était temps de prendre congé. J’ignorais que ce serait notre dernière occasion de parler de notre rapport à la folie, de Freud, de Binswanger, de la psychanalyse existentielle, du suicide et de son Histoire de la sexualité écrite dans un style si limpide. À ce propos, il me dit que dès lors qu’on écrit simplement on passe en France auprès des intellectuels pour un benêt. Rien ne les épate plus qu’une écriture sibylline. J’approuvais, bien sûr. En me raccompagnant jusqu’à l’ascenseur, il me prit par le bras, et, comme s’il tenait à ce que ses derniers mots restent gravés dans ma mémoire, me confia : « Vous savez, je suis un libéral et un sceptique comme vous ».
« Dehors, une bise glaciale soufflait sur Paris. J’avais presque envie de pleurer.
« Comme si ce bref retour sur notre passé avait remué des torrents d’émotion que j’avais peine à maîtriser. Quelques mois plus tard, il était emporté par une épidémie qui bouleversa l’air du temps. Les choses ne seraient plus jamais comme avant. Les mots non plus. « La plus belle chose qu’on puisse offrir aux autres, c’est sa mémoire », a écrit Foucault. C’est ce que j’ai tenté de faire. Sans le trahir, ni me trahir ».

[1] Richard Millet. Langue fantôme ; suivi de Eloge littéraire d’Andres Breivik. Pierre-Guillaume de Roux, 2012.
[2] Roland Jaccard. Penseurs et tueurs. Pierre-Guillaume de Roux, 2018.
-
El Pasaporte

Ces notes constituent la substance du Notebook à l’enseigne d’un Pasaporte de la Republica de Cuba octroyé à l’écrivain libre Quentin Mouron, en l’Ambassade du papillon, par l’employé de faction JLK, le 23 décembre 2011, veille de Noël. Il est souhaitable de ne pas en prendre connaissance avant la lecture du premier roman de ce jeune auteur prometteur, mais seulement après…
Quentin Mouron. Au point d’effusion des égouts. Morattel, 137p.
- L’exergue de Duras prépare à la comédie.
- « Encore une fois la comédie ».
- Et le départ mimant Voyage : « C’est à Los Angeles que ça a commencé ».
- Dans la touffeur d’août où le smog s’enflamme.
- « Et c’est un ciel plus grand qu’ailleurs ».
- Le pavé à consistance molle, ramollie ramollo par la chaleur. Comme à Paris, sauf que plus. Comme à Rome plutôt.
- « On traverse toutes les dimensions d’un coup ».
- Tout de suite se démarquant des impressions générales.
- « Qu’après le mythe c’est rien ».
- Il va dire ce qu’il a vu et ressenti « débarqué de l’avion, au crépuscule, dans l’incendie ».
- Et cette première sentence pour cadrer sa phénoménologie express : « C’est une erreur de chercher l’essence dans l’analyse, postérieurement, au réveil. Il faut sentir le soir même, toutes voiles dehors et l’émotion qui brûle la gorge. Le feu du ciel. Et le délire ».
- Et déjà lui vient un début de fièvre.
- Il va défaillir le petit crevé : il verse.
- Se dit alors qu’il n’est pas fait pour les voyages. Mais qui le serait ?
- Cependant à la douane il passe gentiment. « Je sortais de l’enfance, j’avais pour moi les sortilèges et les rondeurs, le sourire franc- la gueule d’une pièce ».
- D’emblée je relève la papatte. La palpite.
- Le sens des mots. Le sens plus encore d’un mot pour l’autre, secret d’horlogerie fine.
- Il a encore « le chic » et « le casier en fleurs ».
- Mais le voici tituber.
- Juste aidé par un gros Hollandais.
- Sur quoi le voilà sauter dans un taxi auquel il indique Sunset Boulevard. Eh !
- Rend très bien la course en zigzags et la folie visuelle. Tout à fait ce que j’ai vu à Houston et à Montréal et à New York et à Tokyo. « Ma tête partait au bilboquet ».
- Et alors 36 chandelles. K.O. debout. Il verse pour de bon.
- Très bon enchaînement ensuite en rupture de plan.
- Ce que me disait Alain Cavalier : « Le cinéma c’est l’art de passer d’un plan à un autre ». Exactement ça dans Hitchcock, Cassavetes ou Godard.
- Donc change de plan temporel aussi avec un recul : « Je me suis égaré quelquefois dans les ruelles qui bordent le boulevard ».
- Et ce sont quelques silhouettes des ruelles. De vieux édentés. Les paumés à caddies. Des ados menottés.
- Et toute de suite le côté naturellement caricatural et théâtral de tout ça.
- Comme dans un film.
- Mais « abouché avec la vie ».
- Tout ça très finement noté. Mais c’est si rapide que ça risque de ne pas être capté du premier coup si l’œil glisse trop vite.
- Il y a la Catwoman.
- Il y a Elvis le énième.
- Faut que l’illusion tienne.
- Remarque que « Los Angeles tient par ses rue secondaires ».
- Ce qu’on ne dirait pas de San Francisco de la même façon ni de New York.
- « On vend du rêve, c’est bien vrai – on sait aussi vous le reprendre».
- L’illusion pallie la crainte de la réalité. Los Angeles dans les grandes largeurs effraie. Moins verticalement que New York mais horizontalement bien plus et par l’imagination des films.
- Philosophe sur l’illusion : « Quand je joue, je sais pourquoi je joue, quand je vis, je ne sais pas pourquoi je vis ».
- Il n’en faudrait pas trop comme ça, mais là ça va…
- Et voici le cousin Paul.
- Un type « tout au théâtre ».
- Campé en une page.
- Policier de carrière mais de la « petite police » alors qu’il se rêve Rambo.
- Vivant par procuration et « compensations ».
- Un « qui n’a rien ».
- Lorgnant les fillettes.
- Collectionnant des fichiers pornos et se faisant pincer a casa. Jeter au trou.
- Le jeune voyageur, lui, a de nouveau versé à ce qu’il semble.
- Et se retrouve chez sa cousine Clara, dans un tout autre topo.
- Westlake qu’il va découvrir à son tempo lent. « Par dedans ».
- Déçu assez vite quand il y va vraiment.
- Le quartier est riche et chiant, mortel. « les voisins sont aussi très propres ».
- « Sans mythologie, prêtrise, aucune pédérastie ».
- Le raccourci de cette phrase est un quartier. Exactement ce que j’ai capté dans le quartier du consul à New Orleans. « D’une blancheur d’hôpital ». Le ciel en cage.
- Et la cousine Clara un peu dingue. Exactement la mère de Kevin !
- L’Américaine quinqua divorcée névrosée obsédée par la queue qu’elle n’a pas sous la main.
- Accusant donc son ex d’être un monstre lubrique.
- Elle « couleuvre ». Joli verbe.
- Forme un club de plaignantes du sexe.
- Exactement ce que j’ai vu à la télé le premier jour au Texas : l’émission de Phil Donahue sur le thème des mères se demandant s’il fallait branler leurs garçons…
- Tout ça qui impatiente le jeune homme.
- Qui ne perd rien de l’observation. Sur les thérapeutes, les derviches, les ponctionneurs de fric de névrosées.
- Il défie une des thérapeutes. Qui lui tire la langue.
- Et Clara de pleurer.
- « J’ai pas tout inventé », précise-t-il, malin…
- Elle a quand même une certaine éducation.
- Un peu de bibliothèque.
- Quelques tableaux faux.
- Il sent qu’il la juge un peu trop alors qu’il l’aime bien.
- Trop froid, trop sur soi.
- « Seulement j’avais une verge et elle avait un grain ».
- « Nous avons dû nous renoncer à la fin » (p.30). Très bien cette torsion à l’intransitivité du règlement.
- Un soir pourtant ils filent en virée.
- La paire genre couguar et gigolo.
- Soir d’exception. « Barrés »…
- De brèves sentences et de plus longues plus sentencieuses…
- Clara fait la folle. Tombe dans la piscine.
- On s’amuse !
- Délivrance ? Juste pas !
- Retour le lendemain à la case névrose. « Au fond c’est l’habitude du malheur qui nous le rend incontournable ».
- On a besoin de « poignards ».
- Donc on restera.
- Mais lui s’impatiente ! Sort de ses gonds.
- Ils se fâchent. Se quittent pour la soirée. Se revoient le lendemain. C’est fini. - Puis c’est son anniversaire.
- Puis c’est son anniversaire.
- Elle l’emmène au bord de la mer. Dans la brume, vers Malibu.
- Et là, surprise de la cheffe, elle lui demande d’arrêter de se palucher. Kevin promet.
- Scène étonnante : elliptique et un peu folle.
- Puis il évoque la bibliothèque de Clara.
- Avec du Bukowski dedans. Et du développement personnel.
- Elle tend à « étendre son esprit ».
- Suite une réflexion pertinente sur la bonne façon de lire (p.34).
- « Il n’y a pas cent façons de lire un livre : il faut s’y jeter d’un bloc, faire corps avec l’auteur – sans réticences, préjugés, morale ».
- Prône l’adhésion et l’immersion.
- Puis se retrouvent à Beverly Hills.
- Tout un monde de « vagins fripés » et d’« antiques couillons ».
- Clara : « Tous les pianistes sont des maniaques ».
- Il y a là un pianiste obsédé par Beethoven.
- « Et nous avons passé la soirée à mentir au monde qui nous l’a bien rendu ».
- Me rappelle la soirée à Sankt Anton avec le directeur du MET qui s’était déculotté. L’Amérique culturelle. Puis les masques glissent.
- Et l’on se retrouve à Rodeo Drive où ça décolle. (pp.37-39)
- Du lyrisme acéré. A lire à haute voix.
- « Si on sait comme ça blesse profondément le cœur, une jante ».
- Une façon de saisir des situations de fait par raccourcis saisissants.
- Et la prison.
- La prison où il fait meilleur que dehors souvent.
- « On leur donne le sens qui manque », lui avait dit son cousin flic.
- Sur quoi il enchaîne sur ses raisons d’écrire.
- Rien que par vanité !
- Pour se mirer génie dans le miroir. C’est ça.
- « C’est une affaire de nerfs », qu’il dit encore.
- Pointe « l’idéalisme foireux », Icare tombé de l’échelle.
- Dit ne plus croire à l’Artiste.
- Va voir une expo à Santa Monica. Fait le désagréable.
- Daube sur les discours esthétiques, science de branleurs. Pas tout faux.
- Participe cependant à « hurlements couverts ». On voit le tableau.
- L’esthétique « passe le temps ».
- Puis se retrouve chez une amie de Clara qui voit des alcooliques partout.
- Parce qu’elle siffle évidemment.
- On le met en garde contre le mari, vrai monstre.
- Et voilà le mari : un pauvre type chauve « le regard en délire », en chaise roulante.
- Qui a fait partie du cabinet de Schwarzenegger.
- Mais ne baise plus pour raison de santé.
- On l’accable. On l’attend au Funeral Home. Il aimerait aimer mais on le pousse là-bas. Très affreux tout ça.
- Puis le youngster reste trois semaines au lit chez Clara.
- Toujours malade ce petit monstre.
- Et c’est là qu’il remarque la fille de la voisine.
- Une certaine Laura.
- Dont Clara lui dit pis que pendre.
- Formidable ensuite : le récit du comment qu’on se laisse prendre. Par une fille pas vraiment belle mais qui accroche.
- Genre cristallisation à l’américaine. Très bien observé tout ça ma foi.
- Avec un aperçu subit du passé de Laura, fille d’alcoolos violents. Mais on lisse en surface. On fait face.
- « J’aurais aimé être dans ses frissons », note-t-il.
- Et pour se défendre : « Je n’aime pas aimer, je dois le dire, parce que j’ai l’impression d’être désarmé, nu, qu’un mot me fait hurler ».
- Ensuite vient le portrait plus détaillé de Laura. Là aussi tout en ellipses.
- Là encore une autre Amérique sous le verni de Westlake : brutale, paumée.
- Mais Laura ne va pas se lâcher pour autant.
- Alors que lui s’abandonne. Elle craint l’intimité, la rejette.
- « Ca m’a valu des misères de n’être pas tranquille, d’être aussi mal moulé à l’écorce du monde ».
- Laura le tolère «par exotisme ».
- Trop maigre pour être chaleureuse.
- Mais avant de se perdre ils vont à Pasadena.
- Lieu très culture Getty, très science et sport.
- « Einstein a vécu à Pasadena, on s’en costume encore »…
- Le cinéma d’Hollywood, plus la componction.
- Mais lui manque de manières culturelles.
- Avec Laura il vit une journée de bonheur quand même, entre L.A. et San Francisco.
- « Il y a des instants où les choses se montrent au jour, sans fard – sans hostilité ».
- « Le bonheur au creux des choses », en somme.
- Donc ça a l’air de mieux rouler. Et puis vient la nuit. Et patatrac !
- Deux pages magnifiques d’intense pudeur (pp.62-63)
- Ce qu’il a « avoué » à Laura se retourne contre lui.
- « A Palo Alto, tout mon bonheur s’est consumé ».
- Ne se parlent plus le lendemain.
- Lui aime intensément.
- Elle au petit pied.
- Elle a déjà passé outre. Lui restera marqué.
- Puis il revient sur Monterrey.
- Très fin cette économie des retours arrière.
- Retour sur une foire aux vieilles voitures. La nostalgie lourde.
- Et vient novembre plus frais. Avec l’envie du désert.
- Se dit qu’il pourrait regagner Laura par là.
- Mais elle courbe le rendez-vous.
- Se souviendra vaguement de lui.
- Evoque alors Los Angeles comme lieu de spectacle.
- Et le précipice que ça signifie.
- Evoque « cette existence qui ne se supporte que dans la projection. Cette existence qui doit sans cesse se mettre en scène »
- Chapitre II. Las Vegas
- Il arrive à Trona.
- Bled perdu s’il en est.
- Où il tombe sur un vieux type à crochet. Vétéran du Vietnam. Mais pas vraiment héros.
- Une vraie ramassée de sensations.
- La fibre d’un chroniqueur épico-lyrique. Sans trémolo.
- Se trouve d’abord à Barstow. Angoissé la moindre.
- La pause cigarette au bord de la route. « Tous les siècles l’un dans l’autre ».
- « Avec plus rien pour me montrer que le monde vieillit ». De la clope et du paquet de chips.
- Puis le temps « s’est remis en route ».
- La prose avance à petites phrases.
- Bakersfield. Paysages désolés. La ville fantôme de Red Mountain.
- Là aussi du vrai. Et voici Trona. « Aucun menteur ici ». Nowhere.
Et voici Trona. « Aucun menteur ici ». Nowhere.
- Et la station-service. Le vieux au crochet.
- « Pour être exact il faudrait dire les vices ou la violence. La haine ».
- On en apprend plus sur le crochet. Qu’il a échappé à un crash en hélico où ses copains sont restés.
- Le crochet qui se garde une arme pour si jamais, un M16.
- « J’ai rencontré beaucoup de fous dans le désert ».
- Le genre de phrase qui « étend » l’épique.
- Et voilà le champion de la Budweiser dégueulée. Qui poste sur Youtube.
- Joli numéro. Comme on en voit des tripotées sur WebcamWideWorld.
- Pas mal aussi la projection dans le temps : « Quand je suis rentré »…
- Le type typique de l’époque show à la maison. Star mondiale genre Deschiens.
- « Si j’allais moi aussi me cesser de mentir ? Là j’avais à Trona un monde qui ne sait plus mentir. C’était pas à envier ».
- Et d’ajouter : « le gros Jim était sincère. Il ne m’a pas donné beaucoup de goût pour la sincérité ».
- Et cela de remarquable : « Le gros Jim ? Nous étions frères ! Il était moins poète. C’était les mêmes efforts – c’était le même désert ».
- Et de relever qu’il est resté là « moins d’une journée »…
- Et de comparer Trona à Paris.
- Et d’en venir à l’église de Trona, genre bunker ou container.
- En quelques paragraphes : un monde !
- Fabuleuse dégringolade. Pas meilleur raccourci de la déréliction.
- Me rappelle le sapin à la rédaction, orné de papier de chiottes, que je décris dans Soleil d’hiver.
- Evoque le pauvre curé.
- La pauvre pancarte «Ouvert le dimanche ».
- Les ruses de la nouvelle pastorale : bénédiction des billets de loterie, du hamster de Madame, des jerrycans de Monsieur. Folie.
- Tout à fait la dérive d’Import/Export d’Ulrich Seidl en version californienne.
- Et Quentin : « ça renvoie aux anges ».
- Et l’on passe à la course d’école.
- A la Death Valley. Pas le pied pour les écoliers, même pas excités que ça se passe sous la mer.
- Sentence sur le travail. Un peu trop « dans le marbre » à mon goût.
- « On accouche d’une charogne comme racine d’une tragédie ». Bon, ça va…
- Mais après cela repart beaucoup plus fort (pp.85-86).
- Excellentes notations sur le déterminisme et la liberté, même si ça pèche par désabusement juvénile à mes yeux : «La seule liberté, la minuscule –mais l’unique, c’est de se tromper soi-même et d’abuser les autres ».
- Mais non, voyons…
- D’ailleurs les vérités du voyageur sont transitoires : on le verra.
- Intéressant aussi de voir s’amplifier la jalousie à distance.
- Le livre « pour lui montrer »…
- Très bon aussi le retour à la station d’essence.
- Le facteur sonne deux fois c’est connu.
- Et ça lui fait rencontrer Norbert, nouvel olibrius.
- Essai raté avec le crochet : réussi avec le briscard bavarois.
- Très bon portrait là aussi.
- En trois phrases on voit le lascar, émancipé par la voiture, vasectomisé pour la liberté de mouvement. L’époque !
- C’est par Norbert qu’il entend parler de Joshua Tree, où Quentin lira Céline.
- Norbert qui le presse de venir à Vegas !
- « Après L.A. et Trona, il me semblait avoir vécu dix ans ».
- Puis il a une panne.
- Un type à bermudas lui propose son aide et l’invite à un mariage. Il y va.
- Nouvelle séquence carabinée genre Amérique profonde. (p.92)
- Se sent intrus.
- Bientôt regardé de travers.
- Juif ou Arabe peut-être ? La parano galope. J’ai vécu ça comme ça en Floride et avec la mère de Kevin à propos du Vietnam.
- Passage du cercueil dans la cuisine.
- « J’ai roulé jusqu’à Bakersfield avec un souffle au cœur ».
- Excellent : « J’étais arrivé à l’homme au point exact où il se quitte ». - Puis c’est reparti jusqu’à Beatty.
- Puis c’est reparti jusqu’à Beatty.
- Un autre trou où fleurit la crédulité S.F.
- Le type à la caravane qui LES guette. « Les aliens. Les complots. Les maçons ».
- Et puis il a un élan de bonheur nomade.
- Et pense à cela : le repos du nomade, l’envie de se poser.
- Et l’on en vient au vieux John. Qui joue à Farmville avec un Roumain !
- « Que je ne rêvais pas ! ».
- Mais non c’est très réel le virtuel !
- Et débarque un autre type, agacé. Et les deux types parlent au bar sans plus s’occuper du voyageur. Là encore très bien observé. La routine conne des habitués.
- Et le transport soudain. Les stances de café du commerce dans le désert.
- « J’ai lu un truc sur les astéroïdes ».
- Ou ça de géant que Quentin doit inventer : « Il paraît que le monde tiendrait dans la main s’il n’y avait pas de vide ». Chiche qu’il invente pas !
- Il y a là-dedans de l’humanité directe dont parle Elie Faure à propos de Céline.
- Tout plein d’étincelles tout le temps.
- Puis il cède à l’invite de Norbert.
- Et c’est reparti dans le désert populeux.
- Et Vegas alors. L’éblouissement et le bouchon conjugués. On voit ça !
- « Qu’on électrise la détresse ça la rend regardable ».
- Exactement ce qu’il fait en somme avec ses mots.
- Et voilà la « passementerie d’ordures en féerie ».
- Toujours célinien mais à bon escient.
- Et ces notes persos sur la religion du toc (p.113)
- Se raille de faire le sociologue mais c’est aussi bien sinon mieux que le Baudrillard de Cool mémoires. Moins mode, plus dans la pâte et les « configurations d’abattoir ».
- Et voilà le Bellagio. Le pompon doré. Les levées avec Norbert dans la chambre qui valse. Là encore très Import/Export. On écoute Autechre. Tout le boucan.
- Le vieux punk qui convulse sur la moquette…
- Toutes caries et dorures.
- Et de brandir sa poétique. Sa trique seule, ben voyons.
- Et tout qui tourneboule boosté.
- Et tout qui retombe bientôt après les confettis et le vomi.
- Tout ça ramassé en beauté !
- Lendemain de Festen.
- Epilogue – Le Banquet
- Or ce n’est pas fini.
- Car voici le retour à la case départ et le bilan « j’ai perdu ».
- Qu’il croit le jeune gars. Et c’est vrai que les regards pèsent à l’arrivée.
- Genre raconte, fais nous rêver et va ranger tes affaires pour demain…
- Après les grands ciels du bout du monde, le giron des familles. Et après ?
- Chanson connue. Sentiment de frustration. « On va passer à table ».
- Les tapisseries gagnent.
- Le conteur va relancer un peu l’ambiance, mais ça fait mal quand même.
- « On vous étouffe familièrement à bas morceaux de Code, à reliefs de morale, à hoquets de folklore ».
- Cela d’un très jeune écrivain que je ne vois pas proliférer en français d’aujourd’hui.
- Devant les grimaces se promet grave de ne plus jouer.
- Pas croire qu’on « poulope » ensemble. Pas croire !
- Et de pointer le terrible sourire. Tout ce que ça me rappelle ! Le terrible sourire suisse.
- On te veut du bien que c’est pour ton bien.
- Lui proteste qu’il est de plusieurs continents et pas d’Europe ou du recoin.
- Pas citoyen régulier.
- Va voir à la Havane ma salope !
- « Mince haras » au poulain ! -
Entre la prairie et l'étoile
 (Le Temps accordé, 2023)À La Désirade, ce jeudi 15 juin. – Après sa première journée à faucher les hautes herbes d’alentour, notre ami népalais Buddha m’observait avec perplexité, hier soir, en train de préparer mon semainier de médocs, molécules salvatrices de mes deux, à savoir : 10/40 mg d’Ezetimib-Atorvastatin, 75 mg de Clopidogrel, 2 x 2,5 mg d’Eliquis apixaban, 5 mg de Lisinopril, 2 x 50 mg de Metoprolol et 2 x 50 mg de Panzoprazol, qui font en somme de moi un sponsor notable de la Big Pharma, sur quoi je lui ai filé le code de notre wi-fi pour qu’il puisse raconter sa journée aux siens – il a trois beaux enfants et une épouse active dans un choeur folklorique des abords de Katmandou, et quand je lui ai ouvert la fenêtre sur le lac immense et les monts de Savoie en train de se fondre dans l’obscurité violacée, dans la chambre qui lui est dévolue ces jours, il m’a remercié d’un « thank you sir » aussi respectueux qu’amicalement souriant…DE LA FOI. – C’est avec une émotion sincère que j’ai assisté, récemment, au baptême de notre petite dernière, Elizabeth de son prénom, ointe d’eau bénite tandis que ses deux petits frères tourniquaient autour du curé vietnamien, lequel accomplit le rite avec beaucoup de sérieux et force explications à l’intention des marraine et parrain, entre autres parents, avant de se déplacer devant la statue de la vierge qu’il y avait en retrait pour s’y livrer à un chant d’invocation dans sa langue – et cela m’a touché autant que d’autres probables mécréants ou piètres semi-croyants rassemblés, avec les petites sœurs de Teresa, dans la grande et belle église catho de Bellevaux dont les hautes fenêtres s’ouvrent sur la forêt voisine.Or lisant les pages de Michel Onfray qui évoquent le baptême paradoxal du Christ par Jean le guérisseur, et me rappelant le sort des non-baptisés retenus dans les Limbes de la Commedia de Dante, j’ai souri en me remémorant tout ça : ma propre confirmation non moins sincère de petit huguenot de seize ans, les multiples métamorphoses de ce que je n’ai plus guère appelé « ma foi » depuis l’âge de dix-sept ans - au dam de ma mère qui s’en inquiétait plus ou moins -, mon attirance momentanée pour le catholicisme bientôt refoidie par mon ami l’abbé V., ma révolte contre toutes les hypocrisie sociales ou politiques, l’amour de ma douce et la révélation « métaphysique » de notre sort mortel à la naissance de nos enfants, enfin mon rejet absolu du chantage pascalien au salut, mon refus non moins radical de l’idée de rétribution, enfin tout ce que nous avons vécu de bon et de beau dans l’apparente mécréance de notre amour, etc.
(Le Temps accordé, 2023)À La Désirade, ce jeudi 15 juin. – Après sa première journée à faucher les hautes herbes d’alentour, notre ami népalais Buddha m’observait avec perplexité, hier soir, en train de préparer mon semainier de médocs, molécules salvatrices de mes deux, à savoir : 10/40 mg d’Ezetimib-Atorvastatin, 75 mg de Clopidogrel, 2 x 2,5 mg d’Eliquis apixaban, 5 mg de Lisinopril, 2 x 50 mg de Metoprolol et 2 x 50 mg de Panzoprazol, qui font en somme de moi un sponsor notable de la Big Pharma, sur quoi je lui ai filé le code de notre wi-fi pour qu’il puisse raconter sa journée aux siens – il a trois beaux enfants et une épouse active dans un choeur folklorique des abords de Katmandou, et quand je lui ai ouvert la fenêtre sur le lac immense et les monts de Savoie en train de se fondre dans l’obscurité violacée, dans la chambre qui lui est dévolue ces jours, il m’a remercié d’un « thank you sir » aussi respectueux qu’amicalement souriant…DE LA FOI. – C’est avec une émotion sincère que j’ai assisté, récemment, au baptême de notre petite dernière, Elizabeth de son prénom, ointe d’eau bénite tandis que ses deux petits frères tourniquaient autour du curé vietnamien, lequel accomplit le rite avec beaucoup de sérieux et force explications à l’intention des marraine et parrain, entre autres parents, avant de se déplacer devant la statue de la vierge qu’il y avait en retrait pour s’y livrer à un chant d’invocation dans sa langue – et cela m’a touché autant que d’autres probables mécréants ou piètres semi-croyants rassemblés, avec les petites sœurs de Teresa, dans la grande et belle église catho de Bellevaux dont les hautes fenêtres s’ouvrent sur la forêt voisine.Or lisant les pages de Michel Onfray qui évoquent le baptême paradoxal du Christ par Jean le guérisseur, et me rappelant le sort des non-baptisés retenus dans les Limbes de la Commedia de Dante, j’ai souri en me remémorant tout ça : ma propre confirmation non moins sincère de petit huguenot de seize ans, les multiples métamorphoses de ce que je n’ai plus guère appelé « ma foi » depuis l’âge de dix-sept ans - au dam de ma mère qui s’en inquiétait plus ou moins -, mon attirance momentanée pour le catholicisme bientôt refoidie par mon ami l’abbé V., ma révolte contre toutes les hypocrisie sociales ou politiques, l’amour de ma douce et la révélation « métaphysique » de notre sort mortel à la naissance de nos enfants, enfin mon rejet absolu du chantage pascalien au salut, mon refus non moins radical de l’idée de rétribution, enfin tout ce que nous avons vécu de bon et de beau dans l’apparente mécréance de notre amour, etc.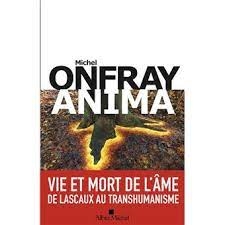 ANIMA. – Passer de ce que dit Claudel, à propos de Rimbaud, de l’accointance liant l’Animus et l’Anima, dans ses Réflexions sur la poésie si lumineuses parfois, au récit à la fois très érudit, très appliqué et dûment vulgarisé que fait Michel Onfray de la « construction » du rapport entre le corps et l'âme dans la tradition occidentale, d’abord égyptienne et ensuite pythagoricienne, platono-plotinienne et complétée à foison par les Pères de l’Eglise, c’est passer de ce que Peter Sloterdijk appelle la « théopoésie » à un discours théologique fondant bel et bien notre représentation dualiste « à tous les niveaux », et le mérite, alors, du dernier pavé d’Onfray jeté dans la mare des certitudes ou des indifférences, est de proposer un récit personnel qui stimule le nôtre – du moins est-ce mon cas alors que j’ai, déjà, lu les miliers de pages de tous les auteurs qui ont achoppé à La Question, de La volonté de croire de William James à l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, entre tant d’autres, jusqu’à La folie de Dieu de Sloterdijk et au chapitre si touchant du physicien Freeman Dyson en conclusion de La vie dans l’univers, qui montre une fois de plus que la foi n’est pas ce qu’on croit…
ANIMA. – Passer de ce que dit Claudel, à propos de Rimbaud, de l’accointance liant l’Animus et l’Anima, dans ses Réflexions sur la poésie si lumineuses parfois, au récit à la fois très érudit, très appliqué et dûment vulgarisé que fait Michel Onfray de la « construction » du rapport entre le corps et l'âme dans la tradition occidentale, d’abord égyptienne et ensuite pythagoricienne, platono-plotinienne et complétée à foison par les Pères de l’Eglise, c’est passer de ce que Peter Sloterdijk appelle la « théopoésie » à un discours théologique fondant bel et bien notre représentation dualiste « à tous les niveaux », et le mérite, alors, du dernier pavé d’Onfray jeté dans la mare des certitudes ou des indifférences, est de proposer un récit personnel qui stimule le nôtre – du moins est-ce mon cas alors que j’ai, déjà, lu les miliers de pages de tous les auteurs qui ont achoppé à La Question, de La volonté de croire de William James à l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, entre tant d’autres, jusqu’à La folie de Dieu de Sloterdijk et au chapitre si touchant du physicien Freeman Dyson en conclusion de La vie dans l’univers, qui montre une fois de plus que la foi n’est pas ce qu’on croit… -
Poésie et vérité
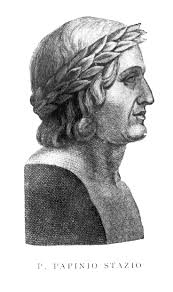
 Une lecture de la Commedia de Dante (53)
Une lecture de la Commedia de Dante (53)Chant XXI. Cinquième corniche: avarice et prodigalité. Stace le poète.
Une secousse tellurique d'une grande intensité a traversé la montagne du Purgatoire de la base à son sommet sans que Dante ni Virgile ne se l'expliquent, aussi est-ce avec une impatiente curiosité qu'ils vont interroger, à ce propos, une ombre qui vient de leur apparaître, debout au milieu des âmes gisant face contre terre le long de la corniche des ladres et des gaspilleurs - ladite ombre étant elle-même à l'origine du séisme. De fait, celui-ci correspond, ainsi qu'elle s'en explique, à sa libération récente, tant il est vrai que la purification effective d'une âme provoque à tout coup ce formidable tremblement, exultation métaphysique traduite par ce phénomène d'apparence t'ouvre physique... mais d'autres surprises non moindre attendent les compère.

Si le chant s'est amorcé par une évocation évangélique explicite (notamment avec l'épisode de la Samaritaine) de la soif spirituelle, et de la foi qui peut l'étancher, c'est de façon plus incarnée, historiquement et poétiquement fondée, Qu'il se développe ensuite à l'apparition de l'ombre citée, qui n'est autre que celle du poète latin Stace, fameux au Ier siècle de notre ère, contemporain de l'empereur Titus et qui se serait converti au christianisme selon Dante - ce qui ne semble pas avéré.
Mais l'important est ailleurs: dans le fait que l'auteur de la Commedia sauve Stace de la damnation comme il a sauvé Virgile, grâce à la poésie et à la purification terrestre qu'elle a favorisée. D'ailleurs Stace va révéler à Dante que c'est par la lecture de L'Enéide de Virgile qu'il est devenu lui-même, avant que Dante lui apprenne que son guide présent n'est autre que ce maitre sublime - et l'ombre de Stace de s'agenouiller au pied de l'ombre de Virgile, etc.
Touchant épisode que cette triple rencontre aux échos littéraires, poétiques et humains dénuées de tout artifice et donnant lieu, avec une pointe d'humour débonnaire, à une sorte de reconnaissance filiale hautement significative, sous l'égide de l'amitié occulte liant entre eux les grands poètes...
-
Bernanos et les âmes mortes
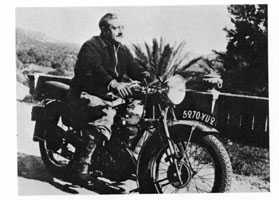
Monsieur Ouine relu au bord de de l'abîme...
En achevant ma énième lecture de Monsieur Ouine, cette fois annotée de part en part, je me demandais comment, aujourd’hui, paraissant en même temps que trois cents autres romans, un tel livre serait reçu, tant par la critique que par les amateurs de littérature. Il est difficile de le dire, malgré les abaissements de la lecture en général et de la critique littéraire actuelle en particulier, et probablement survivent des lecteurs de la qualité d’un Albert Béguin, grand laudateur du livre à sa parution (en avril 1946) ou d’une Claude-Edmonde Magny, qui lui consacra elle aussi un article mémorable.Or à l’écart des estrades médiatiques, qui sont ce qu’elles sont depuis qu’on y lança Radiguet comme un nouveau savon - ou même avant sans doute -, et malgré l’étiolement qualitatif des gazettes et la peau de chagrin des revues et autres lieux d’échanges, je m’obstine à voir encore des écrivains et des intellectuels qui ne sont ni plus bavards que leurs aïeux ni moins soignés de dentition que les chevaux de leurs aïeux, et je me réjouis par exemple de savoir René Girard vivant, dont la théorie mimétique pourrait s’appliquer à merveille à Monsieur Ouine.
Il est certain qu’en regard d'innombrables productions récentes , et autres commentaires critiques qui relève assez automatiquement de platitudes interchangeables, l’approche d’un livre tel que Monsieur Ouine exige non seulement la plus grande attention et la plus totale porosité, mais également un appareillage qui emprunte à l’expérience existentielle et spirituelle autant qu’à l’esthétique et à la métaphysique, voire à la théologie.Monsieur Ouine n’est en rien le roman « illisible » qu’ont dit certains, ni non plus le roman « désespéré » qu’on pourrait croire. C’est assurément une descente aux enfers du non-être modulée par une série de personnages dont chacun représente un abîme virtuel, mais c’est également le roman du possible retournement, de tous les aveux (jusqu’à la déréliction glacée du protagoniste) et de tous les égarements.
« Garde ton coeur en enfer et ne désespère pas », disait je ne sais plus quel saint quidam, et voici l’enfer : c’est le monde qui nous entoure, c’est la « paroisse morte » dans laquelle il semble que plus rien n’ait de sens, alors même que les âmes survivent de souffrir encore et que le grand vent de l’Amour les arrache à eux-mêmes - sauf celui que retient ce qu’il est convenu d’appeler le péché contre l’Esprit, mais qui condamnerait définitivement Monsieur Ouine lui-même ?
On n’est pas ici au catéchisme mais dans un roman, grand laboratoire d’humanité où les questions doivent rester incandescentes.
Il faut lire et relire Monsieur Ouine aujourd’hui, comme on peut relire La Route de Cormac McCarthy, sans se demander si nos contemporains sont encore « dignes » de ce livre et qui le comprendra. Un commentateur distrait réduisait naguère le roman à ce qu'il appelait l’ « apophatisme bernanosien » comme si l'ouvrage ressortissait essentiellement à une théologie négative, sans souligner assez, me semble-t-il, l’affirmation christique secrète et traversante de ce livre, qui recrache le tiède pour mieux figurer les avatars inattendus voire infinitésimaux de l’Amour.Monsieur Ouine, dans l’interprétation d’un René Girard, pourrait être dit le roman de la médiation interne portée à son point extrême, comme il en va des romans de Dostoïevski. Comme celui-ci, mais par une voie plus droite, Bernanos dépasse la tentation du désespoir et mime la sortie du cercle vicieux, comme « par défaut ». L’esprit d’enfance, au sens évangélique, irradie le tréfonds de ce livre glauque et même sale, alors même que cette souillure apparente échappe à la damnation réelle du froid et du non-être: « Le Mal c’est le froid, le Mal c’est le néant, le Mal n’est rien d’autre, finalement, que l’ennui, ce dernier parvenu à son plus idoine état de desséchement »…
Georges Bernanos, Monsieur Ouine, Plon, 1946.

-
L’immortalité de Kundera vous attend à la ressourcerie…
 Revenir au grand écrivain disparu nous révèle son éventuelle actualité – tout dépend de notre lecture -, fût-ce trente-trois ans après la parution d’un de ses plus grands romans, mêlant une réflexion pénétrante sur les avatars et autres simulacres de la passion amoureuse et sur le déclin de la culture européenne, nos vanités mortelles et ce qui leur survit. Au moment de relire l’Œuvre : souvenir d’une rencontre en 1984…La coïncidence anecdotique pourrait relever de la fiction, et pourtant non: une sorte d’ironie des circonstances m’a fait découvrir, il y a deux semaines de ça, serré dans les rayons très richement pourvus de la ressourcerie des Fosses, sous les piliers de l’autoroute des hauts de Montreux, tel exemplaire de L’Immortalité de Milan Kundera ayant appartenu à une certaine Teresa, homonyme à une lettre près de la protagoniste de L’insoutenable légèreté de l’être…
Revenir au grand écrivain disparu nous révèle son éventuelle actualité – tout dépend de notre lecture -, fût-ce trente-trois ans après la parution d’un de ses plus grands romans, mêlant une réflexion pénétrante sur les avatars et autres simulacres de la passion amoureuse et sur le déclin de la culture européenne, nos vanités mortelles et ce qui leur survit. Au moment de relire l’Œuvre : souvenir d’une rencontre en 1984…La coïncidence anecdotique pourrait relever de la fiction, et pourtant non: une sorte d’ironie des circonstances m’a fait découvrir, il y a deux semaines de ça, serré dans les rayons très richement pourvus de la ressourcerie des Fosses, sous les piliers de l’autoroute des hauts de Montreux, tel exemplaire de L’Immortalité de Milan Kundera ayant appartenu à une certaine Teresa, homonyme à une lettre près de la protagoniste de L’insoutenable légèreté de l’être…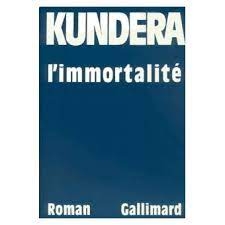 Or, me rappelant que je n'avais plus l’édition originale du roman pour l’avoir prêtée à un ami disparu depuis lors, je m’emparai du volume offert à la reprise - cinq jours avant d’apprendre la mort de l’écrivain…Autre ironie des choses de la vie : que l’auteur de L’Immortalité tirât ainsi sa révérence après avoir été, pour beaucoup, oublié de son vivant. De quoi rire ? Bien plutôt : de quoi le relire !Par delà le kitsch de la gloireL’expression, kitsch au possible, d’«auteur culte », a été appliquée maintes fois à Milan Kundera, dont l’œuvre distille pourtant les anticorps d’une ironie critique défiant toute adulation convenue.Pourtant il fut un temps, aujourd’hui passé, où lire L’insoutenable légèreté de l’être passait pour le top du chic - carrément «incontournable». C’était un peu moins de vingt ans après la parution de La Plaisanterie - l’année de nos vingt ans à nous -, premier grand roman du jeune Tchèque qui lui valut l’opprobre de son pays et reflète le climat d’une époque (comme le cinéma de ces années, par exemple avec Les Amours d’une blonde de Milos Forman) tout en se distinguant nettement de la littérature dissidente par son rejet intrinsèque de toute idéologie – plus tard, un Soljenitsyne taxera cette position de «pluraliste»…
Or, me rappelant que je n'avais plus l’édition originale du roman pour l’avoir prêtée à un ami disparu depuis lors, je m’emparai du volume offert à la reprise - cinq jours avant d’apprendre la mort de l’écrivain…Autre ironie des choses de la vie : que l’auteur de L’Immortalité tirât ainsi sa révérence après avoir été, pour beaucoup, oublié de son vivant. De quoi rire ? Bien plutôt : de quoi le relire !Par delà le kitsch de la gloireL’expression, kitsch au possible, d’«auteur culte », a été appliquée maintes fois à Milan Kundera, dont l’œuvre distille pourtant les anticorps d’une ironie critique défiant toute adulation convenue.Pourtant il fut un temps, aujourd’hui passé, où lire L’insoutenable légèreté de l’être passait pour le top du chic - carrément «incontournable». C’était un peu moins de vingt ans après la parution de La Plaisanterie - l’année de nos vingt ans à nous -, premier grand roman du jeune Tchèque qui lui valut l’opprobre de son pays et reflète le climat d’une époque (comme le cinéma de ces années, par exemple avec Les Amours d’une blonde de Milos Forman) tout en se distinguant nettement de la littérature dissidente par son rejet intrinsèque de toute idéologie – plus tard, un Soljenitsyne taxera cette position de «pluraliste»… Milan Kundera s’est défini comme «un hédoniste perdu dans un monde politisé à l’extrême». Cela valut, à l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être, le reproche d’être frivole. C’était ne pas voir que son engagement, bien plus profond que celui de tant d’écrivains «engagés», opposait une interrogation existentielle fondamentale sur la société communiste, qu’il poursuivrait en Occident d’une autre façon. Ses romans sont subversifs en termes artistiques et humains, illustrant, avec une ironie implacable, alliée à une empathie humaine non sentimentale, la bêtise et le conformisme, le faux sérieux et l’arrivisme. S’il s’est toujours efforcé de dissiper le malentendu faisant de lui un romancier «politique», Milan Kundera, boxeur en ses jeunes années, n’en mena pas moins un formidable combat pour la défense de l’intelligence et de l’art, des qualités humaines et du vrai sérieux.Dès la première nouvelle de Risibles amours, intitulé Personne ne rira, c’est ainsi une femme sensible qui fait le procès d’un jeune intellectuel cynique. Dans la foulée, avec La Plaisanterie, le magnifique Livre du rire et de l’oubli, marquant sa percée aux Etats-Unis, L’Insoutenable légèreté de l’être au retentissement mondial, et L’Immortalité, Kundera développa un art mêlant vie privée et réflexion sociale, qui font du roman un outil d’analyse à l'incomparable plasticité poétique et musicale - une «comédie humaine» inépuisable.«La bêtise des hommes vient de ce qu’ils ont réponse à tout. La sagesse du roman, c’est d’avoir question à tout», écrit Milan Kundera dans L'Art du roman, et toute son oeuvre en témoigne aussi bien.Un entretien entre « frères humains »Avant de reprendre L’Immortalité, je me suis rappelé – privilège extraordinaire à ce qu’il semble aujourd’hui -, ma rencontre parisienne de Milan Kundera, en 1984, dans les jardins du Luxembourg, d’abord à regarder les enfants jouant au soleil, et c’était la vie, puis auprès du le buste de Paul Verlaine bien grave, devant lequel je dis à l’écrivain – un lustre avant son roman fameux -, que j’avais découvert que j’étais mortel au matin de la naissance de notre première fille, deux ans auparavant – et lui d’avoir un geste de saisissement joyeux, les mains au ciel !Mais rien chez lui, à ce moment-là, de l’écrivain célèbre en représentation, plutôt : un frère humain s’intéressant sincèrement aux «mots» impayables de la petite que je lui rapportai, avant de rire de ceux qu’il appelle «les anges» dans Le Livre du rire et de l’oubli auquel j’avais consacré, en 1979, un long papier dont il m’avait remercié de sa main: «Ah, les anges, ce sont tous ces personnages qu’on voit, aujourd’hui, adhérer à la « réalité » sans aucun recul ni la moindre ironie, qui répètent en psalmodiant les slogans de la politique ou les litanies de la dernière mode, qu’il s’agisse de musique pop ou de toquades intellectuelles. Et remarquez qu’ils ne rient pas. Et voyez ces gens qui entendent à tout prix établir partout l’innocence. C’est l’idylle en politique, mais c’est aussi l’angélisme en matière d’érotisme, qui nous fait régresser dans une sorte de paradis sans aucune tension, relief ou passion, bref tout le contraire de l’amour »…
Milan Kundera s’est défini comme «un hédoniste perdu dans un monde politisé à l’extrême». Cela valut, à l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être, le reproche d’être frivole. C’était ne pas voir que son engagement, bien plus profond que celui de tant d’écrivains «engagés», opposait une interrogation existentielle fondamentale sur la société communiste, qu’il poursuivrait en Occident d’une autre façon. Ses romans sont subversifs en termes artistiques et humains, illustrant, avec une ironie implacable, alliée à une empathie humaine non sentimentale, la bêtise et le conformisme, le faux sérieux et l’arrivisme. S’il s’est toujours efforcé de dissiper le malentendu faisant de lui un romancier «politique», Milan Kundera, boxeur en ses jeunes années, n’en mena pas moins un formidable combat pour la défense de l’intelligence et de l’art, des qualités humaines et du vrai sérieux.Dès la première nouvelle de Risibles amours, intitulé Personne ne rira, c’est ainsi une femme sensible qui fait le procès d’un jeune intellectuel cynique. Dans la foulée, avec La Plaisanterie, le magnifique Livre du rire et de l’oubli, marquant sa percée aux Etats-Unis, L’Insoutenable légèreté de l’être au retentissement mondial, et L’Immortalité, Kundera développa un art mêlant vie privée et réflexion sociale, qui font du roman un outil d’analyse à l'incomparable plasticité poétique et musicale - une «comédie humaine» inépuisable.«La bêtise des hommes vient de ce qu’ils ont réponse à tout. La sagesse du roman, c’est d’avoir question à tout», écrit Milan Kundera dans L'Art du roman, et toute son oeuvre en témoigne aussi bien.Un entretien entre « frères humains »Avant de reprendre L’Immortalité, je me suis rappelé – privilège extraordinaire à ce qu’il semble aujourd’hui -, ma rencontre parisienne de Milan Kundera, en 1984, dans les jardins du Luxembourg, d’abord à regarder les enfants jouant au soleil, et c’était la vie, puis auprès du le buste de Paul Verlaine bien grave, devant lequel je dis à l’écrivain – un lustre avant son roman fameux -, que j’avais découvert que j’étais mortel au matin de la naissance de notre première fille, deux ans auparavant – et lui d’avoir un geste de saisissement joyeux, les mains au ciel !Mais rien chez lui, à ce moment-là, de l’écrivain célèbre en représentation, plutôt : un frère humain s’intéressant sincèrement aux «mots» impayables de la petite que je lui rapportai, avant de rire de ceux qu’il appelle «les anges» dans Le Livre du rire et de l’oubli auquel j’avais consacré, en 1979, un long papier dont il m’avait remercié de sa main: «Ah, les anges, ce sont tous ces personnages qu’on voit, aujourd’hui, adhérer à la « réalité » sans aucun recul ni la moindre ironie, qui répètent en psalmodiant les slogans de la politique ou les litanies de la dernière mode, qu’il s’agisse de musique pop ou de toquades intellectuelles. Et remarquez qu’ils ne rient pas. Et voyez ces gens qui entendent à tout prix établir partout l’innocence. C’est l’idylle en politique, mais c’est aussi l’angélisme en matière d’érotisme, qui nous fait régresser dans une sorte de paradis sans aucune tension, relief ou passion, bref tout le contraire de l’amour »…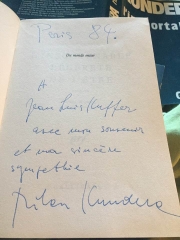 Sa dédicace sur mon exemplaire de L’Insoutenable légèreté de l’être parle de «sincère sympathie » et de «souvenir », et je me rappelle le sérieux sans affectation de ses réponses et sa bienveillance sans flatterie, vraiment rien de l’immortel poseur. Mais est-ce dire qu’il doutât de l’immortalité de son Œuvre ? J’espère bien que non ! « Un écrivain qui ne se gobe pas n’est pas digne de ce titre ! », me disait un jour Pierre Gripari. Et Ludwig Hohl de renchérir : « Celui qui n’a pas vu qu’il est immortel n’a pas droit à la parole »…Mensonge romantique et miroir du romanLire Kundera, me dis-je ce soir en revenant à L’Immortalité, c’est lire et relire sa propre vie avec un regard plus distant et plus amical à la fois, où l'immortel Wolfgang von Goethe devient l'un des personnages du roman au même titre que son pair Hemingway rencontré sur les sentiers de l'au-delà.Ce qu'il faut alors se rappeler, c'est qu'il y a deux formes d’immortalité, à part la postulation religieuse de l’immortalité de l’âme, à savoir : la petite immortalité accessible à nous tous, qui fait que nous survivons dans la mémoire de nos proches tant qu’eux-mêmes vont et viennent dans le luna park des saisons, et la grande immortalité à médailles et lauriers dont le Temple de la Gloire est le lieu de consécration visible, où Bettina von Brentano, la groupie la plus éminente du plus éminent poète européen de l’époque, en la personne de Goethe, aura tout fait pour accompagner celui-ci en multipliant les « selfies »…Dimension Nobel !Je ne sais plus qui, du milieu littéraire parisien, me disait, il y a bien des années de ça, que Milan Kundera était obsédé par le fait d’obtenir le prix Nobel de littérature, mais il est fort possible que ce ne fût qu’un ragot - pareil à l'infamie faisant de lui un délateur en 1950, sur la base d'un faux rapport de police - découlant de la jalousie que l’écrivain suscitait précisément dans le milieu en question.Pour ma part, j’ai relevé, chez un Ismaïl Kadaré ou un Antonio Lobo Antunes, avec lesquels je me trouvais en entretien, la même impatience légitime de voir couronnés des auteurs qu’ils estimaient visiblement moins méritants qu’eux-mêmes, dont le pauvre Bob Dylan aura naturellement été le meilleur exemple, avant la non moins blême Annie Ernaux - et comment ne pas les comprendre ?Mais on peut rappeler, pour détendre l’atmosphère, que Sully Prudhomme, poète de seconde zone mais premier Nobel de littérature en 1901 -, annonça la grise couleur, suivi, dans la ribambelles des «immortels» nobélisés, par de nombreux auteurs voués à l’oubli, alors qu’un Marcel Proust, un Louis-Ferdinand Céline ou un Vladimir Nabokov auront connu le même sort que Milan Kundera non sans relever de la même « dimension Nobel» , etc.Et puis quoi ? Et puis rien: reste l'Oeuvre. Deux volumes de la prestigieuse Bibliothèque de La Pléiade, dans une édition établie sous la direction de l'Auteur par François Ricard, sans l'appareil critique scientifique permettant aux universitaires d'ajouter leur nom au générique glorieux, la biographie de l'auteur se trouvant également zappée au profit d'une biographie des quinze romans et essais réunis. Ne cherchez pas ailleurs, la vie est là, on dirait avec un clin d’oeil: immortelle...Milan Kundera. Oeuvre. Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol. Gallimard, 2011.
Sa dédicace sur mon exemplaire de L’Insoutenable légèreté de l’être parle de «sincère sympathie » et de «souvenir », et je me rappelle le sérieux sans affectation de ses réponses et sa bienveillance sans flatterie, vraiment rien de l’immortel poseur. Mais est-ce dire qu’il doutât de l’immortalité de son Œuvre ? J’espère bien que non ! « Un écrivain qui ne se gobe pas n’est pas digne de ce titre ! », me disait un jour Pierre Gripari. Et Ludwig Hohl de renchérir : « Celui qui n’a pas vu qu’il est immortel n’a pas droit à la parole »…Mensonge romantique et miroir du romanLire Kundera, me dis-je ce soir en revenant à L’Immortalité, c’est lire et relire sa propre vie avec un regard plus distant et plus amical à la fois, où l'immortel Wolfgang von Goethe devient l'un des personnages du roman au même titre que son pair Hemingway rencontré sur les sentiers de l'au-delà.Ce qu'il faut alors se rappeler, c'est qu'il y a deux formes d’immortalité, à part la postulation religieuse de l’immortalité de l’âme, à savoir : la petite immortalité accessible à nous tous, qui fait que nous survivons dans la mémoire de nos proches tant qu’eux-mêmes vont et viennent dans le luna park des saisons, et la grande immortalité à médailles et lauriers dont le Temple de la Gloire est le lieu de consécration visible, où Bettina von Brentano, la groupie la plus éminente du plus éminent poète européen de l’époque, en la personne de Goethe, aura tout fait pour accompagner celui-ci en multipliant les « selfies »…Dimension Nobel !Je ne sais plus qui, du milieu littéraire parisien, me disait, il y a bien des années de ça, que Milan Kundera était obsédé par le fait d’obtenir le prix Nobel de littérature, mais il est fort possible que ce ne fût qu’un ragot - pareil à l'infamie faisant de lui un délateur en 1950, sur la base d'un faux rapport de police - découlant de la jalousie que l’écrivain suscitait précisément dans le milieu en question.Pour ma part, j’ai relevé, chez un Ismaïl Kadaré ou un Antonio Lobo Antunes, avec lesquels je me trouvais en entretien, la même impatience légitime de voir couronnés des auteurs qu’ils estimaient visiblement moins méritants qu’eux-mêmes, dont le pauvre Bob Dylan aura naturellement été le meilleur exemple, avant la non moins blême Annie Ernaux - et comment ne pas les comprendre ?Mais on peut rappeler, pour détendre l’atmosphère, que Sully Prudhomme, poète de seconde zone mais premier Nobel de littérature en 1901 -, annonça la grise couleur, suivi, dans la ribambelles des «immortels» nobélisés, par de nombreux auteurs voués à l’oubli, alors qu’un Marcel Proust, un Louis-Ferdinand Céline ou un Vladimir Nabokov auront connu le même sort que Milan Kundera non sans relever de la même « dimension Nobel» , etc.Et puis quoi ? Et puis rien: reste l'Oeuvre. Deux volumes de la prestigieuse Bibliothèque de La Pléiade, dans une édition établie sous la direction de l'Auteur par François Ricard, sans l'appareil critique scientifique permettant aux universitaires d'ajouter leur nom au générique glorieux, la biographie de l'auteur se trouvant également zappée au profit d'une biographie des quinze romans et essais réunis. Ne cherchez pas ailleurs, la vie est là, on dirait avec un clin d’oeil: immortelle...Milan Kundera. Oeuvre. Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol. Gallimard, 2011. -
La mémoire d’avant
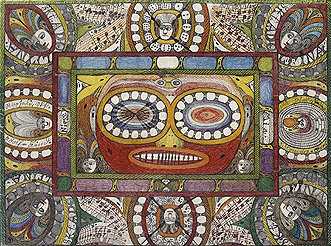
En lisant Kotik Letaev, d’Andréi Biély
Un livre qu'on a l'impression de lire les paupières baissées et le regard tourné vers l'intérieur, lequel s'ouvrirait à l'Univers de la prime conscience: tel est le génial Kotik Letaev d'Andréi Biély.
L'enfance de Kotik, à savoir l'auteur lui-même qui plonge son regard de voyant dans les turbulences de sa mémoire d'avant la troisième année, c'est d'abord le monde indifférencié que doivent percevoir les animalcules de la soupe originelle et toute la suite des créatures non consciente de leur sort, jusqu'aux iguanes accrochés à leurs promontoires, aux îles Galapagos, ruisselants d'eau de mer et faisant rouler les globes de leurs yeux comme de vieilles planètes.
En deça de toute identité, l'on se trouve soudain précipité dans l'espace et le temps, écorché vif, livré au soufle d'un verbe semblant d'avant la parole, avant toute limite établie, dans la polyphobnie chaotique d'
AU COMMENCEMENT.
Dans l'innocence d'un jour éternel, assis sur la pelouse d'une placide maison familiale, l'enfant barbouillé de terre déchire minutieusement les élytres d'un scarabée tandis qu'au-dessus de lui, tombée de ce ciel où ils lui ont dit que Lebondieu demeurait, tonne puissamment une voix, qui n'est peut-être que celle d'un fulminant orage d'été.
Or le craquement sinistre de celui-ci me rappellera toujours, à moi l'enfant des climats alpins de l'ère historique, cette scène du premier massacre et le choc terrible des titans antédiluviens se dressant les uns contre les autres aux créneaux des monts de Savoie ou de l'Oberland maternel.
Ptérodactyles, Iguanodons, Tyranosaures.
Dans la pénombre du bureau de mon grand-père, je coloriais leurs images aux crayons Prismalo.
Ou bien, autre réminiscence confuse: cet après-midi de foehn à l'air de plomb liquide, où l'enfant avait cru qu'ils avaient résolu de le laisser périr de soif, seul dans son nid de Varicelles. Comme elles grouillaient alors au-dessus de l'oreiller rose sentant les larmes et la verveine, ces Varicelles aux trompes de sangsues et aux ailes de papier de soie, qui tournoyaient à chaque poussée de fièvre. Et comme il les avait maudits, alors, sans pouvoir dire quoi que ce fût, elle la mère aux mains gercées (une voix un peu plus haute et plus impatiente) et lui le père exhalant la matin l'eau de Cologne et le soir la fumée de ses Parisiennes. Et le tonnerre secoue la maison. Et l'enfant crie sans mot dire: “Au secours !”. Et la mère: “Je n'en peux plus !”. Et le visiteur à l'odeur inconnue et aux mains pommadées: - C'est la croissance, Madame.
Au commencement était le chaos-sans-images-et-sans-heures.
“En ce temps-là il n'y avait pas de moi -
- il y avait un corps chétif; et la conscience, en l'étreignant, se vivait elle-même dans un monde impénétrable et incommensurable. En moi se formaient des bouillonnements d'écume; la chaleur m'écumait; j'étais torturé, chauffé au rouge; le corps ébouillanté bouillonnait de conscience (os dans acide grésillent, pétillent et bouillonnent). Enfin écuma la première image et ma vie se mit à bouillonner d'images, écuma d'écume montant à moi”.
Ces images, ce sont les mythes, fleurs étranges remontant des grands fonds de l'inconscient de l'Espèce, les archétypes efflorescents de la pensée anthropomorphe, elle-même née de la pensée cosmique.
Ou c'est la basse continue d'un long jour de Scarlatine.
Une puissance amère et brûlante s'est emparée de l'enfant, lequel non seulement cuit dans le feu comme un pain de charbon, mais sait à présent que cette chose qui commence à se craqueler dans les flammes, c'est lui-même.
JE SUIS MOI !
Et j'arrache mes draps, mais les Frissons, dont il est notoire que ce sont les sbires de la sorcière Scarlatine, continuent de me glacer de leur souffle brûlant.
De temps à autre cependant, et quel apaisement ce sera par les années, les draps reviennent à l'enfant tout frais et parfumés, et la lumière vaporeuse filtrant de la fenêtre ouverte à travers les rideaux tirés, paraît chargée d'une vapeur de tisane et des premiers souffles printanniers.
Puis ce sont les premières représentations.
Là, les chambres de DEDANS où cohabitent enfants et mamans, dans un rempart odoriférant d'encaustique et de Baume du Tigre.
Là-bas, l'univers plus mystérieux de DEHORS que rejoignent chaque matin les papas - l'univers des sensations, des images, des émotions et des mots en tas.
Et ce tas est le monde. “Qu'est-ce que cela ?” demande la mère en désignant une poule derrière les grillages du fond du jardin. Et l'enfant de répondre: “Une poule”, et de préciser sous cape: “La poule ? Eh bien, c'est quelque chose de crêtelé-plumeté, ça caquète, ça crétèle, ça picore, ça s'ébouriffe; ça ne change pas au gré de mes états d'âme; la poule, c'est imperméable à tout; et qui plus est, c'est parfaitement distinct; incompréhensible; et pourtant combien précise, époustouflante, cette poule qui vaque à son existence picorante, ébouriffée. D'un côté, mon moi, et de l'autre une mouche. La mouche me tourmente”.Andréli Biély. Kotik Letaev. L'Age d'Homme.
Dessin: Adolf Wölffli
-
Bleu lagon et retouches
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Désirade, ce samedi 20 juillet (soir). – Le paysage de cette fin de soirée d’été diaphane et comme épurée, le val suspendu à peu près silencieux, juste ponctué de quelques clarines assourdies, et les pentes boisées de la Savoie d’en face comme enveloppées de soie au-dessus des eaux du lac à la surface duquel ne se distingue plus aucune voile - cette vision paisible et comme hors du temps se transforme, sur l’écran de mon laptop où je reviens après un long téléphone à Fuerteventura où ma jeune octogénaire de frangine et sa fille, escortées par les deux éphèbes surfeurs de celle-ci, villégiaturent en toute insouciance alors que l’Occident décline (paraît-il) et que s’imposent les autocrates et les anti-démocrates de tout acabit, et voici que mon œil virtuel a roulé du tréfonds de l’azur vers les sables blancs et les lagunes de Costa calma…Nos éphèbes vont s’éclater en ces lieux d’intense exulattion sportive, à l’enseigne de je ne sais que championnat de surf, alors que l’aîné s’apprête à l’initiation au kitesurf qui lui permettra de survoler la vague et de rebondir dans les nuages effilés par le vent fou – ma sœur en était ce matin toute décoiffée et la bouche pleine de sable…Le seul nom de Lanzarote, dans la conversation de ce soir, m’a rappelé l’apparition surréaliste d’un Michel Houellebecq se protégeant de la pluie latino de Locarno sous un parapluie jaune à fleurs violettes, venu présenter La possibilité d’un île en version cinématographque, remarquable film raté cousu de clichés kitsch et d’idées surprenantes, et le seul nom d’Houellebecq m’a ramené à notre repas de ce midi partagé avec mes amis Jackie et Tonio, où nous avons parlé, avec celui-ci, du bel hommage de l’écrivain à son pair Benoît Duteurtre, que Tonio a lu plus que moi.Par ailleurs, j’ai vivement contrdedit le même Tonio, qui s’était lancé dans un éloge du Journal particulier de Paul Léautaud – recueil artificiel et selon moi tout à fait déplacé, des scènes de cul du Journal littéraire sorties de leur contexte – où mon compère voit un affrontement psychologique compliqué à la Strindberg, avec du sado-masochisme au programme, alors que j’y vois essentiellement les scènes chaudes d’un maigre bonhomme saillant sa grasse bonne femme (Le Fléau devant peser deux fois plus que lui) relatées d’une plume volontairement claire et sèche même quand gicle la jute ; mais tout de même j’ai précisé, à la table de mes amis (filets de perches et tartares de saumon arrosé de rouge Coup de sang), que je préférais ces passages d’une honnêteté crasse aux ornements mystico-érotiques d’un Jouhandeau divinisant à la gréco-catho la flamberge et le trou du cul…Aussi le nom de Mozart m’est revenu à table, à propos de la face parfois insondable des génies – Jackie, qui en sait quelque chose, a parlé de bipolarité à son propos – alors que nous parlions de la méchanceté occasionnelle de notre ami Haldas, présumé scribe de l’Attention à l’Autre, de sa misogynie et de son homophie non moins affirmée - mais faut pas charrier, aurons-nous convenu en trio : ce cher Georges a vécu 95 ans, ce qui est beaucoup trop, et signé 83 livres, cela excusant en somme ses manquements éventuels à la compassion ou à la fine éducation des beaux quartiers de Genève, etc.Enfin nous nous serons esbaudis de concert (voire de conserve), avec mes amis, en nous rappelant que nous aurons connu la société de Georges Haldas, tout à fait infoutu de manipuler un ordi dernière généraion, ce même Haldas tout proche du Serbe réac Dimitri convaincu qu’Internet est un enfer, nous auros connu les derniers feux de la société de Charles-Albert Cingria dont le père de Tonio était le cardiologue attentif, avant que les auteurs et autrices de ce pays ne deviennent des feuilletonistes de polars locaux avides de reconnaissance médiatique, nous aurons connu le merveilleux Chappaz proclamant qu’il n’y a pas de salut hors de l’Eglise – alors même qu’il conchiait les promoteurs de son canton, nous aurons connu Maître Jacques lui aussi scotché à son Hermès mécanique à capot et se convulsant de jalousie littéraire traditionnelle à la seule évocation des noms de Bouvier ou de Jaccottet – nous aurons connu ce « monde d’avant » selon l’expression de Roland Jaccard, à l’école de Platon et de Lucrèce qui disaient à peu près la même chose, et dans la foulée je dis à Jackie, qui évoque la peau de chagrin de ses amis, que j’en ai 5000 sur Facebook et que s’il y en a 12 qui me suivent vraiment avec mes amies Bonzon et Massard plus elle-même et Nicole Hebert, ou Jaton et Gaudefroy, Prodhom et Mudry, entre autres potes Novet et Durand, et JMO ou Morattel ou Perrin et Mouron et j'en oublie, va pour le monde d’après s’il y a de l’Humagne au buffet…
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Désirade, ce samedi 20 juillet (soir). – Le paysage de cette fin de soirée d’été diaphane et comme épurée, le val suspendu à peu près silencieux, juste ponctué de quelques clarines assourdies, et les pentes boisées de la Savoie d’en face comme enveloppées de soie au-dessus des eaux du lac à la surface duquel ne se distingue plus aucune voile - cette vision paisible et comme hors du temps se transforme, sur l’écran de mon laptop où je reviens après un long téléphone à Fuerteventura où ma jeune octogénaire de frangine et sa fille, escortées par les deux éphèbes surfeurs de celle-ci, villégiaturent en toute insouciance alors que l’Occident décline (paraît-il) et que s’imposent les autocrates et les anti-démocrates de tout acabit, et voici que mon œil virtuel a roulé du tréfonds de l’azur vers les sables blancs et les lagunes de Costa calma…Nos éphèbes vont s’éclater en ces lieux d’intense exulattion sportive, à l’enseigne de je ne sais que championnat de surf, alors que l’aîné s’apprête à l’initiation au kitesurf qui lui permettra de survoler la vague et de rebondir dans les nuages effilés par le vent fou – ma sœur en était ce matin toute décoiffée et la bouche pleine de sable…Le seul nom de Lanzarote, dans la conversation de ce soir, m’a rappelé l’apparition surréaliste d’un Michel Houellebecq se protégeant de la pluie latino de Locarno sous un parapluie jaune à fleurs violettes, venu présenter La possibilité d’un île en version cinématographque, remarquable film raté cousu de clichés kitsch et d’idées surprenantes, et le seul nom d’Houellebecq m’a ramené à notre repas de ce midi partagé avec mes amis Jackie et Tonio, où nous avons parlé, avec celui-ci, du bel hommage de l’écrivain à son pair Benoît Duteurtre, que Tonio a lu plus que moi.Par ailleurs, j’ai vivement contrdedit le même Tonio, qui s’était lancé dans un éloge du Journal particulier de Paul Léautaud – recueil artificiel et selon moi tout à fait déplacé, des scènes de cul du Journal littéraire sorties de leur contexte – où mon compère voit un affrontement psychologique compliqué à la Strindberg, avec du sado-masochisme au programme, alors que j’y vois essentiellement les scènes chaudes d’un maigre bonhomme saillant sa grasse bonne femme (Le Fléau devant peser deux fois plus que lui) relatées d’une plume volontairement claire et sèche même quand gicle la jute ; mais tout de même j’ai précisé, à la table de mes amis (filets de perches et tartares de saumon arrosé de rouge Coup de sang), que je préférais ces passages d’une honnêteté crasse aux ornements mystico-érotiques d’un Jouhandeau divinisant à la gréco-catho la flamberge et le trou du cul…Aussi le nom de Mozart m’est revenu à table, à propos de la face parfois insondable des génies – Jackie, qui en sait quelque chose, a parlé de bipolarité à son propos – alors que nous parlions de la méchanceté occasionnelle de notre ami Haldas, présumé scribe de l’Attention à l’Autre, de sa misogynie et de son homophie non moins affirmée - mais faut pas charrier, aurons-nous convenu en trio : ce cher Georges a vécu 95 ans, ce qui est beaucoup trop, et signé 83 livres, cela excusant en somme ses manquements éventuels à la compassion ou à la fine éducation des beaux quartiers de Genève, etc.Enfin nous nous serons esbaudis de concert (voire de conserve), avec mes amis, en nous rappelant que nous aurons connu la société de Georges Haldas, tout à fait infoutu de manipuler un ordi dernière généraion, ce même Haldas tout proche du Serbe réac Dimitri convaincu qu’Internet est un enfer, nous auros connu les derniers feux de la société de Charles-Albert Cingria dont le père de Tonio était le cardiologue attentif, avant que les auteurs et autrices de ce pays ne deviennent des feuilletonistes de polars locaux avides de reconnaissance médiatique, nous aurons connu le merveilleux Chappaz proclamant qu’il n’y a pas de salut hors de l’Eglise – alors même qu’il conchiait les promoteurs de son canton, nous aurons connu Maître Jacques lui aussi scotché à son Hermès mécanique à capot et se convulsant de jalousie littéraire traditionnelle à la seule évocation des noms de Bouvier ou de Jaccottet – nous aurons connu ce « monde d’avant » selon l’expression de Roland Jaccard, à l’école de Platon et de Lucrèce qui disaient à peu près la même chose, et dans la foulée je dis à Jackie, qui évoque la peau de chagrin de ses amis, que j’en ai 5000 sur Facebook et que s’il y en a 12 qui me suivent vraiment avec mes amies Bonzon et Massard plus elle-même et Nicole Hebert, ou Jaton et Gaudefroy, Prodhom et Mudry, entre autres potes Novet et Durand, et JMO ou Morattel ou Perrin et Mouron et j'en oublie, va pour le monde d’après s’il y a de l’Humagne au buffet… -
Loin des zombies sympas
 (Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À La Désirade, ce jeudi 18 juillet. – À six heures du matin, ce matin, le ciel annonçant une grande et belle journée d’été, je m’en suis détourné en me rappelant ma rage d’hier soir dans le tonitruement du festival du Néant, comme j’ai cru juste et bon de le nommer non sans me reprocher en même temps de « noircir le tableau sympa »...J’avais fui le bord du lac où se déchaînaient décibels et acclamations folles de la « foule sympa » déboulée en houles dans la ville assiégée, j’avais calé la petite chienne entre le gros volume relié des Archives du rêve et un pack d’eau minérale ; oui c’est cela le néant m’étais-je dit en subissant, fenêtres ouvertes sur les palmiers d’à côté - des palmiers que l’Etat confédéral aimerait éradiquer en sa profonde imbécillité bureaucratique de surface, avais-je appris le matin même dans le journal -, les premiers coups de boule au front de la maison tremblant sur ses fondations, le néant du bruit qui se donne pour de la musique, le néant de ce défilement incessant de foule sympa en shorts sympas , et fuyant l’invasion et son boucan d’enfer je me suis retrouvé sur les hauts où, le jour déclinant à l’ouest dans l’orangé californien, l’on entendait encore le battement sourd de la Machine, là-bas derrière l’épaulement boisé à la brésilienne, et je me suis répété en vieux sanglier que c’était cela même : la Machine à baratter le vide, le néant binaire des zombies sympas, etc.LILOU.- La petite chienne de Julie, actuellement à Phuket avec les siens, a ses humeurs, plus affirmées et déroutantes que ne l’étaient celles de Snoopy, ainsi a-t-elle éventré hier un coussin avant de filer dans la forêt où elle a aboyé je ne sais quel revenant des terriers - pas vu un renard ni un blaireau ou un lynx ces derniers temps- pour revenir ensuite l’air préoccupé et sans daigner m’accorder un regard, gémir au pied de mon lit en me faisant comprendre qu’elle y veut pioncer auprès de moi - et moi si faible avec les bêtes et les enfants, d’attraper d’une main cette peste aux yeux de chauve-souris et de la caler dans un oreiller en lui promettant le bâton si elle attente à son intégrité de commodité du sommeil innocent. Gare ! Sur quoi , la gredine accoisée, je reviens en pensée à Michaux qui a parfois parlé du chien avec sagesse - mais ce n'est pas du chien que parle le Michaux de Qui je fus auquel je reviens à l’instant: c’est de Clodomir l’assassin de Jouhandeau...À La Désirade, ce vendredi 19 juillet. - L’idée m’est venue ce matin de remplir les pages vides du livre relié hérité de nos tantes de Lucerne, dont la tranche annonce un Gästebuch, donc un Livre d’or, avec le fatras quotidien de mes listes, de mes contrerimes, de mes notes de toute sorte et des citations que je glâne au fil de mes lectures - ainsi aurai-je sous la main, et reliées à l’ancienne sous couverture à belles marbures vertes et or, les quelque 333 pages d’une sorte de Mémorial ambulant à usages multiples, e sopratutto per non dimenticar la memoria, cosi come l’avrebbe detto il sior Guido - la Liste inaugurale étant dédiée à Ceux qui osent l'immersion:Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.PERSONA. - La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns. Persona : le masque…CE QUE NOUS DISONS QUE DIT LE CIEL. – Je reprends à l'instant, comme au bord du ciel (le balcon de La Désirade se prête à la métaphore un peu pompeuse), la lecture de mon penseur vivant de prédilection (l’autre, René Girard, nous ayant quittés il y a quelques années), en la personne de Peter Sloterdijk dont le dernier essai – formidable d’érudition et d’intuitions fécondes - , intitulé Faire parler le ciel, cristallise la nébuleuse de mes propres réflexions en la matière depuis mes seize ou dix-huit ans, et qu’oriente sa première phrase : « Le lien établi entre les conceptions du monde des dieux et la poésie est aussi ancien que la tradition des premiers temps de l’Europe ; mieux, elle remonte jusqu’aux plus anciennes sources écrites des civilisations du monde entier »...Or on a bien lu « écrites », vu que le ciel est censé nous parler en dictée, et le terme de poésie est à prendre, précise l’héroïque traducteur Olivier Mannoni, au sens allemand goethéen de Dichtung, incluant l’idée de création, de composition littéraire et de fiction qui fait de Proust et de Bernanos, de Claudel et de Rimbaud, des poètes plus ou moins comparables – car tout ne l’est pas vraiment en vérité - aux « théopoètes » à la manière de Jean l’évangéliste et autres visionnaires du sacré…
(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À La Désirade, ce jeudi 18 juillet. – À six heures du matin, ce matin, le ciel annonçant une grande et belle journée d’été, je m’en suis détourné en me rappelant ma rage d’hier soir dans le tonitruement du festival du Néant, comme j’ai cru juste et bon de le nommer non sans me reprocher en même temps de « noircir le tableau sympa »...J’avais fui le bord du lac où se déchaînaient décibels et acclamations folles de la « foule sympa » déboulée en houles dans la ville assiégée, j’avais calé la petite chienne entre le gros volume relié des Archives du rêve et un pack d’eau minérale ; oui c’est cela le néant m’étais-je dit en subissant, fenêtres ouvertes sur les palmiers d’à côté - des palmiers que l’Etat confédéral aimerait éradiquer en sa profonde imbécillité bureaucratique de surface, avais-je appris le matin même dans le journal -, les premiers coups de boule au front de la maison tremblant sur ses fondations, le néant du bruit qui se donne pour de la musique, le néant de ce défilement incessant de foule sympa en shorts sympas , et fuyant l’invasion et son boucan d’enfer je me suis retrouvé sur les hauts où, le jour déclinant à l’ouest dans l’orangé californien, l’on entendait encore le battement sourd de la Machine, là-bas derrière l’épaulement boisé à la brésilienne, et je me suis répété en vieux sanglier que c’était cela même : la Machine à baratter le vide, le néant binaire des zombies sympas, etc.LILOU.- La petite chienne de Julie, actuellement à Phuket avec les siens, a ses humeurs, plus affirmées et déroutantes que ne l’étaient celles de Snoopy, ainsi a-t-elle éventré hier un coussin avant de filer dans la forêt où elle a aboyé je ne sais quel revenant des terriers - pas vu un renard ni un blaireau ou un lynx ces derniers temps- pour revenir ensuite l’air préoccupé et sans daigner m’accorder un regard, gémir au pied de mon lit en me faisant comprendre qu’elle y veut pioncer auprès de moi - et moi si faible avec les bêtes et les enfants, d’attraper d’une main cette peste aux yeux de chauve-souris et de la caler dans un oreiller en lui promettant le bâton si elle attente à son intégrité de commodité du sommeil innocent. Gare ! Sur quoi , la gredine accoisée, je reviens en pensée à Michaux qui a parfois parlé du chien avec sagesse - mais ce n'est pas du chien que parle le Michaux de Qui je fus auquel je reviens à l’instant: c’est de Clodomir l’assassin de Jouhandeau...À La Désirade, ce vendredi 19 juillet. - L’idée m’est venue ce matin de remplir les pages vides du livre relié hérité de nos tantes de Lucerne, dont la tranche annonce un Gästebuch, donc un Livre d’or, avec le fatras quotidien de mes listes, de mes contrerimes, de mes notes de toute sorte et des citations que je glâne au fil de mes lectures - ainsi aurai-je sous la main, et reliées à l’ancienne sous couverture à belles marbures vertes et or, les quelque 333 pages d’une sorte de Mémorial ambulant à usages multiples, e sopratutto per non dimenticar la memoria, cosi come l’avrebbe detto il sior Guido - la Liste inaugurale étant dédiée à Ceux qui osent l'immersion:Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.PERSONA. - La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns. Persona : le masque…CE QUE NOUS DISONS QUE DIT LE CIEL. – Je reprends à l'instant, comme au bord du ciel (le balcon de La Désirade se prête à la métaphore un peu pompeuse), la lecture de mon penseur vivant de prédilection (l’autre, René Girard, nous ayant quittés il y a quelques années), en la personne de Peter Sloterdijk dont le dernier essai – formidable d’érudition et d’intuitions fécondes - , intitulé Faire parler le ciel, cristallise la nébuleuse de mes propres réflexions en la matière depuis mes seize ou dix-huit ans, et qu’oriente sa première phrase : « Le lien établi entre les conceptions du monde des dieux et la poésie est aussi ancien que la tradition des premiers temps de l’Europe ; mieux, elle remonte jusqu’aux plus anciennes sources écrites des civilisations du monde entier »...Or on a bien lu « écrites », vu que le ciel est censé nous parler en dictée, et le terme de poésie est à prendre, précise l’héroïque traducteur Olivier Mannoni, au sens allemand goethéen de Dichtung, incluant l’idée de création, de composition littéraire et de fiction qui fait de Proust et de Bernanos, de Claudel et de Rimbaud, des poètes plus ou moins comparables – car tout ne l’est pas vraiment en vérité - aux « théopoètes » à la manière de Jean l’évangéliste et autres visionnaires du sacré…