
Carnets de JLK - Page 18
-
Le chemin sur la mer
 « Certes, le vieux monde n’est plus de ce monde,mais plus vivant que jamais » (Ossip Mandelstam)Qui aura chanté pour l’enfantdans vos rangs défilésde battants obsédéspar la plus vide arborescence ?Au présent digitalisé,tout adonnés à vos écrans,vous vivez par procuration:même le vent s’est absenté,le vent, la mer aussi blesséed’être exclue de vos rêves,et vos rêves perdus -le rythme et la rime exclusde vos seuls algorithmes...L’haleine du chien me revient:le souvenir des crocsmordant au plus tendre du corpsde l’enfant pour jouer -l’enfant qui jouait à la guerre,le plaisir solitairede l’Être se reconnaissantdans la caresse des amants...À trier vos déchets,ceux des enfants qui restent là,retrouvant si jamaisle temps en regrets égarés,vont-ils oser le chant ?Retrouver les saveurs du chantde la diva qui s’extasie,et toute l’ironiedu sort et des féériesd’avant la vallée de la mort ...Revivre enfin la douce viecapable de mystère,relancer la cérémoniedu chemin sur la mer...
« Certes, le vieux monde n’est plus de ce monde,mais plus vivant que jamais » (Ossip Mandelstam)Qui aura chanté pour l’enfantdans vos rangs défilésde battants obsédéspar la plus vide arborescence ?Au présent digitalisé,tout adonnés à vos écrans,vous vivez par procuration:même le vent s’est absenté,le vent, la mer aussi blesséed’être exclue de vos rêves,et vos rêves perdus -le rythme et la rime exclusde vos seuls algorithmes...L’haleine du chien me revient:le souvenir des crocsmordant au plus tendre du corpsde l’enfant pour jouer -l’enfant qui jouait à la guerre,le plaisir solitairede l’Être se reconnaissantdans la caresse des amants...À trier vos déchets,ceux des enfants qui restent là,retrouvant si jamaisle temps en regrets égarés,vont-ils oser le chant ?Retrouver les saveurs du chantde la diva qui s’extasie,et toute l’ironiedu sort et des féériesd’avant la vallée de la mort ...Revivre enfin la douce viecapable de mystère,relancer la cérémoniedu chemin sur la mer... -
D'autres batailles
 (Pour Fabio C.)Je suis le type qu’on ne voit pas,perdu dans la bataille,je suis la mémoire qu’on entaille,je serais le pigment,le pigment secret: le pygmée,je suis l’oiseau des canopées,l’insaisissable archeraux traits à jamais immortels -je serais l’ange des prédelles…À San Romano ce jour-là,le temps s’est arrêté:le silence et l’obscur effroide la gloire au fil des épéesse sont soudain figéscomme posant, éternisés,pour défier la meutedéfilant muette aux musées…Quand Micheletto le bikera repris la bagarre,Dedalus au fond de l’Irlandea largué ses amarreset délivré ses mortsde leurs derniers remords,puis en croupe les deux lascarsaux lassos dénoués,reprennent les mots en volée…Paolo Uccello: La bataille de San Romano.
(Pour Fabio C.)Je suis le type qu’on ne voit pas,perdu dans la bataille,je suis la mémoire qu’on entaille,je serais le pigment,le pigment secret: le pygmée,je suis l’oiseau des canopées,l’insaisissable archeraux traits à jamais immortels -je serais l’ange des prédelles…À San Romano ce jour-là,le temps s’est arrêté:le silence et l’obscur effroide la gloire au fil des épéesse sont soudain figéscomme posant, éternisés,pour défier la meutedéfilant muette aux musées…Quand Micheletto le bikera repris la bagarre,Dedalus au fond de l’Irlandea largué ses amarreset délivré ses mortsde leurs derniers remords,puis en croupe les deux lascarsaux lassos dénoués,reprennent les mots en volée…Paolo Uccello: La bataille de San Romano. -
Celles qui ont le coeur à l'ouvrage

Celui qui estime sans arrière-pensée que le travail libère / Celle qui chante en faisant les vitres / Ceux qui bossent à plein temps libre / Celui qui à l’instar du docteur Destouches alias Céline ne respecte que les constricteurs / Celle qui a connu Stefan Zweig à l’poque où il envisageait une trilogie consacrée à Dickens, Dostoïevski et Balzac sous le titre de Trois Maître ou Les Constructeurs / Ceux qui ne supportent pas la négligeance que représente la funeste Coquille / Celui qui ne donnera pas son bon à tirer à un peloton d’exécution non attitré / Celle qui affirme qu’elle s’est « fait » la Comédie humaine « à l’époque » / Ceux qui affirment sur Facebook que Gérard Depardieu a fait réécrire Le Colonel Chabertpar un nègre / Celui qui sue sang et eau sur des poèmes minimalistes / Celle qui met la dernière main à un sonnet en langue inclusive / Ceux qui poursuivent leurs études genre à l’insu de leurs gendres autoproclamés / Celui qui fait subventionner ses intermittences / Celle qui travaille au noir à la Maison-Blanche / Ceux qui se donnent à leur ouvrage qui le leur rend au centuple / Celui qui se concentre tous azimuts / Celle qui dit que tout l’amuse en tant que nouvelle cheffe de projet au Musée de l’Homme / Ceux qui font le job sans cracher sur le taf, etc.
-
Conseils de l'Arbre
 J’aspire à tout ce beau désordre,me disait l’arbre en rêveet sur sa large main ouverteje lisais la brève sentencede nos années enfuies -l’arbre nous aurait bientôt oubliés…Ta sève n’était qu’impatience,a murmuré le ventà l’écoute de cet instantde pure adolescenceoù soudain l’animal jaillit,et le cheval hennit -on eût dit que tremblait le temps…Les mots étaient insuffisants:le mot seul de racine,ou le verbe de revenirvers l’arbre ou vers le vent;revenir au défi du temps:le désordre de l’arbreme suggérait la permanence -revenir au silence…Picture: Snow owl (Nyctea nyctea), by John James Audubon.
J’aspire à tout ce beau désordre,me disait l’arbre en rêveet sur sa large main ouverteje lisais la brève sentencede nos années enfuies -l’arbre nous aurait bientôt oubliés…Ta sève n’était qu’impatience,a murmuré le ventà l’écoute de cet instantde pure adolescenceoù soudain l’animal jaillit,et le cheval hennit -on eût dit que tremblait le temps…Les mots étaient insuffisants:le mot seul de racine,ou le verbe de revenirvers l’arbre ou vers le vent;revenir au défi du temps:le désordre de l’arbreme suggérait la permanence -revenir au silence…Picture: Snow owl (Nyctea nyctea), by John James Audubon. -
À l'ombre des pétales

La Toute Vieille a les pieds secs, les pieds blancs, les pieds froids.
Le jeune Docteur Plastron, d’une voix aussi blanche que son caleçon, lui prend les mains et lui explique en douceur qu’on va lui couper ses pieds pourris si elle est d’accord , mais la Toute Vieille se rebiffe car elle tient à ses pieds morts et montre ses griffes au gamin.
Et de lancer au carabin: «Fiston, sans pieds comment voulez-vous que je foule encore l’ombre des pétales , et qu’en serait-il donc , même pourri, d’un monde sans poésie ? »
Image. Philip Seelen.
-
Au corps ignorant
 (Sur un poème de Rainer Maria Rilke)L'athlète s'en est allé,mais je ne sais ce soirsi ce que je déploreest sa disparition,le drapeau flamboyantde son corps exerçantson art géométrique,ou ses mains électriquesécrivant des poèmes.Je ne sais pas, j'hésite ;réellement ce soir,la fatigue m'a prisdans ses bras fémininsmais ce grand torse à voirde marbre et remontantles chemins de l'oublivia Rilke et Rodin,me rend ces beaux matinsde nos corps élancés,leur grisante sueuret sur le stade inscritela lettre du poème.Ignorant de la peur,l'athlète ainsi demeure.(Athènes, 2011)
(Sur un poème de Rainer Maria Rilke)L'athlète s'en est allé,mais je ne sais ce soirsi ce que je déploreest sa disparition,le drapeau flamboyantde son corps exerçantson art géométrique,ou ses mains électriquesécrivant des poèmes.Je ne sais pas, j'hésite ;réellement ce soir,la fatigue m'a prisdans ses bras fémininsmais ce grand torse à voirde marbre et remontantles chemins de l'oublivia Rilke et Rodin,me rend ces beaux matinsde nos corps élancés,leur grisante sueuret sur le stade inscritela lettre du poème.Ignorant de la peur,l'athlète ainsi demeure.(Athènes, 2011) -
Roland Jaccard s’est achevé, pour mieux survivre en écrivain…
 La Cinquième saison, revue littéraire romande au titre chinoisant aussi « improbable » que le fut le (presque) mauvais sujet, réunit les témoignages, à (presque) charge et (presque) décharge, de vingt-cinq plus ou moins proches et amis, pour un portrait éclaté du « gentil garçon » se la jouant « bad boy », presque infréquentable – comme le diront les wokistes – mais survivant par ses écrits…Presque un monstre, dira-t-on de Roland Jaccard. Et c’est lui qui prend les devants : « Quand les gens vous prennent pour un monstre, il n’y a qu’ une chose à faire : aller au-delà de leurs attentes ». C’est en tout cas ce qu’il explique à sa pharmacienne, comme il l’écrit dans sa Confession d’un gentil garçon, paru en janvier de l’année pandémique 2020.
La Cinquième saison, revue littéraire romande au titre chinoisant aussi « improbable » que le fut le (presque) mauvais sujet, réunit les témoignages, à (presque) charge et (presque) décharge, de vingt-cinq plus ou moins proches et amis, pour un portrait éclaté du « gentil garçon » se la jouant « bad boy », presque infréquentable – comme le diront les wokistes – mais survivant par ses écrits…Presque un monstre, dira-t-on de Roland Jaccard. Et c’est lui qui prend les devants : « Quand les gens vous prennent pour un monstre, il n’y a qu’ une chose à faire : aller au-delà de leurs attentes ». C’est en tout cas ce qu’il explique à sa pharmacienne, comme il l’écrit dans sa Confession d’un gentil garçon, paru en janvier de l’année pandémique 2020. Et de balancer à la pharmacienne en question, dont il est sûr qu’elle n’a pas lu Cioran et qui ne lui fourguera ni Stilnox (qu’il m’a demandé deux ou trois fois de lui amener à Paris) ni Xylo Mepha (qu’il ramenait de Paris à Lausanne à François Ceresa, autre nez bouché), quelques horreurs propres à l’émouvoir : à savoir que ce qui est intéressant dans l’amour, selon Cioran, est son impossibilité, que lorsqu’on est « attaché aux putains, on l’est pour toujours », et que lui-même, le Jaccardo, se rappelle cette dame de mauvaise vie qui, chaque fois qu’elle faisait l’amour, voyait le cadavre de son amant à côté d’elle. «Après cela , comment parler encore d’amour ?, avais-je ajouté. Je l’intriguais déjà. Un bon point ».Dans la foulée, et aux pharmacien(ne)s wokistes que nous sommes « toustes » peu ou prou, de nous assener que « ce que la femme a à vendre, c’est son corps », que « leur conduite est dictée par leurs hormones, d’où leur humeur capricieuse, leur absence de sens moral et leur amour pour les chats », que l’homme pour les femmes n’est jamais que « l’instrument interchangeable d’un plaisir toujours identique », lequel plaisir n’est jamais que « l’infini à portée des caniches », comme disait le charmant Céline, alors que pour lui, le Jaccardo, « la mort est le sublime à la portée de chacun », avant de conclure :. « Préméditée elle a encore plus de panache ».« Panache ! » est d’ailleurs l’exclamation de Roland quand il réussissait une belle passe au ping-pong, ainsi que le rapporte son compère en « calosse » de bain Christophe Passer qui dit à avoir « adoré » jouer avec lui comme André Comte Sponville ou Mark Greene, ses amis en désaccord à peu près absolu avec ses idées, auront raffolé de sa fréquentation, ou presque…Or le « presque » est décisif dans la dramaturgie personnelle de Roland Jaccard, qui le savait - ou presque. Sa façon de se décrier lui-même était presque sincère, au point que ses meilleurs amis y croyaient presque, tandis que ses amantes souriaient, ou presque.Car rien n’était jamais sûr avec ce diable de Roland, et même pas le Diable. Du moins est-ce ma propre conviction d’expérience. Ainsi, me déclarant un soir qu’un écrivain digne de ce nom devait conclure un pacte avec le Démon (et il me regardait) lui ai-je répondu qu’il n’avait aucune idée (ou presque) de ce que représentait ce qu’il venait de me balancer, et lui de me donner absolument raison, ou presque.Cela noté, et sans réserve cette fois, c’est à André Comte-Sponville, parfait introducteur à la pensée de Montaigne dans le Dictionnaire amoureux consacré à celui-ci , que nous devons les vues les plus pertinentes de cette suite d’hommages, notamment à propos de la « profondeur superficielle » de Jaccard, de son « snobisme du mal », mais aussi de sa droiture et de sa générosité, à quoi j’ajouterai deux « presque »...« Voilà deux ans qu’il est mort : je l’aime plus que jamais et ce m’est une raison supplémentaire de ne pas être d’accord avec lui », écrit-ainsi Comte-Sponville. Et l’excellent écrivain qu’est aussi Mark Greene, que j’ai eu le plaisir de rencontrer à la table de Jaccard chez Yushi, abonde dans le même sens en apportant une nuance personnelle à la réserve du « presque », liée au fait qu’il y avait toujours, selon lui, une limite, dans les relations avec le cher disparu : comme une impossibilité, un inaccomplissement dans l’amitié « chaleureuse », ou presque, que vous demandait ou vous accordait Jaccard.
Et de balancer à la pharmacienne en question, dont il est sûr qu’elle n’a pas lu Cioran et qui ne lui fourguera ni Stilnox (qu’il m’a demandé deux ou trois fois de lui amener à Paris) ni Xylo Mepha (qu’il ramenait de Paris à Lausanne à François Ceresa, autre nez bouché), quelques horreurs propres à l’émouvoir : à savoir que ce qui est intéressant dans l’amour, selon Cioran, est son impossibilité, que lorsqu’on est « attaché aux putains, on l’est pour toujours », et que lui-même, le Jaccardo, se rappelle cette dame de mauvaise vie qui, chaque fois qu’elle faisait l’amour, voyait le cadavre de son amant à côté d’elle. «Après cela , comment parler encore d’amour ?, avais-je ajouté. Je l’intriguais déjà. Un bon point ».Dans la foulée, et aux pharmacien(ne)s wokistes que nous sommes « toustes » peu ou prou, de nous assener que « ce que la femme a à vendre, c’est son corps », que « leur conduite est dictée par leurs hormones, d’où leur humeur capricieuse, leur absence de sens moral et leur amour pour les chats », que l’homme pour les femmes n’est jamais que « l’instrument interchangeable d’un plaisir toujours identique », lequel plaisir n’est jamais que « l’infini à portée des caniches », comme disait le charmant Céline, alors que pour lui, le Jaccardo, « la mort est le sublime à la portée de chacun », avant de conclure :. « Préméditée elle a encore plus de panache ».« Panache ! » est d’ailleurs l’exclamation de Roland quand il réussissait une belle passe au ping-pong, ainsi que le rapporte son compère en « calosse » de bain Christophe Passer qui dit à avoir « adoré » jouer avec lui comme André Comte Sponville ou Mark Greene, ses amis en désaccord à peu près absolu avec ses idées, auront raffolé de sa fréquentation, ou presque…Or le « presque » est décisif dans la dramaturgie personnelle de Roland Jaccard, qui le savait - ou presque. Sa façon de se décrier lui-même était presque sincère, au point que ses meilleurs amis y croyaient presque, tandis que ses amantes souriaient, ou presque.Car rien n’était jamais sûr avec ce diable de Roland, et même pas le Diable. Du moins est-ce ma propre conviction d’expérience. Ainsi, me déclarant un soir qu’un écrivain digne de ce nom devait conclure un pacte avec le Démon (et il me regardait) lui ai-je répondu qu’il n’avait aucune idée (ou presque) de ce que représentait ce qu’il venait de me balancer, et lui de me donner absolument raison, ou presque.Cela noté, et sans réserve cette fois, c’est à André Comte-Sponville, parfait introducteur à la pensée de Montaigne dans le Dictionnaire amoureux consacré à celui-ci , que nous devons les vues les plus pertinentes de cette suite d’hommages, notamment à propos de la « profondeur superficielle » de Jaccard, de son « snobisme du mal », mais aussi de sa droiture et de sa générosité, à quoi j’ajouterai deux « presque »...« Voilà deux ans qu’il est mort : je l’aime plus que jamais et ce m’est une raison supplémentaire de ne pas être d’accord avec lui », écrit-ainsi Comte-Sponville. Et l’excellent écrivain qu’est aussi Mark Greene, que j’ai eu le plaisir de rencontrer à la table de Jaccard chez Yushi, abonde dans le même sens en apportant une nuance personnelle à la réserve du « presque », liée au fait qu’il y avait toujours, selon lui, une limite, dans les relations avec le cher disparu : comme une impossibilité, un inaccomplissement dans l’amitié « chaleureuse », ou presque, que vous demandait ou vous accordait Jaccard. Mais comment donc peut-on être Jaccard ?Les animateurs de la Cinquième saison ont estimé qu’une femme adulte responsable, ni bimbo ni nymphette, serait la meilleure introductrice à la livraison consacrée à l’affreux Jaccard, misogyne et supposé limite pédophile, pour aborder illico le côté « problématique » du personnage et ses positions « clivantes », et c’est à la prof de littérature, et fine nouvelliste Valérie Gilliard qu’ a incombé cette tâche délicate, dont elle s’est acquittée avec brio, justesse critique et souci d’équilibre, se demannant illico comment on peut être Jaccard…Situant d’emblée Roland Jaccard dans la mouvance « libertaire », ce qui se discute, l’éditorialiste rappelle plus précisément le climat intellectuel ou mental des années 60-70 en citant une tribune de Gabriel Matzneff datant du 27 janvier 1977, dans Libération, qui prônait la dépénalisation de la sexualité avec les mineurs. Né en 1941, notre Roland, presque « boomer » et conforté par l’esprit du temps où il était de bon ton d’ânonner qu’il est « interdit d’interdire », préfigure cependant la contre-offensive visant le « politiquement correct » des soixante-huitards.Et Valérie Gilliard d’observer avec raison : « Notre époque a tendance à condamner l’amoralisme, notamment celui qui s’exprime dans les productions culturelles, c’est là tout le jeu de la succession des mondes, avec leurs couleurs respectives, leurs croyances, leurs errances. Jaccard n’aura de cesse de regrette son Pris disparu, celui des libertés. Et avec lui, la possibilité de ne pas s’offusquer ; d’exprimer sans arrière-pensée le primat du désir masculin ; de rêver à être un pygmalion tout en effeuillant doucement sa misogynie au soleil de la piscine Deligny ».Cependant à peine lâchées les piques de la critique, la commentatrice se reprend en nuances en invoquant le docteur Freud, la question de la pulsion de mort, le problème papa-maman et tout le fonds de commerce du futur chroniqueur psychanalysant du Monde, athée déclaré mais affilié à la secte freudienne avec tous les « presque » qui iront s’accentuant, dont témoignent une vingtaine de livres que leur auteur évoque en ces lignes (presque) significatives. « Nous avons écrit des livres, sans nous soucier des critiques et des ventes. Mais taraudés par une seule question : avions-nous atteint le niveau que nous nous étions assignés ? En ce qui me concerne, j’en doute. Échec sur toute la ligne (ou presque ) »…Si Jaccard s’accorde cet « ou presque », comme un Georges Haldas le fait à sa façon (peu frivole !) après s’être taxé de nullité, c’est en estimant, à juste titre, que ses livres plaideront pour lui, avec tous les réserves qu’on voudra y trouver, mais en toute liberté accordée à la lectrice et au lecteur.Le nom d’oiseau de Jaccardo figurait sur son siège réservé (genre metteur en scène de cinéma, son rêve) de chez Yushi, rue des Ciseaux , à un coup d’aile de l’Hôtel La Perle jadis offert par Marcel Proust à ses amis Albaret – voisinage qui fait de ce drôle de volatile graphomane un cousin lointain des personnages de La Recherche, entre snobisme germanopratin et goûts bizarres sinon extrêmes, cynisme de façade et (presque ) gentillesse.Après la mort de l’écrivain Bergotte, supposé voué au néant de l’oubli, Proust évoque les livres de celui-ci en vitrine, battant des ailes comme des anges, et l’on filera la métaphore au bénéfice du monstre de second rang que figure le Jaccardo, personnage représentatif d’une époque d’eaux basses, son style tant loué par certains n’atteignant pas les cimes d’un Saint-Simon – lequel n’aurait jamais usé du mot poufiasse pour qualifier une femme -, d’un Joubert, d’un Chamfort, d’un Benjamin Constant, d’un Amiel ou d’un Cioran, et pourtant !Pourtant il y a, bel et bien, un écrivain de style chez Roland Jaccard, ou de ton, ou de voix ou de « papatte », comme on voudra. Autant le vain piapia du poseur à la coq, dans sa basse-cour, pouvait insupporter, autant l’écrivain du Monde d’avant nous intéresse en même temps qu’il nous agace, nous charme autant qu’il nous rebute, nous révulse et nous scotche - ou presque…La cinquième saison. Revue littéraire romande. Roland Jaccard, numéros 22-23, 2024, 194p.
Mais comment donc peut-on être Jaccard ?Les animateurs de la Cinquième saison ont estimé qu’une femme adulte responsable, ni bimbo ni nymphette, serait la meilleure introductrice à la livraison consacrée à l’affreux Jaccard, misogyne et supposé limite pédophile, pour aborder illico le côté « problématique » du personnage et ses positions « clivantes », et c’est à la prof de littérature, et fine nouvelliste Valérie Gilliard qu’ a incombé cette tâche délicate, dont elle s’est acquittée avec brio, justesse critique et souci d’équilibre, se demannant illico comment on peut être Jaccard…Situant d’emblée Roland Jaccard dans la mouvance « libertaire », ce qui se discute, l’éditorialiste rappelle plus précisément le climat intellectuel ou mental des années 60-70 en citant une tribune de Gabriel Matzneff datant du 27 janvier 1977, dans Libération, qui prônait la dépénalisation de la sexualité avec les mineurs. Né en 1941, notre Roland, presque « boomer » et conforté par l’esprit du temps où il était de bon ton d’ânonner qu’il est « interdit d’interdire », préfigure cependant la contre-offensive visant le « politiquement correct » des soixante-huitards.Et Valérie Gilliard d’observer avec raison : « Notre époque a tendance à condamner l’amoralisme, notamment celui qui s’exprime dans les productions culturelles, c’est là tout le jeu de la succession des mondes, avec leurs couleurs respectives, leurs croyances, leurs errances. Jaccard n’aura de cesse de regrette son Pris disparu, celui des libertés. Et avec lui, la possibilité de ne pas s’offusquer ; d’exprimer sans arrière-pensée le primat du désir masculin ; de rêver à être un pygmalion tout en effeuillant doucement sa misogynie au soleil de la piscine Deligny ».Cependant à peine lâchées les piques de la critique, la commentatrice se reprend en nuances en invoquant le docteur Freud, la question de la pulsion de mort, le problème papa-maman et tout le fonds de commerce du futur chroniqueur psychanalysant du Monde, athée déclaré mais affilié à la secte freudienne avec tous les « presque » qui iront s’accentuant, dont témoignent une vingtaine de livres que leur auteur évoque en ces lignes (presque) significatives. « Nous avons écrit des livres, sans nous soucier des critiques et des ventes. Mais taraudés par une seule question : avions-nous atteint le niveau que nous nous étions assignés ? En ce qui me concerne, j’en doute. Échec sur toute la ligne (ou presque ) »…Si Jaccard s’accorde cet « ou presque », comme un Georges Haldas le fait à sa façon (peu frivole !) après s’être taxé de nullité, c’est en estimant, à juste titre, que ses livres plaideront pour lui, avec tous les réserves qu’on voudra y trouver, mais en toute liberté accordée à la lectrice et au lecteur.Le nom d’oiseau de Jaccardo figurait sur son siège réservé (genre metteur en scène de cinéma, son rêve) de chez Yushi, rue des Ciseaux , à un coup d’aile de l’Hôtel La Perle jadis offert par Marcel Proust à ses amis Albaret – voisinage qui fait de ce drôle de volatile graphomane un cousin lointain des personnages de La Recherche, entre snobisme germanopratin et goûts bizarres sinon extrêmes, cynisme de façade et (presque ) gentillesse.Après la mort de l’écrivain Bergotte, supposé voué au néant de l’oubli, Proust évoque les livres de celui-ci en vitrine, battant des ailes comme des anges, et l’on filera la métaphore au bénéfice du monstre de second rang que figure le Jaccardo, personnage représentatif d’une époque d’eaux basses, son style tant loué par certains n’atteignant pas les cimes d’un Saint-Simon – lequel n’aurait jamais usé du mot poufiasse pour qualifier une femme -, d’un Joubert, d’un Chamfort, d’un Benjamin Constant, d’un Amiel ou d’un Cioran, et pourtant !Pourtant il y a, bel et bien, un écrivain de style chez Roland Jaccard, ou de ton, ou de voix ou de « papatte », comme on voudra. Autant le vain piapia du poseur à la coq, dans sa basse-cour, pouvait insupporter, autant l’écrivain du Monde d’avant nous intéresse en même temps qu’il nous agace, nous charme autant qu’il nous rebute, nous révulse et nous scotche - ou presque…La cinquième saison. Revue littéraire romande. Roland Jaccard, numéros 22-23, 2024, 194p. -
Décorum

…Il est clair que vous pouvez avoir un Rembrandt chez vous, j’entends un Rembrandt authentique, pas une copie ni un poster, le Rembrandt en question ne sera rien sans un cadre approprié, pas forcément d’époque mais qui mette en valeur le sujet du Rembrandt tout en l’accordant à votre intérieur, vu qu’un Rembrandt même authentique dont le cadre jurerait avec vos rideaux ne vaudrait pas mieux qu’une copie ou un poster - d’ailleurs Nadine de Rotschild est tout à fait de notre avis…
Image : Philip Seelen -
Ce qu'on essaie de dire...
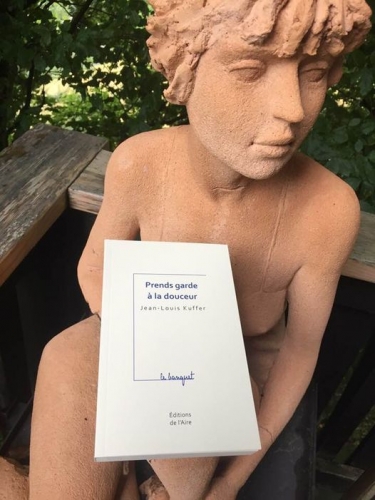 À propos du dernier livre de JLKpar Francis Vladimir"Dans Arles où sont les Alyscans,Quans l'ombre est rouge, sous les roses,Et clair le temps,prends garde à la douceur des choses.Lorsque tu sens batte sans causeTon coeur trop lourd;Et que se taiisent les colombes:Parle tout bas, si c'est d'amour,Au bord des tombes."(Paul-Jean Toulet)L'exergue de Paul-Jean Toulet pare le livre de JLK d'une ineffable aura. À lire d'un trait, le vertige m'a pris, longue dévalée nocturne avec au bout les mots, les mots, toujours les mots qui cernent et disent tant de la vie passée, en allée, que de celle qui demeure toujours à nos côtés, en embuscade en dépit de sa rosserie, de ses moments de grâce, de ses instants fugaces jouant d'éternité.Dans ce long texte qui se déroule page après page en 587 pensées, déclinées à la mode classique, qui se prêtent à l'aube, au cheminement et au soir, l'écrivain ne dévoile rien que nous ne pressentions déjà, une vie d'homme tournée opiniâtrement vers le sens de la vie qui revêt chez lui une interrogation jamais muette, mais assumée par ce que les mots sous sa plume entendent révéler à ceux qui, aveugles ou sourds, en ces temps de misère, sont frappés d'incapacité majeure dans le dévoilement d'eux-mêmes.Dans l'art d'écrire - ( Tchékhov a su dire :... l'art et surtout la scène est un monde où il est impossible d'avancer sans trébucher)- il y aurait donc ce trébuchement sans lequel l'écriture ne saurait aboutir à la luminosité qui se tient dans chacune des pages du livre de JLK. Pour les lecteurs attentifs et fidèles, l'auteur dresse tout un panorama intérieur où le regard est invité à s'arrêter sur chacun des apophtegmes – nommer ainsi ces courts textes est hasardeux – mais il me faut admettre que l'écho de chacun d'eux, d'une langue lyrique, veloutée, âpre, mordante, déposée, conduit le lecteur à un apaisement de lui-même. Il est drôle de consentir à cet état constaté comme si, finalement, les mots dès lors qu'ils sont plus que choisis, justes et ajustés au pourquoi de la chose, le paysage mental, l'expérience de la vie, le sentiment et la douleur, l'accompagnement, le chaos et la respiration profonde, nous réajustent à nous mêmes, nous ré-assemblent aux autres et au monde.De l'éternel présent . - Ceux qui veillent depuis toujours, veilleuses et veilleurs des quatre coins des nébuleuses, le savent à jamais: qu'il n'y a que le présent des choses qui puisse vous révéler votre éternité... Dans le grand théâtre l'écrivain joue le rôle de sa vie, liant et déliant les mots et leur sens, secrets et publics, se confrontant à son intime conviction, changeante et forte, car nul ne sait ce qu'il en sera de demain, de la prochaine aurore, du chemin se perdant dans les bois, du crépuscule de feu sur le lac, et l'écrivain s'il prend au présent et à bras le corps la destinée du monde, tel qu'il va, cahin-caha, a ce rien de bravache, de foudre de guerre errant ( par les mers et les monts, les vallons et les plaines... et la voix au désert ) le disputant tout à la fois à Don Quichotte et au chevalier inexistant.« De la page vécue.- Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu'une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j'entrais dans une forêt, j'étais sur la route d'Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d'adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j'avais seize ans sur les arêtes d'Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie. » L'écrivain se tiendrait donc à la frontière, cette ligne brisée pour certains ou ligne bleue des Vosges pour d'autres, en-deça de laquelle la pièce retombe pile, au-delà de laquelle elle est face. Au jeu du bonneteau de la vie on y voit que du feu. Dans l'obscurité environnante des grands arbres il faut regarder haut, percer la canopée pour retrouver la lumière. Cet entre-deux constant où se joue l'existence, le livre en ces pages les plus sombres ou en ces pages vives, nous est la meilleure des sources pour s'abreuver, humer, jouer avec la fluidité ou le rocher des mots. Sisyphe montait et remontait sans répit la pente. La gangue, qui enserre, l'écrivain en vient à bout, c'est à dire qu'il commet le premier acte d'apprentissage, l'essentiel, celui de buriner le temps.Et JLK laisse échapper ses volutes d'enfance, ses regains d'adolescence, ses attentes de jeune homme, ses attaches d'homme mûr, cette violence de sang et de violence, toutes choses en elles-mêmes qui font et contrefont le souvenir, le visitant et le revisitant, ne se départant jamais de ce qui tient ce texte de bout en bout, l'émotion, le sourire, la tendreté et la douceur malgré sa mise en garde, le rugueux, la colère rentrée, le deuil.Les mots, peut-on l'exprimer, fomentent des répits et des transes, déplacent des montagnes, apaisent ou désespèrent, ramènent au silence. Souffles primordiaux sans lesquels l'écriture n'advient pas. Je disais, en aparté de ma lecture de nuit, que l'égrènement de ces courts textes qui font une vraie somme, - à faire des jaloux – relève des abysses et tutoie des hauteurs. Sans doute, le dit-on avec facilité, la catharsis se fait dans l'emploi des mots, dans cette ré-architecture incessante érigeant le propos. Ici il est intime et universel, chuchoté à l'oreille par une voix amie. Il donne à entendre le monde aujourd'hui dans les échos et les accents d'hier, dans l'évidence de l'autre, la toute proche, l'ailée. « De l'évidence. - Ton mystère ne résidait pas dans ce qui m'était caché de toi, tes secrets ou tes obscurités, mais dans ce que je découvrais chaque jour de toi de nouveau, qui me semblait chaque jour plus beau d'être révélé en pleine lumière... ».Le livre de JLK se retourne à l'épaule, et nous retourne les sens, nous accablant et nous allégeant, mêlant indistinctement les raisons et les déraisons qui mènent au bout du chemin, à la dernière page du livre. « tu t'en es allée une nuit après nous avoir signifié ton désir de dormir et la nuit depuis lors m'est une autre tombe... De ma tristesse.-Ton visage s'est refermé pendant que tu dormais et pourtant je le savais déjà : que ce n'était pas le sommeil qui l'avait refermé... mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...Du plus tendre aveu.-Tu m'as manqué dès que j'ai su que je m'en irais, lui dit-elle... » L'omniprésence de l'intime et du fugace confère à ces pages le noir et le blanc, couleurs de deuil, non pour enfouir l'âme endolorie, la triturer à l'excès, mais bien plutôt pour glisser sous les pas de celui qui reste, une autre portée musicale, lui tendre un arc où réapparaîtront les couleurs, les poinçons d'espérance, l'écriture de feu, la réparation. C'est à cela sans doute que s'attache le livre de JLK, hors- champ, mais dans la lumière matinale sur le chemin des bois, s'en revenant au soir. Avec légèreté, sans emphase, avec les mots sacrés pour le dire, ces sacrés mots, l'empyrée et le refuge qu'il s'est choisis, à la Désirade, sur les hauts de Montreux, pour continuer et faire entendre...De la permanence.- Ce que nous laissons semble n'être rien, mais c'est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous....F. V.Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de l'Aire, 261p. 2023.
À propos du dernier livre de JLKpar Francis Vladimir"Dans Arles où sont les Alyscans,Quans l'ombre est rouge, sous les roses,Et clair le temps,prends garde à la douceur des choses.Lorsque tu sens batte sans causeTon coeur trop lourd;Et que se taiisent les colombes:Parle tout bas, si c'est d'amour,Au bord des tombes."(Paul-Jean Toulet)L'exergue de Paul-Jean Toulet pare le livre de JLK d'une ineffable aura. À lire d'un trait, le vertige m'a pris, longue dévalée nocturne avec au bout les mots, les mots, toujours les mots qui cernent et disent tant de la vie passée, en allée, que de celle qui demeure toujours à nos côtés, en embuscade en dépit de sa rosserie, de ses moments de grâce, de ses instants fugaces jouant d'éternité.Dans ce long texte qui se déroule page après page en 587 pensées, déclinées à la mode classique, qui se prêtent à l'aube, au cheminement et au soir, l'écrivain ne dévoile rien que nous ne pressentions déjà, une vie d'homme tournée opiniâtrement vers le sens de la vie qui revêt chez lui une interrogation jamais muette, mais assumée par ce que les mots sous sa plume entendent révéler à ceux qui, aveugles ou sourds, en ces temps de misère, sont frappés d'incapacité majeure dans le dévoilement d'eux-mêmes.Dans l'art d'écrire - ( Tchékhov a su dire :... l'art et surtout la scène est un monde où il est impossible d'avancer sans trébucher)- il y aurait donc ce trébuchement sans lequel l'écriture ne saurait aboutir à la luminosité qui se tient dans chacune des pages du livre de JLK. Pour les lecteurs attentifs et fidèles, l'auteur dresse tout un panorama intérieur où le regard est invité à s'arrêter sur chacun des apophtegmes – nommer ainsi ces courts textes est hasardeux – mais il me faut admettre que l'écho de chacun d'eux, d'une langue lyrique, veloutée, âpre, mordante, déposée, conduit le lecteur à un apaisement de lui-même. Il est drôle de consentir à cet état constaté comme si, finalement, les mots dès lors qu'ils sont plus que choisis, justes et ajustés au pourquoi de la chose, le paysage mental, l'expérience de la vie, le sentiment et la douleur, l'accompagnement, le chaos et la respiration profonde, nous réajustent à nous mêmes, nous ré-assemblent aux autres et au monde.De l'éternel présent . - Ceux qui veillent depuis toujours, veilleuses et veilleurs des quatre coins des nébuleuses, le savent à jamais: qu'il n'y a que le présent des choses qui puisse vous révéler votre éternité... Dans le grand théâtre l'écrivain joue le rôle de sa vie, liant et déliant les mots et leur sens, secrets et publics, se confrontant à son intime conviction, changeante et forte, car nul ne sait ce qu'il en sera de demain, de la prochaine aurore, du chemin se perdant dans les bois, du crépuscule de feu sur le lac, et l'écrivain s'il prend au présent et à bras le corps la destinée du monde, tel qu'il va, cahin-caha, a ce rien de bravache, de foudre de guerre errant ( par les mers et les monts, les vallons et les plaines... et la voix au désert ) le disputant tout à la fois à Don Quichotte et au chevalier inexistant.« De la page vécue.- Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu'une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j'entrais dans une forêt, j'étais sur la route d'Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d'adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j'avais seize ans sur les arêtes d'Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie. » L'écrivain se tiendrait donc à la frontière, cette ligne brisée pour certains ou ligne bleue des Vosges pour d'autres, en-deça de laquelle la pièce retombe pile, au-delà de laquelle elle est face. Au jeu du bonneteau de la vie on y voit que du feu. Dans l'obscurité environnante des grands arbres il faut regarder haut, percer la canopée pour retrouver la lumière. Cet entre-deux constant où se joue l'existence, le livre en ces pages les plus sombres ou en ces pages vives, nous est la meilleure des sources pour s'abreuver, humer, jouer avec la fluidité ou le rocher des mots. Sisyphe montait et remontait sans répit la pente. La gangue, qui enserre, l'écrivain en vient à bout, c'est à dire qu'il commet le premier acte d'apprentissage, l'essentiel, celui de buriner le temps.Et JLK laisse échapper ses volutes d'enfance, ses regains d'adolescence, ses attentes de jeune homme, ses attaches d'homme mûr, cette violence de sang et de violence, toutes choses en elles-mêmes qui font et contrefont le souvenir, le visitant et le revisitant, ne se départant jamais de ce qui tient ce texte de bout en bout, l'émotion, le sourire, la tendreté et la douceur malgré sa mise en garde, le rugueux, la colère rentrée, le deuil.Les mots, peut-on l'exprimer, fomentent des répits et des transes, déplacent des montagnes, apaisent ou désespèrent, ramènent au silence. Souffles primordiaux sans lesquels l'écriture n'advient pas. Je disais, en aparté de ma lecture de nuit, que l'égrènement de ces courts textes qui font une vraie somme, - à faire des jaloux – relève des abysses et tutoie des hauteurs. Sans doute, le dit-on avec facilité, la catharsis se fait dans l'emploi des mots, dans cette ré-architecture incessante érigeant le propos. Ici il est intime et universel, chuchoté à l'oreille par une voix amie. Il donne à entendre le monde aujourd'hui dans les échos et les accents d'hier, dans l'évidence de l'autre, la toute proche, l'ailée. « De l'évidence. - Ton mystère ne résidait pas dans ce qui m'était caché de toi, tes secrets ou tes obscurités, mais dans ce que je découvrais chaque jour de toi de nouveau, qui me semblait chaque jour plus beau d'être révélé en pleine lumière... ».Le livre de JLK se retourne à l'épaule, et nous retourne les sens, nous accablant et nous allégeant, mêlant indistinctement les raisons et les déraisons qui mènent au bout du chemin, à la dernière page du livre. « tu t'en es allée une nuit après nous avoir signifié ton désir de dormir et la nuit depuis lors m'est une autre tombe... De ma tristesse.-Ton visage s'est refermé pendant que tu dormais et pourtant je le savais déjà : que ce n'était pas le sommeil qui l'avait refermé... mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...Du plus tendre aveu.-Tu m'as manqué dès que j'ai su que je m'en irais, lui dit-elle... » L'omniprésence de l'intime et du fugace confère à ces pages le noir et le blanc, couleurs de deuil, non pour enfouir l'âme endolorie, la triturer à l'excès, mais bien plutôt pour glisser sous les pas de celui qui reste, une autre portée musicale, lui tendre un arc où réapparaîtront les couleurs, les poinçons d'espérance, l'écriture de feu, la réparation. C'est à cela sans doute que s'attache le livre de JLK, hors- champ, mais dans la lumière matinale sur le chemin des bois, s'en revenant au soir. Avec légèreté, sans emphase, avec les mots sacrés pour le dire, ces sacrés mots, l'empyrée et le refuge qu'il s'est choisis, à la Désirade, sur les hauts de Montreux, pour continuer et faire entendre...De la permanence.- Ce que nous laissons semble n'être rien, mais c'est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous....F. V.Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de l'Aire, 261p. 2023. -
Onction parisienne
 On fait le tour du quartier et c’est un monde. De la mansarde d’à côté j’entends les vieux Russes blancs qui s’enguirlandent. Du fond de la rue montent les mélopées entêtantes du café maure. Aux soirs de fin de semaine on est à Rome ou à Barcelone. Cependant, chaque matinée, c’est la province et la Provence qu’on retrouve rue Legendre. Le libraire taciturne a des gestes de mandarin, mais les vrais Chinois du supermarché d’à côté ne s’inclinent même pas : ils ont acquis la même morgue que les Polonais de l’épicerie où je me fournis en Krupnik, la liqueur au miel de feu qui tue de bonheur. Plus loin, à la Butte-aux-Cailles, les basses maisons chaulées m’évoquent le Mexique assoupi. C’est là-bas qu’une fin d’après-midi, place Paul-Verlaine, j’ai commencé de lire Lumière d’août de Faulkner. Ainsi me suis-je retrouvé quelque part entre Alabama et Mississippi, et c’est alors qu’il s’est mis à pleuvoir en plein soleil. Je me trouvais hors du temps, il ne me semblait pas que je pleurais, mais tout pleurait en souriant, tout était trempé, mon livre et mes vêtements, tout était comme lavé et purifié...
On fait le tour du quartier et c’est un monde. De la mansarde d’à côté j’entends les vieux Russes blancs qui s’enguirlandent. Du fond de la rue montent les mélopées entêtantes du café maure. Aux soirs de fin de semaine on est à Rome ou à Barcelone. Cependant, chaque matinée, c’est la province et la Provence qu’on retrouve rue Legendre. Le libraire taciturne a des gestes de mandarin, mais les vrais Chinois du supermarché d’à côté ne s’inclinent même pas : ils ont acquis la même morgue que les Polonais de l’épicerie où je me fournis en Krupnik, la liqueur au miel de feu qui tue de bonheur. Plus loin, à la Butte-aux-Cailles, les basses maisons chaulées m’évoquent le Mexique assoupi. C’est là-bas qu’une fin d’après-midi, place Paul-Verlaine, j’ai commencé de lire Lumière d’août de Faulkner. Ainsi me suis-je retrouvé quelque part entre Alabama et Mississippi, et c’est alors qu’il s’est mis à pleuvoir en plein soleil. Je me trouvais hors du temps, il ne me semblait pas que je pleurais, mais tout pleurait en souriant, tout était trempé, mon livre et mes vêtements, tout était comme lavé et purifié... -
Ce qui ne peut se dire
 «Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire,mais l'écrire.» (Jacques Derrida)La solitude est une nuitque l’aveugle perçoitcomme un mur froid autour de lui -mais qui seul peut le dire ?Comment dire à celui qui dortque la vie est ailleursque dans son rêve sans remordsoù le bercent les heures -qui oserait le dire ?Notre savoir payé de motsgagne à se taire parfoisà la lisière des grands boisoù vit le solitaire -mais qui saura le dire ?Peinture: Edvard Munch, Le tronc jaune.
«Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire,mais l'écrire.» (Jacques Derrida)La solitude est une nuitque l’aveugle perçoitcomme un mur froid autour de lui -mais qui seul peut le dire ?Comment dire à celui qui dortque la vie est ailleursque dans son rêve sans remordsoù le bercent les heures -qui oserait le dire ?Notre savoir payé de motsgagne à se taire parfoisà la lisière des grands boisoù vit le solitaire -mais qui saura le dire ?Peinture: Edvard Munch, Le tronc jaune. -
Le coup du chapeau
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Maison bleue, ce mardi 30 avril. - Après, leur façon de dire «du coup » m’exaspère à un tel point que je m’empare de cet «après » et de ce « du coup » pour les coller à mes mélodies bricolées, et du coup je te dis pas la soirée qu’on a passée l'autre soir avec Jackie et Tonio chez Clémentine et les pêcheurs, ça se raconte pas, mais après je te le raconte quand même, et du coup je revois Jackie à vingt ans qui affronte plus ou moins son père dans le sillage de mai 68, où elle enchaîne bombe sur bombe, puis c’est Tonio qui me chambre avec la nouvelle bio de Kafka, et du coup je le chipote en lui lançant qu’après ces bios de disciples à genoux et autres épigones ne sont finalement que genoux et épigones, et tes lettres de Flaubert à Louise Collet, super – il y a quelque temps déjà que je me suis emparé du mot « super » -, mais moi du coup je reviens à Frédéric Moreau, chez les Dambreuse, découvrant la fiesta des mondains aussi nulle que celle de Marcel au quartier Saint Germain...Tonio était arrivé à la Grappe d'or en chapeau, genre Nizon au chapeau, Guibert au chapeau, Saul Bellow au chapeau, et du coup ça me rappelle le jeune étudiant américain qu’évoque Annie Dillard, très décidé à se faire un nom d’écrivain et commençant par se nantir d’un chapeau – après j’imagine Tonio se pointant chez un chapelier et choisissant ce chapeau grave comme un chapeau de Monk, et du coup je leur dis, à Jackie et lui, que Tonio est un Monk à sa façon, un ahuri que je vois toujours apparaître en caleçon à l’embrasure de la porte de leur noble demeure vigneronne de Bourg en Lavaux, tandis que je m'entretenais avec la belle violoniste spécialiste de Berg - nous deux parlant donc d’Alban Berg et de ses difficultés et Tonio se levant de sa sieste et surgissant à la tangente de notre conversation avec son torse maigre de lecteur de Thomas Bernhard et ses roustons dépassant du caleçon; et à Jackie qui ne suit pas les séries sur Netflix je commence de raconter Monk le frère occulte de son compagnon et de Robert Walser et de Bartleby (dont Tonio a parlé dans un de ses écrits récents) et d’Oblomov aussi , bref de tous ces personnages un peu décalés, dépassés par les événements, genre « no country for the old man » même s’ils sont jeunes, ces ahuris sublimes comme l’était le jeune homme à tout faire de Walser, et du coup je me dis que Jackie et Tonio sont eux aussi des personnages de série, et comme ils acquiescent et se disent prêts à s’y lancer je leur raconte celle dont j’ai esquissé le scénar avec Simon & Lapp au générique, deux vieux potes dont le bon vivant (Simon le jovial) est tenté par EXIT alors que son compère (Lapp le déprimé de naissance) essaie de lui remonter la pendule, et je leur raconte qu’après il y a eu, avec le jeune cinéaste engagé et les compères, les ajouts sans nombre à mon script initial, la mise en œuvre de l’épisode pilote et tout une galère de détails, avant les tractations avec la télé, bref je leur raconte que le projet de série serait le sujet d’une autre suite d’épisodes mais j’ai perdu de vue les compères qui n’apparaissent plus ni à la radio ni sur Youtube à ma connaissance – après je n’en ai d’ailleurs que fiche, et du coup je reviens aux trois tas de journaux que je me suis promis, ce matin, de dépouiller et avec eux les quatre premiers mois d’infos de cette année dite du Dragon de bois par les Chinois, etc…
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Maison bleue, ce mardi 30 avril. - Après, leur façon de dire «du coup » m’exaspère à un tel point que je m’empare de cet «après » et de ce « du coup » pour les coller à mes mélodies bricolées, et du coup je te dis pas la soirée qu’on a passée l'autre soir avec Jackie et Tonio chez Clémentine et les pêcheurs, ça se raconte pas, mais après je te le raconte quand même, et du coup je revois Jackie à vingt ans qui affronte plus ou moins son père dans le sillage de mai 68, où elle enchaîne bombe sur bombe, puis c’est Tonio qui me chambre avec la nouvelle bio de Kafka, et du coup je le chipote en lui lançant qu’après ces bios de disciples à genoux et autres épigones ne sont finalement que genoux et épigones, et tes lettres de Flaubert à Louise Collet, super – il y a quelque temps déjà que je me suis emparé du mot « super » -, mais moi du coup je reviens à Frédéric Moreau, chez les Dambreuse, découvrant la fiesta des mondains aussi nulle que celle de Marcel au quartier Saint Germain...Tonio était arrivé à la Grappe d'or en chapeau, genre Nizon au chapeau, Guibert au chapeau, Saul Bellow au chapeau, et du coup ça me rappelle le jeune étudiant américain qu’évoque Annie Dillard, très décidé à se faire un nom d’écrivain et commençant par se nantir d’un chapeau – après j’imagine Tonio se pointant chez un chapelier et choisissant ce chapeau grave comme un chapeau de Monk, et du coup je leur dis, à Jackie et lui, que Tonio est un Monk à sa façon, un ahuri que je vois toujours apparaître en caleçon à l’embrasure de la porte de leur noble demeure vigneronne de Bourg en Lavaux, tandis que je m'entretenais avec la belle violoniste spécialiste de Berg - nous deux parlant donc d’Alban Berg et de ses difficultés et Tonio se levant de sa sieste et surgissant à la tangente de notre conversation avec son torse maigre de lecteur de Thomas Bernhard et ses roustons dépassant du caleçon; et à Jackie qui ne suit pas les séries sur Netflix je commence de raconter Monk le frère occulte de son compagnon et de Robert Walser et de Bartleby (dont Tonio a parlé dans un de ses écrits récents) et d’Oblomov aussi , bref de tous ces personnages un peu décalés, dépassés par les événements, genre « no country for the old man » même s’ils sont jeunes, ces ahuris sublimes comme l’était le jeune homme à tout faire de Walser, et du coup je me dis que Jackie et Tonio sont eux aussi des personnages de série, et comme ils acquiescent et se disent prêts à s’y lancer je leur raconte celle dont j’ai esquissé le scénar avec Simon & Lapp au générique, deux vieux potes dont le bon vivant (Simon le jovial) est tenté par EXIT alors que son compère (Lapp le déprimé de naissance) essaie de lui remonter la pendule, et je leur raconte qu’après il y a eu, avec le jeune cinéaste engagé et les compères, les ajouts sans nombre à mon script initial, la mise en œuvre de l’épisode pilote et tout une galère de détails, avant les tractations avec la télé, bref je leur raconte que le projet de série serait le sujet d’une autre suite d’épisodes mais j’ai perdu de vue les compères qui n’apparaissent plus ni à la radio ni sur Youtube à ma connaissance – après je n’en ai d’ailleurs que fiche, et du coup je reviens aux trois tas de journaux que je me suis promis, ce matin, de dépouiller et avec eux les quatre premiers mois d’infos de cette année dite du Dragon de bois par les Chinois, etc… -
Au ciel délire
 Les ombres remontent d’en bas,de sous la table, là,où s’étalent tous les décombresdes maisons, des manies, des saisonset des familles aux raisons égarées -cela devait rester caché !Tu me cherches où je ne suis pas,et moi je te retienspar notre lien de long silenceque tu disais précieux,si précieux que nul autre lieuque ma seule présencene te semblait plus accueillant…Ce que vous auriez aimé taireau moment de le faireest ainsi votre aveu,le secret de vos yeux que dévoilece regard d’un dieu reconnupour allier l’eau et le feu…Douce folie jamais éteinte.tendre philosophiedu poète passant par làsans se presser jamais,jamais futile, jamais feinte -au ciel qui s’ouvre perdez-vous…Peinture: Bona Mangangu, Fleur de volcan.
Les ombres remontent d’en bas,de sous la table, là,où s’étalent tous les décombresdes maisons, des manies, des saisonset des familles aux raisons égarées -cela devait rester caché !Tu me cherches où je ne suis pas,et moi je te retienspar notre lien de long silenceque tu disais précieux,si précieux que nul autre lieuque ma seule présencene te semblait plus accueillant…Ce que vous auriez aimé taireau moment de le faireest ainsi votre aveu,le secret de vos yeux que dévoilece regard d’un dieu reconnupour allier l’eau et le feu…Douce folie jamais éteinte.tendre philosophiedu poète passant par làsans se presser jamais,jamais futile, jamais feinte -au ciel qui s’ouvre perdez-vous…Peinture: Bona Mangangu, Fleur de volcan. -
Devant ce portrait
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce dimanche 28 avril.– Le vieux sage au cœur d’enfant et à l'âme souveraine que figurait Charles Du Bos le murmurait en sa timidité devant le monde devenu Machine à faire et défaire indifféremment : « Nous ne sommes pas désespérés, nous sommes dans la perplexité», et le vieux Charlie, en compagnie duquel tout un chacun se sentait toujours un peu grossier, reprenait sa lecture relative à la notion de complémentarité selon Nils Bohr et, plus précisément, à la relation mutuellement exclusive qui existera toujours entre l’utilisation pratique de n’importe quel mot et la tentative visant à le définir rigoureusement, autrement dit la poésie et la science, le savoir nocturne et les théorèmes au jour le jour, l’oraison matinale des peuples ingénus et la macération théologique – et le dimanche y allait de ses cloches à l’autre bout du quartier…J’avais placé ce portrait de Lady L sur la paroi faisant face au grand lit de tek indien haut sur socle dans lequel elle aura dit ces derniers mots un autre dimanche d'il y a trois ans de ça : « Lady veut dormir », et maintenant elle me regarde quand je dors ou m’éveille, avec son air de Madone rhénane, selon l’expression de Pierre Omcikous qui en achevait le portrait, se demandant apparemment ce que mijote celui-là, mais il y a aussi de la bienveillance et de la magnanimité dans son expression, et je lui renvoie son demi-sourire qui ferait croire à certains que je n’en finis pas de cuver mon deuil comme il en va de Monk supposé ne jamais se consoler de la mort non moins cruelle de Trudy, mais l'interprétation est fausse dans les deux cas de cette absence augmentant notre présence...Je suis naturellement plus joyeux de nature que Monk, et plus bohème aussi : pas question que je croche le dernier bouton de ma chemise ni ne panique à la vue d’aucune nudité sexuelle quelconque, mais les bonnes femmes restent réellement là avec leur fichu sens des réalités – ne me parle pas de la Béatrice de Dante ou de la Laure de Pétrarque, et si ma bonne amie n’a pas été aussi sordidement assassinée que la Trudy de l'autre ahuri, comment qualifier le lent massacre qu’elle a subi de la part de la vie elle-même, sinon de crime avéré contre l'humanité ?Peinture: Pierre Omcikous, Portrait de Lady L., 1987. Pp LK/JLK.
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce dimanche 28 avril.– Le vieux sage au cœur d’enfant et à l'âme souveraine que figurait Charles Du Bos le murmurait en sa timidité devant le monde devenu Machine à faire et défaire indifféremment : « Nous ne sommes pas désespérés, nous sommes dans la perplexité», et le vieux Charlie, en compagnie duquel tout un chacun se sentait toujours un peu grossier, reprenait sa lecture relative à la notion de complémentarité selon Nils Bohr et, plus précisément, à la relation mutuellement exclusive qui existera toujours entre l’utilisation pratique de n’importe quel mot et la tentative visant à le définir rigoureusement, autrement dit la poésie et la science, le savoir nocturne et les théorèmes au jour le jour, l’oraison matinale des peuples ingénus et la macération théologique – et le dimanche y allait de ses cloches à l’autre bout du quartier…J’avais placé ce portrait de Lady L sur la paroi faisant face au grand lit de tek indien haut sur socle dans lequel elle aura dit ces derniers mots un autre dimanche d'il y a trois ans de ça : « Lady veut dormir », et maintenant elle me regarde quand je dors ou m’éveille, avec son air de Madone rhénane, selon l’expression de Pierre Omcikous qui en achevait le portrait, se demandant apparemment ce que mijote celui-là, mais il y a aussi de la bienveillance et de la magnanimité dans son expression, et je lui renvoie son demi-sourire qui ferait croire à certains que je n’en finis pas de cuver mon deuil comme il en va de Monk supposé ne jamais se consoler de la mort non moins cruelle de Trudy, mais l'interprétation est fausse dans les deux cas de cette absence augmentant notre présence...Je suis naturellement plus joyeux de nature que Monk, et plus bohème aussi : pas question que je croche le dernier bouton de ma chemise ni ne panique à la vue d’aucune nudité sexuelle quelconque, mais les bonnes femmes restent réellement là avec leur fichu sens des réalités – ne me parle pas de la Béatrice de Dante ou de la Laure de Pétrarque, et si ma bonne amie n’a pas été aussi sordidement assassinée que la Trudy de l'autre ahuri, comment qualifier le lent massacre qu’elle a subi de la part de la vie elle-même, sinon de crime avéré contre l'humanité ?Peinture: Pierre Omcikous, Portrait de Lady L., 1987. Pp LK/JLK. -
À mourir de rire
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)Le navire de Swift s'éloigneDans le temps éternel.Nulle indignation forcenéeNe l'y déchirera plus.Imite-le si tu l'oses,Voyageur qu'abêtit le monde,Car Swift a servi la cause...De l'humain qui est d'être libre...(W.B. Yeats, Swift's Epitaph, traduction d'Yves Bonnefoy)À la Maison bleue, ce samedi 27 avril.- Ce pourrait encore être un lendemain d’hier, aurais-je pu craindre après mes errances dans le vide de la veille à surfer comme un zombie, avant ce que j’appelle le départ du navire de Swift dans la nuit du sommeil - ç’aurait pu être un retour de fiesta désespérée s’il n’y avait eu là-bas, dans ce café perdu à l’immense négressse, le souvenir du rire de Swift réitéré par le récit que Kasperl, dans le rêve, nous avait fait de l’ultime éclat du jeune homme littéralement scié de rire et finalement explosé de rire par la lecture du récit de la Passion du Christ représentée au théâtre municipal de Saavedra de La Paz, quand la croix tout à coup s’ébranle dans le décor minable et que le crucifié s’exclame « putain je tombe ! », et l’évidence ce matin qu’après ce rêve j’allais vivre un samedi féerique comme on en fait plus m’a fait relancer mon propre récit des apparitions de Gian Gaspard...Hier encore, avant le message électronique de Shmuel me remerciant pour ma chronique, qualifiée de « très belle et très touchante « , j’avais été touché moi aussi, en pédalant sur mon vélo de chambre avec, à l’écran de mon laptop, l’épisode à crever de rire (déjà!) de Monk se fait un ami , en me rappelant mon propre fantasme de toujours de l’Ami unique, partageant de toute évidence la candeur idiote du personnage voué par nature aux déceptions de l’enfance.Monk a peur de la Nature, ce qui n'est pas mon cas. Adrian Monk compte plus de 120 allergies, alors que je n'en ai déclaré aucune lors de mon dernier passage à l'hosto - Monk craint les hostos comme la lèpre et les sangsues, alors que je me surprends à faire de l'esprit avec les soignants - ce que je me reproche comme toute indiscrétion ou familiarité déplacées, tutoiement compris. Monk fait une tragédie du moindre saignement de nez, alors que celui-ci m'a fait découvrir la cour des miracles de l'Hotel-Dieu parisien, un matin d'hémorragie qui relevait peut-être de l'acte manqué - je devais rencontrer le même jour un éditeur influent. Monk est un intuitif plus-que- présent, en quoi je m'identifie à cet ahuri angélique me rappelant Robert Walser, Oblomov, Bartleby et autres âmes sensibles familières à Shmuel T. Meyer.Ce samedi à venir n'aura pas son pareil, dédié à sainte Zita, patronne des servantes et des femmes de charge sur la tombe de laquelle se sont multiplié les miracles - lesquels préludent en somme à ce jour qui me trouve un peu tousseux, le souffle court et les mollets sciés à crever de rire, plus quelques signes avant-coureurs de je sais quoi qui me font sortir mon doseur d'initrate isosorbide peut-être contre-indiqué d'ailleurs, avant la prise de mes 10 molécules quotidiennes prescrites au titre de cardiopathe accessoirement sponsor du Big Pharma...Peinture JLK: Le chemin sur La mer, Acryl sur toile, 2020.
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)Le navire de Swift s'éloigneDans le temps éternel.Nulle indignation forcenéeNe l'y déchirera plus.Imite-le si tu l'oses,Voyageur qu'abêtit le monde,Car Swift a servi la cause...De l'humain qui est d'être libre...(W.B. Yeats, Swift's Epitaph, traduction d'Yves Bonnefoy)À la Maison bleue, ce samedi 27 avril.- Ce pourrait encore être un lendemain d’hier, aurais-je pu craindre après mes errances dans le vide de la veille à surfer comme un zombie, avant ce que j’appelle le départ du navire de Swift dans la nuit du sommeil - ç’aurait pu être un retour de fiesta désespérée s’il n’y avait eu là-bas, dans ce café perdu à l’immense négressse, le souvenir du rire de Swift réitéré par le récit que Kasperl, dans le rêve, nous avait fait de l’ultime éclat du jeune homme littéralement scié de rire et finalement explosé de rire par la lecture du récit de la Passion du Christ représentée au théâtre municipal de Saavedra de La Paz, quand la croix tout à coup s’ébranle dans le décor minable et que le crucifié s’exclame « putain je tombe ! », et l’évidence ce matin qu’après ce rêve j’allais vivre un samedi féerique comme on en fait plus m’a fait relancer mon propre récit des apparitions de Gian Gaspard...Hier encore, avant le message électronique de Shmuel me remerciant pour ma chronique, qualifiée de « très belle et très touchante « , j’avais été touché moi aussi, en pédalant sur mon vélo de chambre avec, à l’écran de mon laptop, l’épisode à crever de rire (déjà!) de Monk se fait un ami , en me rappelant mon propre fantasme de toujours de l’Ami unique, partageant de toute évidence la candeur idiote du personnage voué par nature aux déceptions de l’enfance.Monk a peur de la Nature, ce qui n'est pas mon cas. Adrian Monk compte plus de 120 allergies, alors que je n'en ai déclaré aucune lors de mon dernier passage à l'hosto - Monk craint les hostos comme la lèpre et les sangsues, alors que je me surprends à faire de l'esprit avec les soignants - ce que je me reproche comme toute indiscrétion ou familiarité déplacées, tutoiement compris. Monk fait une tragédie du moindre saignement de nez, alors que celui-ci m'a fait découvrir la cour des miracles de l'Hotel-Dieu parisien, un matin d'hémorragie qui relevait peut-être de l'acte manqué - je devais rencontrer le même jour un éditeur influent. Monk est un intuitif plus-que- présent, en quoi je m'identifie à cet ahuri angélique me rappelant Robert Walser, Oblomov, Bartleby et autres âmes sensibles familières à Shmuel T. Meyer.Ce samedi à venir n'aura pas son pareil, dédié à sainte Zita, patronne des servantes et des femmes de charge sur la tombe de laquelle se sont multiplié les miracles - lesquels préludent en somme à ce jour qui me trouve un peu tousseux, le souffle court et les mollets sciés à crever de rire, plus quelques signes avant-coureurs de je sais quoi qui me font sortir mon doseur d'initrate isosorbide peut-être contre-indiqué d'ailleurs, avant la prise de mes 10 molécules quotidiennes prescrites au titre de cardiopathe accessoirement sponsor du Big Pharma...Peinture JLK: Le chemin sur La mer, Acryl sur toile, 2020. -
Ce rire à la folie
 (Kasperliana, 2)L’intensité sans pareille de sa présence se ressentait par défaut quand il les avait quittés et qu’ils se retrouvaient là tout cons à se demander ce qui leur était arrivé pour qu’à l’instant ils se sentent à la fois si pleins et si vides, ils (ou elles si tu préfères), s’étaient retournés une dernière fois dans la ruelle de cette nuit-la ou n’importe où d’où il venait de disparaître, et les choses restaient là sans lui , les choses inexplicables, les choses abruties quand on ne les regarde pas vraiment, le navire de Swift qui a disparu dans la nuit libérée par son rire, et c’est d’ailleurs de cela que vous aviez parlé avec Kasperl avant qu’il ne se retire de la Grappe d’or comme il y était entré - comme en douce serait l’expression la plus exacte-, ce rire à la Swift qui fait parfois mourir tant il est plein de toute la splendeur odieuse et de la cruauté délicieuse des choses de la vie - et ce soir là précisément Kasperl leur avait rapporté ce que son occulte compère Shmuel lui avait narré à propos du garçon scié de rire à la lecture du roman de Vargas Llosa, littéralement explosé de rire quand , à la représentation de la Passion du Christ au théâtre municipal Saavedra, à La Paz , la croix se met à trembler, dont le crucifié s’exclame tout soudain « je tombe, putain je tombe! », et le rire du jeune homme se met à proliférer alentour au kibboutz de Yaad Hanna, Kasperl reprend texto les mots de son compère Shmuel, « Le rire du jeune homme, qui venait de naître dans un théâtre d’Amérique du sud, à trois mille cinq cents mètres d'altitude, deux décennies avant que la nuit n’assombrisse la cime des cyprès et des arbres de Judée du kibboiutz Kvar Avraham, ce rite universel qui rend si truculent, la peau de banane, ce cinéma muet mental de seize images par seconde, avait provoqué la plus miraculeuse des mécaniques humaines »…Tonio riait comme on pète et Jackie pouffait, pliée, tandis que le rire gagnait toutes les tables de la Grappe d’or où la belle Camerounaise s’activait en se gondolant à son tour, et Shmuel y allait de sa lancée : «Jamais rire ne fut plus puissant, porté par le caquètement des poulets et des dindes, par le meuglement des vaches, le hurlement des chiens sauvages, porté à travers les collines desséchées du territoire de Menashé, de Jisr al-Zarqa, jusqu’aux ruines de Césarée, jusqu’à son aqueduc qui longe le sable et la mer, les eaux jaillissantes et le rougeoiement du ciel, aux confins de Sdot Yam »…Notre rire aussi avec Bona et sa Marie Lumière, Bona qui me montrait sur son portable la maison construite de ses mains au-dessus du fleuve Congo et dont tous les ouvriers agricoles s’étaient mis à se désopiler, le rire de Bona quand il avait rencontré cet enfoiré de Tonio, le rire de Marie Lumière quand j’avais débarqué au 69 Burnaby Steet à quelque pas de la salle de musculation désaffectée – vision de boutique bombardée aux gisantes haltères couvertes de poussière – où tu pouvais rencontrer Mister Muscle Great Britain avant les années de dépression -, ce même rire dont parlait Shmuel « destiné à faire plier les puissants et abattre cent portes de forteresse, de sépulcres et de sépultures », ce même rire qui fait dévier les drones russes au-dessus des chaumières d’Ukraine, « le rire libre, gratuit, celui qui n’a d’autre ambition que d’être un orgasme de l’esprit et des boyaux, de congédier dans la volupté le réel, la tragédie, la mort et son attente angoissée ; ce rire collectif était étoilé de milliers de nuances. Une polyphonie symphonique qui possédait toutes les clés pour ouvrir la ville comme une figue mûre et sucrée. Jérusalem fut surprise dans son sommeil peuplé de rêves messianiques », etc.
(Kasperliana, 2)L’intensité sans pareille de sa présence se ressentait par défaut quand il les avait quittés et qu’ils se retrouvaient là tout cons à se demander ce qui leur était arrivé pour qu’à l’instant ils se sentent à la fois si pleins et si vides, ils (ou elles si tu préfères), s’étaient retournés une dernière fois dans la ruelle de cette nuit-la ou n’importe où d’où il venait de disparaître, et les choses restaient là sans lui , les choses inexplicables, les choses abruties quand on ne les regarde pas vraiment, le navire de Swift qui a disparu dans la nuit libérée par son rire, et c’est d’ailleurs de cela que vous aviez parlé avec Kasperl avant qu’il ne se retire de la Grappe d’or comme il y était entré - comme en douce serait l’expression la plus exacte-, ce rire à la Swift qui fait parfois mourir tant il est plein de toute la splendeur odieuse et de la cruauté délicieuse des choses de la vie - et ce soir là précisément Kasperl leur avait rapporté ce que son occulte compère Shmuel lui avait narré à propos du garçon scié de rire à la lecture du roman de Vargas Llosa, littéralement explosé de rire quand , à la représentation de la Passion du Christ au théâtre municipal Saavedra, à La Paz , la croix se met à trembler, dont le crucifié s’exclame tout soudain « je tombe, putain je tombe! », et le rire du jeune homme se met à proliférer alentour au kibboutz de Yaad Hanna, Kasperl reprend texto les mots de son compère Shmuel, « Le rire du jeune homme, qui venait de naître dans un théâtre d’Amérique du sud, à trois mille cinq cents mètres d'altitude, deux décennies avant que la nuit n’assombrisse la cime des cyprès et des arbres de Judée du kibboiutz Kvar Avraham, ce rite universel qui rend si truculent, la peau de banane, ce cinéma muet mental de seize images par seconde, avait provoqué la plus miraculeuse des mécaniques humaines »…Tonio riait comme on pète et Jackie pouffait, pliée, tandis que le rire gagnait toutes les tables de la Grappe d’or où la belle Camerounaise s’activait en se gondolant à son tour, et Shmuel y allait de sa lancée : «Jamais rire ne fut plus puissant, porté par le caquètement des poulets et des dindes, par le meuglement des vaches, le hurlement des chiens sauvages, porté à travers les collines desséchées du territoire de Menashé, de Jisr al-Zarqa, jusqu’aux ruines de Césarée, jusqu’à son aqueduc qui longe le sable et la mer, les eaux jaillissantes et le rougeoiement du ciel, aux confins de Sdot Yam »…Notre rire aussi avec Bona et sa Marie Lumière, Bona qui me montrait sur son portable la maison construite de ses mains au-dessus du fleuve Congo et dont tous les ouvriers agricoles s’étaient mis à se désopiler, le rire de Bona quand il avait rencontré cet enfoiré de Tonio, le rire de Marie Lumière quand j’avais débarqué au 69 Burnaby Steet à quelque pas de la salle de musculation désaffectée – vision de boutique bombardée aux gisantes haltères couvertes de poussière – où tu pouvais rencontrer Mister Muscle Great Britain avant les années de dépression -, ce même rire dont parlait Shmuel « destiné à faire plier les puissants et abattre cent portes de forteresse, de sépulcres et de sépultures », ce même rire qui fait dévier les drones russes au-dessus des chaumières d’Ukraine, « le rire libre, gratuit, celui qui n’a d’autre ambition que d’être un orgasme de l’esprit et des boyaux, de congédier dans la volupté le réel, la tragédie, la mort et son attente angoissée ; ce rire collectif était étoilé de milliers de nuances. Une polyphonie symphonique qui possédait toutes les clés pour ouvrir la ville comme une figue mûre et sucrée. Jérusalem fut surprise dans son sommeil peuplé de rêves messianiques », etc. -
Tierce de joie
(À l’Ami unique et pour Lady L.)Tu me suis partout où je vais,ou plus exactement:tu m’y as précédé souventaux heures qui te chantenten ce constant enchantementde ta seule présence…Tu n’as surgi de nulle part:sans décrier le monde,la part que tu savais y prendrene laissera plus d’autre traceque celle des motstracés à l’eau sur le miroirse rappelant ta grâce…Toi seul savais me parler d’elle,alliés à jamais,buvant à la même fontainela même eau pure du seul instantau commun sablier -seuls à jamais nous ressemblonsà qui n'est jamais séparé... -
Shmuel T. Meyer, contre la haine, célèbre la ressemblance humaine
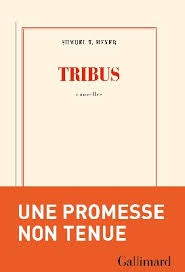 Avec les douze nouvelles de Tribus, souvent déchirantes, mais combien éclairantes et gages d’espoir « malgré tout », l’écrivain franco-israélien en dit plus que maints experts et autres analystes, sondant les sources de la haine qui divise aujourd’hui la société israélienne, où l’idéal sioniste s’est transformé en « messionisme » vengeur avec une violence inouïe…Un double sentiment, d’accablement désespéré et de joie paradoxale, de tristesse partagée et de confiance confuse refusant le pire, ne cesse de s’imposer à la lecture des récits à la fois très incarnés et fortement symboliques de Tribus, nouvelle illustration de l’immense talent de Shmuel T. Meyer, vivant lui-même la déchirure vécue par les Israéliens entre eux.« La vie était propre et simple même après l’assassinat de Rabin, parce que la colère était nourrie d’espoirs. Yoav et son épouse croyaient en la rédemption des hommes », lisons-nous dans la sixième nouvelle de Tribus, intitulée Yoav et Maya et décrivant la vie d’un couple de sexas de bonne foi (lui est le rabbin d’une communauté réformée enseignant l’histoire des religions, et elle est infirmière en oncologie), mais ladite « foi en la rédemption des hommes » a du plomb dans l’aile depuis le 11 septembre (la famille de Yoav l’accompagnait alors aux Etats-Unis pour une série de conférences ), le « judaïsme bonhomme » pratiqué par le couple a subi des coups avec la radicalisation religieuse en marche, et plus particulièrement quand un juge intègre de leur connaissance, ancien président de la Cour suprême, a soudain été placé en résidence surveillée par un sbire du Premier ministre, enfin leur communauté libérale est devenue l’objet d’injures et d’attaques physiques de la part des ultraorthodoxes conspuant les « faux juifs prosélytes d’Amérique », et la conclusion est à fendre le cœur quand ces amoureux de Jérusalem, ces pratiquants d’un « judaïsme de la joie », se font dire, par un fonctionnaire de police des frontières à dégaine de seul véritable défenseur de la tribu, que leur nouveau passeport leur ouvrira désormais toutes les portes, sauf celles de leur pays...La vie décrite, plutôt que les bombes, les destinées personnelles et leurs « petites histoires », ressaisies dans la dérive collective de l’Histoire avec une grande hache, mieux que les analyses expertes et autres explications géo-politiques ou théologico-sociologiques: telle est la matière de ces douze modulations individualisées de la vie des gens à visages de femmes et d’hommes de conditions et de convictions diverses, témoins d’une tragédie aboutissant aujourd’hui, après un odieuse agression de masse islamiste, à un non moins abominable massacre des innocents.Mais que peut faire un écrivain face à la Shoah, face aux pogroms, face aux fatwahs et aux razzias ? L’on se rappelle l’injonction de Theodor Adorno, selon lequel « après Auschwitz, écrire de la poésie est barbare », mais de même qu’Adorno s’est rétracté, la Littérature a prouvé depuis lors qu’elle participait bel et bien à la lutte « contre Auschwitz », et c’est « la poésie », justement, qui constitue l’un des forces de Shmuel T. Meyer, à savoir la concentration, à chaque page de chacune de ses nouvelles de la beauté et de la bonté dans le contexte humain parfois le plus haineux ou le plus laid, cette nouvelle société israélienne aux prises avec le fanatisme et ce que le penseur allemand Peter Sloterdijk appelle justement « la folie de Dieu ».Or nous voici arrivés en ces temps où des citoyens qui ont cru à l’idéal sioniste, déçus voire désespérés par le « messionisme » qui fait danser les Messie avec Satan s’exilent en Allemagne…« Je fous le camp », déclare le jeune Avroumchik. «Définitivement. Vancouver, Melbourne, Auckland, Copenhaugue, Berlin. Un endroit qui n’est pas ici, un endroit où tu ne serais pas juge. Un endroit où Dieu me semblera heureux »...Dans la nouvelle intitulée Le jour du colonel, ce jeune caporal-chef chargé de conduire une juge militaire au procès d’un colonel dégradé représentant « le patron de ce qui restait de l’opposition parlementaire », taxé d’antisémitisme et de trahison par le Premier ministre et qui se suicidera le soir même, cet Avroumchik a perçu la nouvelle violence plombant la capitale de l’Etat hébreu, « une violence qui échappait au sens commun de la violence tribale, économique ou sociale », ici la violence était divine, il n’en doutait pas un instant, une justice sans miséricorde, une violence de la radicalité ».Et le vieux Ravi, le cœur à gauche et l’âme en lambeaux, de formuler son propre désespoir dès la première nouvelle de Tribus et dans son épilogue : « Lui qui était, aux yeux de la communauté séfarade, lorsqu’il portait encore l’uniforme, un symbole de fierté, était devenu à sa retraite et depuis son remariage avec Nava, la cible préférée des prêcheurs des synagogues orientales. Il avait toujours fait le choix d’Israël contre celui des tribus. Il s’était trompé. Le tribalisme ontologique du peuple juif s’était imposé face à l’utopie du rassemblement des exils ».Des prénoms, des visages et des voix…Si vous ne savez rien des traditions et des rites du judaïsme, ne connaissez rien de la cuisine judéo-arabe ou des découpages territoriaux de Jérusalem et environs cousus de checkpoints, sursautez plus ou moins devant les noms et prénoms, ou autres noms de lieux, tels que Shaul et Rafi (deux vieux amis aux positions contrastées) et Nava et Ronit (leurs épouses), ou le septième enfant de dix prénommé Yakov et surnommé Koby, ou le kibboutz Kfar Avraham où sont nés divers personnages, Josh le vieux hippie transformé en mystique , Scanner le rabbin et IRM son épouse, la ville arabe bétonnée à la diable de Umm el Fahm ou la tribu hiérosolymitaine de Reb Pinhas Altschuler ; si les premières manifs de Shalom Akshav (la Paix maintenant) ne vous en disent pas plus que les éditos contestés d’Amira Hass dans le supplément de Haaretz, pas de soucis les amis : vous serez illico dans le bain malgré vous grâce à la grâce grave du conteur dont les histoires rassemblent aux vôtres, histoires de familles semblables aux familles de partout avec leur grognes à propos de tout, sauf qu’Israël ne ressemble à rien avec son Histoire taillée à la hache, son passé terrifiant et « tout » qui recommence comme aux temps bibliques des tribus en bisbilles…Par delà l’horreur, la vie…La composition des onze nouvelles de Tribus a été achevée par Shmuel T. Meyer le 27 juin 2023, au kibboutz Nativ Halamed Hé. L’épilogue, plus que poignant : bouleversant, est daté du 7 octobre 2023. Nous y retrouvons Rafi, en phase terminale de cancer, Nava son épouse et le jeune infirmier Idan du « camp des vainqueurs », petit-neveu de Koby de la Mousrara, mais le contraire de ce perdant : un futur médecin à large kippa qui lance au grand malade : « On les crèvera tous…ces nazis, ne vous en faites pas, Monsieur Rafaël, ces sauvages on les crèvera tous ».Alors Nava, plus que jamais éprise de justice et de vérité, de reprendre Idan : « Ce ne sont pas des nazis. Ils ne mécanisent ni n’industrialisent la mort des juifs, ce sont des pogromistes, comme le furent les Roumains, les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes, les Russes, les Croates ». Et la très belle femme aux cheveux blancs de poursuivre : « J’ai l’âge de ce pays dans lequel j’ai eu la chance de naître, je suis sûre que Rafi dirait « ou la malchance, imagine-toi la Californie en 1948 ». Je suis née à Jérusalem, imagine-toi Idan. Je suis née dans cette ville que tous les juifs durant toutes les générations espérèrent comme la fin de l’exil, la fin de la haine, la fin des pogroms et du gaz, et des crachats et de la peur »…Et la vieille épouse de Rafi de poursuivre au nom de celui-ci : « Le sionisme nous avait promis plein de choses et notre expérimentation collective de deux mille ans d’exil était tentée d’y apporter foi. Les juifs qui ont toujours espéré quelque chose ont été trahis chaque fois par de faux messies venus de leurs rangs, le sionisme semblait pour certains une espérance crédible qui avait répondu à sa première promesse – le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Mais il y avait d’autres promesses, Idan. Celle d’être une démocratie généreuse, mais aussi celle d’être le seul endroit au monde où les juifs seraient en sécurité. Er ces deux promesses-là, le sionisme ne les a pas tenues. Notre démocratie ? La lumière s’éteint comme une bougie qui grésille depuis 1967 déjà. Des Cosaques venus de Gaza arrachent en Israël les têtes des enfants, éventrent les femmes, les violent, les brûlent, assassinent des vieillards. Voici les deux promesses que le sionisme n’a pas voulu ou pas pu respecter, Idan ».Et Nava d’enjoindre finalement le jeune infirmier qui va recevoir son ordre de mobilisation : « Alors, va te battre contre les Cosaque de l’Islam, mais fais respecter cette promesse avec justice et humanité et, lorsque tu reviendras de cette guerre, rallume la flamme de la démocratie qu’on y voie enfin clair dans ce pays et qu’il redevienne une espérance humaine, ici et maintenant, et pas dans un monde où le Messie danse avec Satan »…Shmuel T. Meyer. Tribus. Gallimard, 2024. 164p.
Avec les douze nouvelles de Tribus, souvent déchirantes, mais combien éclairantes et gages d’espoir « malgré tout », l’écrivain franco-israélien en dit plus que maints experts et autres analystes, sondant les sources de la haine qui divise aujourd’hui la société israélienne, où l’idéal sioniste s’est transformé en « messionisme » vengeur avec une violence inouïe…Un double sentiment, d’accablement désespéré et de joie paradoxale, de tristesse partagée et de confiance confuse refusant le pire, ne cesse de s’imposer à la lecture des récits à la fois très incarnés et fortement symboliques de Tribus, nouvelle illustration de l’immense talent de Shmuel T. Meyer, vivant lui-même la déchirure vécue par les Israéliens entre eux.« La vie était propre et simple même après l’assassinat de Rabin, parce que la colère était nourrie d’espoirs. Yoav et son épouse croyaient en la rédemption des hommes », lisons-nous dans la sixième nouvelle de Tribus, intitulée Yoav et Maya et décrivant la vie d’un couple de sexas de bonne foi (lui est le rabbin d’une communauté réformée enseignant l’histoire des religions, et elle est infirmière en oncologie), mais ladite « foi en la rédemption des hommes » a du plomb dans l’aile depuis le 11 septembre (la famille de Yoav l’accompagnait alors aux Etats-Unis pour une série de conférences ), le « judaïsme bonhomme » pratiqué par le couple a subi des coups avec la radicalisation religieuse en marche, et plus particulièrement quand un juge intègre de leur connaissance, ancien président de la Cour suprême, a soudain été placé en résidence surveillée par un sbire du Premier ministre, enfin leur communauté libérale est devenue l’objet d’injures et d’attaques physiques de la part des ultraorthodoxes conspuant les « faux juifs prosélytes d’Amérique », et la conclusion est à fendre le cœur quand ces amoureux de Jérusalem, ces pratiquants d’un « judaïsme de la joie », se font dire, par un fonctionnaire de police des frontières à dégaine de seul véritable défenseur de la tribu, que leur nouveau passeport leur ouvrira désormais toutes les portes, sauf celles de leur pays...La vie décrite, plutôt que les bombes, les destinées personnelles et leurs « petites histoires », ressaisies dans la dérive collective de l’Histoire avec une grande hache, mieux que les analyses expertes et autres explications géo-politiques ou théologico-sociologiques: telle est la matière de ces douze modulations individualisées de la vie des gens à visages de femmes et d’hommes de conditions et de convictions diverses, témoins d’une tragédie aboutissant aujourd’hui, après un odieuse agression de masse islamiste, à un non moins abominable massacre des innocents.Mais que peut faire un écrivain face à la Shoah, face aux pogroms, face aux fatwahs et aux razzias ? L’on se rappelle l’injonction de Theodor Adorno, selon lequel « après Auschwitz, écrire de la poésie est barbare », mais de même qu’Adorno s’est rétracté, la Littérature a prouvé depuis lors qu’elle participait bel et bien à la lutte « contre Auschwitz », et c’est « la poésie », justement, qui constitue l’un des forces de Shmuel T. Meyer, à savoir la concentration, à chaque page de chacune de ses nouvelles de la beauté et de la bonté dans le contexte humain parfois le plus haineux ou le plus laid, cette nouvelle société israélienne aux prises avec le fanatisme et ce que le penseur allemand Peter Sloterdijk appelle justement « la folie de Dieu ».Or nous voici arrivés en ces temps où des citoyens qui ont cru à l’idéal sioniste, déçus voire désespérés par le « messionisme » qui fait danser les Messie avec Satan s’exilent en Allemagne…« Je fous le camp », déclare le jeune Avroumchik. «Définitivement. Vancouver, Melbourne, Auckland, Copenhaugue, Berlin. Un endroit qui n’est pas ici, un endroit où tu ne serais pas juge. Un endroit où Dieu me semblera heureux »...Dans la nouvelle intitulée Le jour du colonel, ce jeune caporal-chef chargé de conduire une juge militaire au procès d’un colonel dégradé représentant « le patron de ce qui restait de l’opposition parlementaire », taxé d’antisémitisme et de trahison par le Premier ministre et qui se suicidera le soir même, cet Avroumchik a perçu la nouvelle violence plombant la capitale de l’Etat hébreu, « une violence qui échappait au sens commun de la violence tribale, économique ou sociale », ici la violence était divine, il n’en doutait pas un instant, une justice sans miséricorde, une violence de la radicalité ».Et le vieux Ravi, le cœur à gauche et l’âme en lambeaux, de formuler son propre désespoir dès la première nouvelle de Tribus et dans son épilogue : « Lui qui était, aux yeux de la communauté séfarade, lorsqu’il portait encore l’uniforme, un symbole de fierté, était devenu à sa retraite et depuis son remariage avec Nava, la cible préférée des prêcheurs des synagogues orientales. Il avait toujours fait le choix d’Israël contre celui des tribus. Il s’était trompé. Le tribalisme ontologique du peuple juif s’était imposé face à l’utopie du rassemblement des exils ».Des prénoms, des visages et des voix…Si vous ne savez rien des traditions et des rites du judaïsme, ne connaissez rien de la cuisine judéo-arabe ou des découpages territoriaux de Jérusalem et environs cousus de checkpoints, sursautez plus ou moins devant les noms et prénoms, ou autres noms de lieux, tels que Shaul et Rafi (deux vieux amis aux positions contrastées) et Nava et Ronit (leurs épouses), ou le septième enfant de dix prénommé Yakov et surnommé Koby, ou le kibboutz Kfar Avraham où sont nés divers personnages, Josh le vieux hippie transformé en mystique , Scanner le rabbin et IRM son épouse, la ville arabe bétonnée à la diable de Umm el Fahm ou la tribu hiérosolymitaine de Reb Pinhas Altschuler ; si les premières manifs de Shalom Akshav (la Paix maintenant) ne vous en disent pas plus que les éditos contestés d’Amira Hass dans le supplément de Haaretz, pas de soucis les amis : vous serez illico dans le bain malgré vous grâce à la grâce grave du conteur dont les histoires rassemblent aux vôtres, histoires de familles semblables aux familles de partout avec leur grognes à propos de tout, sauf qu’Israël ne ressemble à rien avec son Histoire taillée à la hache, son passé terrifiant et « tout » qui recommence comme aux temps bibliques des tribus en bisbilles…Par delà l’horreur, la vie…La composition des onze nouvelles de Tribus a été achevée par Shmuel T. Meyer le 27 juin 2023, au kibboutz Nativ Halamed Hé. L’épilogue, plus que poignant : bouleversant, est daté du 7 octobre 2023. Nous y retrouvons Rafi, en phase terminale de cancer, Nava son épouse et le jeune infirmier Idan du « camp des vainqueurs », petit-neveu de Koby de la Mousrara, mais le contraire de ce perdant : un futur médecin à large kippa qui lance au grand malade : « On les crèvera tous…ces nazis, ne vous en faites pas, Monsieur Rafaël, ces sauvages on les crèvera tous ».Alors Nava, plus que jamais éprise de justice et de vérité, de reprendre Idan : « Ce ne sont pas des nazis. Ils ne mécanisent ni n’industrialisent la mort des juifs, ce sont des pogromistes, comme le furent les Roumains, les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes, les Russes, les Croates ». Et la très belle femme aux cheveux blancs de poursuivre : « J’ai l’âge de ce pays dans lequel j’ai eu la chance de naître, je suis sûre que Rafi dirait « ou la malchance, imagine-toi la Californie en 1948 ». Je suis née à Jérusalem, imagine-toi Idan. Je suis née dans cette ville que tous les juifs durant toutes les générations espérèrent comme la fin de l’exil, la fin de la haine, la fin des pogroms et du gaz, et des crachats et de la peur »…Et la vieille épouse de Rafi de poursuivre au nom de celui-ci : « Le sionisme nous avait promis plein de choses et notre expérimentation collective de deux mille ans d’exil était tentée d’y apporter foi. Les juifs qui ont toujours espéré quelque chose ont été trahis chaque fois par de faux messies venus de leurs rangs, le sionisme semblait pour certains une espérance crédible qui avait répondu à sa première promesse – le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Mais il y avait d’autres promesses, Idan. Celle d’être une démocratie généreuse, mais aussi celle d’être le seul endroit au monde où les juifs seraient en sécurité. Er ces deux promesses-là, le sionisme ne les a pas tenues. Notre démocratie ? La lumière s’éteint comme une bougie qui grésille depuis 1967 déjà. Des Cosaques venus de Gaza arrachent en Israël les têtes des enfants, éventrent les femmes, les violent, les brûlent, assassinent des vieillards. Voici les deux promesses que le sionisme n’a pas voulu ou pas pu respecter, Idan ».Et Nava d’enjoindre finalement le jeune infirmier qui va recevoir son ordre de mobilisation : « Alors, va te battre contre les Cosaque de l’Islam, mais fais respecter cette promesse avec justice et humanité et, lorsque tu reviendras de cette guerre, rallume la flamme de la démocratie qu’on y voie enfin clair dans ce pays et qu’il redevienne une espérance humaine, ici et maintenant, et pas dans un monde où le Messie danse avec Satan »…Shmuel T. Meyer. Tribus. Gallimard, 2024. 164p. -
Ne pas savoir d'amour
 (Aux mânes de W.B. Yeats)Jeunes, ils se seront donc aimés,ne sachant rien de rien,sur le rivage, en nudité,sans un mot pour le dire -le dire de l'obscure lumière,dès l’amour tout premier…Mort ou enfui, tout autre amouraura beaucoup parlé:les vieilles amours savent toutet les arbres en plein journe sauraient ignorerla nuit de leurs corps élevésen feuilles tout là-hautfrémissant entre les écueilsdu grand ciel océan…Vous n’êtes pas morts au remords:vous savez le failli,dès l’enfant sans aucun déni,vous êtes préparé;mais savoir est ange déchu,aurez-vous donc apprisdès qu’amour vous fut accordé,aussitôt enlevé, aussitôt révélé...Aquarelle: carnets de JLK
(Aux mânes de W.B. Yeats)Jeunes, ils se seront donc aimés,ne sachant rien de rien,sur le rivage, en nudité,sans un mot pour le dire -le dire de l'obscure lumière,dès l’amour tout premier…Mort ou enfui, tout autre amouraura beaucoup parlé:les vieilles amours savent toutet les arbres en plein journe sauraient ignorerla nuit de leurs corps élevésen feuilles tout là-hautfrémissant entre les écueilsdu grand ciel océan…Vous n’êtes pas morts au remords:vous savez le failli,dès l’enfant sans aucun déni,vous êtes préparé;mais savoir est ange déchu,aurez-vous donc apprisdès qu’amour vous fut accordé,aussitôt enlevé, aussitôt révélé...Aquarelle: carnets de JLK -
Sourcier de parole
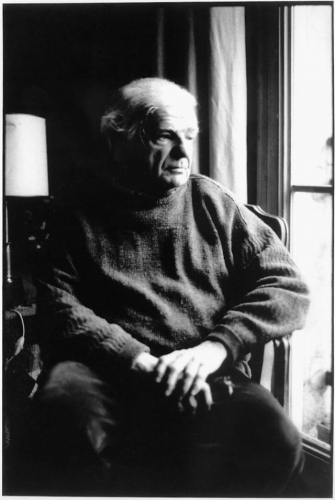
Une belle rencontre en 1992, à Vevey. Yves Bonnefoy y était venu pour évoquer son ami le peintre et sculpteur Raoul Ubac. Entretien.
Il est beau d'entendre un grand poète d'aujourd'hui s'expliquer loyalement, donc avec autant de simplicité que de minutieuses nuances, sur la quête d'une existence et d'une œuvre. Tel préjugé voudrait que la poésie fût réservée à quelques lettrés évanescents, ou ne constitue qu'une sorte de jeu cérébral ou d'évasion esthétique. Mais c'est à l'opposé de ces contrefaçons que se déploie l'œuvre poétique d'Yves Bonnefoy, dont la première vertu est de nous restituer, plus que réelle, la présence du monde, tout en ressaisissant notre propre présence au monde.
— Comment définiriez-vous aujourd'hui, pour le lecteur le moins initié, votre petit-fils ou votre grand-père berger, la poésie et ce qu'elle peut ou veut dire par rapport au discours ordinaire?
— Votre question a plus de sens pour moi que vous ne l'avez imaginé. La mère de mon grand-père fut bergère, en effet, bergère toute sa vie sur le Causse, et si je l'avais connue, et à l'âge où je vins à réfléchir à la poésie, je me serais certainement demandé s'il fallait que je lui explique ce qui d'évidence me retenait à ces publications si étranges, quitte, ensuite, à m'abstenir de rien dire. Pourquoi ne pas vouloir parler de la poésie à un être que l'on respecte, alors que le poème n'existe que sous le signe d'autrui, et par un désir d'échange enfin autre et plus essentiel que les stéréotypes de la parole ordinaire? Parce que ce que cette vieille femme percevait encore instinctivement, sur ses précaires chemins de pierres, dans les chapelles de son village, ou penchée sur l'âtre noirci, à savoir qu'il y a de l'absolu, et que cette sorte-là de présence du monde est comme donnée, à des moments, dans l'arbre, dans le rocher, dans le ciel, eh bien, c'est ce qui pour d'autres qu'elle, et de plus en plus aujourd'hui, est une expérience difficile, à demi éteinte par nos façons de penser, d'où suit qu'on ne pourra la revivre que par une lutte contre les mots, dans des poèmes qui en seront ainsi d'accès difficile pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre conscience de ces événements qui ont lieu à l'intérieur du langage. J'aurais eu à expliquer beaucoup de faits de culture, j'aurais dû tenter de le faire avec des vocables de spécialiste, et n'aurais donc pu qu'attrister la vieille femme vêtue de noir, aux mains sans écriture: elle aurait même pu en venir à croire que c'était moi, celui qui savait! Le souci de la poésie est aussi de nos jours un souci quant à la façon d'en parler à ceux qui sont le mieux placés pourtant pour la vivre encore. Et parmi eux les enfants.
— Avez-vous souvenir de votre premier étonnement poétique?
— Vous avez raison, c'est bien cette idée de l'étonnement qui permettrait sans doute le mieux de définir, disons peut-être plutôt de désigner, la poésie: et surtout si c'est un enfant, celui auquel on s'adresse. Car un certain étonnement, c'est l'enfance même, et c'est en lui que la poésie peut prendre. Mon premier étonnement? Un de mes premiers, en tout cas? Je me revois à la fenêtre ou sur la terrasse de la maison de mes grands-parents, regardant un gros arbre isolé des autres sur la colline d'en face. Je revenais sans cesse l'interroger du regard, en sa distance, en ce silence, pourquoi? D'abord, parce qu'à être ainsi tout seul, là-bas, sur l'arrière- fond indistinct des autres, il parlait du fait d'être un individu, une existence d'individu, ce qui me permettait de prendre conscience de moi- même, en retour, comme d'une personne au seuil de sa destinée. Mais l'idée de personne n'a rien qui conduise à la poésie, spécifiquement, et l'étonnement se portait au-delà, si je puis dire: c'était de voir l'arbre s'éployer, dans cette forme et ce lieu de hasard jusqu'au bout portant de ses branches, à tous les points extrêmes de son contour sur le ciel, ce qui transmutait ce hasard en évidence, cette part du tout en le tout lui- même. L'arbre un jour ne serait plus là ? Et pourtant, c'était lui la réalité, et de façon si profonde que la pensée des temps à venir, ou passés, la pensée du temps, celle aussi bien de l'espace, se dissipaient. Comment mieux dire cela? Et justement, peut-on même le dire? L'étonnement, n'est-ce pas aussi ce qui ne trouve pas de mots pour se dire? Voilà ce que je pourrais rappeler si mon interlocuteur était un enfant (car quel enfant ne vient pas d'avoir une expérience semblable?) en lui disant qu'un poème, c'est quand ce qu'on lit vous rend brusquement à propos de ce dont il parle cette impression que me faisait l'arbre. Je pourrais alors ajouter que pour que le poème existe il faut que celui qui l'écrit ait écouté le son des mots: car c'est d'opposer dans le vers l'exigence des sons à celle du sens qui permet de ne plus être le prisonnier de cet enchaînement des notions qui nous offre de tout dire de chaque chose, sauf sa présence.
— Qu'avez-vous pensé du déploiement festif lié à la commémoration de Rimbaud?
— Rimbaud avait été cet enfant. Il a préservé comme aucun autre poète l'étonnement de l'enfance. Il a évoqué cet étonnement de façon irrésistiblement communicative dans quelques «Illuminations», par exemple. Comment, du coup, être heureux de ces commémorations qui l'ont entraîné dans un flot de formulations, de stéréotypes si conventionnels, si faciles que tout s'éteint là où ils fluent et refluent? Peut-on parler de la poésie, nous demandions-nous tout à l'heure, et comment? Seulement, en tout cas, dans le rapport de personne à personne — conversation, livre qui donne le temps de descendre en ce que nous sommes — et non sur des tréteaux, avec haut-parleurs, et l'imposteur qui est en train de parler plus fort que tous les autres, bien entendu! Dire cela, ce n'est pas vouloir que Rimbaud ne soit pas connu. C'est savoir qu'il ne vaut d'être présent partout que préservé dans son exigence. On n'aura plus rien de Rimbaud si on ne distribue de lui que l'image qui permet à n'importe quel adolescent d'imaginer qu'il est l'auteur d'«Une saison en enfer» dès qu'il se met un baluchon sur l'épaule...
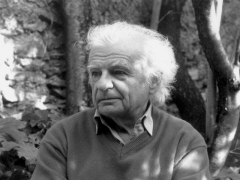 La ferveur et l’absolu
La ferveur et l’absoluCélébration de cela simplement qui est (nos «vrais lieux» et leurs bases élémentaires de pierre et de vent et d'eau et de feu, puis les présences vivantes qui y inscrivent leurs traces et leurs projets), l'œuvre d'Yves Bonnefoy est simultanément interrogation vibrante sur le sens de cette présence marquée du «chiffre de mort» et cernée de «fausse parole»; le musicien du verbe rejoignant alors le penseur.
Dans le sillage de Valéry (dont il poursuit les grandes leçons de poétique au Collège de France), mais en terrien aux figures plus incarnées et moins drapées, Yves Bonnefoy est sans doute, des poètes contemporains, celui qui a le plus magistralement associe les élans obscurs de l'imagination lyrique et les pondérations de la raison discursive.
Ainsi les recueils du poète (les Poèmes de la collection Poésie/Gallimard, préfacés par Jean Starobinski, en regroupent quatre majeurs, constituant la meilleureintroduction, avec la monographie de John E. Jackson dans «Poètes d'aujourd'hui», chez Seghers; et l'on ne saurait trop recommander aussi Début et fin de la neige, paru au Mercure de France en 1991, qui nous comble par sa simplicité souveraine) voisinent- ils avec une œuvre non moins importante d'essayiste, de prosateur et de traducteur de Shakespeare. Lecteur admirable (son introductionà Rimbaud reste un phare pour les jeunes lecteurs), le poète est enfin un interprète à la fois savant et inspiré des messages chiffrés de l'art, dont témoignent les lignes fraternelles et lumineuse consacrées à Raoul Ubac dans le catalogue de l'exposition. Avec ce sourcier de silence, l'on pourrait dire, enfin, qu'Yves Bonnefoy partage le goût des matières élémentaires et des formes transfigurées, porté par la même ardente ferveur et le même sens de l'absolu.
(Cette page a paru dans le quotidien 24 Heures en date du 13 août 1992)
-
Vivre et survivre
(Le Temps accordé, Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, Ce mardi 16 avril. – Comment échapper aux mots creux de la bondieuserie sans cesser de poursuivre sa chasse aux dieux de l’Amour avec une grande aile, me demandais-je ce matin à l’éveil d’une nuit vide suivant une soirée de désordre mental au ciel plein des trous noirs de l’Obsession ? À cela l’oblat aurait répondu : par la prière, tandis que je réponds : par la poésie...SERPILIÈRE. – Quand les jeunotes se pointaient au couvent très impatientes de s’élever l’âme et de plaire à l’Époux, soulevées d’avance à la seule idée d’être demain meilleures et après-demain parfaites, Teresa leur filait un seau et une serpilière et, désignant les sols à récurer, leur disait simplement : récure.Ce que je vais m’efforcer ce matin de faire pour nettoyer ma propre ordure, dedans, et dans mes chambres : les objets, trop d’objets, trop de tas de papiers, de journaux, de revues et de livres, de manuscrits et de tapuscrits, de brochures et de bricoles, et commençant par le tout début, de mon semainier je tire mes 8 molécules du matin en notant : plus de Metroprolol, donc pharmacie cet après-midi...LE SAGE INCONNU. – Constatant mon incapacité de faire des sermons ou de prodiguer de bons conseils sans grimacer, je me rappelle ces années où aux filles, petites ados, j’ai envoyé deux ou trois lettres signées Le Sage inconnu, qui les ont intriguées (cela était posté) amusées (je l’ai constaté) et peut-être incitées à quelque réflexion introspective, qui sait ? Aujourd’hui je n’oserais plus. Mais le Sage inconnu poursuit en moi son travail de sape et de rétrospection sourcilleuse ou d’encouragement libérateur à la relaxe magnanime, contre ma tendance puritaine voire narcissique à l’autoflagellation.À cette médiation participent le Camus de mes seize ans, Alexis Zorba sur les hauts d’Ailefroide, le Jouhandeau de mes dix-huit ans, Charles-Albert le solaire un peu plus tard, et Witkacy le visionnaire, Annie Dillard hier, ce matin l’oblat Maurice Zundel dont j’apprends qu’il cramait deux paquets de cigarettes par jour et ne dormait parfois que deux heures la nuit tant il bûchait, tout à l’heure l’Abbé au téléphone, et j’oublie, entre tant d’autres, le filosofo ignoto de Guido Ceronetti et ce cher vieil Amiel, et Mozart, et Rimbaud jusques au Harrar…DE L’OBESSSION. – Le seul mot fera croire à la police morale multiforme des temps qui courent que c’est de sexe qu’il s’agit, et c’est en effet de sexe qu’il s’agit, mais non tant d’amour et de filiation que d’agitation mondiale et de branloire générale, quand la folle Machine tue le temps, comme on dit, et que la multitude s’agite sur les écrans qui la paient de ses propres mots et d’argent sale, tel étant le trou noir de l’involution où parfois vous vous laissez emporter à votre corps peu défendant, car le corps s’est délabré lui-même en machine reptilienne et c’est ainsi que tout se défait, que tout se décrée entre votre miroir et les abattoirs de Gaza…DE LA SURVIE. – À Georges Haldas qui, d’un ton quasi inquisitorial, lui demanda un soir, au souper des amis, si elle croyait ou non à la résurrection ma bonne amie lui répondit du tac au tac que non, que pas du tout, qu’absolument pas, sauf tous les matins quand le merle ou le facteur sifflotent, et chaque matin je pense à elle qui, pudeur ou bonne façon de fille à sa mère maltraitée en son enfance par les Sœurs peu charitables, célébrait ainsi le cadeau tour à tour béni et maudit de notre vie dont la survie n'est que dans nos cœurs…Dessin JLK: Lady L. en nos jeunes années. -
Comment Simenon et Patricia Highsmith déjouent les poncifs du polar

 Souvent relégués au rayon subalterne du roman policier, Georges Simenon - sujet ces jours d’une exposition à Montricher, et Patricia Highsmith, dont le personnage de Tom Ripley fait l’objet d’une nouvelle série exceptionnelle de Steven Zaillian, avec Andrew Scott dans le rôle-titre - ont laissé deux œuvres d’envergure sondant les profondeurs de la psychologie humaine et développant une observation sociale d’une lucidité rare – qualités rarement partagées par les auteurs de « polars », notamment en Suisse romande…
Souvent relégués au rayon subalterne du roman policier, Georges Simenon - sujet ces jours d’une exposition à Montricher, et Patricia Highsmith, dont le personnage de Tom Ripley fait l’objet d’une nouvelle série exceptionnelle de Steven Zaillian, avec Andrew Scott dans le rôle-titre - ont laissé deux œuvres d’envergure sondant les profondeurs de la psychologie humaine et développant une observation sociale d’une lucidité rare – qualités rarement partagées par les auteurs de « polars », notamment en Suisse romande… Georges Simenon se plaignait de ce que la critique et le public français le considérassent (pour parler comme San Antonio) strictement comme un auteur de romans policiers, alors que le reste du monde voyait en lui un écrivain à part entière. De la même façon, Patricia Highsmith – elle-même vive admiratrice de Simenon mais ne prisant guère le genre policier en tant que tel -, n’appréciait pas du tout le titre de « reine du crime » que d’aucuns lui accolaient.
Or s’il est vrai que les « purs littéraires », et surtout en France, aiment à séparer ce qui est «vraie littérature » des genres dits mineurs (polar, science fiction, fantastique, littérature populaire en un mot), il n’est pas moins évident que le roman policier, dit aussi roman noir, thriller ou polar, a ses règles spécifiques qui en font, qu’on le veuille ou non, et sans mépris, un genre particulier.
Simenon reconnaissait, le premier, que la série de Maigret obéissait à certains schémas dont il éprouva, à un moment donné, le besoin de se libérer. Cela ne signifie pas que ses Maigret soient forcément schématiques, mais le fait est que le meilleur de Simenon échappe aux normes du polar. Un volume en partie « biographique » de la prestigieuse Pléiade, paru en 2009, témoigne à la fois de la reconnaissance et du niveau de qualité et de profondeur d’au moins une trentaine de romans qu’on taxe tantôt, comme l’auteur, de « romans durs », ou de « romans de l’homme ».
C’est ainsi que Lettre à mon juge ou le balzacien Bourgmestre de Furnes, La neige était sale, Les inconnus dans la maison, Feux rouges, Les gens d’en face ou L’homme qui regardait passer les trains, pour ne citer que ceux-là, ressortissent bel et bien à la meilleure littérature, comme il en va de Crime et châtiment de Dostoïevski, si proche à l’inverse de certains romans noirs.
Mais qui était Simenon, formidable personnage lui-même de roman sans rien de «policier» ? De Pedigree à la Lettre à ma mère, entre sept autres romans, le volume de La Pléiade éclairait incidemment la personnalité même du grand romancier.
Quand le « je » devient « il »
Il aura fallu, à l’été 1940, qu’un médecin lui annonce sa mort à brève échéance (deux ans au plus) pour que Georges Simenon entreprenne soudain, pour son premier fils Marc en bas âge, de rédiger l’histoire de sa propre enfance et de son clan liégeois, «afin qu’il sache »...
Dans l’immédiat, interdiction lui était faite de fumer, de boire ou de faire l’amour. Dur, dur pour un homme aussi porté sur la chair que sur la chère, incroyablement fécond (dix romans rien qu’en 39-40 !) et qui venait de payer de sa personne dans l’accueil de 18.000 réfugiés belges à La Rochelle, en tant que « haut commissaire » spécial…
À 38 ans, déjà célèbre et richissime, le romancier avait signé plusieurs centaines de romans, sans jamais parler de lui-même. Or c’est en « je » qu’il allait rédiger les cent premiers feuillets d’un texte (réédité plus tard sous le titre de Je me souviens) qu’il soumit à André Gide, lequel lui conseilla de passer à la troisième personne pour se raconter plus librement, comme… dans un roman de Simenon.
Ainsi fut écrit Pedigree, pavé de 400 pages et tableau vibrant de vie et d’humanité d’un quartier populaire de Liège au début du XXe siècle. Au premier rang : le jeune Roger Mamelin, entre un père sensible et digne (très proche de Désiré Simenon), et une mère castratrice, découvre tout un monde de petites gens attachants, les vertiges du sexe éprouvés par l’enfant de chœur courant au bordel avec les sous du curé, enfin la vie profuse de la ville ouvrière. Le récit s’achève à la seizième année du protagoniste, mais Simenon prétendait que l’essentiel d’un individu se forge avant dix-huit ans…
Qu’il évoque la dictature politique (l’URSS des Gens d’en face) ou la guerre conjugale (dans Pedigree dont les conjoints ne se parlent plus que par billets interposés), ses anciens amis qui ont mal tourné ou les peines d’un enfant trop sensible, Simenon le romancier reste évidemment le même homme que le mémorialiste aigu (à qui l’on intentera trois procès !) ou que le reporter autour du monde : un écrivain d’une incomparable porosité, toujours fidèle à sa devise de « comprendre et ne pas juger ».
Du noyau au « trou noir »…
« Nous sommes deux, mère, à nous regarder ; tu m’as mis au monde, je suis sorti de ton ventre, tu m’as donné mon premier lait et pourtant je ne te connais pas plus que tu ne me connais. Nous sommes, dans ta chambre d’hôpital, comme deux étrangers qui ne parlent pas la même langue – d’ailleurs nous parlons peu – et qui se méfient l’un de l’autre »…
Ce dur constat donne le ton d’un livre à la fois terrible et déchirant, par le truchement duquel on peut sonder l’abîme séparant une mère de son fils auquel elle a toujours préféré son frère cadet en dépit de la « réussite » fracassante de son aîné.
Comme l’inoubliable In Memoriam de Paul Léautaud, griffonné au chevet de son père mourant, la Lettre à ma mère que Simenon a écrite le 18 avril 1974 à Lausanne, trois ans après le décès d’Henriette Brüll, est un de ces écrits fondamentaux qui jettent, sur une vie ou une œuvre, la lumière crue de la vérité.
Ici, le manque absolu de tendresse, la frustration définitive éprouvée par un fils jamais caressé et jamais « reconnu », jusqu’à un âge avancé, en disent sans doute long sur les rapports, trivialement fonctionnels ou beaucoup plus compliqués, voire pervers, que Georges Simenon entretenait avec les femmes. Bref, une galaxie humaine à ne cesser de découvrir, comme en témoigne l’expo à voir ces jours à la fondation Michalski.
Figures de l’humiliation
Autre univers personnel à découvrir : l’arrière-monde de Patricia Highsmith, dont les Écrits intimes de plus de mille pages, parus en 2021 chez Calmann-Lévy, constituent la meilleure introduction.
Bien plus que les secrets d’une « reine du crime », nous y découvrons les soubassements émotionnels et le quotidien professionnel et affectif souvent très difficile d’une insatiable amoureuse qualifiée justement de « poète de l’angoisse » par le grand romancier anglais Graham Greene. Autant que Simenon, Patricia Highsmith a signé des romans et des nouvelles qui ne s’intéressent guère aux aspects techniques policiers ou judiciaires de la criminalité, constituant le fonds des auteurs actuels de polars, mais essentiellement aux motivations obscures de celles et ceux qui « passent à l’acte ». Dès ses premiers écrits de jeune fille, le crime la scotche, mais des flics et des « enquêtes » elle n’a que fiche…
Lors d’une visite que je lui rendis en 1988 dans le hameau tessinois d’Aurigeno, me recevant en l’humble maison de pierre où elle logeait avant sa dernière installation sur les hauts d’Ascona, la romancière, peu soucieuse de parler d’elle-même, répondit, à la question que je lui posai, relative à l’origine, selon elle, de la plupart des crimes, par un seul mot : l’humiliation.
Or celle-ci est la base évidente de la psychologie du plus emblématique de ses personnages, au nom de Tom Ripley, dont tous les agissements paraissent un exorcisme à l’humiliation nourrie d’envie, de frustration et d’esprit de revanche.

On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers inquiétant se plaisant en eaux troubles, mais le personnage est beaucoup plus que cela : un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait, calmé ou justifié.
Il faut lire la série des romans dans l’ordre de leur composition pour bien voir d’où vient Tom Ripley, survivant comme par malentendu à la disparition accidentelle de ses parents. C’est un peu la version thriller de L’homme sans qualités, dont l’écriture apparemment plate de Patricia Highsmith ne tisse pas moins un arrière-monde aux insondables profondeurs. Ripley l’informe rêve d’art et y accède par tous les biais, y compris le faux (l’invention de Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit…
Ripley est un humilié qui se rachète en douce, comme il peut, un pas après l’autre. C’est un peu par malentendu qu’il commet son premier meurtre, parce qu’un jeune homme l’a vexé, et pour tout le reste qui justifiait cet énervement du moment, tout ce que symbolisait ce fils d’enfant gâté. Mais Ripley lui-même est un monde, qui suscite de multiples interprétations, comme on l’a vu au cinéma sous les visages successifs du (trop) bel Alain Delon (Plein soleilde René Clément), du plus équivoque Matt Damon (Le talentueux M. Ripley d’Antony Minghella) et, aujourd’hui, d’un Andrew Scott qui aurait probablement troublé Highsmith elle-même…
Un Ripley « caravagesque »

Contre toute attente, s’agissant d’une série, et donc d’un sous-genre sacrifiant souvent à la superficialité, le dernier avatar de Ripley de Steven Zaillian, avec un Andrew Scott stupéfiant de subtilité dans le rôle du protagoniste, saisit à la fois par sa compréhension en profondeur de l’univers de Patricia Highsmith, son atmosphère « psychique » admirablement traduite par une image extrêmement soignée, l’ensemble des décors, des paysages italiens, des visages et de toute la scénographie du film (on peut le voir ainsi, tout un, malgré ses huit épisodes, avec sa haute qualité cinématographique évoquant le noir et blanc d’Alfred Hitchcock – premier « traducteur » de Highsmith à l’écran avec L’inconnu du Nord-express, il faut le rappeler – autant que le clair-obscur du néo-réalisme italien), mais aussi les jeux du clair-obscur du Caravage qui devient d’ailleurs la référence picturale majeure de cette plongée dans l’Italie baroque à la sensualité lancinante jusqu’au morbide, et enfin dans le jeu des acteurs, formidablement dirigés et que domine la figure diaboliquement souriante, enjôleuse, tranchante et troublante à la fois, trompeuse en plein abandon de sincérité feinte, d’un Andrew Scott au-dessus de tout éloge.
D’aucuns se sont déjà plaints, ici et là, de l’usage du noir et blanc pour évoquer la beauté de l’Italie traversée, de la côte amalfitaine à Rome et de Venise à Naples, alors que c’est justement la « couleur » parfaite de ce périple conduisant Ripley loin de l’Italie des chromos et autres cartes postales aux vertiges existentiels du Caravage, immense artiste et peut-être criminel…
Vide et taiseux, mais frémissant d’intérieure rage vengeresse, escroc minable mais génial instinctif, ambigu et d’emblée soupçonné d’être gay par la petite amie de Dickie le beau gosse de riche, mais insaisissable à tous égards : tel est le personnage de cette admirable série brève loin d’épuiser, à vrai dire, tous les aspects de ce personnage issu de l’imagination vertigineuse d’une romancière qui, chez elle, me disait qu’elle n’avait pas de télé au motif de sa peur du sang…
Georges Simenon. Pedigree et autres romans, Lettre à ma mère. Edition établie et préfacée par Jacques Dubois et Benoît Denis. Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 699p.
Montricher. Fondation Jan Michalski. https://fondation-janmichalski.com/fr/agenda/simenon
Patricia Highsmith. Les écrits intimes de Patricia Highsmith (1941-1995)
Ripley de Steven Zaillian, sur Netflix.
-
Contre la décréation
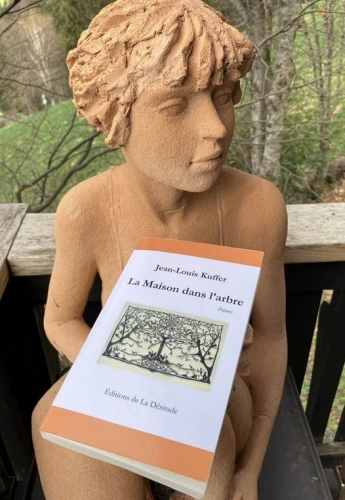 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce mardi 9 avril .- Après l’éclipse solaire totale de cette nuit, totalement invisible pour cause de nuit totale et de manque d’alignement des astres intéressés, le temps de ce matin rompt lui aussi l’alignement soleilleux d’hier: il pleut.Donc on se replie sous la pluie, dit le poème, avant de remettre un peu d’ordre dans le cabanon. Auf deutsch: Ordnung und Sauberkeit für deine Mutter waren das B-A Ba des Tagesprogramms: Liebe kleine Mutter, Heimameise. Meine Eltern waren bescheidene, unerschütterliche Vorbilder, trotz all unserer Fluchtversuche und anderen Verrätereien. Mein grundlegender Kompass im Chaos der Welt, trotz allem. Biblisches Wort: Ehre deinen Vater und deine Mutter usw.CONTRE LA DISPERSION. – Notre projet de fonder une association des Amis de La Désirade, datant déjà de plusieurs années, correspond initialement à mon souci quasi obsessionnel de transmettre un trésor après avoir constaté, ici et là, le gâchis de certains héritages vilipendés - suivez son regard...Ledit trésor, à part tout ce que j’ai reçu dès mon enfance et ma jeunesse, est à la fois affectif et spirituel, mais aussi matériel (et je ne le dirai pas « bassement » mais hautement matériel), constitué d’objets précieux à mes yeux, à savoir plus de 20.000 livres encore, après une première ponction de divers libraires, et plus de 150 œuvres d’art de valeur diverse, sans compter d’autres objets qui seraient à leur place dans un cabinet de curiosités, tel le masque inuit sculpté dans un os de baleine que m’a offert je ne sais plus qui, ou la tête de vieux sage taillée sous mes yeux dans le marbre par le spartano Mario del Sarto, sous les falaises de Carrare, entre autres…Le combat contre la dispersion a représenté pour moi, dès mes quinze ou seize ans, le fondement d’un effort, sans cesse distrait, de rassembler ce qui se dissocie et d’opposer à la « décréation » satanique ce qui nous unifie - et je me rappelle avoir noté la réflexion de Pierre Jean Jouve à propos du poète « qui unifie ».Or voici qu’après avoir envisagé, avec quelques amis, une année après la mort de Lady L., la création d’une entité qui s’opposerait à la déperdition de notre « trésor », et rien de concret ne se faisant pour autant sous l’effet, une fois de plus, de la dispersion des énergies, l’intervention tout à fait inattendue d’un ami longtemps virtuel, rencontré sur nos blogs respectifs il y aura bientôt vingt ans de ça, un certain artiste et écrivain congolais natif de Kinshasa au nom de Bona Mangangu, que je suis allé visiter une première fois à Sheffield en 1992 et qui a passé désormais le cap des 63 ans, m’a proposé de pallier la déroute à peu près complète de mes relations avec les éditeurs locaux par une voie qui m’a d’abord paru loufoque, hautement « improbable », comme on dit, à l’opposé de tout ce que j’aime dans la conception et la diffusion d’un livre, mais qui lui a permis de publier lui-même deux livres de son côté sans bourse délier – deux beaux romans que j’ai aimés autant sinon plus que tout ce que j’ai apprécié et commenté de l’olibrius en question – et voilà que le lascar s’empare du triptyque poétique dont je lui ai dit qu’une nouvelle maison du coin aux prétentions poétiques, à laquelle j’avais soumis le tapuscrit, n’a pas estimé me devoir la moindre réponse, en parfaite conformité avec la muflerie désormais répandue du « milieu »…Ainsi les éditions de La Désirade sont-elles nées, presque à mon insu et grâce à Bona, le seul compère qui m’ait concrètement aidé ces dernières années et s’impatiente, à présent, de défendre mes autres livres publiables, à commencer par mon essai sur Czapski le juste, également snobé par les éditeurs du cru.
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce mardi 9 avril .- Après l’éclipse solaire totale de cette nuit, totalement invisible pour cause de nuit totale et de manque d’alignement des astres intéressés, le temps de ce matin rompt lui aussi l’alignement soleilleux d’hier: il pleut.Donc on se replie sous la pluie, dit le poème, avant de remettre un peu d’ordre dans le cabanon. Auf deutsch: Ordnung und Sauberkeit für deine Mutter waren das B-A Ba des Tagesprogramms: Liebe kleine Mutter, Heimameise. Meine Eltern waren bescheidene, unerschütterliche Vorbilder, trotz all unserer Fluchtversuche und anderen Verrätereien. Mein grundlegender Kompass im Chaos der Welt, trotz allem. Biblisches Wort: Ehre deinen Vater und deine Mutter usw.CONTRE LA DISPERSION. – Notre projet de fonder une association des Amis de La Désirade, datant déjà de plusieurs années, correspond initialement à mon souci quasi obsessionnel de transmettre un trésor après avoir constaté, ici et là, le gâchis de certains héritages vilipendés - suivez son regard...Ledit trésor, à part tout ce que j’ai reçu dès mon enfance et ma jeunesse, est à la fois affectif et spirituel, mais aussi matériel (et je ne le dirai pas « bassement » mais hautement matériel), constitué d’objets précieux à mes yeux, à savoir plus de 20.000 livres encore, après une première ponction de divers libraires, et plus de 150 œuvres d’art de valeur diverse, sans compter d’autres objets qui seraient à leur place dans un cabinet de curiosités, tel le masque inuit sculpté dans un os de baleine que m’a offert je ne sais plus qui, ou la tête de vieux sage taillée sous mes yeux dans le marbre par le spartano Mario del Sarto, sous les falaises de Carrare, entre autres…Le combat contre la dispersion a représenté pour moi, dès mes quinze ou seize ans, le fondement d’un effort, sans cesse distrait, de rassembler ce qui se dissocie et d’opposer à la « décréation » satanique ce qui nous unifie - et je me rappelle avoir noté la réflexion de Pierre Jean Jouve à propos du poète « qui unifie ».Or voici qu’après avoir envisagé, avec quelques amis, une année après la mort de Lady L., la création d’une entité qui s’opposerait à la déperdition de notre « trésor », et rien de concret ne se faisant pour autant sous l’effet, une fois de plus, de la dispersion des énergies, l’intervention tout à fait inattendue d’un ami longtemps virtuel, rencontré sur nos blogs respectifs il y aura bientôt vingt ans de ça, un certain artiste et écrivain congolais natif de Kinshasa au nom de Bona Mangangu, que je suis allé visiter une première fois à Sheffield en 1992 et qui a passé désormais le cap des 63 ans, m’a proposé de pallier la déroute à peu près complète de mes relations avec les éditeurs locaux par une voie qui m’a d’abord paru loufoque, hautement « improbable », comme on dit, à l’opposé de tout ce que j’aime dans la conception et la diffusion d’un livre, mais qui lui a permis de publier lui-même deux livres de son côté sans bourse délier – deux beaux romans que j’ai aimés autant sinon plus que tout ce que j’ai apprécié et commenté de l’olibrius en question – et voilà que le lascar s’empare du triptyque poétique dont je lui ai dit qu’une nouvelle maison du coin aux prétentions poétiques, à laquelle j’avais soumis le tapuscrit, n’a pas estimé me devoir la moindre réponse, en parfaite conformité avec la muflerie désormais répandue du « milieu »…Ainsi les éditions de La Désirade sont-elles nées, presque à mon insu et grâce à Bona, le seul compère qui m’ait concrètement aidé ces dernières années et s’impatiente, à présent, de défendre mes autres livres publiables, à commencer par mon essai sur Czapski le juste, également snobé par les éditeurs du cru. Miracle des rencontres ! C'est à la même enseigne des conjonctions miraculeuses que j'ai publié, en 1973, mon premier opuscule postfacé par mon cher Dimitri - éditeur de rêve, et les meilleures choses qui me seront arrivées auront été marquées par la même magie des rencontres et des partages d'esprit et de coeur, ma bonne amie et les kids, merci Bona, merci la vie...
Miracle des rencontres ! C'est à la même enseigne des conjonctions miraculeuses que j'ai publié, en 1973, mon premier opuscule postfacé par mon cher Dimitri - éditeur de rêve, et les meilleures choses qui me seront arrivées auront été marquées par la même magie des rencontres et des partages d'esprit et de coeur, ma bonne amie et les kids, merci Bona, merci la vie... -
Les liaisons généreuses
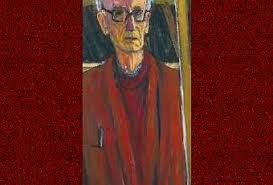 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce jeudi 4 avril. - Même après une séance apparemment réparatrice, hier, de shiatsu, aux bons soins de mon filleul Léo, dont je suis sorti fourbu et momentanément conforté, la doulou m’est revenue avec le ciel noir du soir et la quasi impossibilité de marcher sans une canne et boitant comme l’affreux Dr House que je me suis efforcé de ne pas imiter dans ses imprécations de sale type se vengeant sur les autres de ses propres putains de douleurs...Donc au lieu de hurler sur les quais et de maudire ma prochaine et mon prochain, je me suis tenu à carreau dans mon recoin à poursuivre la (re) lecture des 500 pages de la bio de notre cher Józio (prononcé Ioujo) en tachant de me représenter plus concrètement (souvenirs persos et photos à l’appui) ce qu’a été la vie de cette innombrable personne dont les innombrables épreuves , extérieures et partagées (deux guerres et deux révolutions), ou plus encore intérieures (existentielles, morales et artistiques) n’auront jamais entaché la noblesse (celle de son âme et de son coeur et pas celle de son titre de comte Hutten-Czapski) ni sa fragilité tourmentée de corps et de complexion affective , le faisant à tout moment notre semblable - Joseph m’ayant dit, un jour, avoir plus souffert du mal d’amour à vingt ans que des horreurs de la guerre et de la déportation, de la mort de ses camarades et des mensonges couvrant les massacres (Katyn au premier chef) dont il fut l'un des rescapés les moins enclins à oublier...
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce jeudi 4 avril. - Même après une séance apparemment réparatrice, hier, de shiatsu, aux bons soins de mon filleul Léo, dont je suis sorti fourbu et momentanément conforté, la doulou m’est revenue avec le ciel noir du soir et la quasi impossibilité de marcher sans une canne et boitant comme l’affreux Dr House que je me suis efforcé de ne pas imiter dans ses imprécations de sale type se vengeant sur les autres de ses propres putains de douleurs...Donc au lieu de hurler sur les quais et de maudire ma prochaine et mon prochain, je me suis tenu à carreau dans mon recoin à poursuivre la (re) lecture des 500 pages de la bio de notre cher Józio (prononcé Ioujo) en tachant de me représenter plus concrètement (souvenirs persos et photos à l’appui) ce qu’a été la vie de cette innombrable personne dont les innombrables épreuves , extérieures et partagées (deux guerres et deux révolutions), ou plus encore intérieures (existentielles, morales et artistiques) n’auront jamais entaché la noblesse (celle de son âme et de son coeur et pas celle de son titre de comte Hutten-Czapski) ni sa fragilité tourmentée de corps et de complexion affective , le faisant à tout moment notre semblable - Joseph m’ayant dit, un jour, avoir plus souffert du mal d’amour à vingt ans que des horreurs de la guerre et de la déportation, de la mort de ses camarades et des mensonges couvrant les massacres (Katyn au premier chef) dont il fut l'un des rescapés les moins enclins à oublier...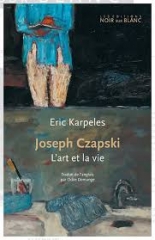
 ET MOI, ET MOI, ET MOI...- Le travail accompli par Eric Karpeles est au-dessus de tout éloge, malgré ses quelques défauts d’écriture et ses commentaires à l’américaine parfois déplacés à mon goût , et relisant sa bio de Czapski, après l’extraordinaire aperçu de l’œuvre pictural de JC dans sa fabuleuse approche illustrée et commentée des tableaux parfois examinés comme sous une loupe, avec le sous-titre d’An apprenticeship of looking, je me dis que c’est un peu vain de ma part de prétendre y ajouter quoi que ce soit avec mon « regard personnel », puis je me rappelle que tous les livres consacrés, ces dernières décennies, à la personne et à la peinture de Czapski, à l’exception peut-être de la monographie de Muriel Werner-Gagnebin, procèdent en somme du même accaparement et de la même implication personnelle, ainsi Wojtech Karpinski et Richard Aeschlimann parlent-ils d’eux-mêmes comme Jil Silberstein et Karpeles parlent d’eux-mêmes en évoquant cette rencontre que j’ai évoquée à mon tour dans Czapski le juste qui constituera, sous l’œil avisé de mon ami peintre Bona, la deuxième publication des éditions de La Désirade, cette année encore…C’est par Proust (l’essai de Czapski intitulé
ET MOI, ET MOI, ET MOI...- Le travail accompli par Eric Karpeles est au-dessus de tout éloge, malgré ses quelques défauts d’écriture et ses commentaires à l’américaine parfois déplacés à mon goût , et relisant sa bio de Czapski, après l’extraordinaire aperçu de l’œuvre pictural de JC dans sa fabuleuse approche illustrée et commentée des tableaux parfois examinés comme sous une loupe, avec le sous-titre d’An apprenticeship of looking, je me dis que c’est un peu vain de ma part de prétendre y ajouter quoi que ce soit avec mon « regard personnel », puis je me rappelle que tous les livres consacrés, ces dernières décennies, à la personne et à la peinture de Czapski, à l’exception peut-être de la monographie de Muriel Werner-Gagnebin, procèdent en somme du même accaparement et de la même implication personnelle, ainsi Wojtech Karpinski et Richard Aeschlimann parlent-ils d’eux-mêmes comme Jil Silberstein et Karpeles parlent d’eux-mêmes en évoquant cette rencontre que j’ai évoquée à mon tour dans Czapski le juste qui constituera, sous l’œil avisé de mon ami peintre Bona, la deuxième publication des éditions de La Désirade, cette année encore…C’est par Proust (l’essai de Czapski intitulé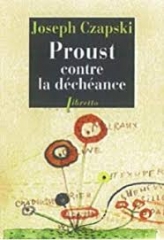 Proust contre la déchéance, que lui a envoyé un ami) que Karpeles, peintre lui-même, a découvert l’écrivain Czapski, alors qu’il préparait, en écrivain, un essai sur la présence de la peinture dans la Recherche, c’est en lisant ces conférences « de mémoire » prononcées par le prisonnier dans un camp du goulag et en y découvrant ce stupéfiant travail de la « mémoire involontaire », que Karpeles, plus de vingt ans après le mort de Czapski, a entrepris son énorme travail de recherche assorti de voyages et de rencontres à Paris et en Pologne, et je me dis maintenant que, de même qu’il a eu l’impression d’être « guidé » par les mânes de Józio, avec des coïncidences quasi magiques, tout ce qui rayonne du noyau commun associant Proust et Czapski – noyau spirituel et existentiel, artistique et conceptuel, éthique et sensuel, etc. – toutes les apparitions (celle du premier tableau de JC découvert par Karpeles chez Karpinski, évoquant «en abyme » un jeune homme contemplant une toile de Nicolas de Staël dans une exposition -, puis les rencontres, les liaisons amicales (Daniel Halévy) ou amoureuses (Czapski et le frère de Nabokov, Sergueï, mort lui-même en déportation), toute cette nébuleuse ressortissant à l’art et à la vie constitue la même « histoire », et la mienne ne vaudra peut-être pas la tienne, mais n’est-ce pas la même chaîne des vivants communiant entre eux par delà toute vanité ?
Proust contre la déchéance, que lui a envoyé un ami) que Karpeles, peintre lui-même, a découvert l’écrivain Czapski, alors qu’il préparait, en écrivain, un essai sur la présence de la peinture dans la Recherche, c’est en lisant ces conférences « de mémoire » prononcées par le prisonnier dans un camp du goulag et en y découvrant ce stupéfiant travail de la « mémoire involontaire », que Karpeles, plus de vingt ans après le mort de Czapski, a entrepris son énorme travail de recherche assorti de voyages et de rencontres à Paris et en Pologne, et je me dis maintenant que, de même qu’il a eu l’impression d’être « guidé » par les mânes de Józio, avec des coïncidences quasi magiques, tout ce qui rayonne du noyau commun associant Proust et Czapski – noyau spirituel et existentiel, artistique et conceptuel, éthique et sensuel, etc. – toutes les apparitions (celle du premier tableau de JC découvert par Karpeles chez Karpinski, évoquant «en abyme » un jeune homme contemplant une toile de Nicolas de Staël dans une exposition -, puis les rencontres, les liaisons amicales (Daniel Halévy) ou amoureuses (Czapski et le frère de Nabokov, Sergueï, mort lui-même en déportation), toute cette nébuleuse ressortissant à l’art et à la vie constitue la même « histoire », et la mienne ne vaudra peut-être pas la tienne, mais n’est-ce pas la même chaîne des vivants communiant entre eux par delà toute vanité ? BROCHET DU SOIR, BONSOIR. – J’étais ce matin à bout de souffle, le cœur flippant dans sa cage d’osses et ruminant un testament relatif à la masse d’objets plus ou moins achevés que je laisserai à mes survivants de bonne volonté, mais ce soir le brochet de Clémentine la Camerounaise, sa sauce d’or et son goût parfait, s’ajoutant aux retrouvailles d’avec mes amis Jackie et Tonio, vieux enfants rieurs aux éclats dont j’aime le truculent et très libre naturel (ils ont fait récemment ami-ami avec Bona auquel j’ai envoyé quelques MMS en cours d’agapes), tout cela m’a si bien requinqué que, tel Lazare sortant de son bar, je me suis retrouvé sous les étoiles tout fringant, comme en ma jeunesse bohème de traîne-patin quotidien du Barbare…
BROCHET DU SOIR, BONSOIR. – J’étais ce matin à bout de souffle, le cœur flippant dans sa cage d’osses et ruminant un testament relatif à la masse d’objets plus ou moins achevés que je laisserai à mes survivants de bonne volonté, mais ce soir le brochet de Clémentine la Camerounaise, sa sauce d’or et son goût parfait, s’ajoutant aux retrouvailles d’avec mes amis Jackie et Tonio, vieux enfants rieurs aux éclats dont j’aime le truculent et très libre naturel (ils ont fait récemment ami-ami avec Bona auquel j’ai envoyé quelques MMS en cours d’agapes), tout cela m’a si bien requinqué que, tel Lazare sortant de son bar, je me suis retrouvé sous les étoiles tout fringant, comme en ma jeunesse bohème de traîne-patin quotidien du Barbare… -
L'échappée libre de la poésie
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce mercredi 3 avril. - Le mot «âme » m’est revenu l’autre jour, à côté de l’ancienne tour des condamnés à mort dominant de son drapeau royal l’hôtel de charme dans lequel je créchais, le mot «âme» et la chose qu’il est censé designer, à la fois très vague et nous disant pourtant quelque chose, m’est revenu en cette veille de Pâques où je lisais, dans ma carrée de l’ex-quartier des officiers de l’ancienne garnison des Hillsborough Barracks, à Sheffield, les pages de Pierre Reverdy intitulées Cette émotion appelée poésie, où le poète commence par dire qu’aucun chirurgien jamais n’a découvert l’ombre d’une âme au bout de son scalpel; et mon cher Reverdy parlait ensuite de cette insaisissable entité avec les mots les plus précis qui seuls conviennent à la poésie à l’opposé de la jactance nébuleuse qui en constitue le plus souvent le commentaire.Le premier souci de Reverdy, dans cet entretien sur la poésie ancré dans l’expérience humaine la plus largement partagée, est de préciser aussi les mots de personne et de beauté, puis de nature, au motif que chaque personne est élément de multitude vague dont le visage et la voix fixent entre tous la personnalité tout à fait unique et irremplaçable (je pensai aussitôt au visage de Marie Lumière, à la voix de Bona et aux yeux de leur fils Parfait), de la nature au sens général émane une beauté particulière dont se distingue pourtant celle qui ressortit à la poésie ou à l’art en général - et Reverdy de préciser alors que la poésie n’est pas à prendre au sens restreint des faiseurs de vers mais désigne l’activité de « tout artiste dont l’ambition et le but sont de créer, par une œuvre esthétique faite de ses propres moyens, une émotion particulière que les choses de la nature, à leur place, e sont pas en mesure de provoquer en l’homme », et c’était faire un sort aux clichés du beau coucher de soleil ou de la beauté naturelle des chats ou des enfants jugée « poétique » par les sectateurs mondiaux d’Instagram & Co unlimited…De fait, le terme même de poésie - en allemand on parle de Dichtung, impliquant une notion plus large de création - est devenu le grand fourre-tout actuel du bavardage plus ou moins lettré et plus prétentieux que jamais - surtout en France - invoquant la poésie comme un supplément d’âme et produisaient cette nouvelle classe de pédants que sans crainte du ridicule on appelle des poéticiens…POÈTE, ET QUOI ENCORE ? - Mon ami Bona me disait l'autre jour, à propos d'un texte que j'ai commis sur la haute Toscane et ses beautés, que je pouvais en être fier, à quoi j'ai répondu what's the Hell Bona, mais un arbre a-t-il à se montrer fier de ses rameaux, alors qu'il se contente de ramer ? Et ça me ramène à ce que j'ai noté en forêt un jour de 1986, rapport à ces anges émissaires que sont en somme nos poèmes :Les poèmes nous viennentcomme des visiteurs,aussitôt reconnus ;et notre porte ne saurait se fermerà ces messagers de nos propres lointains...Et qui pourrait s'en vanter ? Donc se dire poète, en orner sa carte de visite, se réclamer de cet état qui est exactement l'opposé d'un statut social, me semble aussi vain et dénué de sens que me dire vivant alors que je ne fais que vivre et vibrer - mais cela encore ne me concernant que seul, tout à fait content au demeurant de voir mes poèmes, que j'aime comme mes enfants, paraître et se répandre aux quatre vents, peut-être parler à qui veut les entendre ?
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce mercredi 3 avril. - Le mot «âme » m’est revenu l’autre jour, à côté de l’ancienne tour des condamnés à mort dominant de son drapeau royal l’hôtel de charme dans lequel je créchais, le mot «âme» et la chose qu’il est censé designer, à la fois très vague et nous disant pourtant quelque chose, m’est revenu en cette veille de Pâques où je lisais, dans ma carrée de l’ex-quartier des officiers de l’ancienne garnison des Hillsborough Barracks, à Sheffield, les pages de Pierre Reverdy intitulées Cette émotion appelée poésie, où le poète commence par dire qu’aucun chirurgien jamais n’a découvert l’ombre d’une âme au bout de son scalpel; et mon cher Reverdy parlait ensuite de cette insaisissable entité avec les mots les plus précis qui seuls conviennent à la poésie à l’opposé de la jactance nébuleuse qui en constitue le plus souvent le commentaire.Le premier souci de Reverdy, dans cet entretien sur la poésie ancré dans l’expérience humaine la plus largement partagée, est de préciser aussi les mots de personne et de beauté, puis de nature, au motif que chaque personne est élément de multitude vague dont le visage et la voix fixent entre tous la personnalité tout à fait unique et irremplaçable (je pensai aussitôt au visage de Marie Lumière, à la voix de Bona et aux yeux de leur fils Parfait), de la nature au sens général émane une beauté particulière dont se distingue pourtant celle qui ressortit à la poésie ou à l’art en général - et Reverdy de préciser alors que la poésie n’est pas à prendre au sens restreint des faiseurs de vers mais désigne l’activité de « tout artiste dont l’ambition et le but sont de créer, par une œuvre esthétique faite de ses propres moyens, une émotion particulière que les choses de la nature, à leur place, e sont pas en mesure de provoquer en l’homme », et c’était faire un sort aux clichés du beau coucher de soleil ou de la beauté naturelle des chats ou des enfants jugée « poétique » par les sectateurs mondiaux d’Instagram & Co unlimited…De fait, le terme même de poésie - en allemand on parle de Dichtung, impliquant une notion plus large de création - est devenu le grand fourre-tout actuel du bavardage plus ou moins lettré et plus prétentieux que jamais - surtout en France - invoquant la poésie comme un supplément d’âme et produisaient cette nouvelle classe de pédants que sans crainte du ridicule on appelle des poéticiens…POÈTE, ET QUOI ENCORE ? - Mon ami Bona me disait l'autre jour, à propos d'un texte que j'ai commis sur la haute Toscane et ses beautés, que je pouvais en être fier, à quoi j'ai répondu what's the Hell Bona, mais un arbre a-t-il à se montrer fier de ses rameaux, alors qu'il se contente de ramer ? Et ça me ramène à ce que j'ai noté en forêt un jour de 1986, rapport à ces anges émissaires que sont en somme nos poèmes :Les poèmes nous viennentcomme des visiteurs,aussitôt reconnus ;et notre porte ne saurait se fermerà ces messagers de nos propres lointains...Et qui pourrait s'en vanter ? Donc se dire poète, en orner sa carte de visite, se réclamer de cet état qui est exactement l'opposé d'un statut social, me semble aussi vain et dénué de sens que me dire vivant alors que je ne fais que vivre et vibrer - mais cela encore ne me concernant que seul, tout à fait content au demeurant de voir mes poèmes, que j'aime comme mes enfants, paraître et se répandre aux quatre vents, peut-être parler à qui veut les entendre ? -
Suites californiennes

En octobre 1987, le sieur JLK se trouvait en Californie, accompagnant l’Orchestre de la Suisse romande en tournée mondiale. Avec le chef Armin Jordan, deux solistes incomparables: Martha Argerich et Gidon Kremer. Suite des chroniques égrenées tous les jours pour La Tribune - Le Matin, au Japon puis en Californie…

1. Bouchées doubles
Cela fait beaucoup. Il en est même qui disent qu’il y a trop. Qu’on se représente un peu: après treize jours de marathon, ponctués de concerts et de milliers de kilomètres de déplacements quotidiens, il leur a fallu quitter ce Japon auquel beaucoup commençaient à s’attacher.
Sur quoi ce fut le premier déportement jusqu’à Narita, qu’une garde armée jusqu’aux dents continue de surveiller comme un camp retranché. Puis l’attente dans le no man’s land partout pareil, aux sandwiches évoquant le goût du néant. Et cette vision réitérée d’un violoncelliste allemand n’en finissant pas de poursuivre tout seul sa partie d’échecs, debout et lointain au milieu des foules variables. Et cette autre photo sur le vif : d’Armin Jordan commandant un cognac de plus et s’entretenant avec ses musiciens.
Puis le gros avion. La sale fumée. Le film idiot. L’impossible sommeil. Divers spectacles nuageux, et soudain de folles fleurs urbaines jetées sur les pentes inclinées : sans doute un bout de San Francisco, avant l'ultime dérive côtière vers le sud.
Et de la neige, une bataille de coussins relevant de l’épopée aérienne et décontenançant définitivement nos chères hôtesses nippones.
 Puis la joyeuse désorganisation californienne. Les quolibets du tromboniste de France méridionale à la caporale douanière de service, et toutes sortes de bulles ensuite, mais réjouissantes à vrai dire: le soussigné se pointant dans une chambre déjà occupée par le diable sait qui ; le premier violon concertiste surgissant en bermudas de l’ascenseur, à seule fin de se jeter dans la banale piscine. Et plus tard : le bain réparateur d’une tripotée de musiciens dans les rouleaux furieux de Santa Monica, et cet invraisemblable crépuscule rose abricot et vert céladon, comme au cinéma.
Puis la joyeuse désorganisation californienne. Les quolibets du tromboniste de France méridionale à la caporale douanière de service, et toutes sortes de bulles ensuite, mais réjouissantes à vrai dire: le soussigné se pointant dans une chambre déjà occupée par le diable sait qui ; le premier violon concertiste surgissant en bermudas de l’ascenseur, à seule fin de se jeter dans la banale piscine. Et plus tard : le bain réparateur d’une tripotée de musiciens dans les rouleaux furieux de Santa Monica, et cet invraisemblable crépuscule rose abricot et vert céladon, comme au cinéma. Ou bien encore l’Europe revenant par bouffées au Musée Paul-Getty de Malibu. Toute une peinture en vérité, mais comment en dire la nuance ? A vrai dire la question ne se pose pas, car ce soir-là les musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande avaient d’autres chats à fouetter : à peine arrivés à Los Angeles, c’est à Costa Mesa, hier soir, qu’ils donnaient leur premier rendez-vous aux mélomanes de Californie.
Ah ! mais comment font-ils ? N’y a-t-il pas trop à la fois ?
 2. Musique vivante
2. Musique vivanteIl y a diverses façons d’entrer dans une œuvre musicale, qu’on se fie à sa seule émotion ou qu’on s’affaire à en décortiquer savamment la structure, qu’on en détaille les parties ou qu’on l’embrasse comme un tout.
Or, à vivre avec un orchestre en tournée, à fréquenter les musiciens avant et après le concert, à faire chaque jour de nouvelles connaissances et à partager ces moments de pure magie qui, de loin en loin, nous font oublier tout ce qui pèse ou qui grince, à vivre tout cela très pleinement depuis une quinzaine de jours, je ne saurais beaucoup mieux dire, avec mes pauvres mots, toute la gamme des sentiments nouveaux suscités par l'affinement de ma perception des œuvres, mais du moins puis-je mieux me figurer les multiples composantes qui font qu’un concert prend ou non, ressemble à un autre ou relève de l’incomparable.
 Jeudi soir à Pasadena, après une balade quasiment estivale dans les collines des hauts de Hollywood aux folles masures, j’ai faussé compagnie à mes compagnons de route le temps de découvrir, ébahi aux anges, la prodigieuse collection du Norton Museum, avant de me pointer au concert.
Jeudi soir à Pasadena, après une balade quasiment estivale dans les collines des hauts de Hollywood aux folles masures, j’ai faussé compagnie à mes compagnons de route le temps de découvrir, ébahi aux anges, la prodigieuse collection du Norton Museum, avant de me pointer au concert. Au programme figuraient la Deuxième symphonie de Brahms, dans laquelle je commence à peine à me diriger, la Rhapsodie espagnole et la Valse de Ravel.
Quoique lessivé par le manque de sommeil et pour ainsi dire abruti par l’intempestive transplantation, du Japon aux States, je jubilais encore d’avoir retrouvé, dans cet univers sans passé et splendidement chaotique, la « musique » de Botticelli et de Rembrandt, des Utrillo les mieux choisis (tout l’opposé de la surabondance clinquante de chez Paul Getty) ou des séries de Rouault et de Klee entre cent autres exposées comme à peu près nulle part.
Donc j’étais bien. Ça fonctionnait assez super, selon l’expression consacrée des branchés à cheveux rouges et dents bleues de Los Angeles. La salle sonnait plutôt convenable. Le public faisait un peu croquant avec ses applaudissements entre les mouvements. Jordan gratifia même tout un déferlement de retardataires d’un regard inhabituellement noir - à croire que les moquettes et les closettes sont plus respectées en ces lieux que les mânes de Brahms...
Mais finalement quelque chose s’est passé, là aussi, malgré la piètre concentration de l’assistance et la fatigue des musiciens: quelque chose qui tient à la fois à la maîtrise de plus en plus libérée des deux œuvres de Ravel par le Maestro et son orchestre, et à l’originalité propre de cette manière de sculpture sonore aux mille chatoiements et résonances, dans quoi l’on se plonge et replonge comme en un bain de jouvence.
 3. L'envers du vitrail
3. L'envers du vitrailIls viennent des quatre vents et n’ont pour dénominateur commun que de faire métier de musicien d’orchestre. Races et nations panachées, ils se distinguent les uns des autres par l’âge et le caractère, ou leurs idées et leurs goûts.
La tendance au perfectionnisme désincarné pourrait le faire oublier, mais un orchestre n’est pas une cohorte d’anges dont les relations baigneraientdans l’huile d’onction. Ses membres se connaissaient bien plus mal qu’on ne se le figure. D’où l'intérêt notable d’une tournée, qui les réunit un peuplus étroitement que d’ordinaire, les stimule et les fait, parfois, se surpasser.
Fellini comparait l’orchestre à une réplique de société ; et c’est l’évidence même, avec l’antagonisme de toujours et de partout qui oppose les cordes et les souffleurs. Mais passons sur une psychologie de l’instrumentiste par trop sommaire, tout en relevant, à l’OSR par exemple, que les extravertis et les bonnes natures sont effectivement de cuivre, et les plus délicats, voire les moins voyants, de bois.
 Au demeurant, certains franchissent la redoutable ligne de démarcation. On sait un violoncelliste, à particule et profil de chef indien, fort assidu aux conciles arrosés de l’ennemi, et sans doute est-il d’autres cas de transgression inverse. D’ailleurs il n’y a pas que les clans,mais les tronches aussi, même si les plus fameuses ont rejoint aujourd’hui la légende. Disons alors : des personnages.
Au demeurant, certains franchissent la redoutable ligne de démarcation. On sait un violoncelliste, à particule et profil de chef indien, fort assidu aux conciles arrosés de l’ennemi, et sans doute est-il d’autres cas de transgression inverse. D’ailleurs il n’y a pas que les clans,mais les tronches aussi, même si les plus fameuses ont rejoint aujourd’hui la légende. Disons alors : des personnages.Le violon dandy à bouc freudien qui s’adonne à la parapsychologie et que deux courtisanes, durant une tournée, plumèrent comme un pigeon. Ou son jeune compère aux yeux doux et à la très ample bedaine, dont la science culinaire n’a d’égale que celle du vétéran, violon lui aussi, dont on raconte la folle érudition en matière d’électrons et de nébuleuses. Ou bien le trombone facétieux. La fougueuse violoncelliste roumaine ou le cor aux allures de barde à longs cheveux bohèmes.
Ceux qui se détestent et ceux qui s’aiment.
Enfin autant de fragments plus ou moins bien assortis du vitrail dont la musique ne nous montre jamais que la face claire...
 4. Minutes heureuses
4. Minutes heureusesY a-t-il rien de plus « exciting » que la vision de vingt surfeurs aux silhouettes de fulgurantes otaries se détachant sur le fond mandarine du Pacifique au crépuscule ? Du moins le monde semble-t-il, alors, appartenir à cette jeunesse féline et très lisse filant à la crête des vagues comme on dirait que tout glisse en Californie, avec la même aisance de surface.
C’était samedi dernier du côté de Santa Barbara, au soir d’une journée placée sous le signe de la qualité, après l’assez affreux vendredi 13 de la veille, dont le concert avait trahi la lassitude des musiciens interminablement trimbalés dans les encombrements de l’inhumaine galaxie de Los Angeles, et confrontés à la méchante acoustique d’une salle peu garnie, au public rustaud de surcroît.
Ainsi, succédant à l’horreur, ou presque : l’embellie en crescendo, avec le parcours d’une Riviera à l’italienne et la découverte, au cœur de la ville évoquant les colonies ibériques, du plus extravagant théâtre qui se puisse imaginer.
 Qu’on se représente une place telle qu’il y en a à Séville ou à Grenade, avec ses façades multicolores, ses arcades et ses mezzanines. Tel étant, vu de l’intérieur, le décor en trois dimensions flanquant les travées de fauteuils de l’Arlington Theater, duquel on découvre en levant les yeux un ciel peint bleu nuit, aux étoiles incrustées plus vraies que nature.
Qu’on se représente une place telle qu’il y en a à Séville ou à Grenade, avec ses façades multicolores, ses arcades et ses mezzanines. Tel étant, vu de l’intérieur, le décor en trois dimensions flanquant les travées de fauteuils de l’Arlington Theater, duquel on découvre en levant les yeux un ciel peint bleu nuit, aux étoiles incrustées plus vraies que nature. Et que celui qui en doute renonce à me croire si j’ajoute qu’un oiseau surgit d’une fenêtre en plein concert, pour virevolter au-dessus du public, tournoyer autour du Maestro sans le distraire (!) avant de disparaître je ne sais où...
Ce que je ne puis guère ignorer, en revanche, c’est que le concert de ce soir-là, malgré l’acoustique assurément déficiente, fut éclatant autant qu’apprécié par un public saluant l’interprétation de la 5e symphonie de Chostakovitch par le Standing Applause, signifiant, spectateurs debout, l’ovation de nos usages.
Où l’on voit qu’à la pluie succède le beau temps, les jours avec aux jours sans…
 5. En manque d’Europe
5. En manque d’Europe Dans les couloirs feutrés de cet immense hôtel de San Francisco, on entend, de loin en loin, la voix d’un hautbois ou celle d’une clarinette, ou encore un violoncelle reprenant inlassablement le même bout de phrase - de Bach je crois bien.
Bribes de mélodie, comme autant de fragments d’une mosaïque à peine entrevue. Car il est dit aussi que la plupart des musiciens n’auront à peu près rien vu des pays traversés de ce tour du monde.
Avant-hier ils étaient sur le campus de l’UCLA, à Los Angeles, où l’OSR jouait dans une espèce de basilique italienne qu’il y a là.
 Très beau concert au demeurant, avec une Cinquième symphonie de Chostakovitch dont certaines parties massives, ressortissant au réalisme socialiste le plus évident, me rebutent encore à vrai dire, lors même que ses beautés extrêmes, de violence déployée et de lyrisme si délicat, se dessinent de mieux en mieux dans la version détaillée et intense, engagée, qu’Armin Jordan nous en propose avec ses musiciens.
Très beau concert au demeurant, avec une Cinquième symphonie de Chostakovitch dont certaines parties massives, ressortissant au réalisme socialiste le plus évident, me rebutent encore à vrai dire, lors même que ses beautés extrêmes, de violence déployée et de lyrisme si délicat, se dessinent de mieux en mieux dans la version détaillée et intense, engagée, qu’Armin Jordan nous en propose avec ses musiciens.Quant au Concerto pour piano de Ravel, j’avoue que j’ai passé cette fois à côté, prêtant mon attention à la partie orchestrale plutôt qu’à la soliste. Or, sans minimiser l’évidente virtuosité de Cécile Licad, je n’ai rien retrouvé avec elle, pour ma part, de l’émotion pure, légère et un peu sorcière que suscite Argerich, autant dans le tonitruant que dans le subtil et le lent.
Sur quoi ce fut un ravissement, une fois de plus, de suivre les évolutions de L’oiseau de feu, qui m’évoquent les antinomies fondamentales de notre civilisation d’Europe ancienne, où la sarabande dionysiaque alterne avec les mélodies apolliniennes.
 Ce lundi était donc jour de congé. Tandis que les plus scrupuleux répétaient dans leur carrée, les autres auront essaimé vers la baie, les collines à funiculaires, les maisons victoriennes ou les quartiers à marchés bigarrés.
Ce lundi était donc jour de congé. Tandis que les plus scrupuleux répétaient dans leur carrée, les autres auront essaimé vers la baie, les collines à funiculaires, les maisons victoriennes ou les quartiers à marchés bigarrés.De ma fenêtre du 57e étage, on ne voit certes pas ce que Ramuz apercevait de la sienne à La Muette. It’s a long way from Frisco to Lavaux…
 Cependant cette ville se laisse parcourir à pied, baroque jusqu’au délire et conçue à vues humaines. Ainsi l’Europe, qui nous manque parfois tellement, affleure-t-elle ici un peu partout…
Cependant cette ville se laisse parcourir à pied, baroque jusqu’au délire et conçue à vues humaines. Ainsi l’Europe, qui nous manque parfois tellement, affleure-t-elle ici un peu partout… -
La Maison dans l'arbre
 La publication de La Maison dans l'arbre, de JLK, marque laparution du premier ouvrage des Éditions de La Désirade (10 Mars. 2024)1820 Montreux, Suisse. (Switzerland). 278 pages.ISBN-13 : 979-8224874934. Directeur de publication: Bona ManganguLa poésie est un cristal ardent de neige noire arraché au sommeil comme un diamant prompt, elle exclut toute sentimentalité vague, elle est précise, elle est précieuse et sans manières, elle est minutieuse et surexacte par sa métrique et sa rythmique ; elle est chaotique en apparence en ses harmonies inouïes et cependant elle se plie et se déploie comme une rose follement ordonnée en ses tours et pourtours parfumés - elle dit tout ce qui ne se dit que les yeux fermés.Jean-Louis Kuffer, écrivain et critique littéraire, né en 1947 à Lausanne, vit à la Désirade sur les hauts de Montreux, en Suisse, entre renards, écureuils et mésanges. 25 livres parus en France et en Suisse. Prix Schiller, Prix Edouard-Rod, Prix Bibliomedia, Prix Budry, Prix de l'État de Vaud. Anime un blog littéraire depuis 2005.A commander auprès de votre libraire habituel en indiquant le numéro ISBN : ISBN-13 : 979-8224874934ou en ligne: Barnes & Noble (usa), Fnac.com (France) Amazon.uk (United Kingdom), D&R (Turquie), Amazon.com.be (Belgique et Pays-Bas) Buecher, de ( Allemagne) Feltrinelli (Italie), Amazon.com (USA) Amazon.ca (Canada) etc. D'autres plateformes de distribution sont à venir.©Éditions de La Désirade. Montreux. Suisse. 2024
La publication de La Maison dans l'arbre, de JLK, marque laparution du premier ouvrage des Éditions de La Désirade (10 Mars. 2024)1820 Montreux, Suisse. (Switzerland). 278 pages.ISBN-13 : 979-8224874934. Directeur de publication: Bona ManganguLa poésie est un cristal ardent de neige noire arraché au sommeil comme un diamant prompt, elle exclut toute sentimentalité vague, elle est précise, elle est précieuse et sans manières, elle est minutieuse et surexacte par sa métrique et sa rythmique ; elle est chaotique en apparence en ses harmonies inouïes et cependant elle se plie et se déploie comme une rose follement ordonnée en ses tours et pourtours parfumés - elle dit tout ce qui ne se dit que les yeux fermés.Jean-Louis Kuffer, écrivain et critique littéraire, né en 1947 à Lausanne, vit à la Désirade sur les hauts de Montreux, en Suisse, entre renards, écureuils et mésanges. 25 livres parus en France et en Suisse. Prix Schiller, Prix Edouard-Rod, Prix Bibliomedia, Prix Budry, Prix de l'État de Vaud. Anime un blog littéraire depuis 2005.A commander auprès de votre libraire habituel en indiquant le numéro ISBN : ISBN-13 : 979-8224874934ou en ligne: Barnes & Noble (usa), Fnac.com (France) Amazon.uk (United Kingdom), D&R (Turquie), Amazon.com.be (Belgique et Pays-Bas) Buecher, de ( Allemagne) Feltrinelli (Italie), Amazon.com (USA) Amazon.ca (Canada) etc. D'autres plateformes de distribution sont à venir.©Éditions de La Désirade. Montreux. Suisse. 2024 -
Chinois et Ricains

 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)Sheffield, Hôtel Garrison, ce mardi 26 mars, soir. - Et là, et là, et là aussi ce sont les Chinois, Papillon, me dit Bona en me désignant, au centre de Sheffield où des quartiers entiers se trouvaient en voie de délabrement ou d’abandon, de nouveaux bâtiments imposants et d’une sorte de laideur architecturale programmée - là encore, le bloc trapu aux murs aveugles, et là, cet ensemble marron qu’on dirait un hangar et qui accueille des milliers de locataires, tout ça c’est les Chinois, me serine mon cher moricaud, comme il se surnomme lui-même, et je lui dis un peu fataliste: comme en Afrique, et lui en me souriant de toutes ses dents : comme en Afrique, et de m’expliquer que malgré les voix qui s’élèvent et le débat de défense, l’argent des Chinois a force de conviction comme chez nous le dinar et le dollar du Qatar, puis nous montons dans un long tram bleu qui nous conduit un peu à l’écart du centre ville dans un quartier plus arboré où nous longeons ensuite, à pied, autre relief de la récession, un lugubre bord de rue aux magasins abandonnés et aux rideaux de fer baissés dont les Chinois sauront que faire ; après quoi ce sont les anciens murs de la garnison abritant en partie le centre commercial Morrisons et divers Charity Shop, derrière lesquels se dresse l’ancien bastion militaire réhabilité en hôtel de charme - The Garrison , plus anglais et cosy tu meurs, au dam des Chinois, et c’est là que je vais crécher trois jours à cause des Américains…De fait, qui eût pensé que Bona, fils de roi congolais, rencontré sur nos blogs il y a près de vingt ans de ça, puis en 3D à Sheffield une première fois, à rire et sourire aussi avec sa Marie-Lumière, en complicité continue par le truchement de nos écrits et enfin relancé par Facebook découvert par l’entremise de François Bon notre commun compère virtuel – qui aurait pensé que ce peintre-écrivain hyperlettré, ancien élève de Deleuze et te récitant en latin des pages entières de Cicéron ou de Lucrèce, se prenne au jeu des Amerloques lui proposant, gratos, de composer ses livres de A à Z et de les diffuser dans le monde entier, et publiant donc Maurice porteur de foi, bio baroque de « notre » saint Maurice d’Agaune d’origine nubienne, et ensuite Le coin des enfants modulant la confession tendrement enragée d’une Angela de cité zonarde ?Or voilà que, mes affaires déposées dans la chambre-cocon de l’hôtel de charme, suivant l’olibrius jusqu’au bungalow à trois rues de là qu’il partage avec sa Dulcinée - bonsoir Marie Lumière, et nous éclatons de rire ! - et leur fils Parfait, je découvre enfin l’Objet, mon vingt-sixième livre entièrement composé par Bona à l’enseigne des Éditions de La Désirade, tout ça de pris aux Chinois sans vendre pour autant nos âmes au capitalisme sauvage, petite merveille orange enluminée par le découpage de Lady L. dont la grâce rayonne en nous…
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)Sheffield, Hôtel Garrison, ce mardi 26 mars, soir. - Et là, et là, et là aussi ce sont les Chinois, Papillon, me dit Bona en me désignant, au centre de Sheffield où des quartiers entiers se trouvaient en voie de délabrement ou d’abandon, de nouveaux bâtiments imposants et d’une sorte de laideur architecturale programmée - là encore, le bloc trapu aux murs aveugles, et là, cet ensemble marron qu’on dirait un hangar et qui accueille des milliers de locataires, tout ça c’est les Chinois, me serine mon cher moricaud, comme il se surnomme lui-même, et je lui dis un peu fataliste: comme en Afrique, et lui en me souriant de toutes ses dents : comme en Afrique, et de m’expliquer que malgré les voix qui s’élèvent et le débat de défense, l’argent des Chinois a force de conviction comme chez nous le dinar et le dollar du Qatar, puis nous montons dans un long tram bleu qui nous conduit un peu à l’écart du centre ville dans un quartier plus arboré où nous longeons ensuite, à pied, autre relief de la récession, un lugubre bord de rue aux magasins abandonnés et aux rideaux de fer baissés dont les Chinois sauront que faire ; après quoi ce sont les anciens murs de la garnison abritant en partie le centre commercial Morrisons et divers Charity Shop, derrière lesquels se dresse l’ancien bastion militaire réhabilité en hôtel de charme - The Garrison , plus anglais et cosy tu meurs, au dam des Chinois, et c’est là que je vais crécher trois jours à cause des Américains…De fait, qui eût pensé que Bona, fils de roi congolais, rencontré sur nos blogs il y a près de vingt ans de ça, puis en 3D à Sheffield une première fois, à rire et sourire aussi avec sa Marie-Lumière, en complicité continue par le truchement de nos écrits et enfin relancé par Facebook découvert par l’entremise de François Bon notre commun compère virtuel – qui aurait pensé que ce peintre-écrivain hyperlettré, ancien élève de Deleuze et te récitant en latin des pages entières de Cicéron ou de Lucrèce, se prenne au jeu des Amerloques lui proposant, gratos, de composer ses livres de A à Z et de les diffuser dans le monde entier, et publiant donc Maurice porteur de foi, bio baroque de « notre » saint Maurice d’Agaune d’origine nubienne, et ensuite Le coin des enfants modulant la confession tendrement enragée d’une Angela de cité zonarde ?Or voilà que, mes affaires déposées dans la chambre-cocon de l’hôtel de charme, suivant l’olibrius jusqu’au bungalow à trois rues de là qu’il partage avec sa Dulcinée - bonsoir Marie Lumière, et nous éclatons de rire ! - et leur fils Parfait, je découvre enfin l’Objet, mon vingt-sixième livre entièrement composé par Bona à l’enseigne des Éditions de La Désirade, tout ça de pris aux Chinois sans vendre pour autant nos âmes au capitalisme sauvage, petite merveille orange enluminée par le découpage de Lady L. dont la grâce rayonne en nous…
-
J'étais là, telle chose m'advint
 (Le Temps accordé, Lectures du monde 2024)À La Désirade, ce samedi 23 mars. – La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns.APAGONES. – En un momento dado, el protagonista de Una singularidad, con el nombre muy significativo de Abel Fleck (Fleck significa mancha, como todo el mundo sabe), se despierta de un sueño “olvidado” de tres días durante los cuales está “ausente” como en su infancia sonámbula, y este "agujero negro", que comienza a conceptualizar y relacionar con los famosos embudos de la singularidad gravitacional, se confunde más trivialmente con un agujero de la memoria, que me recuerda tantos años como si hubiera sido borrado de mi memoria o los de los demás - así me dijo mi hermana mayor por teléfono que mi retrato de un joven bonito de dieciocho años le hizo darse cuenta de que esos años me había perdido completamente de vista y no sabía en absoluto cómo habría vivido en mi juventud salvaje, uno y otro, saliendo del redil familiar, viviendo cada uno su propia vida antes de reencontrarse años después, y mucho más unidos, incluso en complicidad, en lo que a nosotros respecta, desde la muerte de Ramón y su desgraciada accidente…CRÉPUSCULE. - J’étais hier soir sur le ponton de L’Oasis, seul client resté là au milieu des chaises retournées, attendant mon poulet/frites tandis que le soleil n’en finissait pas de rougeoyer à l’Est de mon Eden et que sur le pan noir de la montagne filait la frise de loupiotes des voitures de la fugue autoroutière des fins de semaine, et je continuais de blaguer sur Messenger avec mon cher Bona, entre deux messages de Quentin tout étonné d’apprendre que j’avais rencontré Jean Genet rue de Rome, en 1973, par hasard sur un banc - j’étais là, le serveur serbe Ilia m’a apporté mon frichti en regrettant avec moi l’absence de notre ami le chien, j’étais là et j’ai pensé avec tendresse à ma douce amie me reprochant ce matin (SMS occulte) d’avoir les cheveux trop longs, raison de mon escale ultérieure chez la coiffeuse Viviane où nous avons fait notre tour d’horizon habituel (la connerie des parents chauvins de jeunes footballeurs qui s’agressent sur les bords de terrains, entre autres), puis remontant à La Désirade je me suis dit qu’avec les oiseaux (la mésange en photo géante dans le salon de dame Viviane) et nos petits-enfants la vie nous restait plus légère et bonne à prendre tandis que Blaise Cendrars racontait, sur l’autoradio de la Jazz, comment, revenant d’Amérique sur le paquebot Volturno, il s’est saoulé de la poésie du monde en frayant avec les centaines de pauvres immigrés renvoyés en Europe par la police new yorkaise, et comment il recueillit les confidences d’un condamné à mort enfermé dans une cage sur le pont arrière, etc.
(Le Temps accordé, Lectures du monde 2024)À La Désirade, ce samedi 23 mars. – La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns.APAGONES. – En un momento dado, el protagonista de Una singularidad, con el nombre muy significativo de Abel Fleck (Fleck significa mancha, como todo el mundo sabe), se despierta de un sueño “olvidado” de tres días durante los cuales está “ausente” como en su infancia sonámbula, y este "agujero negro", que comienza a conceptualizar y relacionar con los famosos embudos de la singularidad gravitacional, se confunde más trivialmente con un agujero de la memoria, que me recuerda tantos años como si hubiera sido borrado de mi memoria o los de los demás - así me dijo mi hermana mayor por teléfono que mi retrato de un joven bonito de dieciocho años le hizo darse cuenta de que esos años me había perdido completamente de vista y no sabía en absoluto cómo habría vivido en mi juventud salvaje, uno y otro, saliendo del redil familiar, viviendo cada uno su propia vida antes de reencontrarse años después, y mucho más unidos, incluso en complicidad, en lo que a nosotros respecta, desde la muerte de Ramón y su desgraciada accidente…CRÉPUSCULE. - J’étais hier soir sur le ponton de L’Oasis, seul client resté là au milieu des chaises retournées, attendant mon poulet/frites tandis que le soleil n’en finissait pas de rougeoyer à l’Est de mon Eden et que sur le pan noir de la montagne filait la frise de loupiotes des voitures de la fugue autoroutière des fins de semaine, et je continuais de blaguer sur Messenger avec mon cher Bona, entre deux messages de Quentin tout étonné d’apprendre que j’avais rencontré Jean Genet rue de Rome, en 1973, par hasard sur un banc - j’étais là, le serveur serbe Ilia m’a apporté mon frichti en regrettant avec moi l’absence de notre ami le chien, j’étais là et j’ai pensé avec tendresse à ma douce amie me reprochant ce matin (SMS occulte) d’avoir les cheveux trop longs, raison de mon escale ultérieure chez la coiffeuse Viviane où nous avons fait notre tour d’horizon habituel (la connerie des parents chauvins de jeunes footballeurs qui s’agressent sur les bords de terrains, entre autres), puis remontant à La Désirade je me suis dit qu’avec les oiseaux (la mésange en photo géante dans le salon de dame Viviane) et nos petits-enfants la vie nous restait plus légère et bonne à prendre tandis que Blaise Cendrars racontait, sur l’autoradio de la Jazz, comment, revenant d’Amérique sur le paquebot Volturno, il s’est saoulé de la poésie du monde en frayant avec les centaines de pauvres immigrés renvoyés en Europe par la police new yorkaise, et comment il recueillit les confidences d’un condamné à mort enfermé dans une cage sur le pont arrière, etc. -
Lenteur de la nuit
 Les heures de la nuit s’allongent...Que cela semble étrangeavère la constatationque s’alentit le temps du songe...Par la bouche ouverte du rêves’en vont les ombres clairesen quête peut-être de chairou d’autres joies trop brèves...Tu te réveilles dans le flotImmobile des heures,et te rendors bercédans la tranquillité du leurre...Plus rien ne sert à la mesuredu temps qui reste là,penché sur ton front que rassurele suspens de son pas...Te reste du moins la caressede l’illusion fécondepar laquelle toute tendresserappelée, surabonde...Le temps se déplie à la fincomme une rose noireoù tu boiras, comme au ciboire,le nectar assassin...Peinture: Leonor Fini
Les heures de la nuit s’allongent...Que cela semble étrangeavère la constatationque s’alentit le temps du songe...Par la bouche ouverte du rêves’en vont les ombres clairesen quête peut-être de chairou d’autres joies trop brèves...Tu te réveilles dans le flotImmobile des heures,et te rendors bercédans la tranquillité du leurre...Plus rien ne sert à la mesuredu temps qui reste là,penché sur ton front que rassurele suspens de son pas...Te reste du moins la caressede l’illusion fécondepar laquelle toute tendresserappelée, surabonde...Le temps se déplie à la fincomme une rose noireoù tu boiras, comme au ciboire,le nectar assassin...Peinture: Leonor Fini
