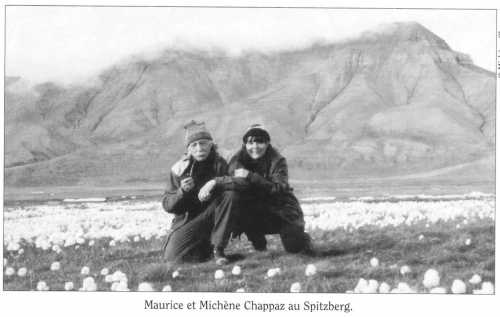Les pêcheuses de perles de l’île de Liam m’invitent à participer à leur plongée nocturne. Elles se montrent honorées de me voir bander lorsqu’elles m’oignent de graisse de baleine, mais ensuite nos corps ne sont plus dévolus qu’aux gestes de la conquête silencieuse.
Le royaume où nous descendons n’est plus tout à fait de ce monde, et pourtant les corps paraissent se fondre là-bas dans la substance originelle de l’univers.
La perle est comme une dent de dieu dans la bouche de l’océan, que protègent des légions de murènes. L’arracher à la nuit est tout un art. Je sais qu’un faux mouvement serait fatal. Je n’ai cependant qu’à imiter scrupuleusement les plongeuses qui me surveillent sous leurs lunettes à hublots. De temps à autre je sens la caresse des seins ou des fesses d’une sirène qui remonte, la perle entre les dents. J’ai remarqué leur façon de se tenir à la corde comme à un pal et de se la glisser parfois dans la fente.
L’eau de la surface mousse à gros bouillons jouissifs sous les lampes des sampans. C’est un plaisir grave que de replonger après avoir repris son souffle sous le dôme ruisselant d’étoiles de la mer de Chine.
poésie - Page 2
-
Pêcheur de perles
-
Verts paradis

Dans le rêve je me trouve sous une Volkswagen enlacé à ma soeur benjamine, et nous y sommes superbien, mais rien de sexuel là-dedans.
Nous jouons comme souvent, avec mes cousines, au Dromadaire. Cette fois nous faisons la course dans les dunes. Le vent soulève leurs jupons et j’y vois tout.
Elle se regarde dans le grand miroir de la chambre de ses parents qui rentreront tout à l’heure de l’église. Elle est vierge et pure, sainte en chemise, et pour la Mary Long qu'elle s'est allumée en douce, il suffira d'aérer. Poil au nez.
Les filles se baignent ensemble dans le baquet de bois, les garçons dans celui de fer.
Un oncle nous fait voir ses biceps. Nous faisons la queue pour les tâter. En passant nous humons les effluves de sa virilité. Il parle sept langues. J’essaie de me représenter ces sept langues dans sa bouche à lèvres.
Je dois procéder à l’inspection des cousines. Il s’agit de vérifier le bon état de fonctionnement de leurs cycles. Les grandes ont de grandes roues et les petites de petits patins latéraux. La chair des unes et des autres est bien ferme. Je me sens ogre avec les petites et cuisinier de chasse avec les grandes. Mon frère les examine et note toutes les réparations dans son carnet du lait.(Extrait de La Fée Valse)
-
Dire le silence
J’aurais voulu dire ce silence, je ne sais pourquoi, peut-être pour le faire durer ? Que ce silence fût me disait quelque chose d’avant qui appelait peut-être un après ? Mais ces mots sont déjà de trop. J’ai donc tenté de dire ce silence d’un pur reflet dans cette eau de source, comme au cœur du temps.
JLK : Lago delle Streghe, huile sur toile, 2007.
-
Aux jardins Boboli
A Gérard Joulié.
Ce que j’aime chez vous,
c’est ce lord, mon ami.
Chez vous l’élégance et la mélancolie
diffusent comme une douce aura de nuit d'été.
Nos conversations le soir
à l’infini s’allongent
au hasard des bars.
et quand nous nous retrouvons à la nuit
(rappelez-vous cette soirée d’été
aux jardins Boboli, lorsque nous parlions
de ce que peut-être il y a après)
sur la marelle des pavés
nous jouons encore
à qui le premier
touchera le paradis.Aux jardins Boboli, cette nuit-là,
vous m’aviez dit que vous,
vous croyez qu’on revivra,
comme ça, tout entiers.
Pour moi, vous-ai-je dit,
je n’en sais rien: patience.
Je ne crois pas bien,
mais, comme au cinéma,
j’attends:
les yeux fermés,
comme aux jardins Boboli de Florence
je souris en secret.
Comme aux jardins Boboli,
je ne vois qu’une lueur
à l’envers de la nuit.Thierry Vernet, Conversation nocturne. Aquarelle.
-
L'éternelle matinée
...Tous les jours, cependant, tous les jours me revient l’une ou l’autre odeur du quartier des Oiseaux, et ce matin c’est cette odeur de cheval sur la route d’en haut, quand les chevaux remontaient du marché, traînant leurs chars, qui me revient et avec elles tout l’arrière-pays et la vision de ce paysan toujours furieux, fumant son vilain cigare et fouettant, fouettant son vieux serviteur accablé.
Il me suffit de fermer les yeux, comme au jeu de l’Aveugle, pour les revoir bien moulées sur la route d’en haut du quartier des Oiseaux : on dirait des boules de chocolat fumant sur l’asphalte, et du même coup c’est l’odeur, l’odeur onctueuse et chaude, l’odeur mielleuse et noire qui me revient et me remplit d’un chaos de sensations et de saveurs premières à jamais liées à cette espèce de matinée éternelle à laquelle je reviens et reviens sans savoir trop pourquoi.
Ou plutôt si, je le sais, maintenant : que dans le premier élan des années je n’ai aimé que les débuts, avant que ne m’apparaissent les beautés de ce qui s’achève, la mort de notre père et les crépuscules, les adieux et les regrets dont on se délecte étrangement, l’élégie et les feuillets éparpillés, jaunis, des cahiers du dernier hiver...Image: Enfant au parc, de Fabien Clairefond. Aquarelle 9,5 x 10cm
-
Au présent absolu
Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: “Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ?”
Je vois ces idéogrammes sans les comprendre, mais c’est alors qu’il m’apparaît que les mots parlent en deça et au-delà des mots, comme le corps se fait âme lorsqu’il danse, et quand je dis le corps “en chinois” je pressens qu’il est corps du pain et du vin et que son âme le déborde et le prolonge tant dans les sept sens que dans les songes de la mélancolie.
Tout à l’heure, et c’était en l’an 700, là-bas à la corne du bois je fermais les yeux dans le parfum du soir et je traduisais en murmure ces traits ailés de pinceau depuis des siècles redevenu poussière: “Des jeunes filles se sont approchées de la rivière; elles s’enfoncent dans les touffes de nénuphars; on ne les voit pas, mais on les entend rire; et le vent se charge de senteurs en passant dans leurs vêtements”.
Et mille deux cents ans plus tard, rentré dans ma trappe, j’avais les yeux ouverts sur le journal et je me rappelais les mots de Tou Fou: “A la frontière, le sang humain se répand, formant des lacs. Mais l’ambition de l’Empereur n’est pas satisfaite!” Calligraphie de Fabienne Verdier
Calligraphie de Fabienne VerdierPeinture ci-dessus: Fabienne Verdier, détail de Maturare No1, L'Esprit de la montagne, 2005.
-
Au Jardin
Des ressources lyriques de la culture potagère. De la lecture de la Vie de Rancé au jardin de curé de La Désirade. Où la mort se trouve priée à goûter.
Ce que je préfère, c’est le fumet de plant de tomate en relisant La vie de Rancé, là vraiment je lévite. Ou reprendre n’importe où La Recherche avec le regard imbibé du jaune tendron de la fleur de courge, ça aussi c’est le nectar, ça et tant d’autres choses que jamais jusque-là je ne pensais trouver au jardin.
C’est que l’image de Candide se retirant derrière sa haie de buis m’avait toujours paru le bas bout de la régression, style troisième âge à flanelle et nains de terre cuite. Tout ce que j’avais envoyé valdinguer à l’âge de refaire le monde se trouvait en somme symbolisé par ce carré confiné: tout le grégaire et le trantran suissaud, tout le côté chasseur de limaces et vieux sage en pot: tout cela me remplissait de fureur à peine adoucie par le fait que mon père aimable, et le père de mon père, participaient eux aussi à la conspiration.
Hélas, combien d’années aurai-je ignoré le goût de la feuille de chou-fleur crue, que j’associe désormais à la lecture d’ Ecuador et à ce moment bleu-vert, frais et croquant, des fins de matinées, après une longue pluie de juillet, quand le Haut Lac fume et que ça sonnaille à tout drelin dans le val suspendu.
Tant de saveurs ignorées par blasement d’époque ! Mais n’est-ce pas le propre de cette fin de siècle au jouir sommaire et au savoir vague, qui prétend avoir fait le tour de tout et s’en ankylose de mélancolie alors que tout reste à goûter, bonnement offert sur un plat ?Au moins me suis-je assez rattrapé, ces derniers mois, depuis que j’ai commencé d’arracher un carreau à la jachère du jardin de curé de La Désirade, puis un autre et un autre encore, sans me presser ni cesser de lire ou de psalmodier à portée de voix de celle que j’aime.
On sait le hasard des rencontres, ou plus exactement ce mélange d’imprévisible et de nécessaire qui fait se croiser deux destinées ou soudain apparaître l’évidence de la parenté liant la tomate verte à Chateaubriand.
De relire une fois de plus La Vie de Rancé m’avait rappelé nos premières lettres d’amour, et celles ensuite d’année en année qui racontaient notre histoire en filigrane, et me revint le parfum à la tomate fraîche de ma jeune fille en fleur.
A un moment donné, plus rien ne compte qu’un certain bonheur de phrase. Ce matin dans le jardin les tomates sentaient la jeunesse des corps et c’est cela même qui me touche tellement dans les pages que je lisais sur la vie qui file d’une lettre à l’autre, le premier mot qu’on écrit dans la transe et ceux qui suivent tous les jours, puis l’érosion, ou l’émiettement, l’effondrement parfois, la chute à pic d’une seule lettre de rupture, ou l’étirement des déchirures et des imaginations vengeresses, ou pour nous deux la fidélité plus lente et les détails bonifiés dont nos gestes seuls et nos regards, nos moindres inflexions formaient toute l’écriture à l’instant quintessenciée en parfum juvénil sur les petites terrasses balinaises de mes plants de tomate.
Puis une autre sensation ancienne me revint en remuant les cailloux brenneux, une sensation de terreur douce.
Je m’étais retrouvé à marcher à travers champs avec le père de mon père, je revois nettement la petite gare au milieu des prés et le seul chemin montant vers nulle part où se déploie soudain un parterre de jonquilles comme je n’en ai jamais vu, puis c’est la ferme dans un repli et, dans la cuisine enfumée de la ferme, la vieille tante à mains sèches que j’entends encore parler, baissant la voix, d’un certain individu qui rôde de par le pays et fiche le feu aux fenils, et le soir que je suis conduit à la grande chambre froide juste en dessus d’où je continue d’entendre l’inquiétant murmure, et j’ai de la peine à me faire à la matière fluide et dure à la fois du petit oreiller rempli de noyaux de cerises, je n’arrive pas à m’ôter de l’imagination que l’individu se dissimule derrière telle horloge jurassienne ou dans l’ombre de telle armoire, et comme une douceur m’apaise cependant, mon grand-père a dû me rejoindre et c’est maintenant lui qui joue le spectre en chemise de nuit, et je perçois bientôt une sorte de bruissement dans l’oreiller, et je vois peu après se déployer l’arbre immense dans la brise de la nuit, oui tout cela me revient pêle-mêle tandis que la terre que je sarcle se remet à respirer.
L’idée d’ Ecuador qu’on puisse courir sur l’océan soudain solidifié, la formidable partie de rollerskate qu’évoque ce journal de voyage m’a fait imaginer à mon tour, je ne sais pourquoi, la coupe de la terre en transparence: du jardin aux fourneaux enfouis des volcans mexicains tout communiquait soudain, et mes siècles de lecture.
Aux îles Bienheureuses, trente ans plus tôt, dérivant entre d’incertaines amours, mais accroché au bois flotté des livres, je voyais déjà tout comme ça: comme un ensemble relié dessous par un même socle et dessus par de fulgurantes flèches. Dans les Cyclades un squelette de chien dans le sable me faisait communier avec un vice-consul ivre à Cuernavaca, ou le goût de la figue de Barbarie dans la fraîcheur du matin s’alliait au nom de Nietzsche sur un livre trempé d’eau de mer que j’annotais au crayon violet au milieu des hippies.La terre en coupe est comme un rêve d’enfant: un merveilleux terrier à étages où l’on descend et remonte à n’en plus finir par tout un réseau de galeries fleurant la vieille farine et les fleurs séchées. Il y a des greniers et des cachettes: c’est là qu’on range les réserves de fruits et les chaînes de saucisses, les jarres et les barriques, les souvenirs de toute sorte. Il y a des balcons de bois d’où l’on surplombe tout le pays et les montagnes d’en face, selon la lumière, forment tantôt un dernier diadème himalayen et tantôt une cordilière pelée.
Les mains dans la terre je divague. Je creuserais bien jusque de l’autre côté, comme lorsque je me suis fait azorer pour grave atteinte à la pelouse familiale, ce jour de l’été de mes sept ans où j’avais décidé de partir à la rencontre des Têtes Bêches à corps peints.
Résumé de la situation: nous sommes au jardin pour toujours et convions la mort à goûter nos tomates. Les anges envient notre miam miam.(Ce texte est extrait du recueil intitulé Le Sablier des étoiles, paru chez Barnard Campiche en 1999).
-
Le mot CELA
Il faut tomber longtemps, avant de tomber sur sa propre image dans un miroir, pour s’apercevoir que le Nom qu’on entend prononcer à tout moment partout où on est correspond à ce que désigne le mot CORPS, qui ne sera d’ailleurs jamais bien clairement défini ni bien distinct de ce que désigne le mot ÂME. Or, on avance à tâtons, et chaque aube on retombe dans cette même difficulté d’exprimer ce que signifie le mot CELA, comme, tout enfant, lorsqu’on regarde une lettre inscrite sur un cube, dans son parc à barreaux, puis une autre, puis d’autres encore dans la soupe aux lettres ou sur les étiquettes des objets, et ces lettres accolées forment des mots comme Le Rêve et ces mots sont déjà des sortes de choses.
Qu’est-ce que CELA? Cela seul à vrai dire, cette question et ce mystère, ce besoin de savoir et d’irradier ensuite me fait revenir avant chaque aube à ma table avec autant d’incertitude attentive que de curiosité de l’âme et du corps, puis de satisfaction du corps et de l’âme, comme à consommer une fusion ou une effusion – cela seul me lance en avant comme la première semence lance en avant l’impubère qui se demande devant son premier sperme: mais qu’est-ce diable que cela? Où s’arrête mon corps? Tiens, l’odeur de ma petite sœur n’est pas la même que celle de mon grand frère! Celui-ci sent plutôt le fromage frais, celle-là plutôt l’abricot, comme notre mère sent le matin la pommade Nivea et notre père la verte eau de Cologne 4711.
Cela forme un premier cercle contenu dans le carré du petit parc délimitant le premier territoire où nous tombons, lui-même contenu dans le dédale de pièces et de couloirs et d’escaliers et de retraits de la maison, elle-même contenue par le quartier et le quartier par la ville et la ville par le pays et le pays par les autres pays et les autres pays par le monde et le monde par la mappemonde du Petit Larousse dans lequel je tomberai quand je serai sorti du parc, et le ciel désigné par le mot LÀ-HAUT qui désigne aussi la demeure de celui que désigne le nom de Dieu, censé contenir tout ça.
Le mot CELA est le premier entonnoir de tous mes vertiges d’enfant et d’adolescent: il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.
Dieu te voit. Dieu t’écoute. Dieu te protège. Dieu te punira, si. Dieu va te récompenser, si. Dieu ne sera pas content, si. Dieu sera triste, si. Le bon vieillard chenu. Le proprio toujours malcontent. L’œil dans un triangle. Le doigt pointé. La terrible voix. Le père sévère, ou pas. L’attentionné pépère, ou pas. La petite voix ou le tonnerre. La petite voix plus intime à toi-même que toi ou le Jupiter tonnant, le Yaweh des nuées. Le Juge Suprême. Celui qui nous attend Là-haut.
Alors que devant le mot CELA je reste seul et muet, comme si je me voyais moi-même sans miroir, de dos ou du dedans, visible les yeux fermés ou invisible à l’œil nu.
(Extrait de L'Enfant prodigue, récit paru en 2011 aux éditions d'autre part)
Image: Adolf Wölffli.
-
La Porte
… Frappez et l’on vous ouvrira, était-il écrit, et nous avons lu et nous avons cru, et le soir du premier jour nous avions les poings en sang déjà mais nous avons frappé, encore frappé et frappé, notez le mot déjà et le mot encore, et les jours suivants nous ne nous sommes jamais lassés, bientôt nous n’aurons plus de force ni de sang mais nous frapperons toujours, notez les mots jamais et toujours…
Image: Philip Seelen
-
Le lait des nuits

Maman renifle ces portulans humides avant même que je ne sache de quoi il retourne. La semence de ce jeune homme était surabondante, dira-t-elle plus tard avec le manque total de retenue qui caractérise souvent la mère typique.
Il me semble d’abord que cela sent la pêche. Non, ce n’est pas la pêche: c’est l’amande que cela sent, l’amande douce, plus exactement la fleur d’amandier dans le vent tiède, le verger tout blanc des matinées de printemps, ou je me fourre le nez là-dedans et je vois plein d’étoiles et je ne pense pas que ça sorte de moi: je me figure comme ça que je suis un pylône et que j’ai puisé dans la profondeur d’un puits de fuel blanc.
Longtemps cela s’épancha de moi par nappes au gré de rêves que je n’ai jamais notés, mais qui me reviennent parfois du tréfonds des années.
Enfin je redécouvre depuis peu ce plaisir pris à la chasteté par les curés et les joueurs d’échecs, quand le corps endormi fait l’amour au sommeil.
-
L’autre désir – la poésie
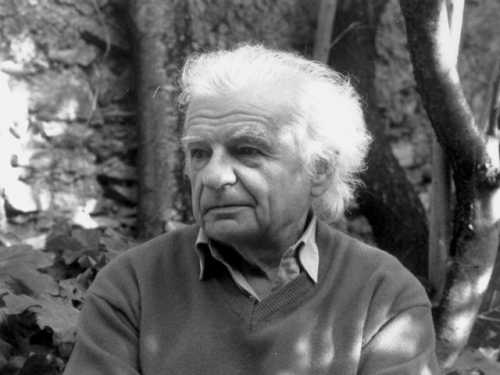
Vient de paraître chez Albin Michel: L'Inachevable, recueil très substantiel d'entretiens avec le poète. Qui nous avait accordé celui qui suit pour Le Passe-Muraille, en 1993.Entretien avec Yves Bonnefoy
La tendance massive de l’époque est à la parole vilipendée à grande échelle, à la présence émiettée, à la distraction planifiée, aux certitudes assenées et qui tuent, au doute qui paralyse et qui stérilise, à toutes les formes du leurre et du simulacre – et comment résister à ce qui paraît un mouvement fatal ?A ces questions bien générales, certaines œuvres particulières répondent et d’abord par la simple évidence d'une voix à sa plénitude d’être et d’expérience. Ainsi celle d’Yves Bonnefoy, poète exemplaire de la présence au monde vécue à tous les degrés de l’intuition sensible, de la connaissance tous azimuts et de la réflexion.
- Quelle place l’écriture tient-elle exactement dans votre vie ? Est-ce une discipline régulière ou une suite de mûrissements et de jaillissements ?
- Quelle place ? Des jours aucune, puisqu’il y a tant de tâches qui nous requièrent dès qu’on a une profession. Nombre de mes journées sont occupées ainsi, dévorées ainsi, et il vaut mieux que je n’essaye pas de les retenir à quelque illusion d’écriture, elles ont leur vérité propre, d’ailleurs, leur enseignement. Et ce qui est vrai pour des jours l’est aussi pour des mois, parfois, si ce n’est même pour des années. Le fait poétique ne cesse pas de me préoccuper pendant ces périodes, il me donne matière à réflexion, sur l’exemple d’œuvres que j’ai toujours avec moi, mais je puis rester longtemps sans écrire. Après quoi, eh bien, c’est comme si j’entrais, parfois peu à peu, dans une autre sorte de vie, et il y a des saisons de la mienne pendant lesquelles je me penche chaque jour ou presque, et pour des heures recluses, sur cette feuille où des surgissements se produisent, que je me propose de comprendre, de raccorder entre eux, en les refusant s’il le faut, c’est-à-dire le plus souvent.
- Qu’en est-il, plus précisément, de cette germination du poème ? Vous semblez dire qu’elle est difficilement accordée ?
- Pour moi en tout cas elle est bien longue, et c’est là un fait qui me rassure, car je ne crois pas qu’il y ait de vraie poésie qui ne soit le renversement de la parole ordinaire par une autre qui monte de très profond dans notre inconscient et cela ne peut donc s’accomplir qu’au travers de maintes péripéties, où il faudra déjouer nombre de pseudo-évidences : certaines d’ailleurs suggérées par cet inconscient même que j’évoquais à l’instant, quand il agit par ses formes superficielles. L’inconscient, autrement dit, ce n’est pas simplement cette parole du désir dont on parle tant depuis Freud. C’est vrai que le désir, l’éros s’est façonné un langage en nous, avec ses symboles, sa scène, son autorité et son énergie, si bien qu’il suffit d’écrire, et le voilà qui afflue : ce vont être ces évidences dont je dis qu’il faut se méfier, celles qui font que l’on croit savoir ce qui est beau, ce qui a du sens. Mais tout cela n’est qu’une image du monde, de l’irréel : et plus profond dans notre rapport à nous-mêmes il est un autre désir qui veut, lui, la réalité et rien d’autre, un désir qui veut la voir, la toucher en ce qu’elle a d’inentamé par les mots – d’immédiat, disons aussi, de présent à notre présence -, et s’impatiente donc contre le discours de l’éros, et cherche à en déjouer les structures, à remonter à travers ses pour nous arracher à leur séduction, pour nous montrer comme à nu, du coup, la montagne, là-bas, ou l’arbre dans le soleil, ou le nuage immobile. Cet autre désir, c’est la poésie. Et comment espérer que l’écoute en soit facile, quand tant de prestiges l’étouffent ? Il ouvre des failles mais on n’en finit pas d’y descendre.
- On a parlé des aspects religieux de votre poésie. Vous considérez-vous comme un esprit religieux ?
- C’est une question de mots. Si un esprit religieux, c’est celui qui croit en un dieu, je n’en suis pas un : il ne m’est donné aucune croyance. Mais si religion signifie désir de vivre dans l’unité plutôt que le fragmentaire, avec respect pour les aspects les plus immédiats, les plus simples de l’être naturel, alors j’accepte ce grand vocable et je voudrais qu’il ait sens pour la société tout entière, sinon celle-ci est perdue, qui ne sera plus qu’un réseau de signes, aveugle au mystère de ce que j’évoquais tout à l’heure : l’arbre dans la lumière, le silence des pentes de la montagne. - Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?
- Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?
- Qu’il ne faut pas qu’il ait peur de cette sorte de préoccupation, mais surtout qu’il ne s’y prête pas que de façon négative, c’est-à-dire en cherchant la rupture, la faille dans le discours de la société, mais fasciné malgré tout par l’infini propre de celui-ci, qui a certes de belles phosphorescences. C’est bien cette rupture que veut la poésie, je l’ai déjà dit, et j’aime la retrouver dans l’apparent décousu ou le minimalisme de bien des poèmes de notre époque, mais le rôle de la rupture, c’est de révéler l’immédiat, l’indéfait du monde, vers lequel il faut donc aussi que l’on se porte en des moments de vie simplement vécue parmi les grandes et belles choses.
- Que pensez-vous de la coupure que l’on constate aujourd’hui entre la poésie et la société ?
- Y en a-t-il vraiment une ? Ou ne s’agit-il pas simplement de la même sorte de distraction qui prive d’eux-mêmes, tous les premiers, ceux qui ont souci de la poésie ? A tout instant celle-ci leur échappe, le discours du concept s’y substitue, et cela qui a lieu aussi pour le groupe social dans son ensemble, depuis surtout que la science détourne de la pensée symbolique, qui gardait l’esprit auprès de la chose, mais voilà qui peut laisser espérer, tout aussi bien, que ce qu’on oublie peut être également ce qui tout se resignifie, et appelle. Peu de place pour les livres de poésie sur les rayons des librairies, mais que de films pour nous éblouir par de brusques instants épiphaniques, poésie brute !
- Quelle pourrait être la fonction de la poésie dans l’univers de fausse parole des médias ?
- Assurément, de combattre ce que l’on peut appeler l’idéologie, laquelle est d’articuler les uns aux autres quelques concepts absolutisés, refusés à tout avenir d’expérience, afin de les substituer au monde et d’ainsi enfermer les êtres, séduits ou contraints par force, dans ce champ d’abstraction, d’intolérance, de mort. Puisqu’il n’y a de poésie que par mémoire d’un au-delà du langage, tout recours au poème est aussi l’accusation, comme par surcroît, mais avec grande efficacité, de ces caricatures de langues qui sont des captations de pouvoir. Et cela me conduit à dire que la poésie est donc, de ce fait, le complément naturel du projet de démocratie – ce droit de chacun à sa parole – et la condition nécessaire à son véritable plein exercice. Il y a de la poésie même aux époques totalitaires, par des recherches individuelles, qui réussissent quelque eu à modifier la pensée commune, comme ce fut le cas à la Renaissance, ou préservent l’avenir. Mais il n’y aurait plus de démocratie si disparaissait l’activité poétique, et il faut donc prendre garde à ce que celle-ci soit protégée et révélée là où c’est possible, c’est-à-dure d’abord dans l’enseignement. Un professeur peut préserver un enfant de la tentation d’être dogmatique, intolérant, tyrannique – ou d’accepter d’être un esclave – en lui donnant simplement à lire – simplement, oui, sans les commenter, pour qu’il reste seul avec elles – quelques pages de Baudelaire ou de Rimbaud… -
Le temps de Charles-Albert Cingria

Il est peu d’écrivains contemporains qui semblent plus étrangers que Charles-Albert Cingria aux tumultes de ce qu’on appelle l’actualité, et qui nous propulsent à la fois, avec autant d’énergie, au cœur même du présent. Cingria aura traversé la moitié de notre siècle ponctué de révolutions locales et de guerres mondiales sans que ses écrits n’en conservent de traces significatives, et pourtant on se tromperait en affirmant qu’il a ignoré son époque. Ce n’est pas qu’il se voile la face ou qu’il prône le dégagement. Simplement il vit à un autre étage. Ce n’est pas qu’il soit coupé de la réalité. Au contraire il l’investit avec une intensité particulière, mais d’une manière qui lui est propre. Ce n’est pas qu’il fuie la terre des hommes. C’est qu’il l’arpente et l’habite à sa façon. Son temps n’est pas celui des grands événements et des grandes questions du jour dont, relevait Jean Paulhan, il se « foutait complètement ». Son temps n’est pas celui des horloges pointeuses, et pourtant la firme Cingria ne chôme pas : c’est l’officine d’un scribe peut-être irrespectueux des horaires mais qui alimentera tout de même quelque quatre mille cinq cents pages imprimées. Son temps n’est pas celui des modes littéraires, ni des écoles ou des mouvements. Cingria ne s’inscrit guère dans l’esprit du temps au sens d’une conformité suivie ou subie, mais cela ne l’empêche pas d’être de son temps. Ainsi va-t-il fréquenter les écrivains et les artistes de son époque, tant en Suisse romande qu’à Paris. Ses portraits et jugements, qu’on aurait tort de ne borner qu’à leur plaisant cocasse, témoignent d’ailleurs d’une acuité de perception et d’une qualité d’évocation sans pareille. Les pages qu’il consacre à Ramuz ou à Léautaud, à Modigliani ou à Stravinski nous paraissent aujourd’hui encore d’une cinglante pertinence alors que tant de gloses à prétentions avant-gardistes ont perdu toute saveur de surprise et tout éclat. Certes l’humeur, à base de susceptibilité froissée ou de prévention plus sérieuse, gauchit-elle nombre des opinions qu’il formule sur ses contemporains. On n’ira pas chercher dans son œuvre un tableau bien objectif des productions artistiques ou littéraires du moment. Plus que quiconque Charles-Albert est personnel dans la ferveur de ses adhésions autant que dans la véhémence de ses fulminations. Du moins ses goûts rompent-ils avec tout souci de se montrer à la page.
« Nous ne nous occupons pas de l’âge (pas de l’actualité) : nous ne nous occupons que des qualités, lesquelles sont comparables quel que soit leur âge. Une chose d’un temps vaut mieux que celle d’un autre. Nous aimons cette chose. C’est ainsi que, bien que le cubisme ou le surréalisme soient actuels (en réalité ils ne le sont plus, mais ils prétendent à l’être), nous ne faisons aucune difficulté de nous charger du grief de « passéisme » (d’abord qu’est-ce que c’est que ce mot ?) en détestant cette stupidité pour être ce qu’il nous plaît d’être, d’antique ou de moderne ou de n’importe quel temps. »
Il y a un provincialisme dans le temps, disait à peu près T.S. Eliot, come il y en a un des lieux. Or Cingria ne se cantonne pas plus dans la considération d’une modernité fabriquée, que dans l’idée provinciale au possible qu’il n’y aurait que Paris pour donner le ton ou que paris pour le corrompre.
« L’art appelé moderne (constructivisme, abstractionnisme, idéisme et mille incommensurables stupidités de ce genre) n’est pas un art naturellement moderne, mais un art voulu moderne. Voulu en dépit de cause, car il ne l’est pas ; voulu avec des éléments imaginaires, mais, surtout – il faut dire cela, car c’est vrai -, sans émotion réelle de la vraie vie, sans spiritualité ou matérialité, ni pour les sens, ni sous l’impulsion d’une passion quelconque. Ce n’est alors qu’une fabrication cérébrale ».
Si le présent n’est pas une valeur ensoi pour Cingria, il y a pourtant une actualité proprement cingriesque, et qui est celle en somme de sa langue, donc de son être manifesté. Il y a ce travail que le poète accomplit sur le tout-venant des jours. Il y a la rue, il y a les gens, il y a les livres, il y a les routes dont le ruban se déroule souplement sous le caoutchouc boucané de sa bicyclette et le conduit à travers champs et forêts, il y a le monde, il y a les saisons que ponctuent le vin nouveau et les feuilles mortes. Charles-Albert n’est pas claquemuré dans sa tour de papier, il fait son miel de cette poussière dorées des jours ouvriers tout se réjouissant, « demain, parce que c’est dimanche ».L’écriture de Cingria ne voudrait rien devoir à l’exécré « moderne voulu moderne », et cependant il y a une modernité de Cingria qui nous saute aux yeux et qui le fait novateur de la langue autant sinon plus qu’André Breton ou que Max Jacob ou que Jean Cocteau. Au premier regard, l’on a peine à croire que Charles-Albert Cingria soit le contemporain de Jean-Paul Sartre, et pourtant s’il n’est pas vraiment représentatif, comme on dit, de ce même siècle où a été formulée la théorie de la relativité et où ont été appliqués les préceptes de l’amour libre, Cingria ne nous touche pas moins par sa façon de faire vibrer ce que Cendrars appelait le profond Aujourd’hui, avec une sorte de juvénile classicisme.
On a souvent parlé du baroquisme de Cingria, mais pas assez sans doute de son classicisme, ou disons plus précisément de la latinité, de la base d’airain de sa propre langue qui font de lui le contemporain simultané de Claudel et d’Apulée. Sa phrase jaillie, tendue, toute souple, cinglante, même sauvage, a conservé quelque chose de sainement archaïque qui n’exclut pas tous les contours et les ornements, les dorures et les arabesques. Il y a là un mélange de force tellurique et de grâce civilisée très rare.
Cependant, préludant même à l’acte d’écrire il y a d’abord ce marmonnement qu’on pourrait dira la basse continue et la base de toutes les improvisations de cette voix aussitôt reconnaissable – et voilà le miracle.
Il faut alors citer la phrase du Canal exutoire où Charles-Albert salue l’apparition dans une brasserie de cet individu apparemment semblable à tout un chacun et que sa qualité d’être identifie à celui que les Chinois appellent l’homme-humain :
« Il suffit qu’il y ait quelqu’un. »
Et ce quelqu’un n’est pas tomé là par hasard mais a surgi dans un ange du temps vivant où il est donné à l’être – « c’est un temps u deux de stupeur insondable dans la vie » – de reconnaître sa nature.
Ainsi s’éclaire la double ubiquité de Cingria dans le temps et dans les lieux, qui est une disposition à l’unité bien plus qu’on ne le pense, une vocation poétique à sensibiliser tous les points de la circonférence à partir d’un seul moyeu. Bien moins errant qu’on le croirait au vu de ses incessantes déambulations, Charles-Albert, dans son vagabondage, était « le moins vagabond des hommes », affirmait justement Jean Starobinski, parce qu’il « allait à la rencontre de l’ancien, du permanent ».
Charles-Albert Cingria s’extasiait à la seule idée qu’il pût y avoir quelqu’un au lieu qu’il n’y ait personne. Cela lui semblait une grâce qu’il pût y avoir un monde au lieu de rien du tout. Il y avait à ses yeux, dans le seul surgissement de l’Univers et de la vie et de ses bonnes choses, un tel miracle que tout phénomène à nos yeux ahurissant, tel que la lévitation d’un bonze sur quelque haut plateau de l’Inde ou que le pas solennel de Notre Seigneur sur les eaux d’un lac, lui paraissait à peine plus surprenant que le fait de pouvoir bouger un orteil et d’abord que cet orteil eût apparu dans le chaos des virtualités gazeuses.
Le monde selon Cingria relève aussi bien de l’apparition, et cela se voit jusque dans les motifs et les métaphores et les formes et les mouvements les plus organiques de sa langue. Le monde selon Charles-Albert est un monde révélé – et nous l’entendons au sens exact d’un dévoilement suivi d’un repli des choses inanimées et animées dans leur secret et leur obscurité. On parle volontiers du caractère jubilatoire de cette prose aux amorces fusées et aux rebonds allègres, mais cette alacrité joyeuse ne se réduit pas à une euphorie de surface ou à une extase passive, à une banale délectation esthétique ou sensuelle. L’économie de cette écriture n’est pas d’ailleurs de consommation mais de consumation. Les lieux de Cingria ne sont point d’évasion mais au contraire d’invasion et de tous les instants. L’être qui se reconnaît marque l’affirmation d’une présence et cette présence est aussitôt livrée à un jeu de relations à travers le temps et les lieux qu’il incombe au poète d’éclairer et de nommer et de définir avec cette surexactitude et ce « sens d’illumination continuelle » que Charles-Albert disait sa « façon de procéder dans la mise au net de n’importe quel problème ».
Les évocations et les définitions de Cingria ont-elles-mêmes la première vertu de faire apparaître les choses ou les êtres avec fulgurance. Voici ces lieux que sa parole magique dégage soudain de leur insignifiance présumée et par exemple ces abords de tas de sable et de hangars et de rails ne menant nulle part qu’il voit du côté du port d’Ouchy où nul villégiateur passant à Lausanne n’aurait l’idée de s’égarer et qui diffusent pourtant cette beauté secrète qui est celle-là même de la terre :
« Il y a une prairie avec des bambous. L’herbe est courte, jaune, trouée par des footballs d’enfants. Des merles, à l’encre, y dessinent leur opulence bombée ».
Ou voici paraître Modigliani : « Ses entrées étaient très hautes, courtoises, taciturnes. Il évoluait dramatiquement avec les dames ».
Voici Paris comme à tout instant l’inattendu s’y révèle :« Paris est une ville où on voit tout d’un coup des choses comme ça : un papillon qui sort du cerveau d’une statue, puis s’élève d’un lourd vol vaseux, puis plane. L’or est tiède sur les façades. Mille têtes, en bas. Il traverse la place. Les gens croient que c’est un bout de papier ou bien ils ne voient pas. Et puis le vent le roule au Nord-Est grassement sur les toitures. Peut-être qu’il ne mourra pas. Il y a de l’herbe tendre, de belles meules éternelles, pas si loin de Paris ».
« L’or est tiède sur les façades », « le bitume est exquis », « l’herbe est divinement tendre » Autant de formules qui signifient à n’en plus finir dans quel ordre de l’éloge et de la célébration s’inscrivent l’évocation et la définition selon ce contemplatif aimant. « Observer c’est aimer », remarque-t-il au passage, et tout aussitôt lui prend l’élan de le communiquer. Il est là. Il observe. Il marmonne. Il rend grâce. Il absorbe. Il mastique. Et bientôt il lui faut noter. Ses premières cartes postales témoignent de cet émerveillement qui fonde en somme son attitude devant le monde, et cela depuis toujours à ce qu’il semble. Il n’a pas vingt ans lorsque, de Rome, il écrit à son compère Adrien Bovy qu’«on ne doit pas avoir du noir (…) », contre lequel il affirme qu’«il n’y a que le travail, ou l’espérance de beaux Voyages ». Et c’est juste quelques jours après avoir fait à sa tante Edmée Stryjenska cette annonce merveilleuse :
« Je partirai quand il n’y aura plus de raisin ».Enfant déjà nous le voyons, sur les photographies de l’album familial, en petit pacha qu’il incarnera toujours d’une certaine façon. Il est à Bône comme chez lui et comme à Grenade, comme à Sienne ou à Fribourg, comme à la rue Bonaparte ou au bord de la Maggia, et très vite il apparaît à ses amis sédentaires en personnage de légende. Que nous soyons en 1902 ou en 1952 se voit à peine dans ce qu’il écrit. C’est presque toujours le même ton, la même découpe de la phrase, la même inaltérable luisance de médaille. Tout adolescent encore il lui vient parfois des les considérations d’un vieux sage, et jusqu’à la fin il conservera quelque chose de la candeur d’un gamin de sept ans. A une demoiselle de Genève qui s’inquiète d’établir la fiche signalétique de Charles-Albert, celui-ci répond en ces termes dont la fantaisie n’exclut pas la vérité profonde : « Mon âge : douze ans et demi et trente-six mille ans. Mes origines : le paradis terrestre ».
Est-ce à dire que le monde ne lui ait jamais pesé ? Le prétendre ne serait pas voir l’extraordinaire énergie qu’il a déployée afin de transmuter les mille misères de sa vie d’homme seul et démuni qui si rarement se plaint ou s’apitoie sur son sort. Nombre de gens assis n’ont vu chez lui qu’un personnage et certes peu commun, mais dont les frasques, les esclandres ou les simples bizarreries de la tournure éclipsaient la réelle qualité. On peut imaginer la solitude sans doute ressentie par l’individu au fil d’une vie où nulle autre liaison autre qu’amicale n’est repérable. On sait les difficultés matérielles constantes et lancinantes qu’il s’est imposées par souci de préserver sa liberté d’artiste. On se rappelle que le caractère de Cingria n’était pas toujours accommodant et que ses dehors enjoués dissimulaient un être à vif. « Sa nature complexe fuyait lorsqu’on cherchait chez lui le dialogue, écrivait le peintre René Auberjonois. Seul le monologue lui était séant ». Dans le monde parisien, les gens cravatés regardaient avec dédain ce pitre drôlement alluré. Dans son Journal, Drieu La Rochelle le classe au nombre des « médiocres délirants » de la Nouvelle Revue Française, et l’on sait que d’autres dents grinçaient à la lecture de son Air du mois. Sans doute Charles-Albert a-t-il vécu mille humiliations cuisantes, qui nous font paraître d’autant plus admirables la fraîcheur lustrale de tant de ses proses et sa formidable aptitude à tout transfigurer dans l’élan du plus haut lyrisme.
Au demeurant, comme il échappe au temps des horloges, celui en qui les philistins ne voyaient qu’un pauvre bougre bravait les contingences et de façon si impérieuse qu’elle exclut toute commisération. On se rappelle à ce propos l’ombrageuse et poignante invective du petit Labyrinthe harmonique :
« Me faisant aimable alors que je suis tueur, me faisant pittoresque alors que je suis roi ».
En un temps de lamento collectif, de ressentiment latent et de déprime patente, Charles-Albert incarne ce pauvre radieux trônant en caleçon de coton dans les opulentes crinières d’herbe riveraine d’un fleuve qu’il vient de remonter de sa puissante brasse et qui nous lance :
« Etonnez-vous donc de ce soleil avant d’en réclamer un autre, mais étonnez-vous aussi de la vie, de cette vie, de la vôtre. Des miracles, vous en avez tout le temps ».
Charles-Albert ferait-il un bon sujet d’étude psychanalytique ? C’est possible mais incertain. Et d’ailleurs nous n’en avons cure. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas ce que le personnage dissimule mais ce qu’il montre au contraire, ou plutôt comment il enlumine la partition du monde et devient lui-même légende. Nulle place n’est faite en tout cas, dans son œuvre, à la psychologie, et c’est un phénomène sans doute et qui l’éloigne plus encore de l’esprit du temps.
Il est piquant de constater qu’à un siècle d’intervalle, et parti de la même ville, Charles-Albert adopte la démarche la plus diamétralement opposée à celle d’Amiel, rompant tout piétinement introspectif par l’échappée et la sublimation. Si la langue d’Amiel évoque un forage et certes bien moins stérile qu’on en le prétend à l’ordinaire, c’est au jaillissement, à la montée inspirée, à l’improvisation lyrique qu’est soumise l’écriture de Cingria dont son ami Jean-Marie Dunoyer relevait qu’avant de l’écrire le poète la parlait comme un jazz verbal incessamment exercé. Jour après jour, Amiel nous paraît incarner par excellence l’homme pris au piège du temps, s’acharnant vainement à en conjurer ou à en corriger les arrêts – et c’est une lancinante et douloureuse musique qui émane de ses cahiers de vieil écolier. De même une mélancolie sans fond enveloppe-t-elle la Recherche proustienne, où le temps lui-même devient musique.
Quant au rapport entretenu par Charles-Albert Cingria avec le temps, il nous semble absolument unique dans la littérature contemporaine. Le temps de Cingria est simultanément celui de l’émotion foudroyante de l’instant et des lentes remontées au fil de l’Histoire. Il y ale temps du voyage et c’est à chaque fois un voyage dans le temps. Il y a le temps du sens et le temps du chant. Enfin et surtout le temps de Charles-Albert est celui de sa langue. Or une langue, il le dit et le répète, ne saurait se borner à sa fonction utilitaire ou à son prestige esthétique, mais signifie à la fois le mystère et la musique de l’être.
« C’est splendide, à vrai dire, d’entendre vibrer comme vire un bocal dangereusement significatif cet instrument étourdissant qu’est un être ».
Le temps de Charles-Albert est celui d’un enlumineur. Mais il y a bien plus qu’un rôle décoratif dans la vocation de celui-ci, bien plus qu’une simple effusion ou qu’un goût cocasse dans le bonheur cingriesque, bien plus que de la fantaisie ou que de ce plaisant farfelu qu’on salue d’un air amusé : toute une formidable énergie de ressaisissement poétique qui fuse du tréfonds. On se rappelle l’image qu’il donnait de la gloire poétique de Pétrarque et qui lui revient en droit à lui aussi :
« Quand Rossignol tombe, un ver le perce et mange son cœur. Mais tout ce qu’il a chanté s’est duréfié en verbe de cristal dans les toiles ; et c’est cela qui, quand un cri de la terre est trop déchirant, choit, en fine poussière, sur le visage épanoui de ceux qui aiment ».
Avec Charles-Albert on se sent au matin de la Création : partout on est chez soi et comme délivré du temps, au présent absolu. C’est une joie, ou plutôt c’est une jubilation, c’est un chant qui répand en nous sa jouvence. S’il ne parle à peu près jamais du mal courant dans le monde ni ne se plaint non plus de ses pauvres maux, ce n’est pas qu’il s’aveugle ou que les tribulations lui soient épargnées : c’est que la célébration le requiert avant tout, et le lui reprocher serait aussi vain que de faire grief à Job ou à Jérémie de n’être pas l’auteur des Psaumes.
Or il nous suffit de regarder une phrase de Cingria pour nous sentir mieux. Il en va comme d’une idée d’apéritif ou de bain turc _ rien que de voir la belle plastique de ces mots écrits nous fait du bien :
« Et ensuite ? Ensuite il se passe que le terrain se refait plat, et l’on remonte sur son engin. Il n’y a plus dès lors d’obstacle à faire une moyenne, fort agréable vitesse. On dépasse une gendarmerie, on dépasse un élevage de chiens, quelques cloches à melon qui luisent noblement dans le soleil de cinq heures. Et puis il y a une descente, jusqu’à un torrent et un pont. Je crois que c’est une frontière de rossignols, cet endroit, car on ne peut s’empêcher de prendre pied pour rendre hommage à un concert d’oiseaux si impressionant ».
Au cœur de l’œuvre de Charles-Albert Cingria, il y a cette adhésion fondamentale qui évoque la plénitude byzantine. Certes et à de nombreuses reprises vous l’entendrez fulminer et tempêter contre les choses ou les gens qui l’horripilent. Il peut entretenir de terribles colères passagères, traverser des passes de désarroi – « L’âme est triste – je suis comme une route qui dégèle – il pleut du pétrole » -, ou ressentir comme chacun les atteintes du temps qui passe :
« Au lendemain de mes vingt-cinq ans je me suis aperçu que réellement ma barbe était plus forte que la veille. C’est vraiment extrêmement douloureux de vieillir. Et dire qu’au lieu de s’arrêter ça continuera toujours. J’y pense avec effroi la nuit quand des Allemands causent bruyamment à côté de ma chambre ou que de stupides messieurs anglais sifflent des airs banals ».Il peut être acerbe, sévère jusqu’à l’injustice, dire de telle personne qu’elle est « tout à fait nulle », quitte à convenir du contraire tout à l’heure – « Oui, mais tout à l‘heure est tout à l’heure, et ce n’est pas maintenant ».
Pour l’essentiel, cependant, c’est sous le signe d’un accord profond avec l’Univers que se place ce clochard céleste apparemment détaché de tout et connaissant pourtant, dans sa misère richissime, le prix de chaque chose. Docteur honoris causa des universités buissonnières, il préfère la compagnie des petits enfants de Lavaux ou du Luxembourg à celle des pontes académiques. Enfin accordons-lui le dernier confort de l’imaginer réincarné sous la forme d’un chat sauvage à sa sieste de haute songeuse civilisation. L’éternité, jusqu’à la fin de l’après-midi, sera sa demeure.
Ce texte a paru initialement en décembre 1993 dans le numéro 491 de la Nouvelle Revue Française. Il a été repris en préface à l’anthologie parue à L’Escampette en 1995. -
Liquidation
…Tout doit disparaître, m’étais-je dit en caressant ses cheveux doux, c’était ma petite princesse égyptienne et deux mille ans et des poussière après cette aube au bord du Nil je reste toujours ému par son épaule affleurant les draps, dans le trépidement des avions, tout doit disparaître, me dis-je en me rappelant que nous avons passé la nuit dans ce putain de motel d’Atlanta, demain nous descendrons dans les tombeaux de la Vallée des Rois si le vol d’Egyptair ne se crashe pas, ma main prend la sienne comme pour la retenir, ses bracelets tintent doucement sous le drap bleu et j’oublie un instant que tout doit disparaître…
Image: Philip Seelen
-
Merveille des merveilles

D'un vers de Schlunegger, poète suicidé, et de L’Elégance du hérisson
Une paire de vers me revient tout le temps, qui m’est devenue comme un fragment de psaume se répétant malgré moi presque tous les jours:
Merveille des merveilles, sous le lilas fleuri
Merveille, je m’éveille…
C’est le poète romand Jean-Pierre Schunegger qui en est l’auteur, Schlunegger que je voyais tous les jours, lorsque j’étais collégien, sur la ligne 6 du trolleybus reliant les hauts de Lausanne au centre ville, Schlunegger qui me faisait l’effet d’une espèce d’ours russe doux en canadienne, avec sa serviette de prof et sa pipe éteinte, Schlunegger qui a vécu quelque temps dans le val suspendu de La Désirade, où il écrivit La chambre du musicien, Schlunegger qui s’est jeté d’un pont de la région, Schlunegger dont il ne me reste que ces vers :
Merveille des merveilles, sous le lilas fleuri,
Merveille, je m’éveille.
Le souvenir du lilas me revient ce matin à cause de la neige de pétales de camélia sur la mousse d’un temple de Kyoto, évoquée dans un film d’Ozu que cite Muriel Barbery dans L’Elégance du hérisson, au blanc de laquelle fait écho la neige de ce matin sur les monts de Savoie, de l’autre côté du lac aux eaux dormantes.
Et toute la poésie de ces choses infimes constituant la « merveille des merveilles » me revient aussi, tandis que j’écoute It’s only a Papermoon de Lester Young, en revenant à ces lignes que j’ai soulignées dans L’Elégance du hérisson (p.93-94) évoquant le rituel d’un inhabituel thé matinal de deux bonnes dames : « Ces instants où se révèle à nous la trame de notre existence, par la force d’un rituel que nous reconduirons avec plus de plaisir encore de l’avoir enfreint, sont des parenthèses magiques qui mettent le cœur au bord de l’âme, parce que, fugitivement mais intensément, un peu d’éternité est soudain venu féconder le temps. Au dehors, le monde rugit ou s’endort, les guerres s’embrasent, les hommes vivent et meurent, des nations périssent, d’autre surgissent qui seront bientôt englouties et, dans tout ce bruit et toute cette fureur, dans ces éruptions et ces ressacs, tandis que le monde va, s’enflamme, se déchire et renaît, s’agite la vie humaine. Alors buvons une tasse de thé… »
Et plus loin : « Où se trouve la beauté ? Dans les grandes choses qui, comme les autres, sont condamnées à mourir, ou bien dans les petites qui, sans prétendre à rien, savent incruster dans l'instant une gemme d’infini ? »
Et ceci, tiré des Sœurs Munakata d’Ozu : «La vraie nouveauté, c’est ce qui ne vieillit pas malgré le temps ».
Alors la concierge philosophe Renée, l’une des protagonistes de L’Elégance du hérisson, de conclure : « Le camélia sur la mousse du temple, le violet des monts de Kyoto, une tasse de porcelaine bleue, cette éclosion de la beauté pure au cœur des passions éphémères, n’est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous ? Et ce que nous autres, Civilisations de l’Ouest, ne savons atteindre ? La contemplation de l’éternité dams le mouvement même de la vie »…
Muriel Barbery. L’Elégance du hérisson. Gallimard, 359p. -
L'instant et le lieu

Entretien avec Pierre-Alain Tâche
L’oeuvre de Pierre-Alain Tâche, riche d’une trentaine de titres, s’inscrit dans la postérité romande de Gustave Roud et de Philippe Jaccottet, dont elle partage l’enracinement naturel et les résonances intimes, tout en s’ouvrant à d’autres lieux et harmoniques, à d’autres parentés aussi, latentes ou revendiquées, de Pierre Reverdy à Pierre-Jean Jouve, en passant par ces grappilleurs d’instants et de lieux que sont Charles-Albert Cingria ou Jacques Réda. Pour éclairer les tenants et les visées de son activité créatrices, le poète lausannois a bien voulu répondre à nos questions qui devaient englober, aussi, le statut actuel de la poésie.
- Comment la poésie est-elle entrée dans votre vie, avant que vous n’entriez « en poésie » ?
- Peut-être bien par la lucarne de ce galetas qui m’a tenu lieu de chambre, chez mes parents, dès mon jeune âge ! J’y contemplais, de mon lit, les étoiles, dont il me semblait entendre le chant libre et si lointain qu’il m’ouvrait tout l’espace. Car telle était l’aspiration de l’enfant que j’aurais voulu rester : rêver les yeux ouverts, jeter les cahiers au feu, dialoguer avec les oiseaux. Une aspiration confuse à la liberté de l’imaginaire : la poésie n’a peut-être d’abord été que cela - garante de cela.
Je me souviens de grandes journées d’été, au bord du lac ou à la montagne. La nature était comme une source : je m’y plongeais avec confiance, avec naïveté aussi, mais j’y cherchais déjà une respiration plus vaste. Il y eut quelques instants liés à un sentiment d’unité heureuse, de plein accord. Il y eut aussi les premiers émois. (C’est ainsi que je dis, aujourd’hui, mais je sais qu’ils ont laissé trace, qu’ils ont fini par susciter le désir d’écrire.)
Et les livres, direz-vous ? Les programmes scolaires m’ont fait découvrir Villon, Ronsard, du Bellay, La Fontaine - on aborderait, plus tard, Lamartine, Musset, Hugo, avant d’effleurer Baudelaire. Je lisais peu de poésie, à l’époque. J’avais fait quelques découvertes grâce à la modeste bibliothèque familiale : Les soliloques du pauvre de Jehan Rictus (j’ai songé à les imiter, sans vraiment passer à l’acte), Paroles de Jacques Prévert...Une culture populaire, en somme, pour un adolescent qui ne dédaignait pas les romans populistes. Et puis, un jour, ce fut Rimbaud - le séisme Rimbaud, qui n’a pas été causé par l’école. J’étais fier de ma découverte ; j’en portais le secret ; j’étais, d’un coup, entré en poésie. (Mais, c’est chez le José-Maria de Heredia des Trophées - on nous avait fait apprendre par cœur La Trebbia et Les conquérants - que je m’en fus - avec prudence ? - chercher mes premiers modèles formels !)
- Qu’est-ce qu’un poème selon vous ?
Un espace à aménager entre soi-même et « ce qui est », devant soi et, le plus souvent, comme au revers des choses ; un peu d’inconscient sauvé par la conscience, dans une forme à inventer, qui le recueillera ; une hypothèse informulée et pourtant attentive ; une tentative de jeter « par-dessus le vide les liens les plus robustes entre le réel palpable et décevant et le réel secret, fascinant, inaccessible » - et c’est Reverdy que je cite ici, me souvenant avoir mis ces mots en exergue de L’élève du matin, sans qu’ils aient pris une ride à mes yeux, depuis lors.
Mais, le poème est aussi le lieu d’un équilibre à conquérir, à ménager sur la page, par l’écriture ; un espace où la scansion, délivrée d’un formalisme étroit, doit trouver sans cesse sa justification, doit inventer quelque chose qui soit de l’ordre du chant. Disant cela, je ne néglige pas l’ambition d’un sens (à la condition qu’il soit dévoilé, plutôt que conquis) ; mais je veux indiquer qu’il n’y a pas, pour moi, de poésie sans musique.
- Quelles sont les sources de votre lyrisme personnel ?
- L’instant. Des instants. A travers eux, l’inattendu, l’imprévu - mais n’est-ce pas plutôt l’imprévisible, quand l’essentiel naît d’une association d’images ou de mots qui ne peut être pensée, quand l’enjeu, au moins dans un premier temps, n’est pas tant de dire que d’être dit ?
A travers eux, encore, des lieux, d’un bout à l’autre de l’horizon européen, dans l’épaisseur de leur humanité, de leur culture. Et puis, comme un enracinement plus profond du regard, en Anniviers, à la faveur d’une ancienne et durable connivence. C’est que les lieux ne se livrent pas volontiers au premier abord - et c’est pourquoi je refais toujours volontiers les mêmes voyages.Pour l’essentiel, donc, des paysages, des êtres, qui font que quelque chose advient qui rend possible, comme l’a bien vu Marion Graf, « une expérience conduisant au seuil d’une connaissance ». J’aurais pu dire : un don - lesté d’une interrogation, parfois d’une inquiétude, et pouvant ouvrir au mystère d’une présence qui s’offre (et je préfère ici me répéter pour ne pas trahir), « hors de toute limite et à profusion », pour qui consent à « la laisser respirer dans un regard désencombré ».
- Dans quelle parenté poétique, littéraire ou simplement humaine vous situez-vous ?
- Je serais bien sûr ingrat de ne pas reconnaître une dette envers Gustave Roud et Philippe Jaccottet. Je sais mieux ce que je leur dois aujourd’hui que ma reconnaissance peut s’inscrire dans une plus juste distance. On trouve d’ailleurs trace de leur influence dans mes premiers livres. J’aurai mis longtemps à m’en déprendre - non tant par goût du reniement (ce n’est pas mon genre !) que par besoin de définir, si possible, une aire qui m’appartienne en propre.J’ai commencé à y voir plus clair, me semble-t-il, après avoir lu Reverdy. La pratique jubilatoire de Cingria, la découverte d’Ungaretti, de Montale, puis de Pessoa, m’auront donné du champ - mieux : de l’espace ! Et puis, il y eut Pierre Jean Jouve - pourtant si fortement marqué par la faute, dont il m’aidera pourtant à m’affranchir ! Mais les rencontres décisives ont, à mes yeux, été celles de Jean Follain, en qui je reconnais un véritable maître, et, plus tard, de Jacques Réda, dont la voix généreuse (tous genres confondus) n’a cessé de me conforter dans l’idée que la poésie, n’est pas vouée au manque, à la perte, au peu, mais qu’elle est toujours prête à surgir où l’on ne l’attend pas, si l’on veut bien qu’elle y soit ! Je lui dois une bonne part de la liberté que je m’accorde.Je puis dire, aujourd’hui, que j’ai peine à imaginer une poésie exsangue, se refusant au foisonnement du réel ou se retranchant des circonstances de la vie (qu’elles soient graves ou légères) - et même de l’histoire ou du siècle ; et de tout ce qui peut concourir au déchiffrement qui lui incombe, qu’il s’agisse de textes littéraires, de musique ou de peinture…
- Y a-t-il, selon vous, une poésie qu’on puisse dire romande ? Et à quoi se reconnaît-elle alors ?
- On sait les esprits divisés sur la question. Le concept même de littérature romande aurait du plomb dans l’aile ! Dans une préface à l’anthologie parue chez Seghers (La poésie en Suisse romande depuis Blaise Cendrars, présentée par Marion Graf et José-Flore Tappy), Bruno Doucet,
s’autorise de l’avis de Jean Starobinski faisant état d’« un décalage fécond », à propos de l’écrivain romand, pour décrire ce dernier « comme inclus de plein droit dans la littérature d’expression française », mais revendiquant le « principe d’une différence essentielle ». Bertil Galland pouvait, en 1986, en déduire l’existence d’une poésie qui cherche à « vaincre l’isolement sans renoncer à l’intériorité qui lui est chère ». J’ai longtemps vu, dans cette particularité, dont subsiste des traces, la justification d’une différence. Je fus donc longtemps de l’avis - et contre celui de Mercanton, lequel se réclame de l’appartenance à une langue pour constater qu’il n’y a pas de langue « romande » - qu’il existe une littérature romande. Sans céder, pour autant, aux arguments polémiques que j’ai pu entende depuis lors, je ne suis pas sûr qu’une spécificité suffisamment marquée le justifie encore, s’agissant de la poésie qui s’écrit ici, aujourd’hui. Il resterait une commune appartenance à un pays. C’est peut-être beaucoup - et je revendique une différence : elle tient au fait que, décidément, je n’écris pas nulle part -, mais ce n’est plus suffisant. Sinon pour justifier la réalité d’une poésie en Suisse romande.
L’abolition d’une hiérarchie longtemps entretenue par nos voisins français relève-t-elle de l’utopie ? Je n’en sais rien. Je veux bien tenter d’y croire. Mais il faudrait, pour qu’elle advienne, que la poésie « romande » trouve en France une plus large diffusion, qui pourrait seule rendre vain le débat !
- Quelle place assignez-vous à la poésie dans l’univers de parole vilipendée qui est le nôtre ?
- Une place menacée, certes, par une parole de plus en plus confisquée au profit (c’est le cas de le dire !) du seul discours (politique, économique, technique) lié au culte de la consommation. Mais aussi, par contrecoup, une place comme assurée d’une légitimité accrue.
La poésie n’a que faire de l’avoir : elle est à l’écoute de l’être. Elle n’acquiert pas : elle accueille, elle reçoit - et en cela, déjà, ne participe pas « à la mise en spectacle de la réalité et à sa falsification ». Elle tend ainsi à préserver d’une déconstruction programmée la vérité, à laquelle il faut bien croire, tout en sachant qu’elle est affaire de convictions ; d’une vérité conçue comme un absolu qui pourrait bien être la face lisible de notre liberté (ou qui le deviendra). J’ai retenu les mots de Fabio Pusterla, parus dans ces mêmes colonnes. Il ajoutait : « Ce faisant la poésie s’avance naturellement à contre-courant, de façon parfaitement isolée et en semi-clandestinité ». Nous ne sommes pas loin d’une forme de résistance ; elle est rendue possible par le fait que « la poésie ne s’établit qu’en rapports individuels ». Sa force est d’activer d’autres circuits, de parier sur eux. On ne s’étonnera pas, cela étant, qu’elle représente pour tout régime politique, qu’il soit de gauche ou de droite, un potentiel de subversion qu’il finit par prendre en compte, dans des situations extrêmes. Le poète, alors, n’a d’autre choix que de devenir un témoin. Je ne crois pas me bercer d’illusions en affirmant que, sans en tirer gloire, nous sommes de plus en plus nombreux à nous accorder, aujourd’hui, sur ce point.
- Que pensez-vous de la pensée de François Cheng, selon lequel il ne saurait y avoir de beauté sans bonté ?
- Sous la plume d’un écrivain qui se définit lui-même comme « un homme sans prévention et sans cuirasse », la bonté devient une justification de l’être. Elle accède à cette dimension d’harmonie dont la beauté, me semble-t-il, est indissociable. François Cheng ainsi me paraît avoir cent fois raison. La beauté est un équilibre lumineux. Elle est donnée de l’intérieur. La bonté, alors, est le surcroît qui la manifeste. (On comprendra dès lors que je sois peu sensible à la beauté du diable !) François Cheng m’invite à poursuivre la réflexion ; à me demander qui ose encore, de nos jours, évoquer la beauté ? C’est, en tous les cas, une notion révoquée par le discours convenu des arts plastiques - pour lequel elle renvoie à une culture que condamne une idéologie à révoquer. Comme si une théorie avait pouvoir d’abolir une réalité. Allons donc ! S’il n’y a plus de place, sur cette terre, pour la beauté - alors même que je la vois partout présente, offerte -, ne serait-ce pas le résultat d’une confiscation ? Le mouvement qui nous porte vers elle n’a pas tari. On voudrait simplement nous faire croire qu’il ne peut plus être sous-tendu par une valeur morale positive. La négation, pour ne rien dire de la violence (dont je n’ignore ni ne néglige l’omniprésence), n’a pas pouvoir d’éradiquer la beauté qu’elles recouvrent, parfois, d’un voile sombre. Et puis, je crois, décidément, que le monde ne peut se passer de notre acquiescement et qu’il rayonnera toujours pour un regard empreint de bonté.
- Qu’aimeriez-vous transmettre par le truchement de votre œuvre ? Et qu’est-ce plus précisément que le « lieu » de votre poésie ?
- Vous parliez, au début de cet entretien, d’« entrer en poésie ». L’expression ne doit rien au hasard, qui renvoie au seuil qu’implique tout engagement, au pas qu’il faudra faire, à l’écart qui en résultera. Vous ne le savez pas, mais vous ne pourrez plus quitter cette voie. (Rimbaud demeure une exception !) Parce qu’elle est chemin de vie, qu’elle est indissociable de votre vie. Voilà pourquoi, sans doute, je n’ai pas vraiment l’ambition de transmettre autre chose que le poème lui-même - car la poésie est vécue en termes d’expérience et non en tant que message. Je voudrais prêcher par l’exemple, suggérer une complétude, donner des gages à ceux qui seraient prêts à s’ouvrir, à risquer, à tenter de voir. Je pourrais même, si cela devait avoir quelque sens pour le lecteur, agencer quelques éléments d’une poétique de l’instant. Je me situerais alors à cette intersection immatérielle de l’espace et du temps, où se joue notre pleine présence au monde ; parce que c’est là le « lieu » d’un instant absolu, qui nous relie à l’unité de ce qui est - au Tout, si l’on veut, et dans la seule éternité qui nous soit acquise. C’est, du moins, ce que j’aurai vécu, parfois - comme une brûlure inoubliable.
Ainsi, l’instant est-il, probablement, le vrai « lieu » de ma poésie. A moins que ce ne soit, en dernier ressort, le poème lui-même où, métaphoriquement, se mêlent, à la limite d’une lagune imaginaire, les eaux claires de l’inconscient et les courants obscurs du réel.

Livres
d’Heures
La lecture de Pierre-Alain Tâche est un croissant bonheur, et c’est dans la lumière limpide de celui-ci, après les régulières parutions récentes de Sur la lumière en Anniviers, L’intérieur du pays et Nouvel état des lieux, que nous publions ces poèmes à venir dans son prochain recueil intitulé Roussan, trente-troisième d’une œuvre inaugurée en 1962 avec Greffes, suivi de La boîte à fumée en 1964 et de Ventre des fontaines en 1967.
Il y a comme une suite enluminée de Riches Heures dans l’oeuvre de Pierre-Alain Tâche, qui serait à la fois d’un promeneur et d’un grappilleur de sensations, d’un amateur au sens fort de celui qui aime en ami et en amoureux, sous le signe d’Eros, d’un arpenteur des lieux et des arts, d’un veilleur aussi à l’attentive présence, d’un sourcier de vocables raffiné, parfois jusqu’à la rareté précieuse, que l’humour et la sagesse acquise ont de mieux en mieux porté au naturel et à la simplicité.
De la porte d’à côté aux plus lointaines balades, de son bercail lausannois où l’homme de la Cité a fait carrière de juge, aux lumières d’Orta, de Vienne ou de Vermeer, des moineaux du jardin aux chiens d’Argolide, Pierre-Alain Tâche multiplie son envol de poète, tel « celui qui veut vivre », dont Pierre Jean Jouve son pair avéré disait aussi : « celui qui unifie »…
LECTURES
CHOISIES
Ventre des fontaines. L’Age d’Homme, la Merveilleuse Collection, 1967.
L’élève du matin. Galland, 1978.
Le dit d’Orta. La Dogana, 1985.
Buissons ardents. Encres et dessins de Jean-Paul Berger. Empreintes, 1990.
Noces de rocher. Dessins de Martine Clerc. Empreintes, 1993.
Le rappel des oiseaux. Empreintes, 1998.
Reliques. La Dogana, 1997.
L’état des lieux. Empreimtes, 1998.
Chroniques de l’éveil. Préface de Patrick Amstutz. L’Aire bleue, 2001.
L’inhabité, suivi de Poésie est son nom et de Celle qui règne à Carona. Préface de Christian Doumet. Empreintes, Poche Poésie, 2001.
Sur la lumière en Anniviers. Fusains de Martine Clerc. Empreintes, 2003.
L’intérieur du pays. Préface de Christophe Calame. L’Age d’Homme, coll. Poche suisse, 2003.
Nouvel état des lieux. Empreintes, 2005.
Cet entretien et ses compléments constituent l'ouverture de la livraison d'été du Passe-Muraille, No 70.Un nouveau livre de Pierre-Alain Tâche, sa première prose de poète musicien, vient de paraître aux éditions Zoé, sous le titre de L'Air des hautbois.
-
Au Lamartine
Il ne faudrait pas se leurrer : l’inspiration,
ce n’est que souffle d’un ventilateur,
qui brasse un temps fané sur le comptoir
où sont des verres taillés, un siphon bleu ;
et l’air qu’il lisse agite des lauriers
que ne recherche plus la main d’Alphonse,
assis sur un rocher, dans la peinture.
Il a, depuis, tout un val à son nom,
sans compter Milly, si cher à son cœur
- et pourtant, c’est ici qu’il aime à méditer,
interpellant les buveurs de petits cafés,
qui ne savent de lui que cette plume immense
et trempée, sur le quai, dans l’encre du terreau,
lance fichée devant la double page
où les fleurs à venir signeront le printemps.Ce poème de Pierre-Alain Tâche est tiré de Roussan, paru aux éditions Empreintes.
Thierry Vernet. La bouteille d'eau. Huile sur toile.
-
Intimité
LE paradis est sous le drap du ciel. Le paradis est dans tes bras. Le paradis est dans la lumière tamisée de la chambre. Le paradis est dans l’orbe du jour. Le paradis est dans la nacelle du sommeil. Le paradis est ce matin gris suprême. Le paradis est une main sur une joue endormie. Le paradis est un regard qui s’éveille.
Le paradis est une femme au petit chien. Le paradis est une paire de petites filles pestes ou de garçons têtus. Le paradis serait que tout ça dure sans durer. -
Les fioles

Mademoiselle me les désigne sur la terrasse du Grand Hôtel de Berg am See, là où son Rainer Maria s’en venait lézarder.
A ce propos j’ai du mal à comprendre qu’elle en ait pincé pour ce furet déprimé, mais il devait avoir un truc à lui, ça je soupçonne.
Quant aux lascars qu’elle me charge de rabattre dans le cabinet aux fioles, elle les choisit d’un oeil plus que sûr, et c’est là que tu vois la salope, mais enfin tu sais ce que je pense d’un peu toutes.
Cela dit ce que j’en pense n’a pas de poids à côté de son argument massue, soit cent francs suisses au donneur et la moitié pour mes colles.
La situation étant ce qu’elle est même en ces lieux à milliards, je les amène facile, d’autant que la rumeur s’est répandue et que c’est quand même autre chose que le sang à la Croix-Rouge avec la spécialiste qui te trouve pas la veine.
Quand ils s’y mettent derrière le paravent, je leur raconte ce qu’elle fait des fioles et ça les épate. La rumeur fait état d’une espèce de vampire, mais c’est du charre. Je leur garantis qu’elle n’en a qu’au parfum de la chose; et j’en ai la preuve, vu que c’est moi, les fioles, qui les rince.
Peinture: Leonor Fini -
Schubert

Il/elle écrit à elle/il que son absence lui manque plus que jamais ce soir mais que tout à l’heure il y aura Schubert entre eux. Elle/il lui avait dit que Schubert était le musicien d’entre tous qui lui avait donné le sentiment d’écrire spécialement pour elle/il, et c’est dans ce sentiment qu’il/elle se remet toujours au piano en pensant à elle/il, plus précisément : qu’il joue pour elle/il, depuis sa disparition.
JLK : aquarelle d’après un motif de Stéphane Zaech -
Le cheval bleu pétrole

Les petits enfants
Les petits enfants qui tombent du balcon
Toute leur enfance défile dans leurs yeux
Elle est courte et ils s’ennuient même un peu
Alors ils regardent ce qui se passe autour d’eux
Ils s’échappent, ils volent devant les fenêtres
Ils disent bonjour
À tous les locataires
On les invite à venir prendre un verre
Ils disent d’accord mais ils ne restent qu’un instant
Poème d’Alain Bashung
Image : Frédérique Kirsch-Noir -
Le jardin suspendu

« Le palimpseste de la mémoire est indestructible »
(Baudelaire)
Ce que je vois d’abord est un jardin, et la maison dans ce jardin, et cette lumière dans la maison, mais la maison semble flotter au milieu de l’eau et c’est pourquoi je me dis que cette image me revient peut-être d’un rêve...
Ce rêve serait celui d’un premier souvenir, revenu par cette image peut-être resurgie d’un récit qu’on nous aurait fait de ce temps-là, mais le jardin sous l’eau relèverait d’une vision plus ancienne - je le comprends maintenant.
J’aurai donc anticipé : avant le jardin il y avait d’abord l’eau cernant la maison, à laquelle on parvenait au moyen de fragiles passerelles qu’à l’instant je me rappelle avoir souvent parcourues en rêve, tantôt au-dessus de l’eau et tantôt sur le vide angoissant, et le jardin n’apparaîtrait qu’ensuite…
Or, ces détails de l’eau et de la maison, des passerelles et du jardin relancent bel et bien le récit possible de tout ce passé que je retrouve à chaque nouvelle aube avec plus de précision : les passerelles sont faites de planches de chantier disposées sur des blocs de parpaing autour de la maison dont on achève les travaux; ensuite le jardin séchera, dont le grand pommier abritera bientôt le landau du nouvel enfant.
Et chaque détail en appelle un autre : tout se dessine chaque jour un peu mieux. On prend de l’âge mais tout est plus clair et plus frais à mesure que les années filent : on pourrait presque toucher les objets alors qu’on s’en éloigne de plus en plus, et les visages aussi se rapprochent, les voix se font plus nettes de tous ceux qui ne sont plus.
Tant de temps a passé, mais ce matin je les retrouve une fois de plus, ces visages et ces voix. Tout a été inscrit dès le premier souffle, pourtant ce n’est qu’à l’instant que je ressuscite ce murmure, ces voix au-dessus de moi puis autour de moi, ces voix dans le souvenir qu’on m’a raconté de ce jour de juin se levant, ces voix dans la confusion des pleurs de la première heure, ces voix et ces visages ensuite allumés l’un après l’autre dans les nuits suivantes comme des lampes à chaleur variable, ces visages étranges, ces visages étrangers puis reconnus, ces visages et ces voix qui sont comme des îles dans l’eau de la maison - et je note tout ce que j’entends et que je vois au fur et à mesure que les mots me reviennent.
Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver. Plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach que relance le dimanche matin une cantate de la collection Disco-Club de notre père, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs.
Cela sent le pain chaud et la chair d’enfant : cela sent mon grand frère qui est encore petit. Nous sommes dans l’eau de l’intérieur de la maison. La mère et le père sont indistincts, sauf par la voix et l’odeur, ou par le toucher des mains et des joues. Ce n’est que plus tard que le père sentira la cigarette Parisiennes et qu’à la mère seront associées les odeurs de cuisine ou de lessive ou d’eau de lavande le dimanche avant le culte. Pour l’instant ce ne sont encore que des ombres ou des lampes autour de moi. Et d’ailleurs que cela signifie-t-il : moi ? Ce n’est qu’après qu’on essaie de se représenter ce chaos originel et de l’arranger tant bien que mal. Pour l’instant on n’est qu’une oreille ou qu’un nez ou que des yeux au bout des doigts.
Tout est sensation, et plus tard seulement viendront les images et les mots et plus tard encore reviendront les sensations par les images et les mots. Mais comment tout cela-t-il vraiment commencé ?
Plus tard seulement me sera racontée l’histoire du serpent dans le jardin, du landau et de la terreur de la jeune fille, bien avant l’histoire de l’école du dimanche. Mais en attendant ce qui est sûr est que seule l’odeur de la pomme, dans l’herbe ou je la ramasserai plus tard sous le pommier qui sera le premier vaisseau de nos enfances, seule cette odeur me reste. Et peut-être, alors, mon culte des draps frais me vient-il de là ? Mon goût du vert sur fond gris et des églises silencieuses ? Mon besoin de tout réparer ? Je ne sais ce qui m’a été donné ce jour-là dans le landau menacé par le serpent : peut-être une conscience ? Une première intuition personnelle ? Mon impatience de tout expliquer ou plus exactement : de tout nommer pour séparer le clair de l’obscur et le dehors du dedans ? Que sais-je ?
Mon frère aîné, dans son pyjama de garçon, ne sera jamais freiné par aucune question. Mon frère est un soleil, constate-t-on en ces années de guerre, mon frère se lève dans son parc et parle à tort et à travers, mon frère agit et ne se regarde pas. Mon frère ne sera jamais pour moi que cette question qu’il n’a pas voulu se poser. Lorsque les cendres de mon frère ont été dispersées dans le Jardin du Souvenir, j’ai ressenti cet abandon du Nom comme une atteinte personnelle, mais aurai-je jamais rencontré mon frère ?
Au milieu de la maison, donc au cœur de l’eau, se trouve le fourneau de fonte qui a l’air d’un cuirassier à l’ancre et dont la porte est percée d’un hublot de verre dépoli par lequel on voit la lueur du feu.
On sait que le feu est un danger, mais ce n’est pas ce qui fait le plus peur, tandis que les hommes noirs venus de dehors et qui transportent les sacs de charbon à travers la maison, noirs sous leurs capuchons baissés, sont aussi effrayants que la menace, pour les enfants, d’être enfermés un jour ou l’autre dans la cave à charbon.
Le mot DEHORS évoquera longtemps un monde mystérieux où s’affairent les pères et les oncles. Dehors il fait encore nuit, en hiver, au moment où les pères et les oncles franchissent le seuil des maisons avant de réapparaître le long des routes enneigées ponctuées de réverbères jaunes, soufflant chacun sa buée ou sa fumée de cigarette pendant que, dedans, les mères et les tantes remettent du charbon ou du bois dans les fourneaux.
En ce temps-là, les mères et les tantes restent dedans à s’occuper de leur ménage et des enfants qui demandent plus de bras qu’on en a - surtout quand il y en a quatre, ne manque de relever notre mère, et nos tantes en conviennent.
Notre mère n’a que deux bras, mais il lui en faudrait quatre fois plus et quatre fois plus d’argent pour nouer les deux bouts même si notre père fait son possible pour en ramener à la maison à la fin du mois. Notre mère et notre père se saignent pour nous, aurons-nous entendu dès ces années, en attendant que notre mère nous serine que jamais nous n’avons manqué alors qu’il y a tant de misère de par le monde et même chez nous.
Le mot DEDANS signifie qu’on est à l’abri ; chez nous, mais à l’abri de la misère, et la marque Le Rêve, en lettres anglaises peintes sur l’émail bleu du potager à bois jouxtant la cuisinière électrique, me revient comme un emblème des heures passées dans la chaleur odorante des matinées d’hiver à la cuisine, avant les années d’école.
C’est là, juché sur une sorte de haute chaise articulée et transformable en siège roulant, que j’entreprends mon attentive scrutation des choses et des gens. Le potager à bois marqué Le Rêve en est un bon départ, et les préparations culinaires de ma mère ne cessant en même temps de dire : vite il me faut faire ceci, schnell il me faut faire cela. Le potager est une sorcière et ma mère est la fée en tablier du logis. Plus tard j’identifierai les hautes pattes du potager Le Rêve à celles de la sorcière Baba Yaga dont le trépignement, à en croire mon grand frère, se fait entendre dans la forêt proche qui s’étend jusqu’en Russie où vient de s’éteindre le Petit Père des Peuples. J’aurai donc cinq ans à l’arrivée de Baba-Yaga du fin fond de la taïga, mon frère en comptera cinq de plus : plus que l’âge de raison, même s’il reste sensible à la férocité chatoyante des contes russes et se réjouit de m’en effrayer à mon tour en me les racontant dans le noir.
C’est comme ça qu’il me raconte, dans le noir, l’histoire des deux Ivan, le petit et le grand, deux frères comme nous, le petit qui rêve et le grand qui vole.
Le petit Ivan vient de s’endormir quand il voit le grand Ivan, appuyé à un rayon de lune, qui lui propose de l’emmener sur l’île où tout est possible, et tout aussitôt le petit Ivan, qui a répondu oui-da, se sent emporté dans les airs par le grand Ivan qui lui recommande de s’accrocher. Sur l’île où tout est possible, les deux premiers défis sont relevés par le grand Ivan, qui allume un feu pour y brûler son ombre avant d’y griller trois poissons qu’il n’a pas pêchés. Mais tout se gâte ensuite lorsque le petit Ivan prétend qu’il voit toujours l’ombre du grand Ivan et que les poissons n’y sont pas, sur quoi la pluie s’abat sur le feu du grand Ivan tandis que le petit Ivan, qui a sorti sa flûte de jonc, en joue pour faire cesser la tempête, au dam de son frère qui défie alors Baba-Yaga, surgie de son ombre, de montrer au petit Ivan de quel bois elle se chauffe. Baba-Yaga se chauffe au bois de mon grand frère, mais un jour mes larmes me sauveront la mise comme elles sauvent la vue de Michel Strogoff avec lequel je reviendrai en Russie bien plus tard.
À chaque aube me revient, du fond du corps, cette angoisse irrépressible qui est peut-être une affaire d’âge, et qui se dissipe avec le premier café en réactivant alors, étrangement, de très anciennes hantises de cataplasmes et de ventouses administrés à l’enfant cloué à plat ventre.
Comment a-t-on pu vivre dans ce tout petit corps de mollusque, et supporter tant de tribulations, et s’en relever si crânement ? Mais avant : comment est-on sorti de l’eau de la nuit sans crever de cet effroi ? Et ensuite, comment a-t-on franchi l’escalier de pierre séparant le dedans de la maison du dehors sans tomber dans le vide qu’on imaginait ?
A mesure que l’angoisse du fond du corps me surprend à chaque aube de plus, s’aiguise l’épée du mot qui me défendra des poignards du souvenir, et je ne parle pas que du souvenir des maux de la première heure qu’évoque l’expression faire ses dents, mais de tout ce qui fait cette planète de douleurs où cataplasmes et ventouses vont de pair avec soif d’enfer ou faim de lait, canicules de fièvre ou frissons glacés des épidémies familiales ou mondiales ; puis le café de l’aube me ramène à l’apaisante onction des mains de mères ou de tantes, aux matinées des petites convalescences.
Le mot CLAIRIÈRE me vient alors, avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait que matérialiseront les biscottes et la tisane du rescapé.
La neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit, mais à présent il est temps de ne plus subir à plat ventre les cataplasmes et les ventouses : c’est l’heure de se lever dans le parc que ma grande sœur vient de quitter en se dandinant comme une canette pour se diriger toute seule vers l’autre monde que désigne le mot dehors ; c’est l’heure de se mettre à tomber.
Il faut tomber longtemps, avant de tomber sur sa propre image dans un miroir, pour s’apercevoir que le Nom qu’on entend prononcer correspond à ce que désigne le mot CORPS qui ne sera jamais bien clairement défini ni bien distinct de ce que désigne le mot ÂME. Or, on avance à tâtons, et chaque aube on retombe dans cette même difficulté d’exprimer ce que signifie le mot CELA, comme tout enfant lorsqu’on regarde une lettre inscrite sur un cube, dans son parc, puis une autre, puis d’autres encore dans la soupe aux lettres ou sur les affiches, et ces lettres accolées forment des mots et ces mots sont déjà des sortes de choses.
Qu’est-ce que CELA ? Cela seul à vrai dire, cette question et ce mystère, ce besoin de savoir et d’irradier ensuite me fait revenir avant chaque aube à ma table avec autant d’incertitude attentive que de curiosité de l’âme et du corps, puis de satisfaction du corps et de l’âme, comme à consommer une fusion ou une effusion – cela seul me lance en avant comme la première semence lance en avant l’impubère qui se demande devant son premier sperme : mais qu’est-ce diable que cela ? Où s’arrête mon corps ? Tiens, l’odeur de ma petite sœur n’est pas la même que celle de mon grand frère ! Celui-ci sent plutôt le fromage frais, celle-là plutôt l’abricot, comme notre mère sent le matin la pommade Nivea et notre père la fraîche eau de Cologne 4711.
Cela forme un premier cercle contenu dans le carré du petit parc délimitant le premier territoire où nous tombons, lui-même contenu dans le dédale de pièces et de couloirs et d’escaliers et de retraits de la maison, elle-même contenue par le quartier et le quartier par la ville et la ville par le pays et le pays par les autres pays et les autres pays par le monde et le monde par la mappemonde du Petit Larousse dans lequel je tomberai quand je serai sorti du parc, et le ciel désigné par le mot LÀ-HAUT désigne aussi la demeure de celui que désigne le nom de Dieu, censé contenir tout ça.
Le mot CELA est le premier entonnoir de tous mes vertiges d’enfant et d’adolescent : il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.
Dieu te voit. Dieu t’écoute. Dieu te protège. Dieu te punira, si. Dieu va te récompenser, si. Dieu ne sera pas content, si. Dieu sera triste, si. Le bon vieillard chenu. Le proprio pas content. L’œil dans un triangle. Le doigt pointé. La voix. Le juge suprême. Celui qui nous attend LÀ-HAUT.
Alors que devant le mot CELA je reste seul et muet, comme si je me voyais moi-même sans miroir, de dos ou du dedans, visible les yeux fermés ou invisible à l’œil nu.(Extrait des premières pages de L'Enfant prodigue, récit achevé en 2009)
-
Trois histoires de rivière

Par Daniel Vuataz
Les époux
Ils avaient quitté père, mère et les cloches battantes du Clos de la Chapelle pour s’enfoncer dans les bosquets, leurs nouvelles bagues à l’annulaire. La rivière coulait lente, charriait d’heureuses promesses. Lui, il ouvrait la marche, écartant pour elle les herbes les plus hautes, lui indiquant sur quelles pierres marcher. Elle, elle remettait de côté sa vaste chevelure rousse, retroussant ses jupes pour ne pas toucher les marécages. Ils trouvèrent du soleil à deux pas d’un pré jaune et posèrent leur en-cas sur un tronc bouturé. De la terrine de lapin. Elle le questionnait sur le cri du lapin, sur son nom, sur le fait que personne ne l’entende jamais, même quand on leur tord le cou. Sans répondre il posa, sur sa bouche étonnée, son doigt gourd qu’il remplaça rapidement par ses lèvres. Elle trouva le goût musqué, salé, comme celui des grands cerfs, et avant qu’elle ne le remarque, il avait introduit sa langue. Elle lui demanda des yeux s’il l’aimait comme elle l’aimait, s’il ne la laisserait jamais tomber, mais il ne bougeait presque pas, ses paupières closes au soleil, sa langue contre la sienne. Elle se dit qu’il fallait bien s’abandonner à quelqu’un un jour ou l’autre, qu’il fallait bien essayer. Elle tira doucement sur les laçages de sa robe, sans qu’il ne bouge ou ne semble rien remarquer. Quand elle fut nue, elle voulut qu’il prenne un peu de recul pour qu’il la regarde en entier et la désire, mais des nuages passèrent sur la clairière, et quand elle parvint enfin à se décoller de ses lèvres séchée, il sentait déjà le mort. Elle le posa raide et pâle sur l’herbe noire et entama la terrine, vaguement attristée à l’idée qu’il lui faudrait encore attendre un peu pour trouver un mari qui convienne vraiment à sa nature.
L’autre
Le plus grand des trois portait le sac et ce qu’il contenait. Le plus petit des trois fermait la marche en jetant régulièrement des regards derrière lui. Celui du milieu effleurait la surface rapide de la rivière avec un grand jonc, ne faisant presque pas bouger l’eau. Le plus grand des trois changea d’épaule le sac et ce qu’il contenait. Le plus petit essaya de chanter une comptine, mais aucune ne lui vint. Celui du milieu trouva que le ciel était assez inhabituel. Les trois s’arrêtèrent en même temps au bord d’une mare sombre que faisait sur la rive la rivière trop rapide. Le plus grand déposa doucement le sac et ce qu’il contenait sur la berge sablonneuse. Le plus petit chercha des yeux celui du milieu, mais celui du milieu était déjà dans la mare, de l’eau noire jusqu’aux genoux, tremblant et suppliant. Le plus grand lui dit de ne pas tenter de discuter, que ça ne servirait à rien, qu’il n’était pas fait pour cela. Le plus petit répéta exactement les mêmes mots que le plus grands, dans un ordre légèrement différent. Celui dans la mare commença à sangloter, répétant que ce n’était pas juste. Les deux autres prirent leurs yeux menaçants. Celui dans l’eau se calma, mit sa tête dans ses mains et recula jusqu’à ce que l’eau lui monte aux épaules. Le plus grand sorti le revolver du sac et le pointa sur la tête du garçon dans l’eau, lui disant tout bas qu’ils n’étaient pas du tout obligés d’en arriver là. Le plus petit vérifia que personne d’autre ne les avait suivis. Le plus grand appuya du pouce sur le chien du revolver. Le plus petit se boucha les oreilles mais garda les yeux grands ouverts. Celui dans l’eau plongea d’un coup et disparut sous la surface noire de la mare. Les deux autres observèrent un moment la créature palmée nager en cercles près de la surface de l’étang, sa crête ne faisant presque pas bouger l’eau. Le plus grand désamorça le revolver et dit au petit de le suivre sur le chemin du retour. Le plus petit jeta un dernier regard à la mare immobile. Plus jamais, c’est sûr, ils ne ramèneraient un de ces grands œufs que personne au village n’avait été capable de reconnaître.
Le roi du village
La troupe entière quitta l’église au petit matin, pain, sel et viande séchée répartis dans des sacs. Ils longèrent en cérémonie le Rio du Village en direction du fleuve, dans lequel se jettent toutes les rivières. Comme d’habitude, ils s’arrêtèrent dans un grand bois à chevreuil, là où se trouve la pierre debout. Un type se coiffa d’une couronne de bois mort et se mit debout sur la pierre debout.
-Vous savez ce qu’ils nous feront s’ils nous trouvent ? dit le type debout sur la pierre debout, tournant le dos à la rivière.
Les autres types ne répondirent pas.
-Vous avez une idée de la taille de leurs membres ? repris le même type, la voix de plus en plus sûre.
Les autres produirent des estimations avec leurs bras, hochant la tête apeurés, consultant du regard les idées alentours.
-Vous connaissez la vraie différence entre nous et ces autres types ? continua le type, debout sur sa pierre debout, écartant les mains, se voulant important.
-Nos coutumes ? osa un petit type au fond de la troupe.
-La civilisation ? ajouta un autre type un peu roux.
-La technique ? essaya un grand type tout défait.
-Notre église, nos trésor ? fit un type que le type principal ne put réussir à repérer dans la masse qui se resserrait lentement autour de lui.
-Vous n’y êtes pas ! lança le type principal. La différence, c’est que nous m’avons moi ! La différence, c’est qu’avec moi vous aurez un guide à suivre et à aimer ! Je suis le roi des types ! Choisissez-moi ! Et il gesticulait debout, sur sa pierre debout.
Les types de la troupe échangèrent quelques regards, et se penchèrent pour ramasser des pierres. Le roi des types tomba dans l’eau dès la troisième pierre, sans que personne ne sut jamais qui avait lancé la première, et le courant fut rouge quelques instants. Quelques -uns des types fouillèrent la rive avec des grandes perches. D’autres eurent des jurons généalogiques. Tous les types reprirent les victuailles qu’ils n’avaient pas touchées, et rentrèrent au village en silence. Le jour suivant, encore une fois, il faudrait recommencer. Le danger était bien présent, on ne pouvait plus faire autrement. Les signes finiraient bien par se manifester en faveur de quelqu’un.
Ce triptyque de Daniel Vuataz, 23 ans, étudiant en lettres à l’Université de Lausanne, est à paraître dans Le Passe-Muraille No 80, le 20 décembre 2009.
-
Chappaz l'émerveillé
Le dernier livre, posthume, de Maurice Chappaz
« Je dis ma disparition… », écrit Maurice Chappaz dans le dernier livre qu’il écrivit entre juin 2008 et janvier 2009, interrompu par sa mort , le 15 janvier 2009, et dont 3 chapitres sur 5 viennent de paraître chez Fata Morgana, intitulés Le roman de la petite fille.
« Voici une heure que je rédige des lettres à des camarades dans l’existence. Sur une enveloppe j’écris le nom d’un ami qui dort au cimetière.
« Pour un peu je mettrais l’adresse du cimetière.
« Ce qu’on fait avec plus d’intelligence quand on prie ».
Maurice Chappaz ou l’intelligence faite poésie : le même pour l’essentiel à passé nonante ans qu’à son premier écrit septante ans plus tôt, intitulé Un homme qui vivait couché sur un banc, je veux dire : le même qui prie et fume, dans la prose la moins fumeuse qui soit : nette et fluide, dansante d’image en image, candide et poreuse, fondue dans le murmure de la nature en laquelle le poète voit partout Dieu. On le retrouve d’abord «à quelques pas de sa maison natale qu’on appelle l’Abbaye », écoutant « avec une joie secrète » l’eau d’une fontaine. « On dirait des diamant qui chantent », notera-t-il tout à l’heure sur une des enveloppes qui lui serviront de papier brouillon où écrire ce livre : « Ce sont les paroles des grandes forêts sombres où se cachent les sources ».
Le tout vieil homme se sait « vers la fin de sa vie », comme on le sentait déjà en tourbillon dans La pipe qui prie et fume, et ressaisit tout ce qui a été dans tout ce qui est et sera, subissant certes un « séisme » physique et mental mais qui « dépasse le désespoir car on s’aperçoit que la vie est un inconnu où l’on va disparaître et se fondre. Ou peut-être s’accomplir tant la vie dépasse toujours la vie ». Et ceci qui traduit si bien son esprit d’enfance inaltéré : « C’est ça la vieillesse : on s’y noie comme dans un berceau. »
 À la toute fin de sa vie, le vieil homme subit des crises d’asthme, soulagées par une médication miracle que ne connut pas sa seconde épouse Michène, atteinte de ce mal vers sa troisième année. Michène se relevant la nuit pour le soulager, lui raconte ainsi ce souvenir d’enfance, et, de fil en aiguille, son enfance et sa mère, le Québec et sa tribu,: voici donc le roman de la petite fille à travers ses aïeux – les Albert et les Rivière, figures quasi mythiques - , le roman de Michène à fines touches et méandres, comme ceux d’un fleuve. On partira de la Grande Guerre et de migrations, d’entreprises humaines et de fâcheries puis de réconciliations, pour arriver aux tribulations de la mère et de l’enfant, entre pénurie et jeux enfantins. « Ma vie va finir. Ces jeux qui balancent le premier âge de mon épouse servent de rame à mes derniers jours. Je me suis embarqué ».
À la toute fin de sa vie, le vieil homme subit des crises d’asthme, soulagées par une médication miracle que ne connut pas sa seconde épouse Michène, atteinte de ce mal vers sa troisième année. Michène se relevant la nuit pour le soulager, lui raconte ainsi ce souvenir d’enfance, et, de fil en aiguille, son enfance et sa mère, le Québec et sa tribu,: voici donc le roman de la petite fille à travers ses aïeux – les Albert et les Rivière, figures quasi mythiques - , le roman de Michène à fines touches et méandres, comme ceux d’un fleuve. On partira de la Grande Guerre et de migrations, d’entreprises humaines et de fâcheries puis de réconciliations, pour arriver aux tribulations de la mère et de l’enfant, entre pénurie et jeux enfantins. « Ma vie va finir. Ces jeux qui balancent le premier âge de mon épouse servent de rame à mes derniers jours. Je me suis embarqué ».Comme dans toute l’œuvre, les images scintillent et sonnaillent en roue libre : « Le tram musiquait dans les rues avec son petit bruit de ferraille et de porte-monnaie. » Comme dans La pipe qui prie et fume, le texte respire la vie bonne : « La mort qui s’approche donne déjà à notre vécu cette dimension inconnue. Il y a de quoi être émerveillé et effrayé d’avance. On fait sa provision d’éternité sans s’en rendre compte. Tous les jours »
Comme une lettre du Paradis écrite les pieds sur terre et qui nous retombe du ciel en pluie vivifiante de mots radieux…
Maurice Chappaz. Le roman de la petite fille. Fata Morgana, 65p. Et pour mémoire : La pipe qui prie et fume, Revue Conférence.
Image: Maurice Chappez et Michène, sa seconde épouse, en Laponie.
-
Adieu poète

Deux poèmes de Maurice ChappazComptine des poètes absents
Revenez, revenez du futur
mélancoliques frères,
revenez à la pluie quotidienne,
revenez vous abriter sous l’auvent,
allons prenez de l’embonpoint
comme les curés, les passe-crassanes,
ne bougez pas au soleil.
Laissez flâner la pluie
sur l’écorce.
Vous êtes toujours loin,
vous allez chez les morts,
vous parlez aussi à des bonshommes
qui ne sont pas encore nés.
Mais vous risquez de perdre en route
votre sac plein d’âmes.
Et de sécher au lieu de mûrir.
Envoyez-nous une carte
d’Assise ou d’Egypte.
Priez je vous le dis
toute la nuit.
Tuez les mots
pour faire naître les images
et puis sacrifiez les images
pour connaître le sens.
Et si votre espace intérieur
ne se remplit d’univers
revenez, revenez, insensés…
à la petite maison
et aux bons poiriers.Le Litre d’ombre
Sur la table
un nuage dans un litre,
je ne désire rien de plus.
Mais l’épicier du coin,
les temps sont durs,
a dû devenir espion pour vivre.
Oh ! je ne comprends pas,
J’étudie beaucoup ;
en chemin j’ai rencontré deux marguerites
dans le jardin de l’hôpital.
Elles me disaient : « Ils n’ont pas supprimé la Mort
Vêts-toi de blanc
et sois tendre malgré tout,
nous sommes des fleurs de là-bas,
la patrie que nul n’aperçoit :
… c’est la terre ».
Rues et rues, étoiles bouillantes.
L’apostrophe des motos !
L’eau de l’évier
sur la motte de beurre en chaleur.
Qu’est-ce que l’amour ?
Depuis que ce quartier a été bâti
je me retourne dans mon lit :
partout la violence du rat.
Je désire dormir,
je désire ne pas être.
De ma fenêtre
les garages montent au ciel,
les librairies-pâtisseries
voisinent avec les fabriques de marteaux-pilons.
Elle bourdonne, notre ruche !
et dans la millième alvéole : un poète
Un seul mot sur sa feuille de papier :
Silence !
Je suis chanoine à l’Eglise de Saint-Ogre ;
Je suis gros et gras ;
Je cultive mes immeubles locatifs.
Dieu n’existe pas
mais le journal et le chocolat glacé.
M.C.
Maurice Chappaz. Pages choisies II. L’Age d’Homme, Poche suisse, no145.

-
Le grand art de l’oiseleur

« L’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini », écrivait Cingria, auquel Jacques Chessex consacre une pièce d’Allegria sous le titre de Petite ode à saint Charles-Albert « qui sut happer la bonne manne/A tout bout de ciel ouvert ».
Or c’est sous le même « ciel ouvert » et devant le même « infini », au gré des mêmes allées de forêts bruissantes ou de bibliothèques savantes, abreuvés aux communes sources du goût et de la pensée, parfois aussi sur le même pas « rythmé comme un air de jazz nègre » qu’évoluent ces deux écrivains habités par une parente inspiration qu’il faut bien dire mystique, en dépit de multiples malentendus relancés par la dernière mode.
A ce propos, il convient illico d’exonérer Le désir de Dieu du soupçon d’appartenance à tout un brouet religieux ou parareligieux remuant dans la marmite faitout du New Age, où mitonnent rogatons de spiritualisme et vertus accommodées à la sauce humanitaire. « La vertu fume, crache, lance du foutre et assassine », écrivait aussi Cingria pour opposer le courage créateur du poète (« celui qui fait ») ou du fou d’amour au moralisme vétilleux des « dames aux ombrelles fanées par les climats qui indiquent ce qu’il faut faire et ne pas faire » ; ou pour distinguer la foi qui renverse les montagnes et capture les tigres du sempiternel scepticisme des gens qui ont « les pieds sur terre » et détestent les songe-creux et autres saute-ruisseaux.
D’emblée Chessex se dit « plein de Dieu » dans ce livre reprenant en fugues et variations tous les thèmes fondamentaux de son œuvre, savoir : l’étonnement initial d’être au monde et la découverte des mots, l’intuition précoce de la mort et la prescience du mal, le vertige du sexe et ses turbulences contradictoires de réserve coupable et de défi blasphématoire, la fascination pour un vide qui serait à la fois une plénitude qu’investit le souffle à la manière orientale, le miel du monde et ses infinies modulations, le rêve du monumentum artistique cher à Flaubert et la consubstantielle conscience de sa vanité - et passent le jour terrestre et ses messagers ailés, tel celui d’Allegria: « Comme Oscar Peterson égrène ses notes/D’eau fine de cascade de nocturne source/Toi fauvette au bois du cimetière/tu me parles/ Dans la douceur d’être vivant /devant la mort ».
Il niche plein d’oiseaux dans le Dieu de Chessex, mais il y a Job aussi et sa « première mise en cause de Dieu comme Infini et Parfait », il y a l’intelligence du « credo quia absurdum » (je crois parce que c’est absurde) d’Augustin et de Nicolas de Cues autant que la bouche cousue d’Arsène Père du désert, la rhétorique théologique trop bien huilée d’Huysmans autant que la béance surabondante de Flaubert, les cris d’Artaud ou les transes furieuses de Bataille en sa « dévotion inversée » de scrutateur de cons et de culs, rapprochées par Maître Jacques des injonctions disciplinaires de Loyola , et voici le tout jeune amant à genoux goûtant le « miel de l’ours » au secret de la jeune fille, ou voilà le lettré prolongeant sa méditation esquissée avec les bons pères de Fribourg chez Sponde ou Bossuet, dans les jardin de Dubuffet ou auprès des chairs écorchées de Soutine et de Bacon.
Il y a dans Le désir de Dieu, comme dans L’Imparfait, autre merveille, mais en plus ample encore et en plus libre, parfois en plus fou, une sorte de pensée-chant qui revisite l’idée de Nietzsche d’un dieu danseur, avec des « impros » évoquant aussi le tourbillon sur place des derviches ou les incantations « en langue » des allumés de la Bible.
Qu’il parle de la maison de ses pare
nts déchirés (dans Come away with me) ou de sa mère dans l’émouvant chant d’Allegria dédié à celle-ci, du mystère de notre présence ici-bas et de l’immanence de la « perpétuelle apparition jaillie », du néant qui nous attire comme un repos de loir et de tout ce qui repousse sur « terre et cendre », du tocsin en nous du nom de Golgotha et de ce « nœud obscur » s’abandonnant à l’ouvert de Pâques, l’oiseleur danse autant qu’il pense, chante autant qu’il énonce, « et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini ».
Jacques Chessex, Le désir de Dieu. Grasset, 358 p.
Jacques Chessex, Allegria. Poèmes. Grasset, 145 p.Dossier spécial Jacques Chessex. Le Passe-Muraille, no 75. Mai 2008.
-
La vie à la venvole

Lettres aux hirondelles de Ramon Gomez de La Serna
C’est un constant et croissant, allègre et profond bonheur que nous vaut la lecture des Lettres aux hirondelles de Ramon Gomez de La Serna, treize en tout et rédigées à chaque retour de printemps. L’inépuisable sourcier d’images y déploie, avec une verve et une ferveur sans pareilles, toute sa profuse et baroque fantaisie inventive, laquelle n’est jamais d’un artificier brillant pour briller, tant l’éloge qu’il fait de la vie est lié chez lui à l’amour de celle-ci et de toutes ses manifestations, en toute connaissance de sa face d’ombre.
Dans son Prologue, Ramon annonce la couleur du livre qui manifestera « une aspiration spirituelle », dit-il, « vers tout printemps à venir », et tout aussitôt les images lui sortent du chapeau en vols virevoltants, comme autant de greguerias.
Dans la foulée, il faut alors rappeler ce qu’est la forme la plus caractéristique de l’art du poète, combinant une métaphore et une pointe d’humour dans une sorte d’aphorisme lyrique, de « fusée » ou de haï-ku non versifié.
Premier exemple de gregueria tiré de ce même Prologue : « Les hirondelles imitent de leurs cris et de leurs sifflements les coups de frein des autos quand elles retiennent leurs quatre roues au seuil de l’été ».
Deuxième exemple : « L’hirondelle se baigne un instant dans l’eau comme la main qui frôle le bénitier puis trace le signe de croix de son vol ».
Troisième exemple : « L’hirondelle qui, rapide, passe le coin de la rue semble apporter dans son bec une épingle à la dame qui en a besoin de toute urgence ».
Quatrième exemple : « Trois hirondelles arrêtées sur le fil du télégraphe forment la broche de la soirée. »
Cinquième exemple : « Les hirondelles ouvrent les pages des livres purement contemplatifs comme d’incessants coupe-papier ramenés d’Alexandrie ».
Sixième exemple : « L’hirondelle réussit à aller aussi loin parce qu’elle est la flèche et l’arc à la fois ».
Et septième exemple puisque tout va par sept au matin du monde : « L’hirondelle est une écriture, bâtons et virgules réunis par la plume pressée du scribe espiègle du destin ».
Et c’est parti à cent vingt-cinq à l’heure (vitesse de pointe de l’hirondelle) pour un festival qui réunira toutes les variétés d’arondes, des ailes bouclées aux arboricoles en passant par l’américaine et le martinet bleuté, pour brasser large et dire leur « poésie sans contenu, belle dans sa manière de distraire et de dissuader des rachitiques et mesquines idées d’argent qui cherchent à remplir l’âme contemporaine ».
De fait il n’y a rien de gratuit ou de futile dans ces lettres, même si les hirondelles sont dites « les moustaches et les barbiches du ciel ».
Car il y a ceci de plus essentiel : « On dirait des bêtes mais ce sont des âmes, des prête-noms, des exécutrices testamentaires, des marraines volantes ».
Toute la poésie, débonnaire d’apparence et divinement poreuse en réalité, de Ramon Gomez de La Serna, fuse et quadrille le ciel de la page dans une suite de pensées-images aux résonances infinies : « Vous êtes comme un vertige d’aiguilles de pendules pointées, libres et emportées par le vent en un tourbillon d’heures aiguës et vous avez quelque chose à voir avec la rapidité du temps, en créant votre hirondellesque remue-ménage. Le doigt de Dieu fait bouger les ailes et les queues effilées à l’heure exacte.
« Je vous écris parce que vous n’avez pas de consigne et que vous ne vous laisserez pas prendre dans de viles polémiques, dans des questions de centimes. Vous êtes une eau apaisante pour la soif de folie, la soif la plus difficile à étancher que vous êtes les seules à calmer, en vous déplaçant sous la dictée de ce qu’il n’y a pas à expliquer ni à s’expliquer ».
« Je vous vois avec vos gilets de chambellans barrés d’une écharpe, et je sais que vous êtes de petits êtres romantiques qui vous promenez dans la roseraie du ciel ».
« Sur le mont Calvaire vous avez ôté ses épines au Christ et, depuis lors, votre bec est comme l’épine de la chance, bien que sur votre bouche soit resté le rictus déchirant de cette douleur. »
Il faut savoir gré à l’éditeur marseillais André Dimanche, et à Jacques Ancet pour sa traduction et sa lumineuse introduction (où sont notamment rappelés le sens du recours à l’épistole et les circonstances de la composition du recueil, dès 1936 en Argentine), qui nous offrent cette édition regroupant les Lettres aux hirondelles et les Lettres à moi-même, d’une tout autre tonalité, plus grave et mélancolique – et j’y reviendrai sous peu comme au Torero Caracho qui paraît simultanément.
Nous sommes un lundi au ciel d’hiver déserté depuis longtemps par les hirondelles, mais celles-ci sont le gage même du « tout continue ».
« Le printemps tout entier amène un cornet d’hirondelles et l’ouvre pour qu’ait lieu ce magique repeuplement du ciel qui proclame la continuité de la vie par-delà la continuité de la mort »…Ramon Gomez de La Serna. Lettres aux hirondelles et à moi-même. Traduit de l’espagnol et présenté par Jacques Ancet. André Dimanche éditeur, 191p.
-
L'enfant à venir
Le jour est bien levé et lavé maintenant, ce matin de Pâques et du retour à ce qu’on dit les beaux jours, pleins de fiel et de sang. Un fond de bleus et de bruns terreux, travaillés par les années, un fond de verts et de terres à lents glacis, un fond de litanies en mineur, un fond de douleurs retournées et d’incompréhensible gaîté tisse la page de plus qui se déploie à l’instant et nous écrit.
La page qui nous écrit, dès cette aube que vous croyez pure, est irradiée et mortellement avariée par les sbires du Planificateur. Or Mozart est solide en bourse ce matin. Le titre Baudelaire bien placé ce matin lui aussi. Les démons de Dostoïevski se portent bien, merci, ce matin radieux. Les enfants en armes sont également donnés gagnants pour le tiercé de ce matin ; les enfants des rues prêts à se vendre ce matin aux ordres des réseaux du Planificateur ; le chaos minutieusement rétabli ce matin par les services du Planificateur…
La tentation serait alors de conclure qu’il n’y aurait plus rien : que rien ne vaudrait plus la peine, que tout serait trop gâté et gâché, que tout serait trop lourd, que tout serait tombé trop bas, que tout serait trop encombré. On chercherait quelqu’un à qui parler mais personne, on regarderait autour de soi mais personne que la foule, on dirait encore quelque chose mais pas un écho, on se tairait alors, on se tairait tout à fait, on ferait le vide, on ferait le vide complet et c’est alors, seulement - seulement alors qu’on serait prêt, peut-être, à entendre le chant du monde.
Ainsi le prêchi-prêcheur de ce matin le dit-il, en vérité il le leur dit, aux mères du monde dans lequel nous vivons : qu’elles n’aient aucun regret, car ce qui leur reste de meilleur n’est pas que du passé, ce qui les fait vivre est ce qui vit en elles de ce passé qui ne passera jamais tant qu’elles vivront, et quand elles ne vivront plus leurs enfants se rappelleront ce peu d’elles qui fut l’étincelle de leur présent - ce feu d’elles qui nous éclaire à présent, et la lumière de tout ça, la lumière sans nom de tout ça – la lumière témoignera.
Une fois de plus, à l’instant, voici donc l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’été bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage immobile absolument sur le lac bleu soyeux, l’émouvante beauté de ce que voit mieux que nous l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...
Le feu ne cesse pas d’être le feu de très longue mémoire. Bien avant leur naissance ils le portaient de maison en maison, le premier levé en portait le brasero par les hameaux et les villages, de foyer en foyer, tous le recevaient, ceux qu’on aimait et ceux qu’on n’aimait pas, ainsi la vie passait-elle avec la guerre, dans le temps…
Trop souvent, cependant, nous avons négligé le feu. Ce qui nous était naturel, la poésie élémentaire de la vie et la philosophie élémentaire, autant dire : l’art élémentaire de la vie dont le premier geste a toujours été et sera toujours d’allumer la feu et de le garder en vie – cela s’est trop souvent perdu.
Or nous croyons le plus souvent que les silencieux se taisent à jamais. Mais s’ils entendaient encore, ce matin, qu’en savons-nous après tout : s’ils entendaient encore cette polyphonie des matinées qu’ils nous ont fait écouter à travers les années, s’ils entendaient ces voix qui nous restent d’eux – si nous écoutions le silence des oiseaux qui chantent en nous ?
Ce matin encore, imaginairement descendu par les villages aux villes, je les entends par les rues vibrantes d’appels et de répons : repasse le vitrier sous les fenêtres de nos aïeux citadins, dans le temps certes, certes il y a bien du temps de ça mais je l’entends encore par la voix des silencieux et les filles sourient toujours aux sifflets des ouvriers des vieux films du muet - et si leurs tombes restaient ouvertes aux mélodies ?
Tous ils semblent l’avoir oublié, ou peut-être que non, au fond, comme on dit, puisque tous les matins il t’en revient des voix, et de plus en plus claires on dirait, des voix anciennes, autour des fontaines ou au fond des bois, vers les entrepôts ou dans les allées sablées des palmeraies - des voix qui allaient et revenaient, déjà, dans les vallées repliées de ta mémoire et la mémoire de tous te rappelant d’autres histoires, et revenant chaque matin de ces pays au tien - tu le vois bien, que tu n’es pas seul ni loin de tous…
Tout nous échappe de plus en plus, avions-nous pensé, mais c’est aujourd’hui de moins en moins qu’il faut dire puisque tout est plus clair d’approcher le mystère prochain, tout est plus beau d’apparaître pour la dernière fois peut-être – vous vous dites parfois qu’il ne restera de tout ça que des mots sans suite, mais avec les mots les choses vous reviennent et leur murmure d’eau sourde sous les herbes, les mots affluent et refluent comme la foule à la marée des rues du matin et du soir - et les images se déplient et se déploient comme autant de reflets des choses réelles qui viennent et reviennent à chaque déroulé du jour dans son aura.
La Désirade, ce 31 juillet 2009)
(Extrait de L'Enfant prodigue, récit achevé ce matin)
-
Des coïncidences révélatrices





Notes panoptiques (6)À propos des deniers livres de Pascal Quignard, David Fauquemberg et Lieve Joris, de Walter Benjamin et de Guido Ceronetti, de Vassili Grossman, de Thomas Sankara et de la momie Mitterrand.
Je venais de retrouver mon exemplaire d’Images de pensée de Walter Benjamin, en rangeant ma bibliothèque, lorsque j’ai commencé de lire le dernier livre de Pascal Quignard, La barque silencieuse, dont les premières pages évoquent ce mouvement qui définit entre tous le « littéraire», consistant à aller au fond des mots, en l’occurrence le premier mot de corbillard, issu des coches d'eau sur lesquels on transportait les nourrissons sur la Seine entre Corbeil et Paris, hurlants. En même temps que j’évoquais, dans un récit que je suis en train de finir sous le titre de L’Enfant prodigue, mes retrouvailles imaginaires avec mon premier mort, à dix ans, dans le quartier des Oiseaux de notre enfance, en la personne d’un petit leucémique prénommé Pierre-Alain ou Pierre-Louis, je ne sais plus bien, et que j’ai appelé Pilou, en même temps que je nous revoyais observer les scarabées je lisais ces jours le très étrange nouveau livre du très étrange Jean-Marc Lovay, Tout là-bas avec Capolino, qui lui aussi descend au fond des mots comme un plongeur en apnée, à la recherche en outre de ce qu’on pourrait dire l’Esprit du conte. Or ce que je me dis à chaque fois, de telle nouvelle rencontre survenue en ce moment précis, et pas à un autre, à telle autre intersection d’observations ou d’expériences, que ces coïncidences figurent le croisement par excellence de la vie et de nos destins. Vie et destin, soit dit en passant : grande rencontre et grande expérience, il y a pas mal d'années déjà, de cet immense roman de Vassili Grossman qui me reste comme un inoubliable concentré de mots sondant l’existence…
°°°
On passe parfois des années à proximité de quelqu’un avant de le rencontrer vraiment. Cela m’est arrivé avec Philip qui partage ces jours notre vie et divers projets communs, dont notre Panopticon (lui par l’image et moi par les mots) et qui lit ces jours La Patience du brûlé de Guido Ceronetti, me disant qu’il se sent tout proche de ce grappilleur d’ « images de pensée », pour reprendre l’expression de Walter Benjamin, dont Ceronetti est à divers égards un héritier, comme l’est aussi un Ludwig Hohl ou, selon Bruno Tackels , le biographe de WB, comme le sont aussi un Pascal Quignard, un Enrique Vila-Matas ou un Sebald, autres purs « littéraires ».
°°°
Or il y a mille façons de vivre la littérature et autant de façons d’aller « au fond des mots ». J’y ai pensé ces jours en lisant deux autres livres qu’on pourrait apparenter à la mode de la littérature-monde et des « étonnants voyageurs », et dont le noyau ressortit essentiellement à une interrogation sur l’homme au monde et sur les chemins écartés, plein air, qui conduisent à son point faible par les mots. « Chaque homme a son point faible, disait Jack Dempsey, l’estomac peut-être, la mâchoire… Alors il faut chercher la faiblesse dans votre homme, et c’est là qu’il faut attaquer. » En le citant en exergue de Mal tiempo, son dernier livre, David Fauquemberg fait autre chose que de proposer la meilleure façon de démolir son semblable: il prépare une formidable rencontre avec la vie et le destin d’un boxeur par désespoir. De la même façon, c’est par la faiblesse de ce qu’elle éprouve après la mort de sa mère, que Lieve Joris, dans Les hauts plateaux, vit sa dernière et plus lancinante rencontre de l’Afrique la plus fragile, où la vie survit en dépit de tous les dangers. Son guide, le jeune David au drôle de chapeau, voudrait être d’abord écrivain comme elle, puis pasteur comme l’évangéliste qui répand la bonne parole aux paroissiens perdus de ces terres oubliées, puis il serait prêt à relancer la révolution de Thomas Sankara, abattu avec la bénédiction de la France, en lisant une biographie du révolutionnaire assassiné par son soi-disant alter ego. Or le seul nom de Sankara me rappelle, autre coïncidence, ce bel hommage à Sankara de l’autre jour, sur Arte, et ce visage et ces mots clairs et nets, comme ceux d’un certain Obama, faisant pièce au discours cauteleux d’un certain Mitterrand, le visage figé d’une momie dont la littérature à prétentions littéraires n’a jamais trouvé la vérité des mots... -
Le mystère du scarabée
Les mots te savent, ce matin un peu plus qu’hier et c’est cela, le temps, je crois, ce n’est que cela : c’est ce qu’ils feront de toi ces heures qui viennent, c’est le temps qui t’est imparti et que tu vas travailler, petit paysan de la nuit, les mots sont derrière la porte de ce matin de printemps et ils attendent de toi que tu les accueilles et leur apprennes à écrire, les mots ont confiance en toi, laisse-les te confier au jour, Monsieur l’Enfant,
L’enfant serait un vieillard ce matin, l’enfant serait un frêle poète et philosophe de tous les temps, l’enfant remonterait le cours du temps à l’envers, droit devant, en ne cessant de s’alléger de tout le bataclan dont les ans l’ont chargé depuis tant de temps.
Le mot DANSE lui réapparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant petite, toute nue et belle dans son long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser...
Du jeu de l’Aveugle de leur enfance ils passeraient, alors, au jeu de rôle de l’ici présent. Je serais Isadora et la Trisha ou la Pina d’aujourd’hui: je serais la danse incarnée de demain, je serais la fille de l’air, je serais la continuelle échappée vers l’avant dont le sol léger reste partout mon garant. Ou je serais l’âme retrouvée de Pilou fleurant bon la liqueur hors d’âge.
En retrouvant imaginairement Pilou je me sens en mesure désormais de répondre à toutes les questions de l’Encyclopédie de l’Univers que nous nous posions entre sept et dix ans, assis sous le grand kapokier ou sous le grand frangipanier de notre jardin en enfance. Nous étions alors plus poètes et plus philosophes que jamais nous ne l’aurons été par les allées des années, ou disons que nous vivions alors LA question à l’état pur, sans moyens réels d’entendre aucune réponse pour de bon. Nous étions pendus aux lèvres de la Question, mais l’enchantement seul comptait en somme, jusqu’au jour où les affaires de Pilou, restées seules sur la table d’écolier à laquelle jamais il ne reviendrait, devinrent l’image même de nos questions sans réponses.
À la différence du grand Ivan, qui disait ne point se poser de questions et le recommandait au petit Ivan, Pilou ne faisait que ça: se poser des questions, de même que je ne faisais que me poser des questions. À l'évidence, savoir comment passer le temps de tel ou tel après-midi de pluie n’était pas pour nous une question. Comment ne pas s’ennuyer n’avait jamais été non plus, pour nous, LE problème à solutionner. La seule question qui se posait à nous, avec Pilou, était de choisir entre tant de possibilités de s’occuper, après quoi toutes les questions nous occupaient sans nous laisser le temps de voir passer le temps.
Nous nous intéressions à toutes les questions, avec Pilou, qui touchent à la poésie et à la philosophie sans que jamais ces mots ne soient évidemment prononcés. La présence seule des choses nous intriguait pareillement. Le pourquoi des choses nous interloquait ; l’inimaginable beauté des choses suscitait chez l’un et l’autre le même engouement. Nous pouvions passer des heures à regarder un scarabée tout semblable à une amulette égyptienne. Nous avions entre sept et dix ans et connaissions le sens du mot AMULETTE, tout proche et résonnant cependant tout autrement que le mot TALISMAN.
Les Sciences naturelles nous avaient introduits à la connaissance surnaturelle sans que nous nous en doutions, et c’est tout naturellement que nous nous passionnions pour les choses d’avant les mots. Il était certes prodigieux que tel papillon fût connu sous le nom de Grand Paon de Nuit, ou que tel autre eût été nommé Sphinx Tête de Mort par les savants, mais la chenille à corne de celui-ci, que nous avions capturée et retenue dans une boîte des cigares cubains de notre oncle Victor, nous avait captivés, par ses reptations et ses contorsions semblant ressortir à une fureur panique, bien avant l’établissement formel de son identité au vu des planches de l’Encyclopédie de l’Univers.
Le Grand Paon de Nuit avait inspiré, à Pilou, la sculpture d’un totem qu’il avait peint de couleurs aussi sombres et vives qu’il était lui-même doux et diapahane apparemment. J’y vois rétrospectivement une annonce prémonitoire, que je relie au rire de Pilou ou à la brutalité dont je faisais preuve dans l’usage des mots. Celui que les réguliers taxent de doux rêveur sait trop de choses dangereuses qu’ils ont appris à se cacher, et qui l’isolent à mesure à leurs yeux.
Avec d’autres compères, nous aurons hanté les grottes, mais seul l’enfant irrégulier se trouve sensibilisé à l’alchimie des choses et des mots par la connaissance des failles. Or nous communiquions avec Pilou, qui n’était pas autorisé à ces exercices de ramping, par transmission de pensée non formulée. Pilou avait-il sondé d’autres profondeurs dès les premières atteintes de son mal. Pilou s’était-il vu traverser les miroirs du temps au seul ébranlement de sa faiblesse ? Avait-il entendu le chant de son sang défaillir ? Avait-il déjà ressenti la surprise infinie contenue dans le mot DÉJA ? Comment savoir ? Ce que je savais seulement, ce que je voyais, ce que je vivais de Pilou était sa fringale de savoir simplement par curiosité d’enfant, et c’était une aussi douce poésie, une aussi douce philosophie que celles des savants de plus de dix ans.
L’enfance de la curiosité est au fondement de l’amour, moins compliqué que ce que le mot AMOUR ne dit le plus souvent que par défaut. L’enfance de demain ne butera plus sur les limites des mots. Rien n’est incommunicable, dit le scarabée sacré à l’enfant entre sept et dix ans, mais il y a des milliards de riens riches à milliards de milliards poudroyant de poussières de poésie et de philosophie dans le mot RIEN qui ne diront rien sans extrême attention de la part du poète et philosophe enfant, de même que l’inattention ne voit qu’un bousier besogneux dans le scarabée sacré dont la Science de l’enfant entre sept et dix ans retrouve la vocation secrète.
Je n’avais certes pas vu la transformation fatale de Pilou, mais à certains secrets nous n’accédons qu’avec le temps. Pilou avait été le premier de nous deux à consulter l’Encyclopédie de l’Univers et m’avait transmis le secret du scarabée sacré, touchant aux métamorphoses, qui ne se vit et se vérifie qu’avec le temps. Un jour pourtant une vision me saisit tandis que Pilou, se relevant de renouer un lacet dans la lumière verdâtre du sous-bois, m’apparut un peu grimaçant, tout grêle et frêle, les joues creusées, comme sculpté dans un bois vieillard, mortel. Et sept jours plus tard, fertig, Pilou m'avait échappé pour se tirer dans le bois sacré où je mettrais une vie àle retrouver...
(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en finition.)
-
Le chapeau de Grossvater


Pour Pascal Janovjak
Où l’on voit que la file d’attente d’un McDrive peut être le lieu propice à de singulières associations de souvenirs. De l’indéniable parenté liant Grossvater et le poète Robert Walser. D’une certaine Suisse farouche.
C‘est en attendant mes rognures de poulet moutarde sous le cinglant soleil de midi, dans la file du McDrive, que je me suis rappelé tout à coup, l’autre jour, que Grossvater était mort pour avoir oublié son chapeau à la promenade de cette journée de printemps d’il y a plus de vingt ans de ça, le lendemain de laquelle il succombait à l’insolation dans son lit de L’Etoile du Matin, au terme d’une longue vie d’obscur bon Suisse, et du même coup je resongeai à la fin du poète Robert Walser, à l'hiver 1956, au milieu d’un champ de neige, le jour de Noël, au bas de la pente blanche où des enfants le retrouveraient, et son chapeau non loin de là.
Leur chapeau est apparement le seul objet qui relie les deux personnages si différents l’un de l’autre que furent Grossvater et Robert Walser, mais ce chapeau est un monde. C’est l’insigne de la décence paysanne suisse. Grossvater et Robert Walser l’enlevaient de la même façon devant les femmes et le photographe. On connaît la photo de Robert Walser posant en costume du dimanche le long d’une route de campagne, la tête découverte, son chapeau et son parapluie tenus de la main droite. Or Grossvater posait de la même façon solennelle, et c’est du reste par cette photo de Carl Seelig que je me suis avisé, pour la première fois, de l’indéniable ressemblance physique qui appariait aussi bien Grossvater et le poète.
Celui-ci confiait un jour à une amie, dans une lettre, que son nouveau chapeau (sûrement celui de la photo), qu’il disait démodé et de façon allemande, lui avait coûté douze francs, et sans doute Grossvater eût-il été le premier à remarquer qu’il s’agissait là d’une somme, mais je n’en suis pas moins convaincu que ce ladre, qui lésinait devant la moindre dépense, se fût fait lui aussi violence pour avoir l’air un peu comme il faut.
Pour lors j’observais les nouveaux Sri Lankais du McDrive, à l’inexpérience desquels nous devions de tant lanterner; et malgré leur gaucherie je me disais: chez eux aussi quel souci de décence ! Avec quelle digne pénétration ils composaient les fameux menus Mac le Marin ou Happy Meal, et avec quel air avenant ils remettaient la marchandise à l’important conducteur du 4x4 Cherokee ou à la mère de l’enfant unique gesticulant à l’arrière de la Toyota Cressida.
Au même moment, j’imaginais la stupéfaction de Grossvater ou de Robert Walser à l’observation d’un tel manège. Qu’on pût se sustenter sans quitter l’habitacle de son véhicule: c’étaient bien là les Temps Modernes!
Fort de ses apprentissages au Ritz de Paris, puis à L’Hôtel Royal du Caire, Grossvater n’y eût probablement trouvé que de nouveaux arguments sur le manque de style du système américain, qu’il décriait souvent à la table de la Stube, tandis que Walser y verrait peut-être un signe plus inquiétant encore de l’extension de tout un empire de forfanterie et de vulgarité. Et je me figure d’ici leur façon commune de secouer la tête sans mot dire, et tout ce que dit ce geste !
Un placard publicitaire voyant proclamait tout à côté, en grandes lettres surmontant l’effigie du nouvel Hyper Mac, qu’avec celui-ci nous attendait Une Autre Vie; mais je continuais à songer, pour ma part, à l’incongruité que représentait, dans un tel monde, un objet de l’espèce du chapeau de façon allemande de Robert Walser et de Grossvater.
Est-ce à dire que je pensais inimaginable la survivance de tels individus dans l’univers du McDrive ? Certes non, et je ne doute pas que les Sri Lankais les serviraient avec la même affabilité qu’ils montraient à tout un chacun. Il me plaît même de conjecturer quelque complicité entre eux, l’occasion étant donnée à Grossvater d’exercer un peu ses vestiges d’anglais, ou à Robert Walser d’entreprendre quelque divagation sur son goût particulier des emplois subalternes.
En cela aussi, d’ailleurs, lui et Grossvater se rejoignaient. La vie de l’un et de l’autre n’évoquait-elle pas la même retraite progressive dans l’humilité et le marmonnement solitaire ?
Que l’un eût rempli des milliers de pages d’une prose originale à tout crin, tandis que l’autre ne fut jamais capable que de réciter ses interminables moralités rimées, ne m’empêche pas de percevoir entre eux plus de résonances, liées à une certaine Suisse farouche, qu’entre deux littérateurs d’égal génie ou deux petits employés semblablement bornés.
J’imagine fort bien, au reste, Grossvater apparaissant dans un récit de Robert Walser.
Ce pourrait être, en premier lieu, ce jeune groom passé de sa cour de ferme des cantons primitifs aux splendeurs capitonnées des palaces d’Europe, debout avant tout le monde et veillant chaque nuit sur ses manuels de savoir-vivre et ses dictionnaires en diverses langues.
Dans la fantaisie de Robert Walser, cet employé modèle est courtisé par une riche héritière de Vaduz au prénom romantique de Merline, mais c’est à la femme de chambre Agatha, sa compatriote, qu’il confie ses projets d’avenir.
Ce qui séduit Walser chez le Grossvater des grandes espérances juvéniles, c’est le mélange de timidité et de sourde détermination, de bon sens et de curiosité, de simplicité et d’humour de vieille souche dans tous les rôles qu’il endosse, les plus humbles ne l’ayant jamais rebuté pour autant que sa dignité fût préservée. La sobriété du jeune homme, et sa réserve cérémonieuse à l’endroit des personnes du beau sexe, le fait railler par certains de ses collègues italiens ou français, mais à le mieux connaître on découvre que son austérité cache une malice et que son souci de l’économie est dicté par l’ambition de régenter un jour son propre hôtel, quelque part entre l’Egypte et Salonique.
Walser comprend cette aspiration à s’élever dans les étages de la société, il lui plaît même de représenter un jeune Grossvater entreprenant, avançant piano ma sano, à peine troublé par l’étalage de richesse des uns ou la lubricité de certaines clientes (ce doit être un plaisir spécial que de faire rougir cet empoté à fières moustaches de Habsbourg), mais c’est dans la déroute de Grossvater et d’Agatha, la ruine de leurs espoirs découlant de l’imbécillité mondiale, la désillusion, le retour au pays, la Grande Guerre et ses calamités, que le poète trouve vraiment en Grossvater un petit homme selon son goût.
Qu’était-ce que cette Autre Vie que nous annonçait le nouvel Hyper Mac ? Pourquoi Grossvater avait-il adhéré par la suite à l’Eglise Adventiste du Septième Jour ? Quelle force poussa Robert Walser à écrire des milliers de pages, et pourquoi y renonça-t-il longtemps avant de s’effondrer au bas de la pente de neige ? Enfin quel chemin avait été celui de la Sri Lankaise aux grands yeux avenants qui me tendait à présent l’objet de ma commande au guichet du McDrive ?
Je n’eus pas, alors, loisir de ressasser longtemps ces questions. Je ne cessai cependant, et je n’ai cessé, jusqu’à l’instant, de songer à ces deux vies que tout séparait apparement, n’était un chapeau passé de mode.
Un autre jour je pourrais imaginer la rencontre de Grossvater et de Robert Walser au service militaire, par exemple dans la grasse campagne de l’Emmental. La chose est tout à fait envisageable et permettrait de se faire une idée du poète sous l’uniforme tel qu’aurait pu le voir Grossvater.
A l’en croire, Walser serait plutôt du genre bon type, quoique parfois impénétrable, voire criseux. En tout cas rien de l’intellectuel de la ville qui se monte le coup. C’est au hasard d’une conversation, une nuit à la garde, sous les étoiles semblables à celles du désert, que Grossvater a appris que son compère fusilier avait lui aussi pas mal voyagé et qu’il écrivait un peu à ses moments perdus.