
Carnets de JLK - Page 49
-
Dans le bleu du temps
 Volutes partent en fuméesdans l’air allégé du matin;le bleu reprend la mainà l’insu de nos destinées.Sur le lac là-bas un bateau,d’un trait tout épuré,marque le vide des proposdes fumeurs accoudés.De quel port sont-ils donc partis,ces beaux messieurs tranquilles,parlant dans le vague roulisde leurs affaires en ville ?Et vers quels ailleurs s’en vont-ils,en quel port incertainse dissiperont-ils enfinau su de quel destin ?
Volutes partent en fuméesdans l’air allégé du matin;le bleu reprend la mainà l’insu de nos destinées.Sur le lac là-bas un bateau,d’un trait tout épuré,marque le vide des proposdes fumeurs accoudés.De quel port sont-ils donc partis,ces beaux messieurs tranquilles,parlant dans le vague roulisde leurs affaires en ville ?Et vers quels ailleurs s’en vont-ils,en quel port incertainse dissiperont-ils enfinau su de quel destin ? -
Le silence des arbres

Tu ne pèses pas lourd,
mais ces os empilés,
ces mains qui décapitent,
ces fosses refermées,
ces murs dynamités
disent ce que tu es.Nous qui n'avons de mots
que ceux que tu nous prêtes,
nous t'écoutons pleurer,
te plaindre, tempêter,
geindre puis menacer;
comme l'ange et la bête,
faire ce que tu hais.Comme la femme au puits
ou le poète hagard
nous restons éveillés
mais nous ne disons mot
qui ajoute à tes cris
le vacarme du sang.Cependant tu le sais:
tu sais notre clairière.
Ton poids n'est qu'un refus.
Le silence t'attend.
Il n'est point de barrière
pour ce qui souffle en toi.(La Désirade, ce 2 avril 2017).
Peinture: Stéphane Zaech.
-
Soutter
 Obscure est ma passion,disait le poète aux doigts noirsdans la nuit en plein jourde la lumière en tintamarre.Folie, folie, foliedes croix dressées dans l’air du soir- l’air de feu et de poixclouées dans le cercueil dressédes femmes en beauté,des visages pêchésdans le filet des innocents- le péché de la hontefurtive se détourne:on ne s’exhibera jamais,tout n’est que dévoilé,on ne connaîtra pas la paix,tout sera bousculé:chassés du temple du Marché,les usuriers du mondejoueront à ne pas jouirà la façon vampiredes âmes sans âme et sans chairgelées par le désirde ne désirer rien...Tout ainsi l’a cloué,le cinglé aux yeux de démentqui nous a dévoiléle monde immonde en son tourment.
Obscure est ma passion,disait le poète aux doigts noirsdans la nuit en plein jourde la lumière en tintamarre.Folie, folie, foliedes croix dressées dans l’air du soir- l’air de feu et de poixclouées dans le cercueil dressédes femmes en beauté,des visages pêchésdans le filet des innocents- le péché de la hontefurtive se détourne:on ne s’exhibera jamais,tout n’est que dévoilé,on ne connaîtra pas la paix,tout sera bousculé:chassés du temple du Marché,les usuriers du mondejoueront à ne pas jouirà la façon vampiredes âmes sans âme et sans chairgelées par le désirde ne désirer rien...Tout ainsi l’a cloué,le cinglé aux yeux de démentqui nous a dévoiléle monde immonde en son tourment. -
Les anges veillent

Bas les pattes ! s’exclame l’enfant:
tu ne m’englueras pas
dans ta bave et tes influences;
d’un saut je me dérobe
à ton bravo de prédateur:
la danse est ma hauteur.Tombera le masqué
séducteur combien souriant.Et les nuages tout là-haut
passant et repassant,
les chastes nébuleux globules
du sang bleu des seigneurs,
sont mes veilleurs armés.Tout se transforme à vue:
la joie m’est fortin de douceur.Peinture: Joseph Czapski.
-
Muet au seul regard
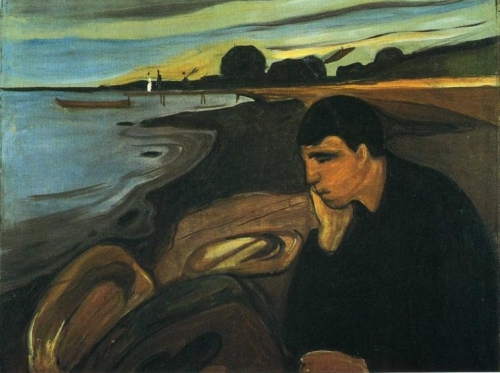
Je t’applaudis d’une seule main,
dit le sage au manchot
qui le regarde sans envie,
la flûte bien tenue
d’une seule lèvre qui sourit.La colombe serpente,
musique courant où elle veut,
de cascades en langueurs.Aux murs aveugles de béton,
nulle main n’applaudit,
et la flûte est muette
aux lèvres qu’on n’écoute plus...Edvard Munch, Mélancolie.
-
Arômes du matin
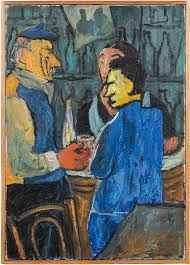
Ce que tu écris à présent
sera-t-il jamais lu ?
Cela ne te regarde pas.Les mots se forment sous tes yeux,
venus tu ne sais d’où,
comme la foule ce matin
sortant d’un peu partout.
Les mots dévisagent des gens
que tu ne connais pas:
cela défile comme en rêve;
à la sortie des gares
on croit qu’untel va s’arrêter,
mais c’est peine sans trêve:
ici la rime féminine
se noie dans la mâle rumeur
des employés pressés -
on éprouve alors un effroi,
comme au bord d’un fossé...Mais tu marches déjà là-bas,
les mots t’ont précédé
dans les rues qui vont quelque part:
ils marchent du pas décidé
du matin des humains
qui, ne pensant ici qu’au soir,
vont aux bureaux chauffés
là-haut où d’autres mots attendent
le moment du café.(Noté ce matin sur mon I-Phone, avant le lever du jour)
Peinture: Joseph Czapski.
-
Au corps ignorant

Sur un poème de Rainer Maria Rilke.
L'athlète s'en est allé,
mais je ne sais ce soir
si ce que je déplore
est sa disparition,
le drapeau flamboyant
de son corps exerçant
son art géométrique,
ou ses mains électriques
écrivant des poèmes.
Je ne sais pas, j'hésite ;
réellement ce soir,
la fatigue m'a pris
dans ses bras féminins
mais ce grand torse à voir
de marbre et remontant
les chemins de l'oubli
via Rilke et Rodin,
me rend ces beaux matins
de nos corps élancés,
leur grisante sueur
et sur le stade inscrite
la lettre du poème.
Ignorant de la peur,
l'athlète ainsi demeure.
(Athènes, 2011)
-
Toupie de Chine ancienne

Le Temps est un enfant, là-bas,
devant son tas de sable ,
que la mer en son doux fracas
pas un instant n’accable.Le Temps ne joue pas à passer
ni jamais ne se lasse
de voir le sable s’écouler
sans laisser nulle trace.Le Temps vous attend quelque part
sans que vous sachiez l’heure,
vous souriant avec son art
d’éluder la douleur.D’ailleurs Le Temps n’aime point trop
qu’on fasse tout un drame
du moment où, tout à vau-l’eau,
le vieil enfant rend l’âmeLe Temps est un arbre là-bas
sous lequel l’enfant joue
sans ressentir rien du tracas
qui dans l’ombre se noue.Dans le temps, l’enfant aimait bien
le vieux grabataire
qui lui filait un peu d’argent
dont il n’avait que faire.Le Temps est un château de cartes
dont l’enfant tout distrait
ne saura jamais, où qu’il parte,
que son sort est joué.Et si le Temps n’existait pas ?
persifle le vieux sage
à barbiche d’enfant chinois
remuant son potage... -
L'enfant bleu

Ce n’est pas tous les jours dimanche,
dit-il à l’enfant bleu
qui l’écoute dans le silence
hagard, après le feu.L’eau du puits est empoisonnée,
dit-on à la télé
d’un air profondément navré;
puis on parle du temps
qu’il va faire ce dimanche-là
sous le ciel radieux
de la publicité captieuse -
et l'enfant bleu se tait. -
Désarroi

Je ne suis pas vraiment chez moi
dans ce monde sans chiens -
ce monde sans secrets.Les barbus porteront des voiles
dans la cité sevrée,
et les chiens seront abattus.Les femmes se tairont
Les armes feront la prière,
selon le vœu des dieux.Ce soir, partout, les chiens
me demandent où nous allons,
mais les dieux sont muets.(Wuppertal, Café Venezia,
ce 6 juin 2019) -
À la douceur terrible

(Pour Aliocha)
Mes pauvres mots ne diront rien
de ce que tu nous chantes,
enfant de la verte prairie
retrouvée tôt matin
sous tes mains et nos yeux fermés -
tes mains courant là-bas
sur le fin clavecin des prés.Nos jardins en enfance
ont des chemins aux affluents
que tes magies font
remonter à la même source ;
au début était la lumière,
nous chantes-tu d’abord
et ton pianiste arbore
cet habit moiré par la course
du tout premier matin -
cette veste noire étoilée...Le chaos des commencements,
le doux pianissimo,
les brises frisant sur les fronts
des vivants effrayés
par Dieu sait quel pressentiment ;
et voici l’autre voix
de violoncelle du Gitan,
fils de Satan ou d’Apollon
qui bientôt ensorcelle -
la voix qui fait pleurer
dans le temps tout désaccordé,
ou bientôt retrouvé ?Tu sais les choses de Russie,
tu sais le printemps fou,
les débâcles de la Neva,
la folie d’Elena -
tu sais la force et la douceur
de l’oiseau Remizov
et du pantelant Oblomov ;
tu sais l’horreur mêlée
des malheurs et autres candeurs ;
tu es l’enfant de ça :
tu sais les larmes et le fracas
et c’est ça que tu chantes,
mon tendre et terrible Aliocha...(Wuppertal, un lendemain d’émotion au soir du 6 juin, à la Stadthalle, à l’écoute d’Eros athanatos de Richard Dubugnon, alias Aliocha).
Peinture: Chaïm Soutine.
-
Marteaux et marées
 Ne cherchez pas le mal ailleurs:regardez-vous en face.Ici les oiseaux se font rares,que vous avez chassés,mais en la nuit les fleurs demeurent,ah ah ah ah ah ah,et l’on va réparer, c’est ça:tenez-vous le pour dit...J’entends les fleurs se taire.Pas loin de là, des tsunamisvous attendent au miroir;votre espèce dénaturéeverra-t-elle le jour leverses armées bientôt désarméesdans l’air tout parfumé ?Ah ah ah ah, comme c’est bien dit !À la fenêtre de la nuit,tôt l’aube de l’hiverqui se prépare aux lendemainssans oiseaux plus jamais,l’enfant se tait là-basen vous répétant au miroir:faisons semblant: c’est ça...Ah ah ah ah, céleste espoir !Réparons, réparons,chantent les oiseaux aux marées,et les marteaux accourentavec les fleurs de la mariée...Peinture: Emil Nolde.
Ne cherchez pas le mal ailleurs:regardez-vous en face.Ici les oiseaux se font rares,que vous avez chassés,mais en la nuit les fleurs demeurent,ah ah ah ah ah ah,et l’on va réparer, c’est ça:tenez-vous le pour dit...J’entends les fleurs se taire.Pas loin de là, des tsunamisvous attendent au miroir;votre espèce dénaturéeverra-t-elle le jour leverses armées bientôt désarméesdans l’air tout parfumé ?Ah ah ah ah, comme c’est bien dit !À la fenêtre de la nuit,tôt l’aube de l’hiverqui se prépare aux lendemainssans oiseaux plus jamais,l’enfant se tait là-basen vous répétant au miroir:faisons semblant: c’est ça...Ah ah ah ah, céleste espoir !Réparons, réparons,chantent les oiseaux aux marées,et les marteaux accourentavec les fleurs de la mariée...Peinture: Emil Nolde. -
Young Memories
Nous avions vingt ans d'âge
et le vent jeune aussi,
la nuit au sommet de l'île
nous décoiffait et sculptait nos visages
de demi- dieux que partageait
l'amoureuse hésitation,
sans poids ni liens que nos
ombres dansantes
enivrées au vin de Samos,
les dauphins surgis de l'eau claire,
nos impatiences enlacées,
un consul ivre sous le volcan
et le feu du ciel par delà le dix-septième parallèle...
Et partout, et déjà,
défiant toute innocence,
les damnés de la terre
plus que jamais déniés;
et si vaine la nostalgie
de nos vingt ans,
en l'insolente injonction de nos rebellions.
C'était hier et c'est demain,
et nos vieilles mains sur le sable
retracent en tremblant les mots
qui se prononcent les yeux fermés
au secret des clairières.
(San Francisco, Nobhill, ce 21 avril 2017).
-
Hugo's drums

Le dieu Totor du haut des cieux,
superbe, vaticine.
C’est le plus fringant de nos vieux
griots d'occulte mine
qui nous bombarde de ses mots,
appelant mille et moult échos,
aux douceurs d’étamine.L’homme qui rit est un démon
au sourire angélique,
un enfant noir sous les néons
des buildings magnifiques;
un misérable très africain,
une diva qui fulmine,
un bœuf musqué dans la toundra,
un marin qui lambine
entre les ombres équivoques ;
un milliardaire américain
dont Gavroche se moque ;
un pal de cruelle mémoire,
les interrogatoires
très secrets de la Loubianka,
du sang giclant aux tabloïds,
la dégoûtante, sordide
très inhumaine humanité
que voici que voilà…À douze ans j’avalais par cœur
tes saucisses de sang;
aux crinières de ta splendeur
je m’accrochais, enfant
piaffant d’alexandrins joyeux
dans les allées tu Temps
martelées par le grand ramdam
du langage oublié,
par toi dûment ressuscité,
à renfort de tam-tam. -
Maison de mots
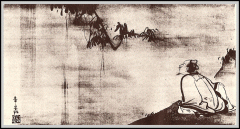
Partout où je suis retombé,
dans mes jours vagabonds,
du ciel des mots rêvés
au quotidien banal -
de Balbec à Cabourg,
j'aurai recomposé
mon désordre vital.
Que s'agit-il de protéger ?
That is the question
que je me suis posée
dès mes jeunes années
de vieux sage avant l'âge.
Vous ne m'aurez jamais:
cela du moins est sûr !
Je dois avoir sept ans
en pensant aujourd'hui
que je suis un Chinois
de plus de sept cents ans
dans ma vie de trouvère;
car au vrai je me sens
pour toujours le coeur vert,
hors du temps à l'instant
de lire les noms de lieux
de partout où je suis;
et partout reconstruis,
de New York à Shanghai,
ma maison dans la faille
de ces mots que j'écris.La foudre à la seconde
ne survit qu'en poème.
-
Révérence au Grand Manou

(Pour Anthony Nolan)
Voici venir le Grand Manou
sur son bel éléphant,
le pachyderme aux yeux très doux,
sage comme un enfant.Il a l’air d’un Maharadjah,
au fringant uniforme,
tout fleuri de beaux falbalas
sous son crâne haut-de-forme.Son ministre en bicorne blanc
tenant haut l’éventail
l’escorte pour son agrément :
c’est son job, son travail.Car il fait chaud chez les Indiens:
c’est marqué dans les livres,
et quand le peuple indien se plaint,
suppliant qu’on délivre
les vents attachés aux nuées,
le Grand Manou l’entend,
et l’éléphant de ses deux ailes,
ventile les innocents.En lisant le Mahrabata,
le Grand Manou s’inspire
des anciens avis avisés,
et l’Alizé respire,
et les Indiens tout requinqués
retrouvent le sourire.Le Grand Manou en sa splendeur
est resté le très humble
et très fidèle serviteur
de celui qui a façonné
dans l’atelier dormant,
en fine pâte à modeler,
sans brevet déposé,
les éléphants et les enfants.
-
Élégie aux yeux clos

La maison hantée était là,
sur la hauteur boisée,
la bouche ouverte et dans le froid,
les yeux crevésL’ordre qu’on nous avait donné
de ne s’y risquer pas
nous brûlait de curiosités
et nous tentait d’être tentés.Il y avait du mystère là-haut,
au bord du ciel;
une voix toute en lamento
affleurait le sommeil
des petits dormeurs effrayés,
d’autant plus attirés
qu’un Manteau y apparaissait
sans tête et sans repos -
et c’était si doux de trembler
de nos blancs osselets...Tremblant encore les yeux fermés,
la mémoire en éveil,
je la revois en mon sommeil,
souriant vaguement
au ciel désormais bétonné,
sans âme, ou peu s’en faut
dans ce rêve au doux adagio... -
Out of joint
 Plus tard je me suis demandési les autres là-basn'étaient pas nés trop tôt ?Je ne retrouvais plusle lieu du portulanoù l'on se retrouvaitdans les années-lumière,où tout semblait allerde rimes en ruisseaux...Alors on se parlaittoujours à demi-mot,et le silence se faisaità l'entour des clairières.Mais hélas tout celaest encore trop écrit.Revenir aux vrais mots.Ne plus édulcorer,je dirai même: ne pluspoétiser.Le temps nous pèse moinsce matin de printempsoù tout s'efface sous nos yeuxdu secret révélé des dieux -sans autre grâce que le présent.(La Désirade, ce 10 juin 2017)Peinture: Vassily Kandinsky
Plus tard je me suis demandési les autres là-basn'étaient pas nés trop tôt ?Je ne retrouvais plusle lieu du portulanoù l'on se retrouvaitdans les années-lumière,où tout semblait allerde rimes en ruisseaux...Alors on se parlaittoujours à demi-mot,et le silence se faisaità l'entour des clairières.Mais hélas tout celaest encore trop écrit.Revenir aux vrais mots.Ne plus édulcorer,je dirai même: ne pluspoétiser.Le temps nous pèse moinsce matin de printempsoù tout s'efface sous nos yeuxdu secret révélé des dieux -sans autre grâce que le présent.(La Désirade, ce 10 juin 2017)Peinture: Vassily Kandinsky -
Ce que parler veut dire
C’est en marchant là-bas,dans le sous-bois de ces années,que cela s’est mis à parler.Je ne sais que te dire :il n’y a pas d’explication;ce n’est qu’un fait divers.Pas plus que la Beauté cela n’est défini.Sais-tu si l’arbre s’en souvient ?Qui parle donc en toiquand les veilleurs ne disent mot ?Qui êtes vous, muets ?Dans mon ciel de papier,mon ciel de lit, mon lit de ciel,je n’entends que cela.(La Désirade, ce 6 novembre 2017)Peinture: Nicolas de Staël -
Encres et fumées
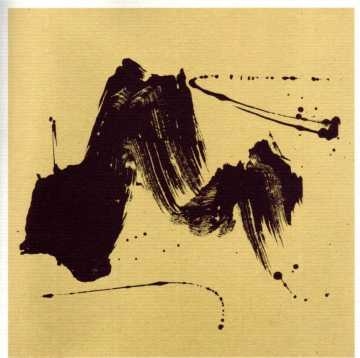
Le petit ouvrier des lettres
se lève tôt matin,
et tout de suite au clavecin
se la joue Grand Prêtre.La plus haute solennité
est en effet requise
de qui veut tirer du saké
de la grise banquise.Il y faut tout un fourniment
et tout un outillage
de tours et de trucs d’artisans
utiles au beau ramage.Il y faut l’encre et le pinceau,
les Japonais le savent,
et les Chinois au jeu de Go
opinent en vieux sages.L’encre est en somme la mer
aux cheveux bleus et verts,
plus vieille que le vieil Homère,
plus légère que l'air.Quant au pinceau c’est un stylo
aux mains de l’écolier,
ou à celles de la dactylo,
le studieux clavier.Le pinceau vert dans l’encre bleue
du plus infime des lettrés
tire d’un cendrier
cette voûte tout étoilée
où vont fumant les dieux. -
Nos coeurs éperdus et muets
Et quand la nuit tombait
sur le quartier de nos enfances,
les filles qui murmuraient,
mêlant secrets et confidences
à l’écart des garçons
dont le poil se faisait plus dur -
les filles tenaient les clefs
de nos coeurs immaturesLa nuit confond tous les visages
dans sa lumière noire
où se sont perdues tant d’images,
dont s’effacent les moires.Mais que sont-ils donc devenus,
les filles et les garçons
du temps de nos adolescences,
tout aux palpitations
de leurs cœurs éperdus
en muettes et vaines romances ?Nous jouons à la canasta
en parlant à voix lasses
du quartier dont on ne sait pas
ce qui ces jours s’y passe...Ainsi sommes-nous devenus
doux oiseaux de jeunesse
aux ailes d’anges un peu perclues,
aux yeux qui se lèvent
à la vue qui baisse,
des cœurs éperdus de tendresse ... -
Bateaux ivres

Verlaine le pouillu,
tout amoureux fou d’un voyou
renifle dans sa verveine;
il a mal partout,
à la tête et au cœur couillu,
car aimer lui fait de la peine.Cet Arthur est un saligaud :
ce foutu gigolo
qui tord le cou aux vers
et fait rendre gorge à l’orage,
les peignant tout en vert
en vrais Peaux-Rouges coupe-gorge -
ce débauché de l’Ardenne bleue
est un démon vaudou
bandant comme un mât de garenne
et cinglant jusques aux étoiles
quand il se fait la malle
sur son bateau nu titubant
de cinglé tout en moelle.Alors Verlaine qui n’en peut plus
lui tire un coup au fond du cœur:
un bon coup de couteau
chargé de vraies balles en métal -
on sait que ça fait mal;
mais Verlaine aime à en faire peur,
il n’est plus que douleur
et de raison: que dalle !Cependant, et bien étonnant
au dam du philistin:
c’est que Rimbe à la fin pardonne,
trouvant à son ami
l’excuse de la maldonne
et des jeux joyeux du destin;
la belle excuse enfin
de qui perd la boussole en mer
et se noie dans la prose,
les yeux égarés de beauté -
deux anges naufragés,
et la musique en toute chose... -
Les garçons bien élevés
 Pour Aloysius et son double.Les garçons qui font la vaissellen’ont plus l’air empruntéde leurs pères aux noires aisselles,quand ils buvaient le théau milieu de leurs péronnelles.Les garçons tricotent en riantdes bonnets d’opéra,et se coulent ainsi que des chatsdans les lits des divasqui les cajolent en ondulantde leur valseur valsant.Les garçons seront désarméssi vous les gourmandezou les privez de leurs jouets,ou les montrez du nezdans les vestiaires mal aérés.Les garçons de ce temps voudraienttant qu’on les courtisâtqu’ils se tendent soudaindans leurs tenues d’équitationaux éperons têtus,et les voici tantôt saillantet tantôt ferraillant,se lançant fiers dans la batailledes messieurs qu’on empaille...Peinture: Bronzino
Pour Aloysius et son double.Les garçons qui font la vaissellen’ont plus l’air empruntéde leurs pères aux noires aisselles,quand ils buvaient le théau milieu de leurs péronnelles.Les garçons tricotent en riantdes bonnets d’opéra,et se coulent ainsi que des chatsdans les lits des divasqui les cajolent en ondulantde leur valseur valsant.Les garçons seront désarméssi vous les gourmandezou les privez de leurs jouets,ou les montrez du nezdans les vestiaires mal aérés.Les garçons de ce temps voudraienttant qu’on les courtisâtqu’ils se tendent soudaindans leurs tenues d’équitationaux éperons têtus,et les voici tantôt saillantet tantôt ferraillant,se lançant fiers dans la batailledes messieurs qu’on empaille...Peinture: Bronzino -
Péchés véniels

(Aux dames de bonne compagnie)
Les beaux garçons sifflent les filles:
c’est l’ordre naturel,
comme les queues du billard brillent
sur l’herbe du bordel.Ces dames sont très philosophes,
qui voient passer la vie;
laissons-les égrener les strophes
de la mélancolie.Ce sont les veilleuses attentives
des péchés délicieux
qui nous rendent les heures plus vives
au décri des fâcheux -
mais laissons ces bonnets de nuit,
et reprenons nos jeux... -
Coulant de source
Coulant de source
Ma première liberté prise
à l'insu de tous,
même de l'unique camarade de ruisseau du moment,
relie toujours
une source jamais vue
et le lac où tous plongeaient,
corps adorables
de l'idéale fantasmagorieà jamais sans âge.
Mais déjà j'étais l'enfant trop conscient,
l'adolescent des rêveries en lisière,
le compagnon errant des rivages.
Déjà!
Cela fait maintenant
le temps d'une vie.
Au ciel de cette nuit blanche
passe un avion silencieux.
(Cracovie, mars 2016) -
Au temps accordé

Pour que la douceur dure un peu,
pour que te soit moins dur
le temps venu de nos adieux,
dans un lointain murmure
tu en reviens à ces années
de toutes nos enfances
où nous venaient les premiers mots,
les premières souffrances,
et le rebond tout aussitôt
de nos impatiences...Tant d’images, de tendres visages.
dans les ondes profondes,
et l’oubli de nos âges.
Tout à nos souvenirs communs.
nous oublions le temps
où jeunes et vieux n’étaient qu’un...Alors à nos mains tu confies
les deux tiennes enfin... -
Un si crâne garçon

Il était parti pour la gloire:
il en avait rêvé
et ne pensait qu’à des victoires
en nouant ses lacets.Petit, il se voyait gérant
de tous les logiciels,
arraché de tous les néants,
aimé des dieux du ciel,
adulé par toutes les mères
et jalousé souvent
par les amants de ces mégères...Je suis unique, chantait-il
sous le soleil et sous l’averse,
et tous les dieux me bercent
comme le pharaon des îles.Mais un tram au coin de la rue
guettait notre prodige,
sur lequel son dévolu
fut jeté, et vertige ;
ce tramway prénommé Désir,
tout ferraillant de fer
l’écrase et le broie et le tire
jusques au Cimetière.Paul Léautaud: "C'est cela, la vie. On travaille, on fait des livres avec des tas de salutations à Pierre et à Paul. On attend la gloire, la fortune - et on claque en chemin".
-
Devant l'enfant qui dort

(Pour Timothy)
Elle a la tête à la renverse,
la Terre vue des étoiles;
on dirait un enfant qu’on berce
dans le nébuleux des voiles
d’un beau navire entre les lunes,
et le ciel a un goût de prune:
l’enfant le reconnaît -
cela lui rappelle le lait
qu’il boit les yeux fermés
quand la nuit devient une roue,
là-haut au ciel très doux
où tournoie le blanc des nacelles.L’enfant sait déjà bien des choses
à son premier sommeil
où Petite et Grande Ourse veillent
tandis que tout repose.Peinture: Vassily Kandinsky
-
Comme un rêve éveillé

J’étais perdu dans la savane,
mais à y resonger,
ce vieux relent de caravanes
m’est un rêve étranger.Je suis en seyant pyjama,
dans cet aéropage
de séducteurs en panamas,
qui me semblent hors d’âge.Tu es tout nu dans les bureaux
des juges en cravates
en train d’aligner des zéros
au nom du Psychopathe.Ils travailleront à la chaîne
de l’usine onirique
tant que nul autre enfant ne vienne
à eux des Amériques.Elle est parfois contrariée
par ton sourire errant
la nuit remuant ses marées,
et ton regard dément.Dans ce monde on ne rêve pas,
dit la Dame aux yeux mauves
qui te berce au creux de ses bras
de fée aux dents de fauve.Peinture: Robert Indermaur. PP. JLK
-
Au poète éperdu

(En mémoire de Crisinel)
À fleur d’eau j’entends murmurer
le soir, ici, tout seul,
sa voix comme voilée
par le temps lui faisant linceul -
sa voix désespérée.Entre seize et vingt ans,
nous nous étions cherchés, là-bas,
dans les déserts ardents
où l’amour ne se connaît pas.Ses mots remontent des grands fonds
de l’eau comme apaisée
au souvenir de son seul nom
de vieil enfant muet.



