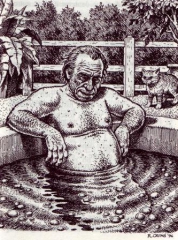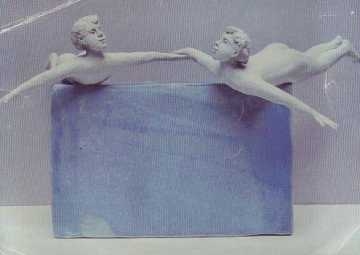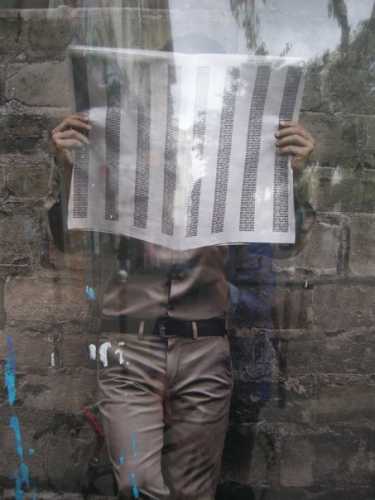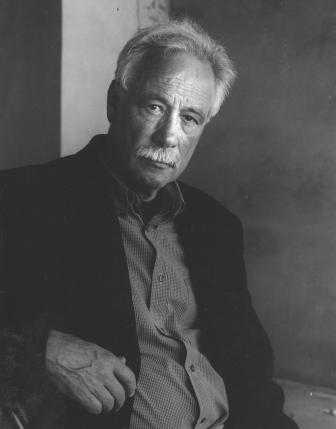Carnets de JLK - Page 45
-
Quelques anges
 Mon rêve dans une soupente parisienne, de l'angélisme et de la réalité...Ce jeudi 14 janvier.- Le rêve très détaillé que j’ai fait ce matin, après m’être réveillé à cinq heures et avoir pallié mon souffle au cœur avec un grand verre d’eau puis m’être rendormi, m’a ramené dans la mansarde parisienne de la rue du Bac où j’ai passé tant de nuits, qui m’évoquait aussi la soupente de la rue de la Félicité où j’ai créché durant mon séjour de 1974 aux Batignolles et ma chambre sous les toits de La Perle aux Canettes, avec un œil-de-bœuf donnant sur la chambre voisine dans laquelle deux personnages aux silhouettes blanches me semblaient en train de faire l’amour, sur quoi l’un d’eux surgissait, très gentil , puis deux autres, puis deux ou trois femmes dont l’une connaissait mon nom et me demanda si j’étais déjà allé en Ayatollie (elle avait dit Anatolie) alors que je demandais à l’ange couché à ma droite (nous étions vaguement couchés) s’il était plutôt Asie ou banlieues parisiennes, après quoi l’un des types genre Francais moyen déclarait que c’était le moment de partir pour leur virée au Touquet - me clignant de l’œil en ajoutant qu’ils étaient férus de la Côte d’Azur, ce qui fit réagir Lady L toujours aussi attaché à l’exactitude géographique, quand je lui racontai ce rêve alors qu’elle prenait des nouvelles de Washington sur sa tablette - et je me suis interrogé alors sur ma propension croissante à voir des anges autour de moi, et pas que dans mes rêves...MESSAGERS. - La fonction traditionnelle des Anges est celle de messagers, mais la question que je me suis posée ce matin, toujours en présence de Lady L. encore couchée dans notre grand lit à cadre de palissandre qu'elle à acquis chez Benoît Lange (!) le fameux marchand de meubles ethnos, était de savoir qui nous envoie les messages de ces rêves, l’explication freudienne étant loin de me suffire - les trois pauvres pages consacrées à l’interprétation des songes dans le dernier numéro de L’Obs me semblant d’une platitude atterrante. Comme si les psys étaient plus avisés en la matière qu’un Proust ou qu’un Fellini !DE LA RÉALITE. - Taxer quelqu’un d’angélisme est censé vous poser en adulte responsable qui a le sens des réalités, mais les messages angéliques de plus en plus réalistes, par le détail, que je reçois depuis quelques décennies m’aident à mieux voir ce qui dans la réalité procède d’une présence qui rayonne, et je ne parle pas que des petit enfants et des vieilles saintes: je parle de l’ange des brasseries évoqué dans mon rêve de cette nuit.De fait à un moment donné, le plus emouvant dans mon souvenir, l’un des mecs mal rasés de mon rêve citait soudain cette phase de Cingria, tirée du Canal exutoire: un archange est là, perdu dans une brasserie, et je prononçai ce dernier mot de brasserie en même temps que lui et nous échangions alors un sourire de connivence rare...
Mon rêve dans une soupente parisienne, de l'angélisme et de la réalité...Ce jeudi 14 janvier.- Le rêve très détaillé que j’ai fait ce matin, après m’être réveillé à cinq heures et avoir pallié mon souffle au cœur avec un grand verre d’eau puis m’être rendormi, m’a ramené dans la mansarde parisienne de la rue du Bac où j’ai passé tant de nuits, qui m’évoquait aussi la soupente de la rue de la Félicité où j’ai créché durant mon séjour de 1974 aux Batignolles et ma chambre sous les toits de La Perle aux Canettes, avec un œil-de-bœuf donnant sur la chambre voisine dans laquelle deux personnages aux silhouettes blanches me semblaient en train de faire l’amour, sur quoi l’un d’eux surgissait, très gentil , puis deux autres, puis deux ou trois femmes dont l’une connaissait mon nom et me demanda si j’étais déjà allé en Ayatollie (elle avait dit Anatolie) alors que je demandais à l’ange couché à ma droite (nous étions vaguement couchés) s’il était plutôt Asie ou banlieues parisiennes, après quoi l’un des types genre Francais moyen déclarait que c’était le moment de partir pour leur virée au Touquet - me clignant de l’œil en ajoutant qu’ils étaient férus de la Côte d’Azur, ce qui fit réagir Lady L toujours aussi attaché à l’exactitude géographique, quand je lui racontai ce rêve alors qu’elle prenait des nouvelles de Washington sur sa tablette - et je me suis interrogé alors sur ma propension croissante à voir des anges autour de moi, et pas que dans mes rêves...MESSAGERS. - La fonction traditionnelle des Anges est celle de messagers, mais la question que je me suis posée ce matin, toujours en présence de Lady L. encore couchée dans notre grand lit à cadre de palissandre qu'elle à acquis chez Benoît Lange (!) le fameux marchand de meubles ethnos, était de savoir qui nous envoie les messages de ces rêves, l’explication freudienne étant loin de me suffire - les trois pauvres pages consacrées à l’interprétation des songes dans le dernier numéro de L’Obs me semblant d’une platitude atterrante. Comme si les psys étaient plus avisés en la matière qu’un Proust ou qu’un Fellini !DE LA RÉALITE. - Taxer quelqu’un d’angélisme est censé vous poser en adulte responsable qui a le sens des réalités, mais les messages angéliques de plus en plus réalistes, par le détail, que je reçois depuis quelques décennies m’aident à mieux voir ce qui dans la réalité procède d’une présence qui rayonne, et je ne parle pas que des petit enfants et des vieilles saintes: je parle de l’ange des brasseries évoqué dans mon rêve de cette nuit.De fait à un moment donné, le plus emouvant dans mon souvenir, l’un des mecs mal rasés de mon rêve citait soudain cette phase de Cingria, tirée du Canal exutoire: un archange est là, perdu dans une brasserie, et je prononçai ce dernier mot de brasserie en même temps que lui et nous échangions alors un sourire de connivence rare... -
Neiges matinales
 De la neige sur les palmiers et de notre Amarcord en 1956, avant un quart d'heure de persiflage signé Quentin Mouron...Ce mercredi 13 janvier. – La pelouse sous nos fenêtres et les palmiers du bord du lac étaient tout blancs, ce matin, et cela m’a réjoui comme lorsque nous découvrions la neige autour de la maison de notre enfance, sur les champs et les bois voisins, nous réjouissant le matin de nous lancer le soir en train de luges du haut au bas de la route traversant la quartier à la verticale - de cinq à dix luges « appondues » en attelages dont les pieds des grands faisaient office de crochets, et quelques jeunes mères du voisinage assuraient la circulation au carrefour pour laisser passer le convoi fou en stoppant les éventuelles voitures, à vrai dire rares en cet hivers 1956 où débarqueraient les réfugiés hongrois dans nos classes…DE QUOI RIRE. - Je me suis rappelé la neige de notre enfance après avoir lu, ce matin, le dernier texte de l’ami Quentin évoquant une garderie d’aujourd’hui dont les mioches sont devenus des « clients » jouant avec des « objets transitionnels » sous l’égide de la nouvelle pédagogie, mais Lady L. en sa compétence expérimentale me rappelle que ce vocabulaire remonte au moins aux années 50, du temps des Winnicot & Co, à quoi j’objecte qu’aujourd’hui ces termes font bel et bien « habits neufs »pour tout un chacun qui « psychologise » à tout-va, même si Quentin en remet une couche alors que nos petits-enfants ont encore droit, dans leur garderie montreusienne, à de candides monitrices moins appareillées en matière de langage technique…
De la neige sur les palmiers et de notre Amarcord en 1956, avant un quart d'heure de persiflage signé Quentin Mouron...Ce mercredi 13 janvier. – La pelouse sous nos fenêtres et les palmiers du bord du lac étaient tout blancs, ce matin, et cela m’a réjoui comme lorsque nous découvrions la neige autour de la maison de notre enfance, sur les champs et les bois voisins, nous réjouissant le matin de nous lancer le soir en train de luges du haut au bas de la route traversant la quartier à la verticale - de cinq à dix luges « appondues » en attelages dont les pieds des grands faisaient office de crochets, et quelques jeunes mères du voisinage assuraient la circulation au carrefour pour laisser passer le convoi fou en stoppant les éventuelles voitures, à vrai dire rares en cet hivers 1956 où débarqueraient les réfugiés hongrois dans nos classes…DE QUOI RIRE. - Je me suis rappelé la neige de notre enfance après avoir lu, ce matin, le dernier texte de l’ami Quentin évoquant une garderie d’aujourd’hui dont les mioches sont devenus des « clients » jouant avec des « objets transitionnels » sous l’égide de la nouvelle pédagogie, mais Lady L. en sa compétence expérimentale me rappelle que ce vocabulaire remonte au moins aux années 50, du temps des Winnicot & Co, à quoi j’objecte qu’aujourd’hui ces termes font bel et bien « habits neufs »pour tout un chacun qui « psychologise » à tout-va, même si Quentin en remet une couche alors que nos petits-enfants ont encore droit, dans leur garderie montreusienne, à de candides monitrices moins appareillées en matière de langage technique… Cela étant, notre gâte-sauce a raison de pointer la jobardise, nouvelle ou pas, de la tendance actuelle des « sachants » à tout conceptualiser et cérébraliser, comme un certain Rabelais le faisait des pédants et des cagots il y a déjà bien des années ; et le même rire rabelaisien me revient à l’observation de ce qui, par les temps qui courent, devrait plutôt nous faire désespérer. Surtout, j’apprécie qu’un garçon de 30 ans et des poussières s’exprime avec autant de vivacité alors que les « millenials » semblent se pelotonner dans leurs terriers en s’envoyant de petits messages vertigineusement vides via Tik Tok…CONSULTATION . - L’excellent Docteur H. , seul à ma consulte de fin de matinée, et prenant sur lui de me piquer le doigt pour le contrôle de mon TP, me répond qu’il fait aller quand je lui demande des nouvelles de sa santé, puis il me propose de m’inscrire par Internet sur la liste d’attente du vaccin, et je lui réponds que ça se fera en temps voulu en précisant que je ne suis pas du tout opposé à la chose comme d’aucuns qui en font un nouveau thème de fronde idéologique à La flan; mais je ne lui dis rien de mes nouvelles douleurs articulaires ou périphériques ( un putain d’orteil que je croyais cassé) de crainte qu’il n'ajoute un médoc aux douze de l’ordonnance que je l’ai prié de renouveler au titre de ma contribution au soutien de la Big Pharma helvétique. Sur quoi je regagne notre sweet home du bord du lac oú je me reconnecter au site du Washington post en quête des dernières nouvelle de la House- mais c'est encore trop tôt...MIDNIGHT. - Après mes divers travaux du jour, une longue sieste, la balade raccourcie avec Snoopy sur les quais enneigés et un film gentiment extravagant sur Netflix (Un casse à Central Park), j'ai suivi en live les délibérations de la House aboutissant à la mise en accusation du Président pour incitation à la violence, suivies de la vidéo bonnement surréaliste où ledit Président, comme si de rien n'était, les yeux au ciel et s'en prenant à la fois à "la droite et la gauche", proclame son horreur de la violence, absolument contraire à ses principes moraux, etc.On croit rêver mais pas du tout: avec Donald la réalité est irréelle et le rêve une preuve aux assises du désirable...
Cela étant, notre gâte-sauce a raison de pointer la jobardise, nouvelle ou pas, de la tendance actuelle des « sachants » à tout conceptualiser et cérébraliser, comme un certain Rabelais le faisait des pédants et des cagots il y a déjà bien des années ; et le même rire rabelaisien me revient à l’observation de ce qui, par les temps qui courent, devrait plutôt nous faire désespérer. Surtout, j’apprécie qu’un garçon de 30 ans et des poussières s’exprime avec autant de vivacité alors que les « millenials » semblent se pelotonner dans leurs terriers en s’envoyant de petits messages vertigineusement vides via Tik Tok…CONSULTATION . - L’excellent Docteur H. , seul à ma consulte de fin de matinée, et prenant sur lui de me piquer le doigt pour le contrôle de mon TP, me répond qu’il fait aller quand je lui demande des nouvelles de sa santé, puis il me propose de m’inscrire par Internet sur la liste d’attente du vaccin, et je lui réponds que ça se fera en temps voulu en précisant que je ne suis pas du tout opposé à la chose comme d’aucuns qui en font un nouveau thème de fronde idéologique à La flan; mais je ne lui dis rien de mes nouvelles douleurs articulaires ou périphériques ( un putain d’orteil que je croyais cassé) de crainte qu’il n'ajoute un médoc aux douze de l’ordonnance que je l’ai prié de renouveler au titre de ma contribution au soutien de la Big Pharma helvétique. Sur quoi je regagne notre sweet home du bord du lac oú je me reconnecter au site du Washington post en quête des dernières nouvelle de la House- mais c'est encore trop tôt...MIDNIGHT. - Après mes divers travaux du jour, une longue sieste, la balade raccourcie avec Snoopy sur les quais enneigés et un film gentiment extravagant sur Netflix (Un casse à Central Park), j'ai suivi en live les délibérations de la House aboutissant à la mise en accusation du Président pour incitation à la violence, suivies de la vidéo bonnement surréaliste où ledit Président, comme si de rien n'était, les yeux au ciel et s'en prenant à la fois à "la droite et la gauche", proclame son horreur de la violence, absolument contraire à ses principes moraux, etc.On croit rêver mais pas du tout: avec Donald la réalité est irréelle et le rêve une preuve aux assises du désirable... -
À la recherche du "divin" Marcel
 À la Maison bleue, ce mardi 12 janvier. – Il fait ce matin un froid de canard, on sent la neige et je pense tendrement à notre père qui aurait eu 104 ans aujourd’hui et serait plus conforté que jamais dans sa détestation de la politique et des idéologies, dont j’ai en somme hérité en garçon hélas plus compliqué que lui, encore que je ne sache pas vraiment tout ce que dissimulait sa réserve timide et ses silences d’humble sage…ET DIEU LÀ-DEDANS ? - Je ne sais plus qui, Gide me semble-t-il, a remarqué qu’on ne trouvait pas une seule fois le mot Dieu dans les milliers de pages de la Recherche, et pourtant plus que jamais l’expression de « cathédrale de mots », dont je ne me rappelle pas plus le nom de l’auteur, me semble approprié à cet immense édifice de vocables et de sensations, de soupirs et de vannes, de pensers et de choses vues ou peintes, de musiques et d’amours polymorphes, de rêveries sans fin et d’inventaires de toute sorte, à commencer par le rêve éveillé qui marque le départ du premier volume autant que du dernier avec la musique picturale de sa première évocation de la chambre de Tansonville aux tapisseries merveilleuses et à la fenêtre donnant sur l’église de Combray, point fixe du Temps avec son clocher sur fond de ciel violacé, et nous tous alentour qui tournons comme des satellites juifs ou chrétiens, noirs comme l’âme du gigolo Morel ou solaires comme Robert de Saint-Jean…
À la Maison bleue, ce mardi 12 janvier. – Il fait ce matin un froid de canard, on sent la neige et je pense tendrement à notre père qui aurait eu 104 ans aujourd’hui et serait plus conforté que jamais dans sa détestation de la politique et des idéologies, dont j’ai en somme hérité en garçon hélas plus compliqué que lui, encore que je ne sache pas vraiment tout ce que dissimulait sa réserve timide et ses silences d’humble sage…ET DIEU LÀ-DEDANS ? - Je ne sais plus qui, Gide me semble-t-il, a remarqué qu’on ne trouvait pas une seule fois le mot Dieu dans les milliers de pages de la Recherche, et pourtant plus que jamais l’expression de « cathédrale de mots », dont je ne me rappelle pas plus le nom de l’auteur, me semble approprié à cet immense édifice de vocables et de sensations, de soupirs et de vannes, de pensers et de choses vues ou peintes, de musiques et d’amours polymorphes, de rêveries sans fin et d’inventaires de toute sorte, à commencer par le rêve éveillé qui marque le départ du premier volume autant que du dernier avec la musique picturale de sa première évocation de la chambre de Tansonville aux tapisseries merveilleuses et à la fenêtre donnant sur l’église de Combray, point fixe du Temps avec son clocher sur fond de ciel violacé, et nous tous alentour qui tournons comme des satellites juifs ou chrétiens, noirs comme l’âme du gigolo Morel ou solaires comme Robert de Saint-Jean… Cela étant, je vois là-dedans plus de « Dieu » que dans maints écrits l’invoquant les yeux au ciel, de même que je vois autant de « Dieu »dans les cathédrales de Monet ou dans les bœufs écorchés, les petits grooms ou les catins de Soutine, que dans les doctes commentaires des théologiens convoqués par la dernière série consacrée sur ARTE aux origines du christianisme, tout intéressants qu’ils soient…CHACUN SON PROUST. – Revoyant hier soir l’adaptation du Temps retrouvé par Raoul Ruiz, je m’étonnais une fois de plus, malgré les divergences de nos représentations, de la justesse de la « vision » du réalisateur qui prolonge la rêverie de Proust dans son dédale d’images à puissante valeur onirique, véritable labyrinthe de la mémoire dont les spirales s’enchaînent avec les plans à la fois chamboulés du point de vue temporel et assez fidèlement liés au texte, parfois cité à la lettre, commençant par la fin (la mort de l’écrivain auprès de Céleste et au milieu d’autres personnages) comme ce dernier récit marque réellement le début de toute la Recherche.
Cela étant, je vois là-dedans plus de « Dieu » que dans maints écrits l’invoquant les yeux au ciel, de même que je vois autant de « Dieu »dans les cathédrales de Monet ou dans les bœufs écorchés, les petits grooms ou les catins de Soutine, que dans les doctes commentaires des théologiens convoqués par la dernière série consacrée sur ARTE aux origines du christianisme, tout intéressants qu’ils soient…CHACUN SON PROUST. – Revoyant hier soir l’adaptation du Temps retrouvé par Raoul Ruiz, je m’étonnais une fois de plus, malgré les divergences de nos représentations, de la justesse de la « vision » du réalisateur qui prolonge la rêverie de Proust dans son dédale d’images à puissante valeur onirique, véritable labyrinthe de la mémoire dont les spirales s’enchaînent avec les plans à la fois chamboulés du point de vue temporel et assez fidèlement liés au texte, parfois cité à la lettre, commençant par la fin (la mort de l’écrivain auprès de Céleste et au milieu d’autres personnages) comme ce dernier récit marque réellement le début de toute la Recherche. Se discute évidemment le casting du film, où j’aurais préféré un Robert plus solaire, un Morel plus canaille et plus veule, une Albertine plus garçonne, une Madame Verdurin et un Charlus plus gras, une Odette moins classiquement belle que Catherine Deneuve, mais la modulation a sa propre cohérence et la mise en scène somptueuse relève aussi de la transposition à la Visconti, avec l’évolution bien marquée vers le théâtre décati et la misère sublime du final bal des spectres…Au demeurant, la distribution de Marcel lui-même, à dix ans ou à l’article de la mort, enfant ou adulte avec la « divine » Gilberte d’une Emmanuelle Béart en porcelaine translucide , me semble parfaite alors que le baroquisme de l’ensemble s’épure dans le temps « déconstruit » de la narration cinématographique.Or celui-ci est encore tout différent dans le très étonnant Journal de Charles Swann (Buchet-Chastel, 2008) du prof proustien américano-alsacien D.L. Grosvogel qui raconte à sa façon la rencontre de Swann avec Proust (pseudo tardif du jeune Marcel Dalgrouves auquel il transmet ses papiers) dès l’adolescence de celui-ci et jusqu’à l’affaire Dreyfus dont il suit les péripéties avec une attention aussi marquée que celle du personnage de la Recherche ; et cette façon de revivre les événements en temps linéaire jette une lumière nouvelle sur la prodigieuse reconstruction mémorielle du roman dans ses vrilles symphoniques…
Se discute évidemment le casting du film, où j’aurais préféré un Robert plus solaire, un Morel plus canaille et plus veule, une Albertine plus garçonne, une Madame Verdurin et un Charlus plus gras, une Odette moins classiquement belle que Catherine Deneuve, mais la modulation a sa propre cohérence et la mise en scène somptueuse relève aussi de la transposition à la Visconti, avec l’évolution bien marquée vers le théâtre décati et la misère sublime du final bal des spectres…Au demeurant, la distribution de Marcel lui-même, à dix ans ou à l’article de la mort, enfant ou adulte avec la « divine » Gilberte d’une Emmanuelle Béart en porcelaine translucide , me semble parfaite alors que le baroquisme de l’ensemble s’épure dans le temps « déconstruit » de la narration cinématographique.Or celui-ci est encore tout différent dans le très étonnant Journal de Charles Swann (Buchet-Chastel, 2008) du prof proustien américano-alsacien D.L. Grosvogel qui raconte à sa façon la rencontre de Swann avec Proust (pseudo tardif du jeune Marcel Dalgrouves auquel il transmet ses papiers) dès l’adolescence de celui-ci et jusqu’à l’affaire Dreyfus dont il suit les péripéties avec une attention aussi marquée que celle du personnage de la Recherche ; et cette façon de revivre les événements en temps linéaire jette une lumière nouvelle sur la prodigieuse reconstruction mémorielle du roman dans ses vrilles symphoniques… -
L'esprit contre la jactance
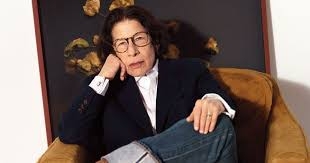 À propos de l'étourdissante causerie de Fran Lebowitz en scène et par les rues de New York, filmée par Martin Scorsese. Du souvenir de Léautaud et de la verve insolente à la Gore Vidal...Ce lundi 11 janvier. – Un long et bon téléphone matinal de mon ami René Z. me rappelle une fois de plus, dans le cercle proche de l’amitié durable (plus d’une trentaine d’années il me semble), la valeur inappréciable d'une conversation nourrie – tour d’horizon mondial en l’occurrence et dernières nouvelles des migrations d’oiseaux dont il est spécialiste à ses heures -, comme je me le disais hier soir en écoutant le savoureux monologue de Fran Lebowitz interrogée par Martin Scorsese dans son épatante série documentaire – la conversation tout opposée à la peste actuelle de la jactance pour ne rien dire.
À propos de l'étourdissante causerie de Fran Lebowitz en scène et par les rues de New York, filmée par Martin Scorsese. Du souvenir de Léautaud et de la verve insolente à la Gore Vidal...Ce lundi 11 janvier. – Un long et bon téléphone matinal de mon ami René Z. me rappelle une fois de plus, dans le cercle proche de l’amitié durable (plus d’une trentaine d’années il me semble), la valeur inappréciable d'une conversation nourrie – tour d’horizon mondial en l’occurrence et dernières nouvelles des migrations d’oiseaux dont il est spécialiste à ses heures -, comme je me le disais hier soir en écoutant le savoureux monologue de Fran Lebowitz interrogée par Martin Scorsese dans son épatante série documentaire – la conversation tout opposée à la peste actuelle de la jactance pour ne rien dire.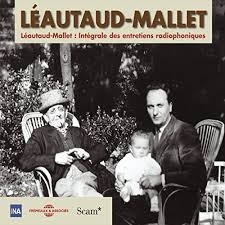 LÉAUTAUD À NEW YORK. – J’ignorais tout, avant-hier encore, de cette célébrité new yorkaise, comme la France des braves gens ignorait tout, sans doute, à la fin des années 50 du siècle dernier, de l’existence de l’écrivain Paul Léautaud, juste connu des happy few des milieux littéraire et théâtral parisiens, qui devint d’un jour à l’autre une « icône » nationale - pour utiliser ce terme ridicule de notre époque - à la suite de la diffusion de ses entretiens radiophoniques avec Robert Mallet.Un écrivain parlant des poètes et de ses animaux domestiques (ce qui revenait au même à ses yeux), de sa mère et des lorettes de sa jeunesse ou de son père souffleur à la Comédie française, de son enfance et du Fléau (sa maîtresse principale), de la décadence du bien-parler et de cent autres choses plus essentielles que Dieu à ses yeux, cela nous régale aujourd’hui encore sur CD et c’est irremplaçable...
LÉAUTAUD À NEW YORK. – J’ignorais tout, avant-hier encore, de cette célébrité new yorkaise, comme la France des braves gens ignorait tout, sans doute, à la fin des années 50 du siècle dernier, de l’existence de l’écrivain Paul Léautaud, juste connu des happy few des milieux littéraire et théâtral parisiens, qui devint d’un jour à l’autre une « icône » nationale - pour utiliser ce terme ridicule de notre époque - à la suite de la diffusion de ses entretiens radiophoniques avec Robert Mallet.Un écrivain parlant des poètes et de ses animaux domestiques (ce qui revenait au même à ses yeux), de sa mère et des lorettes de sa jeunesse ou de son père souffleur à la Comédie française, de son enfance et du Fléau (sa maîtresse principale), de la décadence du bien-parler et de cent autres choses plus essentielles que Dieu à ses yeux, cela nous régale aujourd’hui encore sur CD et c’est irremplaçable...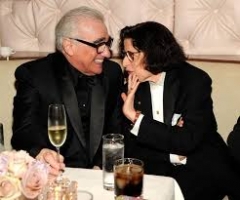 De la même façon, Fran Lebowitz capture littéralement l’attention du public réuni dans je ne sais quel théâtre new yorkais, devant les caméras d’un Scorsese souvent hilare, rien qu’a parler, mais avec quelle finesse sardonique, de son inaptitude enfantine au violoncelle et de la musique en général dont elle avoue ne savoir parler, de la médiocrité de la mémoire des chauffeurs de taxis new yorkais actuels (elle l’a été elle-même en sa jeunesse) par opposition à celles des cuisiniers capables de se rappeler la composition de 4000 plats, de ce qui serait advenu de Picasso si on l’avait obligé de fumer dehors, de la censure insupportable exercée par le politiquement correct , d’une vente aux enchères d’un chef-d’œuvre de la peinture adjugé 160 millions de dollars devant un public de snobs juste capable d’applaudir le montant en question en se foutant de la qualité de l’œuvre, de son ami Charlie Mingus fin bec ou de l’inconfort croissant des avions qu’elle préfère d’ailleurs ne pas prendre vu qu’il n’y a que New York l’invivable où il fait bon vivre selon elle…DE LA GÉNÉROSITÉ. – En écoutant, les yeux ravis (car le monologue est enrichi d’images de New York en tous ses états saisonniers) , cette causerie de l’élégante au chic bohème et aux mains aussi gracieusement volubiles que son bagou, je me suis réjoui de retrouver la faconde de grand seigneur non conformiste de Gore Vidal, autant que de saluer la générosité de Martin Scorsese qui, à part ses propres films, a dirigé naguère d’autres docus de premier ordre à la gloire des cinémas italien et américain ou du blues sous toutes ses coutures.Bien entendu, ces vieux New Yorkais font un peu « petit clan » à la Verdurin, joliment sûrs d’être le centre du monde artiste et intellectuel (on comprend la rage d’un parvenu inculte à la Donald Trump), et pourtant non : il y a chez eux un vrai respect du talent des autres, un vrai bon sens frotté d’humour et une liberté de parole qui fait merveille, autant que celle de Léautaud à Paris ou d’Oscar Wilde à Londres…À voir par conséquent : Martin Scorsese et Fran Lebowitz, Si c'était une ville, sur Netflix.
De la même façon, Fran Lebowitz capture littéralement l’attention du public réuni dans je ne sais quel théâtre new yorkais, devant les caméras d’un Scorsese souvent hilare, rien qu’a parler, mais avec quelle finesse sardonique, de son inaptitude enfantine au violoncelle et de la musique en général dont elle avoue ne savoir parler, de la médiocrité de la mémoire des chauffeurs de taxis new yorkais actuels (elle l’a été elle-même en sa jeunesse) par opposition à celles des cuisiniers capables de se rappeler la composition de 4000 plats, de ce qui serait advenu de Picasso si on l’avait obligé de fumer dehors, de la censure insupportable exercée par le politiquement correct , d’une vente aux enchères d’un chef-d’œuvre de la peinture adjugé 160 millions de dollars devant un public de snobs juste capable d’applaudir le montant en question en se foutant de la qualité de l’œuvre, de son ami Charlie Mingus fin bec ou de l’inconfort croissant des avions qu’elle préfère d’ailleurs ne pas prendre vu qu’il n’y a que New York l’invivable où il fait bon vivre selon elle…DE LA GÉNÉROSITÉ. – En écoutant, les yeux ravis (car le monologue est enrichi d’images de New York en tous ses états saisonniers) , cette causerie de l’élégante au chic bohème et aux mains aussi gracieusement volubiles que son bagou, je me suis réjoui de retrouver la faconde de grand seigneur non conformiste de Gore Vidal, autant que de saluer la générosité de Martin Scorsese qui, à part ses propres films, a dirigé naguère d’autres docus de premier ordre à la gloire des cinémas italien et américain ou du blues sous toutes ses coutures.Bien entendu, ces vieux New Yorkais font un peu « petit clan » à la Verdurin, joliment sûrs d’être le centre du monde artiste et intellectuel (on comprend la rage d’un parvenu inculte à la Donald Trump), et pourtant non : il y a chez eux un vrai respect du talent des autres, un vrai bon sens frotté d’humour et une liberté de parole qui fait merveille, autant que celle de Léautaud à Paris ou d’Oscar Wilde à Londres…À voir par conséquent : Martin Scorsese et Fran Lebowitz, Si c'était une ville, sur Netflix. -
Compagnon de route
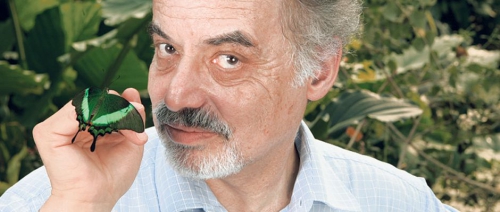
À propos d'un livre amical proposant un Bref aperçu des âges de la vie. Où Jean-François Duval prouve qu'on peut être philosophe en méditant assis devant son chien, un couteau à pamplemousse ou sa vieille mère peinant à nouer ses lacets...Jean-Francois Duval est à la fois un jeune fou et un vieux Monsieur posé, un enfant couratant en tous sens et le penseur de Rodin, un auto-stoppeur de tous les âges, l'homme de Cro-Magnon et le gérontonaute du futur - mais qui est au fond ce type qui ose dire JE et ne fait à vrai dire que ça sans s'exhiber pour autant devant sa webcam: plus discret, plus pudiquement réservé, plus débonnairement délicat ne se trouve pas souvent chez un JE qui n'est autre que notre NOUS multiface. Je suis donc nous sommes, pense en somme Jean-Francois Duval, et tous nos MOI volent en éclats après autant de mues, à travers les âges, pour se reconnaître dans cette universelle fiction verbale du JE. Au commencement était le verbe: JE suis donc Je pense donc j'écris, etc.

Marcel Proust a fait l'inventaire pléthorique, dans sa Recherche du temps perdu, des multiples MOI de son Narrateur (l'un de ses MOI et plus encore), et de leurs transformations à travers les années et les circonstances, de leur effacement occasionnel ou de leur réapparition fortuite sous un effet non moins imprévu (le coup de la madeleine ou du pavé inégal), mais le JE qui gribouille ses cahiers est unique par sa voix et son ton, comme est unique la voix du rabbi juif Ieshoua (dixit André Chouraqui) ou le ton du poète beatnik Charles Bukowski.
D'une façon analogue, mais avec un grain de sel de modestie narquoise, quelque part entre le pédagogue humoriste Roorda et le pédéraste ironiste Oscar Wilde, le compère Duval regroupe ses MOI et les nôtres pour leur faire danser le madison, cette danse en ligne des Sixties en laquelle il voit une sorte d'image du collectivisme bien tempéré, notant au passage que l'amer Michel Houellebecq gagnerait peut-être à s'y mettre. Bref, le JE du meilleur ami de sa chienne mène la danse et nos MOI fusionnent dans le temps en hologramme palimpsestueux...
Comme le précise Wikipedia, Jean-Francois Duval, auteur d'une dizaine de livres, a longtemps disposé de ce sésame qu'est une carte de presse, qui lui a permis de rencontrer quelques grands écrivains et autres clochards dont il a documenté la vie quotidienne. C'est à ce titre sans doute qu'il a rencontré Alexandre Jollien, qui le gratifie ici d'une préface très fraternelle.
Or c'est avec le même passe-passe qu'un jour, rencontrant moi aussi Jollien après la parution de son premier livre, je vécus cet épisode qui pourrait être du pur Duval. À savoir que, ce jour-là, après que le fameux Alexandre se fut pointé à notre rendez vous à bord d'une espèce de grand tricycle, et nous trouvant à la porte de son bureau, il me pria d'insérer à sa place la clef dans la serrure de celui-ci pour pallier sa maladresse d’handicapé - après quoi le philosophe, tel un albatros désempêtré de son grand corps patapouf, s'envolait sur les ailes de la pensée de Boèce !
J'ai fait allusion à la chienne de Duval, qui est elle-même une question philosophique sur pattes, mais une anecdote encore à propos de Jollien, en promenade avec son ami au parc Mon- Repos de Lausanne dont les volières jouxtent un bassin à poissons rouges. Alors Alexandre à Jean-François : "Plutôt oiseau où poisson ?" Et Jean-François: plutôt oiseau, avec des ailes pour gagner le ciel. Mais Alexandre : plutôt poisson, pour échapper aux barreaux...
Ainsi ce Bref aperçu des âges de la vie fait-il valoir de multiples points de vue qui, souvent, se relativisent les uns les autres sans forcément s'annuler, et c'est là que l'âge aussi joue sa partie.
Puisant ses éléments de sagesse un peu partout, Duval emprunte à Jean-Luc Godard, rencontré à Rolle au milieu de ses géraniums, l'idée selon laquelle les âges les plus réels de la vie sont la jeunesse et la vieillesse. Georges Simenon pensait lui aussi que l'essentiel d'une vie se grave dans les premières années, et à ce propos l'on retrouve, dans le livre de Duval, le charme et la totale liberté de parole des dictées du vieux romancier. Pour autant, Duval se garde d'idéaliser l'enfance ou l'âge de la retraite (ce seul mot d'ailleurs le fait rugir), pas plus que le familier des beatniks n'exalte les années 60 en général ou mai 68 en particulier.
Philosophiquement, au sens non académique en dépit de ses multiples allusions à Spinoza ou Sartre, Wittgenstein ou Camus, entre autres, Jean-Francois Duval s'inscrit à la fois dans la tradition des stoïciens à la Sénèque ou des voyageurs casaniers à la Montaigne, et plus encore dans la filiation des penseurs-poètes américains à la Thoreau, Emerson ou Whitman, avec une propension de conteur humoriste à la Chesterton ou à la Buzzati, toutes proportions gardées.À cet égard, Duval ne pose jamais ni ne cherche à en imposer. Un pédant le raccordera peut-être à l'empirio-criticisme pour sa façon de découvrir l'essence de l'esprit critique dans le couteau courbe à pamplemousse, mais il n'en demande pas tant, et sa façon de constater la disparition du sentiment sartro-camusien de l'Absurde relève de l'observation non dogmatique.
À juste titre aussi, Duval constate l'augmentation de la presbytie liée à l'âge, qui nous fait trouver plus courts les siècles séparant les fresques de Lascaux des inscriptions numériques de la Silicon Valley, et plus dense chaque instant vécu. Rêvant de son père, le fils décline franchement l'offre de poursuivre avec celui-ci une conversation sempiternelle dans un hypothétique au-delà, en somme content de ce qui a été échangé durant une vie ou le non-dit voire le secret gardent leur légitimité; et ses visites à sa mère nonagénaire ne sont pas moins émouvantes, mais sans pathos, même s’il se sait exclu du bal des clones futurs.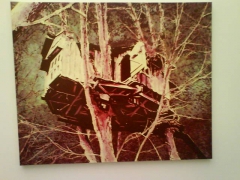
Un bon livre est, entre autres, une cabane où se réfugier des pluies acides et des emmerdeurs furieusement décidés à sauver le monde. Du moins Jean François Duval est-il un compère généreux , qui parie pour la bonne volonté pragmatique de nouvelles générations se rappelant plus ou moins les lendemains qui déchantent de diverses utopies meurtrières, sans cynisme pour autant.
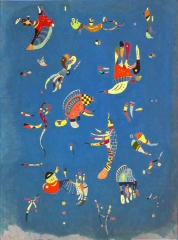
Dans ses observations de vieux youngster (ce salopard est né comme moi en 1947 !) Jean- François Duval constate que la marche distingue l'adulte de l'enfant (et du jogger ou du battant courant au bureau), de même que la station assise caractérise le penseur et son chien, tandis que le noble cheval dort debout dans la nuit pensive. Or la fantaisie n'est pas exclue de la vie du sage, que sa tondeuse à gazon mécanique emporte au-dessus des pelouses tel un ange de Chagall. Alexandre Vialatte dirait que c'est ainsi qu'Allah est grand, alors que Jollien souligne le bon usage de tous nos défauts (inconséquence et paresse comprises) dans notre effort quotidien de bien faire, rappelant l'exclamation de Whitman et la bonne fortune de chacun: "Un matin de gloire à ma fenêtre me satisfait davantage que tous les livres de métaphysique !"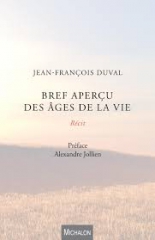 Jean François Duval, Bref aperçu des âges de la vie. Préface d’Alexandre Jollien. Michalon, 238p. 2017.
Jean François Duval, Bref aperçu des âges de la vie. Préface d’Alexandre Jollien. Michalon, 238p. 2017. -
C quoi l'Amérique ?
 À propos d’une affirmation péremptoire d'Emmanuel Macron, du chaos au Capitole, de Fran Lebowitz la sémillante New Yorkaise et du site Observateurs.ch fondu en complotisme primaire…À la Maison bleue, ce dimanche 10 janvier. – Après avoir annoncé aux Français qu’ils étaient « en guerre » contre la vie – nous autres experts en biologie moléculaire estimons en effet que le coronavirus est un élément de la diversité vivante à développement plus ou moins durable -, le sentencieux Emmanuel Macron a déclaré, l’autre soir, en anglais oral, que l’invasion du Capitole par la meute mécontente n’était pas l’Amérique.
À propos d’une affirmation péremptoire d'Emmanuel Macron, du chaos au Capitole, de Fran Lebowitz la sémillante New Yorkaise et du site Observateurs.ch fondu en complotisme primaire…À la Maison bleue, ce dimanche 10 janvier. – Après avoir annoncé aux Français qu’ils étaient « en guerre » contre la vie – nous autres experts en biologie moléculaire estimons en effet que le coronavirus est un élément de la diversité vivante à développement plus ou moins durable -, le sentencieux Emmanuel Macron a déclaré, l’autre soir, en anglais oral, que l’invasion du Capitole par la meute mécontente n’était pas l’Amérique. « Zisse ize notte America », a-t-il martelé en invoquant la démocratie qu’incarnerait par excellence « ze rieul America ». Et de fait, chacune et chacun d’entre nous, bêtement attachés à ce régime moins pire que tous les autres, selon cet autocrate féru de démocratie royaliste parlementaire qu’était Winston Churchill, se sera dit en assistant au reality show mis en scène par Donald Trump, que la démocratie n’est pas tout à fait « ça », mais quel rapport avec l’essentialité présumée de l’Amérique ?
« Zisse ize notte America », a-t-il martelé en invoquant la démocratie qu’incarnerait par excellence « ze rieul America ». Et de fait, chacune et chacun d’entre nous, bêtement attachés à ce régime moins pire que tous les autres, selon cet autocrate féru de démocratie royaliste parlementaire qu’était Winston Churchill, se sera dit en assistant au reality show mis en scène par Donald Trump, que la démocratie n’est pas tout à fait « ça », mais quel rapport avec l’essentialité présumée de l’Amérique ? John Wayne et les bérets verts sont-ils moins l’Amérique que Lincoln , et Charles Manson n’est-il pas autant l’Amérique que Martin Luther King ou Shaman Qanon l’emplumé antisémite et son compère à dégaine de poivrot de western trônant dans le fauteil de Nancy Pelosi ? Et les bombes américaines sur le Vietnam, Belgrad ou Bagdad, est-ce l’Amérique ou pas ?
John Wayne et les bérets verts sont-ils moins l’Amérique que Lincoln , et Charles Manson n’est-il pas autant l’Amérique que Martin Luther King ou Shaman Qanon l’emplumé antisémite et son compère à dégaine de poivrot de western trônant dans le fauteil de Nancy Pelosi ? Et les bombes américaines sur le Vietnam, Belgrad ou Bagdad, est-ce l’Amérique ou pas ?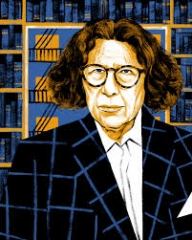 DU BIG LEBOWSKI à FRAN LEBOWICZ…- En regardant hier soir, sur Netflix, le documentaire que Marrtin Scorsese a consacré à la pétulante « icône » new yorkaise Fran Lebowicz, cabotinant avec brio devant une salle comble pour dire ce qu’est selon elle « ze rieul » New York, évoquant notamment la merveille quotidienne que c’est de déambuler tous les jours à pinces dans les rues, au risque d’être renversé par un ado conduisant son vélo des seuls coudes en tenant d’une main son smartphone et de l’autre une part de pizza, je me rappelai cette aube magique, hivernale et donnant aux buildings le profil élancé de pics de haute montagne, de part et d’autre de la 7e Avenue, quand pour la première fois je débarquai de Washington D.C. par le bus à l’enseigne du Lévrier (« ze famousse Greyound ») et me retrouvai dans les entrailles souterraines de Times Square grouillantes de camés et de paumés tirés de leur dernier essai de sommeil par les cops, avant de surgir au grand air de janvier 1981 et d’entreprendre, fasciné, la descente de l’Avenue jusqu’à l’embarquement de Staten Island, tout au bout de Manhattan - et de l’ile ensuite de voir « ça » qu’auront découvert les émigrants au début du siècle: New York debout !...Au début de la pandémie, le New Yorkais de souche allemande Donald Trump eût aimé faire croire à sa clientèle mélangée, nostalgiques du Big Lebowski compris, que son New York n’était pas celui du gouverneur démocrate Andrew Cuomo, mais plutôt celui d’une certain autre ex-Rital au nom de Giuliani et à gueule tordue de Padrone – le même qui combat la Maffia dans le film qu’on sait...Or Fran Lebowicz, ancienne complice de Warhol qu’on donne pour une nouvelle Dorothy Parker, mettra tout le monde d’accord en déclarant que ce qui caractérise New York, au dire surtout des psychiatres, est le bruit dont tous leurs patients se plaignent plus que de leurs relations avec Mère ou Père, et que ce bruit, combiné avec l’odeur du métro, résume la « musique » de New York, etc.
DU BIG LEBOWSKI à FRAN LEBOWICZ…- En regardant hier soir, sur Netflix, le documentaire que Marrtin Scorsese a consacré à la pétulante « icône » new yorkaise Fran Lebowicz, cabotinant avec brio devant une salle comble pour dire ce qu’est selon elle « ze rieul » New York, évoquant notamment la merveille quotidienne que c’est de déambuler tous les jours à pinces dans les rues, au risque d’être renversé par un ado conduisant son vélo des seuls coudes en tenant d’une main son smartphone et de l’autre une part de pizza, je me rappelai cette aube magique, hivernale et donnant aux buildings le profil élancé de pics de haute montagne, de part et d’autre de la 7e Avenue, quand pour la première fois je débarquai de Washington D.C. par le bus à l’enseigne du Lévrier (« ze famousse Greyound ») et me retrouvai dans les entrailles souterraines de Times Square grouillantes de camés et de paumés tirés de leur dernier essai de sommeil par les cops, avant de surgir au grand air de janvier 1981 et d’entreprendre, fasciné, la descente de l’Avenue jusqu’à l’embarquement de Staten Island, tout au bout de Manhattan - et de l’ile ensuite de voir « ça » qu’auront découvert les émigrants au début du siècle: New York debout !...Au début de la pandémie, le New Yorkais de souche allemande Donald Trump eût aimé faire croire à sa clientèle mélangée, nostalgiques du Big Lebowski compris, que son New York n’était pas celui du gouverneur démocrate Andrew Cuomo, mais plutôt celui d’une certain autre ex-Rital au nom de Giuliani et à gueule tordue de Padrone – le même qui combat la Maffia dans le film qu’on sait...Or Fran Lebowicz, ancienne complice de Warhol qu’on donne pour une nouvelle Dorothy Parker, mettra tout le monde d’accord en déclarant que ce qui caractérise New York, au dire surtout des psychiatres, est le bruit dont tous leurs patients se plaignent plus que de leurs relations avec Mère ou Père, et que ce bruit, combiné avec l’odeur du métro, résume la « musique » de New York, etc. ET LA SUISSE, C’EST « ÇA » ? - Enfin ce que je me disais, ce matin, en me rappelant mon dernier surf sur le site qu’on pourrait dire de la SWITZERLAND FIRST, à l’enseigne d’Observateurs.ch dont le moindre papier récent est censuré par Facebook pour fake news avérées, c’est que la démocratie suisse est aussi ça : cette liberté de prétendre que le chaos du Capitole est un coup monté des démocrates et des extrémistes de gauche, que jamais on n’a censuré pareillement la vérité vraie seule accessible au porte-drapeau Uli Windisch (patron du site érigeant le politiquement incorrect en nouveau dogme) passé d’un sociologisme de centre droite à un fanatisme chauvin qui lui fait voir partout l’Hydre de gauche.Pas plus délirant, évidemment, que QAnon-Shaman qui prétend que les Alpes suisse sont truffées de repaires de pédophiles et de bunkers dans lesquels nous préparons le clonage satanique du Futur ?Yes Mum, la Suisse est à la fois Ziegler le Guillaume Tell gauchiste au costar trois-pièces et Blocher le milliardaire nationaliste apprécié des Chinois, et plus que jamais je me sens redevable au coronavirus apocalyptique de faire mieux ressortir cette évidence énoncée par Charles-Albert Cingria, à savoir que « la société est une viscosité et une fiction », et que la vie est la pire chose qui pouvait nous arriver, et la meilleure avec ou sans vaccin, etc.
ET LA SUISSE, C’EST « ÇA » ? - Enfin ce que je me disais, ce matin, en me rappelant mon dernier surf sur le site qu’on pourrait dire de la SWITZERLAND FIRST, à l’enseigne d’Observateurs.ch dont le moindre papier récent est censuré par Facebook pour fake news avérées, c’est que la démocratie suisse est aussi ça : cette liberté de prétendre que le chaos du Capitole est un coup monté des démocrates et des extrémistes de gauche, que jamais on n’a censuré pareillement la vérité vraie seule accessible au porte-drapeau Uli Windisch (patron du site érigeant le politiquement incorrect en nouveau dogme) passé d’un sociologisme de centre droite à un fanatisme chauvin qui lui fait voir partout l’Hydre de gauche.Pas plus délirant, évidemment, que QAnon-Shaman qui prétend que les Alpes suisse sont truffées de repaires de pédophiles et de bunkers dans lesquels nous préparons le clonage satanique du Futur ?Yes Mum, la Suisse est à la fois Ziegler le Guillaume Tell gauchiste au costar trois-pièces et Blocher le milliardaire nationaliste apprécié des Chinois, et plus que jamais je me sens redevable au coronavirus apocalyptique de faire mieux ressortir cette évidence énoncée par Charles-Albert Cingria, à savoir que « la société est une viscosité et une fiction », et que la vie est la pire chose qui pouvait nous arriver, et la meilleure avec ou sans vaccin, etc. -
Ce qu'ils disent vraiment
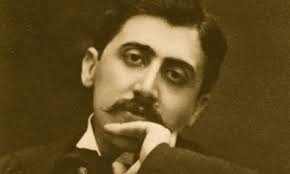 De « ces choses-là » et de La ChoseÀ propos de la réalité réelle que nous vivons et de ce qu’on en peut dire. De ce que disent vraiment Proust et, à leur façon, Céline ou Jouhandeau..Ce vendredi 8 janvier. – Dès la début de la pandémie en cours, j’en ai perçu le tour apocalyptique, au sens propre d'une «révélation », mais pas au sens figuré de la théologie : au sens d’un dévoilement, lequel m’est apparu avant tout comme une mise au jour de l’inanité des idéologies, des théories complotistes ou non, et de tout ce qui fait l’impasse sur la complexité du phénomène et sa réalité bêtement naturelle, si l’on prend la nature comme un grand corps malmené par notre espèce.Cette idée m’est venue avant ma découverte de La vie dans l’univers du physicien Freeman Dyson, qui n’a fait qu’affermir mon intuition avec des arguments combinant la Science et la Poésie, sans que l’une n’interfère avec l’autre comme l’aurait voulu un Jean Guitton berné par les frères Bogdanov et tant d’adeptes du Nouvel Âge plus ou moins escrocs ou escroqués.Cela dit on aura vu proliférer, par rapport à la pandémie, cette nouvelle semi-imposture du «débunkage» qui prétend en finir avec le complotisme au moyen de nouveaux arguments ressortissant eux aussi à une idéologie pseudo-scientifique à relents médiatico-politiques, et le serpent de se mordre la queue à l’enseigne d’une déconstruction relançant la fabrication de l’ignorance – le fait restant têtu, comme le rappelle humblement Dyson, selon quoi notre ignorance reste à peu près entière…CE QU’ON PEUT DIRE. – L’époque est à l’ingénieur et au technicien, comme le rappelle le charmant vulgarisateur qu’incarne Yuval Noah Harari, abusivement taxé de «philosophe», et c’est en somme rassurant qu’on sache à quel guichet s’adresser pour les réclamations, mais la Littérature, la Poésie, l’Art sont autre chose me dis-je en revenant une fois de plus aux trios de Mendelssohn ou au piano de Schubertn avant de reprendre la lecture du Temps retrouvé dont je me demande, tout à trac, ce que signifient les premières vingt pages, jusqu’à l’impayable pastiche de Goncourt...
De « ces choses-là » et de La ChoseÀ propos de la réalité réelle que nous vivons et de ce qu’on en peut dire. De ce que disent vraiment Proust et, à leur façon, Céline ou Jouhandeau..Ce vendredi 8 janvier. – Dès la début de la pandémie en cours, j’en ai perçu le tour apocalyptique, au sens propre d'une «révélation », mais pas au sens figuré de la théologie : au sens d’un dévoilement, lequel m’est apparu avant tout comme une mise au jour de l’inanité des idéologies, des théories complotistes ou non, et de tout ce qui fait l’impasse sur la complexité du phénomène et sa réalité bêtement naturelle, si l’on prend la nature comme un grand corps malmené par notre espèce.Cette idée m’est venue avant ma découverte de La vie dans l’univers du physicien Freeman Dyson, qui n’a fait qu’affermir mon intuition avec des arguments combinant la Science et la Poésie, sans que l’une n’interfère avec l’autre comme l’aurait voulu un Jean Guitton berné par les frères Bogdanov et tant d’adeptes du Nouvel Âge plus ou moins escrocs ou escroqués.Cela dit on aura vu proliférer, par rapport à la pandémie, cette nouvelle semi-imposture du «débunkage» qui prétend en finir avec le complotisme au moyen de nouveaux arguments ressortissant eux aussi à une idéologie pseudo-scientifique à relents médiatico-politiques, et le serpent de se mordre la queue à l’enseigne d’une déconstruction relançant la fabrication de l’ignorance – le fait restant têtu, comme le rappelle humblement Dyson, selon quoi notre ignorance reste à peu près entière…CE QU’ON PEUT DIRE. – L’époque est à l’ingénieur et au technicien, comme le rappelle le charmant vulgarisateur qu’incarne Yuval Noah Harari, abusivement taxé de «philosophe», et c’est en somme rassurant qu’on sache à quel guichet s’adresser pour les réclamations, mais la Littérature, la Poésie, l’Art sont autre chose me dis-je en revenant une fois de plus aux trios de Mendelssohn ou au piano de Schubertn avant de reprendre la lecture du Temps retrouvé dont je me demande, tout à trac, ce que signifient les premières vingt pages, jusqu’à l’impayable pastiche de Goncourt... Que dit Proust entre les lignes en nous bassinant à propos des goûts supposé de Robert de Saint-Jean, passé de Rachel à Morel, des préférences supposées d’Albertine et même de Gilberte, et qu’en a-t-on à fiche de savoir si tel « en est » ou « n'en n’est pas » après les mêmes observations remâchées sur des centaines de pages dans Sodome et Gomorrhe, à croire que Proust n’est qu’un obsédé de ces choses-là ?En fait plus j’« écoute » le Narrateur et plus j’entends une autre musique, qui est celle non de la conformité moralement ou socialement conforme de ces choses-là, mais de la réalité poétique et musicale de La Chose, qui est essentiellement ce qui est dit vraiment sous l’apparence de ce qui est écrit, à savoir précisément cette musique, et picturale, sensuelle et sexuelle (sans une seule « scène explicite») que Céline feint de ne pas saisir alors qu’il dit autrement la même chose.
Que dit Proust entre les lignes en nous bassinant à propos des goûts supposé de Robert de Saint-Jean, passé de Rachel à Morel, des préférences supposées d’Albertine et même de Gilberte, et qu’en a-t-on à fiche de savoir si tel « en est » ou « n'en n’est pas » après les mêmes observations remâchées sur des centaines de pages dans Sodome et Gomorrhe, à croire que Proust n’est qu’un obsédé de ces choses-là ?En fait plus j’« écoute » le Narrateur et plus j’entends une autre musique, qui est celle non de la conformité moralement ou socialement conforme de ces choses-là, mais de la réalité poétique et musicale de La Chose, qui est essentiellement ce qui est dit vraiment sous l’apparence de ce qui est écrit, à savoir précisément cette musique, et picturale, sensuelle et sexuelle (sans une seule « scène explicite») que Céline feint de ne pas saisir alors qu’il dit autrement la même chose.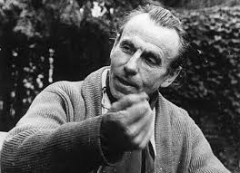 Proust selon Céline, on se le rappelle, ce serait l’histoire de ce mec qui consacre cinquante pages à se demander comment Totor va s’y prendre pour enculer ou se faire enculer par Tatave, mais Céline sait très bien, dans sa gouailleuse mauvaise foi, que «ces choses » n’ont à vrai dire rien à voir avec La Chose, qu’il appelle lui-même tantôt « l’émotion » et tantôt la « petite musique ».
Proust selon Céline, on se le rappelle, ce serait l’histoire de ce mec qui consacre cinquante pages à se demander comment Totor va s’y prendre pour enculer ou se faire enculer par Tatave, mais Céline sait très bien, dans sa gouailleuse mauvaise foi, que «ces choses » n’ont à vrai dire rien à voir avec La Chose, qu’il appelle lui-même tantôt « l’émotion » et tantôt la « petite musique ».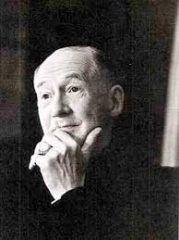 LA MARQUE DU GRAND ÉCRIVAIN. – Dans ses Divertissements, Marcel Jouhandeau, à propos de Molière, se demande ce qui caractérise celui que, trop souvent par abus de langage, on qualifie de « grand écrivain ». Et de constater que « les écrivains de qualité pullulent, les écrivains de talent se multiplient à vue d’œil, mais de grands écrivains il n’y en a pas plus de deux ou trois par siècle ». Et de préciser ensuite que deux critères permettent de reconnaître un éventuel grand écrivain , « l’importance du monde qu’il a ressuscité ou créé, comme Saint-Simon, Balzac, Stendhal et Proust, ou bien l’originalité de son style, du moment qu’on ne peut lire une phrase de lui sans la reconnaître pour sienne, comme il arrive en présence d’une ligne de Pascal, de Chateaubriand, de Chamfort ou de Jules Renard », et l’on pourrait ajouter : de Céline, ou encore: de Jouhandeau lui-même.De la même façon, lisant les évocations furieusement érotiques de Jouhandeau le catho grand seigneur de souche terrienne et de goûts particulier, dans ses Pages égarées sublimement dévolues à la glorification du cul et de la flamberge, je me dis que là non plus ce n’est pas de « ces choses » passionnant les tabloïds qu’il est question là, mais de La Chose qui est affaire de monde recréé et de musique…Freeman J. Dyson, La vie dans l'univers, réflexions d'un physicien. Gallimard, 2009.Marcel Jouhandeau. Divertissements, Gallimard 1965; Pages égarées, Pauvert 1980.
LA MARQUE DU GRAND ÉCRIVAIN. – Dans ses Divertissements, Marcel Jouhandeau, à propos de Molière, se demande ce qui caractérise celui que, trop souvent par abus de langage, on qualifie de « grand écrivain ». Et de constater que « les écrivains de qualité pullulent, les écrivains de talent se multiplient à vue d’œil, mais de grands écrivains il n’y en a pas plus de deux ou trois par siècle ». Et de préciser ensuite que deux critères permettent de reconnaître un éventuel grand écrivain , « l’importance du monde qu’il a ressuscité ou créé, comme Saint-Simon, Balzac, Stendhal et Proust, ou bien l’originalité de son style, du moment qu’on ne peut lire une phrase de lui sans la reconnaître pour sienne, comme il arrive en présence d’une ligne de Pascal, de Chateaubriand, de Chamfort ou de Jules Renard », et l’on pourrait ajouter : de Céline, ou encore: de Jouhandeau lui-même.De la même façon, lisant les évocations furieusement érotiques de Jouhandeau le catho grand seigneur de souche terrienne et de goûts particulier, dans ses Pages égarées sublimement dévolues à la glorification du cul et de la flamberge, je me dis que là non plus ce n’est pas de « ces choses » passionnant les tabloïds qu’il est question là, mais de La Chose qui est affaire de monde recréé et de musique…Freeman J. Dyson, La vie dans l'univers, réflexions d'un physicien. Gallimard, 2009.Marcel Jouhandeau. Divertissements, Gallimard 1965; Pages égarées, Pauvert 1980. -
Que du bonheur...

Ce jeudi 7 janvier.- Quelle soirée captivante nous aurons vécue dans la nuit du 6 au 7 janvier, coïncidant avec la journée très venteuse filant ses heures autour du vénérable édifice à silhouette de pièce montée de pâtisserie que figure le Capitole de Washington D.C. dont je me suis rappelé, dans la foulée, le triste état de ruine après l’attaque terroriste qu’il subit au début de la fameuse série Designated survivor - toujours à découvrir sur Netflix pour qui est en manque de dystopies.
Que d’intéressantes observations nous auront été offertes pendant ces heures évidemment «historiques», selon l’expression préférée des chroniqueurs mondains ou sportifs, et à plusieurs strates spatio-temporelles, en ce qui me concerne, puisque je suivais les actualités américaines en « live » sur les sites alternés de CNN, du Guardian anglais et du Washington Post, tout en regardant d’un œil latéral un documentaire consacré à l’originale destinée du prince Charles et en relisant, de l’autre, le dernier chapitre du premier jet de mon roman panoptique où je rebrasse « tout ça » et le reste...
LOGORRHÉE .- J’attendais l’apparition du président Donald Trump lorsque mon ami écrivain Fabrice P., reconnu jusqu’à Singapour et Boston pour ses travaux en matière de logique et de philosophie des sciences, m’a appelé au téléphone pour notre entretien quasi hebdomadaire sur l’état de nos nations respectives, et j’ai pris note de ses légitimes inquiétudes quant à l’avenir des équilibres démocratiques, fort de sa longue expérience de la vie américaine et de ce qu’il observe aujourd’hui dans la Ville-lumière en état de couvre-feu.
Lui pas plus que moi n’est attiré par quelque théorie complotiste que ce soit, mais notre sens partagé du comique n’exclut pas certain pessimisme – avec le rire forcé qui en procède; et c’est bel et bien le parti d’en rire que j’ai pris ensuite à l’écoute du discours du mafioso présidentiel aussi abondant et vide que ceux de feu Fidel Castro, quoique plutôt genre bateleur de grande surface ou télévangéliste de plage de riches, etc.
Sur le même registre du délire compulsif et de l'idéologie vaseuse, je me suis rappelé en outre nos discours de soixante-huitards, et plus précisément une certaine nuit à la Sorbonne où, avec mon ami carabin Reynald, nous écoutions, petits terriens sidérés, nos camarades Français à la folle éloquence sonnant le creux, aussi interloqués et dubitatifs que le personnage de Ramuz confronté à la même rhétorique sous la Commune et concluant: bah, Samuel, cela n'est pas pour toi...
DE L’HYBRIS.- Comme me le faisait remarquer mon ami logicien ferré en matière d’aberrance maniaque, l’ubuesque Donald est un infantile trépignant que son impériale vanité empêchera jusqu’au bout de ne pas incarner le Winner, ligoté par son hybris en sociopathe de l’espèce que les Anciens traitaient avec une rigueur qui s’est perdue, hélas ou tant mieux - à vrai dire nos douces natures préfèrent la fessée, symbolique ou manu militari, à la peine de mort.
On le voyait d'ailleurs venir dès ses jeunes années de champion de l'immobilier, n'acceptant jamais la défaite ni la moindre contradiction, et ne trouvant à tout coup que la parade de l'argent pour faire taire ses opposants. Suétone et Plutarque avaient décrit le phénomène en leur temps, mais l'orgueil funeste est une denrée durable.

AUTOGOAL.- De graves mines politiciennes ont invoqué, à la suite des désordres iconoclastes de la nuit dernière, la fragilité de la démocratie , dont je me suis étonné au contraire de la solide résistance face à la meute. Celle-ci d’ailleurs était très mélangée, faite sans doute de plus de braves gens que de fous furieux. Quant à la police, elle s'est montrée d'une placidité quasi angélique, toute de retenue sous les quolibets et les crachats...
À vrai dire, l’anarchiste en savates que je suis, tendance Brassens ou Thoreau (ou Montaigne ou Tchekhov, selon les jours) a plutôt souri en voyant tels chenapans hirsutes à tenues semi-guerrières négligées, poser leurs culs mal lavés sur tel ou tel trône pseudo sacré, et comment ne pas rire du paltoquet présidentiel, même si sa bêtise reste dangereuse ?
Pourtant, en optimiste décidément irresponsable, je vois plutôt une chance, dans le formidable autogoal du démagogue, de distinguer plus nettement le monstre du pouvoir abusif dont la seule légitimation est l’argent, et peut-être de mieux s’en protéger.
Or les braves gens ne veulent ils que de ça ? Je n’en suis pas sûr du tout. J’inclinerais plutôt à voir le bon fond du cretinus terrestris. Je me rappelle à ce propos ce que me disait Alexandre Zinoviev à propos du pouvoir soviétique, à la fin des années 70 : que les gens l’auront voulu. Avec l’avantage, par rapport au mal occidental, de voir mieux le monstre. Et les braves gens ont viré celui-ci, en attendant de virer Ubu et le virus pour ne plus se consacrer ensuite, n’est-ce pas, qu'à la recherche sempiternelle du bonheur, etc.
-
Cher Journal
Dans notre lit, ce mercredi 6 janvier.- Quelle impulsion soudaine et irrépressible m’a fait revenir hier soir, une fois de plus, au Temps retrouvé, après avoir regardé en diagonale les dix épisodes nouveaux de la série américaine Kobra Kai, évidemment soulagé, comme des millions de spectatrices et de spectateurs accros à ce feuilleton de par le monde , de voir le jeune et beau latino Miguelito sortir du coma où l’a plongé sa terrible chute dans l’escalier du lycée à la fin du combat qui l’a opposé à Roddie.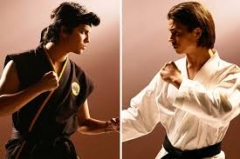 Y a-t-il un lien entre cette série déconseillée aux moins de 13 ans, dont la finalité est en somme un inventaire des diverses façons d’exercer ou de sublimer la violence travaillant la société, et le travail particulier du Narrateur marmonnant dans sa chambre de Tansonville tandis que le jour décline sur le clocher de l’église de Combray dont la silhouette se découpe dans le carré violacé de la fenêtre ? Peut-être, me dis-je à l’instant aux côtés de Lady L. qui, après les dernières nouvelles du Washington post numérique, revient à ses patiences et m’explique que leur enchaînement logique la détend alors qu’elle se bat ces jours avec les schémas de tricot super-compliqués que lui transmet notre fille S. revenue de Californie depuis une bonne année...QUE TOUT SE TIENT.- À nos considérations matinales le chien endormi sur le duvet ne prend aucune part, et pourtant il fait partie du tableau en tant que ressortissant de la Nature apprivoisée, et sa présence aussi nous détend, mieux que le ferait un molosse ou un chinchilla, en fox à poil doux et caractère égal, resté vif à bientôt neuf ans.Tout se tient: la placidité du chien qui se sait aussi en sécurité que nos petits-enfants, là-haut dans la neige de La Désirade, le confort à mes yeux effrayant dans lequel vit ces jours l’ami Roland J. dans sa prison du Lausanne-Palace et la situation générale du monde comme arrêté, en suspens, qu’on pourrait dire à la question avec le double sens d’une interrogation générale et d’un supplice particulier.À DISTANCE.- Dans l’introduction à son dernier essai intitulé Dans la tempête virale, Slavoj Zizek évoque la question, combien actuelle, de la distance obligée, rappelant la réponse du rabbi Iéshouah à Marie Madeleine, Noli me tangere (évangile de Jean, 20, 17) et ce que représente, dans notre rapport aux autres, le fait de ne pas les toucher physiquement. Et de produire cette belle citation du jeune Hegel : « L’être humain est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit, une richesse de représentations, d’images infiniment multiples dont aucune précisément ne lui vient à l’esprit ou qui ne sont pas en tant que présentes (…) C’est cette nuit qu’on découvre lorsqu’on regarde un homme dans les yeux ».Et Zizek d’enchaîner : « Aucun coronavirus ne peut nous enlever cela. On peut donc espérer que la distanciation physique vienne même renforcer l’intensité de notre lien aux autres ». Ce que, personnellement, je vis « moralement » depuis des années à l’enseigne de ce que René Girard appelle la « médiation externe », à savoir la distance excluant ou du moins atténuant la rivalité mimétique et le jeu chaplinesque des chaises de coiffeur où chacun renchérit.Sous l’effet de la « médiation interne », Don Quichotte et Sancho en restent à une rivalité toujours tendue, alors que la passion partagée de Quichotte et du jeune bachelier pour les romans de chevalerie, image parfaite de la médiation externe, assure à leur relation la liberté requise. C’est ainsi que mon amitié avec le Marquis, mon cher Gérard, est restée pure et libre un peu moins de cinquante ans durant alors que tant d’autres de mes relations amicales ou amoureuses ont foiré par manque de distance, l’espace d’une cravate (même virtuelle) ou d’une cravache, comme je le vis depuis quelque temps avec mes compères Quentin et Fabrice…
Y a-t-il un lien entre cette série déconseillée aux moins de 13 ans, dont la finalité est en somme un inventaire des diverses façons d’exercer ou de sublimer la violence travaillant la société, et le travail particulier du Narrateur marmonnant dans sa chambre de Tansonville tandis que le jour décline sur le clocher de l’église de Combray dont la silhouette se découpe dans le carré violacé de la fenêtre ? Peut-être, me dis-je à l’instant aux côtés de Lady L. qui, après les dernières nouvelles du Washington post numérique, revient à ses patiences et m’explique que leur enchaînement logique la détend alors qu’elle se bat ces jours avec les schémas de tricot super-compliqués que lui transmet notre fille S. revenue de Californie depuis une bonne année...QUE TOUT SE TIENT.- À nos considérations matinales le chien endormi sur le duvet ne prend aucune part, et pourtant il fait partie du tableau en tant que ressortissant de la Nature apprivoisée, et sa présence aussi nous détend, mieux que le ferait un molosse ou un chinchilla, en fox à poil doux et caractère égal, resté vif à bientôt neuf ans.Tout se tient: la placidité du chien qui se sait aussi en sécurité que nos petits-enfants, là-haut dans la neige de La Désirade, le confort à mes yeux effrayant dans lequel vit ces jours l’ami Roland J. dans sa prison du Lausanne-Palace et la situation générale du monde comme arrêté, en suspens, qu’on pourrait dire à la question avec le double sens d’une interrogation générale et d’un supplice particulier.À DISTANCE.- Dans l’introduction à son dernier essai intitulé Dans la tempête virale, Slavoj Zizek évoque la question, combien actuelle, de la distance obligée, rappelant la réponse du rabbi Iéshouah à Marie Madeleine, Noli me tangere (évangile de Jean, 20, 17) et ce que représente, dans notre rapport aux autres, le fait de ne pas les toucher physiquement. Et de produire cette belle citation du jeune Hegel : « L’être humain est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit, une richesse de représentations, d’images infiniment multiples dont aucune précisément ne lui vient à l’esprit ou qui ne sont pas en tant que présentes (…) C’est cette nuit qu’on découvre lorsqu’on regarde un homme dans les yeux ».Et Zizek d’enchaîner : « Aucun coronavirus ne peut nous enlever cela. On peut donc espérer que la distanciation physique vienne même renforcer l’intensité de notre lien aux autres ». Ce que, personnellement, je vis « moralement » depuis des années à l’enseigne de ce que René Girard appelle la « médiation externe », à savoir la distance excluant ou du moins atténuant la rivalité mimétique et le jeu chaplinesque des chaises de coiffeur où chacun renchérit.Sous l’effet de la « médiation interne », Don Quichotte et Sancho en restent à une rivalité toujours tendue, alors que la passion partagée de Quichotte et du jeune bachelier pour les romans de chevalerie, image parfaite de la médiation externe, assure à leur relation la liberté requise. C’est ainsi que mon amitié avec le Marquis, mon cher Gérard, est restée pure et libre un peu moins de cinquante ans durant alors que tant d’autres de mes relations amicales ou amoureuses ont foiré par manque de distance, l’espace d’une cravate (même virtuelle) ou d’une cravache, comme je le vis depuis quelque temps avec mes compères Quentin et Fabrice…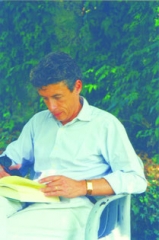 JOURNAL DE BORD .- À propos de Fabrice P., justement, qui m’écrivait l’autre jour qu’il vivait la lecture de Proust sans discontinuer, je me dis aussi que tout se tient, entre la phrase de la Recherche et les siennes, par la précision sensible extrême de la langue et par la porosité « musicienne » avec laquelle ces deux natures délicates de frêles jeunes gens (à la soixantaine Fabrice reste aussi bien d’une sorte de gracilité juvénile, sans compter ses foulards et talonnettes) aux esprits aussi puissants que retors, captent et réfractent dans leurs écrits ce qu’on dit aujourd’hui, assez joliment, le multivers, chacun participant à sa façon très libre à ce que Cowper Powys appelle le « journal de bord de l’humanité ».Or je me dis à l’instant, assis à ma table moulurée d’importation javanaise, devant mon Hyper Mac et bercé par la chanson Rester partir de Francis Cabrel diffusée par mon appli Bluetooth, que ma nouvelle pratique du journal continu, amorcée ce 1er janvier 2021, va constituer, huitième volume de mes Lectures du monde et par delà les collages diachroniques ou non datés de mes carnets, une manière de Cher Journal en temps réel, dont les apparences linéaires ne seront qu’une prolongation de ma pratique littéraire du judo, jusqu’à ce que certaine Dame, en kimono seyant, se pointe sur le dojo…
JOURNAL DE BORD .- À propos de Fabrice P., justement, qui m’écrivait l’autre jour qu’il vivait la lecture de Proust sans discontinuer, je me dis aussi que tout se tient, entre la phrase de la Recherche et les siennes, par la précision sensible extrême de la langue et par la porosité « musicienne » avec laquelle ces deux natures délicates de frêles jeunes gens (à la soixantaine Fabrice reste aussi bien d’une sorte de gracilité juvénile, sans compter ses foulards et talonnettes) aux esprits aussi puissants que retors, captent et réfractent dans leurs écrits ce qu’on dit aujourd’hui, assez joliment, le multivers, chacun participant à sa façon très libre à ce que Cowper Powys appelle le « journal de bord de l’humanité ».Or je me dis à l’instant, assis à ma table moulurée d’importation javanaise, devant mon Hyper Mac et bercé par la chanson Rester partir de Francis Cabrel diffusée par mon appli Bluetooth, que ma nouvelle pratique du journal continu, amorcée ce 1er janvier 2021, va constituer, huitième volume de mes Lectures du monde et par delà les collages diachroniques ou non datés de mes carnets, une manière de Cher Journal en temps réel, dont les apparences linéaires ne seront qu’une prolongation de ma pratique littéraire du judo, jusqu’à ce que certaine Dame, en kimono seyant, se pointe sur le dojo… -
To be or not to be MUM
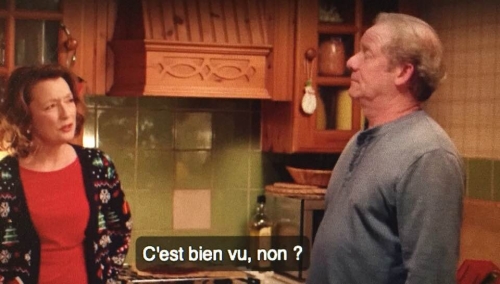 À la Maison bleue, ce mardi 5 janvier. – Pendant que, tôt ce matin, Lady L. me faisait entendre, capté sur sa tablette, un extrait du téléphone d’une heure passé entre Donald Trump et les hauts responsables de Georgie qu’il priait de l’aider à casser le résultat des élections, je resongeai au comique extrême de la situation mondiale que nous vivons ces jours, qui ramène un peu tout au niveau de pitrerie de l’Ubu américain et des joyeux pantins de la comédie anglaise Mum, qu’il faut absolument que je revoie de A à Z pour en détailler tout ce qui nous renvoie aux épisodes de notre propre feuilleton de tous les jours.
À la Maison bleue, ce mardi 5 janvier. – Pendant que, tôt ce matin, Lady L. me faisait entendre, capté sur sa tablette, un extrait du téléphone d’une heure passé entre Donald Trump et les hauts responsables de Georgie qu’il priait de l’aider à casser le résultat des élections, je resongeai au comique extrême de la situation mondiale que nous vivons ces jours, qui ramène un peu tout au niveau de pitrerie de l’Ubu américain et des joyeux pantins de la comédie anglaise Mum, qu’il faut absolument que je revoie de A à Z pour en détailler tout ce qui nous renvoie aux épisodes de notre propre feuilleton de tous les jours.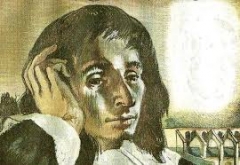 ALTERNANCE. - Conformément à ma pratique athlétique du grand écart, je n’ai cessé de lire, hier, Pascal aux cabinets où une courante récurrente (excès de consommation de bombons aux herbes fourrés sans sucre) m’a ramené vingt fois, déchiffrant donc à peu près vingt pages de La vie de Monsieur Pascal par sa sœur Gilberte, en alternance avec un traité de Jacques Réda sur la versification française intitulé Quel avenir pour la cavalerie ? et la suite et fin de la quatrième saison de The Crown. Sur quoi je me dis que celui ou celle qui apprécie Bouvard et Pécuchet ne peut que raffoler de Mum…
ALTERNANCE. - Conformément à ma pratique athlétique du grand écart, je n’ai cessé de lire, hier, Pascal aux cabinets où une courante récurrente (excès de consommation de bombons aux herbes fourrés sans sucre) m’a ramené vingt fois, déchiffrant donc à peu près vingt pages de La vie de Monsieur Pascal par sa sœur Gilberte, en alternance avec un traité de Jacques Réda sur la versification française intitulé Quel avenir pour la cavalerie ? et la suite et fin de la quatrième saison de The Crown. Sur quoi je me dis que celui ou celle qui apprécie Bouvard et Pécuchet ne peut que raffoler de Mum…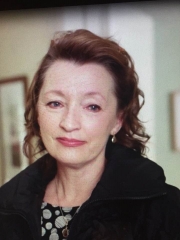 SANS VOIX. - L’expression « sans voix » caractérise la position de Mum face à la sottise de son entourage, autant que celle de son ami Michael, incapable de répondre aux méchancetés dont on l’accable. De même reste-t-on sans voix à l’écoute du grand débile de la Maison-Blanche, comme je reste sans voix en découvrant chaque jour le ruissellement d’imbécillités proférées sur Facebook, qui ne sont rien sans doute à côté de celles qui déferlent sur Twitter et autres dévaloirs d’opinion.Le comique particulier de la série Mum tient au fait que la protagoniste, institutrice de bon sens et de bon cœur, ne cesse de « prendre sur elle » au lieu de répondre aux âneries que profèrent ses tout proches, et c’est à la même réserve que je m’exerce dans mon usage des réseaux sociaux en n’exprimant jamais, ou presque, ce que je pense à propos d’opinions ou de commentaires ne dépassant pas les bas-fonds de la stupidité.COMPLICES. – Je disais aussi ce matin, à ma bonne amie, que seuls deux ou trois de mes amis – dont le merveilleux Gérard, dandy délicat qui a passé les deux tiers de sa vie avec deux veuves de bouchers, et Quentin le malappris – me semblent avoir le sens du comique tissé de grotesque et de conscience tragique, et c’est ainsi qu’hier, au téléphone, nous riions avec Gérard de ce qu’il y a de profondément drôle dans la quête de pureté insensée de Pascal, que je lis donc ces jours aux cabinets et dont Quentin alterne aussi la lecture avec celle de Heidegger et du jeune Aurélien Bellanger – Quentin qui publie ces temps des variations sur le monde actuel qui me semblent à la hauteur des observations de Mum, lesquelles raviraient aussi Gérard qui a signé la préface et traduit le Journal d’un homme sans importance des frères Grossmith, mon bon vieux Gérard qui écrit ces jours des quatrains pour le petit garçon de sa dernière amie…
SANS VOIX. - L’expression « sans voix » caractérise la position de Mum face à la sottise de son entourage, autant que celle de son ami Michael, incapable de répondre aux méchancetés dont on l’accable. De même reste-t-on sans voix à l’écoute du grand débile de la Maison-Blanche, comme je reste sans voix en découvrant chaque jour le ruissellement d’imbécillités proférées sur Facebook, qui ne sont rien sans doute à côté de celles qui déferlent sur Twitter et autres dévaloirs d’opinion.Le comique particulier de la série Mum tient au fait que la protagoniste, institutrice de bon sens et de bon cœur, ne cesse de « prendre sur elle » au lieu de répondre aux âneries que profèrent ses tout proches, et c’est à la même réserve que je m’exerce dans mon usage des réseaux sociaux en n’exprimant jamais, ou presque, ce que je pense à propos d’opinions ou de commentaires ne dépassant pas les bas-fonds de la stupidité.COMPLICES. – Je disais aussi ce matin, à ma bonne amie, que seuls deux ou trois de mes amis – dont le merveilleux Gérard, dandy délicat qui a passé les deux tiers de sa vie avec deux veuves de bouchers, et Quentin le malappris – me semblent avoir le sens du comique tissé de grotesque et de conscience tragique, et c’est ainsi qu’hier, au téléphone, nous riions avec Gérard de ce qu’il y a de profondément drôle dans la quête de pureté insensée de Pascal, que je lis donc ces jours aux cabinets et dont Quentin alterne aussi la lecture avec celle de Heidegger et du jeune Aurélien Bellanger – Quentin qui publie ces temps des variations sur le monde actuel qui me semblent à la hauteur des observations de Mum, lesquelles raviraient aussi Gérard qui a signé la préface et traduit le Journal d’un homme sans importance des frères Grossmith, mon bon vieux Gérard qui écrit ces jours des quatrains pour le petit garçon de sa dernière amie…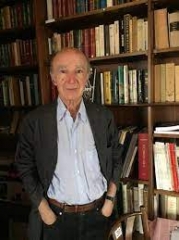 QUE TOUT EST MUM. – Telle autre amie, infirmière recuite aux rigueur des soins palliatifs, me dit que la série Mum ne la fait pas rire, alors qu’elle se tord à l’écoute de Blanche Gardin. Or je comprends qu’on rigole aux facéties pince-sans- rire à la Desproges de l’humoriste française, qui s’en tient cependant au seul comique verbal et à la moquerie explicite, alors qu’apprécier Mum est plus délicat quand on est soi-même un personnage de Mum, comme cette amie et son conjoint dont l’attachement comique à son père défunt vaut bien celui de Jason, et comme nous le sommes tous, moi le premier qui consomme trop de bombons Bonherba de tradition suisse, sans sucres et à base d’herbes médicinales (plaintain et sureau, anis étoilé et lichen d’Islande), fauteurs de chiasse et donc me ramenant plus souvent qu’à mon tour aux cabinets où je poursuis la lecture de Pascal - ce Blaise Pascal très MUM évidemment, avec sa peur maladive de la chair, comme Trump est super-MUM en sa psychose masculiniste et sa jobardise de bateleur fascinant nos libéraux hyper-MUM…
QUE TOUT EST MUM. – Telle autre amie, infirmière recuite aux rigueur des soins palliatifs, me dit que la série Mum ne la fait pas rire, alors qu’elle se tord à l’écoute de Blanche Gardin. Or je comprends qu’on rigole aux facéties pince-sans- rire à la Desproges de l’humoriste française, qui s’en tient cependant au seul comique verbal et à la moquerie explicite, alors qu’apprécier Mum est plus délicat quand on est soi-même un personnage de Mum, comme cette amie et son conjoint dont l’attachement comique à son père défunt vaut bien celui de Jason, et comme nous le sommes tous, moi le premier qui consomme trop de bombons Bonherba de tradition suisse, sans sucres et à base d’herbes médicinales (plaintain et sureau, anis étoilé et lichen d’Islande), fauteurs de chiasse et donc me ramenant plus souvent qu’à mon tour aux cabinets où je poursuis la lecture de Pascal - ce Blaise Pascal très MUM évidemment, avec sa peur maladive de la chair, comme Trump est super-MUM en sa psychose masculiniste et sa jobardise de bateleur fascinant nos libéraux hyper-MUM… -
Astres compères en La Pléiade


Quand Claude Lévi-Strauss et André Breton se retrouvaient au panthéon de l’édition française.
Au printemps 1941, entre le 25 mars et le 20 avril, Claude Lévi-Strauss et André Breton se retrouvèrent sur le même bateau à destination de la Martinique, « une boîte de sardines sur laquelle on aurait collé un mégot », dixit Victor Serge, chargé de quelque deux cents passagers fuyant le nazisme.Evoquant cette traversée, Lévi-Strauss décrit André Breton, au début de Tristes Tropiques, sous les traits d’un voyageur « fort mal à l’aise sur cette galère » en précisant que, « vêtu de peluche, il ressemblait à un ours bleu »…
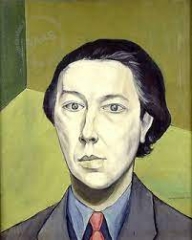
Claude Lévi-Strauss, qui deviendra l’un des plus grands anthropologues du XXe siècle, magnifique écrivain par ailleurs et digne centenaire de l’Académie française, n’était alors qu’un jeune ethnologue « américaniste » revenu de deux expéditions chez les Indiens bororo et au Mato Grosso avec ses première collections et observations.De douze ans son aîné, André Breton faisait déjà figure de « pape » du surréalisme, taxé d’«agitateur dangereux » par la France de Pétain. Une même passion pour l’art, la littérature et la politique (Lévi-Strauss avait un passé de socialiste actif) allait cependant rapprocher les deux hommes, qui converseraient durant ce voyage par lettres et de vive voix.

Or le lecteur retrouvera, dans Regarder écouter lire, le dernier des sept livres des Œuvres de Claude Lévi-Strauss réunis (par celui-ci) dans la Bibliothèque de la Pléiade, un aperçu du débat qui les opposait alors. Breton y défend, notamment, le « spontanéisme » de l’art, le plus vrai dans son jet brut, tandis que Lévi-Straus, plus classique, rappelle l’importance du métier et de l’élaboration « secondaire » de l’œuvre.Plus tard, L’Art magique de Breton suscitera d’autres objections plus fondamentales de Lévi-Strauss, et pourtant, avec le recul, les passions communes et les œuvres de ces deux écrivains se rejoignent dans leur apport respectif à la connaissance de l’homme par la littérature et à travers les arts. Tous deux sont des « bricoleurs » de génie, qui pratiquent par collages. Tous deux sont des explorateurs de la créativité humaine, attentifs à ses mythes et pratiquant le même décentrage par rapport à l’Occident.
Dans sa remarquable préface aux Œuvres de Lévi-Strauss, Vincent Debaene rappelle que « l’étude de l’homme est, par essence, littérature », non du tout au seul sens du « beau style » mais au sens d’un approfondissement de la connaissance qui « exige réflexion, lenteur et confrontation patiente aux données empiriques », à laquelle l’anthropologie peut être d’un grand apport. Sans narcissisme ni fétichisation du style, Lévi-Strauss développe, poursuit Debaene, « une écriture majestueuse qui fait songer à Chateaubriand pour la posture et à Bossuet pour le rythme ». Formules un peu solennelles cependant, à nuancer à la lecture de Tristes Tropiques, d’un ton souvent très direct et d’une mélancolie fleurant le XXIe siècle (la mémorable conclusion, en hommage à la beauté des choses), mais qui inscrivent bel et bien l’anthropologue dans la filière classique des grands voyageurs-naturalistes-essayistes, tel un Montaigne, notamment, dans cette posture qui est de déférence envers le monde et l’homme nu, tranchant avec l’avidité contemporaine…
Taxé d’«astronome des constellations humaines » Lévi-Strauss fut un grand lecteur des cultures conçues comme un ensemble de systèmes symboliques. Laissant les textes scientifiques les plus ardus, dégagées de la « mode » structuraliste, Ses Œuvres réunies ici visent le public cultivé mais non spécialisé. Avec Tristes Tropiques, captivant parcours sur le terrain et fondation des thèses structurales, Le Totémisme aujourd’hui et La pensée sauvage, suivie des trois « Petites Mythologiques » (La potière jalouse, La voie des masques et Histoire de lynx), celui qui se dit « humaniste modeste » a voulu retracer son parcours personnel sous son double aspect scientifique et littéraire, dont la conclusion de Regarder Ecouter Lire marque le point de fusion du savant et de l’artiste éternel.
Œuvres de Claude Lévi-Strauss préface de Vincent Debaene ; édition établie par Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé et Martin Rueff. Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2062 p. -
Chessex plus vif que mort
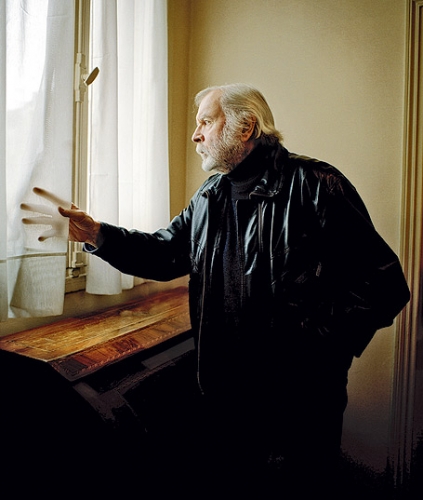
Quatre ans après sa disparition subite, en octobre 2009, Jacques Chessex nous revenait, en 2013, avec Hosanna, bref roman de sa meilleure veine, sans rien du "fond de tiroir" posthume...C'est à vrai dire du "pur Chessex" que cet Hosanna, qu'on pourrait situer dans le droit fil de L'Imparfait, récit autobiographique merveilleusement délié, paru en 1996 chez Campiche. Pour être juste, cependant, l'appellation roman est bel est bien appropriée, en l'occurrence, même si le narrateur apparaît comme le double évident de l'écrivain, comme le plus souvent. De fait, ledit protagoniste acquiert ici une sorte d'autonomie de personnage dans ce qu'on peut appeler un véritable espace romanesque. Par ailleurs, sans qu'on puisse parler de cynisme, cette relation d'un enterrement "par chez nous" se dégage de toute morosité par une sorte d'humour terrien et de singulière bonté à l'égard des figures évoquées du vieux patriarche alémanique qu'on enterre, d'un illuminé qualifié de "fou des tombes", d'une jeune fille-chat consolant le narrateur des rigueurs de la vie et de deux jeunes gens morts à la fleur de l'âge, l'un fauché par le cancer et l'autre par le désespoir suicidaire.
Le temps d'un service funèbre en deux temps et deux langues dans un temple étroit où les cantiques seront accompagnés par un "vieil harmonium tribal des rudes campagnes", le narrateur, confronté à la "belle mort" de son voisin nonagénaire aimé des siens et qui a fait oeuvre utile sur terre en fondant diverses fromageries et autres porcheries, se rappelle la laide fin de son père suicidé et sa propre vie d'irrégulier, à la fois jouisseur et tourmenté, de la race "marquée par l'austérité du remords" et soudain hanté en ce lieu, par la vision mentale d'un Visage en lequel il identifie un gymnasien de dix-huit ans, fasciné par la mort et lecteur de ses livres, qu'il se reproche de n'avoir pas su retenir du coté de la vie.
Or cette remémoration lancinante, qui lui fait imaginer le corps fracassé du jeune homme au pied du pont Bessières, s'inscrit dans un tableau plus ample dont la lumière et les ombres rappellent explicitement les romans du grand écrivain bernois Jeremias Gotthelf (auteur notamment de L'Araignée noire) auquel le vieux voisin de l'écrivain l'a d'ailleurs comparé. Rien de lourd ou d'artificiel, au demeurant, dans ce rapprochement quasi "biblique", tant le roman s'enracine naturellement dans notre terre et ses gens: ces jeunes athlètes de Gampelen saluant le drapeau devant le cercueil du défunt, le voisin lui-même offrant le miel de ses abeilles à l'écrivain, ou celui-ci (qui ne serait pas Chessex sans ce détail) se rappelant le geste fou d'une maîtresse se marquant le corps d'une croix sanglante au rasoir.
"Il y a ceux qui sont en haut, avec le voisin et sa foi, et ceux, en bas, qui agitent leurs histoires comme des guenilles", constate encore le narrateur, dont le récit s'exacerbe soudain, rythmé par l'expression "on est suivis, on est suivis", sur des visions de personnages silhouettés à l'acide sur fond de violence: "Des gens foutent le feu à des fermes, tout le monde sait qui, personne ne dit rien"...
Mélange d'intensité véhémente et de tendresse, révolte et soumission à l'incompréhensible Dieu, folie et douceur cohabitent dans ce livre dont le titre signifie, non sans mystique paradoxe, louange...
Jacques Chessex. Hosanna. Grasset,118p. -
Une descente aux enfers
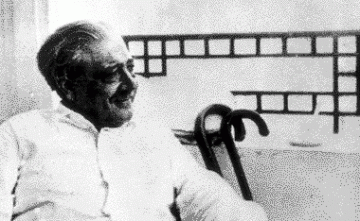
En relisant Monsieur Ouine de Bernanos, dans la foulée de Guy Dupré
C’est une vraie folie, un vrai délire de poésie confuse qui souffle à travers Monsieur Ouine de Georges Bernanos, véritable plongée faulknérienne dans la terre pleine de jeunes morts et dans le trouble des corps et des âmes, dont le trou noir qui menace de tout avaler est ce désir froid d’une espèce de spectre vivant suave et gluant. Guy Dupré rappelle, dans un article pénétrant qui vient de reparaître en recueil, le lien secret courant entre le personnage du vieux pédéraste et celui de l’auteur de Corydon, et de fait il y a chez Ouine la même sensualité molle, la même afféterie rusée, la même délectation morose, la même envie de posséder la jeunesse qu’on retrouve dans le ton de Gide, plus encore chez l’homme (je pense à ses entretiens enregistrés) que chez l’écrivain.
La grandeur de Bernanos est d’inscrire son personnage dans une dramaturgie métaphysique qui fait retentir sa monstruosité dans sa double dimension minable et cosmique, et plus encore dans ce que révèlent ses relations, avec l’Enfant Steeny tout prêt à le suivre et/ou à l’écraser comme une blatte, avec les proies innocentes (sa propre innocence souillée criant vengeance, comme si souvent il en va des pédophiles initialement violés) autant qu’avec les gens qui l’entourent sans se douter qui il est ni voir ce qu’il défait sous ses airs de sainte nitouche.
Amiel parlait de la décréation que signifie l’amor sui, et c’est précisément cela qui agit à travers Monsieur Ouine, qui n’incarne pas que l’hésitation du oui-non mais l’affirmation du non sous couvert du oui. Guy Dupré remarque justement que Monsieur Ouine est le seul personnage qui n’a pas peur de la mort, du fait que la portée métaphysique de la mort lui est totalement étrangère, ou plus exactement : qu’il l’avale dans son trou noir.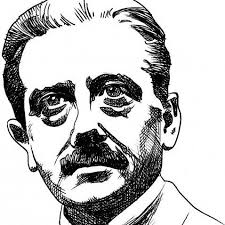
Guy Dupré souligne le caractère inspiré, plus qu’artiste, de ce très grand livre, et c’est pourtant un roman d’une poésie exacerbée que Monsieur Ouine, dont le critique parle ici à partir de l’édition des Carnets de Monsieur Ouine, creuset hallucinant de l’œuvre, où Bernanos tâtonne follement à la recherche de chaque mot et de chaque phrase, comme un somnambule dans un verger cueillant tantôt des bijoux et tantôt des cailloux ou des genoux ou des poux. On lit par exemple (folio 13) « de briller. La vanité. La vanité l’emporta sur. La van. La vanité d’un facile triomphe. La vanité triomph. l’emporta. Néanmoins la vanité. La vanité l’emporta. Une fois de plus pourtant, la vanité l’emporta sur la méfiance. Mais la vanité. Néanmoins la vanité », etc.
Ouine est un démon dostoïevskien à la française, bien que le roman ne soit ni russe ni français. Ouine est du pays de l’enfance perdue, quelque part dans un cave belge où rôde l’ombre de Dutroux, ou dans une cabane du Far West pourri où pourrisent les reste de l’Enfant de Dieu de Cormac McCarthy.
« Ce n’était pas l’homosexualité qui intéressait Bernanos », note encore Guy Dupré, « mais le phénomène d’inversion ontologique fixant le sujet sur son propre sexe – c’est-à-dire sur sa propre essence d’être qui aime. Selon la belle expression populaire : Gide se préférait. Et l’homosexualité de Monsieur Ouine, symbole de l’amour du « moi » - dont Maître Eckhart affirme qu’il n’y a que lui qui brûle en enfer – est bien la curiosité sans amour telle que le vieux Corydon la notait, à la veille de sa mort, comme une particularité de sa nature : « Mon désir, fait en partie de curiosité, s’épuise très vite et même, le plus souvent, lorsque le plaisir est parfait, je me sens saoulé d’un seul coup ».
Enfin Guy Dupré de conclure avec quelle pénétration : « Il y aurait un troublant parallèle à établir entre certaines notations d'André Gide et la confession post mortem de Monsieur Ouine: "Il n'y a en moi ni bien ni mal, aucune contradiction, dit celui-ci, la justice ne saurait plus m'atteindre, tel est le véritable sens du mot perdu. Non pas absous ni condamné, oui, perdu, égaré, hors de toute vue, hors de cause... S'il n'y avait rien, je serais quelque chose, bonne ou mauvaise. C'est moi qui ne suis rien..."
Georges Bernanos. Monsieur Ouine. Plon, 1946. Carnets de Monsieur Ouine, rassemblés par Daniel Pezeril. Seuil, 1991.
Guy Dupré. Je dis nous. La Table ronde, 2007.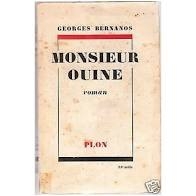
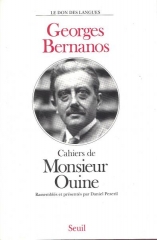
-
Aux extrêmes touchants
 À la Maison bleue, ce 3 janvier. - L’exercice du grand écart, constituant l’une de mes figures de chorégraphie mentale préférée, me permet le soir, comme cette nuit dernière, de lire les chroniques de Saint -Simon avec la même attention avec laquelle j’ai revu les trois derniers épisodes de la série anglaise Mum sur mon Big Mac, où la mélancolie songeuse de Cathy cède enfin la place au choix de foutre le camp avec son amoureux pour échapper un moment à son adorable non moins qu’exécrable famille; et la tonalité de cette dernière séquence m'a rappelé, par grand écart toujours, la fin du Temps retrouvé...
À la Maison bleue, ce 3 janvier. - L’exercice du grand écart, constituant l’une de mes figures de chorégraphie mentale préférée, me permet le soir, comme cette nuit dernière, de lire les chroniques de Saint -Simon avec la même attention avec laquelle j’ai revu les trois derniers épisodes de la série anglaise Mum sur mon Big Mac, où la mélancolie songeuse de Cathy cède enfin la place au choix de foutre le camp avec son amoureux pour échapper un moment à son adorable non moins qu’exécrable famille; et la tonalité de cette dernière séquence m'a rappelé, par grand écart toujours, la fin du Temps retrouvé... BONTÉ DE PROUST. - On ne voit pas assez la drôlerie de Proust, dont la lecture est souvent plombée par le snobisme. Le comble de l’ironie tient en effet à cela que les lecteurs de Proust se croient supérieurs, comme autant de Verdurin collets montés, sans percevoir la raillerie ni la férocité du snob repenti brossant la fresque des vanités. En outre, ce qu’on oublie aussi trop souvent , c’est la bonté mélancolique de Proust, et précisément sous l’apparente férocité des scènes du Temps retrouvé, de même que, dans Mum, la douleur pensive de la veuve n’osant pas avouer son amour à son bêta de fils jouant les protecteurs mêle le plus haut comique à la tendresse contrite.PROFONDEUR DE L'HUMOUR. - L’humour populaire, l’humour qu’on dit anglais ou juif, l’humour qui est de défense débonnaire et non d’attaque fielleuse, l’humour profond de notre drôle d’espèce est un doux mélange de sens commun réaliste et de sagesse débonnaire, de lucidité terrienne et de relativisme qui s'accommode mal des absolus à majuscules - d'où la fureur des dévots et des pédants, notamment à l'égard d'un Molière.
BONTÉ DE PROUST. - On ne voit pas assez la drôlerie de Proust, dont la lecture est souvent plombée par le snobisme. Le comble de l’ironie tient en effet à cela que les lecteurs de Proust se croient supérieurs, comme autant de Verdurin collets montés, sans percevoir la raillerie ni la férocité du snob repenti brossant la fresque des vanités. En outre, ce qu’on oublie aussi trop souvent , c’est la bonté mélancolique de Proust, et précisément sous l’apparente férocité des scènes du Temps retrouvé, de même que, dans Mum, la douleur pensive de la veuve n’osant pas avouer son amour à son bêta de fils jouant les protecteurs mêle le plus haut comique à la tendresse contrite.PROFONDEUR DE L'HUMOUR. - L’humour populaire, l’humour qu’on dit anglais ou juif, l’humour qui est de défense débonnaire et non d’attaque fielleuse, l’humour profond de notre drôle d’espèce est un doux mélange de sens commun réaliste et de sagesse débonnaire, de lucidité terrienne et de relativisme qui s'accommode mal des absolus à majuscules - d'où la fureur des dévots et des pédants, notamment à l'égard d'un Molière. ÉMOUVANTE IDIOTE. - Bien entendu, dans la série Mum, le personnage inénarrable de Pauline, la belle-soeur snob de Cathy qui se donne grand genre et voudrait tant être considérée comme une femme de qualité, relève de la caricature, et la voir lire Ulyse de Joyce au petit déjeuner, l'air compénétré et trouvant cela "riveting", comme elle le répète d'un ton inspiré, frise le code de la satire facile; et pourtant non, car on découvre peu à peu ses failles, son désarroi par rapport au sale mec dont elle essaie de divorcer, et ce qu'elle éprouve réellement pour Derek le paltoquet, frère de Cathy, qui lui lèche les babouches comme un chiot servile. Personne, dira-t-elle dans un moment d'abandon, personne ne m'a jamais montré autant de gentillesse que toi, et toute les série est ainsi parcourue d'aveux aussi émouvants qu'inattendus , qui en scellent le sérieux foncier sous le masque de la futilité...
ÉMOUVANTE IDIOTE. - Bien entendu, dans la série Mum, le personnage inénarrable de Pauline, la belle-soeur snob de Cathy qui se donne grand genre et voudrait tant être considérée comme une femme de qualité, relève de la caricature, et la voir lire Ulyse de Joyce au petit déjeuner, l'air compénétré et trouvant cela "riveting", comme elle le répète d'un ton inspiré, frise le code de la satire facile; et pourtant non, car on découvre peu à peu ses failles, son désarroi par rapport au sale mec dont elle essaie de divorcer, et ce qu'elle éprouve réellement pour Derek le paltoquet, frère de Cathy, qui lui lèche les babouches comme un chiot servile. Personne, dira-t-elle dans un moment d'abandon, personne ne m'a jamais montré autant de gentillesse que toi, et toute les série est ainsi parcourue d'aveux aussi émouvants qu'inattendus , qui en scellent le sérieux foncier sous le masque de la futilité... -
Le parti pris d'en rire
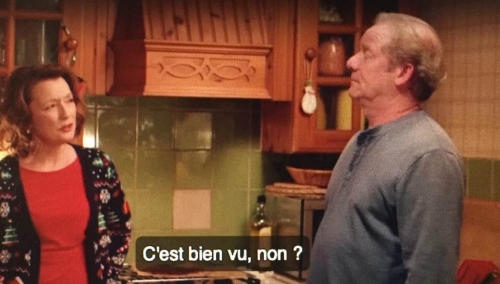 Ce samedi 2 janvier. – Je suis resté scotché bien tard, hier soir, et jusqu’à deux heures du matin, à regarder les dix-huit épisodes de la série anglaise Mum, littéralement fasciné par ces tableautins de la plus pure sottise considérée avec un regard d’une non moins pure tendresse, où la comédie humaine se nourrit des petits riens de la vie quotidienne dans la foulée d’une brochette de personnages rappelant un peu, en costumes actuels de clients de grandes surfaces, les protagonistes de l’inoubliable Journal d’un homme sans importance (Diary of a Nobody) des frères Grossmith qu’Evelyn Waugh disait le roman le plus drôle du monde.Après m’avoir recommandé la chose, Lady L. m’a fait remarquer qu’elle relevait pour ainsi dire de l’intraduisible, et de fait les sous-titres français ne rendent pas la substance très particulière du langage popu de la classe moyenne anglaise inférieure, pas loin du cockney, mais les situations et l’éventail de ce qu’on peut dire un infra-langage, fait de gestes et d’expressions faciales extraordinairement travaillés par les acteurs, reflètent une vérité tellement générale, et avec une telle dose de dinguerie humoristique que n’importe qui en sourira ou en rira aux éclats, alors même que le propos sous-jacent me semble d’un sérieux sans pareil dans le genre, à la fois dans le registre « limite » du grotesque imbécile, et dans celui de ce que Proust appelait les intermittences du cœur.CÔTÉ COEUR. - De fait, le cœur est au cœur, si j’ose dire, de cette apparente galéjade. Cœur blessé, pour commencer, de Cathy la presque sexa qui vient de perdre son conjoint David, et dont le deuil est partagé par son entourage jusqu’à l’étouffement, tandis que Michael, le meilleur ami du défunt, se tient un peu à l’écart tout en se montrant de plus en plus présent, lui aussi poigné au cœur.Rien cependant de larmoyant dans cette donnée affective de base immédiatement submergée par le tourbillon des allées et venues incessantes des personnages secondaires : Jason le grand fils un peu dadais et sa cruche blonde gaffeuse au prénom de Kelly, Derek le frère faraud de Cathy que sa compagne Pauline mène par le bout du gras en mijaurée snob aussi guindée que bas de gamme, à quoi s’ajoutent les vieux parents de David dont l’agressivité grossière se radoucit peu à peu alors même que les traits les plus caricaturaux de tous se nuancent à l’avenant.Car on est ici au-delà de la moquerie ordinaire et du mépris des crétins à la Deschiens: on est avec les gens.Lesdites gens, au premier regard, sont les plus débiles qui soient, et l’apparente vulgarité des saillies ( à en juger par les sous-titres française bien plus que par ce qui est dit en anglais d’en bas…), le lourd comique de répétition, les traits marqués à l’excès pourraient faire conclure à la facilité à grosses ficelles, mais il faut y regarder de plus près, dans le détail comique des postures et des propos toujours au bord de la rupture, au bord du ridicule et de l’indigence, au bord du désarroi et de la timidité, au bord de l’explosion nerveuse et de la méchanceté, au bord de ce gouffre qu’est souvent la relation la plus ordinaire.On regarde ces gens, on est tenté de les trouver nuls, on est au bord de les juger, et pourtant non : on ne les juge pas, on les observe, on les voit de mieux en mieux et plus ils dérapent, plus ils grimacent, plus ils gesticulent et plus on s’attache à eux sans qu’il s’agisse pour autant de complaisance, comme on s’attache aux bouffons de Shakespeare et aux précieuses ridicules ou aux faux dévots de Molière, aux aristos déchus ou aux snobs imbéciles de Proust. Convertir la laideur sociale et la méchanceté en bonté et en beauté non convenue: tel serait le job...Les Français ne savent plus faire cela depuis des décennies, les séries de partout sont désormais saturées par la violence et les conventions sentimentales, et c’est là que Stefan Golaczewski, l’auteur de Mum, porte le fer en retournant bonnement les situations.Avec des personnages de sitcom ultra-typés qu’il pousse à bout, il fait ressortir la possibilité de la bonté, de la lucidité dans le chaos mental et de la compréhension in extremis. Au fil de dix-huit épisodes, Cathy a « pris sur elle » en encaissant les pires énormités, non sans voir que Michael l’assistait muettement de son affection virant à l’amour.DE L'UNDERSTATEMENT. - On sait ce qu’est l’understatement à l’anglaise, qui tend à tout retenir ou à tout atténuer par respect des convenances. Mais il est rare que cette réserve extrême devienne un ressort comique décisif qui permet, au bord de tout éclat, de faire sentir l’irremplaçable particularité de chaque personnage à tout le monde. Marcel Jouhandeau dit quelque part (plus exactement dans ses Divertissements à la gloire d'Epictète, de Madame de Sévigné, de La Bruyère ou de Voltaire) que le génie particulier de Molière tient à cela qu'il fait rire tout le monde, de la base au sommet de la pyramide sociale, et le fait est que ce comique aussi profond que débonnaire propre aussi à La Fontaine se fait rarissime en notre temps de faux sérieux.Or le monde un peu fou qui nous entoure est là, dans cette sitcom à la gomme, et ce sont des gens : Mum est votre mère, votre belle-mère espagnole, votre sœur qui vient de divorcer d’un Slovène parvenu, vous reconnaissez en Jason (le fils de Mum) votre cousin plâtrier amoureux d’une coiffeuse bègue, et le frère complexé de Mum (Derek) vous rappelle ce grand flandrin de votre club de pétanque dont l’insupportable compagne n’en finit pas de citer les préceptes de Nadine de Rotschild, ainsi de suite, entre vos aïeux tousseux et fatigués et vos ados accros aux applis, etc.
Ce samedi 2 janvier. – Je suis resté scotché bien tard, hier soir, et jusqu’à deux heures du matin, à regarder les dix-huit épisodes de la série anglaise Mum, littéralement fasciné par ces tableautins de la plus pure sottise considérée avec un regard d’une non moins pure tendresse, où la comédie humaine se nourrit des petits riens de la vie quotidienne dans la foulée d’une brochette de personnages rappelant un peu, en costumes actuels de clients de grandes surfaces, les protagonistes de l’inoubliable Journal d’un homme sans importance (Diary of a Nobody) des frères Grossmith qu’Evelyn Waugh disait le roman le plus drôle du monde.Après m’avoir recommandé la chose, Lady L. m’a fait remarquer qu’elle relevait pour ainsi dire de l’intraduisible, et de fait les sous-titres français ne rendent pas la substance très particulière du langage popu de la classe moyenne anglaise inférieure, pas loin du cockney, mais les situations et l’éventail de ce qu’on peut dire un infra-langage, fait de gestes et d’expressions faciales extraordinairement travaillés par les acteurs, reflètent une vérité tellement générale, et avec une telle dose de dinguerie humoristique que n’importe qui en sourira ou en rira aux éclats, alors même que le propos sous-jacent me semble d’un sérieux sans pareil dans le genre, à la fois dans le registre « limite » du grotesque imbécile, et dans celui de ce que Proust appelait les intermittences du cœur.CÔTÉ COEUR. - De fait, le cœur est au cœur, si j’ose dire, de cette apparente galéjade. Cœur blessé, pour commencer, de Cathy la presque sexa qui vient de perdre son conjoint David, et dont le deuil est partagé par son entourage jusqu’à l’étouffement, tandis que Michael, le meilleur ami du défunt, se tient un peu à l’écart tout en se montrant de plus en plus présent, lui aussi poigné au cœur.Rien cependant de larmoyant dans cette donnée affective de base immédiatement submergée par le tourbillon des allées et venues incessantes des personnages secondaires : Jason le grand fils un peu dadais et sa cruche blonde gaffeuse au prénom de Kelly, Derek le frère faraud de Cathy que sa compagne Pauline mène par le bout du gras en mijaurée snob aussi guindée que bas de gamme, à quoi s’ajoutent les vieux parents de David dont l’agressivité grossière se radoucit peu à peu alors même que les traits les plus caricaturaux de tous se nuancent à l’avenant.Car on est ici au-delà de la moquerie ordinaire et du mépris des crétins à la Deschiens: on est avec les gens.Lesdites gens, au premier regard, sont les plus débiles qui soient, et l’apparente vulgarité des saillies ( à en juger par les sous-titres française bien plus que par ce qui est dit en anglais d’en bas…), le lourd comique de répétition, les traits marqués à l’excès pourraient faire conclure à la facilité à grosses ficelles, mais il faut y regarder de plus près, dans le détail comique des postures et des propos toujours au bord de la rupture, au bord du ridicule et de l’indigence, au bord du désarroi et de la timidité, au bord de l’explosion nerveuse et de la méchanceté, au bord de ce gouffre qu’est souvent la relation la plus ordinaire.On regarde ces gens, on est tenté de les trouver nuls, on est au bord de les juger, et pourtant non : on ne les juge pas, on les observe, on les voit de mieux en mieux et plus ils dérapent, plus ils grimacent, plus ils gesticulent et plus on s’attache à eux sans qu’il s’agisse pour autant de complaisance, comme on s’attache aux bouffons de Shakespeare et aux précieuses ridicules ou aux faux dévots de Molière, aux aristos déchus ou aux snobs imbéciles de Proust. Convertir la laideur sociale et la méchanceté en bonté et en beauté non convenue: tel serait le job...Les Français ne savent plus faire cela depuis des décennies, les séries de partout sont désormais saturées par la violence et les conventions sentimentales, et c’est là que Stefan Golaczewski, l’auteur de Mum, porte le fer en retournant bonnement les situations.Avec des personnages de sitcom ultra-typés qu’il pousse à bout, il fait ressortir la possibilité de la bonté, de la lucidité dans le chaos mental et de la compréhension in extremis. Au fil de dix-huit épisodes, Cathy a « pris sur elle » en encaissant les pires énormités, non sans voir que Michael l’assistait muettement de son affection virant à l’amour.DE L'UNDERSTATEMENT. - On sait ce qu’est l’understatement à l’anglaise, qui tend à tout retenir ou à tout atténuer par respect des convenances. Mais il est rare que cette réserve extrême devienne un ressort comique décisif qui permet, au bord de tout éclat, de faire sentir l’irremplaçable particularité de chaque personnage à tout le monde. Marcel Jouhandeau dit quelque part (plus exactement dans ses Divertissements à la gloire d'Epictète, de Madame de Sévigné, de La Bruyère ou de Voltaire) que le génie particulier de Molière tient à cela qu'il fait rire tout le monde, de la base au sommet de la pyramide sociale, et le fait est que ce comique aussi profond que débonnaire propre aussi à La Fontaine se fait rarissime en notre temps de faux sérieux.Or le monde un peu fou qui nous entoure est là, dans cette sitcom à la gomme, et ce sont des gens : Mum est votre mère, votre belle-mère espagnole, votre sœur qui vient de divorcer d’un Slovène parvenu, vous reconnaissez en Jason (le fils de Mum) votre cousin plâtrier amoureux d’une coiffeuse bègue, et le frère complexé de Mum (Derek) vous rappelle ce grand flandrin de votre club de pétanque dont l’insupportable compagne n’en finit pas de citer les préceptes de Nadine de Rotschild, ainsi de suite, entre vos aïeux tousseux et fatigués et vos ados accros aux applis, etc. -
L'Année Zéro
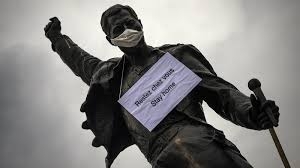 Ce jeudi 31 décembre 2020. – La plus étrange année du XXIe siècle s’achève aujourd’hui, selon notre calendrier, sur fond d’incertitude planétaire, au tréfonds de la déprime pour certains et dans la plus grande perplexité en ce qui me concerne, avec le sentiment profond que la vie continue comme après toutes les calamités naturelles ou imputable à notre espèce, et comme une confiance qui se défend d’être un aveuglement.
Ce jeudi 31 décembre 2020. – La plus étrange année du XXIe siècle s’achève aujourd’hui, selon notre calendrier, sur fond d’incertitude planétaire, au tréfonds de la déprime pour certains et dans la plus grande perplexité en ce qui me concerne, avec le sentiment profond que la vie continue comme après toutes les calamités naturelles ou imputable à notre espèce, et comme une confiance qui se défend d’être un aveuglement. Je lisais hier soir, dans le dernier essai, à la fois touffu et intéressant parfois, de Slavoj Zizek, intitulé Dans la tempête virale, que les bouleversements écologiques subis par la planète, et notamment la destruction du permafrost arctique, nous réservent d’autres surprises virales que le dégagement inéluctable de gaz hilarant ( !), et que les retombées des deux premières vagues de la pandémie actuelle feront partie désormais de notre environnement global.
Je lisais hier soir, dans le dernier essai, à la fois touffu et intéressant parfois, de Slavoj Zizek, intitulé Dans la tempête virale, que les bouleversements écologiques subis par la planète, et notamment la destruction du permafrost arctique, nous réservent d’autres surprises virales que le dégagement inéluctable de gaz hilarant ( !), et que les retombées des deux premières vagues de la pandémie actuelle feront partie désormais de notre environnement global.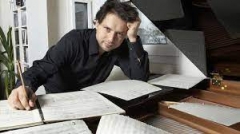 Hier aussi, mon ami Richard Dubugnon, évidemment affecté par le fait qu’il n’ait pu donner aucun concert depuis mars dernier, m’a envoyé plusieurs documents numériques à coloration catastrophiste, notamment de l’anthropologue genevois Jean-Dominique Michel qui avait défendu le « documentaire » Hold-up, revenant ici avec un « petit essai de psychopathologie apocalyptique » où sont visés, une fois de plus, les abus de pouvoir des autorités politico-sanitaires.Dans un premier temps, j’ai rappelé à Aliocha qu’il avait de beaux enfants, une femme adorable et un jardin où relire les classiques en plus de la musique, tout en comprenant son désarroi et sa révolte, comme Slavoj Zizek comprend la peur et la panique, même entretenue à disproportion, de la plupart des gens ne sachant pas plus ce qui leur arrive que les prétendus experts.Nous ne savons pas : voilà la belle découverte, et qui exige de tous un peu plus d’humilité, à commencer par les scientifiques que Freeman Dyson, le physicien rebelle, a raison de classer en arrogants et en modestes.Et qui a raison ? Les libertariens à l’américaine ou les partisans du surveiller et punir à la chinoise ? Ni les uns ni les autres, probablement, et Zizek d’invoquer alors une nouvelle donne «communiste» qui n’aurait rien de commun avec la doxa marxiste sauf qu’elle supposerait bel et bien une réadaptation complète de nos économies soumises à la seule logique du profit et du rendement – et de citer alors la notion de co-immunisme introduite par Peter Sloterdijk, et d'évoquer les mesures qui, sans doute, devront être prises désormais à grande échelle pour se protéger de nouvelles attaques virales annoncées depuis longtemps et peut-être plus prévisibles aujourd’hui...FANTASMES & Co. – Je me demandais, hier, si j’allais poursuivre la lecture du nouveau roman « à succès » de Nicolas Feuz, intitulé Le Calendrier de l’après et qui brosse le tableau apocalyptique d’un monde ravagé par le virus Verna, en imaginant un élu au prénom d’Alexis, fils de la super-soignante Élise Marval, quasi sanctifiée et devenue égérie de la Gouvernance, puis assassinée en suite des conflits liés à la distribution inégalitaire des vaccins...Tout cela, raconté avec la vivacité naïve d’un romancier pour ados, et jouant sur les fantasmes de peur et de défiance opposée aux autorités, dans une Suisse romande de bande dessinée, m’a d’abord semblé d’un simplisme infantile, rappelant tant de séries B américaines et autres romans-catastrophe caricaturaux à la manière du pauvre Pandemia de Franck Thilliez, et je ne me voyais pas perdre plus de temps à cette lecture, pas plus qu’à celle des élucubrations « révolutionnaires » du transgenre Paul Preciado entrevoyant l’aube d’un monde enfin libéré de siècles de tyrannie patriarcale, sur quoi je me suis dit que non : que j’allais lire « tout ça » pour en juger sur pièces, comme autant d’éléments d’un dossier vivant représentant une partie de notre roman des temps qui courent.DE LA REALITÉ. – La faiblesse, à mes yeux, des dystopies les plus alarmistes, d’hivers nucléaires en dévastations biologiques, tient à leur manque de détails, or la réalité est dans le détail, la réalité a mille fois plus de ressources imaginatives et immunitaires qu’on ne le croit, et c’est pourquoi je reste optimiste et confiant en pariant pour le Sage inconnu…NOUVELLE DONNE. – Mon prochain livre s’intitulera L’Année Zéro et sera constitué par le montage de mes carnets de mars 2019 à décembre 2020, avec le sous-titre de Journal des Quatre vérités. Ce sera le septième volume de mes Lectures du monde englobant les années 1973 à 2020, alors que l’avant-dernier volume, Mémoire vive (carnets 2013-2019) reste inédit.L’éditeur qui publiera L’Année Zéro aura le privilège de publier ensuite Mémoire vive et mon roman panoptique en voie de finition, Les Tours d’illusion. Il lui sera en outre autorisé de publier ma trilogie poétique de La Maison dans l’arbre, La Chambre de l’enfant et Le chemin sur la mer.Cela conformément à ma doctrine liée à la nouvelle donne mondiale, qui voudra désormais que les éditeurs proposent et que les auteurs disposent. J’enverrai ainsi L’Année Zéro à sept ou quatorze éditeurs choisis auxquels je communiquerai mes exigences précises, et dont les offres seront soigneusement examinées par les services sourcilleux de ma firme, etc. Dans l'attente de réponses recevables, tous mes écrits seront disponibles en ligne à l'enseigne de Wordpress dès le 30 février prochain. Voilà pour aujourd'hui...
Hier aussi, mon ami Richard Dubugnon, évidemment affecté par le fait qu’il n’ait pu donner aucun concert depuis mars dernier, m’a envoyé plusieurs documents numériques à coloration catastrophiste, notamment de l’anthropologue genevois Jean-Dominique Michel qui avait défendu le « documentaire » Hold-up, revenant ici avec un « petit essai de psychopathologie apocalyptique » où sont visés, une fois de plus, les abus de pouvoir des autorités politico-sanitaires.Dans un premier temps, j’ai rappelé à Aliocha qu’il avait de beaux enfants, une femme adorable et un jardin où relire les classiques en plus de la musique, tout en comprenant son désarroi et sa révolte, comme Slavoj Zizek comprend la peur et la panique, même entretenue à disproportion, de la plupart des gens ne sachant pas plus ce qui leur arrive que les prétendus experts.Nous ne savons pas : voilà la belle découverte, et qui exige de tous un peu plus d’humilité, à commencer par les scientifiques que Freeman Dyson, le physicien rebelle, a raison de classer en arrogants et en modestes.Et qui a raison ? Les libertariens à l’américaine ou les partisans du surveiller et punir à la chinoise ? Ni les uns ni les autres, probablement, et Zizek d’invoquer alors une nouvelle donne «communiste» qui n’aurait rien de commun avec la doxa marxiste sauf qu’elle supposerait bel et bien une réadaptation complète de nos économies soumises à la seule logique du profit et du rendement – et de citer alors la notion de co-immunisme introduite par Peter Sloterdijk, et d'évoquer les mesures qui, sans doute, devront être prises désormais à grande échelle pour se protéger de nouvelles attaques virales annoncées depuis longtemps et peut-être plus prévisibles aujourd’hui...FANTASMES & Co. – Je me demandais, hier, si j’allais poursuivre la lecture du nouveau roman « à succès » de Nicolas Feuz, intitulé Le Calendrier de l’après et qui brosse le tableau apocalyptique d’un monde ravagé par le virus Verna, en imaginant un élu au prénom d’Alexis, fils de la super-soignante Élise Marval, quasi sanctifiée et devenue égérie de la Gouvernance, puis assassinée en suite des conflits liés à la distribution inégalitaire des vaccins...Tout cela, raconté avec la vivacité naïve d’un romancier pour ados, et jouant sur les fantasmes de peur et de défiance opposée aux autorités, dans une Suisse romande de bande dessinée, m’a d’abord semblé d’un simplisme infantile, rappelant tant de séries B américaines et autres romans-catastrophe caricaturaux à la manière du pauvre Pandemia de Franck Thilliez, et je ne me voyais pas perdre plus de temps à cette lecture, pas plus qu’à celle des élucubrations « révolutionnaires » du transgenre Paul Preciado entrevoyant l’aube d’un monde enfin libéré de siècles de tyrannie patriarcale, sur quoi je me suis dit que non : que j’allais lire « tout ça » pour en juger sur pièces, comme autant d’éléments d’un dossier vivant représentant une partie de notre roman des temps qui courent.DE LA REALITÉ. – La faiblesse, à mes yeux, des dystopies les plus alarmistes, d’hivers nucléaires en dévastations biologiques, tient à leur manque de détails, or la réalité est dans le détail, la réalité a mille fois plus de ressources imaginatives et immunitaires qu’on ne le croit, et c’est pourquoi je reste optimiste et confiant en pariant pour le Sage inconnu…NOUVELLE DONNE. – Mon prochain livre s’intitulera L’Année Zéro et sera constitué par le montage de mes carnets de mars 2019 à décembre 2020, avec le sous-titre de Journal des Quatre vérités. Ce sera le septième volume de mes Lectures du monde englobant les années 1973 à 2020, alors que l’avant-dernier volume, Mémoire vive (carnets 2013-2019) reste inédit.L’éditeur qui publiera L’Année Zéro aura le privilège de publier ensuite Mémoire vive et mon roman panoptique en voie de finition, Les Tours d’illusion. Il lui sera en outre autorisé de publier ma trilogie poétique de La Maison dans l’arbre, La Chambre de l’enfant et Le chemin sur la mer.Cela conformément à ma doctrine liée à la nouvelle donne mondiale, qui voudra désormais que les éditeurs proposent et que les auteurs disposent. J’enverrai ainsi L’Année Zéro à sept ou quatorze éditeurs choisis auxquels je communiquerai mes exigences précises, et dont les offres seront soigneusement examinées par les services sourcilleux de ma firme, etc. Dans l'attente de réponses recevables, tous mes écrits seront disponibles en ligne à l'enseigne de Wordpress dès le 30 février prochain. Voilà pour aujourd'hui... -
Portrait de Lady L. à la clope
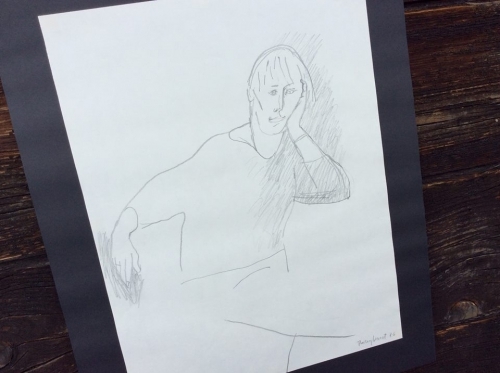 Lady L. tient sa clope, sur le plus beau des dessins de T.V. à ma connaissance, comme s’il en était d’un crayon ou d’un diapason de musicien, et tout le dessin semble fait d’un seul trait comme il en irait d’un seul trait de pinceau chinois, mais ce n’est pas tout à fait exact, et peu importe d’ailleurs : c’est un dessin d’une ligne parfaite dont l’épure va jusqu’à figurer, par du vide, le coin de meuble sur lequel Lady L- est accoudée, pesant à peine de tout son corps détendu et paraissant allégé dans sa posture à la fois nonchalante et ferme, rêveuse et la cibiche réduite à un trait oblique qu’on pourrait prendre, sur sa main, pour un anneau d’alliance qu’à vrai dire elle n’a jamais porté...Thierry Vernet, Portrait de Lucia K, en 1986.
Lady L. tient sa clope, sur le plus beau des dessins de T.V. à ma connaissance, comme s’il en était d’un crayon ou d’un diapason de musicien, et tout le dessin semble fait d’un seul trait comme il en irait d’un seul trait de pinceau chinois, mais ce n’est pas tout à fait exact, et peu importe d’ailleurs : c’est un dessin d’une ligne parfaite dont l’épure va jusqu’à figurer, par du vide, le coin de meuble sur lequel Lady L- est accoudée, pesant à peine de tout son corps détendu et paraissant allégé dans sa posture à la fois nonchalante et ferme, rêveuse et la cibiche réduite à un trait oblique qu’on pourrait prendre, sur sa main, pour un anneau d’alliance qu’à vrai dire elle n’a jamais porté...Thierry Vernet, Portrait de Lucia K, en 1986. -
On the rocks

La question n’est pas de savoir s’il est plus élégant de patiner sur un iceberg ou sur un glacier de Terre de Feu : ce qui compte est le style qui s’y adapte à chaque fois.
Le style est un habitus: qu'on se le dise dans les églises. Le style n'est pas qu'une façon de parler ou de marcher sur les pieds du vulgum pecus: le style est une mesure exacte et la redistribution des générosités de la Nature dûment transformées. Le style est un savoir-boire et sans rêver tu oublies. Le style est l'art de l'oubli porté au biseau de la Mémoire.
Au bar, plus directement, le style découle aussi de sa capacité d'improviser selon l'immémoriale Tradition des banquises bipolaires et autres décors d'aurores boréales, car tout dépend à la fois d'un bon métier et des surfaces taillées au plus ou moins aigu des angles, autant que de la consistance cristalline de leurs effets de ciseaux - et quelle griserie c’est à tout coup de toupiller imaginairement sur son glaçon à la pointe de ses lames tout en laissant couler en soi la chaleur ambrée de son treizième Coca-cognac…
Image : Philip Seelen -
La poubelle Internet

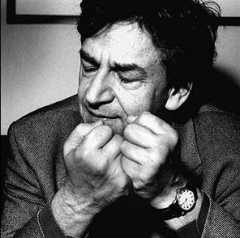
A propos d’un mot d’Alain Finkielkraut
(Dialogue schizo)
Moi l’autre : - Et que penses-tu de ça ?
Moi l’un : - De quoi ?
Moi l’autre : - De ce que prétend Alain Finkielkraut. Qu’Internet serait une poubelle ?
Moi l’un : - Je pense qu’il a raison à 99%. Et que, pour le reste, la poubelle me convient à merveille.
Moi l’autre: - Comme la Winnie de Beckett ?
Moi l’un : - Exactement ce que je me dis à chaque aube où je me connecte : « Encore une journée divine ! »
Moi l’autre : - C’est ta façon virtuelle de te rassurer ?
Moi l’un : - Absolument pas : je ne considère pas du tout Internet comme une réalité virtuelle, ou disons que, sur le 1% de temps compacté que je lui consacre, j’en tire 99% de réalité réelle, que je ne trouverai jamais à la télévision…
Moi l’autre : - Et dans les livres ?
Moi l’un : - Là tu me cherches, mais tu me trouves illico mesures en main : je dirai 100% de présence réelle pour les livres que je lis vraiment, ou pour ce que j’en écris, y compris sur Internet…
Moi l’autre : - Okay, mettons que cela tienne debout en ce qui te concerne, mais Aklain Finkielkraut affirme quelque chose qui relève du jugement de valeur général…
Moi l’un : - Ne fais pas la bête : tu te doutes bien que le philosophe ne vise aucunement l’outil Internet ni son utilisation constructive, mais son contenu réel global où la masse de déchets en croissance exponentielle appelle en effet la comparaison avec la poubelle.
Moi l’autre : - N’est-ce pas à un catastrophisme élitaire que tu cèdes ?
Moi l’un : - Pour le catastrophisme, sûrement pas. Il nous reste 1% où travailler et nous épanouir : c’est à peu près la dimension du jardin perso de chacun. Quant au caractère élitaire du travail au jardin : c’est l’évidence même.
Moi l’autre : - Et ça ne te gêne pas quelque part d’être élitaire ?
Moi l’un : - Certainement pas. Mais pour en revenir à notre statistique, ceci encore : que le 99% des déchets d’Internet correspond probablement, en termes d’objets bons à jeter, aux chiffres de l’industrie audiovisuelle, télévision publique comprise, des productions de l’écrit et de la société de consommation dans son ensemble.
Moi l’autre : On serait donc confinés, selon toi, dans ton minable 1 % ?
Moi l’un : - Minable en quoi ? Ah mais justement, mon jardin de curé m’appelle ! Et là, cher Candide, y a rien à jeter… -
Ceux qui voient le rapport
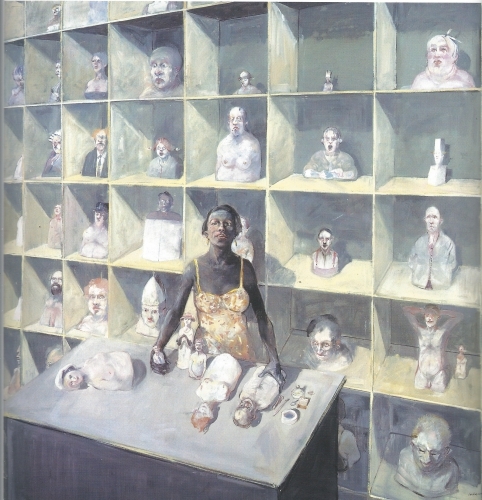 Celui qui théorise le vide par manque de souffle / Celle qui s’est remplie de ses manques / Ceux qui compulsent des équations au second degré / Celui qui ne touche pas terre quand il s’écoute parler / Celle qui est à l’écoute que coûte le doute / Ceux qui ont des relations qu’on dit relatives en américain / Celui qui excelle dans la mise en rapport des sexes sans relations / Celle qui planifie ses rapports en termes d’investissements et retours / Ceux qui voient l’avenir sous le masque du passé antérieur augmenté / Celui qui se fait vacciner par contumace / Celle qui n’entend plus le parfum des couleurs / Ceux que rassure le vide sanitaire ou l’on peut enfin tout se dire au niveau relationnel du ressenti / Celui qui te demande si tu veux lui parler sur un ton qui ne présage rien de bon du point de vue de la discrétion requise entre camarades de centre gauche / Celle qui est convaincue que des relations ouvertes s’imposent entre ses conjoints de tous genres / Ceux qui proposent aux divers membres de leur famille recomposée de ne rien se cacher de leurs pulsions en tant que membres d’un seul corps à plusieurs têtes et autres cartes de crédit / Celui qui garde ta tête sur ses épaules / Celle dont le pacemaker garantit la sérénité de son ménage à trois / Ceux qui relativisent à proportion des mises en rapport constantes qu’ils établissent entre réalité permaculturelle et spiritualité pulsionnelle / Celui qui n'a pas encore intégré la théorie des décisions à l'âge de se retirer du jeu / Celle qui a cru se jouer du hasard avant d''être rattrapée par une Circonstance peu fortuite / Ceux qui se rient du déterminisme qui les laisse dire tant il tient à leur liberté, etc.Peinture: Robert Indermaur.
Celui qui théorise le vide par manque de souffle / Celle qui s’est remplie de ses manques / Ceux qui compulsent des équations au second degré / Celui qui ne touche pas terre quand il s’écoute parler / Celle qui est à l’écoute que coûte le doute / Ceux qui ont des relations qu’on dit relatives en américain / Celui qui excelle dans la mise en rapport des sexes sans relations / Celle qui planifie ses rapports en termes d’investissements et retours / Ceux qui voient l’avenir sous le masque du passé antérieur augmenté / Celui qui se fait vacciner par contumace / Celle qui n’entend plus le parfum des couleurs / Ceux que rassure le vide sanitaire ou l’on peut enfin tout se dire au niveau relationnel du ressenti / Celui qui te demande si tu veux lui parler sur un ton qui ne présage rien de bon du point de vue de la discrétion requise entre camarades de centre gauche / Celle qui est convaincue que des relations ouvertes s’imposent entre ses conjoints de tous genres / Ceux qui proposent aux divers membres de leur famille recomposée de ne rien se cacher de leurs pulsions en tant que membres d’un seul corps à plusieurs têtes et autres cartes de crédit / Celui qui garde ta tête sur ses épaules / Celle dont le pacemaker garantit la sérénité de son ménage à trois / Ceux qui relativisent à proportion des mises en rapport constantes qu’ils établissent entre réalité permaculturelle et spiritualité pulsionnelle / Celui qui n'a pas encore intégré la théorie des décisions à l'âge de se retirer du jeu / Celle qui a cru se jouer du hasard avant d''être rattrapée par une Circonstance peu fortuite / Ceux qui se rient du déterminisme qui les laisse dire tant il tient à leur liberté, etc.Peinture: Robert Indermaur. -
Ceux qui ne pèsent pas lourd
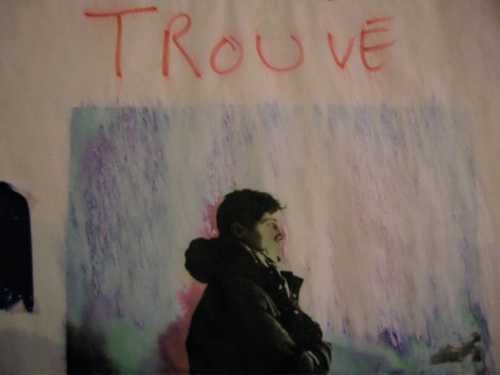
Celui qu’on oublie le long de la route sans faire exprès / Celle qui est naturellement effacée / Ceux qui n’aiment pas être vus même nus / Celui qui est toujours au jardin sauf les jours de retombées radioactives / Celle qui n’apparaît pas dans la liste des rescapés et se sent d’autant plus libre / Ceux qui sont si fâchés avec les chiffres que leurs bons comptes ne leur valent même pas d’amis / Celui qui s’exprime par sa note de frais / Celle qui donne toujours un peu trop (se dit-elle en se le pardonnant somme toute) aux mendiants / Ceux qui n’ont pas d’existence bancaire reconnue / Celui qui suscite des jalousies à proportion de son désintéressement à peu près total je dis bien à peu près / Celle qui n’est jamais invitée chez les De Vargasl à cause de son fils disparu la même année que leur chien Bijou / Ceux qui ne se sont jamais départis de la mentalité bas-de-laine de leur mère-grand Agathe la Bonne / Celui qui aime que les choses soient claires et préfère donc les tulipes blanches et le IVe Concert Brandebourgeois de Jean Séb Bach / Celle qui se dit qu’elle compte pour beurre ici-bas et se console à l’idée que le Très-Haut lui réserve un Bonus / Ceux qui ont compris qu’ils n’étaient rien de plus qu’eux-mêmes dans le métro matinal de Tôkyo / Celui qui essaie de se situer en tant que poète belge en traversant le quartier de Kanda (au centre de Tôkyo) où voisinent environ deux mille bouquineries / Celle qui a plusieurs dépucelages à son actif sans savoir exactement combien / Ceux qui n’ont jamais misé sur le don vocal de leur neveu Paul Anka (chanteur de charme à l’époque) qui en a été secrètement affecté / Celui qui est plutôt Sénèque le matin et plutôt Joubert le soir / Celle qui divague sur son divan de Diva / Ceux qui ricanent de Mademoiselle Lepoil militant au Conseil de paroisse en faveur de la reconnaissance de l’âme des hamsters femelles / Celui qui invoque les Pères de l’Eglise pour faire passer son message punk à la base / Celle qui use de sa muse pour emballer les jeunes nigauds qu’elle convoite / Ceux qui ont des voix de pasteurs noirs qui font bêler les brebis blanches / Celui qui n’a jamais compté les cadavres que son père et lui ont repêchés dans le fleuve / Celle qui n’a plus de créneau dans son Agenda pour caser un moment genre Où en suis-je Edwige ? / Ceux qui sont devenus meilleurs artisans à l’atelier Carton-plié de la prison des Fleurettes / Celui qui reste fidèle à ses erreurs de jeunesse avec un peu plus de métier faut reconnaître / Celle qui fait commerce de ce qui brille et ne récolte pas or pour autant / Ceux qui ont gardé le goût des vieilles Américaines fleurant bon le cuir et le chewing-gum dans lesquelles ils emmènent les veuves de leurs meilleurs amis, etc.
-
Vu que la Noël du poète serait partout et tous les jours
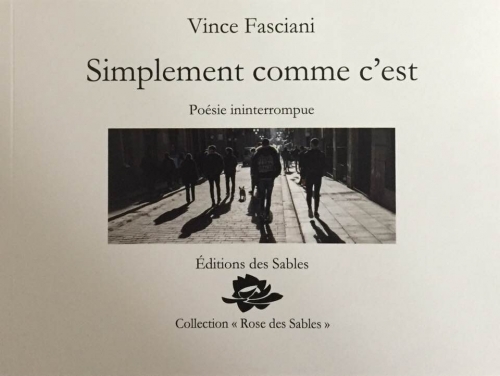 Entre poésie à quatre sous et célébration mystique, confusion mondiale et lueurs d’antique sagesse, marchands du temple et tendre innocence, Savoir à majuscule et sentiments minuscules, l’humanité se cherche un sujet de fête commune qui ait du sens. Folie apparente de ce Noël 2020 aux rites perdus, ou tout le contraire, ainsi que le suggère Simplement comme c’est, poème d’une seule phrase signé Vince Fasciani…
Entre poésie à quatre sous et célébration mystique, confusion mondiale et lueurs d’antique sagesse, marchands du temple et tendre innocence, Savoir à majuscule et sentiments minuscules, l’humanité se cherche un sujet de fête commune qui ait du sens. Folie apparente de ce Noël 2020 aux rites perdus, ou tout le contraire, ainsi que le suggère Simplement comme c’est, poème d’une seule phrase signé Vince Fasciani… Nous fêterions en sage famille la Noël de ce millésime un peu fou, juste cinq pelés et tondues avec l’Enfant et Marie, Joseph le père virtuel et deux figurants genre bergère et roi mage, sans masques mais avec la distance requise et du Bach ou du Dolly Parton sur la Playlist, vraiment le modèle de la sainte famille en son cluster occidental, et la poésie de la Nativité se perpétuerait en ce 24 ou 25 décembre - on ne sait pas trop, disons que le solstice rappellerait, avec l’archaïque célébration du dieu Mithra, le moment propice où, en présence de Vénus au ciel visible, serait advenu le pire et le meilleur en la même nuit, massacre d’innocents et naissance d’un Sauveur présumé de l’humanité mal barrée, cela pour la story magique qui a bel et bien coupé notre temps en deux, avant et après le moment de la crèche…
Nous fêterions en sage famille la Noël de ce millésime un peu fou, juste cinq pelés et tondues avec l’Enfant et Marie, Joseph le père virtuel et deux figurants genre bergère et roi mage, sans masques mais avec la distance requise et du Bach ou du Dolly Parton sur la Playlist, vraiment le modèle de la sainte famille en son cluster occidental, et la poésie de la Nativité se perpétuerait en ce 24 ou 25 décembre - on ne sait pas trop, disons que le solstice rappellerait, avec l’archaïque célébration du dieu Mithra, le moment propice où, en présence de Vénus au ciel visible, serait advenu le pire et le meilleur en la même nuit, massacre d’innocents et naissance d’un Sauveur présumé de l’humanité mal barrée, cela pour la story magique qui a bel et bien coupé notre temps en deux, avant et après le moment de la crèche… Poésie de Noël ? Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas célébrer la naissance d’un enfant palestinien, à la fois juif et citoyen du monde, de nature peut-être divine même si l’on n’en sait pas plus qu’un physicien en matière de cantiques ? Pourquoi ne pas se réjouir de se retrouver en famille comme dans notre enfance, même s’il est politiquement correct de détester Noël ? Pourquoi ne pas se souhaiter joyeux Noël au prétexte que ce n’est pas la joie dans les mouroirs d’à côté et les dépotoirs de Lesbos ou de Calais, les ruines d’Alep et de partout où l’on n’a que ses yeux pour pleurer ? Et si ce qu’on appelle la conscience et la confiance avaient autant de droits, non seulement à Noël mais tout le temps et partout, que ce qu’on dénigre sous la formule de «bonne conscience» ?Au conditionnel de l’enfance, nous serions tous poètes…Ce que j’entends par poésie, sans savoir trop bien de quoi il s’agit au sens du Savoir à majuscule du spécialiste, serait, « simplement comme c’est », une façon « augmentée » de ressentir notre présence au monde et de l’exprimer en « musique », avec ce « supplément d’âme » qu’on ressent comme une joie - tous ces guillemets suggérant que cette joie simple comme bonjour est aussi subtile en sa substance qu’une molécule d’émotion ou un atome de sentiment pur et que les mots ne la ressaisiront pas mieux qu’une mélodie réduite en chiffres…
Poésie de Noël ? Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas célébrer la naissance d’un enfant palestinien, à la fois juif et citoyen du monde, de nature peut-être divine même si l’on n’en sait pas plus qu’un physicien en matière de cantiques ? Pourquoi ne pas se réjouir de se retrouver en famille comme dans notre enfance, même s’il est politiquement correct de détester Noël ? Pourquoi ne pas se souhaiter joyeux Noël au prétexte que ce n’est pas la joie dans les mouroirs d’à côté et les dépotoirs de Lesbos ou de Calais, les ruines d’Alep et de partout où l’on n’a que ses yeux pour pleurer ? Et si ce qu’on appelle la conscience et la confiance avaient autant de droits, non seulement à Noël mais tout le temps et partout, que ce qu’on dénigre sous la formule de «bonne conscience» ?Au conditionnel de l’enfance, nous serions tous poètes…Ce que j’entends par poésie, sans savoir trop bien de quoi il s’agit au sens du Savoir à majuscule du spécialiste, serait, « simplement comme c’est », une façon « augmentée » de ressentir notre présence au monde et de l’exprimer en « musique », avec ce « supplément d’âme » qu’on ressent comme une joie - tous ces guillemets suggérant que cette joie simple comme bonjour est aussi subtile en sa substance qu’une molécule d’émotion ou un atome de sentiment pur et que les mots ne la ressaisiront pas mieux qu’une mélodie réduite en chiffres… J’en viens alors à Simplement comme c’est, le tout récent opuscule d’un poète septuagénaire qui se dit citoyen du monde, au nom de Vince Fasciani, rencontré au petit bonheur de Facebook alors que nous avons publié plusieurs livres à la même enseigne de L’Âge d’Homme sans jamais nous croiser et qu’il vit au bord de l’Arve chère à Georges Haldas.Cependant, lisant sa Poésie ininterrompue de huitante pages, j’oublie son âge, son état-civil et son origine de Rital helvète pour ne ressentir immédiatement que ça: le présent de la présence, si j’ose dire, au double sens d’un cadeau et d’une évidence immanente.Tout de suite en effet cette phrase en zigzags non ponctuée coule de source sur la page et se faufile en mince cours d’eau limpide avec ses mots lumineux cristallisés de loin en loin en constatations pensives ou rêveuses, et c’est une humble célébration de tous les jours avec leurs minutes heureuses mais autant de creux et de ces blancs de l’espace-temps que Cézanne réservait de plus en plus dans ses aquarelles comme peintes en suspens dans l’air léger.Cela à l’air de rien, c’est apparemment le degré zéro de la complication poétique sans être du minimalisme à la sauce blanche, le type qui écrit se dit bel et bien poète mais sans hausser jamais le ton, présent à son « job » en affirmant qu’il « dispose d’un peu de ciel dans son évier », signalant d’emblée qu’un visage suffirait à déplacer l’ordre des choses, et ce sera la présence de l’autre au féminin, ce sera un peu comme à quinze ans quand on a une amoureuse et qu’on brûle d’en parler tout en gardant ce trésor pour soi, car la joie est partout présente, ou le blues qu’il y a forcément au revers de la joie, et la machine à laver qui ronronne et la rue qui bourdonne.Ce serait donc Noël malgré les galères
J’en viens alors à Simplement comme c’est, le tout récent opuscule d’un poète septuagénaire qui se dit citoyen du monde, au nom de Vince Fasciani, rencontré au petit bonheur de Facebook alors que nous avons publié plusieurs livres à la même enseigne de L’Âge d’Homme sans jamais nous croiser et qu’il vit au bord de l’Arve chère à Georges Haldas.Cependant, lisant sa Poésie ininterrompue de huitante pages, j’oublie son âge, son état-civil et son origine de Rital helvète pour ne ressentir immédiatement que ça: le présent de la présence, si j’ose dire, au double sens d’un cadeau et d’une évidence immanente.Tout de suite en effet cette phrase en zigzags non ponctuée coule de source sur la page et se faufile en mince cours d’eau limpide avec ses mots lumineux cristallisés de loin en loin en constatations pensives ou rêveuses, et c’est une humble célébration de tous les jours avec leurs minutes heureuses mais autant de creux et de ces blancs de l’espace-temps que Cézanne réservait de plus en plus dans ses aquarelles comme peintes en suspens dans l’air léger.Cela à l’air de rien, c’est apparemment le degré zéro de la complication poétique sans être du minimalisme à la sauce blanche, le type qui écrit se dit bel et bien poète mais sans hausser jamais le ton, présent à son « job » en affirmant qu’il « dispose d’un peu de ciel dans son évier », signalant d’emblée qu’un visage suffirait à déplacer l’ordre des choses, et ce sera la présence de l’autre au féminin, ce sera un peu comme à quinze ans quand on a une amoureuse et qu’on brûle d’en parler tout en gardant ce trésor pour soi, car la joie est partout présente, ou le blues qu’il y a forcément au revers de la joie, et la machine à laver qui ronronne et la rue qui bourdonne.Ce serait donc Noël malgré les galères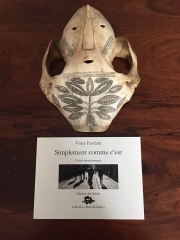 L’art du simple est difficile, qui requiert autant de sensibilité fine que de tact verbal et de grâce musicienne, de modestie intérieure et de mesure détaillée avec ou sans solfège et autres rimes – on pense aux sonatines d’Erik Satie et aux fugues perlées de Scarlatti ou au lento dolcissimo de Thelonius Monk -, il y faut de la concentration et autant de légèreté que dans les haïkus et les tankas de Bashô le vieux natté ou de Takuboko l’autre inspiré nippon mort à un âge encore tendre, tout cela procédant universellement de l’état chantant vécu par Haldas penché sur sa table de Chez Saïd comme un Chinois, ou Pessoa dans son bureau de tabac, ou Saba dans sa librairie de Trieste, et le poète de 70 piges à la page 70 de Simplement comme c’est constate que «malgré toutes ces années sur terre» il remarque encore « la nature raffinée et généreuse de sa bonne amie », et tu le prends pour toi, vous le prenez toutes et tous à votre façon comme les « gisements d’or » du cœur de ceux que vous aimez, bref ce serait Noël malgré les galères et comme le poète je vous souhaite de pouvoir dire « je m’apprête à vivre l’enfantement réciproque de moi et du monde », je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir dire comme lui « là où un homme peut encore faire quelque chose de sa vie je me porte volontaire », et ça finirait en beauté au plus-que-présent car « la joie de la réalité est le spectacle le plus saisissant du monde » et qu’il n’ y a pas « besoin de fermer les yeux » pour le voir et le croire…Vince Fasciani, Simplement comme c’est, Poésie ininterrompue Éditions des sables, Genève, 2020.
L’art du simple est difficile, qui requiert autant de sensibilité fine que de tact verbal et de grâce musicienne, de modestie intérieure et de mesure détaillée avec ou sans solfège et autres rimes – on pense aux sonatines d’Erik Satie et aux fugues perlées de Scarlatti ou au lento dolcissimo de Thelonius Monk -, il y faut de la concentration et autant de légèreté que dans les haïkus et les tankas de Bashô le vieux natté ou de Takuboko l’autre inspiré nippon mort à un âge encore tendre, tout cela procédant universellement de l’état chantant vécu par Haldas penché sur sa table de Chez Saïd comme un Chinois, ou Pessoa dans son bureau de tabac, ou Saba dans sa librairie de Trieste, et le poète de 70 piges à la page 70 de Simplement comme c’est constate que «malgré toutes ces années sur terre» il remarque encore « la nature raffinée et généreuse de sa bonne amie », et tu le prends pour toi, vous le prenez toutes et tous à votre façon comme les « gisements d’or » du cœur de ceux que vous aimez, bref ce serait Noël malgré les galères et comme le poète je vous souhaite de pouvoir dire « je m’apprête à vivre l’enfantement réciproque de moi et du monde », je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir dire comme lui « là où un homme peut encore faire quelque chose de sa vie je me porte volontaire », et ça finirait en beauté au plus-que-présent car « la joie de la réalité est le spectacle le plus saisissant du monde » et qu’il n’ y a pas « besoin de fermer les yeux » pour le voir et le croire…Vince Fasciani, Simplement comme c’est, Poésie ininterrompue Éditions des sables, Genève, 2020. -
Mélancolie
… C’est lorsque tu m’as quitté que j’ai commencé à lire les journaux économiques japonais dans les rues désertes du quartier des affaires, et le soir je ne manquais pas un film animalier, tu t’es toujours gaussée de mon peu de savoir en matière éthologique, aussi prenais-je des notes en me documentant sur la vie du chien ou du singe domestique, mais tu ne passais jamais dans la rue où je me tenais quand tu te rendais à la Bourse, et j’en viens à croire que mon peu de savoir en quoi que ce fût t’aurait suffi, après ma première panne, à te faire préférer la compagnie de ceux que tu appelais tes seules amours…
Image: Philip Seelen
-
Une immense lecture
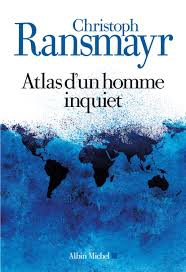

Lecture intégrale du dernier livre, extra-ordinaire, de Christophe Ransmayr. D'autres commentaires suivront...
RANSMAYR Christoph. Atlas d’un homme inquiet. Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 458p.
Au bout du monde- Que les histoires se racontent.
- Sur un bateau à destination de Rapa Nui, l'île de Pâques.
- Navigation mouvementée. Le Pacifique pas du tout calme.
- Tout de suite l’univers physique est très présent.
- Un homme « effroyablement maigre » parle au Voyageur.
- Evoque le peuple de Rapa Nui, qui a peuplé les îles de milliers de statues de pierre.
- Les habitants étaient sûrs d’être seuls au monde et ne se rappellent pas leur origine.
- Parle un mélange d’anglais, d’espagnol et d’une langue inconnue. L’île est assimilée, à sa découverte, au séjour d’un dieu.
- Lequel, Tout Puissant, se nomme Maké-Maké…
- Son père est anglais et sa mère Rapa Nui.
- Manger lui est très pénible.
- Les statues s’appellent moaïs.
- Des figures tutélaires d’un culte oublié, qui sont devenues symboles de puissance.
- L’homme très maigre estime que la faim a été le destin de ce peuple.
- Dont les habitants ont épuisé les richesses naturelles et ont fini par s’entre-dévorer. Avant d’être exploités par les Péruviens dans des mines de guano.
- La quête de la faim est assimilée, dit-il, à une quête du corps astral. Texto.
- Le Voyageur se concentre ensuite sur la présence des sternes fuligineuses, dont l’homme très maigre dit que ce sont des oiseaux sacrés.
- Ils portent des noms étonnants : le puffin de la nativité, le fou masqué ou le pétrel de castro.
- La présence des oiseaux sera récurrente dans ce livre.
- Le Voyageur-poète y apparaît comme un témoin sensible. « J’étais là, telle chose m’advint ».
- Mélange de récit de voyage et d’évocation poétique mais sans fioritures.
 Chant de territoire.
Chant de territoire.
- Le Voyageur se retrouve sur la muraille de Chine enneigée.
- Où il avise la silhouette d’un type s’approchant.
- Un Mr Fox de Swansea, ornithologue, qui a vécu avec Hong Kong avec sa femme chinoise et répertorie des chants de territoire des merles.
- Classe les chants en fonction des sections de la muraille, chaque territoire ayant sa modulation.
- Le chant d’une grive marque l’au revoir des deux hommes.
- Une atmosphère étrange et belle se dégage de cette rencontre. La merveille est partout, très ordinaire en somme et prodigue en histoires.
- Herzfeld
- Chaque récit commence par « Je vis »…
- « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant »…
- Cette fois on est dans l’état fédéral. Brésilien de Minas Gerais.
- On enterre le Senhor Herzfeld.
- Dont le Voyageur a fait la connaissance deux jours plus tôt.
- Le fils d’un fabricant d’aiguilles à coudre du Brandebourg, exilé à la montée du nazisme.
- Herzfeld a commencé à lui raconter sa vie.
- Puis est mort la nuit suivante.
- L’évocation de la mise en bière du Senhor Herzfeld, et son enterrement, forment le reste de l’histoire.
Cueilleurs d’étoiles
- Le récit commence par la chute d’un serveur et de son plateau chargé de bouteilles sur une terrasse jouxtant un café des hauts de San Diego.
- Le serveur se retrouve par terre alors que tous alentour scrutent le ciel.
- Il a buté sur le câble d’alimentation d’un télescope électronique.
- Tous scrutent la Comète.
- Dont le passage coïncide, ce soir-là, avec une éclipse de lune.
- Et le serveur, aidé de quelques clients, ramasse les éclats de verre qui sont comme des débris d’étoiles.
- Cela pourrait être kitsch, mais non.
 Le pont céleste.
Le pont céleste.
- On voit des cônes de pierre noire sur lesquels déferlent des dunes.
- Le Voyageur se trouve quelque part au Maroc, dans un lieu dominé par des tumulus mortuaires d’une civilisation disparue.
- Là encore, le lien entre un lieu fortement chargé, et le passage des humains, est exprimé avec un mélange de précision et de poésie très singulier.
Mort à Séville.
- Le dimanche des Rameaux, dans les arènes de Séville, se déroule un dernier combat entre un cavalier porteur de lance et un taureau.
- La suite des figures est marquée par l’hésitation du taureau et la blessure du cheval, puis du public jaillit la demande de grâce, d’une voix unique.
- L’affrontement est évoqué avec une sorte de solennité, sans un trait de jugement de la part du Voyageur.
- C’est très plastique et assez terrifiant.
- Et cela finit comme ça doit finir.
- Sans que rien n’en soit dit.
 Fantômes.
Fantômes.
- On passe ensuite en Islande, où le Voyageur croit voir des fantômes.
- Se trouve là en compagnie d’un photographe, familier des légendes islandaises,nourries par les proscrits relégués dans cet arrière-pays.
- Lui raconte celle, saisissante, du bandit à qui le bourreau a coupé une jambe pour l’empêcher de se sauver, et qui a appris a courir en faisant « laroue ». Une roue humaine qui terrifie les passants quand elle leur fonce dessus…
- Où il est question de la peur du noir et des « diables de poussière ».
- Extinction d’une ville.
- Le Voyageur se retrouve au sud de Sparte.
- Il a été jeté de sa moto par il ne sait quoi.
- Puis remarque, dans la nuit, que les lumières de la ville de Kalamata sont éteintes.
- Ensuite il rejoint un café en terrasse où il découvre, à la télé, qu’un séisme vient d’avoir lieu dans la région.
- Qui a provoqué sa chute et l’extinction de la ville.
- Cela encore raconté sans le moindre pathos. J’étais là, telle chose m’advint.
- Mais rien non plus de froidement objectif là-dedans.
À la lisière des terres sauvages.
- Dans un asile psy autrichien, une jeune femme s’apprête à faire du feu avec du papier et des copeaux invisibles.
- On voit la scène, très développée ensuite.
- Sous le regard d’une gardienne dans une cage de verre.
- La jeune femme entend une voix qui lui dit : « Tu ne doit pas tetuer »…
 Tentative d’envol.
Tentative d’envol.
- Au sud de la Nouvelle Zélande, en terre maorie, le Voyageur observe un jeune albatros royal en train d’essayer de s’envoler.
- L’occasion d’une longue et épique digression sur la vie des albatros, telle que la lui évoque un ancien chauffeur d’autocar devenu ornithologue après la mort accidentelle de sa femme.
- Formidable récit ponctué de nouvelles diverses en provenance du monde des humains.
- Le Paon.
- ÀNew Delhi, son chauffeur de taxi lui évoque l’imminente pendaison du meurtrier d’Indira Gandhi.
- Une certaine psychose règne, liée àl’attentat qui a provoqué le massacre de milliers de sikhs.
- Atmosphère de pogrom.
- Le Voyageur veut se rendre au Rajasthan et à Jaïpur.
- « Et c’est alors que je vis le paon ».
- Uneapparition qui rappelle celle du paon de Fellini, dans Amarcord…
L’attentat.
- Le Voyageur se retrouve à Katmandou, dont les frondaisons des arbres sur le boulevard central, sont occupées par des milliers de renards volants.
- Plusieurs membres de la famille viennent d’être tués, et le nouveau roi se trouve probablement dans la limousine d’un convoi.
- Au moment de l’attentat auquel assiste le Voyageur, une nuée de renards volants obscurcit le ciel.
- Où le Voyageur croit voir un écho significatif aux événements en cours…
 Attaque aérienne.
Attaque aérienne.
- On se trouve maintenant sur les hautes terres boliviennes.
- Où le Voyageur chemine avec des amis, un biologiste bavarois et sa compagne italienne.
- Quand surgissent des chasseurs qui volent en rase-motte au-dessus d’eux, la jeune femme leur lance en espagnol : No pasaran.
- Il faut préciser qu’un nouveau dictateur s’est installé en Bolivie.
- Mais le pilote a vu le geste de défi de la jeune femme et fait demi-tour et canarde le trio.
- Se non è vero… io ci credo purtoppo.
- Plage sauvage.
- Un vieux type au crâne rasé, sur une plage brésilienne, semble rendre un culte privé à une femme dont il tient la photographie près de lui.
- Et soudain son parasol s’envole.
- Le Voyageur va pour l’aider, mais un jeune homme sort de la forêt et secourt le vieux.
- Sur quoi le voyageur lance « Amen ! Amen ! » à l’océan.
- Tout cela toujours étrange et vibrant de présence.
-
- Homme au bord de la rivière
- Un type repose en maillot de bain au bord de la Traun, rivière de haute-Autriche.
- Quelques enfants veillent sur son demi-sommeil, claquant des mains pour tuer les taons qui lui tournent autour.
- Les taons morts sont recueillis dans des sachets de feuilles.
- Lorsque le type se réveille, il compte les taons et distribue des piécettes à ses gardiens du sommeil.
- Etrange et belle scène d’été.
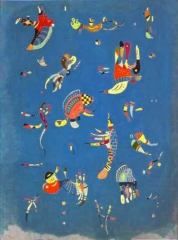 Le souverain des héros.
Le souverain des héros.
- Au sommet de l’île d’Ios, dans les Cyclades, le Voyageur découvre les stèles blanches du tombeau d’Homère (92-97) et médite à propos de ce monument au « plus grand poète de l’humanité ».
- Il y voit un monument « à la mémoire d’un chœur de conteurs disparus »,tout en évoquant merveilleusement ce lieu que je me rappelle comme de ce jour-là après la baignade…
- Un chemin de croix.
- Sur la route de Santa Fe, à bord d’une Cadillac bordeaux qu’il a louée, le Voyageur croise une procession entourant un porteur de croix, dont les pèlerins lechassent bientôt à coups de pierre.
- Peuaprès il rencontre un deputy sheriffqui lui explique que ces penitentes procèdent parfois à de véritables crucifixions, parfois fatales au crucifié volontaire,mais absolument illégales…
- D’outre-tombe.
- À Mexico, le Voyageur observe une petite accordéoniste jouant sur le trottoirdans un entourage de squelettes et de têtes de mort et de cercueils en chocolat marquant la fête du Jour des Morts.
- Le Voyageur se rappelle alors une jeune Indienne sur une fresque, visiblementdestinée à un sacrifice rituel à l’ancienne cruelle façon. (p.104)
- Chacunde ces récits se constitue en unité, cristallisé par le regard du Voyageur etplus encore par son art de l’évocation, à la fois réaliste et magique.
- Onpense à Werner Herzog, en moins morbide, ou à Sebald, en plus profond.
Déplacement de sépultures
- Sur l’Île de Robinson Crusoë, quatre mois après un tsunami.
- Un homme s’affaire à mettre de l’ordre dans les tombes dévastées par l’eau.
- LeVoyageur se trouve là sur les traces d’Alexandre Selkirk, le boucanier donts’est inspiré Daniel Defoe.
- Unrécit qui suggère physiquement la mêlée des vivants et des morts.
- L’alertedonnée par une petite fille a permis de limiter le nombre de morts en ceslieux.
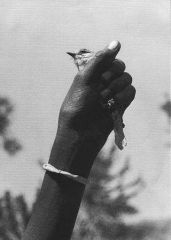 Prise accidentelle
Prise accidentelle
- Suit le récit du sauvetage, par un pêcheur de homards furibond, du bateau à bordduquel le Voyageur se trouvait.
- Le pêcheur maudit le ciel à cause de sa pêche calamiteuse : Un seul homarddans 59 casiers.
- Maisen arrivant au port, de rage, il remet le homard unique à l’eau…
- Dans les profondeurs
- Avecd’autres whale watchers, le Voyageur observe une baleine « timide »qui a l’air de rêver au-dessous de lui, son aile reposant sur son baleineau…
- Ensuiteil éprouve une vraie terreur lorsque la baleine s’approche de lui. On pense àMoby Dick, au fil d’une évocation de ces immensités marines…
La reine de la jungle
- Il voit un veau mort dans une clairièred’herbe entourée de jungle.
- Lachose se passe dans l’Etat fédéral brésilien de Sao Paulo.
- Le proprio est un Allemand émigré qui a importé des vaches du Simmenthal.
- La forêt vierge perçucomme une entité vivante que l’Allemand a combattu pendant des années.
- Récit de ses tribulations.
- Et soudaine apparitiond’un anaconda de sept ou huit mètres traversant lentement la route.
- Telle étant la reinede la jungle.
- Dont un train routierlui fonçant dessus aura probablement brisé les vertèbres, quoique le serpentcontinue d’avancer…
La transmission
- Histoire du batelier Sang, sur le Mékong, dont le filsconduit depuis trois jours le bateau sur lequel se trouve le Voyageur.
- Quand il y a un danger, son père lui pose la main surl’épaule, sans un conseil de plus.
- Le fils connaît chaque remous du fleuve par son nomancien.
- L’histoire de Sang recoupe celle des bombardements sur leLao, dont l’intensité à dépassé ceux de l’Europe à la fin de la guerre.
L’Adieu
- Sur un banc de laplace du marché d’un bourg autrichien, un vieil homme, prof retraité et veuf,reste là avec une amie et fait parfois semblant de dormir.
- Cette fois pourtant,il peine à se réveille, jusqu’au moment où l’on constate qu’il ne fait plussemblant du tout.
- À la morgue, une larmeversée par le Voyageur nous fait comprendre qu’il vient de perdre son père.
Dans l’espace cosmique
- Le Voyageur seretrouve couché dans un canot à fond plat, conduit par un Maori dans une sortede labyrinthe à ciel ouvert.
- Puis le canot s’échouesur un matelas spongieux formé d’insectes morts.
- On retrouve là lessensations à la fois physiques et et quasi métaphysiques évoquées par Coloaneou Sepulveda au contact de la nature sauvage.
Drive au Pôle Nord
Récit d’une tout autre tonalité, dont un joueur de golf de l’Illinois est le sujet.
- Natif de Riga, il aémigré aux States après la déportation de son père par les Soviétiques.
- Débarqué au pôle nordà bord d’un brise-glace atomique, il va tirer dix coups sous le regard interditdu Voyageur, dix balles de golf dans la neige, à proximité du drapeaurusse…
Retour au bercail
- Le long d’une rivière canadienne, en Ontario, le Voyageur assiste à la remontée problématique dessaumons qui vont se heurter à l’obstacle d’une cascade asséchée.
- Désignant la« saloperie da cascade », un pêcheur n’en fait pas moins lacueillette de quelques saumons survivants…
Courants contraires
- Au Cambodge, leVoyageur assiste au feu d’artifice sur le Mékong, à l’occasion de la fête del’eau à Phnom Penh, avant d’évoquer les effets de la mousson sur les crues descours d’eau et des lacs.
- Cette évocationrecoupe celle des massacres imputables aux Khmers rouges.
- Très remarquable récit là encore.
 Le travail des anges
Le travail des anges
- Le Voyageur se retrouve à Trebic, près de l’égliseSaint Martin et nonloin du cimetière juif dont s’occupe le vieux Pavlik, ancieninstituteur non juif.
- Il est làé comme ungardien de mémoire, car il est question de désaffecter ce cimetière où reposentplus de 11.’’’ Juifs.
- Il est visiblementmarqué par la réflexion selonlaquelle les anges du Tout Puissant ont regardépasser les trains de déportés vers les camps d’extermination sans broncher.
Dans la forêt de colonnes
- Devant la citerne géante de Yerebatan, en la basilique souterraine de Justinien, au milieu de laforêt des colonnes, le Voyageur observe le curieux manège d’un visiteur quis’immerge après avoir jeté une pièce dans l’eau, qu’il entreprend ensuite deretourner.
- Scène étrange en celieu, comme beaucoup d’autres scènes de ce livre en d’autres lieux…
La beauté des ténèbres
- Le Voyageur se décritlui-même en train de scruter, avec ses instruments d’astronomie, la galaxiespirale de la Chevelure de Bérénice, qui a mis quelque 44 millions d’annéespour arriver du fond de l’espace à cet observatoire pseudo de Haute-Autriche.
- La séquence est assezvertigineuse, finalement traversée par le cri d’une chouette hulotte rappelant que le ciel communique avec la terre…
Tombé du ciel nocturne
- À Jaipur cette fois,du toit en terrasse de l’hôtel dit Le Palais des Vents, le Voyageur assiste àl’envol de milliers de cerfs-volants à l’occasion de la fin de l’hiver.
- Le récit de la chuted’une roussette, blessée par l’armature aiguisée d’un cerf-volant, corse lerécit de manière significative, comme l’épisode des renards volants…
Le pianiste
- Il y a du conte trèsplastique, à la japonaise, dans cet épisode faisant intervenir un très petitpianiste, assis comme un enfant à un grand piano, tandis que l’air extérieur vibre au chant des cigales.
- Le reste se ressentplus qu’il ne se décrit, comme souvent au fil de ces pages subtiles, à la foisréalistes et irréelles.
La chance et l’océan calme
- Le Voyageur, dans unquartier populaire de Valparaiso, observe un type qui lui semble un vendeur debillets de loteries au vu du collier de tickets qu’il porte autour du cou.
- Or ces billets ne sont pas à vendre mais représentent la collection des billets non gagnants rassemblés par le type en question.
- Tout cela sur f
ond de réalité chilienne non détaillée au demeurant…
Les règles du paradis
- Suit le plus long récit du livre, de presque vingt pages, évoquant la saga fameuse des révoltés du Bounty, alors que le Voyageur se trouve sur l’île perdue de Pitcairn où lesmutins ont fini par débarquer et crever après moult tribulations.
- L’on en apprend plus sur l’aventure de Fletcher Christian et de ceux qui l’ont assisté, puis le
Voyageur interrogecertains des descendants des forbans et se balade le long des falaises à-pic del’île.
- Il y a là-dedans un mélange de souffle épique et de sauvagerie où les fantasmes paradisiaques à la Rousseau en prennent un rude coup.
Tout cela très fort,toujours inattendu et intéressant, d’une expression limpide et comme nimbéed’étrangeté ou de mystère.
Loin est ici àmi-parcours de ce livre sans pareil.
La face cachée du salut
- L’apparition d’ungilet de sauvetage rouge, au bord d’un champ d’épaves de l’Océan indien,prélude à l’évocation du drame qui a coûté la vie à l’équipage d’un cotredisparu. Dont l’épave seule, intacte, réapparaît ensuite. Geste rituel d’uneHindoue versant de l’eau du Gange dans l’eau où reposent les noyés.
Le non-mort.
- Ensuite on se retrouvesur la Place Rouge, à Moscou, où sept couples de jeunes mariés attendent de sepointer dans le mausolée de Lénine.
- Diversesconsidérations devant la dépouille irréelle du révolutionnaire devenu dictateur.
Visiteurs au parlement.
- Après la visite à lamomie russe, le Voyageur observe un vieux type, pieds nus, dans la file descurieux se pressant à l’entrée du Reichstag de Berlin.
- Les pieds nus de l’original intriguent unepetite fille et mettent en évidence, sans peser, l’aspect étrange voire absurde de cetteprocession.
 Nu dans l’ombre
Nu dans l’ombre
- De nombreux récits durecueil ont une connotation politique. Sans discours à ce propos.
- Ici, c’est un hommenu, dans la cours d’une prison psychiatrique, dans la Grèce des colonels.
- Le cri du type déchireet signifie, sans besoin d’autre commentaire.
- Cependant la scène estminutieusement détaillée, avec quelque chose de très oppressant.
Un requin dans le désert
- Sur une route côtièrede la mer Rouge, le Voyageur remarque un arbre couvert de petits fanions, luirappelant les drapeaux de prière tibétains. Mais la comparaison s’arrête là carces chiffons n’ont rien de sacré.
- Puis on se retrouve aumarché aux poissons d’Al Hudaydah, et ensuite sur les lieux d’un accident detriporteur dont le conducteur débite le requin qu’il transportait.
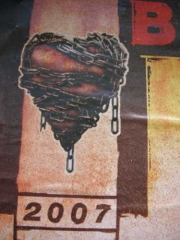 Sang
Sang
- Le Voyageur se remémore son enfance en Autriche, après le massacre, par la police, d’un garçon sauvage du lieu.
- Ivre, le lascar avait profané un monument aux morts de la guerre, et les anciens combattants l’ont dénoncé.
- Le Voyageur étaitalors enfant de chœur, et il évoque le drame à la manière d’un Thomas Bernharddans ses récits de faits divers.
- Les traces de sangdans l’église ont marqué la mémoire du narrateur.
Arche de lumière
- Le Voyageur seretrouve à Sydney où il observe l’ascension de l’arche gigantesque du HarbourBridge, par un type dont il croit qu’il va se suicider.
- Puis la ville estfrappée par une panne d’électricité géante.
- Il croit voir« la phase terminale d’un chemin de vie ».
- Mais c’est comme une erreur d’optique, ou comme une façon d’accommoder la vision, fréquente chez CR.
Seconde naissance
- À bord d’un brise-glace russe à l’arrêt sur labanquise, un pilote d’hélico convie ingénieurs et matelots à fêter sa secondenaissance après le crash de son appareil.
- Cela se passe vingtans après le récit de la découverte de la Terre François-Joseph, qu’il aévoquée dans Les effrois de la glace etdes ténèbres.
- Très belle évocationd’une ourse polaire et de ses petits (p.274)
Le dieu de glace.
- Le Voyageur évoque ledésarroi d’un petit garçon qui voit fondre la tête d’un bonhomme de neigeconservé dans un congélateur.
- La scène se passedevant un manoir du comté de Cork.
- Le père et le fils finissentpar éclater de rire à la vision de la tête fondue.
- On n’en saisit pasmoins l’importance magique de cette têtede neige…
Le prêcheur.
- Se la jouant Jésus et les marchands du temple, un prêcheur invective les petits commerçants ukrainiens et caucasiens dont les cahutes envahissent la pelouse du grand stadedu Dixième anniversaire, construit en mémoire du soulèvement de Varsovie.
- La scène est assez emblématique, typique de la Pologne de la fin des années 80.
- Je me rappelle une manifestation patriotique monstre dans le même stade, pendant les années de plomb.
Un photographe.
- Un cantonnier en train de creuser une fouille, devant une maison bleu pâle de la ville dominicaine dePuerto Plata, est prié par une dame de la prendre en photo avec deux types.
- Une pancarte vientd’être posée devant la maison, annonçant l’ouverture d’un cabinetd’hypnotiseur.
- Le cantinier, aprèsavoir tenu l’appareil de photo en ses mains, se dit que peut-être sa vie auraitpu être tout autre…
- Là encore, la banalitéd’une scène se charge d’étrangeté et de sens plus profond.
Pacifico, Atlantico.
- Le Voyageur se retrouve à 3400 mètres d’altitude, juste au-dessous du cratère de l’Irazu, levolcan le plus dangereux du Costa Rica.
- Il se trouve là dansl’espoir de voir l’oiseau quetzal, mais le brouillard est au rendez-vous.
- Il est aussi question du pèlerinage à la Vierge noire, la Negrita.
Love in vain.
- Dans une clairière de la mangrove, sur la côte est de Sumatra, le Voyageur surprend une scène un peusurréaliste de karaoké sans public, dont le chanteur (aveugle) interprète untube des Rolling Stones,
- Comme à chaque fois, ce n’est jamais lepittoresque qui est recherché par le Voyageur, mais l’étrangeté, le mystère, lamagie d’une situation où nature et culture ne cessent de s’interpénétrer.(p.300)
La menace
- En Malaisie, le Voyageur est confronté à la chasse aux trafiquants de drogue,menacés de mort.
- Raconteun contrôle à la douane, où son bus est vidé de ses occupants et immobilisélonguement.
- Une jeune femme est contrôlée plus sévèrement que les autres.
- Puis elleregagne sa place dans le bus. Mais personne ne vient s'asseoir près d'elle...
Présumé coupable
- Puis on se trouve en Afrique du Sud.
- Le buss'est arrêté auprès d'une pancarte proclamant : Hang em !
- Il estquestion d'un flic blanc, soupçonné de meurtre. Mais rien n'est sûr.
- Des conversations contradictoires suggèrent le climat du moment, plus à cran que jamais...
 Dimanche blanc
Dimanche blanc
- Où il est question de la prochaine communion d'une petite fille.
- Que son père accompagne dans un magasin de chaussures, sans cesser de critique cette dépense, et cette fête, non sans charrier la vendeuse de mufle manière .
- La grossièreté du type me rappelle tout à fait certaine Autriche. Le con.
- Et comme elle raison, la petite fille, de refuser de porter les godasses !
La pêcheuse à la ligne
- Une autrepetite fille, à Katmandou, avec une canne à pêche.
- Elle setrouve là au milieu des bûchers, sur lesquels crament des cadavres.
- Elle pêche, à l'aimant, des bijoux tombés des bûchers.
Le vase chinois
- À Santiago duChili, dans un jardin retiré, le Voyageur tombe sur une vase chinois genreMing, de trois mètres de haut.
- L'ambiance est à la préparation d'une garden-party.
- À un momentdonné, un employé du personnel de service déplace le vase, qui semble nepeser rien.
- L'objet doit êtrede papier.
- Le détailchange tout de ce qu'on perçoit de la séquence...
Calligraphes
- Au bord du lac de Kunming, au nord-ouest de Pékin, des calligraphes recopient des poèmes Tang sur de grandes pierres, se servant d'eau en guise d'encre. De sorteque le soleil fait s'évaporer tout ce qui s'écrit.
- Merveilleuse évocation là encore, sans rien de kitsch...
Pèlerins
- À l'extrême -sud du Sri Lanka, sept ans après le tsunami qui a fait 7000 morts,Sameera le conducteur de tuk tuk raconte son histoire.
- Evoque lesort précaire des humains sur cette terre.
- Le vieil ermite, et ce lieu édénique où l'homme brille par son absence... (P.336-347)
Consolation des affligés
- Aux portes de l'hospice psychiatrique de Steinhof (cf. Thomas Bernhard), quelques dévots psalmodient.
- - Rappelle le passé, de très sinistre mémoire, du plus grand asile d'aliénés dumonde, qui comptait 4800 lits médicalisés à sa grande époque.
- Et comment les nazis déportèrent ou liquidèrent les individus jugés"indignes de vivre".
Le ténor
- Le Voyageur se retrouve dans un hôtel de Mourmansk, "les yeux braqués sur le chaos blanc".
- Décrit la décrépitude du lieu, aux eaux complètement polluées par ledémantèlement des sous-marins nucléaires, notamment.
- Sur cet arrière-fond apocalyptique, suit une émission de télé consacrée à unconcours de chant.
- Oùs'illustre un ténor anglais amateur, interprète glorieux de Puccini...
Homme sans soleil
- Dans un pub du comté de Cork, desouvriers se racontent l'histoire d'un tailleur de pierre qui a juré de cesserde boire.
- lest d'ailleurs là. L'entrepreneur allemand qui les emploie a juré de le virers'il arrivait une fois de plus en retard.
- Il va donc se préparer au réveil du lendemain, sans se rendre compte du faitqu'il a une nuit d'avance.
- Unehistoire dingue qui rend très bien certain climat de folie arrosée àl'irlandaise...
Ralenti
- Sur la côte pacifique du Costa Rica, un paresseux tombe d'un arbre et s'écrase au pied d'une femme en train de repasser une chemise blanche.
- La femme éclate de rire et le petit chien qu'il y a là montre son vif mécontentement à l'animal griffu, qui se traîne lamentablement au sol, cherchant l'ombre de la forêt...
-
Le chasseur de varan
- À Java Timur, tout un attroupement de gens se fait au lieu d’un accident, autour d’un conducteur de mobylette couché au sol.
- Unefillette hurle et l’on voit un varan ficelé sur le véhicule, lui aussi blessé.
- Puisun homme en pagne soulève la fillette au-dessus du sol, comme le font ensuiteplusieurs spectateurs, et la fillette cesse de hurler et rit comme une folle.
 Avis de tempête.
Avis de tempête.
- Le Voyageur se rappelle avoir vu deux bras gracile d’une femme étendre du linge,tandis qu’un orage s’approchait de Roitham en Haute-Autriche.
- Unorage qui arrache le toit de la plus grande demeure du village, dont le contenu du grenier s’envole et retombe dans la cour.
- Ily a là des drapeaux nazis et un grand portrait d’Adolf Hitler en chevalierteutonique.
- Comme le retour du refoulé…
Une fin du monde
- Dans une flambée apocalyptique s’effondrent la Bank ou China et toute une série d’établissements bancaires, cramant sur la mer de Chine à Hong Kong.
- Ce ne sont évidemment que des maquettes de bois qui flambent sur l’eau.
- Magnifique évocation,une fois de plus, d’une fête populaire local, ici à la gloire du ciel Tin Han,déesse de la mer de Chine orientale.
- Le Voyageur a participé à une rencontre de poètes et écrivains occidentaux et chinois.
- Ce qu’il en tire n’a rien de convenu au demeurant…
Le chien de berger
- On est maintenant en Lycie, dans le Taurus occidental.
- Le Voyageur se rappelle la guerre de Troie.
- Un chien le conduit aulieu d’une coulée de terre, d’où émerge un sarcophage.
- Là encore les vestiges du lointain passésuscitent une ré-actualisation étonnante.
À l’ombre de l’homme-oiseau.
- Retour à l’île dePâques, où le Voyageur chemine jusqu’à la baie d’Anakena.
- Là que ce serait établie la première colonie humaine.
- Il approche d’uneferme où pourrit une charogne de cheval.
- Surgit ensuite untroupeau de bovins hurlant de faim.
- Il va pour les abreuver et rencontre une femme, avant de développer un récit épique relatif àun ancien rite divin.
- Fabuleuse plongée là encore. (p.400-411)
Scènes de chasse
- Où il s’agit, en premier lieu, du jeu cruel d’unchat avec un oiseau.
- Cela se passe au bord du Parana, dans un poste d’essence dont le patron est soupçonné de trafic decoke.
- Les deux histoires, dujeu du chat et de la disparition du trafiquant, se mêlent en contraste.
- Et l’épisode finit parle défilé de colonnes de fourmis à côté de l’oiseau mort.
Le scribe
- Trois hommes et trois femmes se trouvent engagés dans une expédition à travers le Tibet oriental,déclaré zone dangereuse en ces jours précis ; mais ils sont déjà en route.
- Les témoins éventuelsde la répression policière chinoise contre les moines tibétains ne sont pas lesbienvenus ( !)
- Ils vont découvrir desinscriptions, sur des pierres, datant de siècles.
- Puis ils découvrent untrès jeune scribe, dont on comprend que lui aussi écrit depuis des siècles… Transgression
Transgression
- Une jeune nageuse évolue dans une piscine bleue, au milieu d’un jardin nocturne de Bali.
- Cela se passe à Nyepi,lors d’une fête exigeant l’obscurité totale.
- Et là, des nuées depapillons son attirés par la lumière de la piscine…
- Les papillons menacésde noyade se réfugient sur le dos de la jeune fille.
- Il est question despierres du ciel tombées d’un certain volcan.
- Les images se mêlentune fois de plus…
Silence
- Sur la côte est de SriLanka, un troupeau d’éléphants. C’est le soir de Noël.
- Le troupeau n’est que l’avant-garde d’une immense colonne de 200 éléphants sauvages, fuyant la guerrecivile entre forces gouvernementales et tigres tamouls
- Là encore se combinentl’observation d’un premier plan et la situation politique en crise du moment,sans le moindre commentaire au demeurant.
Fillette sous l’orage d’hiver
- Au bord de l’Inn, une fillette de six ou sept ans cherche la main de son frère aîné, mais celui-ci reste distant.
- Il est question d’un père qu’on doit aller chercher à la taverne.
- Le grand frère joues on rôle.
- À un moment donné, la fillette, dans la nuit, fait l’expérience de l’épouvante.
- La trace de la nuit entre danger et lieux de protection prendra, avec le temps, une dimension poétique particulière aux yeux du Voyageur.L’arrivée
- Dans l’ouest de l’Himalaya, à 4000 mètres d’altitudes, le Voyageur voit trois moines quimarmonnent de concert dans une grotte.
- De très jeunes moines.
- Qu’il découvre aprèsdes heures de marche difficile, jusqu’au lac de Phoksundo, près du village de Ringnmo.
- Après un premier arrêtau village, son compagnon le persuade, malgré leur fatigue, de monter jusqu’à àune grotte où ils découvrent les trois jeunes moines.
- Qui leur offrent du thé salé au beurre de yak.
- La nuit tombe au pied des 6000, et, dans unesorte de sérénité, le Voyageur note encore ceci : « Je me sentais à l’abri comme en ces temps révolus où l’on me portait au lit soir après soir : par une fente de la porte qu’on laissait entrouverte à cause de ma peur du noir, jevoyais un rai de lumière et j’entendais chuchoter dans la pièce d’à côté lesadultes qui me protégeaient. Lorsqu’une étincelle sauta de la cendre blanche comme neige et s’éteignit en vol dans l’obscurité froide de la grotte, je m’endormis. À présent j’étais arrivé. ( P.455)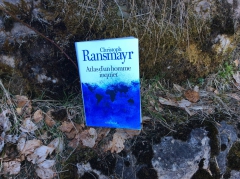 (Première lecture de ce livre sublime achevé au soir du 18 avril 2015, alors que Lady L. volait vers les States)
(Première lecture de ce livre sublime achevé au soir du 18 avril 2015, alors que Lady L. volait vers les States) -
Le temps du dévoilement
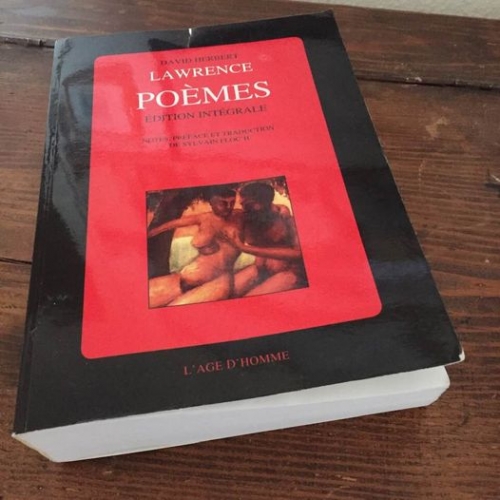 La poésie, encore largement méconnue, de D.H. Lawrence, fait écho à son essai consacré à l'apocalypse, moment de révélation à extirper de son fatras théologique et nous ramenant à ce qui se dévoile sous nos yeux pour peu que nous les tenions ouverts. Et si la naissance d'un dieu restait source de poésie ? C'est aussi la question que posait William James (petit frère du grand Henry) au début du XXe siècle dans son aperçu de l'Expérience religieuse, disponible aujourd'hui via Kindle pour 4 euros. La même question marque en outre la conclusion de La Vie dans l'univers du physicien Freeman Dyson (Gallimard, 2006), type même du savant modeste auquel le poète Jacques Réda s'adresse dans sa Lettre au physicien (Gallimard, 2012), où l'hypothèse d'une poésie ininterrompue se vérifie une fois de plus , telle que la propose le SDF genevois du vers libre Vince Fasciani dans Simplement comme c'est (Éditions des sables, 2020) entre autres allumés du réverbère...
La poésie, encore largement méconnue, de D.H. Lawrence, fait écho à son essai consacré à l'apocalypse, moment de révélation à extirper de son fatras théologique et nous ramenant à ce qui se dévoile sous nos yeux pour peu que nous les tenions ouverts. Et si la naissance d'un dieu restait source de poésie ? C'est aussi la question que posait William James (petit frère du grand Henry) au début du XXe siècle dans son aperçu de l'Expérience religieuse, disponible aujourd'hui via Kindle pour 4 euros. La même question marque en outre la conclusion de La Vie dans l'univers du physicien Freeman Dyson (Gallimard, 2006), type même du savant modeste auquel le poète Jacques Réda s'adresse dans sa Lettre au physicien (Gallimard, 2012), où l'hypothèse d'une poésie ininterrompue se vérifie une fois de plus , telle que la propose le SDF genevois du vers libre Vince Fasciani dans Simplement comme c'est (Éditions des sables, 2020) entre autres allumés du réverbère... -
Fille de l'air
 Elle porte son duffle-coat bleu roi comme un petit nain. Lorsque je me pointe dans le compartiment d’à côté, elle se déplace et vient s'asseoir en face de moi. Je n’ai pas envie de faire attention à elle, mais elle m’y oblige: elle n’a personne ni nulle part où aller. Elle est adorable sans être jolie ni belle. En principe elle allait à Vienne dans la Drôme, mais à la gare où je descends elle descend aussi. Je remarque qu’elle n’a aucun bagage. Ensuite elle me suit partout, jusque chez moi où je lui dis que je n’ai qu’un lit, mais ça lui va. Nous dormons sans nous déshabiller, sans nous caresser, sans dormir peut-être mais dans les bras l'un de l'autre. Le matin je lui dis que j’ai du boulot au journal. Le soir quand je reviens l’oiseau s’est envolé.
Elle porte son duffle-coat bleu roi comme un petit nain. Lorsque je me pointe dans le compartiment d’à côté, elle se déplace et vient s'asseoir en face de moi. Je n’ai pas envie de faire attention à elle, mais elle m’y oblige: elle n’a personne ni nulle part où aller. Elle est adorable sans être jolie ni belle. En principe elle allait à Vienne dans la Drôme, mais à la gare où je descends elle descend aussi. Je remarque qu’elle n’a aucun bagage. Ensuite elle me suit partout, jusque chez moi où je lui dis que je n’ai qu’un lit, mais ça lui va. Nous dormons sans nous déshabiller, sans nous caresser, sans dormir peut-être mais dans les bras l'un de l'autre. Le matin je lui dis que j’ai du boulot au journal. Le soir quand je reviens l’oiseau s’est envolé.Image: Lucian Freud
-
Ceux qui se cherchent
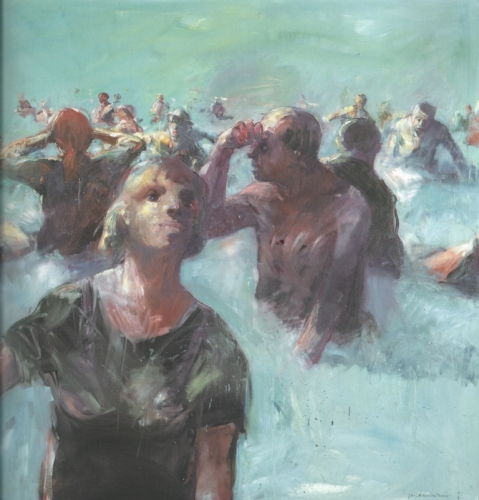
Celui qui se filme en train de se filmer / Celle qui parle à la Nation devant sa webcam / Ceux dont les minutes de silence ont fait des trous dans la Toile / Celui qui a un succès monstre dans son numéro de jodleur en jockstrap / Celle qui poste une séquence de vidéosurveillance de la Banque du Saint-Esprit captant une tentative d’agression au distributeur de dinars / Ceux qui laissent éclater leur créativité tous azimuts / Celui qui performe en toge de procurateur romain à l’époque du roi Hérode et de son gang dans les territoires occupés / Celle qui a mis en lignes diverses approches par zoom de sa fameuse tourte aux carottes / Ceux qui de Youtube ne se disent pas vraiment croyants mais juste pratiquants /

Celui qui ne souffre pas de n’être pas connecté vu qu’il n’est qu’un blaireau dans son terrier avec ses réserves pour l’hiver / Celle qui se dit de la nouvelle Eglise en Réseau / Ceux qui pensent sur Twitter, communiquent par Facebook et se lâchent sur Youtube / Celui qui a scandalisé ses collègues dames du Bureau de Objets Trouvés par la mise en ligne qu’il a faite des images de sacs à main «non réclamés par les pétasses» vu que ce langage est indigne d’un fonctionnaire municipal membre qui plus est du Groupe de Réflexion / Celle qui recycle les premiers clips de la grande époque d’Alice Dona / Ceux qui ne vont plus se perdre dans les bois depuis qu’ils sont connectés /
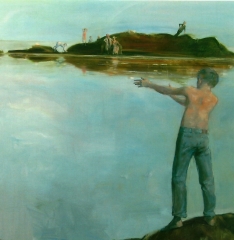
Celui qui ne voit plus personne vu que tout le monde est sur son écran / Celle qui espère être remarquée par un produc tombant sur quelque scène osée qu’elle a filmée dans son living mauve / Ceux qui ont filmé la dernière biture d’Arno le Belge dont ils ont fait un must cartonnant / Celui qui a imaginé une suite à la série Deschiens avec sa famille et les divers animaux / Celle qui entrevoit un nouvel avenir à la prostitution ancillaire / Ceux qui ont bien entendu la mise en garde du télé-philosophe Alain Finkielkraut relative à la poubellisation du concept sur Internet mais n’en pensent pas moins qu’il faut vivre avec son temps comme le disait Kant lors d’une de ses promenades dans la zone proche du Neckar que traverse aujourd’hui la nouvelle Autobahn fierté des Allemands / Celui qui s’est fait connaître pour ses imitations de Ben Laden et du rut du renne canadien / Celle qui surprend Marceline sa chambrière en train de mater des scènes de copulation basse sur Webcamworld dans la chambre du petit / Ceux qui ne se doutent pas de ce qui se passe dans la chambre des jumelles la nuit / Celui qui invite les 66.000 internautes connectés à son adresse Skype de s’agenouiller avec lui et de chanter de concert Il est né le divin enfant – pardon aux Juifs et aux Musulmans mais moi j’assume / Celle qui estime que le cybersexe n’est qu’une fiction de plus avec un peu moins de plaisir et de draps à changer ça c’est sûr / Ceux qui passeront un bon Noël en famille y compris leur million d’amis de Facebook et plus si affinités, etc.
-
Journal des Quatre Vérités, XLIII
 À la Désirade, ce dimanche 12 juillet. – Beauté de la mère et de l’enfant. Simple joie devant cette douce présence. Les voir au jeu, dans la caisse à sable, la mère et les deux bambins, résume à mes yeux ce qu’on appelle « la vie » quand on dit «c’est la vie», même en parlant des enfants malades ou des enfants arrachés prématurément à «la vie»…°°°Je regardais tout à l’heure mes mains de « vieux », qui me semblent à vrai dire moins marquées que les mains de vieux de nos aïeux, dont la vieillesse était à vrai dire plus vieille, si j’ose dire, que la nôtre. Curieusement, la notion de génération, qui paraît tellement importante à nos contemporains, m’est absolument étrangère, me rappelant ma sagesse de « vieux » à 18 ans et ma folle «jeunesse» cinquante ans plus tard avant de passer par 155 séances d’accélérateur linéaire et même après, le crabe repoussé sous roche avec l’anguille de la mort. Les distinctions entre X, Y et Z me semblent des fabrications publicitaires jouant sur la peur de vieillir, renvoyant au provincialisme dans le temps dont parlait T.S. Eliot à propos des nouvelles tribus amnésiques ou des vioques flattant les «djeunes».Tout cela produit d’époque, donc insignifiant à long terme. Ceci dit je pense à mes aïeux avec tendresse en me rappelant leur humble retrait sans beaucoup de mots pour le dire et sans télé pour en faire un drame, sans conseils de psychologues spécialisés et de sociologues les réduisant à des statistiques.Solitude du vieil Émile descendant tous les jours à son jardin, solitude du vieil Heinrich écoutant tous les soirs les nouvelles de Paris ou de Moscou débités sur un ton funèbre par le speaker de l’Agence Télégraphique Suisse, et nos aïeules n’en pensant pas moins mais ouvertes à l’accueil ou pensives dans leur coin, Louise penchée sur sa machine à coudre Singer à invoquer L’Ecclésiaste ou Agatha tricotant pour les missions - toutes deux si bonnes avec nous qui ne pensions jamais à leur âge...CONSEILS À SOI-MÊME. - Tout faire en sorte de couper à toute forme d’aigreur, démon mesquin. L’humeur mauvaise me semble le plus vilain trait de l’époque, à base de ressentiment envieux et de mécontentement vague, de mépris latent et d’inattention fébrile, sans la moindre reconnaissance. Toute rivalité mimétique à éviter, à l’imitation de Bartleby l’Occidental ou même d’Oblomov l’oriental. Je sais comment se faufile le serpent volant, djinn impalpable monté des glandes originelles au cerveau reptilien, mais le savoir ne suffit pas à lui résister sauf à regarder par la fenêtre…
À la Désirade, ce dimanche 12 juillet. – Beauté de la mère et de l’enfant. Simple joie devant cette douce présence. Les voir au jeu, dans la caisse à sable, la mère et les deux bambins, résume à mes yeux ce qu’on appelle « la vie » quand on dit «c’est la vie», même en parlant des enfants malades ou des enfants arrachés prématurément à «la vie»…°°°Je regardais tout à l’heure mes mains de « vieux », qui me semblent à vrai dire moins marquées que les mains de vieux de nos aïeux, dont la vieillesse était à vrai dire plus vieille, si j’ose dire, que la nôtre. Curieusement, la notion de génération, qui paraît tellement importante à nos contemporains, m’est absolument étrangère, me rappelant ma sagesse de « vieux » à 18 ans et ma folle «jeunesse» cinquante ans plus tard avant de passer par 155 séances d’accélérateur linéaire et même après, le crabe repoussé sous roche avec l’anguille de la mort. Les distinctions entre X, Y et Z me semblent des fabrications publicitaires jouant sur la peur de vieillir, renvoyant au provincialisme dans le temps dont parlait T.S. Eliot à propos des nouvelles tribus amnésiques ou des vioques flattant les «djeunes».Tout cela produit d’époque, donc insignifiant à long terme. Ceci dit je pense à mes aïeux avec tendresse en me rappelant leur humble retrait sans beaucoup de mots pour le dire et sans télé pour en faire un drame, sans conseils de psychologues spécialisés et de sociologues les réduisant à des statistiques.Solitude du vieil Émile descendant tous les jours à son jardin, solitude du vieil Heinrich écoutant tous les soirs les nouvelles de Paris ou de Moscou débités sur un ton funèbre par le speaker de l’Agence Télégraphique Suisse, et nos aïeules n’en pensant pas moins mais ouvertes à l’accueil ou pensives dans leur coin, Louise penchée sur sa machine à coudre Singer à invoquer L’Ecclésiaste ou Agatha tricotant pour les missions - toutes deux si bonnes avec nous qui ne pensions jamais à leur âge...CONSEILS À SOI-MÊME. - Tout faire en sorte de couper à toute forme d’aigreur, démon mesquin. L’humeur mauvaise me semble le plus vilain trait de l’époque, à base de ressentiment envieux et de mécontentement vague, de mépris latent et d’inattention fébrile, sans la moindre reconnaissance. Toute rivalité mimétique à éviter, à l’imitation de Bartleby l’Occidental ou même d’Oblomov l’oriental. Je sais comment se faufile le serpent volant, djinn impalpable monté des glandes originelles au cerveau reptilien, mais le savoir ne suffit pas à lui résister sauf à regarder par la fenêtre… Ce jeudi 16 juillet. – La suite de la composition de l’espèce de roman que j’ai intitulé Les Tours d’illusion, avec le chapitre consacré à La question des enfants, m’est venue d’une traite et quasiment en état second de porosité « associative ». Or c’est peu dire que la réflexion de MaxDorra sur le thème des associations libres me parle, puisque je la vis bonnement dans la logique obscure indiquée par l’exergue du livre emprunté au journal de Julien Green : « Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes », étant entendu que ce « n’importe quoi » n’a rien à voir avec une indifférenciation chaotique relevant de l’automatisme, et tout avec le langage premier de «dessous la table ».POUR S’AMUSER. – Quand je dis que je m’amuse en écrivant ou en lisant, je n’enjolive ni n’exagère du tout, ressentant ce jeu comme une vraie discipline, où l’ironie est évidemment de mise, ou plus exactement : l’humour le plus sérieux, la vie étant à mes yeux une farce, et des plus graves.Ce samedi 25 juillet. – Je me dis ces jours que l’enfance en moi me tient lieu d’ange gardien, à la fois sage aux yeux mi-clos et petit sauvage ; et celui-ci je me rappelle la réaction de surprise horrifiée de ma grand-mère et de sa fille (la molle tante H. au mari si dur…) un jour que, le répétant je ne sais d’où, vers mes dix ans, j’ai prononcé le mot de volupté – toutes deux s’entendant comme larronnes de paroisse pour qualifier « ces choses » de cochonneries…DE LA POESIE . -La réflexion sur la nature de la poésie relève -t-elle du débat académique ou, pire, de la délibération idéologique, ou pis encore : du tribunal des spécialistes qu’on appelle, aujourd’hui, sans rire, de poéticiens et des poéticiennes ? Rien de tout cela: ce n’est qu’une affaire d’âmes sensibles et d’amateurs attentifs au sens qui veut que l’amateur soit celui qui aime.Ce vendredi 31 juillet. – L’impression que tout, dans le monde actuel, est sens dessus dessous, sous l’effet de la folle situation de pandémie que nous vivons depuis mars dernier, me donne l’idée d’une collection de lettres de refus que tel auteur adresserait aux multiples éditeurs lui proposant de publier son dernier présumé chef-d’œuvre : « Madame, Monsieur, ayant pris connaissance de votre proposition de publier mon incomparable dernier roman, je suis au regret de décliner votre offre au motif que votre ligne éditoriale, autant que votre éthique et les accointances idéologiques de vos collaborateurs et collaboratrices, diffuseurs et libraires affilés, ne correspondent pas vraiment à mes principes écologiques voire animalitaires», etc.
Ce jeudi 16 juillet. – La suite de la composition de l’espèce de roman que j’ai intitulé Les Tours d’illusion, avec le chapitre consacré à La question des enfants, m’est venue d’une traite et quasiment en état second de porosité « associative ». Or c’est peu dire que la réflexion de MaxDorra sur le thème des associations libres me parle, puisque je la vis bonnement dans la logique obscure indiquée par l’exergue du livre emprunté au journal de Julien Green : « Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes », étant entendu que ce « n’importe quoi » n’a rien à voir avec une indifférenciation chaotique relevant de l’automatisme, et tout avec le langage premier de «dessous la table ».POUR S’AMUSER. – Quand je dis que je m’amuse en écrivant ou en lisant, je n’enjolive ni n’exagère du tout, ressentant ce jeu comme une vraie discipline, où l’ironie est évidemment de mise, ou plus exactement : l’humour le plus sérieux, la vie étant à mes yeux une farce, et des plus graves.Ce samedi 25 juillet. – Je me dis ces jours que l’enfance en moi me tient lieu d’ange gardien, à la fois sage aux yeux mi-clos et petit sauvage ; et celui-ci je me rappelle la réaction de surprise horrifiée de ma grand-mère et de sa fille (la molle tante H. au mari si dur…) un jour que, le répétant je ne sais d’où, vers mes dix ans, j’ai prononcé le mot de volupté – toutes deux s’entendant comme larronnes de paroisse pour qualifier « ces choses » de cochonneries…DE LA POESIE . -La réflexion sur la nature de la poésie relève -t-elle du débat académique ou, pire, de la délibération idéologique, ou pis encore : du tribunal des spécialistes qu’on appelle, aujourd’hui, sans rire, de poéticiens et des poéticiennes ? Rien de tout cela: ce n’est qu’une affaire d’âmes sensibles et d’amateurs attentifs au sens qui veut que l’amateur soit celui qui aime.Ce vendredi 31 juillet. – L’impression que tout, dans le monde actuel, est sens dessus dessous, sous l’effet de la folle situation de pandémie que nous vivons depuis mars dernier, me donne l’idée d’une collection de lettres de refus que tel auteur adresserait aux multiples éditeurs lui proposant de publier son dernier présumé chef-d’œuvre : « Madame, Monsieur, ayant pris connaissance de votre proposition de publier mon incomparable dernier roman, je suis au regret de décliner votre offre au motif que votre ligne éditoriale, autant que votre éthique et les accointances idéologiques de vos collaborateurs et collaboratrices, diffuseurs et libraires affilés, ne correspondent pas vraiment à mes principes écologiques voire animalitaires», etc. -
Les anges exilés de Thomas Wolfe
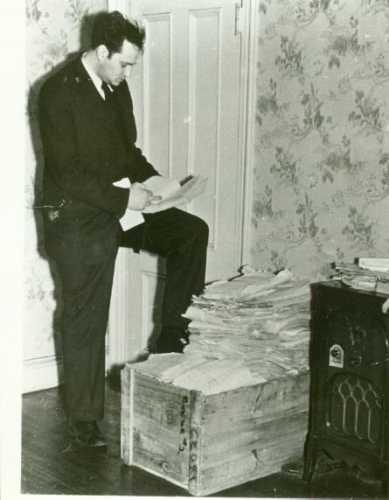 Thomas Wolfe, terrassé le 15 septenbre 1938 par la tuberculose cérébrale, aurait eu 120 ans cet automne... Le géant de la littérature américaine reste assez méconnu en dépit d'une oeuvre monuentale.
Thomas Wolfe, terrassé le 15 septenbre 1938 par la tuberculose cérébrale, aurait eu 120 ans cet automne... Le géant de la littérature américaine reste assez méconnu en dépit d'une oeuvre monuentale.Pour ceux qui ont accompli, déjà, la grande traversée des quelque six cents pages de L’Ange exilé, inaugurant en 1982 la réédition des œuvres de l’écrivain dans la première traduction française qu’on puisse dire recevable, la seule mention du nom de Thomas Wolfe (à ne pas confondre évidemment avec Tom Wolfe !) est évocatrice d’une légende fabuleuse et, pour ce qui concerne les œuvre, de grands espaces romanesques peuplés de personnages inoubliables.
Thomas Wolfe incarne la tentative inégalée de restituer, dans un maelström de mots et d’images, l’inépuisable profusion du vivant. Tout dire ! Folle ambition de l’adolescence transportée par sa passion généreuse…
Or il y a de l’éternel adolescent chez ce grand diable d’à peu près deux mètres, né avec le siècle et fauché par la sale mort à l’âge de 38 ans, après qu’il eut arraché des millions de mots de ses entrailles, constituant la matière de quatre immenses romans, de nombreuses nouvelles et de pièces de théâtre, notamment. Là-dessus, à ses élans juvéniles à jamais inassouvis, Thomas Wolfe alliait des dons d’observation tout à fait hors du commun et une profonde expérience du cœur humain, ayant vécu précocement toutes les contradictions et les souffrances de l’individu accompli.

Il y a la légende de Thomas Wolfe. Celle du jeune provincial d’Asheville (Caroline du Nord) quittant l’univers confiné de sa ville natale pour débarquer dans la galaxie fascinante de New York, décrite avec un lyrisme sans égal. La légende de l’écrivain solitaire travaillant debout à longueur de nuit dans de gros registres posés sur un réfrigérateur, faute de bureau à sa taille, tout en se cravachant à la caféine. Et celle du forcené des errances nocturnes dans la ville immense, dont nous retrouvons des échos bouleversants dans les nouvelles de De la mort au matin. Ou celle, aussi, de sa rencontre providentielle avec l’éditeur Maxwell Perkins, qui eut le double mérite de parier pour son génie et de l’aider à transformer ses manuscrits torrentiels et désordonnés en ouvrages publiables.
Mais l’essentiel de la légende de Thomas Wolfe, c’est évidemment dans son œuvre que nous le découvrons, transposée et magnifiée sous la forme d’une autobiographie incessamment recommencée. Est-ce à dire que l’écrivain s’est borné à se scruter le nombril et à raconter sa vie ? Tout au contraire : car nul n’est plus ouvert à toutes les palpitations du monde que ce « récepteur » ultrasensible, lors même que les faits et toute la geste humaine se parent, sous sa plume, d’une aura mythique.
À la mythologie, Le temps et le fleuve emprunte les titres des huit sections qui le composent, sans pour autant que les noms cités d’Oreste, de Faust, de Télémaque ou d’Antée, notamment, correspondent très strictement au récit et à ses péripéties. Plutôt, il s’agit d’indications poétiques qui signalent peut-être, en outre, l’influence de Joyce sur l’auteur. Avec celui-là, comme le précise Camille Laurent, traducteur, Thomas Wolfe partage la conviction que « ce qui est fascinant, c’est le quotidien, et l’extraordinaire, ce qu’on a sous les yeux ».
Ce qui tisse ainsi les huit cents pages du deuxième livre de l’écrivain américain, qu’on pourrait dire une autofiction épique, c’est l’expérience quotidienne qui fut la sienne entre 1920 et 1925, ponctuée par son arrivée à Harvard, la rencontre déterminante d’Aline Bernstein et un voyage en Europe.
Cela précisé, l’autobiographie se fait poème et roman dès les premières pages du livre, avec la scène des adieux du protagoniste à sa mère, et la prodigieuse évocation de son voyage en train.
Eugène Gant, double romanesque de Thomas Wolfe, et qui était déjà le héros de L’Ange exilé, quitte donc Altamont (Asheville en réalité) pour Harvard, non sans faire étape auprès de son père en train de mourir du cancer. Or, tout le livre sera marqué, conjointement, par le thème joycien de la quête du père et par la recherche d’une identité personnelle et nationale à la fois – car ce voyage au bout de soi-même, à travers les circonstances de la vie, les passions et les vices, les émerveillements et les désillusions, engage de surcroît la destinée de tout un peuple.
Qui sommes-nous, Américains ? se demande aussi bien Thomas Wolfe. Et la question ressaisira toute l’énergie de l’écrivain, persuadé de cela que l’œuvre à faire participe d’une aventure propre au Nouveau-Monde.
Peu connu des lecteurs de langue française, et d’abord parce qu’il fut exécrablement traduit, Thomas Wolfe demeure également, aux Etats-Unis, le grand oublié de la littérature contemporaine. Evoquez son nom dans les universités ou les milieux intellectuels américains et vous verrez quelle petite moue supérieure on opposera à votre enthousiasme.
C’est qu’il est assurément problématique, pour ceux qui accoutument de disséquer les textes, de se faire à ce titan romantique et fort indiscipliné dans ses constructions, dont les élans ne vont pas toujours sans emphase ou répétitions. Au demeurant, seul l’aveuglément ou la méconnaissance peuvent expliquer le terme de « logorrhée » dont on a parfois taxé son style, d’une fermeté et d’un éclat où nous voyons surtout, pour notre part, l’expression de la meilleure vitalité, au temps où le rêve américain faisait encore rêver…
Editions L’Age d’Homme, Le temps et le fleuve, 582p. L'Ange exilé a été réédité, également à L'Age d'Homme, où l'intégralité de l'oeuvre devrait paraître.
-
Sebald à sa source
Une suite poétique en triptyque fondateur
On croyait avoir tout lu de W.G. Sebald, disparu prématurément en 2001, à l’âge de 57 ans, enfin disons l’essentiel, à savoir Les émigrants, Les anneaux de Saturne, Vertiges et Austerlitz, et de fait, en dépit de leurs grandes qualités respectives, l’essai intitulé De la destruction, traitant du châtiment infligé aux Allemands par le feu du ciel des Alliés, et la suite de digressions critiques réunies dans Séjours à la campagne, relevaient un peu des marges de l’œuvre, mais qui aurait pu s’attendre, à part les germanophones avertis, à ce qui nous arrive aujourd’hui en traduction par la grâce de Sibylle Muller et Patrick Charbonneau ?
Or ce livre est LA première source de l’oeuvre et LE premier grand arpentage du monde et du temps de W.G. Sebald, comment dire ? C’est à la fois un paysage à multiples replis et déplis et la traversée de trois vies qui s’y logent et y bougent (la vie du peintre Grünewald, la vie du naturaliste voyageur Georg Wilhelm Steller, et la vie de W.G. Sebald lui-même), et c’est autre chose encore flottant entre les deux infinis de Pascal, plaçant le lecteur dans la position du personnage tout pensif d’un tableau fameux de Caspar David Friedrich.
Il y a beaucoup de très fine peinture, à la fois naïve et savante comme les maîtres anciens savaient la faire sous de doux glacis, et beaucoup de romantisme aussi, paradoxalement, dans ce livre dont la tristesse irradie une lumière que connaissent les lecteurs de Sebald, mais ici à un état de concentration rare.
La poésie de Sebald est narrative, et ce sont trois récits qui se donnent ici en triptyque sous trois titres qui chantent aussi bien. Comme la neige sur les Alpes est celui de la somnambule pérégrination à genoux ou à cheval de Grünewald, dont il est question ici comme chez aucun historien de l’art…Et que j’aille tout au bout de la mer nous emmène au bout de la terre en compagnie d’un luthérien allemand sans dieu, la bouche asséchée par le sel des planètes ; enfin la sombre merveille intitulé La nuit fait voile nous plonge au cœur des ténèbres de l’Allemagne où fut conçu W.G. au moment où Dresde s’effondrait sous le tonnerre des Justes…
Cela n’a rien à voir mais j’ai retrouvé, en lisant D’après nature, le mélange de sapience et de saveur, de miel et d’épices, de pollen et de tabac, de silence et de bruit du temps que j’ai goûté en découvrant un jour Le sceau égyptien de Mandelstam, par exemple. Surtout, je me suis retrouvé, sans les documents photographiques, dont on n’a pas besoin ici tant le texte est déjà saturé d’images, dans l’univers à la fois enveloppant et perdu de Sebald. Ce ne sont ici que de premières notes. Je vais parler et reparler de ce livre d’une sombre beauté et d’une lancinante musique pensée…
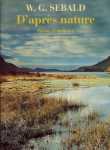 W.G. Sebald. D’après nature. Poème élémentaire. Traduit de l’allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau. Portrait de W.G. Sebald: Horst Tappe.
W.G. Sebald. D’après nature. Poème élémentaire. Traduit de l’allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau. Portrait de W.G. Sebald: Horst Tappe.