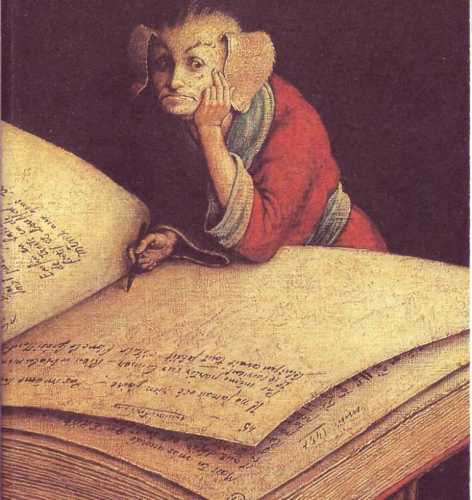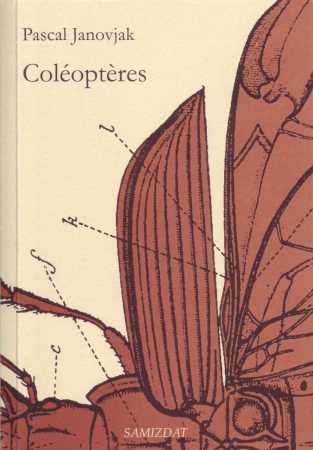COUP DOUBLE Un nouveau recueil et un Plan-Fixe éclairant.
L’œuvre sereine et lumineuse de Pierre-Alain Tâche, poète lausannois qui fut magistrat judiciaire et reste très présent dans la vie culturelle lausannoise, s’enrichit aujourd’hui, conjointement, d’un trente-sixième ouvrage et d’un plan-fixe, en dialogue avec notre confrère Charles Sigel.
« La clairière où l’enfant a compris / qu’il est des choses infinies /demeure un lieu vaste et sacré », écrit le poète dans Forêt jurée, son dernier recueil orné de beaux pastels de Martine Clerc, son épouse. Or c’est dans une même «clairière» que se déroule, en un peu moins d’une heure, la conversation enregistrée le 12 septembre 2008, où Pierre-Alain Tâche, souriant et tranquille, mais aussi aigu et dense par son verbe, évoque d’abord sa trajectoire de rejeton de gens ordinaires (grand-père paysan, père dans le commerce pharmaceutique, peu de livres à la maison), snobé au collège pour ses culottes courtes mais repéré dès le gymnase, par André Guex, pour ses dons littéraires, vite concrétisés dans un premier recueil, Greffes, paru à sa vingt-deuxième année, en 1962. Choisissant le Droit « par défaut », avocat puis magistrat judiciaire (juge cantonal de 1981 à 2002), Pierre-Alain Tâche aura donc vécu ce «grand écart» entre les dossiers de la justice et le royaume de la poésie, à la fois plus intérieur et grand ouvert sur les jardins du monde.
Tôt convaincu, notamment par Jacques Chessex, que la poésie doit engager toute la personne, le poète a vécu celle-ci comme un chemin à parcourir, en constante évolution. Du vers irrégulier mais ciselé, parfois même précieux, de ses débuts, à une poésie de plus en plus naturelle et libre, en apparence (en réalité bien composée et tenue), l’œuvre est marquée par les deux instances du Lieu (référence à L’Arrière-pays d’Yves Bonnefoy, plus encore qu’à Roud ou Jaccottet, autres proches) et de l’Instant, moment-clef de l’expérience sensible, entre fuite du temps et éternité.
Petit regret : qu’aucun livre n’apparaisse en cours de conversation, juste cités au passage. Mais le dialogue renvoie, pour l’essentiel, à la « Vallée offerte comme un livre ! » du dernier recueil réitérant la « confiance en la vie qui va »…
Pierre-Alain Tâche. Forêt jurée. Pastels de Martine Clerc. Empreintes,87p.
Pierre-Alain Tâche, poète et magistrat. Plans-Fixes 1239. Première projection le 26 février, à 18h.30, à la Cinémathèque suisse, Casino de Montenon, Lausanne.
littérature - Page 21
-
Pierre-Alain Tâche en chemin
-
Jacques Chessex en fait trop…


En 1942, un sordide assassinat à caractère antisémite fut commis, dans une écurie du paisible bourg vaudois de Payerne, par un groupe de pauvres types entraînés par deux ou trois fanatiques hitlériens, dont un certain pasteur Lugrin. Arthur Bloch, marchand de bestiaux juif établi à Berne mais venu à la foire de Payerne ce jour-là, fut attiré dans un guet-apens et massacré sur place avant d'être découpé en morceaux, ses restes bientôt engloutis dans le proche lac de Neuchâtel. Ainsi les émules locaux du Führer prétendaient-ils lui faire plaisir à la veille de son anniversaire. Sûrs de leur fait, ils s'y prirent si grossièrement que tous (sauf le sinistre pasteur) furent promptement arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Or, ayant passé sa prime enfance en ces lieux, Jacques Chessex a été marqué par ce crime affreux. Après l'avoir déjà évoqué dans certaines proses, il y revient dans Un juif pour l'exemple, récit d'une centaine de pages qui s'est arraché en Suisse romande: après un mois, l'ouvrage s'est déjà vendu à plus de 30.000 exemplaires. Si la qualité du livre n'est pas en cause, le marketing déployé par l'écrivain laisse songeur. Etablissant des parallèles douteux entre le destin de son père (lui-même écrivain et notable impliqué dans une affaire de moeurs, qui s'est suicidé) et celui du pauvre Juif Arthur Bloch, bouchoyé de la plus odieuse façon, Chessex en arrive aujourd'hui à prétendre que le crime de Payerne préfigure Auschwitz. Et de gesticuler pour que la Municipalité, 70 ans après les faits, débaptise sa place principale pour la consacrer à la mémoire de Bloch. Et de faire l'impasse sur ceux qui, antérieurement, ont documenté cette affaire aux riches implications sociales et morales, affirmant dans 24 Heures qu'il détient la "paternité" du crime de Payerne. C'est donc dans les colonnes du même quotidien que je me suis permis cette amicale mise en garde...
Jacques Chessex a signé, avec Un juif pour l’exemple, un livre qui fera date au double titre de la littérature et du témoignage « pour mémoire ». Lorsque l’écrivain nous a annoncé, en décembre dernier, le sujet de ce nouveau roman, nous avons un peu craint la «resucée» d’un drame déjà évoqué sous sa plume, notamment dans Reste avec nous, paru en 1965, et c’est donc avec une certaine réserve que nous avons abordé sa lecture, pour l’achever d’une traite avec autant d’émotion que d’admiration. La terrible affaire Bloch pourrait certes faire l’objet d’un grand roman plus nourri que ce récit elliptique, mais le verbe de Chessex, son art de l’évocation, sa façon de réduire le drame à l’essentiel, touchent au cœur.
Cela étant, avec tout le respect que mérite l’écrivain, et même à cause de l’estime que nous portons à son œuvre, comment ne pas réagir à certaines postures que nous lui avons vu prendre ces jours au fil de ses menées promotionnelles, et notamment en s’arrogeant la « paternité » du crime de Payerne (lire notre édition du 18 février), traitant avec dédain le travail documentaire qui aboutit à un film référentiel de la série de grands reportages de Temps présent, en 1977, réalisée par Yvan Dalain et Jacques Pilet, et au livre de celui-ci sous-intitulé (sic) Un juif pour l’exemple ?
Que Jacques Chessex ne mentionne par cette double source dans son roman n’est pas choquant à nos yeux. Un grand sujet n’appartient pas à tel ou tel, surtout dans un travail de mémoire. Cependant, affirmant lui-même qu’il était «sur le coup» avant Dalain et Pilet, Jacques Chessex pourrait faire croire qu’ Un Juif pour l’exemple n’est qu’un «coup» et qu’il s’agit d’occulter tout concurrent. Or son livre vaut mieux que ça!
Une scène saisissante, dans Un Juif pour l’exemple, évoque le triple aller et retour d’Arthur Bloch, attiré dans une écurie par ses assassins, qui hésite avant de conclure le marché fatal. Nous imaginions cet épisode inventé par l’écrivain, or c’est du film de Dalain et Pilet qu’il est tiré. Il va de soi que ce détail n’entache en rien le mérite de Chessex, mais que perdrait celui-ci à saluer le travail d’autrui ? À cet égard, la posture de Chessex nous a rappelé celle du cancérologue médiatique Léon Schwartzenberg qui, un soir, après une émission de télévision à laquelle participait un jeune romancier médecin de notre connaissance, lui téléphona pour lui dire : cher confrère, le cancer à la télévision, c’est moi !
Dans le même élan écrabouilleur, Jacques Chessex s’est répandu récemment, dans l’émission radiophonique Le Grand Huit, en propos consternants sur l’état de la littérature romande actuelle, concluant à son seul mérite exclusif et à l’inexistence d’aucune relève. Ainsi, le même écrivain qui prétend défendre la mémoire collective, piétine ceux qui, à leur façon, contribuent à la culture commune. Plus rien ne se fait après nous: telle est d'ailleurs la chanson triste des grands créateurs de ce pays virant aux caciques, de Tanner et Godard à Chessex. Or nous osons le dire à celui-ci : cette posture est indigne de toi, frère Jacques : ton œuvre vaut mieux que ça !Cette chronique a paru dans l’édition de 24Heures du vendredi 20 février 2009.
-
Le Valais de coeur d'Alain Bagnoud
ENTRETIEN L’écrivain quasi quinqua revient avec Le Jour du dragon, très vivante évocation autobiographique de la bascule des «seventies», à Chermignon.
Alain Bagnoud, issu d’une tribu valaisanne comme les a peintes Maurice Chappaz dans son Portrait des Valaisans, a connu de l’intérieur cette société que le sociologue Uli Windisch étudia, à Chermignon, dans un essai au titre significatif, Lutte de clans, lutte de classes. C’est là que Bagnoud est né, en 1959, et que se déroulait déjà La Leçon de choses en un jour, parue en 2006, épatante chronique d’un adieu à l’enfance. Avec Le Jour du dragon, l’initiation sociale de l’adolescent se prolonge entre fanfare, messe et potes, débats politiques et surboum, premier baiser et premier joint…
- Qu’est-ce quoi vous a poussé à cette double entreprise autobiographique ?
- C’est l’âge... La maturité m'a fait m'interroger sur mon passé et a donné un autre sens aux questions qu'on se pose tous, il me semble: Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il y a en moi de semblable aux autres? De différent? Qu'est-ce qui me relie aux hommes et qu'est-ce qui me sépare d'eux? L'autobiographie, ça permet de chercher assez directement des réponses à ça. De confronter celui qu'on croit avoir été avec les circonstances, de se demander en quoi elles nous ont formés et en quoi on a pu échapper aux déterminismes. De voir ce qui est commun en nous à toutes les périodes. Donc de rechercher qui on est.
- Est-ce que c'est un moyen d'atteindre une vérité ?
- De la reconstituer pléutôt. Ou alors de la constituer. On se recrée par la mémoire, on se réécrit un destin ou une existence par la forme qu'on lui donne en l'utilisant comme matériel d'écriture, en la modifiant forcément. On se resaisit de soi-même, c'est comme si on se refaisait, si on s'appropriait. De nouveau. Et puis il y a la question de la vocation.
- La question de savoir pourquoi l'on devient écrivain?
- Oui. Cette envie est peut-être assez fréquente, mais enfin, ça me stupéfie toujours que certains y arrivent. Parce que c'est difficile, vous le savez, il y a beaucoup plus d'appelés que d'élus. C'est un appel, mais aussi un travail, et il y a une position à prendre par rapport à soi-même et un rapport avec la langue à trouver. Ce n'est jamais donné. Il y a une maturation à faire. J'aimerais comprendre comment j'ai cherché ma voie dans le langage.
- En quoi la communauté que vous décrivez a-t-elle changé depuis les années que vous évoquez ?
- Les différences sont énormes. Moi, je suis né dans un petit village de 170 habitants où tout le monde connaissait les grands-parents, les arrières-grands-parents de chacun. On était tous plus ou moins cousins, au deuxième, troisième degré. Cette homogénéité a disparu. Beaucoup de filles et de fils sont partis, et des inconnus ont acheté des maisons. La communauté est très amincie. Avec cet amincissement, il y a toute une idéologie, des normes, des obligations qui se sont évaporées. Et puis il y a eu une transformation historique. Mes grands-parents étaient nés presque encore au Moyen Age: ils soignaient des terres pour d'autres, avaient peu d'outils, pas d'argent, ne connaissaient rien de l'extérieur...
- Quelles ont été les difficultés techniques que vous avez rencontrées pour ces deux récits ?
- La composition d'abord. Il fallait s'arranger pour que ça ne soit pas un simple recueil de souvenirs disparates. C'est pour ça que j'ai donné à chaque livre le cadre d'une journée, en tâchant de donner une direction, de hiérarchiser le texte pour que ça avance dans une direction précise. Et puis, autre difficulté: le langage. La nature même de ce qui était évoqué, ce monde villageois, je ne voulais pas en donner une image savante ou méprisante ou extérieure. Ça m'a incité à simplifier, à adopter un ton neutre, souvent oral, un peu amusé parfois. En tout cas pas savant ou exagérément littéraire.
- Entendez-vous développer plus avant ce « tableau » de votre pays ?
- Oui. Le projet initial, c'était un cycle de sept livres qui se passaient tous les sept ans. Bon, ça ne va pas se faire, en tout cas pas sous cette forme. Parce que si les âges de sept, quatorze et vingt-et-un ans tombent bien pour représenter l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, ça se gâte après. Pour l'instant, je travaille au troisième volet. Le passage à la grande ville et à l'université. Après, on verra.
- Comment votre entourage (et le Valais) a –t-il reçu ces deux ouvrages ?
- Étonnamment bien. J'avais un peu d'appréhension, même si j'avais fait lire les textes à ma famille. Il y a quand même des attaques franches contre un système local pas très transparent et des personnages qui pourraient se reconnaître. Mais les gens ont apprécié. Par nostalgie en partie, peut-être, mais aussi parce que nous partageons le même humour, et qu'il fait passer bien des choses.
- Quel est, pour vous personnellement, l’héritage de Maurice Chappaz, et quels autres auteurs vous tiennent-ils lieu de « guides » éventuels ?
- Chappaz, quand j'étais adolescent, c'était le maître, l'exemple à suivre. Cette langue dense, forte, solaire. Cette présence dans le canton. Ce mélange de thèmes locaux et universel. Il montrait qu'on pouvait parler d'un lieu sans verser dans le régionalisme ou la complaisance. Sinon, il y a des écrivains que je relis constamment. Ramuz, Céline, Stendhal. Proust surtout.
- Qu’avez-vous à cœur de transmettre ?
- Peut-être qu'il faut refuser de parler les langages convenus qu'on essaie de nous imposer. Tout conspire à nous emprisonner, à nous rapetisser. Langage de la pub, celui des entreprises, celui des idéologies, celui des groupes, des communautés. Il faut voir plus loin, notamment dans les livres. En les fréquentant, il me semble que chacun peut trouver sa propre langue, dans laquelle il peut se réaliser, qui peut lui permettre de dire ce qu'il a de personnel, de singulier. Et je ne parle pas ici seulement pour ceux qui veulent écrire, mais pour tout le monde…
Un dragon à pattes d’éléphant
Après la chronique quasiment « exotique » de La Leçon de choses en un jour, évoquant une enfance villageoise de la fin des années 60, Alain Bagnoud aborde, avec Le jour du dragon, correspondant aux festivités initiatiques de la Saint-Georges, une matière personnelle et collective beaucoup plus délicate à traiter : une adolescence en province, d’une musique à l’autre : entre trompette de fanfare et guitare électrique. Dire la mutation de toute une société à travers la mue d’un ado touchant à l’âge d’homme, et le dire en restituant à la fois le langage de la tribu et les nouvelles façon de parler correspondant au vent nouveau soufflant d’Amérique, n’est pas une sinécure pour qui veut échapper à la fois aux clichés et au documentaire sociologique. Le tout est de trouver la bonne distance et le ton juste, à quoi parvient Alain Bagnoud avec une sorte de générosité souriante, mais jamais sucrée, de malice et d’honnêteté, autant que de netteté dans la peinture. Slalomer, en un jour, entre fanfare du clan doré (qui fait la pige aux argentés, ces nuls…) et copains à récentes collections de 33tours, paternel excité par sa première voiture et tonton bâtisseur, pudeurs de puceau et mécaniques roulées à l’instar des plus délurés, fidélité familiale et tentation de rejoindre la boum ou l’atelier de tel artiste bohème – tout cela ne va pas de soi dans un récit suivi. Or Alain Bagnoud, jouant à merveille de l’alternance des temps et des points de vue, y parvient avec autant de naturel que d’ironique et tendre empathie.
 Alain Bagnoud. Le Jour du dragon. L’Aire, 264p.
Alain Bagnoud. Le Jour du dragon. L’Aire, 264p.
Portrait d'Alain Bagnoud: Pascal Frautschi. -
Deux regards vivifiants
En mémoire de Thierry Vernet et de Floristella Stephani. Hommages à Genève.5 avril: dernier jour de l'exposition double au Manoir de Cologny. A voir absolument !
De janvier à juin 2009, les œuvres des peintres Thierry Vernet (1927-1993) et Floristella Stephani (1930-2007) seront exposées en divers lieux genevois. A l’initiative d’Ilona Stephani et de quelques amis, ce substantiel hommage rend justice à la mémoire de deux créateurs plutôt méconnus de leur vivant, hors de quelques cercles romands et parisiens. Cette généreuse initiative déclinera quatre verbes liés à leur double démarche existentielle et artistique :
PEINDRE : Tous deux avaient l’intime conviction d’être « nés peintres ». A l’écart des modes, dans leur petit logement de Belleville, à Paris, ils ont exploré toutes les ressources de leur art: dessin, gravure, aquarelle, huile, décors de théâtre ou de marionnettes.
VOIR : Floristella Stephani et Thierry Vernet, ouverts au monde à l’enseigne de la même soif spirituelle, vivaient cette relation par le truchement d’un même regard poreux et englobant, libre, essentiel et incarné, aboutissant à une expression communicable. Leurs œuvres participent de deux visions originales et bien distinctes, que relie cependant un même sentiment poétique.
VIVRE : Il leur a fallu composer avec les difficultés quotidiennes d’une vie entièrement dévolue à l’art, sans cesser des rester ouverts au monde, aux autres, aux livres et au voyage. Leurs travaux alimentaires (décors pour Thierry, restauration de toiles anciennes pour Floristella) a nourri leurs œuvres respectives.
S’EXILER : Le déplacement leur a paru correspondre à la recherche de soi et d’un lieu ouvert à la création. Issus tous deux de bonnes familles genevoises, ils se sont installés à Paris en 1958. L’hommage entend répondre à la question du départ et de la recherche d’un lieu favorable à la création.
AU PROGRAMME :
PINACOTHÈQUE DES EAUX-VIVES. Du mercredi 14 janvier au dimanche 15 février 2OO9
www.pinacotheque.ch - 7, rue Montchoisy - 1207 Genève - Arcade au chemin Neuf Tél. + 41 22 735 66 75
Mercredi et vendredi de 16h à 19h - Jeudi de 16h à 20h - Samedi de 11h à 18h
De l'usage du dessin à «l'Usage du Monde»
En constante observation des êtres et paysages rencontrés, Thierry Vernet s’est toujours senti «en voyage». Le récit de cette
aventure donnera à la fois «L‘Usage du Monde», livre écrit par Nicolas Bouvier et illustré par Thierry Vernet et «Peindre,
écrire, chemin faisant», lettres de Thierry Vernet à sa famille. Belgrade, Kaboul, Tabriz, Téhéran et jusqu’à Colombo, partout
Thierry dessine, s’émerveille, apprend, travaille, prépare des expositions qui contribuent financièrement à les pousser plus
loin. La Pinacothèque offre la possibilité exceptionnelle de voir pour la toute première fois les impressions des dessins à partir
des plaques typographiques originales.
- Nicolas Bouvier «L’Usage du Monde», dessins de Thierry Vernet, Payot 1992
- Thierry Vernet «Peindre, écrire, chemin faisant» L’Age d’Homme, Genève 2006
Vernissage le mercredi 14 janv. à 18h en présence de Mme Eliane Bouvier.
Brunch de clôture à la pinacothèque: dimanche 15 février 2009 dès 11h
LES CINÉMAS SCALA. Dimanche 15 février 2OO9, 19h
www.les-scala.ch - Rue des Eaux Vives, 23 - 1207 Genève - Tél. + 41 22 736 04 22
Le film ”22 Hospital Street”
Après deux années de voyage, au début des années 1950, de Genève au sud de l’Inde, Nicolas Bouvier arrive aux portes d’une
île ensorcelée : Ceylan. Il y rejoint son compagnon de voyage, le peintre Thierry Vernet et sa femme, Floristella. Ceux-ci
retournent au pays et le laissent seul dans la petite ville côtière de Galle. Bouvier y sombrera dans une zone de silence, peuplée
d’insectes et de magie noire, Le récit de cette déréliction sera un livre «surécrit», d’une prose splendide et malicieuse:
«Le Poisson-Scorpion». Un film, réalisé par Christoph Kühn, nous en retrace les prémices et l’histoire.
(Bernard De Backer, La Revue nouvelle, décembre 2006). Séances en présence de M. Christoph Kühn, cinéaste, réalisateur indépendant qui crée son propre bureau de production,«Titanicfilm » et de Mme Eliane Bouvier, compagne de Nicolas Bouvier, elle poursuit son oeuvre en la mettant
généreusement à disposition de jeunes talents ou de nouveaux projets. Consciente de rester l'ultime mémoire de ce quatuor
d'amis, elle nous en conte l'histoire.BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-VIVES.Du mercredi 28 janvier au jeudi 3O avril 2OO9
www.ville-ge.ch/bmu - Rue Sillem, 2 - 1207 Genève - Tél. + 41 22 786 93 00
Mardi, jeudi vendredi 15h -19h - mercredi 10h-12h, 14h-18h - samedi 13h30-17h
Peindre pour voir le monde
ou «la raison du tableau est toujours la meilleure» Th.V.
L'exposition, réalisée par Francis Renevey (l'Atelier Nomade), retrace le parcours de Floristella Stephani et Thierry Vernet au gré
de leurs peintures, écrits, notes, rencontres et voyages. Elle propose une réflexion sur le métier de peintre avec ses joies et ses
exigences. Cette exigence vis-à-vis de soi et des autres transparaît dans leurs oeuvres, souvent contemplatives,véhiculant à la fois
la sérénité et l’effroi du monde.
Vernissage le mercredi 28 janvier 2009, dès 18h.LA COMÉDIE DE GENÈVE. Du 5 au 21 février 2OO9.
www.comedie.ch - Bd des Philosophes, 6 - 1205 Genève - Tél. + 41 22 320 50 01
Du mardi au vendredi 10h30 à 18h30 - Samedi 13 février 15h à 18h - et les soirs de spectacles
Peindre le vrai et le faux
De 1949 à 1990 Thierry Vernet a conçu les décors de théâtre à la Comédie Française, à la Comédie, au Grand Théâtre et à l'Opéra
de Chambre de Genève. De ces décors que reste-t-il, peu, car le spectacle fini, les décors sont brûlés. C'est donc à travers un jeu
de croquis, de maquettes, d'aquarelles ou d'accessoires que nous glanerons les éléments qui nous ont fait rêver. Ils démontrent
l'habileté d'un peintre habitué à se consacrer à la recherche du vrai mais qui se joue ici du trompe-l’oeil et de l'éphémère.
Vernissage le jeudi 5 février 2009 à 18h, spectacle de marionnettes d’Alain et Blaise Recoing à 19h, entrée libre.
Punch et Judy: spectacle de marionnettes
Alain Recoing fut à l'origine du deuxième voyage, en Orient, de Thierry Vernet. Ensemble ils ont participé à un échange de
créations entre marionnettistes indonésiens et parisiens. Cette unique représentation de «Punch et Judy» revisite, avec des
marionnettes à gaines, ce canevas conçu dans la plus pure tradition anglaise. «Tout, ici, est soi-même et autre chose, d'où la
distance marionnettique, ce détachement, ce faire-semblant-de-telle-façon-que-ça-se-voit qui confère à cet art son étonnant
pouvoir poétique.» Th.V Un beau moment permettant de retrouver le castelet créé par Thierry Vernet.
 LIBRAIRIE LE VENT DES ROUTES. Du samedi 28 mars au mercredi 22 avril 2OO9
LIBRAIRIE LE VENT DES ROUTES. Du samedi 28 mars au mercredi 22 avril 2OO9
www.vdr.ch - Rue des Bains 50 - 1205 Genève - Tél. + 41 22 800 33 81
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 - samedi 9h à 17h
Le visage des peintres de ce monde
Cette librairie de voyage s’inspire du souffle à la fois littéraire et itinérant de l’écrivain genevois Nicolas Bouvier. Il était naturel
que le café-librairie devienne l’escale de ce voyage artistique autour de l’oeuvre de Thierry Vernet et Floristella Stephani.
Seront exposées des photos prises par leurs amis, Nicolas Bouvier, Jean Mohr ou Jean Bouvier, le peintre.
Vernissage le samedi 28 mars 2009 dès 10h
Mercredi 22 avril dévernissage dès 17h30 en présence de M. François Laut, auteur de «l'oeil qui écrit» biographie
de Nicolas Bouvier et de Mme Eliane Bouvier, suivi d'une séance de signature.
THÉÂTRE À LA BIBLIOTHEQUE DES EAUX-VIVES. Le mardi 31 mars à 2Oh3O
Les Anges du Levant
Textes: Thierry et Floristella Vernet, adaptation: Jérôme Richer
Avec une comédienne et un musicien
Lier lettres de Thierry et journal intime de Floristella, dresser le tableau de deux fameux observateurs du monde, créer des
ponts entre l’Europe et l’Asie, faire un voyage à travers la pensée de deux amoureux de la vie, voilà l’invitation à laquelle vous
êtes conviés. Un voyage qui se fera en musique, entrée libre. MANOIR DE COLOGNY. Du mardi 24 mars au dimanche 5 avril 2OO9
MANOIR DE COLOGNY. Du mardi 24 mars au dimanche 5 avril 2OO9
4 place du Manoir 1224 Cologny/Genève
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi 15h-19h, samedi et dimanche de 15h à 18h. Visites sur demande 079 337 60 14
La peinture du monde
Exposition de peintures issues de collections privées genevoises.
Thierry Vernet et Floristella Stephani se marient à Ceylan et se fixent à Paris pour vivre leur passion commune: la peinture.
Installés sur les hauteurs de Belleville à Paris depuis 1958, ils explorent les joies uniques et les aléas d’une création avec la
rigueur calviniste de suisses exilés. S’interdisant tout jugement sur l’oeuvre de l’autre, ils s’engagent dans une création parallèle
affrontant ensemble avec patience les difficultés du quotidien. Des amis les encouragent et acquièrent leurs tableaux.
Cette exposition est donc un double hommage: à leurs oeuvres et à ceux qui les ont aimées.
On y découvre notamment les peintures de Thierry Vernet de 1954, en Afghanistan, rarement exposées, et la magnifique évocation de Café Florian, à Venise, de merveilleuses aquarelles et des dessins de Vernet et de son épouse qui se rejoignent daans leurs épures stylisées.
magnifique évocation de Café Florian, à Venise, de merveilleuses aquarelles et des dessins de Vernet et de son épouse qui se rejoignent daans leurs épures stylisées.
TEMPLE DE SAINT GERVAIS. Du lundi 6 au samedi 11 avril 2OO9
www.espace-saint-gervais-ch - Rue du Temple et Rue des Terreaux-du-Temple - Tél. + 41 22 345 23 11
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
Le chemin de croix de Floristella Stephani
et le via crucis de Franz Liszt
Protestante de naissance, Floristella Stephani a choisi de devenir catholique. Une de ses oeuvres majeures qui explicite ce
parcours spirituel est son «Chemin de Croix». Présenté au temple de Saint-Gervais, il sera accompagné de ses textes lus par
la comédienne Dominique Reymond, nièce de Thierry Vernet, et du Via Crucis de Franz Liszt interprété par: Diego Innocenzi
et direction, Marie-Camille Vaquie, soprano, Cendrine Carmelt, alto, Ives Josevski, ténor, Florent Blaser, basse.
Vernissage le lundi 6 avril dès 19h30, concert à 20h
Concert-lecture lors du vernissage de l’exposition du «Chemin de Croix» de Floristella Stephani.
BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE. Mardi 21 avril 2OO9
http://www.ville-ge.ch/bge/actualites/espace-ami-lullin.htm - La salle de conférence Espace Ami Lullin, au rez-de-chaussée.
Horaire dès 18h15, de 18h30 à 20h, conférences.
La Bibliothèque de Genève accueille en présence de Madame Barbara Roth, conservateur du Département des manuscrits,
les conférences d'Alexandra Loumpet-Galitzine et de François Laut.
L’exil de la création, la création de l’exil
En choisissant librement parmi les oeuvres de l'exposition, Alexandra Loumpet-Galitzine docteur de l’Université de Paris I,
interroge le processus de création comme une mise en exil volontaire du monde et de soi.
L'oeil de l'Autre!
François Laut, auteur de «L'oeil qui écrit», portrait littéraire de Nicolas Bouvier Ed. Payot, 2008, une biographie saluée par
la critique, nourrie de leurs échanges, de l’accès qui lui a été accordé aux archives Bouvier et notamment à sa correspondance
avec le peintre Thierry Vernet.COLLÈGE & ÉCOLE DE COMMERCE NICOLAS BOUVIER. Du jeudi 19 mars au vendredi 3O avril 2OO9
60, rue de Saint-Jean - 1203 Genève - Tél. +41 22 546 22 00
Du lundi à vendredi de 7h30 à 18h30
ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE HENRY-DUNANT. Du jeudi 7 mai au vendredi 3O juin 2OO9
20, av. Edmond-Vaucher - 1203 Genève - Tél. +41 22 388 59 00
Du lundi à vendredi de 7h30 à 18h30
avec la participation du
COLLEGE POUR ADULTES ALICE-RIVAZ (COPAD)
Un nouvel usage du monde
http://wwwedu.ge.ch/po/bouvier/
Exposition de travaux d’élèves réalisés durant les cours d’arts visuels autour de l'oeuvre de Floristella Stephani et Thierry Vernet.
Deux équipes d’enseignants en arts visuels s’associent dans ce projet pédagogique. Les élèves assisteront aux divers événements
organisés lors de cet hommage aux deux peintres. La découverte de l’univers de ces créateurs et la confrontation avec
leurs oeuvres, leur démarche artistique, leur regard sur le monde, constituera pour chacun des étudiants le point de départ
d’une recherche personnelle, puis d’un travail de réinterprétation et de création en dessin, peinture ou photo.
L’exposition présentera au public un florilège de ces réalisations.
Vernissage à CEC Nicolas Bouvier le jeudi 19 mars 2009 dès 17h, à l'espace d'exposition.
Vernissage à ECG Henry-Dunant le jeudi 7 mai 2009 à 17h, dans le hall principal.CRÉATIONS EN 2O1O
Pièce de théâtre > Sur les textes de Thierry Vernet et Floristella Stephani, un travail de Jérôme Richer, metteur en scène
et comédien.
Publication > Rédigée par Alexandra Loumpet-Galitzine, anthropologue et écrivain, une publication articulée à la fois
autour des thématiques de l’exposition: une saison autour de l’oeuvre de Floristella Stephani et Thierry Vernet et d’extraits
choisis de leurs oeuvres.
Film > Une palette à quatre mains, création d'Hélène Faucherre, réalisatrice à la TSR
Âmes généreuses, Floristella Stephani et Thierry Venet ont transmis leur vision artistique à travers leurs oeuvres et leurs
écrits, mais ils ont aussi laissé des traces dans les coeurs de ceux et celles qui les ont côtoyés.
SOUSCRIPTION 2OO9* 2O1O**
IMPRESSION DES DESSINS DE L'USAGE DU MONDE.
5O tirages typographiques numérotés dont 1O folios sur papier cuve
AFFICHE* > Une saison avec Floristella Stephani et Thierry Vernet
AFFICHE DES PANNEAUX > de Francis Renevey Atelier Nomade
MAGASINE VOYAGER* > les cahiers de l'Atelier Nomade N°5, Un voyage d'artiste, numéro spécial Vernet
DVD** > Une palette à quatre mains du film d'Hélène Faucherre, Réalisatrice à la TSR
PUBLICATION** > D'Alexandra Loumpet-Galitzine, anthropologue et écrivain.
ASSOCIATION «A LA DÉCOUVERTE DE L'OEUVRE DES PEINTRES
FLORISTELLA STEPHANI ET THIERRY VERNET»: 4DOP:FS_TV
Cotisation annuelle ordinaire Frs 30.- / cotisation annuelle de soutien Frs 200.- / dons
Compte postfinance No: 10-712838-7 / Pour les paiements en provenance de l’étranger IBAN CH87 0900 0000 1071 28387
Toutes les informations sur le site www.thierry-vernet.org
Images: grand format: Thierry Vernet, Vufflens-la-Ville; Java, Café Florian; Floristella Stephani, Moustapha. -
Le fluide de Tanguy Viel
En lisant Insoupçonnable, en 2006.
Cela fait toujours du bien de se tremper dans une écriture neuve, surtout à ce moment où la nature se réveille et que tout repousse ; et c’est de fait dans le ruissellement de la fonte des neiges, faisant déborder les torrents des pentes alentour que jai lu le dernier roman de Tanguy Viel, le premier que je découvre pour ma part, dont la fraîcheur du style m’a régalé – jusqu’à ce que l’auteur dit, en fin de récit, de tout ce qui rouille : « Le port continuait de rouiller. Les entrepôts rouillaient. Les tôles rouillaient. Les bateaux rouillaient. La mer rouillait. Même les hommes, les quelques égarés qui continuaient de remuer la poussière des quais, on ne savait déjà plus si le soleil, le sel, l’iode, ou simplement le reflet de la rouille partout, on ne savait plus ce qui avait cramoisi leur peau ».
Mais l’or ne rouille pas, me disais-je en lisant cette page d’Insoupçonnable, ni le noir ni la paille du chapeau panama qui joue là-dedans le rôle d’objet-pivot autour duquel tourne le deal fatal final : ta femme contre mon silence, deux cents balles pour le chapeau et tu coupes à perpète…
C’est l’histoire de deux faux frère et sœur fauchés (Sam et Lise) et de deux vrai faux frères friqués (Henri et Edouard) qui se cherchent et se trouvent.
Sam et Lise vivent dans l’insouciance qui rouille à la longue de la vie facile plus ou moins décheuse, à laquelle un million d’euros de plus (ou mieux : un million de dollars) ajouterait un lustre plus durable.
Or tant qu’à se faire du cinéma, la story est vite filée (sur l’idée de Lise) au conditionnel des sales gosses : tu serais mon frère plutôt que mon mec, j’épouserais Henri pour son blé et je serais kidnappée, Henri cracherait le million par amour de moi et ensuite tous les deux on file aux îles ou à Fargo se la faire belle, le scénar de rêve.
Cela tient évidemment par l’astuce filée de bout en bout, sans être vraiment un polar, disons plutôt roman noir mental, ou plus ouvert par l’écriture et la puissance d’évocation : suspense poétique.
Il y a en effet une poésie très singulière dans la vision autant que dans l’écriture de Tanguy Viel, et c’est ce qui m’enchante bien plus encore que les trouvailles dont le livre regorge.
Celles-ci n’ont rien de gratuit au demeurant : les variations sur le golf (« Il est toujours plus dur de putter en descente qu’en montée ») ou la « valse épuisée » de Chostakovitch, même les phrases plus ostensiblement trouvées (« Je peux vous dire, même sur cinq cents mètres, c’est quelque chose de conduire une Jaguar avec un commissaire-priseur dans le coffre » ou « Mais ce n’est pas ma faute si ce sont les vieux qui sont riches ») ne se ressentent pas d’une recherche d’effets mais se fondent dans la coulée du texte bien fluide et pourtant en étrange, hagard et souriant suspens, comme d’une rêve éveillé.Tanguy Viel. Insoupçonnable. Minuit, 2006.
-
Matricule 2000

Trois ans de Carnets de JLK. De l'écriture et de la lecture sur la Toile. Notes en chemin...
A La Désirade, ce samedi 7 février 2009. – La nuit tombe sur la montagne enneigée, on se dirait hors du temps, et les mots qui me viennent à l’instant voudraient refléter la sérénité d’une soirée d’hiver au coin du feu, auprès de personnes aimées – ma bonne amie et son frère. Celui-ci, sous le nom de Philip Seelen, est devenu familier ces derniers mois des lecteurs de ces Carnets de JLK, notamment du fait de la série Panopticon, contrepoint d’images et de brefs textes, inspirés par celles-là, que nous filons tous les jours à quatre mains. Si j’évoque la sérénité de notre petit clan, ma bonne amie, que j’appelle aussi Lady L., en est la première inspiratrice en dépit des charges qu’elle assume dans sa profession de formatrice d’enseignants, spécialisée dans la recherche en matière de récits de vie. Notre vie commune se poursuit en harmonie depuis 27 ans, étroitement associée à celle de nos deux filles Sophie Cécile et Julie Loyse. Je note cela en toute transparence sans me préoccuper du fait que ces mots peuvent être lus n’importe où et par n’importe qui, à commencer par les 500 lecteurs réguliers de ce blog, qui furent 938 le 21 janvier, à consulter 4223 pages en un jour, et 1078 le 28 janvier, à consulter 11091 pages, sans que je n’aie la moindre idée de ce qui, ces jours-là, m’a valu cette attention – je préfère d’ailleurs ne pas le savoir…
Ce qui m’importe, en revanche, est la continuité parfaitement régulière de ces consultations, en légère baisse le samedi. J’y vois comme une marque de curiosité soutenue et peut-être de confiance, parfois même d’amitié, manifestées par quelques signes. Dès l’ouverture de ce blog, en juin 2005, j’ai eu la bonne surprise de voir se constituer un réseau de lecteurs, parfois à visages découverts, marqué par de vrais échanges ici et là prolongés sous forme de publications ou d’articles de ma part. C’est ainsi que j’’ai publié, dans le journal littéraire que je dirige, à l’enseigne du Passe-Muraille, des textes de Raymond Alcovère, de Joël Perino, d'Hubert Simard, de Frédérique Hirsch-Noir, puis de Bruno Pellegrino ou de Pascal Janovjak, notamment, et j’ai présenté, dans le journal 24 Heures dont je suis le mercenaire, quelques livres de ces complices, tels Christian Cottet-Emard, Alina Reyes, Raymond Alcovère, Jean-Jacques Nuel, ou Bona Mangangu, plus récemment François Bon, entre autres. Remue.net & Co
Remue.net & Co
François Bon, avec son formidable réseau virtuel, tant à l’enseigne de Remue.net que du Tiers.livre ou de Publie.net, représente à mes yeux l’illustration la plus remarquable de la mutation profonde que peut signifier l’écriture ou la publication en ligne, par un nouveau vecteur arborescent. Fort peu porté, à l’origine sur les nouvelles technologies, j’ai trouvé initialement, dans la pratique du blog, la prolongation des carnets que je tiens depuis une quarantaine d’année, et qui ont fait l’objet de deux publications substantielles (L’Ambassade du papillon, 1993-1999, et Les Passions partagées, 1973-1992), et, d’autre part, l’occasion de déployer mes activités de passeur de littérature ou de chroniqueur en matière de théâtre ou de cinéma.
De plus en plus, cependant, le support du blog me semble lui-même induire de nouvelles pratiques, et c’est ainsi que trois nouvelles arborescences, au moins, se sont développées sur ces Carnets de JLK au fil des mois : je veux parler des 150 lettres que j’ai échangées à ce jour avec Pascal Janovjak, écrivain franco-suisse établi à Ramallah, et qui constituent après un an, sous le titre de Lettres par-dessus les murs, un livre virtuel de plus de 300 pages ; de la série déjà citée du Panopticon, comptant déjà plus de 200 séquences, et de plus récentes méditations poétiques modulées sous le titre de Pensées de l’aube, qui me sont comme une hygiène spirituelle quotidienne.
Pascal Janovjak, écrivain franco-suisse établi à Ramallah, et qui constituent après un an, sous le titre de Lettres par-dessus les murs, un livre virtuel de plus de 300 pages ; de la série déjà citée du Panopticon, comptant déjà plus de 200 séquences, et de plus récentes méditations poétiques modulées sous le titre de Pensées de l’aube, qui me sont comme une hygiène spirituelle quotidienne.Du blog au livre
Le passage du blog au livre n’est pas, à mes yeux, un transit obligatoire, mais je me réjouis de publier, sous peu, un ouvrage de 280 pages, sous le titre de Riches Heures, constitué de textes tous publiés en ce lieu, à paraître aux éditions L’Age d’Homme à l’instigation de mon ami Jean-Michel Olivier. Par ailleurs, je suis reconnaissant à François Bon d’avoir établi, sans que je ne lui demande rien, un recueil de mes listes sous le titre de Ceux qui songent avant l’aube, à l’enseigne de Publie.net, avec une belle couverture de Philippe de Jonckhere. Ces nouvelles procédures d’édition feront-elles florès demain ? Je n’en sais rien mais n’y suis nullement rétif, quoique préférant toujours un livre de papier à un e-book dernier cri, et me réjouissant comme au premier jour de voir paraître un livre ordinaire…
N’empêche : une société est en train d’en remplacer une autre. Hier encore, je parlais avec le jeune nonagénaire René de Obaldia de la société littéraire que nous avons connue et qui est en train de disparaître. Le vieil académicien au regard vif s’étonnait de ce que les noms de Max Jacob, d’Oscar de Lubicz-Milosz ou d’Audiberti me disent encore quelque chose (!), mais à l’opposé de ceux-là qui retirent l’échelle derrière eux, comme il en est tant aujourd’hui à marmonner leur « après nous le déluge », je me suis réjoui de l’entendre parier pour de nouvelles formes tout en concluant à la fin d’une ère.
Georges Nivat évoque, dans soin dernier livre, Vivre en Russe, l’importance cruciale des blogs dans la nouvelle Russie, et le niveau élevé de leurs réseaux en matière littéraire. De la même façon, j’entendais parler l’autre jour, à la radio, du rôle décisif de la blogosphère iranienne en matière de débat démocratique - sans parler de la galaxie Obama...
Dans cette optique de l’échange vivifiant, je regrette pour ma part de ne pas consacrer assez de temps aux blogs de qualité qui constellent la toile francophone, dont François Bon ou Christine Genin (http://blog.lignesdefuite.fr/) ont établi d’utiles répertoires. Les lecteurs de ces Carnets de JLK connaissent déjà, sans doute, ceux que j’ai cités en Liens, du passeur de poésie Jalel El-Gharbi à Eric Poindron en son Cabinet de curiosités ou de Feuilly à Soulef, d’Alain Bagnoud à Jean-Michel Olivier et à bien d’autres dont la liste (incomplète) figure ci-contre.
Le Labyrinthe ne cesse de jeter de nouvelles allées et l'Arborescence de nouvelles relations entre scripteurs et lecteurs. Or l’attention et la présence, mais aussi les réactions de ceux-ci sont autant de viatiques et de pierres d’achoppement pour ceux-là dans le Work in progress. Bref, à «mes» 500, parmi lesquels je distingue de plus en plus de visages amis, je dis une fois de plus ce soir, ma vive reconnaissance. E la nave va…Images: Lucienne K: Le feu dans la neige. Philip Seelen: Neige à La Désirade.

-
Matricule 1500
Confession d’une note prise en avril 2008, relue à l’instant d'annoncer le Matricule 2000...
Je suis la mille cinq centième note de ce blog. Je n’y suis pour rien ni ne sais diable ce que je vais dire, et je me demande si celui qui me prend le sait lui-même ? Je le sens bien songeur à l’instant. Je sens qu’il pense à ceux qui sont en train de me lire, se demandant visiblement qui ils sont et ce qu’ils ont à faire de moi, donc de lui qui nous prend à peu près tous les jours, nous les notes de ce blog, avec la conscience claire qu’il nous expose à la vue de tous ces regards occultes.
Le fait d’être lue quelques instants après avoir été prise devrait m’être indifférent, étant la mille cinq centième et n’ayant que ça à faire à ce qu’il semble (c’est du moins ce que celui qui me prend à l’air de penser, mais allez savoir avec lui…), et pourtant je sens à la fois que mon rôle est de faire date, en tant que chiffre rond, et j’apprécie que celui qui me prend me considère maintenant (il vient d’esquisser un sourire) avec une sorte de tendresse.
Je dois alors préciser, capable que je suis tout de même d’entrevoir ma propre origine, que cette tendresse englobe, dans l’esprit de celui qui me prend, tous ceux qui prennent la peine de nous lire, nous les notes de ce blog, qu’ils acquiescent à ce que nous exprimons ou qu’ils le réprouvent. Ce qu’ils apprécient chez nous, ce qu’ils attendent ou ce qu’ils trouvent est un peu mystérieux, mais celui qui me prend ne s’en inquiète pas trop. Ainsi que, la nuit du 5 janvier dernier, pas moins de 8700 pages aient été scrutées par eux l’intrigue certes, mais qu’en dire et qu’en penser ? C’est ce qu’il ne saurait exprimer par mon truchement. En fait, il ne se soucie que de s’exprimer sur ce qu’il aime ou qui l’intéresse, sans chercher à plaire ou à capter l’attention. Les visiteurs fidèles de ces Carnets de JLK sont environ 500-700 par jour. Lorsqu'un thème dont on parle est abordé, ils sont jusqu'à 900, jamais plus à ce jour, d'ailleurs 1000 n'est jamais que deux fois 500 et JLK est trop indolent ou trop snob (?) pour aller à la pêche aux voix. Le compteur de ce blog affichait 1495 visiteurs au 30 juin 2005, premier mois de son entrée en lice. En avril 2008, il en a recensé 18774. Tels sont les progrès de la course aux sacs.
Voilà : c’est noté, j’étais la mille cinq centième, j’ai fait mon tour de piste et je cède ma place à la mille cinq cent et unième. On sent le printemps, me fait dire celui qui me prend, et cela encore: qu'il a les crocs. Cela sent la neige et le bœuf à la ficelle, par conséquent bonsoir. Il vous salue bien amicalement, tous tant que vous êtes à me lire à l’instant, salut les gens et merci la vie… -
La fée des Grottes

Jean-Michel Olivier, dans Notre Dame du Fort-Barreau, rend hommage à une « sainte » Jeanne à la Brassens
Certains êtres traversent notre vie comme des anges discrets dont nous n’évaluons pas toujours, sur le moment, les bienfaits, alors que le temps nous révèle le rôle qu’ils ont joué et ce que nous leur devons. Or c’est exactement cet élan de reconnaissance rétrospective qui a poussé Jean-Michel Olivier, plus de dix ans après sa disparition, à rendre hommage à une impayable vieille dame dont il a senti, dès leur première rencontre, au mitan des années 70, qu’elle compterait beaucoup dans sa vie.
C’est à une « vierge » de ses amies (une Théa décidée à « faire » un enfant toute seule en cette époque d’émancipation) que l’étudiant lettreux, féru de photo et de littérature, doit sa première rencontre avec l’étonnante Jeanne, l’air d’une chiffonnière et possédant néanmoins deux grands vieux immeubles dans le quartier populaire des Grottes, où elle accueille qui lui chante, le plus souvent des sans-le-sou, marginaux, artistes ou étudiants.
L’auteur trouve alors, à ce 31 de la rue du Fort-Barreau, un appartement dont la lumière l’enchante, et d’emblée se noue un rapport à la fois plus personnel, plus romanesque (on s’échange des billets plus ou moins sibyllins), moins prévisible aussi que ceux qui s’établissent entre locataires et logeurs ordinaires.
L’accueil est le fort de Jeanne, que son hôte compare bientôt à la Jeanne de Brassens, et c’est même à une sorte d’apostolat, aussi discret que fantaisiste, que se voue cette fille de pasteur héritière de deux immeubles (une cinquantaine de logements), donc virtuellement riche, mais fagotée comme l’as de pique et montrant immédiatement plus d’intérêt pour les écrits de son locataire que pour l’encaissement de son loyer. Elle-même un peu cultivée, épouse de violoniste amateur, mémoire de ces lieux aussi, elle raconte à l’auteur la très plaisante histoire de la nuit qu’y passa un certain exilé russe du nom de Vladimir Oulianov, dont elle souligne avec candeur que personne n’a su ce qu’il était devenu après son passage en ces murs…
Loin de s’en tenir à la seule évocation de ce beau personnage, Jean-Michel Olivier faufile toute une chronique des décennies successives et de ses débuts puis de ses avancées d’écrivain allant et venant entre Genève, Paris, Avignon ou l’Amérique, à chaque fois interrogé par dame Jeanne sur ses découvertes. Sans peser, le récit est aussi celui d’une vie déclinante, à la fin de laquelle Jeanne se retrouvera bien isolée en dépit de la sollicitude de quelques-uns – dont l’écrivain n’est pas toujours. Une scène très émouvante, à valeur d’expiation pour l’auteur, figure plus précisément l’humiliation publique de la vieille Jeanne un peu perdue, dans une épicerie, moquée par les gens sans que son locataire-ami n’ose s’interposer, à sa honte cuisante.
Avec l’effet apaisant des années, c’est avec une tendresse d’autant plus marquée, quoique sans pathos, que Jean-Michel Olivier évoque sa première visite de l’appartement de sa vieille amie, peu après la mort de celle-ci, dans l’inimaginable capharnaüm duquel il trouve un carton rempli de tous les articles consacrés à ses livres, découpés par la vieille dame et annotés, non sans ironie parfois…
Plein d’humour et de bonté, à l’image de cette touchante figure de «juste», ce récit est, de la même façon, comme nimbé d’une aura d’humanité.
Jean-Michel Olivier. Notre Dame du Fort-Barreau. L’Age d’Homme, 100p.
-
Le souffle du roman anglais

Bien plus qu’en France, les romanciers britanniques captent la réalité multiple, intime ou collective.
Le constat s’impose : en dépit de rentrées pléthoriques, le roman français fait pâle figure en regard de son homologue british. Manque d’ouverture au monde et de pugnacité critique, mais aussi de curiosité, d’empathie humaine et de souffle poétique, manque aussi du simple plaisir de raconter dont le récent roman de Salman Rushdie, L’Enchanteresse de Florence, est l’éclatant exemple. Autant que les « métèques » de sa Majesté, tel l’immense V. S. Naipaul ou le « Paki » Hanif Kureishi, dont le regard extérieur a été d’un apport décisif, la satire selon Swift ou le réalisme poétique à la Thomas Hardy continuent d’inspirer les nouvelles générations. Ian McEwan l’illustre bien, dont l’irrésistible dernier roman, Sur la plage de Chesil, ressaisit les prémices intimistes de la révolution sexuelle des sixties avec une tendre lucidité.
Lucide, lui aussi : Jonathan Coe. Très caustique à ses débuts, avec Testament à l’anglaise, conjuguant immédiatement tableaux de mœurs et fresque d’époque marquée par la politique, le wonderboy du roman anglais des années 80-90 poursuivit sur cette lancée satirique avec Bienvenue au club et Le cercle fermé. Avec La pluie avant qu’elle tombe, le ton du quadra change en revanche. Son nouvel opus est baigné de mélancolie et conjugué au féminin comme un roman de Rosamond Lehman, grande romancière d’avant-guerre à laquelle il rend implicitement hommage. Voici de fait Rosamond, protagoniste du roman, qui vient de se suicider non sans s’être confiée au magnétophone à Imogen, son arrière-petite cousine aveugle, en commentant une vingtaine de photos qui « fixent » ce qu’elle a vécu depuis l’époque du Blitz anglais - trois générations de femmes revivant la même malédiction de la haine maternelle, entre autres. Sans pasticher l’auteure de Poussière, Jonathan Coe déploie une prose fluide et lancinante (l’ombre fugace de Virgina Woolf passe aussi entre les lignes) où la sensualité lesbienne le dispute aux peines et aux frustrations, au fil d’un récit très émouvant, mélodieusement noir.
Jonathan Coe. La Pluie, avant qu’elle tombe. Traduit de l’anglais par Jamila et Serge Chauvin. Gallimard, coll. Du monde entier, 254p.
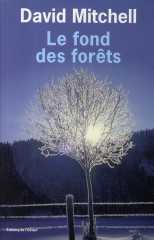 Doux oiseau d’adolescence
Doux oiseau d’adolescence
On pense à L’Attrape-cœurs de Salinger en se plongeant dans l’univers chevaleresque et candide, violent et doux de Jason le bègue, enfant de notre époque (plus précisément l’an 1982, sous le règne de Maggie Thatcher) zigzaguant entre la sauvagerie campagnarde et les nouveaux mythes de la télé, entre autres multiples références. Après son étonnante Cartographie des nuages, le quadragénaire David Mitchell revisite ici le passage délicat de l’enfance à l’âge d’homme avec une profusion truculente, du point de vue de l’observation, que traduit une langue jouant bien, malgré les écueils de la traduction, sur les registres de l’oralité «djeune», tout en modulant des sentiments tendres ou cuisants, ici liés à la mésentente des «vieux». L’adolescence a beau achopper aux nouvelles mœurs, avec l’attirance entêtante de la sexualité précoce (le protagoniste n’ayant que 13 ans), elle n’en reste pas moins romantique – Jason publie ainsi des poèmes sous le pseudo d’Eliot Bolivar dans le journal paroissial... Janus biface, le personnage, très attachant, rappelle enfin Mark Twain et Roddy Doyle…
David Mitchell. Le fond des forêts. Traduit de l’anglais par Manuel Berri. L’Olivier, 473p.
 Mon père, cette énigme…
Mon père, cette énigme…
Qui a jamais connu son père ? se demandait le grand romancier américain Thomas Wolfe, et la question se charge d’une résonance cruelle, sur fond de trivialité coupable, dans ce roman sombre et magnifique de l’Ecossais John Burnside, dont on se rappelle Les empreintes du diable au climat fascinant, découvert l’an dernier. Il suffit de l’innocente question d’un autostoppeur du nom de Mike, en quête de son propre père, pour confronter le narrateur aux abysses des relations le liant à son paternel violent et alcoolique, qu’il entreprend alors d’évoquer en affabulant. Ce premier détour par le mensonge n’est qu’un premier pas dans un dédale où la dissimulation a empêché toute relation claire du fils avec le père, pour des motifs qu’on découvre au fil des pages, incitant de plus en plus à l’écoute indulgente.
John Burnside. Un mensonge sur mon père. Traduit de l’anglais par Catherine Richard. Métailié, 307p.
 Au cœur de l’humain
Au cœur de l’humain
Le premier roman d’Owen Sheers, poète gallois déjà reconnu, fait figure de découverte à la fois par sa thématique, relevant de l’histoire-fiction, son approche des êtres au plus vif des sentiments, sa prise en compte parfois insoutenable des tragédies individuelles, et la qualité de sa langue simple et belle, d’une poésie très évocatrice, sans effets ni chichis.
En fin de volume, Owen Sheers raconte dans quelles circonstances il a eu l’idée, en travaillant avec un vieux maçon du pays de Galles qui lui évoquait les préparatifs amorcés, en 1940, pour une éventuelle résistance contre l’invasion allemande, dans les « montagnes noires », d’imaginer cette Résistance anglaise dont on estimait alors l’espérance de vie à une quinzaine de jours. Or, à partir de cet improbable canevas, Owen Sheers développe une « uchronie » prenante et parfois bouleversante, où le point de vue des femmes de la vallée d’Olchon, qui découvrent un matin que tous leurs hommes ont disparu pendant la nuit, alterne avec celui des soldats allemands chargés de mission spéciale en ces lieux. Sous la direction de l’officier Albrecht, ancien d’Oxford, la patrouille des cinq soldats va nouer, avec les femmes, des relations inattendues, quoique naturelles, humaines, vraies.
Dans Le complot contre l’Amérique, Philip Roth imaginait les conséquences d’une prise de pouvoir pro-nazie aux USA, Owen Sheers, lui, pose une question qui, de son pays, nous conduit au cœur de l’humain, comme dans Le silence de la mer de Vercors. A lire absolument…
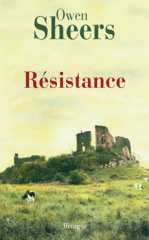 Owen Sheers. Résistance. Traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner. Rivages, 411p.
Owen Sheers. Résistance. Traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner. Rivages, 411p.Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 31 janvier 2009.
-
Du slam pour Vera
 Tchatche ou crève, de Dorota Maslowska, au Cabaret Tastemot. Découverte de l'enfant terrible de la nouvelle littérature polonaise. Suivie d'une rencontre avec Vera Michalski.
Tchatche ou crève, de Dorota Maslowska, au Cabaret Tastemot. Découverte de l'enfant terrible de la nouvelle littérature polonaise. Suivie d'une rencontre avec Vera Michalski.« Hep, vous, là, il est temps, allez, réveillez-vous, écoutez un peu l’histoire d’un incendie dans une chaussure, écoutez, c’est l’histoire d’une jeune femme hideuse avec un corps de chien… »
Ainsi commence, en trombe verbale, Tchatche ou crève de la jeune Polonaise Dorota Maslowska, roman très oral et choral d’une sale gamine des mauvais quartiers de Varsovie, dont le nom avait déjà fait le tour au cap de ses 20 ans, après la parution de son premier livre, Polococktail Party. On a comparé son apparition à celle de Sagan, et sa matière brutalement « sexy » à celle d’un Henry Miller. L’apparentement de son écriture et de son énergie au hip hop et au slam évoque également les petits-enfants anglo-saxons ou néo-russes du grand Céline. Dans un entretien publié par la revue Transfuge, Dorota Maslowska confiait modestement à Oriane Jeancourt Galignani : « La littérature polonaise, en dehors de moi, ne produit pas grand-chose en ce moment ». Passons sur la provoc, rappelant celle de jeunes Russes se la jouant destroy ou du vieux Bukowski pré-punk : par delà le turbulent phénomène, Maslowska a bel et bien un tempérament d’écrivain à cinglante « papatte », qui tire une prose vibrante et vivante, d’un lyrisme grinçant, du dépotoir actuel, partiellement localisé dans le Bronx varsovien que représente le quartier Praga. Autour de celui-ci, au fil d’une acid story gratinée, tourbillonne la « tchatche » du monde comme il va, entre paysans clochardisés et gens de médias « foutraques », mannequins à la peine et psychiatres à la gomme…
Pour lire et dire la prose hyper-rythmée de Dorota Maslowska, la comédienne Delphine Horst et la rappeuse Zelga conjugueront jeudi soir leurs talents. En fin de soirée, l’éditrice Vera Michalski, patronne de Noir sur Blanc, où a paru Tchatche ou crève, parlera de son métier et de ses auteurs.
Lausanne, Cabaret Tastemot, Théâtre 2.21, salle 2. Jeudi 29 janvier, dès 20h. Entrée libre. Bar.Dorota Maslowska. Tchatche ou crève. Traduit du polonais par Isabelle Jannès-Kalinowski.
Editions noir sur Blanc, 2008, 141p.
Dorota Maslowska. Polococktail Party. Noir sur Blanc 2004, et coll. Points No P1472.
-
L’empire d’une passion

Entre Lausanne, Paris et la Pologne, Vera Michalski développe, à l’enseigne de Libella, un groupe éditorial de plus en plus influent, regroupant Noir sur Blanc, Buchet-Chastel, Phébus, Maren Sell et Anatolia. Rencontre.
L’éditeur parisien Jean-Pierre Sicre, qui lui en veut férocement… d’avoir sauvé Phébus, sa maison littéraire au prestigieux catalogue, l’appelle « la femme à la hache ». Vera Michalski « tueuse » ? L’appellation cadre mal avec le style et les choix de la co-fondatrice des éditions Noir sur Blanc, crées à Montricher en 1986 avec son mari polonais Jan Michalski pour jeter un pont vers ce qu’on appelait alors l’Autre Europe. De la même façon, le qualificatif de « riche héritière », que d’aucuns ressassent pour minimiser son mérite en rappelant son lien familial avec l’empire Hoffman-Laroche, ne saurait éclipser l’exigence intellectuelle et littéraire qu’ont fait valoir les Michalski en élaborant le catalogue de Noir sur Blanc avant de racheter les légendaires éditions Buchet-Chastel (où parurent Henry Miller, Lawrence Durrell ou Roger Vailland) et de les revitaliser complètement, sauvant en outre Phébus de la faillite et accueillant tout récemment la collection Anatolia de Samuel Brussell.
Entre ses bureaux de Lausanne, la parisienne rue des Canettes où une cinquantaine de personnes collaborent à Buchet-Chastel, Varsovie et Cracovie où deux établissements publient les auteurs occidentaux en traduction (de Cendrars à Bouvier, en passant par Naipaul ou Eco), et la meilleure littérature polonaise, Vera Michalski « règne » en déléguant volontiers, tout en gardant la haute main sur la gestion et les choix décisifs. Ainsi est-elle en train de lire elle-même Les Bienveillantes de Jonathan Littell pour décider si, oui ou non, elle en assumera l’édition polonaise. Autant dire qu’elle reste très attentive à l’actualité littéraire internationale.
- Que vous inspire la pléthore de la rentrée française ?
- J’estime qu’elle signale, malgré tout, la vitalité de la lecture autant que la propension à s’exprimer. Evidemment, je compatis avec les libraires, mais je pense que cette profusion reste positive. Cela étant, à la dernière rentrée de printemps, les chiffres ont été très mauvais dans l’ensemble de l’édition sur mai et juin parce que le public s’est focalisé sur certains titres, comme le Da Vinci Code, et cela n’est pas bon.
- Qu’est-ce qui vous pousse à faire de l’édition ?
- C’est une des métiers les plus captivants qui soient. Je reste fidèle à l’option que nous avions formulée avec mon mari dès le premier catalogue de Noir sur Blanc : découvrir de jeunes talents et rendre justice à des auteurs injustement oubliés. D’abord focalisés sur la Pologne et la Russie, nous avons élargi notre aire. Du vivant de Jan, il nous manquait ainsi l’ouverture à la littérature française. D’où l’idée de faire revivre Buchet-Chastel. Notre intention était surtout d’en relancer la partie littéraire en faisant appel à des gens compétents, notamment Pascale Gautier qui a donné une « ligne » claire à sa collection , avec des auteurs tels Cookie Allez, Philippe Ségur ou Philipe Lafitte. Nous avons également repensé la non-fiction, avec de la géopolitique et de la philosophie, des essais, des biographies de musiciens et de la poésie, ainsi que la série des Cahiers dessinés, que dirige Frédéric Pajak, qui me tient très à cœur et où vont paraître un ouvrage de Pierre Alechinsky et les dessins de Dürrenmatt. Enfin, j’ai été ravie de publier Robert Littell, le père de Jonathan, dont le roman consacré à la CIA, La compagnie, a été un succès.
- Comment avez-vous vécu la campagne de dénigrement de Jean-Pierre Sicre vous traitant d’ambitieuse tyranique ?
- Jean-Pierre Sicre est un grand éditeur et un piètre gestionnaire, c’est connu. Après que nous avons renfloué sa maison en difficulté, il m’a demandé lui-même de la racheter, en pensant qu’il pourrait continuer d’agir à sa guise. J’aurais aimé qu’il reste jusqu’à sa retraite, en ce mois d’octobre précisément, mais il s’est comporté d’une façon telle, en pratiquant les calomnies et la menace, que j’ai été obligé de m’en séparer et de le remplacer. Ce qu’il aurait aimé, c’est qu’on paie et qu’on se taise. Il nous a d’ailleurs longtemps considérés comme ses « banquiers suisses », avec une morgue humiliante. J’ai pourtant gardé la confiance de Daniel Arsand, directeur de collection, et ma nouvelle directrice, Helène Amalric, travaillera dans la continuité du catalogue de Phébus. Sicre n’est pas le premier « fondateur » à mal vivre la fin de son aventure !
- Jusqu’ou pensez-vous vous développer ? Visez-vous d’autres acquisitions ?
- Non : je crois que nous avons atteint, aujourd’hui, une dimension qui correspond à mes possibilités. Mes moyens financiers me donnent la chance de faire ce que j’aime, et je n’ai de comptes à rendre à personne, mais je ne fais pas de mécénat pour autant. J’aime que des livres difficiles à vendre, malgré leur qualité littéraire, soient « aidés » par des ouvrages de plus large intérêt public. Je ne suis pas contre les « coups » éditoriaux, mais ce n’est pas ma priorité. En fait, je continue à faire de l’édition comme j’y suis venue avec Ian, par goût, par curiosité, par plaisir et en essayant de propager cette passion.
Joseph Czapski. Proust contre la déchéance, premier livre paru à l'enseigne de Noir sur Blanc, en 1987.
Cet entretien a paru dans l'édition de 24Heures du 4 octobre.
Portrait photographique de Vera Michalski: Florian Cella. -
Le roman romand new look

Nicolas Pages et Pascale Kramer américanisent les lettres romandes. Deux auteurs quadragénaires, également atypiques, campent leurs derniers romans à New York et Los Angeles.
La paroisse littéraire romande a de quoi frémir: le mauvais genre s’y pointe. Le démon, faudrait-il dire dans le langage des darbystes vaudois dont Nicolas Pages est un rejeton. I love New York, cinquième livre du quadragénaire lausannois dont les chaperons successifs furent Pierre Keller et le sulfureux Guillaume Dustan, nous plonge en effet dans un univers de fêtes, de sexe gay et de drogue qui détone dans nos lettres, bien plus que le Garçon stupide de Lionel Baier n’a choqué le milieu moins feutré du cinéma suisse. Un point commun réunit pourtant ces deux mauvais sujets : une honnêteté qui, de situations apparemment amorales, dégage une sorte de nouvelle éthique artistique.
« Ce que je cherche, explique Nicolas Pages de passage à Lausanne, c’est la véracité, contre la fausse vertu et l’hypocrisie. Jusqu’à l’âge de dix-huit ans, où je suis parti de la maison pour ne pas y étouffer, j’ai vécu sous une chape de plomb où tout ce qui a trait au corps était maudit. Nous allions quatre fois par semaine à l’église et la prière accompagnait chaque repas, mais les relations, avec mon père surtout, étaient glaciales. Il était absolument exclu, à ses yeux, d’envisager une carrière artistique. Mon enfance et mon adolescence ont été formatées par un puritanisme extrême, dans un milieu clos où même les vacances se passaient entre élus… »
Après une rupture brutale, à l’instar de ses deux sœurs, le jeune homme se prend en charge, passe son bac et, fou de culture allemande, séjourne quelque temps à Berlin puis à Cologne avant d’amorcer des études d’architecture à Genève, pour se retrouver à l’Ecal lausannoise. Plasticien, il y réalise notamment une série provocatrice. «En reproduisant exactement le graphisme des bandeaux publicitaires de livres à succès, j’y imprimais des formules choc du type : Le livre le plus nul de l’année, Le nouveau navet de l’auteur culte, etc. Sur quoi je remplaçais discrètement, en librairie, les originaux par mes bandeaux, et j’observais les clients. J’attendais des réactions scandalisées. Mais non : pas un n’a bronché ! »
Ce goût de la provocation, Nicolas Pages, venu tard à d’autres lectures que religieuses, mais avec passion, marque aussi son premier livre paru en 1997, Je mange un œuf, suscité par la question d’un de ses profs : qui êtes-vous ? Qu’est-ce aujourd’hui qu’un artiste ? Réponse : une totale mise à plat de ses faits et gestes, 120 jours durant. Plus « objectif », plus dénué de psychologie ou de sentiments, tu meurs. «La lecture de Moins que zéro, de Bret Easton Ellis, a été l’une de mes premières fascinations, avant Duras ou le Butor de La Modification. Cette façon de « glacer » la réalité, ce refus des fioritures, l’art du mot juste de Duras, le souci de la construction de Butor, correspondaient à mon rejet radical de la «littérature» traditionnelle.
Dans I Love New York, tissé de dialogues comme une pièce de théâtre, l’écrivain lausannois fait un grand pas, justement, dans l’art de la construction et de l’usage, hyper-précis et sensible, de chaque mot. Une cuisante déception amoureuse y prélude à l’évocation d’une amitié folle, d’une espèce d’innocente sauvagerie. L’énergie galvanisante de la Grande Pomme, où Nicolas Pages s’est lancé dans une activité d’agent artistique, alterne avec une traversée épique de l’Amérique et d’amicales retrouvailles en région parisienne. Fuite en avant dans le «fun» et recherche éperdue de vraies relations, constat de ce qui est sans cynisme pour autant: et si le mauvais genre de Nicolas Pages cachait un écrivain ?
Nicolas Pages. I love New York. Flammarion, 245p.

L’insoutenable acuité sensible d’un regard
Plus l’œuvre de Pascale Kramer se développe, et notamment depuis Les Vivants, plus sa « manière », sans rien de maniéré, et plus sa matière s’imposent comme un univers cohérent où la perception la plus fine des atmosphères et des êtres se traduit par une écriture dont l’hyperréalisme n’exclut pas l’émotion et la poésie. Pascale Kramer fait « tout » parler, pourrait-on dire, comme si les objets eux-mêmes s’exprimaient, et malgré le peu d’éloquence de ses personnages.
La trajectoire personnelle de Pascale Kramer est sans doute pour quelque chose dans son type d’observation, pure de tout académisme. À l’écart de la classique filière lettreuse, la romancière s’est formée «sur le terrain». Actuellement installée à Paris, elle y travaille dans la publicité en indépendante tout en démarchant régulièrement, aux Etats-Unis, des projets de scénarios d’auteurs francophone susceptibles d’intéresser Hollywood.
Si son dernier roman, évoquant le malaise exacerbé d’une jeune femme au lendemain de son premier accouchement, pourrait se passer n’importe où, la lumière à la fois éblouissante et moite, sucrée et vaguement pourrie, de Los Angeles, est immédiatement présente dans le tendre inferno de cette Alissa naguère choyée par sa mère et que l’émancipation soudaine de celle-ci révolte alors qu’elle se demande à quoi rime cette enfant et si elle aime vraiment le père «gamin» qui l’a fait avec elle, souffrant de tout quoique « ayant tout pour être heureuse » aux yeux des autres.
D’une attention extrême au moindre regard, au moindre mot, au moindre mouvement de ses personnages, Pascale Kramer, comme dans Fracas, également situé aux Etats-Unis, pratique la même «objectivité» qu’un Bret Easton Ellis, sans rien cependant de froid ni de cruel. Bien plus : la grandeur de ce petit roman tissé de faits minuscules tient à ce que ressent, sans théories ni mots pour le dire, une jeune femme confrontée à l’énormité de cette vie nouvelle sur fonds d’hésitations, d’envies, de frustrations, d’élans de violence, dans un balancement constant entre égoïsmes atomisés et puérilité prolongée, en attendant de plus paisibles réveils…
Pascale Kramer. L’implacable brutalité du réveil. Mercure de France, 140p.
-
De Beyrouth à Gaza

Roméo et Juliette à Beyrouth: une nouvelle de Ritta Baddoura
Ritta Baddoura est une jeune poétesse libanaise. Cette nouvelle, premier texte en prose publié, constitua l'ouverture de la 68e livraison du journal littéraire Le Passe-Muraille en février 2006, après avoir obtenu le premier prix de littérature des Jeux de la francophonie. Ritta Baddoura avait ouvert à cette époque un blog où elle racontait sa vie quotidienne sous les bombes. On la retrouve aujourd'hui en pensée quotidienne avec les habitants de Gaza.
http://rittabaddouraparmilesbombes.chezblog.com
QuinzeLa nuit, Selwa ne dort pas. Les lieux sont encombrés par les corps alourdis d’attente, impotents, que le rêve même déserte. Son corps à elle est gorgé de désir, sa peau tendue, presqu’écorchée par la vie qu’elle ne peut plus tenir à l’intérieur. Il y a trop de monde alentour: ses voisins, ses aïeux, père et mère, petite sœur et tous ses frères qui regardent. Stupéfaits ils se donnent à la peur qui gronde dans la gorge des canons. Il y a assez de morts. Ils encombrent les escaliers, même ceux qui respirent. Ne rien faire de tout cela. Juste s’ouvrir, fleur soudain écrasée par les coulées de lave. Attendre, les seins collés à l’écho, que la stridence encore s’abatte.
Sifflant tel un oiseau en feu, l’obus touche le sol.
- « Ce soir ils sont très proches », articule Hind. « Cela a dû éclater dans la vallée… ».
Peu à peu, dans l’odeur de poudre brûlée, s’infiltre l’haleine de l’aube et la tendresse tarie des fleurs d’orangers.
- « C’est ça. La vallée flambe » dit Aboulias. « Bientôt ce sera notre tour. Allah. Ya Allah. »
Il met son transistor en marche. Une rumeur s’élève de sa poitrine ruisselante, traverse les corps des veilleurs. Une voix grésille, égrène les noms de blessés et de décédés dans une région proche. Le parfum déchu des orangers persiste. Bûcher des arbres, tout crépite doucement.
Quelques déflagrations s’estompent dans le lointain. On dirait une fête étrange qui s’éteint dans une contrée voisine. Dernier cadavre de l’obscur : le silence s’abat dans sa robe de repentir.
Malkoun se lève. Il s’approche des sacs de sable. Il pousse le grand portail, traverse le rez-de-chaussée et sort de l’immeuble. Il inspire fortement les sutures de l’air, tâte sa poche, trouve son paquet de cigarettes. Il revient vers les sacs de sable et tend la tête vers l’intérieur.
- « Ça y est. Ils se sont arrêtés.»
Il éclate de rire : les dents sont blanches et les yeux petits et fatigués.
- « Je vais faire un tour. J’ai besoin d’un briquet. J’achèterai du lait en poudre pour les gosses, si j’en trouve ». A sa femme : « Je ne tarde pas Dada. Tu devrais sortir un peu aussi, hein ? pour le petit dans ton ventre. Il fait beau dehors… Les orangers ont cramé… »
Ses pas feutrés dans la cour de l’immeuble, crissement du verre pilé. A mesure qu’il s’éloigne, le jour se lève, pénètre jusqu’aux recoins de l’abri qui se vide au profit des hauteurs. Chacun regagne son étage : vérifier l’état des appartements, combien de vitres brisées, partager ce qui reste de fromage, œufs et confitures dans le placard. Douce torpeur de survie, il est difficile de retrouver les gestes familiers. Les meubles, les murs sont comme couverts d’une poussière invisible ; celle des sentiers ravagés par les herbes folles lorsque le temps n’y passe plus.
*
Engouffré dans son plumage, le canari ne prête guère attention à Selwa. Elle le pourvoit d’eau propre, accroche la cage au balcon. Son doigt tendu à travers les barreaux de bois frôle le tendre duvet de Prince. Lui parvient la voix de sa mère qui l’appelle. « Plus tard maman, je n’ai pas faim maintenant! ». Selwa entend profiter autrement de l’accalmie. Son cartable est là, contre le mur. Etendue sur la balançoire, elle feuillette ses livres d’écolière. Elle revoit son pupitre; et de son pupitre la mer : marge bleue derrière les toits de Beyrouth pressés à la fenêtre. La boîte de craies multicolores est peut-être encore sur le bureau de la maîtresse; que d’arc-en-ciels barrés pour dire les mois de captivité. Selwa se lève, sort de chez elle. Discrètement. Elle dévale les escaliers vides. Dehors, la journée est étrangement calme. Il y a des flaques de soleil partout.
Nassim habite dans la rue parallèle. Chez lui, il n’y a pas d’abri. Il vient souvent avec les siens se réfugier dans le sous-sol de l’immeuble où demeure Selwa. C’est ainsi qu’ils se sont rencontrés. Ils ne s’étaient jamais croisés auparavant. Il y a, dans la chambre de Nassim, tout un monde. Des déserts se déroulent à perte de vue, des sources vives jaillissent dans les paumes de Selwa lorsqu’elle y pénètre. Pénombre. Nassim est là. Il regarde un film : sur l’écran, deux épaules. L’une claire, l’autre sombre sont comme couvertes de sueur. Fine nappe d’amertume, une voix de femme murmure: «… Hiroshima se recouvrit de fleurs. Ce n’étaient partout que bleuets et glaïeuls, et volubilis et belles-d’un-jour… ». Selwa pousse aussi et récemment, l’humeur des coquelicots a envahi son entrejambe. Elle n’en a parlé à personne. Même les racines des arbres sont en sang et les hommes, surtout ceux qui tombent, ignorent tout à propos de cela. Nassim parle doucement, de la rencontre de ces deux étrangers, de l’amour qui est en train de naître. Selwa répète : « Hiroshima », comme une olive noire gorgée d’huile se dissout dans la bouche. Les visages du japonais puis de la française envahissent l’écran, collision. Combien y a-t-il de temps d’un grain de peau à un grain de terre ?
Nassim pose sa tête sur les genoux de Selwa. Elle aussi a un peu sommeil. Elle laisse ses doigts errer lentement sur son visage. Elle veut l’apprendre, déchiffrer son mystérieux langage, en garder le sens aux extrémités d’elle-même.
Qu’ils sont lisses et blancs ces os bien ordonnés sur les tables rectangulaires. Des centaines d’os alignés comme pour la prière. Selwa effleure ces navires immobiles sur une mer de bois. Elle regarde autour d’elle : grande salle aux murs hauts presque vacillants. Par la fenêtre, le sol est rouge aux pieds d’un baobab en fleurs. Elle ne peut penser qu’à la chaleur qui pèse sur le silence. Sous la chaux, les murs criblés de cris, de regards tuméfiés se dressent dignement et la plaine dehors semble immense. Selwa choisit deux os longs et fins et se dirige vers la porte. Il y a un tabouret, posé seul, sous le soleil tout-puissant, qui l’attend. Elle s’assied, écarte les jambes, saisit le manche de l’instrument. Sa tête se penche et ses cheveux sombres le long de l’os s’accordent. Frottement de l’archet presque vivant contre les mèches grinçantes. A mesure que le son s’élève, l’air exhale un étrange parfum. Le baobab pleut et la terre à ses pieds est un cimetière.
Les sens de Selwa, peu à peu, s’engourdissent. Elle a beau remuer son archet, elle n’entend plus rien. Ses yeux sont trop étroits pour l’arbre gigantesque, sa peau trop fine pour ce manteau de morts. Seul, l’ordre des os est immuable. Ses yeux clos l’emprisonnent, des branches noires effractent ses paupières. Elle n’échappera pas à ce voyage. Ce lieu désormais la possède. Jusques dans les recoins de sa gorge où le souffle gît inanimé. Ce cri qu’elle ne pousse, l’écartèle. C’est lui qui lui donne naissance, c’est à lui qu’elle doit sa vie. Mais il faut qu’il sorte, il faut pousser au risque de briser les cordes, il faut hurler tout ce noir. Il ne faut que les hyènes abattent la gazelle. Il n’y a plus de place sur les tables.
- « Selwa ?… je suis là. Doucement, oui Selwa, oui, doucement… » chuchote Nassim contre son visage.
Elle se sent comme aspirée par un point lumineux, du fond d’un puits humide, jusqu’à la surface. Elle ouvre ses paupières. Les yeux de Nassim plongent dans les siens. Son rêve est encore tapi dans la pénombre. L’ombre géante du baobab règne. Baisers contre sa joue, creux du poignet, rondeur d’épaule, Nassim l’étreint tendrement. Ils restent là, sans rien dire, pour un moment. L’écran affiche le générique du film. Bientôt il lui faudra rentrer chez elle. Elle a promis d’aider son père à classer les vieux journaux cet après-midi. Il y a aussi le rendez-vous chez Hind qui a invité tout le monde pour une limonade sur la terrasse. En sortant de l’abri ce matin, elle a lancé de sa voix un peu cassée :
- « Je vous attends tous, hein ? pas d’excuses…il y aura des petits g¬âteaux et de la musique ».
Selwa sourit à l’idée de voir Hind remuer, un verre de limonade glacée à la main, au rythme langoureux de vieux succès orientaux. Elle mettra probablement sa robe fleurie, rouge et jaune, qui découvre sa poitrine opulente couverte de médailles miraculeuses.
- « Arrange ces beaux cheveux Selwa et mets quelque chose de spécial » lui a-t-elle dit.
Puis sur le ton de la confidence :
- « Ta mère devrait te maquiller un peu, ce n’est pas tous les jours la fête. Ton amoureux sera là, n’est-ce-pas ? j’ai tout remarqué dès le premier jour…rien n’échappe à Hind, petite! Tu viendras, dis ? »
- « Je viendrai, Tante Hind. Je n’ai jamais raté l’occasion de déguster tes patisseries, tu sais bien que je les aime tant ! ».
Selwa aime surtout se retrouver chez Hind au crépuscule. Elle a souvent pensé que, du haut de sa terrasse, le soleil met plus de temps pour se coucher.
* *
Vue de la terrasse, la vallée offre les corps pétrifiés des orangers en partage. L’horizon en rappelle les teintes ardentes, sanglots écorchés au large de la Méditerranée. Selwa observe les silhouettes qui dansent ; des enfants mangent encore à la table garnie. Le gros rire de Hind ponctue ses allées et venues entre les convives. S’approchant de Selwa, elle vante avec ferveur les délices de la glace musquée fabriquée ce matin. Quelques voisins discutent bruyamment de politique dans un coin. Du fond de la vallée, la petite rivière continue, invisible, d’avancer. Le son clair et perlé de son gosier résonne, porté par les causeries irrégulières de quelques grenouilles. Les touffes odorantes de basilic et de menthe, bordant la balustrade, baignent les premières humeurs du soir. Sous leur habit de chair, les cœurs sont tristes et inquiets. L’heure des autres retrouvailles, celles qui durent toute une nuit dans l’abri, approche.
- « Selwa ! je vais avec Malkoun acheter quelques paquets de bougies. Il n’y en a pas assez pour ce soir. Tu nous accompagnes ? » lance Nassim.
- « Il n’en est pas question! » riposte le père de Selwa . « Il fait déjà assez sombre, les routes ne sont pas sûres…Tu achèteras des bougies demain Malkoun ».
- « Bah, la journée a été calme » répond Malkoun avec sa bonhomie habituelle. « Nous allons chez Hanna, c’est à deux pas. Le magasin doit être encore ouvert à cette heure-ci…ça nous épargnera une veillée dans le noir jusqu’au petit matin. Allez Nassim, on y va ».
Selwa sirote son sirop de mûres. Elle pense que Malkoun a raison, qu’il est préférable d’avoir des bougies tant que le courant électrique reste coupé. Elle espère qu’il n’y aura pas de grand danger cette nuit. Elle essaiera de s’endormir, même si les matelas posés à même le sol, ne sont pas confortables. « On a moins peur quand on dort » lui avait confié sa petite sœur.
Selwa imagine les clichés qui ont porté le visage déchiqueté de son pays sur les écrans télévisés du monde. Au sein de tant de violence, il reste à Beyrouth un toit perdu, parmi tant d’autres, où Nassim peut inviter Selwa à danser. Elle répète à mi-voix leurs deux prénoms : « Nassim et Selwa ». La musique s’est maintenant arrêtée, on débarrasse la table, c’est presque l’heure du couvre-feu.
Des tirs éclatent soudain.
- « Cela n’a pas dû se passer très loin d’ici » énonce faiblement Hind.
L’angoisse envahit les lieux, les cœurs haletants se froissent. Un bruit de pas sourds au bout de la rue puis une ombre émane brusquement de la pénombre, arrive péniblement jusqu’au parking de l’immeuble. Un râle puissant s’élève :
- « Ils l’ont eu ! à moi, à l’aide ! ils nous ont tiré dessus, salopards de francs-tireurs ! je l’ai laissé par terre… »
- « C’est la voix de Malkoun. Malkoun ! mon chéri ! » hurle sa femme, dégringolant les escaliers.
- « Nassiiim… » sanglote Malkoun, l’épaule blessée ; « je n’ai rien pu faire, je l’ai abandonné mort par terre. Nassiiiim ! salopards ! salopards ! saloperie de bougies. Tout est de ma faute, ma faute à moi ! le gosse est mort à cause de moi ».
Les femmes s’assemblent autour d’Oum Nassim. Elle frappe, les yeux révulsés, sa poitrine. Elle frappe fort de ses poings fermés. Les femmes la soutiennent. Selwa n’entend plus rien. Elle se souvient surtout d’Abou Nassim, d’Aboulias et de son fils Elias sortant de l’immeuble en courant, se fondant dans l’obscurité. Elle a dans la tête un point incandescent, un caillou dur avec plus rien autour. Il lui suffit de bouger un peu la tête pour le sentir rouler lourdement.
* * *
Pendant bien des années, Selwa a porté ce caillou en elle et à ses mains deux os longs et lisses et blancs. Des immeubles hauts et laids, une fumante usine, ont poussé depuis dans la vallée, mais la petite rivière roucoule encore. Fraîcheur nocturne de mai, Place des Martyrs : Selwa sourit au public.
- « Combien y a-t-il de temps d’un grain de peau à un grain de terre ? quelle idée Selwa ! » s’était exclamé Nassim. « Attends, je crois savoir : quinze…quinze jours peut-être… »
- « Pourquoi quinze ? »
- « Comme ça…parce qu’il a fallu quinze jours, après le nuage atomique, pour que Hiroshima se recouvre des plus belles fleurs ».
Selwa prend place, se penche sur son violoncelle. Les sons qu’elle égrène coulent jusqu’à la mer, brodent autour de Beyrouth une robe de menthe sauvage et de fleurs d’oranger. Lorsqu’elle finit de jouer, les applaudissements éclatent. Selwa tremble un peu en saluant. Selwa sourit encore. Il lui semble, du bout des lèvres, confusément retrouver une olive noire en sa saveur étrange.R.B
-
Rentrée littéraire Bis
Après le raz-de-marée de septembre, on surfe en eaux plus claires…
Devenue monstrueuse (plus de 600 romans en automne dernier), la rentrée littéraire française d’automne, dopée par la course aux prix littéraires, devient de plus en plus contre-productive. Dommageable aux nouveaux venus (combien de premiers romans morts-nés par noyade ?), le tsunami l’est aussi à nombre d’excellents auteurs qui, naguère, tenaient absolument à « sortir » en septembre. Or, depuis quelques années, avec le Salon du Livre de Paris (des 13-18 mars prochains) en point de mire, de plus en plus de « ténors » de la scène éditoriale française, francophones et étrangers confondus, se réjouissent plutôt de paraître en janvier. A preuve cette année : les nouveaux romans de trois Philippe à succès (Djian, Sollers et Besson), entre autres fleurons du meilleur « linge » littéraire, avec deux substantiels romans de Jean Rouaud (La femme promise) et Richard Millet (La confession négative, tous deux chez Gallimard ), les nouveaux romans d’Olivier Adam, (chronique d’un quotidien familial meurtri intitulée Des vents contraires, à L’Olivier), d’Alain Mabanckou (en crescendo dynamique avec Black Bazar) et de Chloé Delaume( Dans ma maison sous terre), tous deux au Seuil, de Jean Rolin (Un chien mort après lui, chez P.O.L.) ou de nos deux compatriotes Pascale Kramer (L’implacable brutalité du réveil, au Mercure de France) et de Nicolas Pages (I Love New York, chez Flammarion), notamment.
La nouvelle donne est également prometteuse au rayon des traductions, avec ce qu’on dit le plus beau roman de John Burnside, déjà remarqué l’an dernier, avec Un mensonge sur mon père (Métailié), le premier livre de Jonathan Coe en première personne féminine (La pluie avant qu’elle tombe, chez Gallimard), et une suite de digressions de Paul Auster sur l’écriture et la solitude avec Seul dans le noir (chez Actes Sud). Enfin une rumeur élogieuse annonce le retour d’une des découvertes de Sabine Wespieser, la Vietnamienne Duong Thu Hong, avec Au zénith toujours, après l’admirable Terre des oublis qui est aujourd’hui traduit dans le monde entier.
 Sollers
Sollerstel quel
Un roman-de-Sollers fait désormais figure de genre littéraire en soi, avec un narrateur qui n’est autre que l’auteur, entouré de jolies personnes qu’il honore de ses caresses et de son savoir. Après Une Vie divine, la suite de l’évangile selon Nietzsche se décline au fil d’un voyage à travers les lieux et les œuvres géniales échappant au «Parasiste », dont le point de départ est un stand de tir du Quartier latin, pour une guerre chic. Comme Sollers est un immense lecteur et un homme de goût, c’est souvent passionnant. L’écriture, fluide et fruitée, est souvent à la fête aussi. Et le roman là-dedans ? Disons que le roman-de-Sollers est une sorte d’essai voyageur…
Philippe Sollers. Les voyageurs du temps. Gallimard, 243p.
 Besson
Bessonhomophile
Le dernier roman de Philippe Besson évoque, en finesse, la relation fraternelle intense de deux jeunes Américains de Natchez que tout unit depuis leur enfance, et qui vont évoluer différemment au tournant des sixties, entre révolution des mœurs et guerre du Vietnam. Si l’auteur de Son frère ne manque pas de suggérer certaine sensualité dans la relation de Thomas le contestataire et de son ami plus conventionnel, c’est dans la relation mimétique avec leur commune amie Claire que tout va basculer, jusqu’à la tragédie. Avec beaucoup de sensibilité, restituant bien le ton de l’époque, le romancier change de cieux tout en restant fidèle à lui-même.
Philippe Besson. La trahison de Thomas Spencer. Julliard, 270p.
 Dantzig
Dantzigpour inventaire
Quand on lui demandait quel livre il emporterait sur la fameuse île déserte, Jean Cocteau répondait : le dictionnaire.
Un amateur de lecture y ajoutera volontiers le déjà fameux Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, qui a raflé trois prix importants et se retrouve ces jours en poche, et l’ Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, nouvelle somme extravagante dont le titre doit figurer impérativement en tête de toute prochaine liste d’achats de livres. De quoi s’agit-il ? De listes, précisément, sous la forme d’une fabuleuse énonciation du monde, où l’auteur (comme le Pérec du mémorable Je me souviens) va bien au-delà d’un procédé, tout au déploiement des mots et des noms, des catégories et de leurs projections au ciel de la fiction ou de la poésie arborescente. Liste gracile des moments gracieux. Liste des minorités. Liste de la bonté des hommes. Liste aléatoire du succès. Liste de brèves définitions. Liste de ce que je n’ai pas voulu faire : autant de souples tremplins vers le désir, les regrets, les curiosités infinies, les fruits du génie humain, la beauté, la bêtise, autant de fusées lyriques ou de pointes critiques, autant d’esquisses de poèmes, de nouvelles, de romans, de règlements, autant de retouches à un autoportrait du dandy en causeur stellaire.
Charles Dantzig. Encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Grasset, 789p.
 Djian noir
Djian noirsur noir
Un sentiment de complète déréliction se dégage de la lecture d’Impardonnables, seizième roman de Philippe Djian confirmant décidément les qualités de cet «enfant du siècle» devenu «auteur culte», selon la formule marketing, qui n’en fait pas pour autant un écrivain à célébrer les yeux fermés non plus qu’à dédaigner. Philippe Djian, comme un Michel Houellebecq, quoique par des chemins différents, a su capter le ton d’une époque et filtrer les sentiments ou les malaises d’une génération, dès ses premiers romans du début des années 1980 (Bleu comme l’enfer, Zone érogène ou 37°2 le matin), avant de développer une observation plus ample et plus aiguë de ce qui dissocie le groupe humain contemporain, société ou famille. A cet égard, des romans tels que Sotos (1993), Assassins (1994, Criminels (1996) ou Sainte-Bob (1998) et Impuretés (2005), ont fondé un véritable univers romanesque, avec une atmosphère qu’on pourrait dire «chaleureusement glaciale» dont les personnages souffrent sans pouvoir l’exprimer, et contribuent parfois à leur propre noyade et à celle de leur entourage, où les enfants sont voués à « trinquer ».
C’est d’ailleurs ce qui se passe dans Impardonnables, qui accumule toutes les poisses et toutes les crasses. Le protagoniste, romancier à succès vieillissant, dont la femme et l’une des filles ont été brûlées vives dans sa voiture, sous ses yeux et ceux de son autre fille Alice, apprend au début du roman que celle-ci, actrice en vue et à frasques, a disparu, laissant bien désemparé son compagnon un peu paumé, ex-junkie que la charge de leurs deux petites jumelles embête plutôt – d’où son recours au grand-père. Or ce « jeune vieillard », en exil doré au pays basque, ne s’intéresse « plus du tout » aux enfants, suffisamment occupé de lui-même, que sa nouvelle femme Judith, brillant dans l’immobilier, délaisse de plus en plus, au point de le faire recourir à une ancienne amie devenue détective, dont le fils sorti de prison débarquera dans sa vie comme l’ange exterminateur.
Ange minable en réalité, fils de nul et qui pleure comme un enfant son chien broyé par la mer. Tous les personnages d’ Impardonnables ont d’ailleurs quelque chose de « broyé », à tout le moins de perdu. Cet égarement plombe toute apparence d’espoir, à la fin de ce roman qui n’en est que plus « humain, trop humain »…
Philippe Djian. Impardonnables. Gallimard, 232p.
Post scriptum: à noter, à propos du livre du dandy Dantzig, qu'une belle, amicale non moins que lucide approche en est faite sur le blog épatant de Frédéric Ferney, Le Bateau Livre, dont j'avais signalé l'apparition il y a quelque temps. Conversation ininterrompue d'un honnête homme avec les livres et les gens: http://fredericferney.typepad.fr/
Image ci-dessus: peinture de Verlinde.
-
Le grand cristallier

Maurice Chappaz, l'un des plus grands écrivains romands, est mort à 92 ans.
« C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, à Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. Or ce cristal est resté le même dès le premier texte publié (en 1939) du jeune poète, Un homme qui vivait couché sur un banc, jusqu’à ses derniers écrits de nonagénaire encore vif d’esprit et de plume. La meilleure preuve en est l’étincelant recueil de pages de son journal (années 2003-2004, réécrit en 2007-2008) publié en novembre 2008 sous le titre de La Pipe qui prie et fume. «Je mordille dans l’au-delà » y écrit-il, et cela encore: «Il faut accepter un absolu où l’on meurt. Je ne puis y songer qu’en disant le fameux Merci à l’instant qui me sera donné ».
Toute l’œuvre de Maurice Chappaz, qu’on pourrait situer dans un Valais «tibétain » et un temps qui serait à la fois celui des Géorgiques de Virgile et du voyant Rimbaud, est aussi bien de la même eau, qu’elle se module en vers libres ou qu’elle se décline en chroniques, en récits épiques (dont le fameux Match Valais-Judée), nomades ou polémiques, et jusque dans son saisissant Evangile selon Judas, paru en 2001 chez Gallimard et passé quasiment inaperçu de la critique française.
S’il y avait du bohème et de l’errant en Chappaz, qui s’est heurté violemment à la volonté du père, notable valaisan, pour obéir à sa vocation, lui-même connut cependant les responsabilités d’une charge de famille après son mariage avec S. Corinna Bille, en 1947, avec laquelle il eut trois enfants. L’expérience de la guerre, sa participation à la construction du barrage de la Grande-Dixence, et le travail sur les domaines vignerons de la famille, constitueront, avec maintes virées proches et autres grands voyages, autant d’expériences formatrices ou lucratives qui distinguent nettement son mode de vie de celui d’un homme de lettres, d’un professeur ou d’un journaliste, même si le poète écrivit lui aussi de nombreuses chroniques pour assurer la matérielle. Mais là encore, le combat de Maurice Chappaz s’inscrit dans l’ensemble d’une vision du monde marqué au sceau de la poésie. En dépit de son titre provocateur, le pamphlet qui a valu au poète haines privées et injures publiques, Les maquereaux des cimes blanches, est un poème autant qu’une attaque frontale des affairistes immobiliers et autres marchands du temple valaisan.
 « J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète en colère, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ».
« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète en colère, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ».
L’œuvre de Maurice Chappaz, dans sa double nature lyrique et prophétique, ne saurait être séparée de la tradition biblique et de la foi catholique, comme l’a montré Christophe Carraud dans le premier essai substantiel consacré, en France, à l’écrivain. Cela étant, loin des tourments de conscience de l’âme romande, à dominante protestante, le catholicisme de Chappaz et sa poésie sont tissés de sensualité et de saveur.
Bien enracinée dans sa terre d’origine et faisant écho aux préoccupations de notre temps, non sans résistance farouche, l’œuvre de Chappaz nous transporte à la fois autour du monde et hors du temps, ou plus exactement au cœur de ce noyau temporel que figure l’instant « éternisé » de la poésie.
Pour Lire Maurice Chappaz
Un Homme qui vivait couché sur un banc, [Revue Suisse romande], 1939. Castella, Albeuve, 1988.
Testament du Haut Rhône, Rencontre, Lausanne, 1953 et 1966. Fata Morgana, 2003.
Portrait des Valaisans en légende et en vérité, L’Aire, 1983.
Les Maquereaux des cimes blanches, Galland, Vevey, 1976. Zoé, Genève, 1984, 1994.
Maurice Chappaz, pages choisies. L’Age d’Homme, Poche Suisse, 1988
Le Garçon qui croyait au paradis, L’Aire, 1995.
Evangile selon Judas. Gallimard, 2001.
La pipe qui prie et fume. Editions Conférence, 2008.De nombreux recueils de Maurice Chappaz ont été réédités chez Fata Morgana.
Cet hommage a paru dans l'édition de 24Heures du 16 janvier 2009.
-
Dans l'amitié d'Alain Gerber
 Eloge d'un grand méconnu, romancier et poète jazzy...
Eloge d'un grand méconnu, romancier et poète jazzy...
Alain Gerber était, à trente ans, à la parution de son premier livre, La couleur orange, le type du doux oiseau de jeunesse de province (il est né à Belfort en 1943), du genre fou de Jarry et de jazz, de cinéma et de romans américains (auxquels, avec deux trois compères, l’avait initié son prof de lycée Henri Baudin), qui rêvait de devenir si possible Hemingway et distillait déjà, avec un lyrisme bluesy, la mélancolie des anges terriens conscients qu’il battront tant un jour de l’aile qu’ils ne s’en relèveront plus.
Un peu moins de trente ans plus tard et avec quarante livres jonchant son sillon de grand laboureur, dans un bar parisien proche de Radio-France où tous les soirs il raconte le roman du jazz, notre ami Alain (une amitié nourrie par ces coups de coeur successifs que nous valurent Le Buffet de la gare en 1976, Le Faubourg des coups-de-triques en 1979, les inoubliables nouvelles des Jours de vin et de roses en 1982, puis distraite et distendue comme souvent par «la vie», relancée avec le très beau quatuor de la cinquantaine que fut Quatre saisons à Venise, en 1996, et ravivée plus encore par le sentiment profond de stoïcisme fraternel qui se dégage de son dernier roman) paraît à vrai dire plus frais et libre qu’à l’époque où l’exténuait la course aux prix littéraires.
L’auteur du Plaisir des sens (1977) et de La porte d’oubli (1993) eût certes mérité plusieurs fois le Goncourt, mais il ne saurait pourtant être dit un maudit (l’ensemble de son oeuvre lui a valu le Grand Prix du roman de la Ville de Paris, entre autres distinctions), même si le public lui est plus fidèle que la critique établie, qui le snobe plutôt. A sa façon de sanglier des Vosges, avec sa chère moitié dédicataire de tous ses livres, il a fait sa vie à l’écart des estrades et des cénacles, souriant aujourd’hui de «tout ça» et se réjouissant surtout d’écrire enfin avec plaisir.
«Pendant des années, j’ai travaillé dans la peine et le labeur, mais j’étais convaincu que c’était le prix à payer. J’ai mis beaucoup de temps à me trouver en harmonie avec ce que j’écrivais. C’est peut-être avec ce dernier roman, où j’ai vraiment dit exactement ce que je voulais, que le bonheur d’écrire m’est venu. A présent, il faudrait presque m’arracher de ma chaise, même si je travaille toujours beaucoup dans la masse. C’est vrai que je suis un cheval de labours et qui ne se retourne pas... Je n’ai pas du tout l’impression d’avoir fait «une oeuvre». A l’origine, je crois que je je n’aurais jamais écrit si je ne m’étais pas mis dans la peau d’un écrivain américain behaviouriste. Non, sans Hemingway, je n’aurais jamais écrit. C’était un peu contre mon naturel, qui était plus «lucide» et plus porté aux idées. Je ne suis pas poète, mais ce qui m’a quand même intéressé dans le roman, c’est de faire dire aux mots ce que les mots ne son pas capables de dire. C’est d’ailleurs la définition qu’on donne de la musique...»
De la musique, il en ruisselle dans l’oeuvre d’Alain Gerber, et pas seulement quand il brosse ses «portraits en jazz» ou lorsqu’il se glisse carrément dans la peau de Lester Young, de Clifford Brown ou, tout récement, de Bill Evans. Or, à propos de ces livres apparemment distincts de ses fictions, Alain Gerber se défend d’avoir composé des biographies.
«En racontant Lester Young ou Bill Evans, je ne fais en somme que me raconter d’une autre façon. Avec Bill Evans, plus précisément, c’est un retour à ma source «philosophique». Par ailleurs, le milieu du jazz est celui que je fréquente de la manière la plus proche et constante, depuis des années, et en même temps celui que je comprends le moins. Je vois ces gens vivre et se défoncer, je ne vis absolument pas leur vie de dingues, mais j’essaie néanmoins de les rejoindre en écrivant. De la même façon, je fais de la batterie depuis plus de quarante ans, et je ne suis toujours pas fichu de jouer. Jouer de la musique est un truc tellement mystérieux, au sens le plus fort, presque au sens religieux... Or, je me dis souvent que si j’en avais le secret, j’aurais le secret de beaucoup d’autres choses.
Ce même introuvable «secret» se trouve, en somme, au coeur de Jours de brume sur les hauts plateaux, dernier roman d’Alain Gerber que d’aucuns, un peu trop vite, auront classé dans la postérité du Désert des Tartares, sous prétexte que l’histoire se passe dans une garnison «oubliée» de l’Histoire, en pleine brume cochinchinoise.
«Après en avoir écrit une quarantaine de pages sans penser du tout à Buzzati, je me suis dit tout à coup qu’on allait me tomber dessus avec cette comparaison, et j’ai donc laissé ce texte de côté, que j’ai repris des années plus tard pour l’achever en trois semaines. Quant à son vrai déclencheur, c’est plutôt du côté de La 317e section qu’il faut le chercher. Ce film m’avait bouleversé à l’époque, et quelque chose en reste évidemment dans le rapport liant les deux officiers.»
Le thème de la filiation, qu’Alain Gerber lui-même dit présent dans tous ses livres, fonde la relation initiatique établie entre le commandant vieillissant et son jeune second impatient de prouver sa valeur, qu’un adjudant baroudeur va éprouver plus physiquement de son côté. Très «physique» aussi bien, ce roman à tournure de conte philosophique baigne dans un climat de fantasmagorie où les données bien terrestres de l’action, de la force, de l’élan guerrier, du désir sexuel, se mêlent, dans ce no man’s land, à celles du vieillissement, de la faiblesse, de la conscience de plus en plus aiguë de la vanité de toutes choses.
«La première de toutes mes révoltes, explique encore Alain Gerber, je l’ai éprouvée dans ma toute petite enfance, lorsque je me suis rendu compte que nous devrions mourir. Cette énormité m’est apparue: que les gens qui m’entouraient seraient morts lorsque j’aurais leur âge. Plus tard j’ai choisi, comme ma femme, et même avant que nous nous rencontrions, de ne pas avoir d’enfant. L’idée de savoir, à mes côtés, une pendule vivante qui me rappellerait tous les jours que devrais mourir m’était insupportable. C’est peut-être pour m’en «excuser», d’une façon inconsciente, que je reviens sans cesse à ce thème de la filiation... Je ne sais pas, pas plus que je ne sais pourquoi j’écris... J’ai besoin, toujours, de sentir le trousseau dans ma main, mais je ne sais pas quelles portes mes clefs vont ouvrir...»
Alain Gerber. Jours de brumes sur les hauts plateaux. Fayard, 167p.
Alain Gerber. Bill Evans. préface de Pierre Bouteiller. Fayard, 360p.Alain Gerber a publié, récemment un nouveau roman-jazz consacré à Frank Sinatra, chez Fayard.
-
Orlando ou le sexe d'un ange

Au Théâtre de Vidy, la magie de Virgina Woolf opère en finesse.
Orlando fut un homme jusqu’à trente ans, puis il s’endormit et se réveilla femme. Orlando fut un jeune homme entreprenant à la prestigieuse époque élisabéthaine, puis, jeune femme, il quitta le monde entre les deux guerres mondiales du XXe siècle. Orlando est l’impossible fait Anglais, ou plus précisément : poésie anglaise, entre magie shakespearienne, baroque pré-romantique à la Tristram Shandy (protagoniste du chef-d’œuvre de Laurence Sterne) et lyrisme à la fois intime et cosmique de Virginia Woolf. Orlando est à la fois une farce et une traversée émouvante du temps des siècles et des cœurs. Paru en 1928, ce roman-poème génial (lire encadré) ne semble pas a priori un objet littéraire fait pour le théâtre, tant il foisonne. Et pourtant, après une adaptation de Bob Wilson, avec Isabelle Huppert, qui n’a pas laissé un immortel souvenir à Vidy, une jeune troupe israélienne, emmenée par le metteur en scène Amit Drori, relève à son tour le défi pour en tirer une représentation à la fois originale et fidèle à l’esprit autant qu’à la lettre du texte, heureusement donné en anglais avec un surtitrage français intelligible. La représentation qui en résulte, tenant de la «performance» plasticienne plus que du théâtre ordinaire, en impose autant par l’orchestration de ses beautés que par sa « musique » intérieure en crescendo, après un début quelque peu maniéré et flageolant.
Rien de « magique » là-dedans au demeurant, mais un impressionnant artisanat collectif , réglé par une équipe de «techniciens» maîtrisant les apports combinés de la scénographie et des appareils (Noam Dover et Amit Drori), autant que de la lumière et des images vidéo très évocatrices (Jackie Shemesh). Dans cet environnement visuel et sonore figurant alternativement les fastes orientaux de Constantinople ou les brouillards de Londres, Orlando, qui est à la fois son propre biographe et le personnage de cette épopée lyrique, est incarné à fleur de sensibilité par la comédienne androgyne Sylwia Trzesniowska-Drori, qui se coule gracieusement dans les avatars successifs de son personnage. « Tout » Orlando n’est certes pas là, mais ce qui y est filtre bel et bien l’essentiel…
Lausanne. Théâtre de Vidy, Salle de répétition, jusqu’au 1er février. Lu—sa, à 19h.30. Di 18 janvier et lu, relâche. Di 25 janvier et 1er février, 18h.30. Réservations : 021 619 45 45, www.vidy.ch et librairie Payot.
Un charme shakespearien
Virginia Woolf doutait un peu, à la fin de la composition d’Orlando, liée à son amoureuse amitié avec Vita Sackwille West, du bien-fondé d’un texte « trop long pour une farce et trop frivole pour un livre sérieux », pronostiquant un désastre éditorial à l’époque même où elle prononçait des conférences sur le concept d’androgynie. « Peut-être, disait-elle alors, un esprit exclusivement masculin est-il aussi incapable de créer qu’un esprit exclusivement féminin ». Le public la rassura aussitôt, qui fit fête à ce récit pénétrant et débridé, qui garde aujourd’hui toute sa poésie et tout son mordant satirique, notamment à propos de ce vieux radoteur annonçant, à l’époque de Shakespeare, la fin de toute littérature…
Virginia Woolf. Orlando. Livre de poche Biblio, 317p. -
À la Dame de Haute Savoie
A La Désirade, ce samedi 10 janvier 2009. - Nous vivons en face les uns des autres, sans bien nous connaître. Les plus anciens se rappellent les Savoyardes traversant le lac afin de participer aux travaux des vignes. Sur le premier bateau du matin, il leur arrivait de faire le voyage avec quelque comtesse russe ruinée dans la nuit au Casino d'Evian. Pour ma part, j'aime retrouver la douce France dans les rues de Thonon ou les vieux murs d'Yvoire. À la Savoyarde en exil qui a déposé ce soir quelques mots sur ce blog, je dédie ces quelques images de ce que, tous les jours, nous voyons, depuis notre val des hauts de Blonay, de son beau pays...

-
Pensées de l'aube (1)
De la joie. - Il y a en moi une joie que rien ne peut altérer : telle est ma vérité première et dernière, ma lumière dans les ténèbres. C’est dans cette pensée, qui est plutôt un sentiment, une sensation diffuse et précise à la fois, que je me réveille tous les matins.
De l’Un. – Ma conviction profonde est qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’une seule Vérité, mais que cela n’exclut pas tous les dieux et toutes les vérités : que cela les inclut.
Du noir. – Plus vient l’âge et plus noir est le noir d’avant l’aube, comme un état rejoignant l’avant et l’après, à la fois accablant et vrai, mais d’une vérité noire et sans fond qui reprend bientôt forme tandis qu’un sol se forme et qu’un corps se forme, et des odeurs viennent, et des saveurs, et la joie renaît - et cet afflux de nouveaux projets.Image: La Savoie, l'hiver. Aquarelle JLK.
-
Ce sorcier de Salem

Merveille de fantaisie énigmatique, de profonde malice et de douleur sublimée que Trois hommes dans la nuit.
« L’aiguille des boussoles enfantines pique et blesse », écrit Gilbert Salem dans son dernier roman, d’abord touffu comme une pelote d’étoiles lançant mille feux, et qui se désentortille au fur et à mesure de la lecture tout en demandant, au lecteur, une attention de chaque instant et un effort de dinguerie participative. De fait, Trois hommes dans la nuit n’est pas un roman aussi immédiatement accessible que Trois Hommes dans un bateau, de l’irrésistible Jerome K. Jerome, ni aussi débonnaire que Trois Hommes dans une Talbot, du charmant Paul Budry. On ne sait pas très bien, au fil des premiers chapitres, où l’on va, mais on y va. On y rencontre d’abord une insupportable millionaire protestante cul-bénit, en la personne de Clarisse Lebief-Guingue (de la fabrique de papier Papirama délocalisée dans le monde entier), flanquée d’un majordome au nom bizarre de Donat Jovié, qui se dégonfle soudain comme une baudruche pour se trouver réduit à l’état de petit anneau de caoutchouc mauve. L’ambiance est donc illico à l’insolite frotté de sortilèges, mais c’est, plutôt que dans le merveilleux ou le fantastique prisé des têtes blondes, dans les eaux du réalisme magique que va se déployer la narration, aussi pauvre en « action » apparente que mille pages de Proust ou de Joyce. Un formidable brassage de mémoire doit pas mal, d’ailleurs, au génie filtré et recyclé de ces deux titans, dont Gilbert Salem est un (humble) disciple à deux titres majeurs : son rapport mélancolique au Temps et aux Noms proustiens, et , côté Joyce, sa sensualité poétique et mystique de sourcier d’une langue « totale », laquelle se déploie en moires de haute lice et en polyphonies tour à tour somptueuses ou détonantes voire délirantes - des éructations du capitaine Haddock aux vaticinations des prophètes, en passant par trois voix d’hommes et une voix de femme, le chant des anges et le boucan alterné d’un flipper des années 70 et d’un groupe de rock prog…
Les enfants perdus
Trois hommes : trois hyperdoués de naissance, et une femme, qui devient géniale à son tour par le triple exercice de la musique, du tissage à la lyonnaise et de l’invention d’un Christ peu clérical : tels sont les protagonistes du roman, dont les portraits, extraordinairement détaillés et cohérents, se constituent au fil du roman. Les trois lascars, quadras, se sont connus à l’internat catholique de l’Effeuille, ados géniaux et teigneux, au début des années 70. Il y a là le Provençal Jean-Baptiste Contine, géant empêtré dans son corps, aux cils d’enfant et à l’âme inquiète ; le minuscule Celte Simon Bouffarin vif comme un elfe et «catholosof» facétieux; et son ami Vladimir Sérafimovitch, alias Volodia, dandy cynique résolument athée et d’une beauté méphistophélique. Tous trois ont été conviés à une réception par Alma Lebief-Dach, belle-fille de Clarisse, en ce Noël 2002, dont la nuit du 26 au 27 accueillera leur triple immense errance - le récit oscillant entre leurs débats présents et leurs ébats d’adolescents « feuillantins». Quant à Alma, Lithuanienne d’origine et devenue théologienne luthérienne à Strasbourg après une initiation au tissage chez les soyeux de Lyon, elle sera présente-absente tout au long du roman, inspirant à l’auteur ses pages les plus lumineuses.
Et Dieu là-dedans ? Il est partout et nulle part, dans une sorte d’omniprésence poétique qui doit autant aux bouffons de Shakespeare qu’aux princes ambigus de la collection Signe de Piste, à la foi toute pure d’un enfant ou de Bach qu’à la théologie érudite. Dans la foulée, au fil de magnifiques évocations lyonnaises, on se rappelle que Les Deux étendards de Lucien Rebatet, grand débat romanesque entre christianisme et athéisme, se déroulait précisément à Lyon, mais l’exploration de Gilbert Salem - donnant mystérieusement raison (ou presque) à chacun – s’enracine dans une sorte de christianisme enchanté, triste et radieux à la fois comme l’enfance, défiant en somme la fameuse sentence d’Alfred Loisy : « Le Christ annonçait le Royaume, et c’est l’Eglise qui est venue », citée en exergue.
Or le plus étonnant, dans ce roman qu’on pourrait imaginer « élitiste » et « passéiste », voire obsolète par sa thématique, est son ébouriffante fraîcheur, son inventivité verbale et son scannage des derniers états du monde dit virtuel, autant dire sa déroutante modernité. Bonne nouvelle : la divine Littérature n’a pas déserté tout à fait son royaume, où nous ramène ce sorcier de Salem.
 Gilbert Salem. Trois hommes dans la nuit. Campiche, 592p.
Gilbert Salem. Trois hommes dans la nuit. Campiche, 592p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 10 décembre.
Portrait de Gilbert Salem: Philippe Pache -
Par-dessus les murs
Correspondance entre Pascal Janovjak (Palestine) et JLK (Suisse).
Nous entreprenons ici, avec Pascal Janovjak, entre Ramallah et La Désirade, un échange épistolaire au jour le jour où les lecteurs de ce blog nous feront l’amitié de voir d’abord un jeu, peut-être plus si affinités et développements.
Je n’ai jamais rencontré Pascal Janovjak, dont je sais très peu, sinon qu’il est né à Bâle en 1975 et qu’il vit depuis trois ans à Ramallah. Du moins avais-je déjà apprécié son talent de prosateur poète, que j’ai évoqué une première fois, trop brièvement, à la parution de son premier livre, intitulé Coléoptères et paru aux éditions Samizdat. Tout récemment, son seul prénom a reparu sur les commentaires de ce blog, sans que je ne fasse le rapport avec le Pascal de Ramallah, et c’est hier seulement qu’un vrai contact s’est établi entre nous à la suite de la présentation que j’ai faite de quelques auteurs israéliens invités au Salon du livre de Paris.
Quatre premières lettres en un seul jour: ainsi le fil s’est-il noué à partir de ces mots que j’adressai à Pascal à propos d’un message vindicatif reçu sur ce blog à la seule évocation d’Israël: comment répondre aux mots de la haine, comment ne pas monter aux extrêmes, comment montrer la ressemblance humaine, comment la dire, comment la transmettre ?
 Ramallah, le 11 mars 2008, 13h.19.
Ramallah, le 11 mars 2008, 13h.19.
Cher JLK,
Cela fait quelques temps que je me pose ces mêmes questions : comment dépasser la haine, comment montrer les ressemblances… depuis que je suis arrivé à Ramallah, il y a bientôt trois ans. Je suis venu ici pour écrire un roman, que j'achève bientôt. J'y suis venu parce que j'avais déjà séjourné dans la région, le climat est agréable, les gens sympathiques, j'aime les brochettes et la purée de pois chiche... et ma compagne a trouvé un travail ici, ce qui m'a permis de quitter le mien.
Je me suis mis au boulot. J'aurais pu habiter dans un monastère, sur une île, j'ai tenté de nier l'extérieur, j'y ai réussi, jusqu'à un certain point. Et puis les coups de feu, et les incursions, la violence, la peur aussi... ça traverse les portes et les fenêtres et les écrans des téléviseurs, ça suinte sur internet, pas moyen d'y échapper. Sortez boire un verre pour vous changer les idées : tout le monde ici a perdu un proche, inévitablement on vous parlera de la mort, de l'humiliation quotidienne – à laquelle les étrangers n'échappent pas toujours. La situation s'est immiscée jusque dans mon roman, et le conflit l'a détruit de l'intérieur - il s'est appuyé sur d'autres conflits aussi, c'était inévitable, il s'agissait d'une réécriture du Frankenstein de Shelley. Je ne désespère pas de ressusciter le monstre mais je suis passé à autre chose.
Sans doute faut-il commencer par accepter la haine, admettre que face à la blessure il n'y ait aucune alternative immédiate. L'homme ne s'élève pas facilement au-dessus de l'animal, surtout quand l'animal est blessé. Il aboie et il mord, vous n'allez pas essayer de le caresser. On ne peut pas en attendre autre chose. Ce serait nier sa blessure, pire, le frapper davantage. Il faut constater, témoigner, écrire, parler. C'est pour cela que si le boycottage d'un salon littéraire est absurde en soi, j'estime que le débat qui entoure ce salon est nécessaire. La maladresse des organisateurs, des boycotteurs et surtout celle des médias en ont fait un débat stupide, tant pis – si les mots sont creux, il est salutaire qu'il y ait au moins du bruit. Ce ne sera jamais que le faible écho des cris et des bombes, larguées d'avion ou portées en ceinture. Rien n'est plus insupportable que le silence, que la normalisation d'une situation qui, contrairement aux hommes qui en sont victimes, n'est pas normale.
Ensuite il faudra trouver d'autres mots. Pour lutter contre la durée, la lassante répétition de l'atroce. Des mots qui ne soient pas usés par le journalisme. J'ai relu ici la trilogie d'Agota Kristof, le Grand Cahier etc. Misère, j'aurais dû m'abstenir. Ca résonne encore plus ici, ça fait encore plus mal. Ce qui est admirable, dans cette oeuvre, c'est l'absence de repères spatiaux et politiques. Le pays d'ici, le pays d'en face, la frontière, on la passe, on ne la passe pas, on ne sait pas où on est - mais on y est, et les deux pieds dedans.
Il faut faire ce que fait toute littérature : tirer vers l'humain, vers l'universel. Se méfier comme de la peste de l'éthéré et de l'abstrait, mais tirer vers le haut, au-dessus des murs. A cette hauteur-là, on aura - sans même le vouloir - dépassé les camps et leurs rhétoriques éculées.
La Palestine a trouvé sa place dans mon nouveau roman. Elle ne l'a pas prise, je lui ai donnée, c'est important. Elle est loin d'avoir le premier rôle, mais elle ne fait pas non plus de la figuration. Je vous ferai lire, si vous voulez bien, dans un mois ou deux. Bien à vous, Pascal.
La Désirade, ce mercredi 11 mars, 15h.
Cher Pascal,
Je viens de lire votre lettre, je relève les yeux sur les montagnes enneigées d'en face, Gidon Kremer joue un quartet pour cordes de Schubert et j'essaie de vous imaginer, là-bas à Ramallah, votre compagne et vous. Aussitôt je revois ces maisons explosées des hauts de Dubrovnik, en mai 1993, à la frontière serbe où m'avaient entraînés deux reporter allemands; je revois quelques enfants égarés dans les ruines et cette tête coupée de sanglier que des combattants croates avaient clouée contre la paroi d'une maison serbe incendiée - la première fois que j'ai flairé l'odeur de la guerre...
Que vous soyez à Ramallah parce que vous en aimez le climat, les brochettes et la purée de pois chiche, est déjà un début de roman. Ce que vous m'écrivez, ensuite, de ce que vous vivez, votre projet de Frankenstein rattrapé par la réalité, la réalité environnante que vous découvrez et celle qu'évoquent les médias, ensuite le Grand Cahier que vous relisez - tout cela aussi me paraît la substance même que nous avons à brasser en quête de ce qu'on pourrait dire "le vrai", dont La Vérité n'est probablement qu'un autre masque.
Je m'en vais voir, dès ce jeudi à Paris, dans quelles circonstances se déroule cette présentation des écrivains israéliens au Salon du Livre, dont je ne sais trop que penser pour ma part. Vous aurez compris, sans doute, que je ne suis partisan d'aucun camp. Simplement, je vous dirai mes impressions et tâcherai de rencontrer quelques-uns des auteurs présents.
Ce qu'attendant je vais descendre en ville où j'ai rendez-vous, tout à l'heure, avec un redoutable rebouteux censé me délivrer d'une vraie calamité de crampe dorsale. Meilleures pensées à votre moitié et mes amitiés du premier jour...
PS. Seriez-vous d'accord d'échanger avec moi, sur mon blog, des lettres semi-fictives à l'image des ces deux vraies ? Sans mêler du tout vie privée et publique, ce pourrait être une façon de parler des thèmes qui nous intéressent et du temps qu'il fait. Je manque terriblement, pour ma part, de vrais correspondants. Mais si cette façon de s'exposer vous fait violence, je comprendrais évidemment que nous nous bornions à une correspondance réservée. Je me rappelle pourtant ce livre étonnant qui s'intitulait quelque chose comme Conversation d'un coin à l'autre de la chambre, reproduisant les épistoles de deux écrivains russes de l'autre siècle... Amitiés. JLs.
 Ramallah, le 11 mars, 21h.33
Ramallah, le 11 mars, 21h.33Cher JLK,
C'est avec grand plaisir que je me prête au jeu, les missives précédentes, présentes et futures incluses, à utiliser quand comment et où bon vous semblera. La correspondance sera d'autant plus originale que la poste régulière s'arrête elle aussi aux check-points... Je me rappelle un colis, adressé à un quidam expatrié. L'envoyeur avait naïvement indiqué Ramallah. Le colis est bien arrivé, mais avec plus d'un an de retard. Le courrier électronique est donc un bon choix, on ouvre sans doute nos lettres aussi, mais au moins elles passent les murs.
Notre correspondance en tout cas me changera de celle que j'entretiens avec la Sécurité Sociale française… Le sujet en est un litige qui m'oppose à ladite institution, celle-ci m'ayant effacé de ses fichiers, long séjour à l'étranger oblige. La lutte épistolaire m'oppose d'abord à Madame Bourgat, directrice du service contentieux, Mademoiselle Loiseau ensuite, département des indemnités, et enfin Monsieur Mouchu, sous-secrétaire au service contentieux (il n'est que sous-secrétaire, parce que j'ai dû recommencer toute la procédure suite à la démission inopinée de Mademoiselle Loiseau). Je pense en faire un recueil, il plaira, j'en suis persuadé, les mots sont enlevés, le style vif, les rebondissements nombreux. L'éditeur me suggère toutefois de réduire le tout à 400 pages, et de ne pas y inclure mes réclamations au sujet de la nouvelle machine à laver que ma mère - bref, ceci pour dire que les lettres d'un écrivain sont toujours semi-fictives, comme vous le suggérez, nous avons une grosse propension au mensonge, et les mots nous sont trop importants pour qu'on puisse les signer les yeux fermés et en toute naïveté... Peut-on attendre quelque chose d'authentique, de la part d'un écrivain ? Lui qui doit toujours polir ses phrases, les parfaire, les atténuer ou les exagérer ?
Votre description de tête de sanglier en tout cas fait froid dans le dos. J'avais lu quelque part que la violence en ex-Yougoslavie ne s'expliquait que par la quantité de slivovic que les combattants ingurgitaient. C'est peut-être vrai. On ne trouve pas de slivovic ici, ni de têtes de sanglier – mais c'est peut-être parce que le cochon est banni, en Israël comme en Palestine. Le conflit est moins violent, c'est un fait. C'est un « conflit de basse intensité », c'est le terme technique, c'est joli, c'est comme le courant de basse intensité, ça pique un peu les vaches, dans les champs, ça suffit à les tenir à l'écart. Les écrivains que vous rencontrerez jeudi auront des mots plus justes, j'attends avec impatience le récit de votre ballade au salon, je l'aurais volontiers faite en votre compagnie.
En attendant, toutes mes salutations à votre rebouteux, vous m'en direz des nouvelles. Moi c'est l'épaule qui coince, satanée souris d'ordinateur. Je pourrais aller me faire masser au hammam, mais on vous y casse un bras pour un oui ou pour un non, c'est embêtant. Salutations distinguées à votre épouse, et mes amitiés du premier soir… Pascal.

La Désirade, ce 11 mars 2008, 23h.
Cher Pascal,
Le sieur Robertino m'a presque cassé, comme cela arrive dans les hammams, tout en me reboutant, au point que je suis entré chez lui la tête fichée dans les épaules, et que j'en suis ressorti la faisant tourner comme un gyrophare. Le personnage est à peindre, autant que son antre. Cela se trouve sous-gare, à Lausanne-City, dans une rue évoquant un canyon, et l'on entre en passant sous une arche avant de se retrouver dans un trois-pièces fleurant la vieille bourre aux murs couverts de centaines de fanions d'équipes de foot et de trophées de toutes sortes, entre cent photos de bateaux et d'enfants (le maître de céans doit être grand-père à la puissance multi) et d'oiseaux et de lointains à vahinés.
Lorsque vous arrivez, vous prenez place dans une salle d'attente évoquant une gare de province, et là vous entendez les premiers cris sourds, assortis parfois de hurlements, qui indiquent la progression des soins prodigués à ceux qui vous précèdent. A vrai dire je m'attendais au pire, et ce fut donc à reculons que j'entrai dans la salle de torture de ce tout petit homme tout en muscles et en uniforme chamarré de soigneur (il l’a été dans diverses équipes fameuses), mais tout s'est finalement bien passé. Sans un mot, après m'avoir interrogé sur la nature du mal, Robertino m'a fait m'asseoir sur une chaise bien droite derrière laquelle il s'est tenu bien droit. En quelques mouvements puissants, il m'a alors retroussé les tendons et les muscles et les os et la peau de mon épaule droite, faisant rouler et se tordre le tout comme une corde et, des pouces ensuite, faisant sauter un noeud après l'autre; après quoi, même traitement à l'épaule gauche. Or curieusement, mon bourreau semblait plus éprouvé que moi par ce début de traitement. Ensuite, de te prendre un bras après l'autre et de te les secouer comme de grosses lianes, pour en arracher Dieu sait quoi, avant le finale: les pouces cloués dans les clavicules, puis quatre torsions aux os des articulations des bras, comme s'il voulait te mettre les mains derrière et les coudes et les épaules à l'envers. Et pour finir: merci: l'homme vous salue comme un maître de karaté stylé et vous vous fendez de dix ou vingt modestes francs, à votre choix, qu’il serre aussitôt dans un modeste tiroir. Or un ostéopathe diplômé m'aurait pris vingt fois plus et je ne serai pas en état, ce soir, de vous pianoter ces quelques mots.
Ah les aventures de Madame Bourgat, de l'oiselle Loiseau et de Monsieur Mouchu du contentieux: je guette déjà l'A suivre, vous m'avez affriolé: on voit que le monde est partout pareil, mais à présent racontez encore. Je me réjouis déjà, demain, de retourner à Ramallah. Votre ami du premier jour. JLS.Ces quatre lettres marquent le début d'un échange épistolaire qui en compte aujourd'hui 136. Il a scellé une amitié qui s'est incarnée en été 2008, avec la visite de Pascal et de sa compagne, Serena, sur les hauteurs de Montreux, en Suisse romande, où se trouve La Désirade.
-
A celui qui, à celle qui, à ceux qui...

À Sophie et Julie et leurs Jules / à Philip et Philippe et Filou et mon doux Phil de verre et ses anges gardiennes / à tous les K et aux F et aux L de La Casona / à notre chère BA / à Luna qui vient de naître et à ses jeunes vieux / à Michèle et Aurial / à Niki et sa bande de voyous et de voyelles / à Jean-Michel et Corine et Sarah et la chtite dernière / à Dimitri / à Marius Daniel et à ses belles / à Pascal et Serena / à noss deux Hélène et à Léo / alla Professorella ed al Gentiuluomo ed a Thea ed ai sette gatti con sei code / a Fabio Ciaralli nel carcere di Marina Massa / à Nicolas et Battuta et Jalel / à François et sa tribu tourangelle / à Jean-François du Feuilly / à René et son Annemarie / à D et à D / à Christiane de Saint-Ouen / aux ondines Soulef et Oceania / aux ondins Heurtebise et Matthieu de Berlin / à Fred au cheval bleu / à Bertrand en Polska / à Mirek de Brno / à Gilles-Marie au miel de fiel / à Alina et son auréole de papier / à Jacqueline et son Antonin et leurs Félix et Lou / à Jean et son Isabelle / à Eric le curieux / à Myriam / à Sarah du Théâtre au bord de l'eau / à René qui est rené de son crabe /à Rodrigue / à Nathalie et Frédéric et leur Anatole / à Maya / à Alain et à Marie-Joséphine / à l'autre Alain du Sud-Est et à sa compagne / à David le boxeur et à son club / à l'autre Alain du Sud-Est profond / à Bill Adelman / à Marie de Tahiti et à Marie sur Loire / à l'Anne-Marie et sa copine Anne / à Frère Maximilien-Marie / à Alain et son dragon / à Clopine / à Raymond et son vieux Paul / à Bona des Couleurs / à Pascal / à Bruno / à Nadia du Canada / à Bernard et sa Joëlle / à Denis et sa Mireille et à Mireille et son Jean-Marc / à Fabien et ses pinceaux / à Pascal et Gilbert revenus de l'enfer / aux camés et aux pédés et aux gens ordinaires ou extraordinaires / à Maritou et Pierre et Yvan nos voisins d'alpage / à Maria et à Damien des îles / aux commères et compères de 24Heures sur 24 / au gang de la rubrique culturelle et à Michel qui va nous manquer durant son trip californien / à Louis-Philippe et Sylvie en nos Lectures croisées / à Claude et à Sylviane et à Karine mes libraires préférés / à Pascale de L'Implacable brutalité du réveil / à Charles le bon génie de Comme il vous plaira / à tous les autres souriants ou fulminants / à Jacques des insomnies / à Etienne et Alain de la Ligne de coeur / à ceux qui crèvent la faim et à ceux qui croûtent / aux Méchants et aux Gentils, très bel et bon An 9.
Papier découpé: Lucienne
-
Dantec genre road story
Un roman qui se la joue polar paramystique genre Sailor et Lula de SF: Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute.
Cela commence par un braquage dans une vieille poste de la région parisienne et la ligne de fuite de la narration suit la cavale d’un couple « speedé », porteur d’un neurovirus dangereux qui a cela de particulier de rendre plus «performant». Lui, fils de gauchiste rejetant son paternel, informaticien de formation et se rêvant flic-mercenaire, s’est retrouvé braqueur avec Karen, journaliste lausannoise (!) issue d'une famille de Tchèques victimes du nazisme-et-du-communisme et fan du saxophoniste déjanté Albert Ayler, massacré en 1970 à New York. La motivation finale de ce couple d’enfer semble de se retirer sur une île lointaine. Un cliché de plus. Et même fastidieux si l’on compte les paragraphes consacrés aux ruses des protagonsites pour échapper à leurs poursuivants et planquer leur butin. Quelques épisodes violents relanceront l’intérêt du lecteur friand d’arts martiaux divers, mais c’est sur un autre plan qu’on retrouve (un peu) Dantec, même s’il n’a plus l’air d’y croire tellement lui-même.
Le « plan » en question recoupe, on s’en doute, les composantes spatio-temporelles de la réalité, les interférences entre matière et musique, science et mystique. Au passage, on aura appris que le neurovirus, dit de Schiron-Aldiss, déclenche «une appréhension nouvelle des phénomènes quantiques, probabilistes et relativistes». Sic. Et dans la foulée, Dantec nous rappelle les travaux de l’anthropologue Jeremy Narby sur le serpent cosmique, grâce auxquels nous savons désormais comment le chaman qui est en nous peut connecter son ADN personnel à la grande hélice cosmique...
Quant à l’angéologie version Dantec, elle joue ici sur quelques motifs narratifs resucés, avec la mission révélée à Karen, via les «états augmentés» du neurovirus, de sortir Albert Ayler de ses limbes pour le réintégrer dans sa «forme infinie». En quelque sorte : le salut par le saxo et l’intercession féminine. Albert lui-même, avec son instrument, est chargé de sauver l’équipage de la station Mir en train de se crasher. Mais rien ne se fera sans le couple «élu». Trop sérieux s'abstenir... Or, comme il s'agit de faire un peu sérieux quand même, il est précisé que le braqueur camé qui nous a embarqués a lu quelques livres édifiants durant sa période d’isolement médico-sécuritaire: un peu de Jung-Freud-Reich, mais aussi de l’ethnologie aborigène, la Bible et le Pères de l’Eglise en multipack.
Ainsi cette bédé pour ados «augmentés» débouche-t-elle finalement sur cette révélation: La Révélation, justement, autrement dit l’Apocalypse, vers laquelle on se dirige à pas chaloupés dans les «blue suede shoes» d’Elvis sur lesquels il est recommandé de ne pas marcher, sinon gare à la tatane - destination finale : Armageddon…
Maurice G. Dantec. Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute. Albin Michel, 210p. En librairie le 8 janvier 2009.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 30 décembre 2008.
-
Cette flamme

Cette flamme qui brûle au fond des êtres est belle et pure. Ce n'est pas une déflagration qui calcine. C'est une action obstinée et réfléchie, une combustion continue. C'est la force de l'irréductible.
C'est une flamme qu'on ne remarque pas tout d'abord, parce qu'on est souvent distrait par toutes les étincelles et tous les éclats qui tourbillonnent sans cesse : la brillance, le luxe, miroirs partout tendus, phares aveuglants braqués sur les yeux, grandes plages de couleur, de blancheur.
Mais lorsque tout devient gris de fatigue et d'usure, lorsque la plupart des êtres se sont éteints et se sont effacés, alors on remarque cette lueur étrange qui brille par endroits, comme des feux de braise. Quelle est cette lueur? Que veut-elle? Est-ce le désir? Le plus simple désir alors, la force de la vie, la force de la vérité.
Ceux qui refusent les mensonges, ceux qui ne sont pas compromis dans les affaires louches du monde, ceux qui ne se sont pas avilis, qui n'ont pas été vaincus, ceux qui ont continué à vibrer quand tous les autres se sont endormis : la lumière n'a pas quitté leurs yeux. Elle continue à sortir de leur peau, de leur âme, la lumière pure qui ne cherche pas à vaincre ou à détruire.
La lumière pour cette seule action : voir, aimer.
Je cherche ceux et celles qui brûlent. Ce sont les seuls immortels.
J.M.G Le Clézio(Cité par Océania, alias Danielle D. en courriel amical, ce matin, par manière de voeux. Bonne vie à elle, et à tous réitérés, pour l'An 9)
Image: Philip Seelen
-
L'enfant mystérieux

Avec Arnaud Rykner dans le silence blanc. Reading Rando (5)
«Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe », écrit Jacques Audiberti, et c’est sans cesser de penser à un été désert, silencieux et blanc, au fond des chambres duquel on entendrait de cristallines voix d’enfants, que je marchais cet après-midi limpide en me remémorant les premières pages d’Enfants perdus, cinquième livre d’Arnaud Rykner dont l’image de couverture, signée Bernard Faucon, et la même limpidité des phrases développent une lente et lancinante rêverie dont le protagoniste muet est un garçon qui se sent muer, au sens profond du terme, comme si son corps donnait naissance à un autre corps confusément ressenti comme inhabitable, vers une vie pressentie invivable.
 D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque.
D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque.
Le silence de la neige et le silence de la mer sont comparables par le sentiment d’infini qu’ils dégagent, mais c’est par une cabane dans un arbre que, marchant le long de la forêt, m’ont surpris tant de souvenirs au moment où il est question, dans le roman d’une cabane toute semblable, où le garçon secret a établi son royaume que nul ne lui dispute d’ailleurs: « L’arbre, il le connaît bien. C’est le sien, celui où il habite quand il sent qu’il ne peut plus habiter en bas, avec eux, les autres ». Le silence de la neige, plus que celui de la mer, sauf à l’aube immobile, creuse une sorte de temps songeur dans le temps, et c’est précisément « loin de l’année » que les enfants se retrouvent pour jouer : jouer aux aveugles dans le brouillard d’une entrée maritime, jouer à la mort pour voir comment c’est, jouer à la guerre le temps de lancer quelques pétards, joués à être perdus en s’impatientant, S.O.S. venez-me-délivrer, que des sauveteurs surviennent.
 Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac.
Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac.
Rien ici de la suavité factice d’une enfance idéalisée autour du mythe de l’innocence, mais le récit d’une sorte de fatal arrachement à la vie de l’enfant mystérieux, évoque par Ruysbroeck l’Admirable et qui m’a rappelé, dans le jour déclinant, ces mots de Juan Carlos Onetti : « Je me déplaçais parmi des corps et des voix sans perturber le chemin qu’ils s’étaient imposés, tenaces involontairement, oublieux de l’heure de leur mort et ignorant en outre que le temps n’existe pas. Mais je le savais, moi, depuis l’enfance, et je protégeais mon secret comme une maladie »…
Or le garçon d’Enfants perdus ne pourra jamais dire «depuis l’enfance», puisqu’il choisit de faire exister le temps en s'immolant – et je voyais là-bas, sur la neige, comme une tache de sang bientôt évaporée…
Arnaud Rykner. Enfants perdus. Le Rouergue, coll. la brune, 92p. Disponible en librairie dès janvier 2009.
Images: Philip Seelen.
-
Ce que PEUR veut dire
Avec François Bon en partage. Reading Rando (4)
Les verticale des anciennes pluies, scrutées de derrière la vitre dans l’impatience de nos enfances, avant de partir loin, relaient dans Peur les verticales des cordes urbaines entre lesquelles zigzaguent un saxo tâtonnant et un violon titubant, et quel rapport avec les verticales de roc et de glace ?
Je dirai : paysage mental, murs de New York ou de l’Aiguille du Fou, souvenir des villes, paysages où transi d’angoisse on lève la tête dans le matin glacial, Manhattan ou l’Aiguille du Trident – ma seule PEUR panique un matin de roche rouge et de glace il y a juste vingt ans avec mon ami R. fracassé vingt jours après au Mont Dolent -, et voici :
Que je repars ce matin avant l’aube, par grand beau se levant, avec Peur de François Bon et de ses musiciens au walkman, prêt à gravir ce couloir d’effroi, un pas sur l’autre, entre les hauts piliers comme de gratte-ciels – On avait traversé des villes sans personne -, et la neige glacée crisse comme les instruments de Peur, mais les crampons s’accrochent comme les tampons aux parois de verre des villes de fer et de béton :
On progresse, le couloir est à la fois paroi trouée de fenêtres comme les buildings hallucinés de Buzzati, et cela:
Quand on ferme les yeux pour souffler, les verticales basculent et voici les ravines bleutées devenues allées de cimetière - Tu marchais dans la maison des Morts -, tout devient Labyrinthe aux yeux fermés un instant, tes morts te pèsent et te soupèsent puis tu entends une voix pure, peut-être le jeune poète de Rilke – Nous manquons d’invocations sorcières –, enfin tes yeux clairs se rouvrent et retrouvent les horizons de plus en plus larges à mesure que tu montes vers le ciel grand ouvert, la PEUR aiguise les marches mais de la surmonter te sort de l’impasse et de là-haut tu vois mieux ce qui te manque et qui te manque, à qui tu manques – Et comment on est venu on sait pas, et où tu vas t’en sais rien ? – mais de moins en moins de PEUR tout en haut du couloir d’angoisse, à monter on surmonte la PEUR, et voici :
 L’arête atteinte, l’équilibre entre deux vertiges, étroite rue où danser – Là-bas murs et seringues, voilà pour manger, trajets tracés, tous les bruits du monde -, ici l’ouvert par delà l’obscur et l’indistinct :
L’arête atteinte, l’équilibre entre deux vertiges, étroite rue où danser – Là-bas murs et seringues, voilà pour manger, trajets tracés, tous les bruits du monde -, ici l’ouvert par delà l’obscur et l’indistinct :Vaincue la PEUR à l’instant, dis-tu, au jour partagé, songeant à eux, mais qui t'attendent demain là-bas - l'angoisse et l'effroi retrouvés tôt l'aube…
Cette divagation de rando suit les séquences lues (François Bon en diseur d’extrême sensibilité) de Peur, sur ses textes (cités ici en italiques) et des compositions de Dominique Pifarély (au violon, sur de magnifiques variations), avec François Corneloup (sax baryton), Eric Groleau (batterie) et Thierry Balasse (électro-acoustique).
Peur. 1 CD chez Poros éditions, 2008.
Le texte intégral de Peur peut se télécharger sur internet : http//www.publie.net/peur/
Image: peinture de Buzzati ainsi légendée: Quando la grande montagna all'improvviso diventa la nostra vita, la nostra città, la nostra vecchia casa, l'antica nostra tomba.
-
Harold Pinter le résistant
Le Prix Nobel de littérature 2005 avait consacré le plus grand dramaturge anglais vivant, dont le théâtre est marqué par u n rire panique. Pinter vient de nous tirer sa dernière révérence.
n rire panique. Pinter vient de nous tirer sa dernière révérence.
C’est un écrivain de théâtre et un personnage public unanimement respecté, en dépit de ses légendaires coups de gueule, qui fut consacré par l’Académie de Stockholm en la personne du dramaturge anglais Harold Pinter. Après le choix controversé de l’Autrichienne Elfriede Jelinek qui avait provoqué la démission bruyante d’un des leurs, les académiciens suédois ont soigné leur crédibilité en consacrant une œuvre théâtrale à la fois novatrice et mondialement reconnue, dont l’exigence éthique de l’auteur s’est également manifestée sans relâche sur le devant de la scène publique. Encore marqué par les stigmates d’une chimiothérapie, Sir Harold prit en effet la parole à Hyde Park, en février 2003, lors de la manifestation monstre contre la participation de l’Angleterre à l’intervention en Irak, déclarant par ailleurs dans un entretien : « Je craindrais fort, si je me tenais en face de Tony Blair, de lui cracher dans l’oeil ». Cela pour le style du personnage, qui a exorcisé son cancer en composant des poèmes empreints de la même rage… Mais Pinter, citoyen non aligné qui fut objecteur de conscience à dix-huit ans, et dramaturge aux thèmes explicitement politiques dans les années 80, est également un artiste accompli et l’inventeur d’une sorte d’infra-langage (ce qui se dit sous les mots, derrière les silences ou dans les formules les plus creuses en apparence) caractérisant ses « comédies de menace ».
D’abord comédien sous le nom de David Daron, ce fils de tailleur juif vit sa première pièce montée en 1957, et c’est en 1960 que le succès lui vint avec Le gardien, Suivi par La collection (1961) et Le retour (1965), notamment. Depuis lors, Le gardien a fait le tour du monde. Par ailleurs, les cinéphiles se rappellent les trois films de Joseph Losey dont Pinter composa les scénarios : The Servant, Accident et Le messager. Pour le même Losey, Pinter conçut également une adaptation d’ A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui ne fut jamais tournée mais que Gallimard a publiée l’an dernier sous le titre Le Scénario Proust, parallèlement à l’édition conjointe de la première (La chambre) et de la dernière (Célébration) de ses pièces, séparées par quatre décennies mais restituant leur époque (la dèche matérielle et morale d’après 45, et le cynisme des yuppies d’aujourd’hui) avec la même acuité, le « vieux » Pinter étant peut-être plus radical que jamais quant à l’économie du langage.
Souvent apparenté au théâtre de l’absurde, Harold Pinter apparaît plutôt, aujourd’hui, comme l’inventeur subtilement réaliste (saisissant aussi bien l’absurde de péripéties réelles) d’une dramaturgie tragi-comique déterminée par les conditions de la vie actuelle, où se trouve accentuée la terrible solitude de l’individu tendant « délibérément à esquiver la communication », selon les propres termes de l’écrivain. Moins porté au lyrisme métaphysique qu’un Samuel Beckett, et moins ouvertement violent qu’un Edward Bond, Pinter fait figure de résistant aussi sensible à la condition humaine qu’il paraît mal embouché. « Je ne cherche certainement pas l’universalité », conclut-il ainsi à sa façon : j’ai assez à faire pour écrire une foutue pièce »… -
Lectures de Rando (1)

Par les hauteurs avec Philippe Sollers et Charles Dantzig
Rousseau disait quelque part que « seul celui qui marche est apte au réel », et cela vaut même en montagne et même avec des raquettes et deux livres dans son sac en peau de chamois, sur la neige encore bien portante de la matinée.
Or donc me voici reparti, pour une première mise en jambes que je m’étais promis d’assortir de deux arrêts, selon le principe de la Lecture de rando que j’inaugure par la même occasion Il faisait ce matin un temps à lire le nouveau Sollers, intitulé Les Voyageurs du temps et dont les cinquante premières pages s’inscrivent dans le droit fil d'Une vie divine, avec un narrateur qui ne se distingue de l’auteur que par un faufil de fiction (et encore) pour se concentrer sur des variations littéraires et philosophiques dans une langue fluide et rythmée à la fois. Le zeste de fiction nous transporte initialement dans un stand de tir parisien, tout près de son bureau de la NRF, où son chemin croise une agréable Viva, garde du corps aux divers sens du terme.
J’avais fait un quart d’heure de raquettes, depuis le Parking des Lynx, lorsque je me suis trouvé face à une pancarte ordonnant, en cas d’avalanche,de prendre le chemin du bas. L’état des pentes me semblant plus mollissant que menaçant, j’ai pris le chemin des hauts jusqu’à un promontoire où j’ai repris ma lecture.
 Dans les cent premières pages des Voyageurs du temps, Sollers parle de son corps, comme d’une espèce de double n’en faisant parfois qu’à sa tête (de nœud), puis il consacre de belles pages à l’antagonisme de la Bête (on dira pour faire court : le génie) et du Parasite, avant de bifurquer vers les irréguliers, de Kafka et Nietzsche à Rimbaud et Lautréamont via T.E. Lawrence. Dans la foulée, le roman s’est déjà transformé en soliloque tissé de phrases fringantes, mais c’est le moment de reprendre la rando.
Dans les cent premières pages des Voyageurs du temps, Sollers parle de son corps, comme d’une espèce de double n’en faisant parfois qu’à sa tête (de nœud), puis il consacre de belles pages à l’antagonisme de la Bête (on dira pour faire court : le génie) et du Parasite, avant de bifurquer vers les irréguliers, de Kafka et Nietzsche à Rimbaud et Lautréamont via T.E. Lawrence. Dans la foulée, le roman s’est déjà transformé en soliloque tissé de phrases fringantes, mais c’est le moment de reprendre la rando.
 L’air est cristallin comme une page du grand Paon, l’azur cingle et le lac là-bas, immense fleuve immobile dans sa gaze de soie bleutée, a l'air de penser comme le dieu danse (mauvaise influence de Zarathoustra...) et comme Dantzig fait ses listes en dents de scie.
L’air est cristallin comme une page du grand Paon, l’azur cingle et le lac là-bas, immense fleuve immobile dans sa gaze de soie bleutée, a l'air de penser comme le dieu danse (mauvaise influence de Zarathoustra...) et comme Dantzig fait ses listes en dents de scie.
J’ai naguère accablé les lecteurs de ce blog de citations des milles pages du Dictionnaire égoïste de la littérature française, paru en 2006. Je vais remettre ça avec les 700 pages de l’ Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, somme de listes dont la première (liste des cadeaux à réclamer au père Noël) devrait inclure le titre de ce livre-mulet enfilant perles sur trouvailles, avec des hauts et des bas certes, mais c'est le propre du livre où grappiller une foison d’observations-sensations-émotions que le lecteur prolonge avec les siennes propres.
Listes des lieux, des villes, des « caressants ailleurs », Listes du beau & du chic ou du corps & du sexe, Listes des femmes comme on en voudrait dans sa famille ou des chansons de variétés tragiques, et cent et mille autres qui font de ce seul livre une épatante lecture de rando. J'y reviendrai plus souvent qu'à mon tour...
Philipe Sollers, Les voyageurs du temps. Gallimard, 243p.
Charles Dantzig. Encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Grasset, 790p.
Les deux ouvrages seront en librairie en janvier 2009. -
Dimitri quinze ans après
Sur une alliance indestructible. Postface à la réédition de Personne déplacée, en Poche Suisse.
Lorsque Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse, m’a demandé, à l’automne 2007, quel livre j’aurais à cœur de voir figurer au sommaire de ce panorama référentiel de la littérature helvétique, l’idée de lui proposer la réédition de Personne déplacée m’est venue tout naturellement, tant il me semblait souhaitable qu’un nouveau public, aujourd’hui et demain, découvre ce livre qui fait date, je crois, dans l’histoire de l’édition et de la littérature romandes, et bien au-delà.
La vie de Dimitri, et ce qu’on peut dire l’œuvre de Dimitri, auxquelles se confondent pour ainsi dire l’histoire et la vie de L’Age d’Homme, relèvent en effet d’une aventure qui dépasse les tribulations d’un individu particulier ou les anecdotes de la chronique littéraire. Comme aura pu le constater le lecteur de ces pages, une sorte d’aura poétique nimbe la parole même de Dimitri, comme d’un personnage de légende, et celle-ci relève de la littérature au sens le plus large, autant que de la vie de tous.
Dans l’exemplaire de Personne déplacée que Dimitri m’a dédicacé au soir du 8 novembre 1986, jour de la saint Dimitri, notre ami m’écrivait notamment « Mon père portait sa main de sa poitrine vers moi et me disait faiblement : veliki savez (grande alliance). Je vous le renvoie ».
Cette « grande alliance » signifie une filiation qui ne se manifeste pas que par le sang. On peut la concevoir en termes religieux, par la notion de « communion des saints » chère aux catholiques. Dans le sillage de Baudelaire, Georges Haldas parle de « société des êtres ». En ce qui concerne mes liens avec Dimitri et avec L’Age d’Homme, dont je me suis tenu éloigné pendant quinze ans, je la rapporte à ce lien indestructible, aussi indestructible à mes yeux que l’amitié vraie, qui court entre les âmes et les livres et constitue cette chaîne de questions et de réponses, de vœux et d’aveux, de culture et de civilisation que décrit John Cowper Powys dans ses Plaisirs de la littérature, traduits par Gérard Joulié à L’Age d’Homme. « Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, écrit encore John Cowper Powys, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables, mais il ne pourra jamais « voir Dieu », il ne pourra jamais vivre dans un présent qui est le fils du passé et le père de l’avenir sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature ».
En relisant Personne déplacée, je me suis demandé si ce livre serait encore possible aujourd’hui sous cette forme, et force m’a été de constater que non. J’ai relevé, dans mon préambule, que je partageais et contresignais, pour l’essentiel, les positions de mon interlocuteur, dans une sorte de symbiose. J’ajoutais ceci : « Question politique, je crois sa réflexion toute bonne, dont on découvrira d’ailleurs les fondements, liés plutôt à la métaphysique qu’aux certitudes partisanes ». Or les années qui ont suivi la publication de Personne déplacée ont marqué, pour Dimitri, le passage de la réflexion « platonique » à un engagement personnel obéissant bel et bien aux « certitudes partisanes ». Par la décision de son directeur, qui n’a pas disjoint son travail d’éditeur littéraire d’une activité militante à caractère politique, à l’enseigne de l’Institut serbe, L’Age d’Homme s’est trouvé impliqué dans une mêlée qui lui a valu bien des avanies. Or Dimitri a-t-il eu raison, lui qui m’expliquait, au fil de nos conversations, que la particularité des auteurs de L’Age d’Homme était de se trouver tous «à côté» de telle ou telle cause ou conviction ? N’aurait-il pas fait mieux de se tenir «à côté» de la cause serbe au lieu de la servir au premier rang ? Le lecteur se rappellera le chapitre Petite tête serbe avant de lui jeter la pierre…
J’ai raconté jour après jour, dans mes carnets de L’Ambassade du papillon (1993-1999), ce qui m’a progressivement éloigné de Dimitri, non sans un constant sentiment de déchirement. Dès le début des années 1990, l’impression de replonger dans Le Temps du mal, grand roman de guerre où Dobritsa Tchossitch décrit l’empoisonnement mental qu’a constitué la politique dans la société yougoslave, entre nazisme et communisme, avec cette espèce de passion furieuse qu’il dit le propre de sa nation - ce sentiment de croissante intoxication a fait que j’ai commencé de me sentir étranger auprès du plus cher de mes amis, dont les vitupérations se multipliaient tous azimuts. J’ai tenté de parler avec Dimitri, vainement, je lui ai écrits maintes lettres, toutes restées sans réponse : je ne lui en veux pas le moins du monde. Ma position d’ami très proche, et en même temps de journaliste dans un grand quotidien, ne facilitait pas non plus nos rapports. Ayant défendu la cause serbe tant que je le pouvais, il m’est apparu à un moment donné, après que le président Dobritsa Tchossitch (auteur de L’Age d’Homme) eut été écarté par Milosevic, que défendre Milosevic, et demain Karadzic, par seule fidélité à Dimitri, m’obligerait à trahir ce que je ressentais au fond de moi. Qui avait raison ? Qui avait tort ? Ce qui est sûr est que je n’aimais plus nos rencontres de plus en plus brèves, et moins encore nos veillées de plus en plus lourdes. Je suis donc parti et ne le regrette pas. Pas un instant je n’estime avoir trahi Dimitri. J’ai souvent repensé à la brouille « à mort » des frères Issakovitch, dans Migrations, cet inoubliable roman de Milos Tsernianski que nous sommes allés présenter en Serbie en compagnie de Dimitri, en 1987. Dans mon exemplaire de Personne déplacée, j’ai conservé comme une relique la photo de Dimitri sur les rives de la Drina, qui a comme on sait « les plus beaux cailloux du monde ». Cher chauvin de petite tête serbe. Cher barbare avéré. Personne déplacée, décidément.
Dimitri ne m’a pas envoyé un mot quand ma mère est décédée. Pas bien. Je n’ai pas envoyé un mot à Dimitri quand j’ai appris son terrible accident. Pas bien non plus. Dimitri ne m’as fait un signe après les livres que je lui ai envoyés le supposant le premier à les devoir aimer. Mauvais point. Je n’ai plus défendu L’Age d’Homme avec la même passion que naguère. Autre mauvais point. Chacun de nous est probablement convaincu que ses griefs pèsent plus que ceux de l’autre, comme il en va de nous tous quand nous jouons les Issakovitch. C’est ainsi, puis un seul geste et tout est oublié : ce geste serait un livre. Le voici.
Lorsque, quinze ans après m’être détourné de lui, je suis allé serrer la main de Dimitri, la joie de son regard, la lumière de son sourire, la reconnaissance qu’il éprouvait à l’idée de rééditer Personne déplacée, m’ont tenu lieu de nouvelle dédicace. Je vous la renvoie…
A La Désirade, ce jeudi 10 avril 2008.Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée - entretiens avec Jean-Louis Kuffer. L'Age d'Homme, coll. Poche suisse.
-
Fulgurances poétiques
L’art suraigu de Pascal Janovjak
C’est avec une prose inouïe que se pointe Pascal Janovjak dans son premier recueil intitulé Coléoptères, une première soixantaine de morceaux, suivis d’une quinzaine d’Elytres. J’entends par prose inouïe: jamais entendue, ni vue, ni lue même si elle rappelle ces prosateurs de l’inquiétante, cosmicomique étrangeté que furent un Henri Michaux ou un Alberto Savinio, pas loin non plus des conteurs minimalistes à la Brautigan ou Edoardo Berti, sans qu’il s’agisse ici d’influences manifestes, plutôt de parenté
Par exemple je cite intégralement Le Train : « Gare. Le train s’en file, porté par les voix des morts. Traverse la très-ancienne plaine avec à bord un caillou noir qui vibre avec le grondement des machines, résonne avec les plaintes des profondeurs.
« Les boiseries laquées du compartiment reflètent les lueurs des lampes, je n’aurais jamais dû accompagner R. dans sa fuite, un noir caillou dans mes doigts, un verre de vin tremblant sur la table.
« De l’horizon déboule le train, passe devant une ancienne cahute de bois et se perd dans la nuit d’en face, disparaît des yeux du chat qui traverse doucement la voie chaude ».
C’est étincelant , plastique en diable, tantôt plutôt sculpté dans la matière verbe et tantôt plutôt flûté les yeux fermés mélancoliquement murmuré ou silencieusement sifflé comme siffle silencieuse la salamandre chauffant au feu doux.
Il y a là-dedans des merveilles, comme l’évocation des cheveux follets d'Emma dans L’orage flaubertien, et j’aime le tout bref Week-end, après le restaurant : « Elle est ressortie nettoyer la vitre arrière, c’est gentil, l’antibuée ne marche plus.
« Et à travers le voile translucide du givre qu’elle gratte, je regarde sa silhouette ondulante se découvrir peu à peu – elle trouve toujours de nouveaux moyens de me séduire »...
Ce sont des « fusées » poétiques qui tiennent du conte-goutte ou de l’haïku au premier regard, mais qui ont un pouvoir de « diffusion » dès qu’à l’image des fleurs de papier proustiennes fameuses on les immerge pour qu’elle s’ouvrent toutes grandes comme les pages d'un possible roman esquissé.
J’y reviendrai. Dans l’immédiat, je note que ce petit livre très remarquable paraît à l’occasion des quinze ans des éditions Samizdat, à Genève, et qu’il est l’œuvre d’un auteur de 32 ans né à Bâle et qui vit aujourd’hui à Ramallah.
On peut vivre à Ramallah et écrire aujourd’hui ceci, sous le titre de La Maison :
« Tu te rappelles ces os que nous avons trouvés dans la forêt Tu disais que c’était un animal, moi j’essayais de te persuader du contraire, jusqu’à ce qu’affolée tu t’enfuies en pleurant. Ensuite tu racontais tout à Maman et j’étais privé de dessert.
« Je suis retourné voir la maison. Il n’en reste plus grand-chose et la mauvaise herbe a tout recouvert ».
 Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.
Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.Pascal nous signale que le poète Jalel El-Gharbi a commenté ces jours son livre sur son blog, Un site de poésie et de lumière intelligente, d'un passeur généreux, à recommander absolument: http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com/