Notes siennoises

Mezzodì a Siena. Me revoici sur mon cher Campo, tout entouré de pigeons jeunes et vieux, les plus décatis faisant peine à voir, voletant et boitillant, arrivant trop tard au festin de la dame qui régale l’engeance et souvent livrés aux mômes tortionnaires.
 Juste avant midi, sur les Bianchi di sopra, il y avait une dense affluence de gens de la ville, des tas de garçons et des tas de filles plus beaux les uns que les autres, se tenant par le bras à deux ou trois et se croisant en s’adressant des œillades. Jamais je n’ai eu cette impression d’une ville qui ait autant l’air de savoir ce qu’elle est et qui ne se le montre qu’à elle-même.
Juste avant midi, sur les Bianchi di sopra, il y avait une dense affluence de gens de la ville, des tas de garçons et des tas de filles plus beaux les uns que les autres, se tenant par le bras à deux ou trois et se croisant en s’adressant des œillades. Jamais je n’ai eu cette impression d’une ville qui ait autant l’air de savoir ce qu’elle est et qui ne se le montre qu’à elle-même.
Et ce soir, de nouveau, c’est l’heure orange. À l’instant on dirait que la lumière émane des pierres du Palazzo Pubblico et des façades qui entourent la place. Toute la ville paraît réunie sur la place pour jouir de cette fin de semaine, mais trois heures plus tard : plus une ombre dans les rues sonores.
 Une fois de plus m’a frappé le ton particulier des Siennois, mélange de race et de morgue, de beauté policée et de naturel provincial. La beauté des femmes y est moins sensuelle qu’à Rome. La femme n’y est pas très grande, elle a l’air sage et plutôt avenant, elle est bien moulée quand elle est jeune et ne semble pas s’épaissir autant que les matrones romaines ou les mégères de plus au sud. Elle a les cheveux satin sombre, ou blond vénitien, un doux arrondi de visage, sans trace de vulgarité, avec des mains potelées et un derrière qu’une jupe plissée assez bourgeoise n’empêche pas d’être là. Visiblement la Siennoise cherche mari en ses murs, voire dans sa contrada. Quant à l’homme, il est volontiers superbe à dix-huit ans, un peu faraud et plus modeste ensuite, portant bientôt le chapeau du Monsieur.
Une fois de plus m’a frappé le ton particulier des Siennois, mélange de race et de morgue, de beauté policée et de naturel provincial. La beauté des femmes y est moins sensuelle qu’à Rome. La femme n’y est pas très grande, elle a l’air sage et plutôt avenant, elle est bien moulée quand elle est jeune et ne semble pas s’épaissir autant que les matrones romaines ou les mégères de plus au sud. Elle a les cheveux satin sombre, ou blond vénitien, un doux arrondi de visage, sans trace de vulgarité, avec des mains potelées et un derrière qu’une jupe plissée assez bourgeoise n’empêche pas d’être là. Visiblement la Siennoise cherche mari en ses murs, voire dans sa contrada. Quant à l’homme, il est volontiers superbe à dix-huit ans, un peu faraud et plus modeste ensuite, portant bientôt le chapeau du Monsieur.
On voit à tout moment les gens en groupes, qui ont l’air de s’aimer entre eux. Beaucoup de sourires, beaucoup de gestes affectueux qui sont de vraies cajoleries. Les garçons se tiennent volontiers bras dessus bras dessous, et les jeunes filles par le cou, avançant dans la rue en lignes, parfois sur toute la largeur de la rue pavée, comme un front joyeux – de fait elles sont gaies et délicieuses, vraiment des amours de jeunes filles.
Ce soir enfin, à la Locanda Diana, j’observe un garçon-cheval qu’aurait aimé filmer Pasolini: un vrai centaure piaffant et montrant ses biceps, ruant sur sa chaise puis hennissant lorsqu’on lui sert son minestrone, follement impatient à l'évidence de s'éclater durant les trois minutes de folie du prochain Palio...

littérature - Page 20
-
L'heure orange
-
Chienne de belle vie
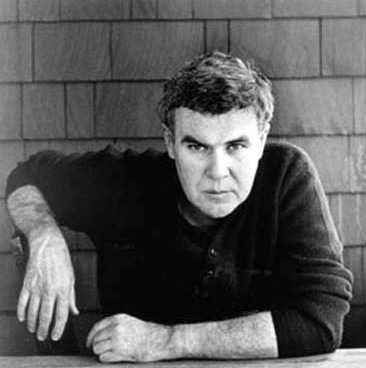
Deux recueils posthumes de Raymond Carver. Et deux nouvelles adaptées au théâtre par Jacques Lassalle, ces jours au Théâtre de Vidy.
«Cette fois, c'est vraiment la fin», écrivait Tess Gallagher à un ami à l'époque où elle préparait la publication de ces cinq nouvelles de Raymond Carver. Ainsi qu'elle le raconte plus en détail dans sa postface, la compagne de «Ray» fut très occupée, après la mort prématurée de l'écrivain (terrassé par un cancer du poumon en 1988), par la supervision de trois recueils posthumes, ajoutée à ses propres travaux (elle est enseignante et poétesse), qui l'empêchèrent de s'occuper d'éventuels inédits de Carver, avant qu'un des responsables de la revue Esquire, Jay Woodruff, ne vienne à sa rescousse pour la préparation de ces cinq nouvelles inédites et plus ou moins achevées - on sait que Carver rédigeait jusqu'à trente versions d'une de ses histoires avant de l'estimer parfaite.
Or, loin de constituer des ébauches, et moins encore des fonds de tiroir, les nouvelles parues en traduction sous le titre de la dernière, Qu'est-ce que vous voulez voir?, sont dignes du meilleur Carver, à quelques détails formels près que les éditeurs ont d'ailleurs eu raison de ne pas gommer. Pour l'essentiel en revanche, touchant à la résonance émotionnelle et à la beauté limpide de ces tranches de vies meurtries, le lecteur retrouvera dans ce livre tout ce qui fait le charme et la profonde poésie de l'auteur des Vitamines du bonheur ou de Parlez-moi d'amour.
La première de ces nouvelles (Appelle si tu as besoin de moi) est à la fois la plus simple et la plus touchante. Un couple, au bord du divorce, loue une maison dans la campagne d'Eureka (sur la côte nord de la Californie) pour tâcher de se retrouver. Or, tout semble aller bien, mais ça ne va quand même pas, jusqu'au moment où l'apparition de deux chevaux blancs, dans le jardin, leur fait revivre ensemble un instant de magie et reparler et se retrouver bel et bien... avant de repartir chacun de son côté. Plus douloureuse, la nouvelle intitulée Rêves relate la mort, dans un incendie, des deux enfants d'une femme dont le mariage s'est effondré, tandis que le thème de l'homme brisé repartant de zéro, fréquent chez Carver (qui l'a vécu lui-même à plusieurs reprises), se trouve magnifiquement traité dans Du bois pour l'hiver.
Tels des contes de la douce déglingue que ses personnages affrontent comme autant d'enfants perdus, les nouvelles de Carver diffusent une tendresse lancinante et jamais démonstrative, comme d'un Tchékhov américain, et, souvent puisée dans la nature, une lumière et une beauté régénératrices.
 Un Tchékhov américain
Un Tchékhov américain
Le titre de la nouvelle Intimité, tirée du beau recueil posthume Les Trois roses jaunes (Rivages poche, 1999) dont la dernière évoque la mort d’Anton Tchékhov, situe exactement le lieu où se déroulent les histoires tendres et déchirantes de Raymond Carver: au cœur du cœur de la vie des gens. Plus exactement : des gens de l’Amérique populaire ou bohème, souvent paumés ou dérivant dans l’alcoolisme, comme l’auteur. Si Carver rend si bien les bleus au cœur de ceux qui s’aiment et se griffent, c’est d’ailleurs qu’il l’a vécu lui-même avec ses deux femmes successives : Maryann la violente, mère de ses enfants dont il divorça, et la poétesse Tess Gallagher qui s’occupa très activement de son œuvre après sa mort, à 50 ans, en 1988. Loin cependant de se borner à un inferno conjugal, le monde de Carver, plein de vitalité et de poésie, se situe très loin des complications psychanalytiques d’un Woody Allen ou d’un Philip Roth. C’est que Carver, de Parlez-moi d’amour aux Vitamines du bonheur ou aux Short cuts adaptés au cinéma par Robert Altman, est plus direct, plus brut et plus lyrique surtout, même si ses « fans » ignorent souvent sa magnifique poésie tissée de ballades où le quotidien se trouve comme enluminé…
Raymond Carver, Les Trois rose jeunes. Rivages Poche, 1999.
Qu'est-ce que vous voulez voir? Traduit de l'anglais par François Lasquin. Postface de Tess Gallagher. L'Olivier, 134 pp.Le grand metteur en scène français Jacques Lassalle présente, ces jours, un spectacle en création à Vidy, intitulé Parlez moi d'amour et fondé sur deux nouvelles de Raymond Carver, Intimité et Le bout des doigts. La Passerelle, du 25 avril au 17 mai.
Infos: http://www.vidy.ch -
Le temps de la vraie lecture
 Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !
Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !
Le sentiment dominant de l’époque est à l’égarement et au désarroi sous l’effet de ce qu’Amin Maalouf appelle Le dérèglement du monde dans son bel essai où il se demande avec lucidité «si notre espèce n’a pas atteint, en quelque sorte, son seuil d’incompétence morale, si elle va encore de l’avant, si elle ne vient pas d’entamer un mouvement de régression qui menace de remettre en cause ce que tant de générations successives s’étaient employées à bâtir».
 Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.
Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.
 Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.
Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.
 Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)
Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)La nouvelle livraison du Passe-Muraille, No77, d'avril 2009, vient de paraître. Commandes: Passemuraille.admin@gmail.com
Le Passe-Muraille est présent Salon du Livre et de la presse de Genève, à Palexpo, du 22 au 26 avril. Rue Kafka, tout au fond de la halle où PERSONNE ne va...
Retrouvez Jalel El Gharbi sur son site: http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com/
-
Les mains pleines d'orage

par Alain Gerber
Elles vous brûlent les doigts
les années couvées dans les nids de mitrailleuses
c‘est un argent facile
que la monnaie de ce temps-là
Les belles années de l’ambition
fauchées au pied des sémaphores
la sueur et l’encre
la brume de craie
l’œil vert de la radio
le chagrin des fées
la peur léthargique du hanneton
dans sa boîte
la perplexité du doryphore
l’écho des voix sous les préaux
un ancien dimanche
en automne
jonché de marrons cirés
dans la buée des candélabres
le goût des robinets
de cuivre
les soirs qui jouent avec les allumettes
Ce sourire gourmé
le sourire du chat
sur le visage d’un cadavre ironique
allongé sous la glace
de l’étang des Forges
où l’on se confie
un pied après l’autre
au balancier de ses bras
un après-midi de Noël
prodigue en illusions concrètes
Les sentiers de mâchefer
la brume brune
le campement dissolu des cabanes à outils
leurs ailes de goudron battant leurs flancs
vermineux
à flanc de colline
les verres épais avec leurs yeux de verre
à ras bord la crasse du temps qui passe
payé rubis sur l’ongle dans les fabriques
la gloriette de guingois
au toit de zinc dépoli
on y respire encore les clafoutis
du temps des cerises
aucunement prophétique
Rester là
ne rien savoir d’aucun avenir pour personne sur la Terre
on voit si bien les montagnes
on pourrait les toucher du doigt
un vol de martinets
l’écho du silence
l’ombre sur le mur quand les gens sont partis
Les troupeaux frileux
les bœufs éberlués
entre les grilles des préfectures
ripant sur le pavé
grimpés sur le trottoir au grand scandale des assassins
armés d’un bâton
buveurs de café bouillu
l’odeur du sang des bêtes
à l’emplacement de futurs cinémas
derrière le brouillard et le pâle
du faubourg des argentés
sur le chemin des Perches
que le vent repousse au fond de ses ornières
un vent de fer et de dimanche raté
loin des désirs absolus
La rue des jeudis héroïques
de sabres et d’arbalètes
traversée par un mur
que couronnent
des tessons d’existence
le haut des plus hautes tombes
les chapeaux noirs des affligés
les plumets noirs des chevaux de corbillard
arborant le monogramme d’un défunt présomptueux
à qui en pénitence
on n’a même pas laissé son alliance et sa montre
sa tabatière son culbutot
et par-dessus la voix du bronze
absente
monocorde
qui ne connaît pas un mort d’un autre
ni celui qu’on regrette
ni celui qui voulut qu’on épinglât
sa médaille sur un coussin violet
(…)
Rue de Châteaudun
dans le jus de lanterne
sourde
où piétine le gros chien boréal
qui garde les saucisses
ébouriffé de fourrure orange
on charrie un fardeau sans poids de grammaires
de sapience
de plumier d’astrolabe
avec un chiffon doux aussi
sans doute quelques bons points
et un cahier couvert de papier bleu
étiqueté à l’anglaise dans un coin
on traverse les fumées charcutières
l’haleine des soupiraux
rosée de toutes les défaites
l’odeur grenue de la pluie de la veille
la poudre des petits matins
crissante comme du sel et
la queue d’un nuage
qui n’a pas fait sa nuit
et couche sur le trottoir
la tête reposant dans les bois de l’Arsot
(…)
Mon père enfile son casque
garnit de vieux journaux
sa veste de cuir
range dans sa serviette
ses crayons sa gomme son stylo
son décamètre
et les plans énigmatiques
de la Reconstruction nationale
sur du papier violet
il réveille avec précaution
sa motocyclette
il fonce vers Champagney Ronchamp Lepuis-Gy
naviguant sur le verglas
dans la purée d’aurore
(…) et parfois il achète un buffet ancien
délogeant une basse-cour
ou un tas de charbon
j’y songeais à ses funérailles
nous étions trois ou quatre
sous les branches nues
sous le ciel déserté
à quelques pas seulement de ses fenêtres
- et donc
tout ce temps
toutes ces années du cristal de l’or vieux et des cendres
tout ce long temps sans prix
tout ce temps compté
il avait pu
contempler à loisir
le décor de son trou…
(…) il n’est de lettres que d’exil
et confiées aux bouteilles
on écrit sur le mur de l’usine
les choses qu’on a perdues
on use son crayon
son rare son tout petit
dressé dans les décombres
la grosse affaire des vagabonds
et c’est toujours
merde à celui qui le lira
car personne ne lit plus
justement
les jours passent
plus ou moins
dans la cohue du portillon
l’air du temps
change de propriétaire mais
la vente continue durant les travaux
la braderie aux prix sacrifiés
où tout doit disparaître
et le reste est détruit
un beau matin
les temps avaient changé
si elles avaient pu se voir nos vies nos villes
ne se seraient pas reconnues
depuis des mois et des semaines
je ne dormais plus tranquille
pourtant je n’ai rien suspecté
l’enfrance s’est lassée de nos mauvais traitements
elle a déménagé à la cloche de bois
en oubliant de m’emporter
Bournazel n’est plus là pour personne
j’ai rangé
toute ma famille sous les arbres
des promesses de l’ancien régime
rien ne s’est accompli
sinon ce qu’on a pu
bricoler soi-même
c’est-à-dire un amour et aussi
une gaieté passagère
qui fut sainte et féroce
il y a bien longtemps
pieds nus sur les tommettes de titane
à tâtons je fais mon sac dans la cuisine obscure
des gamelles melles-melles
des bidons dons-dons
on est lundi matin d’une autre galaxie
la semaine sera longue
vivement dimanche !
des gamelles des gamelles des bidons
Envoi
Les graveurs de vent
les graves célibataires de leur propre créance
au lexique équivoque
aux gestes somnambules
aux maigres fournitures
aux barques trop fragiles
précaires gardiens des écuelles
se marient une année
sont quand même pendus l’autre
aux espagnolettes
de l’hôtel Algonquin
ayant renié leurs fraîches phrases d’avril
lovées dans les violoncelles
disposées en travers
des tickets de rationnement
leurs cous s’allongent pour voir
par-dessus la rampe
le côté du mur
qui n’en eut jamais aucun
mars 2008
(Ces séquences sont extraites d'un vaste poème intitulé Enfrance, encore inédit. Elles constituent l'ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille, d'avril 2009, No77, qui vient de paraître, incluant un entretien avec Alain Gerber et un aperçu de son oeuvre romanesque.)
-
Le roman qui refait le monde ailleurs
 ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER
ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBERAlain Gerber est un écrivain fluvial. À poser quelques questions à un romancier fluvial, on s’expose à recevoir de fluviales réponses, dont voici le partiel delta…
- Vers quel ailleurs votre écriture est-elle repartie ce matin ?
— Il n’y a plus de pays qui m’attire. Ils se sont banalisés et standardisés en même temps que leurs trop désinvoltes visiteurs. Quand je partais voir ailleurs, j’avais besoin de ne plus me sentir chez moi : maintenant, je m’y sens chez les autres. Pas ceux qui habitent là : ceux qui descendent en rangs serrés des avions et des autobus. En conséquence, la réalité à laquelle il m’importe de croire encore, les climats, les lumières, un certain style de relations entre les personnes, je ne la trouve que dans des œuvres — des livres, des films, des tableaux, et comme je ne suis pas d’un naturel assez contemplatif pour me contenter de les admirer, je mets la main à la pâte. Ca me permet d’imaginer que je suis réel, moi aussi, à un moment de mon existence où, dirais-je,… tout ne porte pas à le croire !
- Comment, en vous retournant, voyez-vous votre œuvre ?
— Pas comme un ensemble structuré : plutôt une série de tentatives abandonnées un jour par lassitude ou, plus exactement, parce que je me sentais appelé ailleurs. J’insiste sur ce mot, ailleurs, parce que chacune de mes « périodes » fut un territoire, avec son passé, ses coutumes, sa culture, sa langue, ses codes sociaux, son climat, voire ses spécialités culinaires lorsqu’il s’agissait de l’espace vaguement balkanique où j’ai logé mes Citadelles de sable. Tel ou tel de mes territoires peut coïncider avec une zone géographique bien délimitée (les Etats-Unis, en particulier), mais les deux ne sont jamais superposables. Je m’attache à ce qu’ils ne puissent pas l’être. Je ne suis toujours considéré comme un cinéaste de la plume : un cinéaste américain des années 50. Un de ces types à qui les producteurs confiaient un jour un western, l’année suivante un péplum ou un film intimiste...
- Un fil rouge relie-t-il vos livres ?
- S’il y a une unité à ce patchwork, elle ne réside pas dans l’écriture, mais dans le principe qui préside à celle-ci. Elle n’est pas dans la thématique proprement dite mais dans le retour obsessionnel de thèmes que je ne peux pas ne pas traiter, jusque dans ma poésie: la fuite du temps, l’inévitable métamorphose des choses que nous aurions voulues éternelles, l’échec ou, très spécifiquement, les relations avec les pères (de 1975 à 1999), puis avec les mères (à partir de 2000). Je suis le type qui revient sans cesse sur quelques images fondatrices, plongées dans une lumière très précise, environnées d’odeurs qui ne ressemblent pas à d’autres et qui, autour de ces scènes primitives (la seule chose qui lui importe, pour être franc), tente par politesse envers son lecteur de construire une intrigue de roman.
- D’où vient La couleur orange, votre premier livre ?
— C’était un bilan des années mortes — déjà ! Je l’ai écrit pour me dire, dans une période matériellement difficile : « Elles n’ont pas été tenues, mais voilà toutes les promesses que la vie t’avait faites. » J’ai raconté, avec des scrupules rabbiniques, trois mois de ma vie dont il m’avait semblé qu’ils étaient le début de quelque chose et qui, dix ans après, n’avaient débouché sur rien d’autre qu’une inconsolable nostalgie.
Pour le reste, l’ouvrage reflète deux fascinations littéraires assez incompatibles : le roman naturaliste-behavioriste américain (Hemingway, Chandler, etc.) et la recherche formaliste, qu’elle soit du Nouveau Roman ou d’ailleurs. Trois fées se sont penchées sur ce berceau : le Hemingway de Paris est une fête, le Perec de Les Choses et le Butor de Passage de Milan. J’étais aussi fasciné à l’époque (et le suis toujours), par les grandes littératures mystico-lyriques de l’Amérique : celle du Sud avec Faulkner, de la Nouvelle-Angleterre avec Melville et Hawthorne — sans parler bien sûr du new-yorkais Thomas Wolfe dans lequel je me suis plongé au début des années 70 avec la sensation de retrouver le liquide amniotique.
—Comment avez-vous vécu l’expansion de vos territoires romanesques ?
—Comme un type lancé dans la recherche éperdue d’une terre promise où ses graines germeraient, où il récolterait enfin le genre de beaux fruits qu’il voyait pendre aux arbres des autres. La question de l’exil s’est posée après Le Plaisir des sens. Je me garderai bien de dire si ce texte est ou non réussi. Ce que je sais, c’est qu’il fut le premier (et le seul) où l’écriture m’a offert bien davantage que ce que j’avais espéré d’elle. Il y avait un livre dont je n’étais pas du tout capable, ni techniquement ni sur aucun autre plan, et cependant, je l’ai écrit. Même si ce n’était que moi qui me le décernais, c’était comme de recevoir son bâton de maréchal sur le théâtre des opérations. À part le succès (pas immodéré en l’occurrence), il ne me restait – en ce qui me concernait — rien de mieux à attendre de la littérature. Je ne pouvais que répéter Le Plaisir à l’infini, ou bien creuser un autre sillon, sachant que la grâce ne me tomberait pas dessus une deuxième fois. Ce fut le seul moment de ma carrière où, pendant deux ans, je suis resté incapable d’écrire. Je ne m’en suis sorti qu’en décidant d’accomplir ce qui, au départ, n’était pour moi qu’une parodie, et pas du tout le projet humaniste que d’aucuns ont célébré : ce Faubourg des Coups-de-trique qui était pour moi, contrairement à ce que nombre de ses lecteurs ont cru, une façon de déréaliser Belfort et d’en faire un espace strictement littéraire, une attitude à la Fellini, en quelque sorte, le Fellini d’avant La Dolce vita qui m’a toujours beaucoup inspiré.
—Qu’est-ce pour vous qu’un roman ?
—A-t-on encore le droit d’écrire des romans : j’aimerais avoir l’assurance d’en avoir déjà écrit un, après une quarantaine d’années d’écritoire ! Faute de m’être posé la question, un roman, je ne sais pas ce que c’est. Mais je sais que, pour moi, c’est la vie elle-même — je veux dire une vie avec quoi « la vraie vie » a les plus grandes peines à rivaliser. Je crois qu’un bon roman refait le monde, mieux peut-être et en tout cas de manière plus tangible que beaucoup de philosophies. L’imitation du réel, certes, n’a pas grand intérêt, mais ce que propose la littérature, avec une arrogance qui me réjouit, c’est tout le contraire: c’est que le réel devienne le toc et la contrefaçon du romanesque.
—Faites-vous une distinction entre vos romans-romans et vos romans du jazz ?
— Il y en a au moins une qui est énorme : les romans-romans, j’attends qu’ils veuillent bien frapper à ma porte ; les autres, je vais les chercher manu militari. Avec eux, je ne m’embarque pas sans biscuits. Le travail romanesque consiste essentiellement à aller chercher la vérité des personnages. En revanche, je touche peu à la matérialité des faits. Quand j’introduis des scènes et des dialogues de fiction, c’est toujours parce que les scènes et les dialogues de la réalité sont trompeurs ou équivoques. J’ai au départ, très précisément, quelque chose à dire, ce qui est très rarement le cas lorsque j’aborde mes autres livres. Là, en règle générale, je ne pars ni d’un personnage, ni d’une ébauche d’histoire, mais d’une sensation forte, d’une émotion tenace liée à une image très particulière (mon magasin d’images : essentiellement la télévision – où je consomme énormément de films). Je finis toujours par oublier ces visions fondatrices, mais je crois pouvoir dire que presque tous mes livres sont nés d’une photographie transformée en hologramme, de manière que je puisse tourner autour, accompagnée de conditions climatiques extrêmement précises et, surtout, d’une odeur qui ne ressemble exactement à aucune autre. Je peux passer des mois sans être visité par une de ces images au spectacle desquelles j’ai soudain envie de planter ma tente. Mais envie n’est pas le mot… C’est plutôt que j’ai l’impression que, dans ce lieu-là, je parviendrai à me sédentariser assez longtemps pour parvenir jusqu’au terme du livre (lequel, deux fois sur trois, m’est révélé à ce moment-là, c’est-à-dire avant que j’aie rédigé la première phrase). Pour le reste, je vais à l’aventure : je pose un décor, puis un premier personnage dans le décor et j’attends de voir ce qui va se passer. Tout dernièrement, le décor s’est révélé bosniaque, grâce à un documentaire diffusé à la télévision. J’ai décrit ce décor (au début de Si le roi savait ça). En quelques phrases, j’ai dépeint l’atmosphère qui s’en dégageait plus exactement. Tout le reste est venu de là, et d’une vague idée que j’avais d’introduire un charnier dans l’intrigue. Ma « documentation » s’est limitée à la consultation du Petit Robert des noms propres, à l’article Bosnie.
— Comment êtes-vous retombé en Enfrance, si j’ose dire ?
— On m’a poussé ! Le grand saxophoniste Jean-Louis Chautemps, un ami de longue date, et un poète au quotidien, un poète de fait, qui n’a même pas besoin d’écrire, m’a lancé ce défi, en forme de boutade, il y a déjà trois ou quatre ans. Je n’en ai tenu aucun compte, ne me sentant pas plus apte à la poésie qu’à la pratique du jazz. Et puis, en avril de l’an dernier, je ne sais trop pourquoi, au cours d’une insomnie me sont venus les deux premiers vers d’Enfrance. Je les ai notés sur un bout de papier. Le lendemain, j’ai creusé ce sillon et, à mon grand étonnement, j’ai vu que le sol se fendait sous l’étrave. Pendant trois mois, je n’ai plus écrit que de la poésie, presque à marche forcée. C’aura été l’une des expériences les plus exaltantes de toute ma vie. Cette péripétie était assez inattendue : à part celle de Jacques Réda, qui me touche profondément, je n’avais pour ainsi dire plus lu de poésie depuis le lycée. Je commence seulement à me rattraper un peu : je me découvre quelques affinités avec le Transsibérien de Cendrars, ou Zone d’Apollinaire, singulièrement. Je constate en revanche que les poètes qui me fascinent le plus (Breton, par exemple, ou le Rimbaud des Illuminations) évoluent dans un cercle qui me restera fermé à jamais. Ces auteurs sont initiés à un mystère dont je n’aperçois même pas les contours.
—Et la lecture là-dedans ?
—J’ai dévoré des livres depuis l’âge de cinq ans, en commençant par Fenimore Cooper, Jack London, Dumas et L’Ile au trésor. Vers 1985, j’ai renoncé à ce bonheur-là. J’aimais à la fois trop d’auteurs trop différents les uns des autres, après avoir découvert, entre autres les Latino-américains, les Asiatiques, les Français de l’entre-deux-guerres (Fargue, Morand, Larbaud : j’avais longtemps voulu les ignorer, alors qu’ils écrivaient spécialement pour moi !). J’avais tendance à vouloir les intégrer tous ensemble à ma propre écriture. J’étais menacé, non seulement d’écartèlement, mais de perdre mon diapason personnel. J’ai pris en catastrophe la seule mesure qui s’imposait, ne lisant plus dès lors que les livres d’amis. L’été dernier, condamné à la retraite à mon corps défendant, je m’y suis remis. J’ai lu ou relu des auteurs dont les œuvres sont inscrites au catalogue de la Pléiade : Stevenson, Melville, Simenon, Ramuz, Rimbaud. Je crois que je peux maintenant avancer le doigt sans me faire happer par la machine. Mais certains romans de Simenon n’ont pas été loin de me décourager d’écrire, comme jadis Au Cœur des ténèbres…
— Votre avant-dernier roman fait retour au Belfort de vos débuts…
— Je me demandais, n’ayant plus à écrire pour la radio, si je devais m’accrocher encore à la musique, devenue mon terreau le plus fertile depuis la fin du siècle dernier, et, accessoirement, si j’étais encore capable de parler d’autre chose que de la création et des créateurs. J’avais peur que non, aussi ai-je voulu mettre toutes les chances de mon côté pour tenter cette escapade. Les noms des rues belfortaines ont le pouvoir de me mettre en confiance. Là, je n’ai même pas besoin d’image originelle : il me suffit de ces sonorités. Ce sont en quelque sorte mes sésames intimes.
— L’envoi sera-t-il pour Marie Joséphine ?
— « Pour qui écrivez-vous ? » Le savoir est un rare privilège. Une façon de se forger un style homogène est de s’adresser à un auditoire spécifique (grâce à mon émission de radio Le jazz est un roman, j’ai eu dix ans ce privilège). Je crois cependant que la vraie question est « À qui écrivez-vous ? » Ecrivant à la personne que je connais et qui me connaît le mieux au monde, je sais d’emblée quoi ne pas dire, ce qui est l’essentiel du métier d’écrivain. Je sens quand je triche ; je me surprends quand je me regarde écrire et j’ai honte de moi… Sans elle, ou bien je parlerais tout seul, ou bien j’enverrais des bouteilles à la mer. On s’en lasse vite… Quand on mène ce genre d’entreprise, bien sûr on n’échappe pas à la solitude. Il est capital que quelqu’un vous attende à la sortie du désert. Que quelqu’un vienne vous chercher, comme à l’école, vous tire de là et entretienne autour de vous, ne serait que par sa façon d’être, le climat grâce auquel vous trouverez le courage de retourner casser les cailloux le lendemain. Je dois bien plus à Marie Joséphine qu’elle-même ne l’imagine, plus sans doute que je n’en ai moi-même conscience et bien plus en tout cas qu’une série de dédicaces ne peut le laisser entendre…
Cet entretien avec JLK a paru dans Le Passe-Muraille, No77.
-
Notre tumulte en vrai

 À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.
À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.
Trois niveaux d’écriture
 Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…
Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…Pratiques éprouvées
Pratiquant, en alternance ou simultanément, ces trois niveaux d’écriture depuis que je me mêle de journalisme (j’’ai écrit mon premier papier à quatorze ans, dans le journal d’un mouvement de jeunesse, sur le thème du pacifisme), de critique littéraire (ma première chronique a paru en 1969 dans La Tribune de Lausanne, portant sur Les Courtisanes de Michel Bernard) et de littérature pure, je n’en mesure pas moins à l’expression ou à l’inflexion près ce qui ressortit à l’un ou à l’autre. D’aucuns, notamment dans les cercles académiques du milieu littéraire romand, m’ont reproché ce côté touche-à-tout indigne d’un Véritable Écrivain ne se consacrant qu’à Son Œuvre, n’est-ce pas ? mais ils n’ont pas idée, ces chers bonnets de nuit, de ce que ce type d’absorption peut représenter d'enrichissant aussi pour l’élaboration d’un travail littéraire.Nouveaux tumultes
Il en va de même, aujourd’hui, pour l’usage de nos blogs et autres vecteurs virtuels. C’est par ceux-ci que j’ai rencontré François Bon et une kyrielle de gens intéressants, auteurs ou lecteurs, qui m’ont plus ou moins accompagné dans une nouvelle pratique de l’écriture qui, loin d’exclure l’expérience accumulée, la revivifie parfois de manière stupéfiante, dont le meilleur exemple à ce jour est Tumulte de François Bon, précisément.
Dix ans avant Tumulte, j’ai composé un roman que j’ai longtemps intitulé Roman virtuel, ensuite devenu Le viol de l’ange, alors que j’ignorais tout des virtualités réelles de la Toile. Mais depuis ma quatorzième année, lorsque des barres d’habitation sont sorties de terre dans l’immédiate proximité du quartier de notre enfance au bord des champs et des bois, le choc provoqué par la vision, la nuit, de ces milliers de fenêtres scintillant d'autant de vies, m’a fait basculer dans cet univers tumultueux d’une nouvelle perception simultanéiste de l’espace/temps : tout à coup la ville était là, le Grand Labyrinthe dont la Toile est un autre avatar, et qui bouscule tous nos codes de réception et d’émission, si j’ose parler en machine...
Hic et nunc on the blog
Nous sommes le samedi 18 avril 2009. Je viens de prendre ces notes provoquées par une expression de François Bon, l’autre jour au téléphone, remarquant que nous nous parlions « en vrai ». J’ai rencontré François le temps d’un soir, à Lausanne, et nous nous sommes un peu observés, tous deux à la fois ouverts et un peu timides, comme des ours au coin d’un bois. De le rencontrer « en vrai » ne m’a pas révélé un autre François qu’en lisant Tumulte ou en découvrant sa dernière note sur Andrzej Stasiuk, que je venais pour ma part de découvrir et d’aimer dès les première pages de Fado. Mais c'est vrai que la vie en vrai nous importe... Voilà pour le tissage de la toile…
 Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.
Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.
E la nave va… va falloir ramasser les feuilles mortes d’après la neige… va falloir vivre « en vrai » avant de se reconnecter pour tâcher de dire mieux que tout ça procède à vrai dire du réel et du vrai… salut le Tumulte de la vie qui s’écrit…Image: Philip Seelen
-
Ceux de la photo sépia
Ils seraient tous là dans les maisons communicantes des diverses villes où ils sont venus, des villages, s’établir plus sûrement au début du siècle, attirés par les lumières et l’idée nouvelle d’une Amérique prochaine; ils se retrouveraient là comme naguère et jadis, timides ou conquérants, posant crânement ou paraissant s’excuser d’être sur la photo.
Voici l’objet : c’est la photo sépia, le grand portrait de groupe des vingt ans de la mère de notre mère : notre vénérée Grossmutter, qui occupe ici le centre du premier rang assis des onze frères et sœurs entourant le père et la mère, lesquels siègent de part et d’autre de la claire et nette jeune femme au beau visage ovale mis en valeur par sa chevelure relevée, les mêmes yeux précis et pressants que ceux de sa mère et de la nôtre, l’air aussi résolu que ses deux frères aînés debout au dernier rang alors que le plus jeune – le futur oncle Fabelhaft de notre enfance – sourit de côté, et que Theo, l’immense jeune homme d’une sombre beauté qui se tient un peu incliné, tout à droite, semble faire peser sur tous son irrépressible désir de partance.
Le ton dominant de la photo sépia est solennel, imitant la façon des grands bourgeois à automobiles du nouveau siècle, voire des familles nobles d’une autre époque finissante, princes européens ou russes, peut-être même arabes, avec le décor de palmes et de fleurs exotiques typique de ces années suivant l’Exposition Universelle, que le photographe Emil Goetz a disposé dans son grand atelier de Berg am See, vers le pont aux Cerfs.
La photo sépia est datée 1911. Trente ans plus tôt, le père de Grossmutter, qui siège ici dignement au premier rang, la moustache fournie et torsadée, comme en paille de fer, évoquant celle du missionnaire musicien Albert Schweitzer, officiait au titre de chef de train de la première équipe qui franchit la barrière des Alpes par le tunnel du Saint-Gothard – mais l’homme a su garder cet air discret, dans sa calme dignité, que montreront tous les pères de ce temps-là en cette tribu-là : dignes et discrets. De fait, notre père et les pères de nos mère et père ne nous auront jamais montré que cet aspect digne et discret de l’honnête père de famille en ce pays-là, cravatés dès leur lever, incarnant ceux que je qualifierai toujours de Réguliers et que je respecte en tant que tels, tout en me distinguant d’eux, comme je distingue à présent deux de mes grands-oncles de la photo sépia : le plus jeune assis au premier rang, l’air enjoué, le regard vif, prénommé Leopold, dit aussi Leo ou Poldi, et que nous connaîtrons des lustres plus tard sous le surnom d’oncle Fabelhaft, et derrière lui cet oncle Theo dont la destinée de chercheur d’or nourrira la légende à multiples rebondissements.
Nous sommes en septembre 1911 et le Premier ministre russe, Pierre Stolypine, vient de se faire assassiner par l’anarchiste Bogrov dans une salle de théâtre, quelques mois près avoir posé lui aussi au milieu de sa famille, sur un cuirassé de la marine impériale, ainsi que l’illustre une coupure de journal retrouvée dans les papiers de Grossvater. Or je crois savoir que notre bisaïeul de Berg am See attendait quelque chose de ce Stolypine. Je ne sais trop comment cela m’est parvenu, mais je me rappelle une de ses observations, rapportée par Grossvater à propos de la Russie, selon lequel seul un type capable du genre de Piotr Arkadiévitch Stolypine aurait pu infléchir les événements de sorte à empêcher la calamiteuse Révolution russe, selon l’expression de Grossvater - tout cela qui me revient inopinément en me penchant sur la photo sépia pour mieux voir mon bisaïeul, si digne et discret et songeant peut-être précisément, à l’instant, au sort des grands ce monde incessamment exposés à la menace de l’anarchie.
Or rien n’est plus vraisemblable, à y réfléchir, que ce fait que le beau-père de Grossvater ait eu son idée à propos du sort de la Russie tsariste en voie de se réformer sous l’impulsion de Stolypine. S’il a vraiment dit, une fois, que Stolypine était un type capable, ce ne peut être sans avoir lui-même réfléchi à la question. Car Grossvater, qui connaissait la Russie pour y avoir travaillé, n’aurait pas rapporté la chose si le jugement de son beau-père, qu’il respectait, n’avait pas été tant soit peu fondé et réfléchi. Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, selon l’expression, j’en arrive à imaginer maintenant que, la photo prise, le chef de famille se lève et se tourne vers son grand fils au regard farouche, pour lequel il a toujours eu un faible, Theo n’ayant jamais juré que de trains en partance et de départ aux Amériques, et lui demande à brûle-pourpoint ce qu’il pense des révolutionnaires russes – cette digression imaginaire me venant du fait de la saisissante ressemblance, que je viens de constater, entre la ténébreuse aura de Theo et celle du poète révolutionnaire Vladimir Maïakovski, né la même année que lui…
C’est d’ailleurs tout un roman qu’on pourrait imaginer à l’observation des personnages de la photo sépia, dont la fixité des sujets n’est pas telle qu’elle exclue maintes nuances frémissantes, cela n’empêchant pas non plus les équivoques de l’oubli. Deux sœurs seules sourient sur la solennelle photographie, mais l’une d’entre elles d’un sourire un peu narquois qu’elle s’adresse à elle-même, elle qui se pendra plus tard sans qu’on en démêle le pourquoi, et de l’autre qu’elle identifie sous le nom de Violetta, ma chère Lena, qui m’évoque aujourd’hui ces destinées, ne se rappelle pas bien ce qu’elle est devenue – mis de toute façon, conclut-elle, c’est du passé…
Or je proteste, moi, que c’est notre passé, tout ça : je veux savoir qui est qui, je veux pouvoir dire à nos enfants d’où nous venons, au moins ça, fais un effort ! Et je vais pour gronder un peu Lena, qui aime d’ailleurs ça, qu’on la gourmande - je vois aussi bien que ça la touche que je la pousse à se rappeler son passé à elle, cependant nous restons tous deux un peu embarrassés : comment en effet les faire parler, ceux de la photo sépia, à l’instant de dévisager, même attentivement ces supposés proches dont elle-même ne se rappelle plus bien, et de moins en moins, ce que chacun d’entre eux est devenu au juste…
Mais quel air imposant, pour ainsi dire d’un autre temps, ont donc ceux-là, me dis-je ensuite en scrutant les deux fils les plus âgés - Albrecht le plus sévère, en son amplitude physique de marchand de primeurs en gros, et Conrad, tout massif lui aussi mais au visage plus ovale et spirituel d’ingénieur - que la mine plus enjouée de notre grand-tante Violetta, moins de vingt ans sur la photo sépia et gracieusement assise au premier rang, dans sa robe de tournure Art Nouveau, pondère et radoucit heureusement. Et cette autre qu’elle, debout à côté de l’imposant Albrecht, n’est pas moins jolie elle aussi, mais c’est elle qui se pendra à la stupéfaction des siens, m’a rappelé Lena ; et celle-là qui semble égarée, comment se prénommait-elle encore, et cette autre qui semble comme prise en faute, et cette autre encore qui détourne carrément le regard ? Mystère : Lena donne sa langue au chat.
Cependant la voix de l’Oncle Fabelhaft me revient - sa voix haut perchée nous saluant, les enfants, du fond de son inénarrable arrière-boutique de marchand d’orviétan brocanteur aux allures de cabinet de curiosités dont chaque objet singulier, peau de serpent ou tête réduite de Jivaro, fera l’objet d’une nouvelle histoire.
Or je n’en reviens pas ce matin, et pour la première fois peut-être, tant d’années après l’avoir écouté bouche bée des heures durant, de voir là, sur la photo, quel garçon a été l’affabulateur mirifique autour de ses vingt ans, siégeant bien droit et bien mis, coiffé à la gomina, l’air posé mais fringant, sûrement bon athlète et bon nageur, le visage régulier du jeune Européen bien disposé et bien parti pour la vie – la vie qui lui appartient, comme on dit et comme paraît le dire ce même œil pétillant qui, maintes fois, tant d’années plus tard, nous aura pris à témoins, les enfants.
Voici donc Leo et Theo, le Conteur et l’Aventurier, figures de mes songeries légendaires, parangons s’il en fût des Irréguliers de ma planète imaginaire, et me voilà guetter la moindre de leur parole, comme j’aimerais aussi que se déboutonnent leurs frères ainés, les Réguliers, à commencer par le grand-oncle Albrecht au front buté, mais que je sais un passionné d’aéronautique nouvelle, et par Conrad qui s’est établi à Berlin pour y diriger de grand travaux urbains - tous deux à la fois présents et pas vraiment là, étant entendu que leurs affaires les attendent et que ça n’attend pas, selon l’expression - pas que ça à faire, comme on dit encore, même si cela se fait en ces années, dans un pays civilisé, de poser pour la postérité en famille de sorte que celle-ci apparaisse dans son établissement, en cette année 1911, dans le décor vaguement colonial du photographe Emil Goetz, 8 Hisrchmattstrasse, tel. 689.
Et que nous disent-ils donc tous, tant qu’ils sont ? Que nous disent les Réguliers et les Régulières ? Que nous dit, au premier rang, l’air de quelqu’un qui en sait long sur les choses de la vie, comme on dit - que nous dit la mère de Grossmutter, siégeant bien droite, mais sereine aussi, tenant un magazine, nous regardant en face comme nous la regardons à près d’un siècle de distance – que nous dit-elle et que pourrions-nous lui dire à l’instant ? Que signifie l’air comme effrayé de la fragile Milena, tout à gauche de la photo sépia, juste derrière Leo, la main posée sur la solide épaule de celui-ci, qui porte une minerve et sourit encore moins que quatre autres de ses sœurs ? Que voudraient peut-être dire les trois autres, ensuite, du milieu du deuxième rang, dont les regards nous regardent eux aussi bien en face et fixement à presque un siècle de distance, modestes ou plus insistants ? Et que ne dira sûrement pas, tout à droite au second rang, comme écrasée par la masse du beau Theo, avec quelque chose de russe elle aussi, la sombre Marta au regard qu’on pourrait dire carrément refusé, et dont Lena ne se rappelle plus ce qu’elle est devenue ?
Enfin les regards de nos deux Irréguliers, que nous chantent-ils donc au primesaut de cet autre matin d’hiver ? Que nous raconte le regard du dernier né de la famille rassemblée, ce fringant jeune homme du premier rang, prénom Leopold, que nous connaîtrons sous les traits d’un personnage hirsute et gesticulant revenu des comptoirs orientaux et des jungles, et que nous dit le long regard ombrageux de son frère Theo, élégant plus que les autres, avec son col cassé, et qui paraît déjà désigné par la destinée pour quelque aventure hors du commun ?
D’autres heures d’avant l’aube, en ces veillées de ce long hiver, je serai resté à quêter le moindre mot de nos silencieux, revenant et revenant à la photo sépia ou compulsant les albums des autres branches de notre généalogie, sans entendre rien ni rien oser leur dire ou rien dire d’eux, jusqu’à ces jours de fin décembre et de janvier de l’année suivante, puis des mois suivants où, la neige cédant le pas au jour et au printemps, CELA recommença de parler à travers les années.
On aurait donc hiberné, se dira-t-on ensuite, sans se rappeler à l’instant tant d’hivers passés à ne rien entendre ou dire, faute d’écouter. On se reprocherait alors d’avoir manqué à la vie. On serait tenté de déplorer le temps perdu, tout en se sachant passé par l’épreuve d’un temps d’imprégnation et de maturation et de descente et d’immersion et de remontée des eaux mêlées de nos mémoires dont on ressortirait tout frais et neuf comme les deux jeunes Irréguliers de la fameuse photo sépia, le Conteur et l’Aventurier, et ces matinées des temps d’avant Pâques tout revivrait et rebondirait en flots de mots par les prairies des premières heures, et le récit reprendrait, des maisons retrouvées...(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en finition)
-
CELA

CELA serait le grand mystère de ce que je vois sans le voir, et j’y associe ce matin mon frère mystérieux. Dans ce paysage immense qu’on dirait à l’instant de monts de Chine encrés à rehauts de bleu sombre, mon frère est ce personnage à manteau noir qui s’en va seul, là-bas, sur la rive du lac semblant un fleuve, mon frère n’est aujourd’hui plus que cendres sans mystère et telle est ma question : qui est cet homme que je vois là-bas qui me fait signe ?
Tu me disais, tas de cendres, que CELA ne nous regarde pas, mais ton prénom me rend un corps et c’est le tien : ton corps d’Indien de nos étés, ton corps tatoué de grand Ivan que je regarde et qui me regarde, oui CELA me regarde, tas de cendres, CELA nous regarde, mais où s’arrête ton corps, ce matin, comment ne pas entendre ta voix de garçon petit et tout blond dans le silence de CELA ?
Mais qu’est-ce diable que CELA? Où commence le corps de notre premier enfant ? Tiens, l’odeur de la première merveille n’est pas la même que celle de la seconde. Celle-ci sent plutôt le jasmin, celle-là plutôt l’abricot, comme leur mère sent le matin le jardin et leur père le sanglier.
Le mot CELA est le sempiternel entonnoir de tous mes vertiges de vieil enfant et d’adolescent prolongé: il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.
Dieu tu ne l’as jamais vu. Dieu n’est pas CELA, mais CELA te ramène à ce Nom sans nom. Dieu t’a toujours tenu dans sa main, te dis-tu parfois, mais que diable en sais-tu ? Eux le savent qui en ont fait le Tout-Puissant, Seigneur des armées, mais de celui-là tu ne veux rien savoir. Eux le savent qui en ont fait le Verbe ou l’Absent, le Vengeur ou le Sacrifié, le Glorieux ou le Mendiant, mais de tous ceux-là tu ne sais que dire ce matin alors que le mot CELA t’engloutit, seul et muet, comme si tu te voyais toi-même sans miroir, de dos ou du dedans, seulement visible les yeux fermés.
Le ciel est ce matin de cendre et je m’en couvre le front. Ce seraient comme des mains aimées sur le front de l’enfant. Dans la maison sous la neige il y aurait encore des braises cependant, comme autant de noms retrouvés.Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chaantier.
Image: Philip Seelen
-
Lilith

Ce n’est pas le combat grossier que les gars applaudissent mais ce qu’il y a derrière, et derrière il y a la Déesse.
Aucun d’eux ne saurait l’expliciter. Cela se passe bien en deça des mots, à l’époque où ils pataugeaient dans leur propre matière. Elles ont d’ailleurs l’apparence de merdes mouvantes, mais ce n’est pas ça qui les trouble, au contraire: c’est ce qu’il y a de glèbe et de pluie, d’animal et de divin dans ces femelles endiablées.
Il leur est en principe interdit de toucher et à elles de s’en prendre aux orifices, mais la tension n’en est que plus vive et le trouble plus lancinant, qui rappelle des choses confuses et fortes aux gars de la prairie et des montagnes, surtout les descendants d’Irlandais ou de Balkaniques.
Ils se rappellent certain conte des temps anciens, et comme ils en redemandaient tandis qu’un vent brûlant charriait les cris des petits enfants dévorés par l’affreuse mère.
Ils ne savent plus, à vrai dire, s’ils désirent ou redoutent les filles de Jutta qu’ils sont venus voir se battre dans ce sacré bourbier. -
Un art perdu

Longtemps ce fut la maison des Wei, aux confins des territoires impériaux riverains des Quatre-Mers, qui détint le Secret du Pal.
Ce symbole de soumission faisait l’envie de tous les dominions. Quel prince, à l'instar de l'Empereur Wu des Wei, n’avait rêvé d’exposer ainsi la chair toute vive du vaincu au Pal, quel hiérarque n'aspirait à régner tant que vivrait le supplicié ?
Jusque dans le bas peuple on connaissait l’extrême difficulté de mettre au Pal. La règle absolue veut le vaincu préservé dans ses quatre fonctions vitales et l’aptitude à mouvoir incessamment ses cinq membres, pour survivre au moins sept ans. Cet art se ramasse dans une formule, constituant le Secret.
La chute de la maison Wei restera liée, dans les annales, à la divulgation du Secret du Pal, imputable à la concupiscence d’un Conseiller. Pour une montagne d’or celui-ci vendit le Secret que jamais, au demeurant, le Barbare venu de l’Ouest ne sut faire appliquer par ses techniciens à la main faillible.
La suite figure dans les livres d’histoire. Aujourd’hui encore les Américains ont recours à la chaise électrique ou à la chambre à gaz. Nous buvons certes du Coca-Cola, mais n’en pensons pas moins. -
Une quête d’absolu

Into the Wild, de Sean Penn
C’est un bien grand beau film généreux et limpide qu’Into the Wild de Sean Penn, dont l’empreinte qu’il laisse au cœur est toute pure. L’histoire en est prenante, les personnages principaux sont également de belles personnes, comme on dit, les images et la musique ne sont pas moins superbes et, surtout, il s’en dégage un sentiment général d’autant plus bienfaisant et tonique qu’il n’a rien de complaisant ou d’édulcoré, voire de frelaté, comme pourrait le faire redouter le thème rebattu du retour à la nature. De fait, les rudes lois de celle-ci ne sont pas ignorées ni sous-estimées. Une scène terrible, marquée par le sacrifice « inutile » d’un élan, souligne le caractère très problématique d’une immersion « naturelle », même si la quête du solitaire reste fondée. Le titre d’ En pleine nature ne rend d’ailleurs pas compte du piège que celle-ci représente bel et bien dans le film, alors que l’original Into the Wild en désigne mieux l’ambivalence, qui renvoie aux obstacles et au combat du héros de Construire un feu de Jack London.
 L’esprit des Jack, London et Kerouac, mais aussi de Thoreau et de Tolstoï, préside à ce parcours initiatique d’un tout jeune homme déçu par ses parents, dont la mésentente tourne à la haine sous les dehors du mensonge et de l’hypocrisie.
L’esprit des Jack, London et Kerouac, mais aussi de Thoreau et de Tolstoï, préside à ce parcours initiatique d’un tout jeune homme déçu par ses parents, dont la mésentente tourne à la haine sous les dehors du mensonge et de l’hypocrisie.Deux grandes lignes narratives traversent le film et se relancent l’une l’autre en contrepoint, modulant en outre le passage des années et scandant l'avancée de chaque nouveau chapitre: d’une part, c’est le récit du Magic Bus, la carcasse d’autocar perdue en plein Alaska où Alex Supertramp (c’est le pseudo glorieusement naïf qu’il s’est choisi) va vivre cent jours de solitude absolue ; et, de l’autre, la chronique tenue par sa sœur au fil de ses années de fugue, qui témoigne des conséquences de celle-ci sur les parents restés sans nouvelles, reconnaissant leurs responsabilités et se rapprochant peu à peu l'un de l'autre.
On le sait, Sean Penn revient de loin : de toutes les défonces et de tous les dégoûts. Or ce qui sidère en l'occurrence est la complète fraîcheur de son regard sur le monde et sur les gens, tous abordés avec tendresse et jusqu’à l’indulgence, s’agissant du père égoïste et violent qui se prend pour Dieu au point, une année, de décider, le con, que Noël n’aura pas lieu…
L’Amérique d’Into the Wild est à la fois celle de L’Attrape-cœur de Salinger et de Sur la route de Kerouac, des anciens hippies dans les déserts et de Bush Senior justifiant la guerre du Golfe ou des paumés down & out crevant dans les grandes villes; et l’on se rappelle aussi la dernière page de La Route de Cormac McCarthy dont on pourrait dire que Sean Penn la réinvestit avant la catastrophe ou au moment d’en renaître…
Si la « théologie » de McCarthy est plus profonde dans son aperception tragique et sa visée rédemptrice, que la religiosité tolstoïenne qui se dégage d’Into the Wild, ce film ne représente pas moins, aujourd’hui, un geste de résistance aux forces obscures et destructrices de l’empire du fric, à la violence, au fanatisme, au cynisme ou à la décadence. Le fait qu’Alex, prodigieusement vécu, plus encore qu’interprété, par Emile Hirsch, soit à la fois un fou de lecture et un pèlerin de l’absolu, dont l’apprentissage passe par une nouvelle naissance et une filiation restaurée (avec une femme, puis un vieil homme qui l’adoptent pour ainsi dire en le poussant au pardon des siens), avant la révélation finale de ce que le bonheur n’a de sens que partagé – tout cela élève le film au-dessus des rêveries New Age à base de marshmallow spiritualisant.
La grande générosité d’Into the Wild va de pair avec une forme lyrique n’excluant pas ici et là quelque pompe ni quelques clichés, mais c’est aussi la loi du romantisme à l’américaine (on est bien dans la lignée de Twain, London ou Thomas Wolfe), dans un ample mouvement et un grand souffle. Si la scène de l’empoisonnement « naturel » du protagoniste rappelle La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic, c’est à Tolstoï qu’on pense à la fin poignante d'Alex, rappelant la mort « cosmique » du prince André...
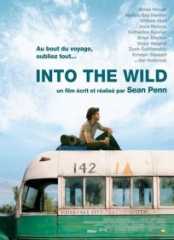 Sean Penn, Into the Wild. Sur DVD et en salles.
Sean Penn, Into the Wild. Sur DVD et en salles. -
Riches Heures. Blog-notes 2005-2008
Vient de paraître
aux éditions L'Âge d'Homme.
Du blog au livre...
Au lecteur
Ce recueil, établi à la demande de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse, aux éditions L'Age d'Homme, rassemble une partie de mes Carnets de JLK, blog littéraire ouvert sur la plateforme HautEtFort en juin 2005. Proposant aujourd’hui quelque 2000 textes, dans les domaines variés de la littérature et des arts, de l’observation quotidienne et de la réflexion personnelle, entre autres balades et rencontres, ces Riches heures de lecture et d’écriture s’inscrivent dans le droit fil des carnets manuscrits que je tiens depuis une quarantaine d’années, qui ont déjà fait l’objet de deux publications : Les Passions partagées (1973-1992) et L’Ambassade du papillon (1993-1999), chez Bernard Campiche.
En outre, ces Carnets de JLK illustrent les virtualités nouvelles, et notamment par le truchement de l’échange quotidien avec plusieurs centaines de lecteurs, de cette forme de publication spontanée sur l’Internet, qu’on appelle weblog ou blog.
Dans l’univers chaotique qui est le nôtre, où le clabaudage et la fausse parole surabondent, ces carnets se veulent, au-delà de tous les sursauts de méfiance ou de mépris, la preuve qu’une résistance personnelle est possible à tout instant et en tout lieu pour quiconque reste à la fois attentif à la rumeur du monde et à l’écoute de sa voix intérieure. À l’inattention générale, ils aimeraient opposer un effort de concentration et de réflexion au jour le jour, ouvrant une fenêtre sur le monde.
SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.
J’écris cependant, tous les jours, «sous le regard de Dieu», et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK. Cela peut sembler extravagant, mais c’est ainsi que je le ressens. En outre, j’écris tous les jours sous le regard d’environ 500 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 5000 sans que cela ne change rien : je n’écris en effet que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux.
Ecrire «sous le regard de Dieu» ne se réduit pas à une soumission craintive mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».
A LA DESIRADE. – Nous entrons dans la nouvelle année par temps radieux et la reconnaissance au cœur alors que tant de nos semblables, de par les monde, se trouvent en proie à la détresse, à commencer par les victimes des terribles tsunamis qui viennent de dévaster les côtes de l’Asie du Sud-est.
A La Désirade, la vision de ma bonne amie qui fait les vitres, comme on dit, me semble la plus belle image de la vie qui continue…
(1er janvier 2005)
ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.
Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.
Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, tout le pantelant de gestes impatients et de jouissance à la diable, chose facile.
Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…
Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.
La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté; et ce travail alors repose et fructifie.
 En librairie ces prochains jours. Commandes directes : http://www.lagedhomme.com/
En librairie ces prochains jours. Commandes directes : http://www.lagedhomme.com/ -
Un couple uni

Nous aimons nous tenir par la main et déambuler ainsi le long des Ramblas.
Notre dernière querelle date de 1987, le soir précédant mon départ en Pologne. J’étais rentré bourré. Elle m’a dit je ne sais plus quoi. Je lui ai mis une beigne avant de m’en rendre compte. Je lui fis dans l’avion une lettre que mes larmes de sentimental à la con trempèrent de grosses gouttes. Lorsque je suis revenu de Varsovie, elle portait encore des lunettes noires pour cacher son bleu.
A Varsovie, j’ai passé toute une nuit avec un confident de l’ex-pape, amputé d’une main, qui se rappelait les décombres de la ville en 1945, il avait sept ans et son père lui disait de bien regarder - la ville entièrement reconstruite aujourd’hui où l’on trouve des boutiques de Cardin .
C’est ce que je lui raconte sur les Ramblas, qui valent toujours le déplacement.
Ah oui cela encore: notre position préférée est celle du missionnaire. -
Ceux qu’inspire la rumeur de la mer
Celui qui porte un bouquet de jonquilles dans la poche arrière de son jean / Celle qui s’en va tout doucement dans la lumière plombée du fjord / Ceux qui se sont retrouvés pour accueillir la mort ensemble / Celui qui évite de penser à tout ce qu’il sait essentiel / Celle qui trouve les mots trop grands pour ses émotions d e demoiselle / Ceux qui n’osent pas dire qu’ils s’aiment / Celui qui décapite des tortues dans un film javanais / Celle qui a perdu sa sœur dans une manif d’Athènes / Ceux qui se rappellent le jour et l’heure de la mort de Lady Diana / Celui qui estime que The Queen is dead est le meilleur album des Smiths / Celle qui ne veut écouter que Strangeways en mâchant de la rhubarbe / Ceux qui se demandent à quoi l’on rêve quand on a perdu le sens des couleurs / Celui qui se promet de s’engager dans la Légion étrangère s’il échoue à l’examen d’admission à la fonction de Palefrenier Chef du haras de la Comtesse Bouleboule / Celle qui reproche à son fils de ne pas porter de bretelles / Ceux qui se séparent pour survivre / Celui qui a découvert la leçon de sagesse subliminale du roman à succès Jody et le faon / Celle qui ment à en avoir la face bleue / Ceux qui prétendent aimer la pluie en banlieue et les politiciens de seconde zone / Celui qui estime que la vie ne fait que prendre sans rien donner / Celle qui dort toujours dans le sac de couchage de son premier prétendant explorateur / Ceux qui considèrent que le bonheur ne vaut rien sans matelas bancaire conséquent / Celui qui se juge indigne des compliments du vice-président de son club de tango / Celle qui pense que tout désormais est trop tard / Ceux qui sont morts dans le même fauteuil à oreilles de l’institution Le Clair Matin / Celui qui trouve un réconfort au Hamburger Heaven / Celle qui spécule sur le fait que la fille d’un premier mariage de sa bru va se retrouver dans le même lycée que Louis Sarkozy et que son fils Tibère pourrait en profiter d’une manière ou de l’autre en dépit de son penchant récent pour la religion musulmane / Celle qui pense qu’un gros aurait plus de chance avec elle qu’un aveugle malgré la tendance inverse / Ceux qui aiment l’odeur mêlée des clopes et des fish’n’chips / Celui qui a la nostalgie des jardins ouvriers de la Banlieue Ouest / Celle qui passé de la passion pour Sissi impératrice à celle des tailleurs ton sur ton / Ceux qui prétendent avoir assisté au dernier concert de Chet Baker au New Morning, etc.Aquarelle JLK: dunes de Sète, 2007.
-
Max Frisch sans bémol
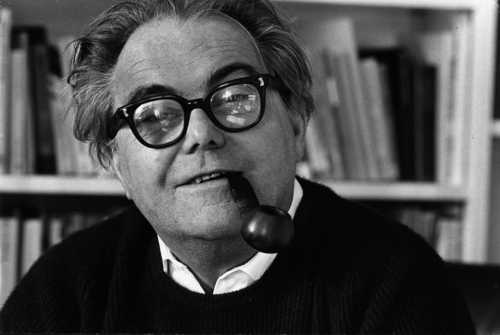
DOCUMENTAIRE. Matthias von Gunten rend hommage à un maître de l’esprit critique… sans trace d'esprit critique.
C’est un film intéressant et nécessaire, assurément, que ce Max Frisch citoyen qui retrace, avec une tendre déférence, tournant parfois à la dévotion, le parcours de l’écrivain qui fut l’exemple-type de l’intellectuel engagé. Un intellectuel : c’est ainsi que le présente immédiatement Helmut Schmidt, qui insiste sur la légitimité de ce regard critique sur le pouvoir. En contrepoint, ses amis Peter Bichsel et Gottfried Honegger rappellent qui fut l’homme. Présent au monde, Max Frisch le fut en Suisse, dès son intervention contre la xénophobie, autant que devant le monde, comme le rappellent un Günter Grass, qui évoque leur complicité et leurs fâcheries, Christa Wolf rappelant ses rapports avec l’Allemagne de l’Est, ou Henry Kissinger leur différend à propos de l’impérialisme américain, notamment.
Tissé de documents d’époque (en ralentis répétitifs un peu pompeux), enrichi de citations bien choisies et de quelques fragments de films plus anecdotiques, le film de Matthias von Gunten déçoit en revanche par son manque total de recul critique. La seule opposition à ce maître à penser d’une génération est en effet une lettre de lecteur imbécile, dont la haine rehausse, par contraste, le caractère hagiographique du film.
Si les vertus de la contestation sont évidemment célébrées, de la lutte contre la xénophobie en Suisse à la guerre du Vietnam, en passamt par Mai 68 à Zurich, le terrorisme en Allemagne ou la votation sur la Suisse sans armée, le réalisateur passe comme chatte sur braise sur les positions de Frisch face au communisme dans le monde ou au goulag. A ce propos, le témoignage de Christa Wolf reste lui aussi assez platement anecdotique...
Bref: dommage que tout ça relève un peu trop de la célébration nostalgique entre anciens combattants,et pas assez de l’incitation, visant les nouvelles générations, à découvrir une œuvre dont rien n’est dit du contenu précis des romans (Stiller juste évoqué au passage, ou Homo faber) ou des pièces de théâtre (même si celui de Frisch n’est pas à la hauteur d’un Dürrenmatt, les fables d’Andorra ou de Monsieur Bonhomme et les incendiaires auront fait date), ni rien non plus de son magnifique récit des dernières années intitulé L’homme apparaît au quaternaire. La dernière intervention publique de Max Frisch, aux Journées de Soleure, où il confesse sa seule foi en l’amitié, dans un monde où il semble se résigner à cultiver son jardin, en Candide un peu raplapla, n’a pas de quoi susciter le plus vif intérêt d’un jeune lecteur, alors que les volumes (chez Gallimard) du Journal de Frisch restent, aujourd'hui encore, une lecture vivifiante.
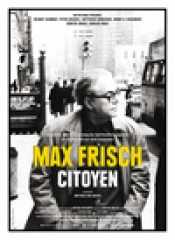 DVD. Max Frisch citoyen. Pelicanfilms
DVD. Max Frisch citoyen. Pelicanfilms -
Le temps de la violence

Octogénaire d’une impressionnante vitalité, le grand romancier mexicain achoppe à la violence du monde dans Le Bonheur des familles…
Carlos Fuentes approchait de sa 80e année, fêtée en grand pompe l’an dernier à Mexico, lorsqu’il publia Le Bonheur des familles, qu’on dirait le roman d’un jeune auteur plein de sève et de feu impatient de « casser le morceau ». En bref, c’est le roman de la famille mexicaine dans tous ses états et ses éclats, en seize récits liés ensemble par les chants heurtés d’un chœur de tous les âges, des filles-mères de la rue aux fils à papa. Débordant l’immense Mexique où cohabite misère et splendeur, créativité et corruption, c’est aussi à toute la famille humaine que s’adresse le grand écrivain.
Le titre original du livre, Toutes les familles heureuses, fleure la dérision en écho ironique à l’exergue de Tolstoï : « Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa façon ». En l’occurrence, toutes les « familles heureuses » qu’observe Fuentes sont malheureuses à leur façon, à commencer par celle de Pastor Pagan, qui se demande pourquoi lui seul a jamais été honnête dans l’entreprise dont il vient d’être viré. Même les cinq mille dollars de « bonus » qu’on lui a offerts lui apparaissent comme une incitation à la corruption, « présupposé majeur », au Mexique, « qui règne à tous les niveaux, des membres du gouvernement aux employés, du quincailler au paysan ».
Carlos Fuentes, que son père fouettait pour lui inculquer les bonnes manières, rit jaune en évoquant la femme de Pastor, chanteuse de boléro réfugiée dans son fantasme romantique, Alma leur fille qui vit par procuration en surfant sur internet ou en suivant le dernier épisode d’un reality show, ou enfin le fils Abel, crâne et velléitaire jeune glandeur revenant au bercail en trentenaire vaincu tout semblable à son paternel. Quatre paumés très ordinaires en temps de crise ou, peut-être, de recomposition dans un Mexique restauré, car la vie selon Fuentes est souvent plus forte que l’ordre traditionnel mortifère ou l’anarchie sur fond de drogue: ainsi le père veuf des trois lascars du deuxième récit se réjouit-il finalement de voir son fils aîné, dont il voulait faire un curé par dévotion à sa femme bigote, le « trahir », saluant verre en main son garçon qui a fui le séminaire et pris son destin en main !
Au fils des seize récits de ce Bonheur des familles qui n’a rien d’une série télévisée, Carlos Fuentes traverse toutes les couches de la société mexicaine, du couple gay vieillissant et perdant ses repères à cette mater dolorosa écrivant à l’assassin de sa fille pour lui dire qui était celle-ci, en passant par le Président et son fils ou tel curé péchant les yeux au ciel avec l’Indienne dont il vitupère la souillure… Or alternent, en contrepoint, les voix de ceux qui n’ont pas de mots, au fil d’une suite chorale où le romancier grappille les traits de langage et les rythmes d’aujourd’hui, genre rap parodié…
Un demi-siècle après la parution de La plus limpide région, où il entreprit une première ressaisie romanesque de la nébuleuse humaine-inhumaine de Mexico, Carlos Fuentes ajoute, aux multiples « temps » de son œuvre monumentale (« Mal du Temps » avec Aura, « Temps des Fondations » avec Terra nostra, « Temps politique » avec Le siège de l’aigle, temps autobiographique avec Diane ou la chasseresse solitaire où il exorcise sa passion malheureuse pour Jean Seberg), ce qui pourrait se dire le temps de la violence intime – le roman s’achève aussi bien sur les mots « violence, violence » - et de son exorcisme… Comme si le grand romancier cristallisait, au nom de ses propres enfants disparus – son fils et sa fille sont tous deux morts tragiquement il y a une dizaine d’années -, sa rébellion contre les maux de la destinée.
Carlos Fuentes, Le Bonheur des familles. Traduit de l’espagnol (Mexique) par Céline Zins et Aline Schulman. Gallimard, collection Du Monde entier, 455p. Simultanément paraît, aux éditions de L’Herne, un passionnant essai sur Don Quichotte, Cervantès ou la critique de la lecture. Un Cahier de l’Herne consacré à Fuentes a paru en 2006.
Carlos Fuentes en dates
1928 Naissance à Panama. Parents diplomates. Enfance entre Quito, Montevideo, Mexico, Washington. Etudes de droit à Mexico et à Genève.
1958 Premier roman, La plus limpide région, critique virulente de la société mexicaine.
1962 La mort d’Artemio Cruz et Aura. Suivront Le Chant des aveugles, Zone sacrée, etc.
1977 Terra nostra, son chef-d’œuvre, est consacré par le Prix Romulo Gallegos.
1987 L’ensemble de son œuvre est couronné par le Prix Cervantès. Nobélisable dès cette époque.
1999-2005 Mort de son fils Carlos Lemus, artiste hémophile victime du sida en suite d’une transfusion, et de sa fille Natasha, dans un quartier pauvre de Mexico.
2004 Critique infatigable de l’impérialisme économique et culturel américain, il publie Contre Bush.Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 4 avril 2009.
-
Sonate pour un homme seul
La vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck
Il y avait beaucoup d’émotion l’été avant-dernier sur la Piazza Grande du Festival de Locarno, lorsque La vie des autres a été projetée pour la première fois devant cinq ou six mille spectateurs, et depuis lors, ce premier film d’un jeune Allemand né à Cologne mais de parents originaires d’Allemagne de l’Est, n’a cessé de passionner et d’émouvoir tous les publics, jusqu’aux States où il a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger.
 C’est une histoire à pleurer que celle de cet écrivain passant pour l'enfant chéri du régime, lié à une actrice non moins adulée, qui subissent d’un jour à l’autre (notamment parce que le ministre de l’intérieur a des visées sur la jeune femme) la surveillance la plus étroite de la Stasi, par le truchement d’un officier pur et dur de celle-ci, Wiesler de son nom. Usant des procédés techniques les plus au point, celui-ci se greffe pour ainsi dire sur la vie du couple. Parce qu’il défend un metteur en scène proscrit, et qui se suicidera en cours de route, l’auteur dramatique Georg Dreymann est soupçonné de duplicité, mais l’observation quotidienne à laquelle se livre Wiesler depuis le galetas de la maison, avec écrans et micros lui transmettant les moindres faits et gestes des amants, va l’amener à un revirement progressif alors qu’il voit les hauts responsables du Parti, auquel il obéit comme un véritable croisé de la Bonne Cause, se comporter comme des opportunistes de bas étage et des profiteurs carriéristes, de vrais porcs en ce qui concerne les ministres de l’intérieur et de la culture.
C’est une histoire à pleurer que celle de cet écrivain passant pour l'enfant chéri du régime, lié à une actrice non moins adulée, qui subissent d’un jour à l’autre (notamment parce que le ministre de l’intérieur a des visées sur la jeune femme) la surveillance la plus étroite de la Stasi, par le truchement d’un officier pur et dur de celle-ci, Wiesler de son nom. Usant des procédés techniques les plus au point, celui-ci se greffe pour ainsi dire sur la vie du couple. Parce qu’il défend un metteur en scène proscrit, et qui se suicidera en cours de route, l’auteur dramatique Georg Dreymann est soupçonné de duplicité, mais l’observation quotidienne à laquelle se livre Wiesler depuis le galetas de la maison, avec écrans et micros lui transmettant les moindres faits et gestes des amants, va l’amener à un revirement progressif alors qu’il voit les hauts responsables du Parti, auquel il obéit comme un véritable croisé de la Bonne Cause, se comporter comme des opportunistes de bas étage et des profiteurs carriéristes, de vrais porcs en ce qui concerne les ministres de l’intérieur et de la culture. La vie des autres est un film admirablement construit, dans une sorte de hiératisme crépusculaire où la menace de ne cesse de flotter, dont tous les interprètes sont impressionnants de vérité, à commencer par Ulrich Mühe dans le rôle de Wiesler et Sebastian Koch dans celui de l’écrivain. Si le rôle de la Stasi est bien illustré (qui mobilisa jusqu’à 91.000 agents et 180.000 informateurs pour une population de 17 millions d’habitants, soit le plus fort taux d’encadrement du bloc de l’Est), le réalisateur ne se contente pas de « dénoncer » vertueusement pour la satisfaction de notre bonne conscience, mais expose bel et bien le dilemme tragique que beaucoup de socialistes sincères, entre autres artistes plus ou moins naïfs, ont vécu, les uns cédant par fragilité (ainsi de l’actrice qui finit par trahir son amant après avoir été humiliée et abusée par l’abject ministre de l’intérieur) et les autres fuyant à l’Ouest ou se suicidant comme le metteur en scène ami de Dreymann, après la mort duquel celui-ci prendra sur lui de publier, à l’Ouest, un article éloquent sur le taux de suicide en RDA au mitan des années 80.
La vie des autres est un film admirablement construit, dans une sorte de hiératisme crépusculaire où la menace de ne cesse de flotter, dont tous les interprètes sont impressionnants de vérité, à commencer par Ulrich Mühe dans le rôle de Wiesler et Sebastian Koch dans celui de l’écrivain. Si le rôle de la Stasi est bien illustré (qui mobilisa jusqu’à 91.000 agents et 180.000 informateurs pour une population de 17 millions d’habitants, soit le plus fort taux d’encadrement du bloc de l’Est), le réalisateur ne se contente pas de « dénoncer » vertueusement pour la satisfaction de notre bonne conscience, mais expose bel et bien le dilemme tragique que beaucoup de socialistes sincères, entre autres artistes plus ou moins naïfs, ont vécu, les uns cédant par fragilité (ainsi de l’actrice qui finit par trahir son amant après avoir été humiliée et abusée par l’abject ministre de l’intérieur) et les autres fuyant à l’Ouest ou se suicidant comme le metteur en scène ami de Dreymann, après la mort duquel celui-ci prendra sur lui de publier, à l’Ouest, un article éloquent sur le taux de suicide en RDA au mitan des années 80.Du film se dégage, finalement, le portrait d’un juste, auquel Georg Dreyman consacrera un roman après la chute du Mur lorsque, en possession des archives de la Stasi, lui qui se croyait épargné de toute surveillance, il découvre que c’est celui-là même chargé de sa filature et de la mise en fiches de ses faits et gestes qui lui a valu la vie sauve. Conclusion lénifiante que celle de La vie des autres, qui finit sur la vision de l’ancien agent de haut vol devenu petit employé postal anonyme ? Nullement, car tout le film joue sur cette frontière imperceptible qui ne sépare pas d’office bons et méchants, héros ou salauds, mais évalue bel et bien, comme avec la plus fine balance, les sentiments et les actes de chacun. Qu’auriez-vous fait à la place de chacun de ces personnages, dans telle ou telle situation précise ? C’est le genre de questions que pose implicitement, et très honnêtement, ce premier film magistral d'un jeune Allemand, à voir absolument.
-
Le réel absolu
En lisant Christiane Singer et Annie Dillard
Je relis ces jours deux livres en alternance, ou disons plutôt que je les relis à tout moment, qui me font office, plus que de béquilles: de tapis volants. Ce sont les constats présents et joyeusement éternels d’une femme en train de mourir et d’une autre femme non moins attentive au plus vif de la vie.
«Qui eût pu soupçonner qu’au cœur d’une aussi difficile épreuve se soit lovée la merveille des merveilles ? » se demandait Christiane Singer en janvier 2007, à un mois de sa mort, toute faible et ravagée, mais de plus en plus légère et rayonnante. A ses mots font écho ceux d’Annie Dillard qui évoque, au début d’Au Présent, le scandale énigmatique des enfants malformés, nains à tête d’oiseau et autres gosses à branchies de requins, pour constater : « Certes le monde est toujours aussi sublime, aussi exaltant, mais pour plus de crédibilité il faut bien commencer par les mauvaises nouvelles ».
Il y a, chez Christiane Singer et chez Annie Dillard, un même mélange de porosité que je dirai christique, en cela qu’elles semblent accueillir toutes l’humanité dans leur observation, d’hypersensibilité délicate et de force, de force terrible, de formidable potentiel de joie. Est-ce par exaltation frisant l’hystérie morbide que Christiane Singer, sur son lit de mort, écrit d’un dernier bout de crayon «me croira-t-on si je dis que je n’ai jamais été plus heureuse que maintenant ?». Tout au contraire elle l’écrit les yeux ouverts sur la putain de maladie et la putain de mort, qu’elle accueille en fondant sa vie dans La Vie. De la même façon, c’est de toute son âme que Dillard interroge La Vie qui produit à la fois la merveille et le monstre, continuant de croire au sens de tout ça en scrutant les tempêtes sur le désert de Gobi, le Mal courant d'une génération à l'autre, les formations nuageuses, la vie en Israël, la pensée des Hassidim, les paradoxes apparemment insensés qu’on est prié de considérer comme allant de soi.
Rien de va de soi quand on est à l’article de la mort ou sur la crête métaphysique de la vie, mais ne prenons pas pour de la résignation passive ces mots lumineux de Christiane Singer : « Ce lieu où tout cela advient m’apparaît si précieux que je dois en prendre passionnément soin. C’est le jardin où Dieu se promène chaque matin. »
Dieu ne va pas bien ce matin, nous souffle Anne Dillard, ça a beau être dimanche, ça ne s’arrange pas dans le monde est c’est ça qu’il faut réparer nom de Dieu. « La divinité frêle est un Rien, un SUR RIEN », disait Angelus Silesius, et Christiane la mourante : « Je ne mange ni ne bois, je me sens cherchée ». Et cela aussi qui peut servir : « Je vous le jure. Quand il n’y a plus rien, il n’y a que l’Amour. Il n’y a plus que l’Amour. Tous les barrages craquent. C’est la noyade, l’immersion. L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ». Et cela pour finir : « Je croyais jusqu’alors que l’amour était reliance, qu’il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin ! Nous n’avons même pas à être reliés : nous sommes à l’intérieur les uns des autres. C’est cela le mystère. C’est cela le plus grand vertige. Au fond je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle : de l’autre côté du pire t’attend l’Amour. Il n’y a en vérité rien à craindre. Oui c’est la bonne nouvelle que je vous apporte »…
Christiane Singer. Derniers fragments d’un long voyage. Albin Michel, 2007.
Annie Dillard. Au présent. Bourgois, 2001. -
Santos et le puma
Nouvelle inédite
Par David Fauquemberg
« Là-haut, tout est plus lent », m’avait prévenu Modesto. Je l’avais rencontré juste après La Poma, un village oublié du Nord-Ouest argentin. Chapeau noir et poncho de laine, le visage raviné, dents jaunies par les chiques de coca, Modesto gardait ses lamas, assis sur un rocher à l’ombre des volcans jumeaux. Deux cônes de basalte parfaitement identiques. Soucieux de me voir partir seul, il avait déposé une offrande à la Pachamama, qu’elle me laisse franchir la montagne. Trois gouttes d’eau versées sur un apacheta, amoncellement de pierres chaulées juste au bord du chemin. J’aurais dû l’écouter. Sept heures déjà que je roulais plein nord sur cette piste dévastée. La ruta cuarenta montait en sinuant vers les hauteurs andines, coupant et recoupant les méandres gelés du río Calchaquí. Sans cesse, il fallait descendre du pick-up pour déplacer une pierre, la branche tombée d’un arbre, s’assurer que les gués demeuraient praticables, installer les chaînes, les enlever. Je m’étais épuisé en gesticulations, j’avais la tête lourde, le souffle de plus en plus court. L’altitude sapait mes forces.
A trois heures de l’après-midi, j’ai atteint le sommet du col. Abra del Acay, 4895m. C’était écrit sur un panneau, couché par les rafales. Le vent du sud, glacé, soulevait la poussière. J’avais de la peine à me tenir debout. A perte de vue, les arrondis gris-bleu de la cordillère, les arabesques de la piste qui dévalait le versant nord, les étendues désertes de la Puna, et tout au fond, là-bas, le miroitement des Salinas Grandes, où des hommes décharnés, en haillons, se brûlaient les yeux et la peau pour extraire à la pioche de lourds blocs de sel. D’ici, on n’apercevait que du minéral désolé. Au bout de quelques pas, j’ai vacillé. Je me suis accroupi pour reprendre mon souffle. Les parois de mon crâne contraignaient ma cervelle. J’avais la nausée, des vertiges. Il fallait redescendre, et vite. Mais d’abord lentement regagner la voiture. Je me suis assis sur mon siège, j’ai sorti de mon sac le citron que Modesto m’avait offert. Comme il me l’avait conseillé, je l’ai coupé en deux pour en sucer le jus. Mais j’étais bien conscient qu’il était déjà tard. J’ai remis le contact, basculé dans la pente.
La pierraille fuyait sous mes roues, dans le violent dévers des virages en lacets. Agrippé au volant, je ne contrôlais rien. J’avais froid, je suais. Ma vue se troublait. Deux fois, j’ai manqué verser dans le ravin, ne rattrapant le coup que d’extrême justesse. Déployant les doigts de ses ailes immobiles, un condor planait trois cents mètres plus bas. Je m’approchais de lui, virage après virage. Le cœur au fond de la gorge, concentré à l’extrême pour passer les ornières, les éboulis, je n’ai pas vu approcher la troupe de vigognes. Elles ont surgi devant moi, graciles et fugitives, aussitôt disparues derrière les touffes de paja, de coirón amargo, jaune fané sur le bleu du ciel.
La pente s’est adoucie, soudain. La piste traversait, en parfaite ligne droite, un plateau d’altitude. Mais je n’étais pas tiré d’affaire, à près de quatre mille mètres. Je me suis arrêté pour boire un peu d’eau fraîche. Les veines sur mes tempes menaçaient d’exploser. Des formes fulgurantes, d’un vert fluorescent, palpitaient sur l’écran noir de mes paupières. Frissonnant, j’ai déplié la carte. A Santa Rosa de Tastil, plus bas dans la vallée, je trouverais de l’aide. Cinquante kilomètres à tenir. Jusqu’à la ville, Salta, il en restait plus de deux cents. Sale endroit pour tomber malade. Pour qu’il arrive quoi que ce soit. Et forcément, c’est arrivé. Franchissant le rio, j’ai senti la glace se rompre, le pick-up plonger vers la gauche. J’ai passé la seconde, accéléré à fond. Les roues ont fouaillé le lit de la rivière, mitraillant de galets le dessous du châssis. Déflagration. Le pneu avant droit venait d’exploser, déchiqueté sans doute par le fil d’une ardoise. J’ai accéléré de plus belle, en vain. La jante dénudée s’était enfoncée dans la vase. J’ai frappé le tableau de bord. « Putain ! »
Déployer le câble du treuil, trouver un point d’ancrage : pas la peine d’y songer. Je n’aurais pas eu la force d’actionner le cric, la clé en croix, ni de porter ces roues qui pesaient une tonne. La nationale 51, plus fréquentée, n’était qu’à quelques kilomètres. Mais qui passerait là à une heure pareille ? Le soleil était bas au-dessus du Chili, vers l’ouest. Bientôt, la nuit et le gel tomberaient. J’ai éteint le moteur. Posant le front sur le volant, je me suis efforcé de reprendre mon calme et de rassembler mes idées, qui voletaient, insaisissables, sous la chape de ma migraine. J’étouffais. Ouvrant la portière, je me suis hissé sur le capot, puis sur la rive proche. Rien que le bruit du vent, le frottement sec des broussailles.
 Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »
Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »
L’intérieur du rancho était d’un seul tenant, étroit. Il fallait se courber pour y tenir debout. J’ai mis quelques secondes à vaincre la pénombre. Sous une lucarne minuscule, un lit de fortune, rembourré de paille sèche, avec un crucifix accroché aux barreaux, des amulettes de plumes et de cristaux bleus. Le chien m’observait, tête posée sur les pattes. Un bâtard famélique, inquiet. Il s’est mis à gronder, me fixant dans les yeux. « Ouh, tais-toi ! », a tonné le vieil homme, agenouillé dans un coin devant sa cheminée. « Comprenez, c’est qu’on ne voit jamais personne. » Il me tournait le dos, remuant doucement l’eau bouillante d’une casserole, y jetant une poignée de feuilles. Des soubresauts incontrôlés lui agitaient les mains.
Il s’est tourné vers moi, a soulevé son chapeau. « Santos, c’est comme ça que les gens m’appellent. » Quinte de toux rêche, douloureuse. « M’appelaient. » Trempé de sueur, j’avais les yeux exorbités. Je me sentais partir. Désignant un tabouret, il m’a fait signe de m’asseoir. « Tu es malade, l’ami. La Puna, ça vous brise un homme. » Il m’a tendu une tasse blanche, ébréchée, bouillante. « Thé de coca, ouh ! » Je me suis forcé à boire le liquide brûlant, par petites gorgées. Il a tiré d’une boîte en fer deux galettes de maïs, qui se sont effritées au contact de mes mains. « Crevaison, hein ? Ouh, je ne suis qu’un vieux paysan ! Je ne peux pas grand-chose. Il est tard, tu vas dormir là. Les camions passent tôt le matin, sur la nationale. Des Chiliens. » Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. L’effet de la coca commençait à se faire sentir.
J’ai dû m’assoupir sur mon tabouret. Quand j’ai ouvert les yeux, Santos n’était plus là. L’odeur rance d’un ragoût de chèvre m’a soulevé le cœur. Dehors, il faisait noir. La lueur des flammes éclairait les murs nus. La peau d’un grand puma était clouée au-dessus de la porte, dont les pattes pendaient, énormes, animées d’une force bestiale. Posé sur un buffet en bois de caroubier, le crâne blanc de l’animal exhibait des crocs menaçants. La porte s’est ouverte, laissant entrer le froid. Santos a posé son chapeau sur le rebord du lit. Sans un mot, il s’est accroupi près du feu, inspectant le ragoût. « Faut bien rentrer les chèvres. Sinon le puma, ouh ! » J’ai montré du doigt le trophée. « C’est moi qui l’ai tué. » Il remuait le ragoût, parlait à voix basse, étouffée, comme pour lui-même. « Je l’ai tué de mes mains. Avec la pierre que tu vois là. » Un galet rond, noirci de sang, gisait sur la terre battue. Santos m’a resservi du thé. Il s’est assis en face de moi.
« Certains parlent de Mauvais Œil. Tomber sur une femelle qui vient de donner bas, et le mâle qui entre en furie, ça n’arrive à personne, jamais… J’aurais dû mourir. Hé, ce n’était pas mon jour ! A Chicloana, un type s’est fait arracher le bras d’un seul coup de griffes, et puis la tête… »
Pour la première fois, je voyais ses yeux. Blanchis par le soleil, incapables de me fixer, ils sautaient de droite et de gauche, comme de leur propre volonté.
« J’avais marché toute la journée, sur les hauteurs. C’est en rentrant le soir que j’suis tombé sur eux. Le mâle m’a sauté à la gorge avant que je le voie. Le soleil, ouh ! Il m’a jeté par terre, j’ai tendu mes vieux bras, pour attraper sa carotide... Qu’est-ce que je sais ? J’ai vu la vie s’enfuir, il fallait bien lutter… Ses yeux, je les revois souvent. »
Santos pleurait. Des larmes de vieux, silencieuses. Il les a essuyées de ses grosses mains tremblantes.
« Le puma me déchirait les bras, le cou, mais je n’ai pas lâché. Il m’a traîné derrière une roche et il me secouait, le sang ça les rend fous. Ses yeux… J’ai pensé Une pierre, j’ai attrapé celle que tu vois, j’ai frappé fort, encore et encore et encore. Et le puma est tombé mort, sur moi. »
Il a levé les yeux vers la peau du félin, s’est signé plusieurs fois, psalmodiant des prières en une langue inconnue.
« Il m’a laissé idiot, vois-tu. Mon âme s’est envolée là-haut, au pied du rocher. Depuis que ma dame est partie, je suis comme perdu… Je tourne en rond. Si jamais je m’éloigne, je ne reviendrai pas. Ouh, malédiction ! J’ai tué ce puma, et il a pris mon âme. »
D.F.Cette nouvelle de David Fauquemberg a constitué l'ouvertrure du No76 du Passe-Muraille, paru en octobre 2008. Le prochain livre de l'auteur de Nullarbor, Prix Nicolas Bouvier en 2007, est à paraître en septembre prochain chez Fayard.
-
L’enchantement au bord de l’eau

Concert scénique, la dernière création de Heiner Göbbels, à Vidy, relève d’un art incomparable.
La magie conjuguée du verbe, de la musique et de l’image émane en beauté pure de la dernière réalisation du compositeur et metteur en scène allemand Heiner Göbbels, à laquelle participe le sublime quatuor vocal anglais du Hilliard Ensemble, dans une scénographie également magistrale de Klaus Grünberg.
Qualifier cette création polyphonique de «concert scénique» indique immédiatement le type d’écoute requis, où la perception sensible passe avant la compréhension d’un sens quelconque. Celui-ci n’est pas absent pour autant des quatre textes poétique rassemblés, à commencer par la fameuse Chanson d’amour de J. Alfred Prufrock, où l’humour du génial T.S. Eliot entremêle trivialité quotidienne et résidu de cérémonie sacrée. Au-delà du récit et de tout « message » discursif, dont La Folie du jour de Maurice Blanchot illustre le dépassement dans une modulation «simultanéiste» merveilleuse de Klaus Grünberg, le fil rouge d’une narration épurée lie les trois morceaux principaux, dont le Cap au pire de Samuel Beckett touche à une sorte de litanie sonore défiant la traduction, et l’intermède ironico-lyrique de L’excursion à la montagne de Franz Kafka.
Les spectateurs impatients de comprendre ce que « ça veut dire » seront peut-être aussi désorientés que devant une toile de Rothko ou à l’écoute du Miserere d’Arvo Pärt (autre interprétation référentielle du Hilliard, soit dit en passant), mais rien, dans I went to the house but did not enter, de l’esbroufe sonnant creux de tant de spectacles de «recherche», car ici l’on «trouve», au sens des trouvères médiévaux. A partir de textes qui sont à retrouver (quatre pures merveilles à revisiter aussi bien), le compositeur-metteur en scène trouve, de concert avec cet autre homme–orchestre qu’est le scénographe-peintre, et avec quatre voix comme surgie hors du temps, la beauté où elle est, cernée d’abîmes, portée par le chant, voilée de mystère…
 Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch
Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch
Images: La séquence tirée du Cap au pire de Beckett; Heiner Göbbels.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 17 mars 2009.
-
L’âme nageuse

…Regarde-la pour mieux te voir toi-même, toi qui te crois changer avec l’âge alors qu’elle te signifie combien ton âme d’enfant lui reste consubstantielle, ton corps paresseux à se déprendre de ses vieilles peaux, ton esprit de chaque matin qui te retrouve dans la vague porté par ta joie de toujours, regarde-là qui t’ouvre le bleu du temps suspendu où ton verbe va modulant nue par nue…Photo JLK: Nuage, le 20 août 2007.
-
La double vue de l’aveugle

RECIT Brigitte Kuthy Salvi vit dans la nuit depuis l’âge de 15 ans. De ce qui lui a été arraché, la non-voyante a tiré Double lumière, un livre qui donne à mieux voir…
Dans la vie de Brigitte Kuthy Salvi, il y eut un AVANT, suivi d’un APRÈS. Avant, c’est le souvenir d’une petite fille à laquelle son grand-père, sous le ciel étoilé de Carthage, fait découvrir la «couleur nuit » ou, lors d’une balade, lui dit « viens, sens cette belle de nuit».
« J’ai tellement aimé voir ! », dira-t-elle… après. Mais avant, il y aura une première alerte, à onze ans, avec un premier décollement de rétine. « J’avais été opérée et je souffrais de la terrible interdiction de lire durant des semaines ». Suivra un répit durant lequel, amoureuse de peinture, elle commencera elle-même de peindre, jusqu’à ce soir fatal de sa quinzième année où son chirurgien ophtalmologue, lui annonçant l’échec d’une nouvelle opération, lui avoue qu’il ne peut plus rien pour elle. Alors elle : « Je l’ai consolé comme j’ai pu en me montrant reconnaissante de ce qu’il avait tout tenté pour que ma vie ne bascule pas dans cette obscurité terrifiante ».
Et c’est l’après: « Pas une belle nuit noire qui invite au voyage » mais la peur, l’immédiate peur de s’endormir, les bouffées d’angoisse, les moindres bruits inquiétants, la panique à l’idée de perdre toute indépendance (surtout « que personne ne me prenne en pitié »…) et pourtant le recours aux autres, aux gestes parfois bouleversants, et son propre dédoublement : la Brigitte d’avant qui prend la main de l’aveugle…
L’histoire n’est pas ordinaire, même rapportée à la statistique: environ 80.000 à 100.000 déficients visuels sur l’ensemble de la population suisse, entre 10.000 et 20.000 personnes suivies par des institutions spécialisées, 10% environ de celles-ci aveugles, 8 à 10% handicapées de la vue de plus de 74 ans. Autant de chiffres qui ne disent rien d’une réalité dont les voyants n’ont qu’une vague idée. Témoignages et reportages documentent certes les états du handicap, de l’aveugle de naissance aux victimes d’une cécité progressive. Rares, cependant, ceux qui nous font percevoir le drame « de l’intérieur». Plus rares encore les récits qui disent à la fois la souffrance physique et psychique de l’aveugle, mais aussi ses révoltes et ses espoirs, ses façons de passer de la peur et de la rage initiales à la vie partagée, active, constructive, ouverte à l’amour et à tout ce qui «reste» malgré la vue perdue.
A cet égard, le récit de Brigitte Kuthy Salvi a quelque chose d’exemplaire. Pas tant pour la «performance» de la femme devenue avocate, ni pour sa façon de célébrer « ce qui reste », mais pour dire aussi ce que la cécité lui a apporté. « Depuis longtemps, explique-t-elle, tout ce qui se rapporte à la vue, et à ce qu’on ne voit pas même avec de bons yeux, me préoccupait, mais ce n’est que depuis trois ans que l’envie de casser ma solitude par l’écriture a trouvé sa forme, par fragments courts où je m’efforce de suggérer, de frôler les thèmes plus que de les traiter ».
Rien pourtant d’évanescent dans ce récit qui dit les choses avec une sobre netteté. La double lumière fait certes allusion au dédoublement intérieur de l’aveugle, mais aussi à certaine Leila, « reine de la nuit » de la mystique soufie. Pourtant la « double vue » ne serait rien sans un combat terre à terre contre le handicap, mais aussi contre les autres et contre soi : dans les difficultés de l’adolescence et du réapprentissage, des études et de tous les emmerdements auxquels les voyants ne pensent même pas. Avec l’aide des siens, de ses frères et sœurs, de son compagnon dont elle perçoit le regard avec une saisissante acuité. Et de remarquer qu’il est des aveugles qu’elle ne rencontre pas mieux que certains voyants. Et de venir vers nous du même coup…
« Si la vue m’était rendue, ce qui est complètement improbable dans mon cas, je me demande parfois ce que je voudrais garder de moi aveugle», remarque enfin Brigitte Kuthi Salvi, reconnaissante jusqu'à l’initiation que lui a valu son mal. Grande leçon d’humanité…
 Une nuit scintillante de mots
Une nuit scintillante de mots
« On ne voit bien qu’avec le cœur », écrivait Saint-Exupéry. Vérité d’une pleine évidence mais parfois devenue poncif, et peut-être incomplète. Car on voit aussi avec les yeux du corps et de l’esprit: c’est tout un, se dit on en pénétrant dans le labyrinthe de Double lumière, tissé d’ombres lourdes et de peines, mais aussi d’allées plus légères (parfois illusoires, quand on retombe sur les angles durs des murs et des objets) et d’échappées vers le ciel des émotions, entre autre regards sur l’énigme de la création.
Quand on lui demande pourquoi la musique n’est pas plus présente dans son livre, alors qu’elle va visiter des musées, évoque des films (y compris celui qu’elle a failli tourner) ou sa « rencontre » avec la sculpture de Giacometti, Brigitte Kuthy Salvi remarque justement que la musique est tout en elle et ne lui a jamais posé la moindre question, modulée en revanche dans ses mots. « Ce qui m’importe est de voir au-delà de la vue », dit en outre l’auteur de Double lumière, nous rejoignant alors par-delà son handicap.
C’est en effet un livre de communion et de transmission que Double lumière qui nous aide, paradoxalement, à mieux voir…
Brigitte Kuthy Salvi. Double lumière. Préface de Michel Cazenave. Editions de L’Aire, 161p.
En dédicace à Lausanne : librairie Payot de Pépinet, le 19 mars, dès 17h. -
Gloire à Daniel Kehlmann

Après Les Arpenteurs du monde, le jeune écrivain allemand rebondit en beauté en pleine dinguerie contemporaine. Un irrésistible conteur.
Notre époque est formidable. Une erreur d’aiguillage de votre téléphone portable, et vous voici, quidam minable, destinataire de tous les SMS et autres appels ardents destinés à tel acteur célébrissime. Gloire à vous ! Et gloire à tous au plus haut des cieux actuels ou virtuels, que Daniel Kehlmann arpente en observateur aigu, drôle et tendre à la fois.
Vous seriez donc ce quidam, réparateur d’ordinateurs un peu fatigué de votre femme, - elle-même lectrice assidue des livres new-age du fameux Miguel Auristos Blancos, auteur du Chemin du moi vers son moi -, et voici que l’achat (réticent) de votre premier téléphone portable vous vaudrait la surprise de recevoir les messages envoyés à l’acteur de cinéma Ralf Tanner. Hier encore, vous vous disiez : « Pourquoi certains ont-ils tout pour eux et d’autres presque rien ? », et voilà que le rêve ferait irruption dans votre vie. Mais vous pourriez, aussi, trois histoires plus loin, être ce Ralf Tanner, dont le téléphone portable cesserait de fonctionner et qui rencontrerait, en ville, un sosie puis un autre plus ressemblant à sa propre image médiatique que lui-même. Ou vous seriez le fameux Miguel Auristos Blanco, en train d’écrire Interroge l’univers, il parlera, et tout à coup l’interpellation d’une abbesse candide vous enjoignant, dans votre courrier, à répondre aux Vraies Question, vous découvrirait l’imposture de votre vie de moraliste mondial à la Paulo Coelho. Mais vous pourriez être aussi le jeune blogueur employé en téléphonie qui positiverait à la lecture de Miguel Auristos Blanco lui conseillant de « ne plus faire qu’un avec les choses » ou d’ « apprendre à accepter ». Or ces sages préceptes vaudraient aussi pour tel écrivain, du nom de Leo Richter, invité dans les centres culturels allemands du monde entier, persuadé de vivre une vie dangereuse malgré sa peur pour sa petite santé et auquel, lectrice, vous pourriez demander d’où lui viennent ses idées (question universelle à deux balles) tout en vous identifiant à sa compagne du moment, une Elisabeth cadre au CICR dont les délégués viendraient d’être enlevés en Afrique…
Fantaisie et gravité
On pense au Voyage aux enfers du XXe siècle de Dino Buzzati en lisant Gloire, même si les personnages de Daniel Kehlmann ont plus d’étoffe affective et de présence charnelle que ceux du grand conteur italien. Par ailleurs, c’est bien dans le XXIe siècle postmoderne que nous plonge Kehlmann avec cette suite d’histoires communiquant entre elles, dont la plus émouvante est à la fois la plus « virtuelle». La vieille Rosalie, que son cancer du pancréas condamne à brève échéance, demande à l’auteur s’il ne pourrait pas lui réserver un meilleur sort que de l’envoyer se faire euthanasier à Zurich ? Or Daniel Kehlmann, comme le Marcel Aymé de la nouvelle intitulée Le romancier Martin, parvient à nous faire croire à sa vieille dame tout en négociant avec elle le scénario de sa fin de vie.
Magie, malice, pénétration sensible, regard critique, voire satirique, mais aussi compassion : telles sont les qualités de l’écrivain-médium dont le rire qu’il tire de nous à chaque page n’est jamais froid ni blessant. Superbement fluide et chatoyant, musical jusque dans sa parodie du langage des dingues de l’Internet, ce roman en neuf histoires se dévore d’une traite tout en laissant, après lecture, place à une vraie réflexion prolongée. Autant dire que le plaisir de lire Gloire n’a rien de gratuit.
 Daniel Kehlmann.- Gloire. Roman en neuf histoires traduit de l’allemand par Juliette Aubert. Actes Sud, 174p.
Daniel Kehlmann.- Gloire. Roman en neuf histoires traduit de l’allemand par Juliette Aubert. Actes Sud, 174p.Daniel Kehlmann en dates:
1975 Naissance à Munich. Fils du réalisateur Michael Kehlmann et de la comédienne Dagmar Mettler.
1981 Installation de la famille à Vienne .Etudes de philosophie et de littérature
2003 Accède à la célébrité avec Moi et Kaminski (traduit chez Actes Sud en 2004), après trois premiers livres.
2006. Les Arpenteurs du monde. Succès de l’année. Plus d’un million d’exemplaires, traduit en 50 langues. Prix Kleist. Vient de paraître en poche Folio.
-
Le temps des masques
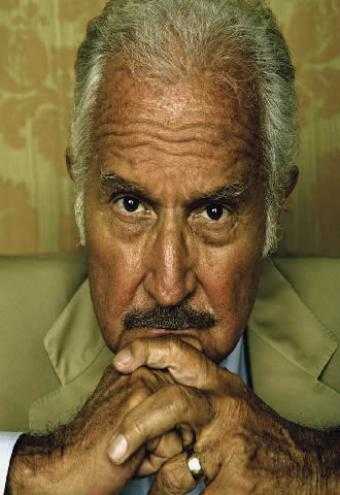
Le siège de l’Aigle de Carlos Fuentes, une lucide et fascinante illustration de la passion politique
Nous sommes au Mexique en 2020, sous le règne du sage président Lorenzo Teran, au moment où, celui-ci ayant refusé de cautionner l’occupation militaire de la Colombie par les Etats-Unis, et soutenant par ailleurs l’augmentation du prix du pétrole par l’OPEP contre l’avis des USA, voit son pays puni par ceux-ci qui paralysent, d’un jour à l’autre, tout le système de télécommunications. L’effet collatéral de cette mesure est de forcer les gens à communiquer par lettres, déclenchant du même coup ce roman qui revitalise le genre épistolaire puisqu’il sera simultanément chronique d’une lutte pour la succession du Président (lequel doit être remplacé en 2024), récit d’une conquête amoureuse stendhalienne (un Julien Sorel à la mexicaine mis au défi par une femme supérieurement manipulatrice) recoupant de multiples intrigues de cour ou d’alcôve, réflexions de haute volée (nourries de Plutarque, Platon et Machiavel, entre autres) sur l’histoire contemporaine et l’art de la politique - tout cela porté par une ligne narrative d’une parfaite clarté, avec un mélange d’humour et de réalisme jamais cynique (même si certains des personnages le sont diablement) qu’oriente une grande connaissance des êtres et de la « nécessité».
La passion politique habite la magnifique Maria del Rosario Galvan, qui fut la compagne de l’actuel ministre de l’Intérieur, Bernal Herrera, type du «juste » humaniste et réservé en lequel elle voit le successeur idéal du Président. A cette fin, elle imagine de se servir (ad interim) d’un jeune homme brillantissime, Nicolas Valdivia, dont elle entreprend l’éducation politique (en lui promettant autre chose « plus tard ») et qui va bel et bien se retrouver au pouvoir en exerçant ses propres talents de jeune fauve sans états d’âme. Un peu comme s’il décortiquait un artichaut, dont chaque lettre du roman représenterait une feuille, le lecteur va découvrir peu à peu, et par le jeu de miroirs de leurs divers correspondants, à travers leurs actes et leurs feintes réciproques, qui sont Maria et Nicolas, avec leur passé respectif et leur drame secret.
Entre Dumas et Goya
De la même façon, tous les personnages du roman se dévoilent progressivement, autant par ce qu’ils écrivent que par ce que d’autres lettres apprennent au lecteur, lequel reconstruit finalement l’ensemble du tableau sans la moindre difficulté. Le Président lui-même, et l’intègre Bernal Herrera, comme l’énigmatique Ancien des Arcades (qui rejoue le Masque de fer à sa façon) distillant ses sentences à la manière d’un sage antique, conservent une sorte d’immobilité hiératique, tandis que s’agitent les masques de la Comédie. Et c’est le gluant Tacito de La Canal, directeur de Cabinet du Président dont il lèche les bottes en rêvant de le remplacer, après avoir « couvert » une arnaque financière sans pareille; c’est le fascisant Général Cicero Arruzza n’en pouvant plus de se retenir de casser de l’étudiant ou du paysan ; c’est César Leon l’ancien Président fomentant son retour en multipliant les alliances louches; ou c’est « La Pepa », nymphomane passant d’un homme fort à l’autre. Or, loin de se réduire à des caricatures, tous ces personnages (et il y en a encore beaucoup d’autres non moins bien dessinés à la Goya) ont une histoire personnelle que le romancier détaille de feuille en feuille, jusqu’à nous laisser goûter au cœur de l’artichaut…
Toute l’œuvre romanesque de Carlos Fuentes est placée sous le signe explicite du Temps, décliné en Temps des fondations (Terra nostra), en Temps révolutionnaire (La mort d’Artemio Cruz) ou en Temps politique (La tête de l’hydre et Le siège de l’aigle), notamment. Or ce qui saisit une fois de plus, à la lecture du Siège de l’aigle, c’est la profonde empathie, la bonté fondamentale de l’écrivain, dénuée de tout sentimentalisme, qui n’en finit pas de parier, sans illusions sur la foire aux vanités, pour un temps plus humain.
Carlos Fuentes. Le siège de l’aigle. Traduit de l’espagnol (Mexique) par Céline Zins. Gallimard, coll. Du monde entier, 443p.
Carlos Fuentes. Territoires du temps ; une anthologie d’entretiens. Gallimard, Arcades, 393p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 6 décembre 2005.
-
Ordo ab chao

Ludmila Oulitskaïa et son grand roman de la médiation.
par Hélène Mauler
« […] ce livre n’est pas un roman, c’est un collage. Je découpe avec des ciseaux des petits morceaux de ma propre vie et de celle d’autres personnes, et je colle "sans colle / une histoire vivante sur les lambeaux des jours1". »
Ludmila Oulitskaïa
1 Citation d’un poème de Pasternak
Il y a des romans qui, au-delà de l’histoire qu’ils racontent, soufflent au visage du lecteur toute la puissance du projet qui les anime. Tantôt en tempête, tantôt avec le calme plein de creux et de rumeurs qui fait vibrer l’air au débouché des grandes plaines d’Asie centrale ou aux confins des déserts africains, ils déploient une onde chahuteuse qui se rit du temps et de l’espace, ils enroulent et tourneboulent les destinées, ils vivent indépendamment des personnages une vie qui est la leur et dont à son tour on aimerait connaître la genèse, décrypter le manuscrit, élucider l’élan – pour découvrir le roman du roman, en quelque sorte.
Ici, le roman du roman, qui est aussi le roman lui-même, se démultiplie à l’infini sitôt ouvert le volume bien sage, carré et compact, que l’on tient entre les mains : des fragments de notes prises à Boston, à Jérusalem ou à Berkeley par des hommes et des femmes de la diaspora juive en quête d’un passé et d’une identité, des courriers envoyés de Vilnius à Jérusalem, de Santorin à Cracovie, de Rio de Janeiro à Haïfa, la retranscription d’une longue conversation enregistrée en Galilée, un télégramme, une carte postale, des documents tirés des archives du NKVD et du KGB, une brochure touristique « Visitez Haïfa », un certificat de baptême, des extraits de la presse israélienne rendant compte de la visite du pape Paul VI, un extrait du courrier des lecteurs du journal « Les nouvelles d’Haïfa » avec la réponse de la rédaction, des lettres de dénonciation aux autorités de l’Eglise, toute cette matière écrite semble échappée d’un de ces gros dossiers à sangle que l’on trouvait, autrefois, sur les étagères des avocats, des médecins ou des commissaires de police. Collectée feuille à feuille, minutieusement assemblée, entrelacée, tissée, elle dessine un vaste paysage lacéré qu’illumine, radieuse et joyeuse, la figure de Daniel Stein, interprète.
Interprète… Rares sans doute ont été les destins vécus aussi pleinement sous le double signe de la traduction et de la médiation que celui de Daniel Stein, alias Oswald Rufeisen, un personnage réel né dans une famille juive de Galicie en 1922 et mort en Israël en 1998. Jeune homme, dans une Biélorussie annexée par les Russes au lendemain de la Première Guerre mondiale, partiellement cédée à la Pologne, puis occupée par l’Allemagne à partir de 1941, il fait office d’interprète (forcé) entre la gendarmerie allemande, la police biélorusse et la population locale, mais tente aussi de sauver des Juifs en leur transmettant les informations auxquelles ses fonctions lui donnent accès. Démasqué, réfugié dans un couvent de religieuses polonaises, il se convertit au catholicisme et part pour la Terre sainte où il sera ordonné prêtre. Là, il créera une paroisse où, après avoir dit la messe en Polonais, il finira par opter pour l’hébreu, langue véhiculaire des nouveaux immigrants venus de Hongrie, de Russie, de Roumanie. Mais surtout, il militera jour après jour pour que l’Eglise catholique renoue avec ses racines, qui se trouvent dans le judaïsme : riche lui-même d’une double culture juive et chrétienne, mais non reconnu comme juif en Israël parce que chrétien, ayant vécu au plus près le chaos des guerres, l’horreur de la Shoah, les intransigeances de la foi, les défis de la liberté, il consacrera sa vie à jeter des ponts entre deux traditions qui, à l’origine, n’étaient qu’une.
« Mon christianisme s’est révélé une pierre d’achoppement pour mon peuple », constate Daniel Stein à son arrivée en Israël, et c’est ce qui guide sa réflexion comme son action. Hilda, une jeune Allemande immigrée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’assiste sans faillir auprès de fidèles venus de tous les horizons, elle aussi au cœur d’un inextricable nœud de contradictions en raison de ses origines, mais aussi de son amour pour Moussa – Moussa qui vit au quotidien la difficulté d’être arabe, « surtout quand on est de confession chrétienne et de nationalité israélienne ». Et c’est autour de ce duo tout d’ombres et de lumière, Daniel et Hilda, que s’organise une superbe réflexion sur la foi, la judéité, la distinction incertaine entre les méchants et les gentils, les assassins et les victimes – et la vie qui avance, trébuche et reprend – ou pas – sa marche, parce que l’on se trouve à tel endroit, à tel moment, parce que l’on reçoit une lettre, un livre, une convocation, un signe du destin, bon ou mauvais…
H.M.
Ludmila Oulitskaïa. Daniel Stein, interprète. Traduit du russe par Sophie Benech, Gallimard, 2008, 526 pages.
Cet article est à paraître dans Le Passe-Muraille, No77, en avril 2009.
-
La passion du livre

Sylviane Friederich fait passer le livre comme un témoin d’humanité
« Je suis autodidacte à 100% », rappelle volontiers Sylviane Friederich même si, en matière de lecture, elle en sait autant sinon plus que moult lettrés. Libraire quasi légendaire pour son accueil et ses compétences, présidente en exercice de l’ASDEL (Association suisse des libraires, distributeurs et éditeurs), choniqueuse littéraire à ses heures (au Temps et à la Librairie francophone) jusqu’au moment où, l’an dernier, les éditions In Folio lui confièrent la direction de leur nouvelle collection de littérature, la patronne de La Librairie n’a rien pour autant du bas-bleu. Aussi débonnaire en apparence que rigoureuse et tenace, il y chez elle de la militante (notamment pour le prix unique du livre) et de l’humaniste.
« A la maison, on ouvrait plus souvent une bouteille qu’un verre », précise cette fille de tonneliers-cavistes. «La bibliothèque familiale se résumait à peu près à la série des classiques Nelson, mais ça m’a permis de me « faire » la totale des Dumas, entre autres Balzac et Zola. Celui-ci m’a marquée par ses descriptions de la misère des villes et des campagnes, et m’a transmis un début de conscience sociale et politique. Et puis il y avait la bibliothèque locale que j’ai écumée. Mais en fait, c’est surtout avec les autres que j’ai appris »…
Les premiers « autres » seront, à sa seizième année, à Zurich, dans une librairie anglophone fréquentée par un certain Kokoschka et les artistes de l’opéra voisin, des amis libraires qui lui révèlent un nouveau monde après l’éteignoir d’un bref séjour à l’Ecole normale lausannoise. «J’y ai aussi rencontré le mythique Wenger, tenancier de la librairie française, auquel, toute jeunote, j’ai acheté ma première gravure de Franz Anatol Wyss, pour 80 francs – une sacrée somme… » Dès cette époque, son double goût pour la littérature et la peinture ne cessera de cohabiter. Après un apprentissage en bonne et due forme à la librairie protestante de L’Ale, à Lausanne, elle assouvira mieux cette passion à la librairie-galerie Melisa, à la rue de Bourg, auprès du libraire-écrivain Roger-Jean Ségalat chez lequel défile la fine fleur de l’intelligentsia locale. A l’approche de la trentaine, après une escale à la galerie de L’Entracte où elle élargit le cercle de ses amis artistes ou collectionneurs, Sylviane Friederich se lance, soutenue par quelques amis, dans la belle aventure personnelle de la librairie-galerie Couvaloup, qu’elle installe dans les murs pittoresques d’anciennes écuries. C’est là qu’elle accueille maints artistes et qu’elle commence à constituer un fonds de librairie à sa ressemblance, nullement confiné ou trop spécialisé mais ouvert au monde: éclectique. Un quart de siècle plus tard, c’est enfin dans un ancien atelier industriel de la rue des Fossés que La Librairie se transporte, bel espace en dédale de plain-pied et plus spacieux, plus chaleureux aussi, où les enfants se trouvent aussi à l’aise que les esthètes, les fouineurs et les amis.
De la génération des soixante-huitards, Sylviane Friederich a été marquée par les grandes figures de la contestation et de la résistance intellectuelle, de Martin Luther King à Hannah Arendt. Dans le même esprit, elle a toujours défendu les porte-paroles des cultures périphériques, sans oublier la Suisse romande. « La lecture est un cercle infini, qui m’a conduit à travers tous les siècles et les pays. Il y a parfois des chocs, comme la découverte de Cent ans de solitude de Garcia Marquez. Mais il y a aussi des découvertes plus intimistes, qu’on transmet comme des secrets. Je pense à La Demande de Michèle Desbordes ou aux livres de Sylvie Germain, qui est d’ailleurs venue à La Librairie de son vivant.
La Librairie, précisément, qui tient du salon débonnaire où l’on s’attarde volontiers seul ou entre amis, obéit elle-même à une véritable « mise en scène », selon l’expression de la maîtresse de céans. Non du tout pour la frime mais pour s’opposer à la frénésie ambiante. «La librairie devrait être un témoin de l’Histoire », conclut aussi bien Sylviane Friederich.
En dates
1950. - Naissance à Morges, dans une famille de tonneliers-cavistes.
1966. -Première expérience en librairie, à Zurich, après un début d’Ecole normale insatisfaisant.
1967. Apprentissage de libraire à la Librairie protestante de l’Ale, à Lausanne. Proche de la bohème lausannoise et des milieux artistiques et intellectuels.
1974. Collaboratrice de Roger-Jean Ségalat à la Librairie-Galerie Melisa, à Lausanne. Se passionne autant pour la littérature que pour les arts plastiques.
1978. Fondation de la Librairie-galerie de Couvaloup, à Morges. Y organise de nombreuses expositions.
2003. Installation à La Libraire, dans une ancienne quincaillerie de la rue des Fossés. Expositions, animations, conférences, signatures.
2005. Présidente de l’ASDEL. En première ligne du combat pour la réglementation du prix du livre.
2008. Directrice littéraire de la collection Littérature aux éditions In Folio.
-
La (dé)mesure de Shakespeare

Mesure pour mesure au Théâtre de Vidy, en 2009. Mémorable !
Le grand art est tout simple, qui ne va pas sans grand artisanat, l’un et l’autre exigeant un immense travail qui ne se voit pas. Il en résulte une impression d’évidence et de légèreté qui marque, particulièrement, la mise en scène claire et fluide de Mesure pour mesure, signée Jean-Yves Ruf, dans une scénographie de Laure Pichat montrant sans démontrer, boîte à surprises où tantôt on serait au palais et tantôt au bordel, en costume de banquier ou le cul à l’air. Les costumes de Claudia Jenatsch, les lumières de Christian Dubet, le son de Jean-Damien Ratel participent aux sortilèges du lieu théâtral, dans lequel s’incarnent les personnages du Big Will, par le truchement de son verbe magique.
Celui-ci, comme celui de Dostoïevski sous la même signature d’André Markowicz, est une sorte de monstre apte à «tout dire», Dans Mesure pour mesure, il est question de bon gouvernement et de justice divine, royale ou bonnement humaine. Il est question de pouvoir mesuré ou démesuré, de pureté peut-être hypocrite et de sainteté non feinte, il est question d’expérience humaine et d’indulgence acquise, de ceci qui semble simple et de cela de bien plus compliqué.
La grande réussite de cette coproduction, créée à Bobigny en novembre 2008 et donc bien rodée aujourd’hui (3 heures sans un instant d’ennui), tient à moult éléments, dont l’interprétation. Mention spéciale à Jérôme Derre pour son Duc magistralement dédoublé en moine retors, meneur de jeu annonçant le Prospero de La Tempête. Bonus à l’Escalus puissant et doux de Jean-Jacques Chep, au Prévôt soumis-révolté de Jacques Hadjaje ou à la Marianne de Noémie Dujardin, aussi expansive qu’est concentrée l’Isabelle très authentique et très émouvante de Laetitia Dosch… Enfin ce conseil : de revenir au texte, disponible à la librairie de Vidy.Image: Eric Ruf, dans le rôle d 'Angelo, et Laetitia Dosch, dans celui d'Isabelle. Photo Mario del Curto.
Lausanne-Vidy, Salle Apothéloz, jusqu’au 4 mars, les ma-me-je-sa, à 19h. Di à 18h.30, Ve, à 20h.30. Relâche lundi. Location : 021 /619 45 45 ou www.vidy.ch Eric Ruf vit Shakespeare « par le ventre et la tête »…
Eric Ruf vit Shakespeare « par le ventre et la tête »…
RENCONTRE. A Vidy, l’éclatant acteur de la Comédie-Française retrouve son frère Jean-Yves dans Mesure pour mesure.
Un très grand bonheur théâtral s’offre ces jours au public du théâtre au bord de l’eau. Avec un immense texte, complexe mais intelligible, que la nouvelle version française d’André Markowicz rend propice à la mise en chair et en bouche, dans une réalisation éclairante de Jean-Yves Ruf, et une interprétation portée par le même souffle et la même intelligence. En face de la jeune Laetitia Dosch, formée (entre autres) à la Haute école de théâtre romande, qui incarne une Isabelle virginale évoquant à la fois Bécassine, Antigone et Jeanne d’Arc, Eric Ruf campe le seigneur Angelo dont la froide rigueur puritaine s’enflamme au feu de la vertu…
- Que représente Shakespeare pour vous ?
- J’ai quelque peine à le dire, car c’est la première fois que je l’aborde dans un grand rôle. J’y ai été préparé par Le Partage de Midi de Claudel, dans le rôle de Mesa, le même genre de jeune homme pur et dur qui montre soudain une fragilité d’allumette. A l’école, j’avais mesuré la grande difficulté de cette langue et l’importance de la traduction, souvent injouable. Avec celle de Markovicz, dont la poésie est directe et concrète, l’incarnation s’est faite aussitôt. Deux jours durant, nous avons démêlé avec lui les obscurités du texte. Il nous a appris ainsi à accepter la part de l’obscur. Il a d’ailleurs une théorie à ce propos : si Shakespeare ménageait cette part, c’était pour faire revenir le spectateur une deuxième fois ! Pour en revenir à votre question, je me sens devenir très passionné de Shakespeare, qui est à vivre par le ventre et la tête. Je projette d’ailleurs une mise en scène de Macbeth…
- Que vous dit, personnellement, Mesure pour mesure ?
- Je suis frappé par la complexité de chaque personnage. Le mélange du tragique et du comique, de la vertu et du vice, est inouï. Angelo me semble, au début, un type pur, assez semblable en cela à Isabelle, mais le désir qui lui fond dessus est du genre qui tue et la charge érotique liée à l’apparition de la vierge implorante est inouïe. Enfin on découvre un homme. Aussi, c’est une pièce sur la justice. Et là, je remarque que le jeune public réagit au quart de tour, saisi par ce qu’on pourrait dire des jugements à «deux vitesses »…
- Comment avez-vous vécu la collaboration avec votre frère ?
- Cela s’est bien passé, alors que nous avons été très rivaux durant notre adolescence. Mais le théâtre nous a rapprochés. En l’occurrence, nous avons partagé les mêmes réactions par rapport à une éducation de petits-fils de pasteurs, notamment en ce qui concerne le puritanisme d’Angelo et l’arrière-plan religieux et moral de la pièce. D’un autre point de vue, le personnage du Duc est non moins insondable, plus ambigu peut-être que tous les autres, alors qu’il prétend clarifier et pacifier le jeu au nom de la justice.
- N’y a –t-il pas, dans le dénouement tellement humain de la pièce, quelque chose de Molière ?
- En effet : comme souvent chez Molière, le happy end apparent ne résout rien. Pas de jugement final qui conforterait. Il y a même un humour sardonique là-dessous : pensez au sort futur d’Angelo, condamné à vivre avec la femme qui l’aime et qu’il a rejetée on ne sait pourquoi…
- Quels sont vos projets à venir ?
- Je vais revenir à la scénographie, pour un Fortunio à l’Opéra comique. En outre je vais collaborer à une variation sur Jekyll du jeune auteur Christian Montalbetti et, à la Comédie Française, je jouerai le Soliony des Trois sœurs de Tchékhov. Enfin, le pauvre Angelo se retrouvera en patron de sex-shops dans Pigalle, une série télévisée à venir…Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 26 février 2009.
Portrait d'Eric Ruf à Vidy: Florian Cella.
-
Les savants foldingues

Les arpenteurs du monde, ou l'érudition pétulante de Daniel KehlmannUne idée aussi répandue que sotte voudrait qu'un best-seller répondît à des critères standards, alors que rien n'est moins prévisible qu'un grand succès de librairie qui allie qualité et popularité. Une nouvelle preuve en est donnée par Les arpenteurs du monde du jeune écrivain allemand Daniel Kehlmann, qui a fait un tabac fumant en Allemagne avec plus d'un million d'exemplaires vendus et l'acquisition de ses droits pour une trentaine de traductions. Or le moins qu'on puisse dire est que le thème du roman n'a rien d'accrocheur a priori: ni violence ni sexe, mais le récit alterné des mésaventures de deux illustres savants de la fin du XVIIIe siècle allemand: le naturaliste-explorateur Alexander von Humboldt et le mathématicien génial Carl Friedrich Gauss.
Relevant du gai savoir fantaisiste plus que de la reconstitution fidèle, le roman confronte deux façons d'explorer le monde à la fois opposées et complémentaires – Humboldt sillonne et cartographie le monde du fin fond de l'Amazonie au bout des steppes sibériennes, tandis que Gauss scrute les nébuleuses mathématiques ou les galaxies physiques sans quitter ses savates – et deux attitudes par rapport à la science: l'optimisme scientiste pour Humboldt, et le scepticisme plus humble pour Gauss.
Un récit effréné
Dès les premières pages du roman, où l'on voit le vieux Gauss râler comme un schnock à l'idée d'avoir à se pointer à Berlin (nous sommes en 1828) à un congrès de naturalistes où le convie Humboldt en qualité d'invité d'honneur, l'irrésistible drôlerie du récit se mêle au plaisir de la découverte. Car le titre du roman tient bientôt sa promesse: c'est le monde que le lecteur va bel et bien arpenter au fil des investigations alternées des deux inénarrables savants.
D'un côté, voici donc Humboldt l'aristo craignant les femmes, naturaliste curieux de tout, géographe parti pour mesurer le monde entier de la première colline de Salzburg à la plus insondable grotte pleine d'oiseaux-radars d'Amérique du Sud, dont les expéditions cocasses évoquent à la fois Rodolpe Töpffer en ses zigzags loufoques et Blaise Cendrars au plus long cours. De l'autre, issu de milieu populaire: le farouche Gauss qui sidère son maître d'école dès l'âge de huit ans, multiplie les découvertes que ses profs publient sous leur nom avant que son premier maître-ouvrage n'en fasse le prince des mathématiciens européens. Si la trajectoire de von Humboldt, ami de Goethe et frère d'un éminent diplomate, recoupe celle des grands de ce monde, le parcours de Gauss est à la fois plus individualiste et plus familial, d'une première femme adorée aux tribulations d'un fils tenté par les idées nouvelles qu'il tyrannise et force à se refaire une vie meilleure en Amérique.
Tissé de malice, le roman du trentenaire Daniel Kehlmann évoque une Allemagne éminemment cultivée que l'on n'imagine pas, évidemment, régresser un jour dans la barbarie. Avec un clin d'œil à chaque paragraphe, le romancier ne cesse cependant de montrer, chez ses deux protagonistes, les aspects tout humains de vieux gamins égomanes ou de tyrans domestiques, de même que les Lumières philosophiques de l'époque (Kant toussote encore dans son coin) vont de pair avec de vraies ténèbres politiques ou policières. La satire est souvent carabinée, mais la tonalité du livre reste débonnaire, avec une nuance plus mélancolique sur la fin. Il en découle un immense plaisir de lecture, qu'on se réjouit de voir si largement partagé…
Daniel Kehlmann. Les arpenteurs du monde. Traduit de l'allemand (magnifiquement) par Juliette Aubert. Actes Sud, 299 pp.
Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 9 janvier 2007. -
Goncourt du premier roman
L’Académie « innove » en rebaptisant sa Bourse. Tatiana Arfel eût été une découverte moins convenue que les papables…
La découverte d’une voix «inouïe », d’une nouvelle « papatte » ou d’un univers «jamais-vu » constitue un moment gratifiant pour le passionné de lecture. L’apparition de Ramuz par Aline, premier chef-d’œuvre d’un garçon de vingt-quatre ans, ou celle de Michel Houellebecq par Extension du domaine de la lutte, ont fait date. Si la catégorie du premier roman n’est pas une valeur en soi, il paraît légitime de soutenir un auteur prometteur à ses débuts. D’où les divers prix et autres bourses qui mettent en exergue l’appellation, sans oublier le Festival du premier roman de Chambéry...
Depuis 1977, le Prix du premier roman, actuellement présidé par Joël Schmidt, a signalé, sur l’ensemble des lauréats, un bon quart de jeunes auteurs dont les œuvres ont « décollé » par la suite, tels Alexandre Jardin, Isabelle Jarry, Christophe Bataille ou Boualem Sansal. A signaler pourtant que le palmarès s’en tient exclusivement à l’édition parisienne, et que son impact médiatique ou commercial reste limité. Même remarque pour le Prix du Premier roman du Doubs, parrainé cette année par David Fœnkinos, romancier primé dès son premier livre (Prix Mauriac de l’Académie française) et qui remarque : «Un prix pour un premier roman, c’est un coup de pouce décisif. Il paraît tant de livres chaque année qu’il n’est pas facile de se faire remarquer autrement. D’ailleurs, il n’y a pas de petits prix. D’abord parce que c’est toujours agréable d’en recevoir un, ensuite parce que ça ouvre des portes, retient l’attention des libraires et des lecteurs, suscite d’autres prix ».
Label Goncourt
Edmond de Goncourt prévoyait, dans son testament, un soutien particulier aux jeunes auteurs. La chose s’est parfois concrétisée avec le Prix Goncourt lui-même, mais un legs, datant de 1914, a institué la Bourse Goncourt du premier roman, dont le palmarès de ces trente dernières années est à vrai dire plus chiche en vraies découvertes que celui du Prix du Premier roman lui-même, et très marqué par le label Gallimard.
Or la liste des six derniers nominés du nouveau Prix Goncourt du premier roman, qui remplace la « bourse » de naguère et sera décerné le 3 mars prochain, recycle également deux poulains Gallimard de la course au Goncourt de l’automne dernier, avec certain air de réchauffé: le finaliste de novembre Jean-Baptiste del Amo, pour Une éducation libertine, et Tristan Garcia, avec La meilleure part des âmes, déjà très largement médiatisés. Or on espère un choix moins « téléphoné », même si les autres lauréats, tel Laurent Nunez avec Les récidivistes (Champvallon), Paul Andreu avec La maison (Stock) ou Justine Augier avec Son absence (Stock) font assez pâle figure. Quant à la plaisante vacherie bien parisienne de Marion Ruggieri, avec Pas ce soir, je dîne avec mon père (Grasset), elle ne relève guère non plus de l’alternative excitante. Le premier roman de Tatiana Arfel (lire encadré) nous semble d’une tout autre originalité. Son premier « prix » aura consisté en son insertion, chez José Corti, dans la prestigieuse collection Merveilleux, à côté de Robert Walser, de Daniel Defoe ou de Bram Stoker. Excusez du peu !
Une belle fable de l'enfance bafouée
C’est une sorte de grande fable, apparemment naïve, en réalité lestée d’une profonde expérience de la vie, que L’Attente du soir de Tatiana Arfel. La jeune romancière (née à Paris en 1979) y raconte l’histoire, qui pourrait sembler invraisemblable, de trois naufragés de l’existence dont le récit des destinées alterne avant de les faire s’entrecroiser: un vieux clown malmené par ce qu’il appelle « le Sort», une femme «éteinte» par le manque d’amour et un enfant sauvage, « slumdog » des gadoues contemporaines qui aurait dû y crever. Cela pourrait être d’un kitsch achevé, et c’est immédiatement prenant, envoûtant même, évoquant à la fois les enfants d’Agota Kristof ou de Romain Gary, avec quelque chose de pourtant inouï et de jamais vu qui tient à la saisissante porosité émotionnelle de l’auteur et à sa capacité d’exprimer, avec ses mots, simples, et ses images, très concrètes, toute la tristesse de la vie froide et toute la merveille du monde revivifié par les gestes de la tendresse et par la capacité créatrice de notre drôle d’espèce, de Lascaux à l’art brut.
L’Attente du soir ne se raconte pas. Une analyse de ce roman très substantiel, mais toujours lisible, demanderait un long développement. J'y reviendrai d'ailleurs. Mais plus important me semble cependant, dans l’immédiat, de «vivre» ce livre de la solitude et des séquelles du manque d’attention et d’affection, mais aussi de la possible rédemption. Face à la grisaille du monde et au mur d’indifférence qui sépare les êtres, Tatiana Arfel réaffirme une foi candide mais non moins impérieuse en les pouvoirs du langage poétique ou artistique. D’aucuns ricaneront peut-être, tant l’ingénuité de ce livre, en rupture totale avec le cynisme ambiant, détone et surprend, mais c’est aussi sa force, exigeant du moins la plus vive attention, et le même abandon qu’en nos enfances, à rire et pleurer en lisant nos premiers livres…Tatiana Arfel, L’Attente du soir. José Corti, 325p.
Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du samedi 21 février 2009.
-
L’humour de Tanguy Viel
On se régale à la lecture de Paris-Brest…
On ne sait pas trop à quoi ça tient, mais il y a quelque chose d’irrésistible dans Paris-Brest, le nouveau roman de Tanguy Viel, qui tient à la fois à l’horreur de la situation et à son comique imprévisible, sans compter le bonheur de sa phrase et la poésie singulière de ses évocations. Il y est question, dans une ville affreuse (Brest reconstruite l’a été de façon affreuse), d’un jeune Candide mal tombé question famille, entre une mère froidement dominatrice et imbue de ses principes bourgeois, et un père faible livré à l’opprobre de toute la ville à la suite d’un scandale footballistico-financier. Dès son enfance, Louis a été humilié par l’entraîneur des Poussins locaux, qui a décidé qu’il ne serait jamais un grand footballeur, et par sa mère le traitant d’imbécile après sa chute dans le bassin d’un jardin municipal. Au début du roman, on ne sait rien de tout ça, sinon que les parents du narrateur se trouvent exilés en Languedoc-Roussillon tandis que Louis reste auprès de sa grand-mère devenue richissime sans le vouloir après s’être montrée aimable envers un très très vieux client du Cercle Marin où elle a ses habitudes, Albert de son prénom.
Chassés au sud pour un trou de 14 millions dans les comptes du Stade Brestois, les parents de Louis vont vivre trois ans loin de la grand-mère aux œufs d’or (dix-huit millions) sur laquelle veille son petit-fils préféré tandis que son frère s’engage dans une carrière de footballeur. Louis fait un peu office de concierge pour son aïeule, laquelle a promis à Albert, après la mort de celui-ci, dûment advenue, de garder sa femme de ménage, Madame Kermeur, flanquée de son fils, dit le fils Kermeur, âme damnée du narrateur, que la mère de celui-ci, qui n’aime pas les pauvres, a fait renvoyer de l’école après un vol dans un supermarché. On ne va pas entrer dans le détail de ce « roman familial » à la fois parodique et tout à fait plausible, aux personnages finement ciselés et aux situations explosives dès lors que l’argent de la vieille a rendu un peu d’espoir de réhabilitation à la mère de Louis, lequel explique au fils Kermeur, son envahissant ami, que pour elle « le monde est une sorte de grand cercle et au milieu il y a une montagne d’argent et sans cesse des gens entrent dans le cercle pour essayer de gravir la montagne et planter un drapeau en haut »…
Le bonheur de cette lecture découle de plusieurs de ses composantes, à commencer par son endiablement narratif à récurrences rageuses rappelant parfois un Thomas Bernhard à la française. Et puis il y a la combinatoire de ladite narration, ingénieuse et décapante à la fois. Le roman familial est en effet celui que nous avons en mains, mais le texte manuscrit transporté comme une bombe par Louis, qui revient pour un Noël à Brest après son établissement à Paris et son début de carrière d’écrivain, dans la maison cossue en bord de mer acquise par ses parents avec l’argent de la grand-mère claquemurée dans un grenier; et, troisièmement, le récit virtuel de «la vie» elle-même, que le lecteur reconstitue à sa façon. Or les divers plans de la narration se combinent parfaitement dans le temps du roman et ses espaces, impliquant aussi les interférences redoutables entre la «vérité» de l’observateur romancier, espion redouté des familles («est-ce que tu parles de nous ?»), et les versions de chacun, parfois aussi plausibles que celle-là. Tout cela rendu avec une malice cruelle, mais frottée d'un zeste de tendresse et surtout de gaîté vache à l’anglaise. Le roman qui en résulte scintille enfin de mille facettes sans se réduire à un exercice de virtuosité, tant il est incarné, sensible, imprégné de cette bonne méchanceté qui caractérise les humoristes profonds.
Tanguy Viel. Paris-Brest. Minuit, 2009, 189p.








