
Avec Proust et Frédéric Ferney sur les hauts de Caux. Lecture de rando (2)
Marcel Proust ne s’est guère arrêté à Montreux quand il y passa en 1899, trop fauché pour se payer le petit funiculaire à crémaillère de Glion (cher à Henri Calet, qui en parle dans Rêver à la Suisse), qu’il eût sans doute apprécié lui aussi, et plus encore le tortillard de montagne qui escalade les roides pentes jusqu’au sommet des Rochers de Naye, d’où la vue plonge sur le lac comme sur Rio du haut du Pain de Sucre. Ici c’est la Dent de Jaman qui a l’air d’un pain de sucre (certains passants étrangers la confondent avec le Cervin…) et ce n’est pas par le train des neiges mais par la piste noire dite du Diable que j’ai fait ma balade du jour avec, en poche, un petit livre récemment paru au Castor astral sous le titre de Précaution inutile, constituant une espèce de première mouture de La prisonnière, préfacé par Frédéric Ferney.
Ici c’est la Dent de Jaman qui a l’air d’un pain de sucre (certains passants étrangers la confondent avec le Cervin…) et ce n’est pas par le train des neiges mais par la piste noire dite du Diable que j’ai fait ma balade du jour avec, en poche, un petit livre récemment paru au Castor astral sous le titre de Précaution inutile, constituant une espèce de première mouture de La prisonnière, préfacé par Frédéric Ferney.
Conformément au principe de la lecture de rando, j’ai d’abord gravi la première pente enneigée dominant les Hauts de Caux (où François Nourissier avait naguère son chalet) jusqu’au lieu dit Le Pacot, où je me suis arrêté près d’une fontaine à l’eau gloussant sous la glace pour lire ceci : « Avant Turner, il n’y avait pas de brumes sur la Tamise, disait Oscar Wilde. Avant Proust, on ne savait pas ce qu’était le chagrin, et ce loisir enchanté que devient en prose la tristesse. Et peut-être aussi ce ressentiment, ce ressac amer du sentiment, qui naît d’un amour déçu, et que Proust érige en joie sombre – quelque chose comme l’envers du bonheur et l’un des plus sûrs chemins de la vérité ».
Voilà comment écrit Frédéric Ferney. Qui ajoute : « Il y a un je-ne-sais-quoi d’absolu, de fanatique dans ce processus ».
En relevant les yeux de ce premier paragraphe d’une sensibilité si moirée, j’ai constaté que le jour déclinait déjà (j’étais parti tard) et que la mer de brouillard recouvrait presque entièrement le lac Léman, comme d’un édredon… proustien. Derrière moi, la Dent de Jaman flamboyait de dernière lumière orangée. Devant, une pente vertigineuse semblant un toboggan par lequel on eût pu se précipiter jusqu’au lac. Pour ma part, je suis alors descendu à freine-raquette jusqu’à un banc d’où le couchant rougeoyait. Et là j’ai continué ma lecture de la présentation de Frédéric Ferney : «L’intelligence de Proust est pure, conquérante, archaïque, révolutionnaire, contagieuse comme un islam ou un christianisme premier : on croit s'engouffrer, et pourtant tout est imbu de clarté, comme si on entrait dans les ordres..."
Ainsi est aussi, parfois, la marche en montagne, comme ces jours de neige et d’air de cristal.
Et Ferney encore : « A lire ce texte (il parle de Précaution inutile), inespéré, on est ému comme devant un pastiche tant Proust se ressemble, et se décèle d’emblée à sa perception du détail, à sa cruauté, à sa douceur maladive, à certains petits émois frileux et surannés qui ornent son style et que Saint-Simon, son maître lointain, aurait rougi de connaître ». Et voici encore comment Frédéric Ferney pratique la lecture-écriture critique : « Du blanc, du bleu et du noir. C’est sa palette – comme Vermeer, qu’il admirait tant.
Et voici encore comment Frédéric Ferney pratique la lecture-écriture critique : « Du blanc, du bleu et du noir. C’est sa palette – comme Vermeer, qu’il admirait tant.
« Le froid, c’est le pays d’où il vient et qui ne le quitte pas : écrire, ce sera rompre avec des lenteurs d’hiver, des paniques immobiles, des peurs bleues comme la glace. Il faudra beaucoup d’encre noire et de nuits blanches pour faire fondre cette «banquise invisible détachée d’un hiver ancien ». Proust n’a pas connu Montreux, mais il a retrouvé une sorte de Montreux suspendu, plus japonais de lumière, mais au même confluent du nord et du sud, où nature et culture s’aiment (avec Nietzsche et Thomas Mann, Rilke et Jouve et bien d’autres), dans l’Engadine de Sils-Maria. On retrouve la trace de ses séjours dans Mille et un voyages, de la collection Voyager avec, un volume riche et truffé d’images émouvantes ou cocasses, mais aussi dans Marcel Proust sur les Alpes de Luzius Keller, où il est surtout question du séjour de l’été 1893 du gentil Marcel avec Louis de La Salle.
Proust n’a pas connu Montreux, mais il a retrouvé une sorte de Montreux suspendu, plus japonais de lumière, mais au même confluent du nord et du sud, où nature et culture s’aiment (avec Nietzsche et Thomas Mann, Rilke et Jouve et bien d’autres), dans l’Engadine de Sils-Maria. On retrouve la trace de ses séjours dans Mille et un voyages, de la collection Voyager avec, un volume riche et truffé d’images émouvantes ou cocasses, mais aussi dans Marcel Proust sur les Alpes de Luzius Keller, où il est surtout question du séjour de l’été 1893 du gentil Marcel avec Louis de La Salle.  Je n’ai rien dit de Précaution inutile, mais ce sera pour une autre randonnée, alors que l’air fraîchit et que la nuit tombe sur l’édredon proustien. Quant à Frédéric Ferney, outrageusement interdit de péniche, il se retrouve dès aujourd’hui sur son blog à cette adresse, passant du Bateau-livre au Bateau libre : http://fredericferney.typepad.fr/. Bon vent à lui.
Je n’ai rien dit de Précaution inutile, mais ce sera pour une autre randonnée, alors que l’air fraîchit et que la nuit tombe sur l’édredon proustien. Quant à Frédéric Ferney, outrageusement interdit de péniche, il se retrouve dès aujourd’hui sur son blog à cette adresse, passant du Bateau-livre au Bateau libre : http://fredericferney.typepad.fr/. Bon vent à lui.
Marcel Proust. Précaution inutile. Edition présentée par Frédéric Ferney. Le castor astral, 173p.
Marcel Proust, Mille et un voyages. Textes présentés et choisis par Anne Borrel. LaQuinzaine/Vuitton, 375p.
Luzius Keller. Marcel Proust sur les Alpes. Zoé, 135p.

 Tel est le sens de l’agenouillement : « Cet enfant, quand il se met à genoux devant lui, n’a plus de frontières ». Cela se fait sans sacrifier aux caprices éventuels d’une tyrannie enfantine : « Tu ne perds rien pour attendre, mon gaillard. Ton immensité, je vais te la faire mériter ».
Tel est le sens de l’agenouillement : « Cet enfant, quand il se met à genoux devant lui, n’a plus de frontières ». Cela se fait sans sacrifier aux caprices éventuels d’une tyrannie enfantine : « Tu ne perds rien pour attendre, mon gaillard. Ton immensité, je vais te la faire mériter ». La neige est comme un désert, et c’est par le désert que passe l’Errant du Marcheur à genoux. Il a fui la ville comme nous éprouvons tous, à certains moments, le besoin de la fuir pour nous retrouver : «L’Errant accusait les objets de voler leur place aux arbres et aux choses vivantes, de créer des faims nouvelles, de puiser dans les pays habités par les pauvres pour être achetés par les riches, de creuser l’abîme entre les possesseurs et ceux qui ne possèdent pas ». Mais c’est aussi le désert qui dit ensuite à l’Errant : Retrouve la ville ». Et justement, touchant au dernier sommet, que je résolus ce matin de rebaptiser secrètement Pointe Henrard (1777m.) je me retournai vers l’immensité du brouillard troué, là-bas, découvrant une ville humaine au bord du lac immense.
La neige est comme un désert, et c’est par le désert que passe l’Errant du Marcheur à genoux. Il a fui la ville comme nous éprouvons tous, à certains moments, le besoin de la fuir pour nous retrouver : «L’Errant accusait les objets de voler leur place aux arbres et aux choses vivantes, de créer des faims nouvelles, de puiser dans les pays habités par les pauvres pour être achetés par les riches, de creuser l’abîme entre les possesseurs et ceux qui ne possèdent pas ». Mais c’est aussi le désert qui dit ensuite à l’Errant : Retrouve la ville ». Et justement, touchant au dernier sommet, que je résolus ce matin de rebaptiser secrètement Pointe Henrard (1777m.) je me retournai vers l’immensité du brouillard troué, là-bas, découvrant une ville humaine au bord du lac immense.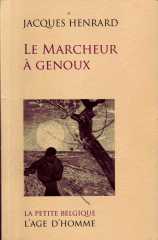 Jacques Henrard. Le marcheur à genoux. L’Age d’Homme, collection La Petite Belgique, 106p.
Jacques Henrard. Le marcheur à genoux. L’Age d’Homme, collection La Petite Belgique, 106p.
 D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque.
D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque. Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac.
Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac. Arnaud Rykner. Enfants perdus. Le Rouergue, coll. la brune, 92p. Disponible en librairie dès janvier 2009.
Arnaud Rykner. Enfants perdus. Le Rouergue, coll. la brune, 92p. Disponible en librairie dès janvier 2009.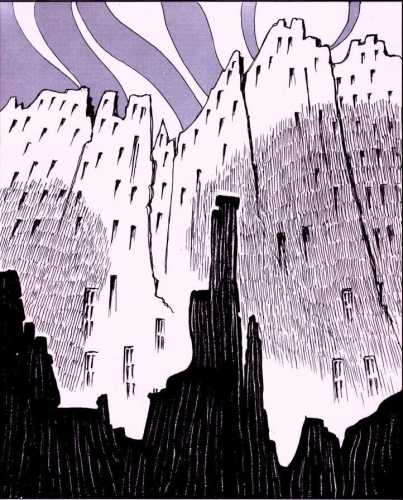
 L’arête atteinte, l’équilibre entre deux vertiges, étroite rue où danser – Là-bas murs et seringues, voilà pour manger, trajets tracés, tous les bruits du monde -, ici l’ouvert par delà l’obscur et l’indistinct :
L’arête atteinte, l’équilibre entre deux vertiges, étroite rue où danser – Là-bas murs et seringues, voilà pour manger, trajets tracés, tous les bruits du monde -, ici l’ouvert par delà l’obscur et l’indistinct :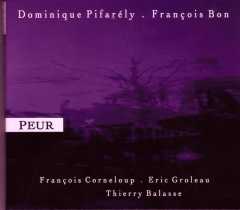 Cette divagation de rando suit les séquences lues (François Bon en diseur d’extrême sensibilité) de Peur, sur ses textes (cités ici en italiques) et des compositions de Dominique Pifarély (au violon, sur de magnifiques variations), avec François Corneloup (sax baryton), Eric Groleau (batterie) et Thierry Balasse (électro-acoustique).
Cette divagation de rando suit les séquences lues (François Bon en diseur d’extrême sensibilité) de Peur, sur ses textes (cités ici en italiques) et des compositions de Dominique Pifarély (au violon, sur de magnifiques variations), avec François Corneloup (sax baryton), Eric Groleau (batterie) et Thierry Balasse (électro-acoustique).
 Ce que j’aime bien, dans le processus de la lecture de rando, c’est qu’elle remet en somme un livre à distance et dans sa juste proportion avec l’univers environnant. Les hauts de Morcles, en dessus de Saint-Maurice, à peu près à 1600 mètres d’altitude, au debouché d’une longue route forestière sinueuse et très étroite bordée de fortifications militaires datant de la dernière guerre (toute la montagne est truffée de forts et de casernes souterraines) s’ouvrent soudain sur un paysage d’une grande majesté, dominé d’un côté par la Dent de Morcles et de l’autre par la Cime de l’Est avec, en arrière-fond, l’Aiguille verte et les Drus.
Ce que j’aime bien, dans le processus de la lecture de rando, c’est qu’elle remet en somme un livre à distance et dans sa juste proportion avec l’univers environnant. Les hauts de Morcles, en dessus de Saint-Maurice, à peu près à 1600 mètres d’altitude, au debouché d’une longue route forestière sinueuse et très étroite bordée de fortifications militaires datant de la dernière guerre (toute la montagne est truffée de forts et de casernes souterraines) s’ouvrent soudain sur un paysage d’une grande majesté, dominé d’un côté par la Dent de Morcles et de l’autre par la Cime de l’Est avec, en arrière-fond, l’Aiguille verte et les Drus.  Ce décor contraste pour le moins avec le climat du récit d’Aggoune, mais après avoir chaussé mes raquettes et gravi une longue pente, jusque sur un promontoire, j’ai lu les phrases suivantes dans une disposition particulière qui en accentuait le relief.
Ce décor contraste pour le moins avec le climat du récit d’Aggoune, mais après avoir chaussé mes raquettes et gravi une longue pente, jusque sur un promontoire, j’ai lu les phrases suivantes dans une disposition particulière qui en accentuait le relief. Heureux celui qui a été adoubé par son père. Mais heureux aussi celui qui retrouve son père manquant.
Heureux celui qui a été adoubé par son père. Mais heureux aussi celui qui retrouve son père manquant.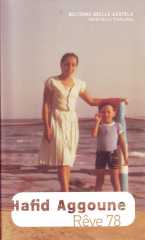 Hafid Aggoune, Rêve 78. Joëlle Losfeld, 63p.
Hafid Aggoune, Rêve 78. Joëlle Losfeld, 63p.
 Dans les cent premières pages des Voyageurs du temps, Sollers parle de son corps, comme d’une espèce de double n’en faisant parfois qu’à sa tête (de nœud), puis il consacre de belles pages à l’antagonisme de la Bête (on dira pour faire court : le génie) et du Parasite, avant de bifurquer vers les irréguliers, de Kafka et Nietzsche à Rimbaud et Lautréamont via T.E. Lawrence. Dans la foulée, le roman s’est déjà transformé en soliloque tissé de phrases fringantes, mais c’est le moment de reprendre la rando.
Dans les cent premières pages des Voyageurs du temps, Sollers parle de son corps, comme d’une espèce de double n’en faisant parfois qu’à sa tête (de nœud), puis il consacre de belles pages à l’antagonisme de la Bête (on dira pour faire court : le génie) et du Parasite, avant de bifurquer vers les irréguliers, de Kafka et Nietzsche à Rimbaud et Lautréamont via T.E. Lawrence. Dans la foulée, le roman s’est déjà transformé en soliloque tissé de phrases fringantes, mais c’est le moment de reprendre la rando. L’air est cristallin comme une page du grand Paon, l’azur cingle et le lac là-bas, immense fleuve immobile dans sa gaze de soie bleutée, a l'air de penser comme le dieu danse (mauvaise influence de Zarathoustra...) et comme Dantzig fait ses listes en dents de scie.
L’air est cristallin comme une page du grand Paon, l’azur cingle et le lac là-bas, immense fleuve immobile dans sa gaze de soie bleutée, a l'air de penser comme le dieu danse (mauvaise influence de Zarathoustra...) et comme Dantzig fait ses listes en dents de scie.