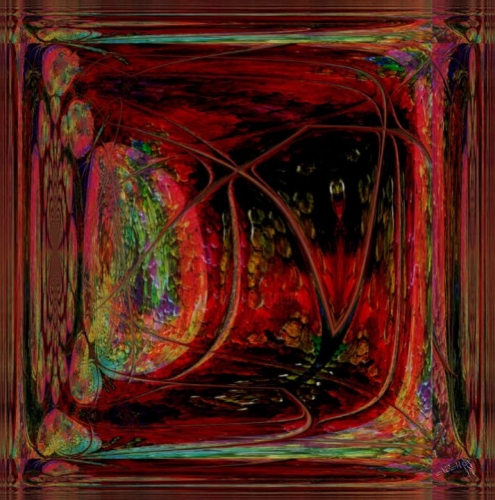À propos de Vallotton est inadmissible, de Maryline Desbiolles.
Pas mal de gens ne voient en la peinture qu'un élément de décoration (on dit aujourd'hui déco, et ça cartonne à la télé), qu'il s'agisse de prairies fleuries à la Monet pour faire ambiance champêtre, en consonance avec les rideaux à ramages du salon, ou de motifs abstraits à la Mondrian pour la cuisine ou la salle de bain. Il n'y a d'ailleurs rien de mal à cela: les musées croulent de peinture décorative, et Monet, ou Bonnard, restent de merveilleux jardiniers-ensembliers.
Mais la peinture-peinture est aussi autre chose, qui nous cloue, et c'est ce qu'exprime immédiatement Maryline Desbiolles dans le petit livre dense qu'elle consacre à se fréquentation de longue date avec la peinture de Félix Vallotton, immédiatement appariée à l'univers de Proust.
 La première expérience dont elle témoigne n'a pas à voir directement avec la peinture, plutôt liée à une expérience plus fondamentale, qu'on pourrait dire pompeusement ontologique, découlant en effet du saisissement que tout un chacun peut éprouver en constatant soudain l'unicité plus ou moins vertigineuse de son être (je suis moi et pas un autre...), comme Maryline Desbiolles l'a vécu en son enfance, du côté d'Antibes, en voyant soudain un olivier au bord d'une route (cet olivier et pas un autre). Cette expérience fondamentale de notre présence au monde qui donne à certains la nausée (suivez le regard de Sartre) et en fait léviter d'autres (Cingria n'a pas son pareil pour chanter "l'être qui se reconnaît) relève aussi bien de la métaphysique ou de la poésie, et l'art en cristallise les vertiges d'angoisse ou les "minutes heureuses". Plus précisément, certains artistes nous font revivre ce qui n'a souvent été qu'un ébranlement passager et nous illuminent ou nous clouent.
La première expérience dont elle témoigne n'a pas à voir directement avec la peinture, plutôt liée à une expérience plus fondamentale, qu'on pourrait dire pompeusement ontologique, découlant en effet du saisissement que tout un chacun peut éprouver en constatant soudain l'unicité plus ou moins vertigineuse de son être (je suis moi et pas un autre...), comme Maryline Desbiolles l'a vécu en son enfance, du côté d'Antibes, en voyant soudain un olivier au bord d'une route (cet olivier et pas un autre). Cette expérience fondamentale de notre présence au monde qui donne à certains la nausée (suivez le regard de Sartre) et en fait léviter d'autres (Cingria n'a pas son pareil pour chanter "l'être qui se reconnaît) relève aussi bien de la métaphysique ou de la poésie, et l'art en cristallise les vertiges d'angoisse ou les "minutes heureuses". Plus précisément, certains artistes nous font revivre ce qui n'a souvent été qu'un ébranlement passager et nous illuminent ou nous clouent.
 L'olivier solitaire de Marylin Desbiolles lui est apparu soudain comme "en trop", non sans lui faire éprouver un choc: "C'était violent. D'une violence qui faisait crisser les dents". Or elle a retrouvé cette même violence dans la peinture de Vallotton, même si le premier tableau dont elle croit se souvenir est le fameux Ballon de 1899, figurant un petit garçon à chapeau de paille - un "garçon-soleil",écrit-elle -, qui lui évoquera plus tard le petit Marcel, dans La Recherche, jouant avec Gilberte dans les jardins des Champs-Elysées.
L'olivier solitaire de Marylin Desbiolles lui est apparu soudain comme "en trop", non sans lui faire éprouver un choc: "C'était violent. D'une violence qui faisait crisser les dents". Or elle a retrouvé cette même violence dans la peinture de Vallotton, même si le premier tableau dont elle croit se souvenir est le fameux Ballon de 1899, figurant un petit garçon à chapeau de paille - un "garçon-soleil",écrit-elle -, qui lui évoquera plus tard le petit Marcel, dans La Recherche, jouant avec Gilberte dans les jardins des Champs-Elysées.
C'est alors qu'il faut regarder, plus attentivement, cette toile que Maryline Desbiolles découvrit sur une carte postale, avant de la revoir au musée d'Orsay en grandeur nature, pour en déchiffrer la profondeur cachée sous la scène apparemment anodine. Violence de Vallotton ? Certes pas au premier regard, dans cette toile apparemment candide. Mais en voit-on assez l'ombre ? A-t-on bien regardé ? Que nous dit cet enfant vu du ciel ? Voit-on assez le poids de ce vert lesté de noir; et ces deux minuscules personnages blanc et bleu, au fond de la toile, semblant se parler comme Dante et son guide, ne participent-ils pas eux aussi à l'étrangeté de la scène. Ce n'est pas, à proprement parler, ce que dit Maryline Desbiolles: c'est mon sentiment que j'exprime, à travers ce que je perçois de ce tableau, comme elle exprime son sentiment à elle en regardant avec Vallotton.
De même Maryline Desbiolles évoque-telle les intérieurs de Vallotton (dans lesquels ses personnages ne semblent jamais se fondre tout à fait, jamais à l'aise, contrairement à ceux de Vuillard), ou les nus féminins de Vallotton, soit endormis soit mal consentants. Mais a-t-on assez regardé ces chambres et ces corps ? A-t-on été assez attentif à la terrible confrontation de ses rouges et de ses verts ? A-t-on assez regardé ce que profèrent ou vocifèrent les couleurs de ses paysages ? A-t-on assez vu la beauté sidérante de la nature vue par Vallotton, dont le regard croise souvent ceux de Munch ou de Nolde, comme sa conception de la guerre des sexes (dans son roman La vie meurtrière) rencontre celle de Strindberg ou d'Ibsen ?
"J'ai beau regarder le monde avec Vallotton", écrit Maryline Desbiolles, "j'ai beau le regarder tout crûment, je ne peux me résoudre, pas plus que Vallotton, à ce que le monde soit désenchanté. Car, en vérité, il ne l'est pas."
Evidemment, l'enchantement du monde vu par Vallotton n'a rien d'une romance: c'est un saisissement. "Vallotton me cloue le bec", écrit encore Maryline Desbiolles. Francis Bacon prétendra, plus tard, toucher "directement le système nerveux" par ses couleurs, elle aussi acérées comme des clous. Or, en marge de l'expressionnisme, par delà le projet nabi, Vallotton frôle souvent le fantastique sans céder jamais à ses convulsions (comme dans les paysages de Schiele ou Soutine) ni perdre de sa force expressive.
Maryline Desbiolles est venue à Lausanne et, devant le Léman, n'a pas vu l'aimable lac bleu-vert ou gris-sabre à l'étendue placide, mais "un gouffre". C'est voir avec les yeux de Vallotton...
"Regarder Vallotton", écrit-elle encore, "regarder un Vallotton, regarder est violent. Il faut sans doute jouer le jeu, consentir à sa propre violence pour seulement commencer de voir un de ses tableaux. "Nous sommes au bord du paysage, au bord dune falaise ou d'un champ de betteraves, nous ne reconnaissons rien, nous sommes dépossédés, mais nous nous sentons fortement étreints".
 La fin de cet indispensable petit livre (on court l'acheter et la file d'attente au Grand Palais en permettra la lecture en moins d'une heure) évoque une pêche nocturne au lamparo du côté de Cagnes-sur-Mer, où Vallotton a peint et où a vécu Maryline Desbiolles. Mais avant cette conclusion, il faut citer encore ce que l'auteure écrit à propos de La Mare, paysage Honfleur, où elle détaille "une étreinte d'autant plus brusque qu'on ne s'y attendait pas": "La nuit est tombée à présent. Le trou noir de la mare a été découpée au rasoir sur la nappe des lentilles d'eau d'un vert jaune acidulé. Nous serrons les dents. Au bord, sur l'herbe rase, une tignasse ébouriffée de joncs. Dans le fond, on devine un bosquet. Mais surtout, à gauche, un grand sureau dont les ombelles blanches poudroient. Me revient inopinément, une nouvelle fois, le conte de Perrault, Barbe-bleue, "Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie", dit Anne, ma soeur Anne. Il se pourrait que Vallotton ait attendu la nuit et l'éclairage de la lune pour débusquer la mare du conte, son entaille trop précise, affolante dans la verdure. La mare est une découpe de ténèbres, elle se casse le nez sur le bord droit du tableau où apparaissent des ondes que je vois tout à coup. Est-ce là le dessin d'une source ou, plus inquiétant, d'un tourbillon qui achèverait de nous entraîner dans le noir, de nous perdre ?"
La fin de cet indispensable petit livre (on court l'acheter et la file d'attente au Grand Palais en permettra la lecture en moins d'une heure) évoque une pêche nocturne au lamparo du côté de Cagnes-sur-Mer, où Vallotton a peint et où a vécu Maryline Desbiolles. Mais avant cette conclusion, il faut citer encore ce que l'auteure écrit à propos de La Mare, paysage Honfleur, où elle détaille "une étreinte d'autant plus brusque qu'on ne s'y attendait pas": "La nuit est tombée à présent. Le trou noir de la mare a été découpée au rasoir sur la nappe des lentilles d'eau d'un vert jaune acidulé. Nous serrons les dents. Au bord, sur l'herbe rase, une tignasse ébouriffée de joncs. Dans le fond, on devine un bosquet. Mais surtout, à gauche, un grand sureau dont les ombelles blanches poudroient. Me revient inopinément, une nouvelle fois, le conte de Perrault, Barbe-bleue, "Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie", dit Anne, ma soeur Anne. Il se pourrait que Vallotton ait attendu la nuit et l'éclairage de la lune pour débusquer la mare du conte, son entaille trop précise, affolante dans la verdure. La mare est une découpe de ténèbres, elle se casse le nez sur le bord droit du tableau où apparaissent des ondes que je vois tout à coup. Est-ce là le dessin d'une source ou, plus inquiétant, d'un tourbillon qui achèverait de nous entraîner dans le noir, de nous perdre ?"
Maryline Desbiolles, Vallotton est inadmissible. Seuil, coll. Fiction & Cie, 43p.















 Giacometti rime-t-il avec Betty Bossi ?
Giacometti rime-t-il avec Betty Bossi ?



 Anker pré-pédophile et Hodler «obscène» militariste?
Anker pré-pédophile et Hodler «obscène» militariste?