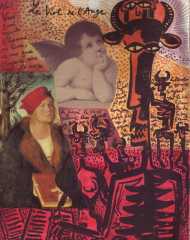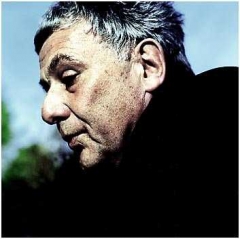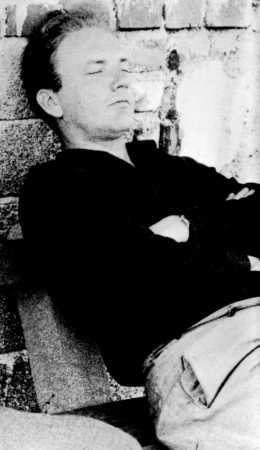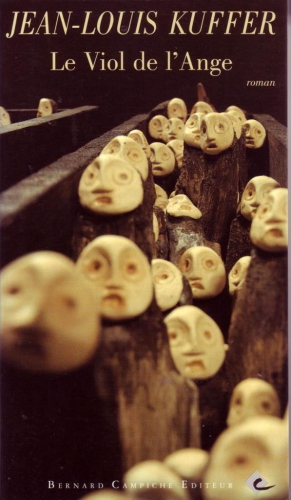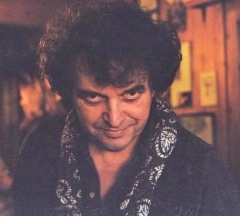Livre - Page 14
-
Les bons enfants
 (Chanson en mémoire de Thomas Platter)Ils vont marchant d’un pas joyeux:ce sont les escholiers,les petits savants renaissantsaux souliers recollés...Descendus des monts enneigés,chantant et mendiant,ils vont là-bas par les vergers,priant et grappillant...Les pays en guerre et la pestene les arrêtent pas,et jamais ils ne sont en restede nouveaux débats...Les Maîtres les ont accueillisde Bâle à Cracovie,plus que jamais tout réjouis,jusques aux Pays-Bas...Le latin n’a plus de secretspour ces gais chenapans,et Platon l’éveilléles conduit à travers le temps...À nos seize ans les rencontrantau détour d’un chemin,à mon tour je suis devenu,plus libre que jamais en erre,bon enfant autoproclaméet dûment diplôméDe l’université buissonnière...(Contrerimes advenues en marge de la lecture du Problème Spinoza, très remarquable roman d’Irvin Shalom évoquant les apprentissages contrastés de Baruch à Amsterdam et d’Alfred Rosenberg le futur genocidaire de la Solution finale qui fit main basse sur la bibliothèque du philosophe en 1941)
(Chanson en mémoire de Thomas Platter)Ils vont marchant d’un pas joyeux:ce sont les escholiers,les petits savants renaissantsaux souliers recollés...Descendus des monts enneigés,chantant et mendiant,ils vont là-bas par les vergers,priant et grappillant...Les pays en guerre et la pestene les arrêtent pas,et jamais ils ne sont en restede nouveaux débats...Les Maîtres les ont accueillisde Bâle à Cracovie,plus que jamais tout réjouis,jusques aux Pays-Bas...Le latin n’a plus de secretspour ces gais chenapans,et Platon l’éveilléles conduit à travers le temps...À nos seize ans les rencontrantau détour d’un chemin,à mon tour je suis devenu,plus libre que jamais en erre,bon enfant autoproclaméet dûment diplôméDe l’université buissonnière...(Contrerimes advenues en marge de la lecture du Problème Spinoza, très remarquable roman d’Irvin Shalom évoquant les apprentissages contrastés de Baruch à Amsterdam et d’Alfred Rosenberg le futur genocidaire de la Solution finale qui fit main basse sur la bibliothèque du philosophe en 1941) -
Du Temps qui nous tisse
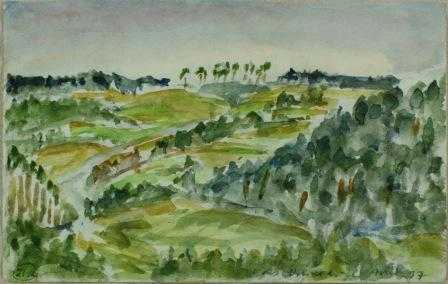
Du Diabolo. - Trois heures et demie du matin. Réveillé par un drôle de rêve. Adolescents en bande et confusion d’une tournante. Ensuite visions de dissolution. Et cette pensée: que la dissolution est l’Ennemi. L’Ennemi qui rôde et raille. Le Satan qui disperse. Le Diabolo parasite. D’un autre point de vue l’on dira que ce sont les violents qui l’emportent, et pourtant quelque chose se prépare en secret.
 En ville, ce 4 novembre, soir. — Une assez mauvaise journée a été sauvée, ce soir, par une très grande secousse poétique, sous l’effet du verbe prodigieux du Michaux de La marche dans le tunnel, proféré au théâtre par ce fou furieux de Jacques Roman. Je ne connaissais pas cette suite de chants, tirés d’Epreuves, exorcismes, et inspirés en partie par la guerre, mais j’ai été saisi, physiquement autant que psychiquement par la force de cette pensée et de cette sensibilisation de toute douleur humaine. Il y a là une extraordinaire incantation, d’une puissance de vision et d’une profondeur, d’une plasticité, d’une drôlerie parfois d’une virulence contre la bêtise sous toutes ses formes — d’une humanité surtout qui m’a réellement attrapé.
En ville, ce 4 novembre, soir. — Une assez mauvaise journée a été sauvée, ce soir, par une très grande secousse poétique, sous l’effet du verbe prodigieux du Michaux de La marche dans le tunnel, proféré au théâtre par ce fou furieux de Jacques Roman. Je ne connaissais pas cette suite de chants, tirés d’Epreuves, exorcismes, et inspirés en partie par la guerre, mais j’ai été saisi, physiquement autant que psychiquement par la force de cette pensée et de cette sensibilisation de toute douleur humaine. Il y a là une extraordinaire incantation, d’une puissance de vision et d’une profondeur, d’une plasticité, d’une drôlerie parfois d’une virulence contre la bêtise sous toutes ses formes — d’une humanité surtout qui m’a réellement attrapé.En revenant à la source je découvre ces phrases carabinées, par exemple : « Dès ce moment, la mort, ses fauchées furent grandes ». Ou ceci : Les idées, comme des boucs, étaient dressées les uns contre les autres. La haine prenait une allure sanitaire. La vieillesse faisait rire et l’enfance fut poussée à mordre. Le monde était tout drapeau ». Il me semble qu’il n’y a que Céline à avoir trouvé ces raccourcis.
Celui qui se fie strictement à l’organigramme / Celle qui esquive toute discussion à contenu / Ceux qui se raccrochent à l’acupuncture virtuelle, etc.
À La Désirade, ce 23 novembre. - En lisant Le mot Musique d’Alexandre Voisard, je me dis que là se trouve l’un des deux centres vitaux de ma vie vivante, consistant à lire et annoter un beau livre dont je m’attacherai à dégager et à transmettre la substance - l’autre centre étant ma table matinale à écrire. Or c’est à ce double foyer que je dois m’en tenir tous les jours et rigoureusement, opiniâtrement, sans me laisser distraire ou décontenancer par rien.
Du temps retourné. - Le temps coule autour de nous et en nous. Le temps nous tisse. Les hommes filtrent le temps et le fertilisent. La culture est notre façon de tisser le temps qui nous tisse.
Top Matin. - La Une du Matin d’un jour de la semaine dernière était consacrée à la comparaison de la longueur des verges des hommes de France et d’Allemagne, d’Europe et d’Amérique. Je me demande tous les jours jusqu’où ce journal infâme va s’abaisser et abaisser ses lecteurs, et tous les jours je constate un progrès inattendu. Conserver précieusement le document en question, pour mémoire de l’abjection.
Paul aux Romains: tu veux te glorifier, ce n’est pas toi qui portes la racine, c’est la racine qui te porte.
Nous restons en vie mais pas pour longtemps.
Ceux qui pensent religion comme on pense magot ou ce qui n’est pas mieux: assurance tous risques.
Je ne sais rien de la mort, sinon qu’elle n’existe pas. La mort est: c’est tout ce qu’on en peut dire.
La médiocrité est reine de la planification. Tout est balisé par l’organigramme. Tout se veut cadré et mesuré. Mais la vie déborde de partout.
De l’amitié. - Dans ses Papiers collés, Georges Perros orthographie: l’amythié. C’est vrai qu’il y a de ça, en tout cas j’ai toutes les raisons personnelles de le penser cette année, sans amertume pour autant. Cela étant, plus que de l’écrire, je voudrais décrire ce processus qui de l’amitié mythifiée tire la justification de comportement injustifiables. Par amitié tricherais-je avec toi? Refuseras-tu de me rendre ce service si je te le demande par amitié? Puis-je ne pas être respecté si j’ai commis telle ou telle saloperie par amitié?
J’ai vu que l’amitié, souvent, n’était qu’une sujétion ou qu’un leurre. Je vois qu’on me ménage, ou qu’on me berce, qu’on me flatte pour se servir de moi, et si je ne sers pas on me juge alors inamical. J’ai fait maintes observations de cette sorte depuis quelques années, et me tiens par conséquent sur mes gardes, tout en souriant désormais de ce genre de sollicitations.
A La Désirade, ce 25 novembre. – Tôt réveillé ce matin, j’ai passé deux heures à annoter la nouvelle somme d’Alfred Berchtold, consacrée aux multiples avatars de la figure de Guillaume Tell; et je me suis pointé chez lui vers midi. Or, le retrouvant, lui et sa chère épouse, après sept ans sans nous voir, il m’est apparu aussi vif d’esprit que lors de nos entrevues de La passion de transmettre, et sa conversation toujours aussi intéressante m’a fait beaucoup de bien. Dans l’atmosphère délétère des temps qui courent, c’est une bénédiction.
La foi te construit, l’espérance te fait parier pour l’avenir, la charité te réconcilie avec tous.
Peu importe que je ressuscite avant ou après la mort. Ce qui compte est que je ressuscite chaque jour pour annuler la mort.
Du nationalisme. - Ce que Michel Serres appelle « la libido d’appartenance » qui fait « aussi mâle rage que chez les rats », je l’ai vue à l’oeuvre de tout près et je crois en avoir été guéri pour jamais.
En ville, ce 22 novembre.- Accablé ce matin par une espèce de terrible tristesse, à la fois physique et psychique, qui m’a tenu au bord des larmes jusqu’à notre arrivée en ville – et je pensais au pauvre Jean-Claude Fontanet assis sur sa chaise de dépressif et pleurant du matin au soir pendant des mois et des années, trouvant cependant l’énergie miraculeuse de tirer enfin un livre admirable, L’Espoir du monde, de son chaos physique et mental. Après quoi, ayant déposé ma bonne amie à la HEP, une émission, consacrée à la psychologie du chien, sur la radio de la voiture, m’a fait éclater de rire et j’ai rebondi.
De la mesquinerie. - Je suis redevable aux mesquins, cette année, de s’être montrés si mesquins qu’ils m’ont donné la force de m’arracher à jamais à leur emprise. Je me ris désormais des mesquins. Je les ignore. Chaque fois que j’aurai affaire à l’un d’eux, je lui répondrai, sans lui répondre justement: je t’ignore. Mais cela surtout: ne plus répondre. Et ne plus être, soi, jamais mesquin non plus.
A La Désirade, 16 décembre 2004. – On voudrait écrire juste, mais le plus souvent ce n’est qu’à peu près ou à côté – j’entends : dans l’expression des sentiments délicats ou des idées complexes.
Ceci de Georges Perros: « Il faut écrire pendant que c’est chaud », à quoi j’ajouterai qu’il faut écrire pour se tenir chaud.
Les Français ont le sexe froid et méchant en littérature. Sade en est la meilleure preuve. Très peu d’auteurs français sont réellement sensuels et chaleureux dans leur érotisme, sauf peut-être un Restif de la Bretonne.
Du naturel. - Perros semble exclure le naturel du journal intime, mais ça se discute. Ce qu’on appelle naturel, pour un véritable écrivain, genre Léautaud ou Jouhandeau, s’agissant de « journaliers », est certes déjà composé, mais quelle importance ? On voit avec Céline que l’apparente spontanéité est également le résultat de tout un travail. Pareil avec Ramuz. Le contre-exemple exemplaire pourrait être Amiel qui écrivait son Journal intime au fil de la plume et sans penser qu’il ferait jamais l’objet d’une publication, et donc avec un naturel parfait. Mais est-ci si sûr ? Je n’en crois rien…
Celui qui n’a plus de goût à la vie / Celle qui se fixe des programmes / Ceux qui se taisent, etc.
À la Désirade, ce vendredi 31 décembre.- Réveil tardif, dans les bras de ma bonne amie, par grand beau temps hivernal. Très intéressé par la lecture d’Avec Marcel Proust d’Edmond Jaloux, dont j’apprécie autant l’écriture si belle que l’intelligence si pénétrante. C’est vraiment le grand style de la critique comme il n’y en a plus de nos jours. Jaloux est le moins jaloux des jaloux ; on sent que sa joie et son bonheur sont de partager une admiration longuement et finement détaillée.
Écrire comme on respire. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.
Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.
Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion répandue, qui ne dit du chemin que le pantelant des pulsions, de gestes impatients et de jouissance à la diable, chose facile.
Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…
Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.
La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté; et ce travail alors seul repose et fructifie.
(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel)
Image: Vers Donneloye, aquarelle JLK.
-
Le Magicien de Colm Tóibín danse entre Lucifer et Dionysos…
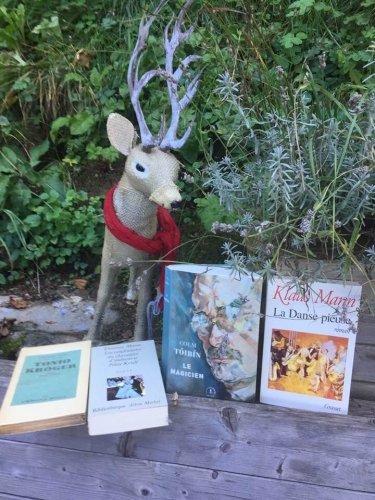 La saga de Thomas Mann et des siens relève du mythe littéraire fascinant, autant que d’une réalité familiale et nationale à maints égards tragique. Après d’innombrables témoignages et affabulations, le romancier irlandais Colm Tóibín, avec autant de discernement documenté que de génie intuitif, nous fait vivre de plain-pied un roman captivant.Le Magicien du romancier irlandais Colm Tóibín est d’abord un roman à part entière de cet auteur poreux et puissant, d’une densité limpide sans égale et d'une fabuleuse pénétration psychologique, avant de représenter une ample chronique biographique de Thomas Mann et de sa famille - hautement romanesque elle-même -, de la fin du XIXe siècle à Lübeck (à l’ombre du père sénateur et capitaine d’industrie sans illusions sur sa descendance), aux années 50 où le plus grand écrivain vivant de langue allemande est devenu un symbole de la défense de l’Occident démocratique, antinazi tardif mais implacable, mort en Suisse en 1955 à l’âge de 80 ans, aussi conspué-adulé dans son propre pays qu’honoré-rejeté de par le monde...
La saga de Thomas Mann et des siens relève du mythe littéraire fascinant, autant que d’une réalité familiale et nationale à maints égards tragique. Après d’innombrables témoignages et affabulations, le romancier irlandais Colm Tóibín, avec autant de discernement documenté que de génie intuitif, nous fait vivre de plain-pied un roman captivant.Le Magicien du romancier irlandais Colm Tóibín est d’abord un roman à part entière de cet auteur poreux et puissant, d’une densité limpide sans égale et d'une fabuleuse pénétration psychologique, avant de représenter une ample chronique biographique de Thomas Mann et de sa famille - hautement romanesque elle-même -, de la fin du XIXe siècle à Lübeck (à l’ombre du père sénateur et capitaine d’industrie sans illusions sur sa descendance), aux années 50 où le plus grand écrivain vivant de langue allemande est devenu un symbole de la défense de l’Occident démocratique, antinazi tardif mais implacable, mort en Suisse en 1955 à l’âge de 80 ans, aussi conspué-adulé dans son propre pays qu’honoré-rejeté de par le monde...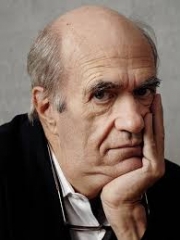 Colm Tóibín s’est déjà illustré, dans Le Maître, par une biographie romancée du grand romancier anglo-américain Henry James, dont il a (notamment) mis en lumière un aspect peu connu voire occulté de la personnalité, à savoir son homophilie de célibataire endurci ; et de même s’attache-t-il à celle, plus documentée, d’un Thomas Mann nourrissant diverses passions masculines dès son adolescence et jusque tard dans sa vie, probablement demeurées à peu près platoniques en dépit de l’intensité de leur évocation dans son Journal.Mais si l’auteur irlandais du Magicien, notoirement gay, se plaît à illustrer cette composante intime rapprochant évidemment l’auteur de La mort à Venise de son protagoniste Gustav von Aschenbach, entre autres projection littéraires de ses fantasmes érotiques - et plus encore de son exaltation d’un fantasmatique « jouvenceau divin » - , cela ne l’empêche pas de rendre justice, dans les grandes largeurs d’une vie où la Littérature reste la maîtresse la plus exigeante de l’écrivain, à un génie littéraire doublé d’un homme fort et fragile à la fois dont l'auteur rend magnifiquement la présence de colosse cravaté à pieds d'argile, autant que celle de l'indomptable et douce Katia, son épouse issue de grande famille juive « assimilée », soutien quotidien et bonne fée-dragon assurant l’équilibre de ses relations avec le monde et avec leurs terribles enfants dont les deux aînés (Erika et Klaus), outrageusement libres dans leur vie personnelle et politiquement engagés, furent eux aussi des figures emblématiques de la littérature allemande en exil et de l'intelligentsia antinazie de premier rang.
Colm Tóibín s’est déjà illustré, dans Le Maître, par une biographie romancée du grand romancier anglo-américain Henry James, dont il a (notamment) mis en lumière un aspect peu connu voire occulté de la personnalité, à savoir son homophilie de célibataire endurci ; et de même s’attache-t-il à celle, plus documentée, d’un Thomas Mann nourrissant diverses passions masculines dès son adolescence et jusque tard dans sa vie, probablement demeurées à peu près platoniques en dépit de l’intensité de leur évocation dans son Journal.Mais si l’auteur irlandais du Magicien, notoirement gay, se plaît à illustrer cette composante intime rapprochant évidemment l’auteur de La mort à Venise de son protagoniste Gustav von Aschenbach, entre autres projection littéraires de ses fantasmes érotiques - et plus encore de son exaltation d’un fantasmatique « jouvenceau divin » - , cela ne l’empêche pas de rendre justice, dans les grandes largeurs d’une vie où la Littérature reste la maîtresse la plus exigeante de l’écrivain, à un génie littéraire doublé d’un homme fort et fragile à la fois dont l'auteur rend magnifiquement la présence de colosse cravaté à pieds d'argile, autant que celle de l'indomptable et douce Katia, son épouse issue de grande famille juive « assimilée », soutien quotidien et bonne fée-dragon assurant l’équilibre de ses relations avec le monde et avec leurs terribles enfants dont les deux aînés (Erika et Klaus), outrageusement libres dans leur vie personnelle et politiquement engagés, furent eux aussi des figures emblématiques de la littérature allemande en exil et de l'intelligentsia antinazie de premier rang. La mise en abyme multiforme d’une vieLe magicien est un immense roman d’une totale simplicité en apparence, synthèse miraculeuse d’une quantité d’histoires personnelles complexes, sur fond de convulsions historiques marquant l’effondrement d’une certaine Allemagne et la transformation d’une incertaine Europe en deux blocs dont on voit aujourd’hui la persistante fragilité.Le titre du roman de Colm Toibin évoque la figure du pater familias qui aimait fasciner ses cinq enfants par ses tours d’illusion, quand bien même certains d’entre eux lui reprocheraient plus tard le caractère illusoire de sa présence, ou l’artifice écrasant d’une omniprésence de Commandeur littéraire mondialement reconnu mais parfois bien maladroit à reconnaître les siens en dépit de ses constantes aides financières.Le roman commence par ce qui pourrait être une nouvelle « nordique » de Thomas Mann lui-même qui s’intitulerait La mort du père, située en 1891 à Lübeck et racontant le double effondrement d’un homme et d’une firme commerciale auréolée de prestige. Peut-on croire Colm Tóibín quand il prête, à Thomas Mann, l’intuition selon laquelle l’entrée dans la famille Mann de Julia la Brésilienne, sa mère enchanteresse, belle et raconteuse d’histoires, qui oppose son rire latino à la sévérité guindées des Luthériens « nordiques », aura marqué le déclin de la dynastie ?Ce qui est sûr, après le désaveu d’un testament imposant une tutelle à l’épouse et à ses fils aînés, c’est que le rejet paternel, humiliant, va provoquer l’émancipation de l’aîné, Heinrich, qui fera ses premières armes d’écrivain en Italie, bientôt suivi de Thomas dont ses tuteurs tâcheront vainement de faire un sage employé d’assurance. En outre, la mort du père déplacera la famille vers le sud à l’initiative de Julia, à Munich où la bohème artistique fleurit plus généreusement que sur les rivages puritains de la Baltique – et Les frères ennemis pourrait être, alors, une nouvelle de Klaus Mann, futur aîné de Thomas, considérant, en lecteur marxisant, les destins parallèles et souvent opposés de Heinrich, compagnon de route des communistes, et de Thomas l’humaniste incessamment hésitant, d’abord nationaliste et ensuite se ralliant à l’Occident démocratique par dégoût viscéral du nazisme.Dès sa vingtaine, Thomas Mann va tisser, entre sa vie et ses écrits, des liens constants et profonds, qui laissent à penser que tout lui fait miel littéraire, et les effets spéculaires se multiplieront avec les livres de son frère et de ses enfants, autant que par les commentaires quotidiens de son Journal sur ce qu’il vit et le roman en chantier.Ainsi, le premier chef-d’œuvre, qui lui vaudra explicitement le Nobel de littérature en 1929, à savoir la saga familiale des Buddenbrook, constitue-t-il la projection balzacienne, quasiment « d’après nature », de la chute de la maison Mann à Lübeck, avec un jeune Hanno, trop délicat pour vivre longtemps, qui ressemble à la part la plus sensible de l’auteur lui-même. Ensuite, à Munich, dans l’extraordinaire nouvelle intitulé Sang réservé, le futur époux de Katia Pringsheim se servira, non sans énorme culot, de la relation gémellaire liant sa nouvelle amie à son frère Klaus, pour évoquer une relation incestueuse « wagnérienne » d’une sensualité et d’un raffinement proustien, à quoi s’ajoute une dimension symbolique où l’Allemagne et la judéité de sa famille sont clairement impliquées.À propos du seul prénom de Klaus, l’on relèvera dans la foulée qu’il est à la fois celui du beau-frère de Thomas, de son fils aîné et d’un jeune homme angélique qui comptera beaucoup dans sa vie secrète, dont le personnages de « divin jouvenceau » ressemble évidemment au Tadzio de La Mort à Venise, alors que l’ombre de Gustav Mahler plane également sur la lagune…De la même façon, comme le montre Colm Tóibín, plus attentif à la vie de Thomas Mann qu’au détail de ses œuvres, celles-ci ne cesseront de se nourrrir de la substance existentielle de l’écrivain et de son entourage, de La Montagne magique (après l’hospitalisation de Katia en Engadine) au Docteur Faustus où les relations de Mann et d’Arnold Schönberg joueront un rôle à la fois épineux et central.Boutons de culottes et autres détails intimes...À propos de Schönberg, précisément, Colm Tóibín fait dire à Thomas Mann que ce qui distingue les musiciens des romanciers tient à cela que les premiers en décousent avec Dieu et l’éternité, tandis que les seconds doivent achopper d’abord aux boutons de culottes de leurs divers personnages, autrement dit : au détail, jusqu’à l’intime, de la vie qui va et non seulement aux grands sentiments et autres sublimes idées.À la hauteur, quant au rayonnement intellectuel et moral, d’un Tolstoï et d’un Romain Rolland, ou d’un André Gide, ses contemporains, Thomas Mann est sans doute le seul grand auteur-intellectuel, des années 30 aux années 50 du XXe siècle, avant et après les crimes du nazisme et la débâcle de l’Allemagne et sa partition, à incarner, en son exil de Californie puis à son retour en Europe, la voix de la liberté et de la démocratie, notamment dans ses innombrables interventions en conférences ou émissions radiophoniques. Proche de Roosevelt, pressenti par certains comme un président de l’Allemagne à venir, il fut adulé par les Américains jusqu’au temps du maccarthysme où on lui supposa des accointances avec le communisme. On n’imagine guère, aujourd’hui, malgré l’influence d’un Sartre ou d’un Soljenitsyne, les attentes qu’a suscité le plus grand écrivain allemand du XXe siècle, et la violence des réactions que ses positions non partisanes ont suscitée, des injures de Brecht aux mesquineries du FBI, notamment. Son retour en Allemagne en 1950, pour célébrer la mémoire de Goethe à Weimar (à l’Est) autant qu’à Francfort, illustre l’indépendance et le courage exceptionnel du vieil homme.Cela étant, le roman de Colm Tóibín n’a rien d’un « reportage » historico-politique. Son Herr Doktor Mann mondialement connu, romancier fêté dont les ventes considérables lui permettent de bien vivre et d’aider nombre de ses confrères, sans parler de sa famille dont il assure la protection avec l’aide de son épouse – ce patriarche à cigares est aussi un Mister Hyde de désir entretenant, sous le regard ironique de Katia et de ses filles, une espèce de passion obsessionnelle , et qu’il juge lui-même « infantile », pour ce qu’il appelle lui-même le «divin jouvenceau» - tel Jupiter enlevant le mignon Ganymède - dont le dernier avatar sera un gentil serveur du palace Dolder, à Zurich, sur la main duquel le Magicien pose sa patte en croyant atteindre le paradis. Et puis quoi ?Et puis rien, ou tellement plus que ce rien fantasmagorique: le noyau-vortex du chapitre final de ce roman qui évoque, plus qu’il ne décrit, avec le souvenir revenu de la mère latino dévoilant, à ses enfants, un secret merveilleux dont la lectrice et le lecteur découvriront la nature renvoyant à la beauté d’une œuvre et du monde qui l’a inspirée…Colm Tóibín. Le Magicien. Grasset. Traduit (admirablement) de l’anglais (Irlande) par Anna Gibson. Grasset, 603p.
La mise en abyme multiforme d’une vieLe magicien est un immense roman d’une totale simplicité en apparence, synthèse miraculeuse d’une quantité d’histoires personnelles complexes, sur fond de convulsions historiques marquant l’effondrement d’une certaine Allemagne et la transformation d’une incertaine Europe en deux blocs dont on voit aujourd’hui la persistante fragilité.Le titre du roman de Colm Toibin évoque la figure du pater familias qui aimait fasciner ses cinq enfants par ses tours d’illusion, quand bien même certains d’entre eux lui reprocheraient plus tard le caractère illusoire de sa présence, ou l’artifice écrasant d’une omniprésence de Commandeur littéraire mondialement reconnu mais parfois bien maladroit à reconnaître les siens en dépit de ses constantes aides financières.Le roman commence par ce qui pourrait être une nouvelle « nordique » de Thomas Mann lui-même qui s’intitulerait La mort du père, située en 1891 à Lübeck et racontant le double effondrement d’un homme et d’une firme commerciale auréolée de prestige. Peut-on croire Colm Tóibín quand il prête, à Thomas Mann, l’intuition selon laquelle l’entrée dans la famille Mann de Julia la Brésilienne, sa mère enchanteresse, belle et raconteuse d’histoires, qui oppose son rire latino à la sévérité guindées des Luthériens « nordiques », aura marqué le déclin de la dynastie ?Ce qui est sûr, après le désaveu d’un testament imposant une tutelle à l’épouse et à ses fils aînés, c’est que le rejet paternel, humiliant, va provoquer l’émancipation de l’aîné, Heinrich, qui fera ses premières armes d’écrivain en Italie, bientôt suivi de Thomas dont ses tuteurs tâcheront vainement de faire un sage employé d’assurance. En outre, la mort du père déplacera la famille vers le sud à l’initiative de Julia, à Munich où la bohème artistique fleurit plus généreusement que sur les rivages puritains de la Baltique – et Les frères ennemis pourrait être, alors, une nouvelle de Klaus Mann, futur aîné de Thomas, considérant, en lecteur marxisant, les destins parallèles et souvent opposés de Heinrich, compagnon de route des communistes, et de Thomas l’humaniste incessamment hésitant, d’abord nationaliste et ensuite se ralliant à l’Occident démocratique par dégoût viscéral du nazisme.Dès sa vingtaine, Thomas Mann va tisser, entre sa vie et ses écrits, des liens constants et profonds, qui laissent à penser que tout lui fait miel littéraire, et les effets spéculaires se multiplieront avec les livres de son frère et de ses enfants, autant que par les commentaires quotidiens de son Journal sur ce qu’il vit et le roman en chantier.Ainsi, le premier chef-d’œuvre, qui lui vaudra explicitement le Nobel de littérature en 1929, à savoir la saga familiale des Buddenbrook, constitue-t-il la projection balzacienne, quasiment « d’après nature », de la chute de la maison Mann à Lübeck, avec un jeune Hanno, trop délicat pour vivre longtemps, qui ressemble à la part la plus sensible de l’auteur lui-même. Ensuite, à Munich, dans l’extraordinaire nouvelle intitulé Sang réservé, le futur époux de Katia Pringsheim se servira, non sans énorme culot, de la relation gémellaire liant sa nouvelle amie à son frère Klaus, pour évoquer une relation incestueuse « wagnérienne » d’une sensualité et d’un raffinement proustien, à quoi s’ajoute une dimension symbolique où l’Allemagne et la judéité de sa famille sont clairement impliquées.À propos du seul prénom de Klaus, l’on relèvera dans la foulée qu’il est à la fois celui du beau-frère de Thomas, de son fils aîné et d’un jeune homme angélique qui comptera beaucoup dans sa vie secrète, dont le personnages de « divin jouvenceau » ressemble évidemment au Tadzio de La Mort à Venise, alors que l’ombre de Gustav Mahler plane également sur la lagune…De la même façon, comme le montre Colm Tóibín, plus attentif à la vie de Thomas Mann qu’au détail de ses œuvres, celles-ci ne cesseront de se nourrrir de la substance existentielle de l’écrivain et de son entourage, de La Montagne magique (après l’hospitalisation de Katia en Engadine) au Docteur Faustus où les relations de Mann et d’Arnold Schönberg joueront un rôle à la fois épineux et central.Boutons de culottes et autres détails intimes...À propos de Schönberg, précisément, Colm Tóibín fait dire à Thomas Mann que ce qui distingue les musiciens des romanciers tient à cela que les premiers en décousent avec Dieu et l’éternité, tandis que les seconds doivent achopper d’abord aux boutons de culottes de leurs divers personnages, autrement dit : au détail, jusqu’à l’intime, de la vie qui va et non seulement aux grands sentiments et autres sublimes idées.À la hauteur, quant au rayonnement intellectuel et moral, d’un Tolstoï et d’un Romain Rolland, ou d’un André Gide, ses contemporains, Thomas Mann est sans doute le seul grand auteur-intellectuel, des années 30 aux années 50 du XXe siècle, avant et après les crimes du nazisme et la débâcle de l’Allemagne et sa partition, à incarner, en son exil de Californie puis à son retour en Europe, la voix de la liberté et de la démocratie, notamment dans ses innombrables interventions en conférences ou émissions radiophoniques. Proche de Roosevelt, pressenti par certains comme un président de l’Allemagne à venir, il fut adulé par les Américains jusqu’au temps du maccarthysme où on lui supposa des accointances avec le communisme. On n’imagine guère, aujourd’hui, malgré l’influence d’un Sartre ou d’un Soljenitsyne, les attentes qu’a suscité le plus grand écrivain allemand du XXe siècle, et la violence des réactions que ses positions non partisanes ont suscitée, des injures de Brecht aux mesquineries du FBI, notamment. Son retour en Allemagne en 1950, pour célébrer la mémoire de Goethe à Weimar (à l’Est) autant qu’à Francfort, illustre l’indépendance et le courage exceptionnel du vieil homme.Cela étant, le roman de Colm Tóibín n’a rien d’un « reportage » historico-politique. Son Herr Doktor Mann mondialement connu, romancier fêté dont les ventes considérables lui permettent de bien vivre et d’aider nombre de ses confrères, sans parler de sa famille dont il assure la protection avec l’aide de son épouse – ce patriarche à cigares est aussi un Mister Hyde de désir entretenant, sous le regard ironique de Katia et de ses filles, une espèce de passion obsessionnelle , et qu’il juge lui-même « infantile », pour ce qu’il appelle lui-même le «divin jouvenceau» - tel Jupiter enlevant le mignon Ganymède - dont le dernier avatar sera un gentil serveur du palace Dolder, à Zurich, sur la main duquel le Magicien pose sa patte en croyant atteindre le paradis. Et puis quoi ?Et puis rien, ou tellement plus que ce rien fantasmagorique: le noyau-vortex du chapitre final de ce roman qui évoque, plus qu’il ne décrit, avec le souvenir revenu de la mère latino dévoilant, à ses enfants, un secret merveilleux dont la lectrice et le lecteur découvriront la nature renvoyant à la beauté d’une œuvre et du monde qui l’a inspirée…Colm Tóibín. Le Magicien. Grasset. Traduit (admirablement) de l’anglais (Irlande) par Anna Gibson. Grasset, 603p.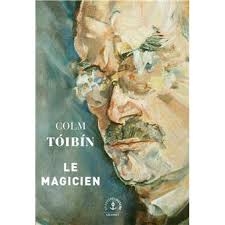
-
Ceux que leur gaîté protège
 Celui qui n’arrive pas à rester fâché / Celle qui a l’art guerrier de dévier les traits / Ceux que tout atteint mais qui n’en montrent rien / Celui qui sourit dans le vague avec la fixité précise de l'Archer / Celle qui lit Le Trottoir au soleil de Philippe Delerm dans la salle d’attente du train de nuit / Ceux qui rebondissent comme des ballons sur la pelouse du jour vert électrique / Celle qui fait la vaisselle en chantant l’air de Mimi de La Bohême (« Mi chiamano Mimi », etc.) pendant que ses jeunes invité pioncent encore après les excellents excès de la veille / Ceux qui restent pensifs après le départ de tous les clients du bar gay Au Soleil levant tenu par la famille vietnamienne qui en a superchié pendant les guerres dont les gamins ne savent plus foutre rien / Celui qui a écrit « la lumière est en vous aussi » et que les gens liront avec reconnaissance quand le bouquin sera en vente / Celle qui se console de n’avoir pas été invitée à la noce pipole du présentateur de la télé et de la Miss Météo en apprenant qu’on s’y est fait hyper-tartir / Ceux qui jurent qu’ils n’en sont pas quand on leur demande s’ils en sont / Celui que la vision des abattoirs déprimait à chaque fois qu’il prenait le TGV Lyria et qui déprime maintenant de ne plus avoir assez de ronds pour se payer Paris-Folie / Celle qui se défoule dans la foule du métro après sa sortie du couvent motivés par Dieu sait quoi / Ceux qui prient le Seigneur avec une ferveur de 3 janvier sans trop savoir qui c’est çui-là mais Lui doit le savoir alors ça va / Celui qui se rappelle son premier Happy Meal au goût de petite madeleine / Celle qui fête le Nouvel An avec les Chinetoques d’à côté qui s’intéressent à ses années de musicologie à l’Academia Chigi de Siena (Italia) / Ceux qui offrent des figues sèche sà la tante Glouton / Celui qui va skier ce matin aux Portes du Soleil où il tombe sur quelques aveugles en luges guidés par une monitrice à sifflet / Celle qui envoie promener ceux qui lui recommandent de fermer la porte aux Soucis alors qu’y que ça de bon dans la vie répond-elle sur le ton de la plus pure mauvaise foi paléochrétienne / Ceux qui sont trop actifs et réactifs pour regarder quoi que ce soit alentour où que c’est si beau n'est-ce pas Mado / Celui qui se rebiffe quand on le regarde malgré qu’il est si beau que ça fait même pas d’jaloux / Celle qui sourit sans écouter ce que radote son conjoint rouquin qui bégaie dans ses bretelles / Ceux que soucient grave plusieurs kilos de surpoids consécutifs aux Fêtes mais tu verras Betty je me réabonne au Fitness Hyperforme / Celle qui aime la bonne méchanceté de certaines fortes femmes fragiles style Flannery la dompteuse de poules / Ceux qui ont dansé le Fox-trot en 1953 tandis que Staline cannait pour de bon mais les kids des Lycées Béjart et Aragon n’ont entendu parler ni de l’un ni de l’autre / Celui qui remonte en danseuse la côte du Grand Sabot Breton / Celle qui tient le bar lesbien Au Bon Gigot / Ceux qui draguaient nos sœurs à la sortie du ciné en plein air de Levanto et qui sont aujourd’hui de vieilles peaux berlusconisées à mort ou qui sont morts ou va savoir avec la Nave qui va / Celui qui a pas mal fait l’amour en groupe et se retrouve pas mal seul à l’heure qu’il est mais sans que Dieu s’en soit mêlé qu’allez vous croire cancrelats ? / Celle qui se tenait au piquet de Valerio quand il fonçait sur sa Vespa par les monts de La Spezia / Ceux qui reviennent sur les lieux dont les livres les ont fait rêver genre Balbec ou Sils Maria / Celui qui nourrit des projets brésiliens après que Jean Ziegler lui a raconté ses nuits de candomblé à la Mère Royaume / Celle qui médite devant une pomme lisse comme une conne / Ceux qui peignent à l’ancienne des sujets sociaux genre Jed Martin se défonçant à la disco avec Olga la Ruskova / Celui qui se réjouit de retrouver à Salonique ses jeunes amis fous de La Callas et de Cavafy / Celle que tout met en joie même la perspective de retrouver la cafète de l’Entreprise où l’Alcool est proscrit mon chéri / Ceux dont la bonne humeur inaltérable entretien une ambiance du tonnerre aux RH de l’Entreprise et surtout quand tous se retrouvent sur le toit pour cloper, etc.Peinture: Robert Indermaur
Celui qui n’arrive pas à rester fâché / Celle qui a l’art guerrier de dévier les traits / Ceux que tout atteint mais qui n’en montrent rien / Celui qui sourit dans le vague avec la fixité précise de l'Archer / Celle qui lit Le Trottoir au soleil de Philippe Delerm dans la salle d’attente du train de nuit / Ceux qui rebondissent comme des ballons sur la pelouse du jour vert électrique / Celle qui fait la vaisselle en chantant l’air de Mimi de La Bohême (« Mi chiamano Mimi », etc.) pendant que ses jeunes invité pioncent encore après les excellents excès de la veille / Ceux qui restent pensifs après le départ de tous les clients du bar gay Au Soleil levant tenu par la famille vietnamienne qui en a superchié pendant les guerres dont les gamins ne savent plus foutre rien / Celui qui a écrit « la lumière est en vous aussi » et que les gens liront avec reconnaissance quand le bouquin sera en vente / Celle qui se console de n’avoir pas été invitée à la noce pipole du présentateur de la télé et de la Miss Météo en apprenant qu’on s’y est fait hyper-tartir / Ceux qui jurent qu’ils n’en sont pas quand on leur demande s’ils en sont / Celui que la vision des abattoirs déprimait à chaque fois qu’il prenait le TGV Lyria et qui déprime maintenant de ne plus avoir assez de ronds pour se payer Paris-Folie / Celle qui se défoule dans la foule du métro après sa sortie du couvent motivés par Dieu sait quoi / Ceux qui prient le Seigneur avec une ferveur de 3 janvier sans trop savoir qui c’est çui-là mais Lui doit le savoir alors ça va / Celui qui se rappelle son premier Happy Meal au goût de petite madeleine / Celle qui fête le Nouvel An avec les Chinetoques d’à côté qui s’intéressent à ses années de musicologie à l’Academia Chigi de Siena (Italia) / Ceux qui offrent des figues sèche sà la tante Glouton / Celui qui va skier ce matin aux Portes du Soleil où il tombe sur quelques aveugles en luges guidés par une monitrice à sifflet / Celle qui envoie promener ceux qui lui recommandent de fermer la porte aux Soucis alors qu’y que ça de bon dans la vie répond-elle sur le ton de la plus pure mauvaise foi paléochrétienne / Ceux qui sont trop actifs et réactifs pour regarder quoi que ce soit alentour où que c’est si beau n'est-ce pas Mado / Celui qui se rebiffe quand on le regarde malgré qu’il est si beau que ça fait même pas d’jaloux / Celle qui sourit sans écouter ce que radote son conjoint rouquin qui bégaie dans ses bretelles / Ceux que soucient grave plusieurs kilos de surpoids consécutifs aux Fêtes mais tu verras Betty je me réabonne au Fitness Hyperforme / Celle qui aime la bonne méchanceté de certaines fortes femmes fragiles style Flannery la dompteuse de poules / Ceux qui ont dansé le Fox-trot en 1953 tandis que Staline cannait pour de bon mais les kids des Lycées Béjart et Aragon n’ont entendu parler ni de l’un ni de l’autre / Celui qui remonte en danseuse la côte du Grand Sabot Breton / Celle qui tient le bar lesbien Au Bon Gigot / Ceux qui draguaient nos sœurs à la sortie du ciné en plein air de Levanto et qui sont aujourd’hui de vieilles peaux berlusconisées à mort ou qui sont morts ou va savoir avec la Nave qui va / Celui qui a pas mal fait l’amour en groupe et se retrouve pas mal seul à l’heure qu’il est mais sans que Dieu s’en soit mêlé qu’allez vous croire cancrelats ? / Celle qui se tenait au piquet de Valerio quand il fonçait sur sa Vespa par les monts de La Spezia / Ceux qui reviennent sur les lieux dont les livres les ont fait rêver genre Balbec ou Sils Maria / Celui qui nourrit des projets brésiliens après que Jean Ziegler lui a raconté ses nuits de candomblé à la Mère Royaume / Celle qui médite devant une pomme lisse comme une conne / Ceux qui peignent à l’ancienne des sujets sociaux genre Jed Martin se défonçant à la disco avec Olga la Ruskova / Celui qui se réjouit de retrouver à Salonique ses jeunes amis fous de La Callas et de Cavafy / Celle que tout met en joie même la perspective de retrouver la cafète de l’Entreprise où l’Alcool est proscrit mon chéri / Ceux dont la bonne humeur inaltérable entretien une ambiance du tonnerre aux RH de l’Entreprise et surtout quand tous se retrouvent sur le toit pour cloper, etc.Peinture: Robert Indermaur -
L'Auteur est dans la malle

(Dialogue schizo)
Moi l’autre : - Donc il n’y a, selon toi, que l’Auteur ?
Moi l’un : - Il n’y a que l’Auteur à majuscule radieuse, et qui n’a pas de nom ou qui a tous les noms, c’est du kif.
Moi l’autre : - Qu’entends-tu par là ?
Moi l’un : - J’entends que, dès l’Origine dont nous ne savons rien, aux fins dernières qui n’ont pas encore trouvé de mots pour les dire, il n’y a qu’un souffle de Verbe et qu’une signature dont le Nom ne se dit pas. L’auteur de la Genèse n’a pas de nom. L’auteur de l’Apocalypse est peut-être Jean, mais c’est juste pour l’Etat-Civil alors qu’il n’est même pas sûr que ce soit le Jean auquel on pense… Le Jean de l’Apocalypse désigne sûrement, en effet, un tas de gens. Et tu sais bien que le nom d’Homère a été discuté. Le gag, que raconte Umberto Eco, dont le nom n’est lui-même qu’un écho d’Ecco, c’est que ceux qui ont mis en doute l’attribution de l’œuvre en deux volumes d’Homère à Homère ont abouti finalement à la conviction que l’œuvre d’Homère n’était pas d’Homère lui-même mais d’un parent d’Homère, du nom d’Homère...
Moi l’autre : - Ainsi le nom de l’auteur, pour ainsi dire interchangeable, n’a-t-il aucune importance à tes yeux, et cette notion de tiers inclus ne serait qu’une faribole ?
Moi l’un : - On pourrait le penser en oubliant la malle, mais tu le sais autant que moi : tout est dans la malle, et c’est là que ça devient intéressant, pour l’identification fine de l’auteur, libéré de sa majuscule, et pour ce qui touche au tiers inclus. On entre là dans la comédie littéraire. Divine comédie : Dante Alighieri a bel et bien un nom, et je le vois bien signer à la FNAC, avec sa couronne de lauriers, comme Amélie Notoire en chapeau de sorcière à la Potter. Sinon, l’Auteur à majuscule ne serait qu’une marque comme celles qu’on voit aujourd’hui dans le ciel du marché mondialisé : UBS ou MICROSOFT über Alles. Dans cette logique marchande MOZART est une marque cotée en Bourse, tandis que la malle recèle un trésor pareil à celui de l’île fameuse, et l’expédition n’est autre que le tiers inclus. Cela n’a rien à voir, soit dit en passant, avec la théorie barjo de la disparition de l’auteur, pas plus qu’avec la surévaluation démagogique du tiers inclus qui fait dans l’hommage aux petites mains.
Moi l’autre : - Tu me sembles passer un peu vite sur le dévouement sans bornes des invisibles qui travaillent à la seule gloire de l’Auteur, mais passons. Parlons plutôt de ce que tu reconnais bel et bien comme le tiers inclus…
Moi l’un : - Si je ne m’étends pas sur la noble cohorte des assistants de l’Auteur à majuscule et gilet coin-de-feu, entre Admirable Compagne, et Coach amical ou professionnel, plus toute la kyrielle de parents et amis qu’une nouvelle vogue consiste à remercier désormais au titre du tiers inclus, ce n’est pas du tout par mépris mais parce que cette attention aux invisibles cache, je le crains, autre chose. Nier la réalité de l’auteur, sans majuscule, au profit du Texte, devenu seule Origine et seule Fin de l’écriture, relève d’une esthétique que je récuse, car c’est nier implicitement le primat de la voix, c’est nier le rythme, c’est nier l’aura d’une personne unique et irremplaçable, corps et esprit sans lesquels le texte serait lettre morte. Cela étant j’aime bien l’idée que le non moins irremplaçable Carl Seelig soit une sorte de tiers inclus dans la survie de Robert Walser. Hommage aussi à tous les invisibles – hommage à l’invisible et non moins irremplaçable dactylographe de Georges Haldas, mais demande-t-elle seulement qu’on lui bricole une statue ?
Moi l’autre : - Par extension, ne pourrait-on pas dire que la Petite Mère d’Haldas, comme il l’appelle, ou l’Homme Mon père, participent aussi du tiers inclus ?
Moi l’un : - Cela va de soi, comme le grand-père de Thomas Bernhard, Madeleine Gide même quand elle brûle les lettres de son mari la trompant avec Marc Allégret, ou Berthe Ramuz qui accepte de ne plus peindre pour se consacrer au seul ravaudage des bas bruns du Maître.
Moi l’autre : - D’autres exemples, Malus ou Bonus, qui aient joué dans ton propre travail ?
Moi l’un : - Trois exemples entre mille : le premier est cette admirable déclaration du Doyen grave de la Faculté des Lettres de Lausanne nous déclarant, en 1967, dans sa séance d’accueil, que nous n’étions guère bienvenus en ces lieux si nous aimions la littérature, car en ces lieux la littérature s’étudierait scientifiquement. Je me le suis tenu pour dit et ne me suis plus consacré désormais qu’à mon Amour majuscule de la Littérature. Le second fut cet autre mot de Vladimir Dimitrijevic qui me dit, après avoir publié mon premier livre, que j’allais réaliser tous ses rêves d’écrivain. Le même Dimitri a opposé un déni total aux livres que j’ai publiés, vingt ans plus tard, après notre séparation pour motifs graves, chez Bernard Campiche, mais l’élan était donné et ma reconnaissance à Dimitri reste entière. Et le troisième cadeau d’un tiers inclus, entre tant d’autres, fut le désir de l’homme de théâtre Henri Ronse de me voir écrire une série de proses fuguées, qui m’a inspiré Le Sablier des étoiles, écrit pour Henri en peu de mois, comme une lettre à un ami.
Moi l’autre : - Il y a là du mimétisme décrit par René Girard, qui estime que notre désir procède, pour beaucoup, du désir de l’autre. Nous écrivons forcément par et pour l’autre, et cet autre est légion, qui écrit à travers nous.
Moi l’un : - Comme je le disais tout à l’heure : tout est dans la malle. Je fais allusion, bien entendu, à la malle de Fernando Pessoa, contenant son œuvre non encore publiée. La malle contient aussi les manuscrits de Walter Benjamin non publiés de son vivant et les manuscrits non publiés de son vivant de Franz Kafka. L’Auteur est dans la malle avec parents et enfants, libraires et bibliothécaires, censeurs et encenseurs - tout est dans la malle…
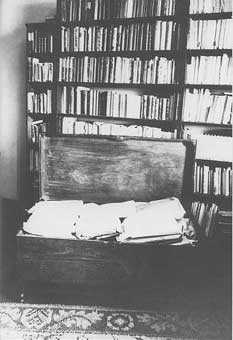 PS. Le titre de ce texte me vient de mon ami René Zahnd, tiers inclus à son insu.
PS. Le titre de ce texte me vient de mon ami René Zahnd, tiers inclus à son insu.Images: Béatrice, Tierce incluse de Dante Alighieri; la malle de Fernando Pessoa.
-
Eros calviniste

(Jacques Chessex)
Le plus célèbre des écrivains romands de la fin du XXe siècle s'est effondré, au soir du 9 octobre 2009, dans le bourg vaudois d'Yverdon-les-Bains, durant une causerie consacrée à l'un de ses livres, La Confession du pasteur Burg. Une interpellation virulente d'un spectateur sur l'affaire Polanski, dont l’écrivain avait pris la défense, est à l'origine de son effondrement. Il avait 75 ans. Il s’appelait Jacques Chessex.
«La conduite d’un homme avant sa mort a quelque chose d’un dessin au trait aggravé », écrit Jacques Chessex dans le roman paru peu après sa mort, Le Dernier crâne de M. de Sade. «Il y acquiert un timbre à la fois plus mystérieux et plus explicite de son destin. Dans la lumière de la mort, dont le personnage ne peut ignorer entièrement la proximité, chacune des ses paroles, chacun de ses actes résonne plus fort, de par la cruauté du sursis».
À lire ces mots, la dernière scène du « roman » que constitua la vie de l’écrivain résonne étrangement, prolongeant les analogies entre la fin pressentie de Sade, à 74 ans, et la mort subite de l’écrivain.
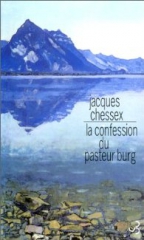 On peut rappeler alors plus précisément que Jacques Chessex, venu à Yverdon-les-Bains au soir du 9 octobre 2009 pour y parler en public de La Confession du pasteur Burg, histoire d’une jeune fille abusée par un pasteur calviniste, fut soudain interpellé par un auditeur de la causerie à propos du viol commis par Roman Polanski sur la personne d’une adolescente, que Chessex, interrogé par les médias, avait réduit à « une affaire minime ».
On peut rappeler alors plus précisément que Jacques Chessex, venu à Yverdon-les-Bains au soir du 9 octobre 2009 pour y parler en public de La Confession du pasteur Burg, histoire d’une jeune fille abusée par un pasteur calviniste, fut soudain interpellé par un auditeur de la causerie à propos du viol commis par Roman Polanski sur la personne d’une adolescente, que Chessex, interrogé par les médias, avait réduit à « une affaire minime ». Le contradicteur s’identifia comme médecin généraliste, familier des cas d’abus sexuels. Jacques Chessex commença de lui répondre sur un ton ironique, en disant exactement: "voilà un généraliste qui généralise", puis il tomba comme une masse pour ne plus se relever.
On me dira peut-être qu’il est malséant de rappeler un tel épisode, mais comment ne pas voir que le thème de l’éros calviniste, tel que je vais essayer de l’illustrer, y est présent, avec cette double instance de la luxure et de la mort, du désir sexuel et de la transgression sociale, de la liberté artistique et de la censure morale, que nous retrouvons à tout moment dans l’œuvre de Jacques Chessex, autant que dans sa vie.
Nous retrouvons également ces composantes dans le dernier roman de Jacques Chessex, paru deux mois après sa mort et lui aussi marqué par ce qu’on pourrait dire l’antinomie de l’érotisme et d’un certain puritanisme que figure, de façon souvent caricaturée, le calvinisme.
 C’est ainsi que Le dernier crâne de M. de Sade, paru dans un climat de scandale annoncé, fut vendu en Suisse sous cellophane par crainte de suites judiciaires. Les mauvais esprits, dont je suis évidemment, auront pensé que la recherche de la publicité n’était pas étrangère à cette démarche, mais passons...
C’est ainsi que Le dernier crâne de M. de Sade, paru dans un climat de scandale annoncé, fut vendu en Suisse sous cellophane par crainte de suites judiciaires. Les mauvais esprits, dont je suis évidemment, auront pensé que la recherche de la publicité n’était pas étrangère à cette démarche, mais passons...Et revenons plutôt à la littérature, ou plus précisément au noyau vif, ardent, incandescent même de l’écriture de Jacques Chessex, où le couple antinomique de la luxure et de la mort joue à l'évidence un rôle central, plus fondamental encore que celui du Désir et de la Loi, non moins présent.
Cette antinomie aura hanté Jacques Chessex jusqu’au dernier mot de son dernier roman. En quatre lettres de feu et de glace : c’est le mot de MORT. Ce mot est tiré de deux vers du poète romantique Eichendorff que cite à la fin du livre une «rose doctoresse» de la clinique lausannois La Cascade, assise sur un mur dominant le lac Léman, le long du quai d’Ouchy, et tenant sur son ventre doux le crâne biend ur de ce M. de Sade qu’on appela le « divin marquis », tenu pour le Diable par l’Eglise et dont la mâchoire semble bouger encore:
« Comme nous sommes las d’errer ! Serait-ce déjà la mort ? »
La réponse du Commandeur, que représentait sans s’en douter évidemment, ce soir-là le pauvre généraliste, foudroya prématurément Jacques Chessex, mais la question demeure, qui traverse Le dernier crâne de M. de Sade et cristallise en figure de contemplation que des siècles d’art et de littérature ont appelée Vanité : crâne exhumé de la tombe de Yorick (titre d'un recueil de poèmes de Chessex, soit dit en passant) devant lequel Hamlet psalmodie son «être ou ne pas être », têtes de mort peintes ou moulées que le mortel contemple avec mélancolie.

La mort et le sexe, plus précisément le sexe à mort dont le plaisir est aussi torture, constituent en effet la substance explosive du dernier roman de Jacques Chessex dont la fascination pour Sade, athée absolu, contredit absolument son propre « désir de Dieu » maintes fois réaffirmé et donnant son titre à l’un de ses plus beaux livres.Le dernier crâne de M. de Sade relate les derniers mois de la vie du philosophe, de mai à décembre 1814, à l’hospice des fous de Charenton où il est enfermé depuis onze ans en dépit de son «âme claire». Donatien-Alphonse François de Sade est alors âgé de 74 ans. Son corps malade est brûlé dedans et dehors, « et tout cela qui sert d’enveloppe, de support corporel déchu à l’esprit le plus aigu et le plus libre de son siècle ». Il n’en continue pas moins d’assouvir ses désirs fous.
Or, précise Chessex: «Un vieux fou est plus fou qu’un jeune fou, cela est admis, quoi dire alors du fou qui nous intéresse, lorsque l’enfermement comprime sa fureur jusqu’à la faire éclater en scènes sales ».
Lesdites « scène sales » se multiplient avec la très jeune Madeleine, engagée dès ses douze ans, fouettée, piquée avec des aiguilles et qu’il force à dire « ceci est mon corps » quand elle lui offre ses étrons à goûter. Et Sade de se faire sodomiser par la gamine en poussant d’affreux cris. Et de la payer à grand renfort de « figures », comme il appelle, sur son Journal, les pièces de monnaie qui suffisent à calmer la mère…
Pour faire bon poids de perversité et de sacrilège, le « vieux fou » exige du jeune abbé Fleuret qui le surveille, autant que de ses médecins, de ne pas autopsier son cadavre et de ne pas affliger sa tombe d’aucune « saloperie de croix ». Et de conchier enfin la « sainte escroquerie de la religion »…
Alors le lecteur, et pas seulement le lecteur calviniste, de s’interroger : mais pourquoi diable Jacques Chessex est-il si fasciné par l’extravagant blasphémateur dont il compare le crâne à une relique, et dont il dit qu’il y a chez lui « la sainteté de l’absolu ».
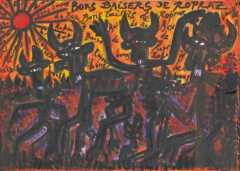 Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, que l'écrivain fait passer à travers son fétichisme personnel (très explicite aussi dans sa peinture) autant que dans ses fantaisies baroques frottées d'une sorte d'humour macabre.
Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, que l'écrivain fait passer à travers son fétichisme personnel (très explicite aussi dans sa peinture) autant que dans ses fantaisies baroques frottées d'une sorte d'humour macabre.« M. de Sade parle, les murs tombent, les serrures et les grilles cèdent, la liberté jaillit des fosses », écrit Jacques Chessex par allusion évidente à sa propre liberté d’artiste, dont on comprend mieux alors sa défense de Polanski autant que, en d'autres temps, de Pier Paolo Pasolini cité dans un poème.
°°°
On l’aura déjà constaté dès cette première évocation : il y a du forcené en Jacques Chessex, et j’ajouterai, avec une liberté qu’on m’a parfois reprochée, à commencer par l’intéressé: pour le pire autant que pour le meilleur.
Pourtant je me garderai bien de classer les livres de Chessex selon les critères du «meilleur» et du «pire», tant la contradiction lui est inhérente, quasi consubstantielle, brassée par une écriture certes composite, souvent baroque, aux intensités très variables, mais finalement tenue ensemble comme un organisme vivant et résistant.
De fait, Jacques Chessex est écrivain dans la masse, pourrait-on dire, sans discontinuer et depuis toujours à ce qu’il semble, à l’imitation d’un père fou de mots avant lui - Pierre Chessex était historien, rappelons-le, spécialiste des étymologies. Rien de ce qui est écrit n’est étranger à cet écrivain flaubertien par sa passion obsessionnelle, quasiment religieuse, du Monumentum littéraire. Toute sa vie a été mise en mots et sa carrière d’homme de lettres fut l’objet d’une stratégie tissée de plans et de calculs, de flatteries et de rejets, d’avancées sensationnelles (le premier Prix Goncourt romand, en 1973) et de faux pas signalant la passion désordonnée d’un grand inquiet peu porté, au demeurant, à s’attarder dans les mondanités.
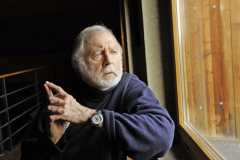 Jacques Chessex carriériste, pour parler un peu vulgairement ? Jacques Chessex pontife des lettres vaudoises et romandes ? Jacques Chessex seul grand écrivain du landerneau littéraire romand ? Tout, et son contraire, a été dit à son propos et lui-même a beaucoup fait, aussi, pour constituer une image publique qui relève plus du folklore que de la réalité. Or celle-ci est sans doute plus intéressante et complexe, que ce qu’en ont montré de multiples images médiatisées, surtout dans les dernières années d’une certaine gloire relancée.
Jacques Chessex carriériste, pour parler un peu vulgairement ? Jacques Chessex pontife des lettres vaudoises et romandes ? Jacques Chessex seul grand écrivain du landerneau littéraire romand ? Tout, et son contraire, a été dit à son propos et lui-même a beaucoup fait, aussi, pour constituer une image publique qui relève plus du folklore que de la réalité. Or celle-ci est sans doute plus intéressante et complexe, que ce qu’en ont montré de multiples images médiatisées, surtout dans les dernières années d’une certaine gloire relancée. Or tâchons, avec un peu de distance, de considérer la chose avec plus de légèreté.
Jacques Chessex s’est portraituré maintes fois en renard, et c’est en effet la figure de bestiaire qui lui convient le mieux, même s'il y a aussi chez lui du chat et du poisson, ou de l'ours veillant sur son miel...
On peut rappeler alors, au jeu des analogies animales, la distinction que faisait le critique anglais Isaiah Berlin, entre auteurs-renards grappilleurs, semblables par exemple à un Charles-Albert Cingria, et auteurs-hérissons concentrés sur leur table et constituant leur oeuvre en un seul massif, qu’évoquerait plutôt un Ramuz.

 Or Chessex a certainement du renard, par son œuvre de poète en prose, multipliant fugues et fragments et touchant à tous les genres, qu’on peut rattacher à la filiation d’un Cingria, mais il y a aussi chez le romancier du hérisson bardé de piquants, groupé sur lui-même et rapportant tout à son Œuvre, comme un Ramuz
Or Chessex a certainement du renard, par son œuvre de poète en prose, multipliant fugues et fragments et touchant à tous les genres, qu’on peut rattacher à la filiation d’un Cingria, mais il y a aussi chez le romancier du hérisson bardé de piquants, groupé sur lui-même et rapportant tout à son Œuvre, comme un Ramuz L’œuvre de Jacques Chessex n’a rien, pour autant de statique ni de prévisible: elle impressionne au contraire par son évolution constante et son enrichissement, sa graduelle accession à une liberté d’écriture aux merveilleuses échappées, rappelant à l’évidence le meilleur Cingria ou, parfois, les envolées lyriques d’un Aragon ou d’un Audiberti.
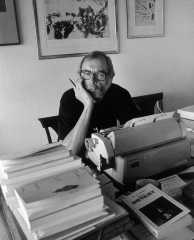 Aux sources de l’oeuvre
Aux sources de l’oeuvreL’œuvre de Jacques Chessex tire l’essentiel de sa dramaturgie et de sa thématique d’un scénario existentiel marqué par le suicide du père, évoqué et réinterprété à d’innombrables reprises, à la fois comme une sombre nue zénithale et un horizon personnel dégagé, un poids de culpabilité et une mission compensatoire, une relation particulière avec la mort et un appel à la transgression.
La démarche de l’écrivain procède à la fois d’un noyau poétique donné et d’un geste artisanal hors du commun, d’un élan obscur et d’un travail concerté sans relâche.
Dès la parution du premier de ses recueils, l’année de ses vingt ans, et avec les trois autres volumes qui ont suivi rapidement, le jeune poète se montre à la fois personnel, déterminé et bien conseillé, visant aussitôt la double reconnaissance romande et parisienne. Après quatre premiers recueils de poèmes qui s’inscrivent sans heurts sur la toile de fond de la poésie romande, l’écrivain va s’affirmer plus nettement dans les récits de La tête ouverte, publié chez Gallimard en 1962, et surtout avec La confession du pasteur Burg, paraissant en 1967 chez Christian Bourgois et qui amorce la série des variations romanesques sur quelques thèmes obsessionnels, à commencer par celui de l’opposition de l’homme de désir et des lois morales ou sociales.
De facture plutôt classique, La confession du pasteur Burg, que l’auteur appelle encore récit, représente bel et bien le premier avatar d’un ensemble romanesque à la fois divers et très caractéristique en cela qu’il «tourne» essentiellement et presque exclusivement autour d’un protagoniste masculin constituant la projection plus ou moins directe de l’auteur.
Cette cristallisation, à caractère autobiographique, sera la plus dense dans Jonas, grand livre de l’expérience alcoolique, mais le romancier saura rebondir parfois à l’écart de l’autofiction, comme Le rêve de Voltaire l’illustre de la manière la plus heureuse.
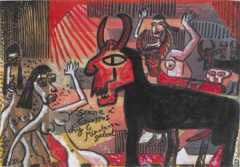 Ce qui me paraît en revanche plus limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la figure romanesque autonome. Dans une monographie consacrée à l'écrivain, l'essayiste et critique Anne-Marie Jaton a souligné, la première, cet aspect de l'oeuvre romanesque, entre autres déclinaisons du féminaire chessexien.
Ce qui me paraît en revanche plus limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la figure romanesque autonome. Dans une monographie consacrée à l'écrivain, l'essayiste et critique Anne-Marie Jaton a souligné, la première, cet aspect de l'oeuvre romanesque, entre autres déclinaisons du féminaire chessexien.°°°
Le lendemain de l’attribution du prix Goncourt 1973 à L’ogre, un certain Jean-Louis Kuffer publiait, dans La Tribune de Lausanne, un article intitulé Un roman fait pour le Goncourt, dont le ton de juvénile impudence contrastait évidemment avec les vivats locaux, et pourtant il y avait du juste dans la mise en exergue du côté fait de L’ogre, et je dirais plus précisément aujourd’hui, et sans intention critique malveillante pour autant: fait pour la France.
 A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à mes yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.
A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à mes yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, ou encore Les saintes écritures, consacré aux auteurs romands et nettement plus daté, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.
 Un tempérament et un style
Un tempérament et un styleJacques Chessex, pour l’essentiel, fut un styliste étincelant de la langue française, ainsi qu'un personnage quasi légendaire du monde des lettres romandes. Je veux évoquer, brièvement, le personnage. Cela aussi m’a été reproché au lendemain de sa mort : qu’on puisse parler de l’homme et non seulement de l’œuvre soudain exaltée, non sans hypocrisie tardive…
Or on peut rappeler que la querelle, l’invective dans les cafés et les journaux, voire la bagarre à poings nus, n’auront point trouvé de représentant plus acharné que le meilleur des prosateurs romands apparus dans la filiation directe de Ramuz.
Le dernier exemple d’un conflit spectaculaire auquel le Goncourt romand aura été mêlé remonte à la parution, en 1999, de son fameux pamphlet, Avez-vous jamais giflé un rat?, en réponse à un essai non moins virulent s’attaquant à lui sous la plume (à vrai dire médiocre) de l’enseignant lausannois Charles-Edouard Racine, intitulé L’imposture ou la fausse monnaie.
Dans la postérité de Ramuz, l’œuvre de Jacques Chessex est incontestablement, avec celles d’Alice Rivaz, de Maurice Chappaz ou de Georges Haldas, des plus marquantes de la littérature romande et francophone. Du seul point de vue des pointes de son écriture, Chessex nous semble n’avoir qu’un égal, en la personne de Maurice Chappaz.
 Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le Désir de Dieu, qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l'hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d'un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l'exemple...
Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le Désir de Dieu, qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l'hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d'un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l'exemple...Dans la perspective d'une illustration des littératures francophones, nous devons, assurément, une reconnaissance réitérée à Jacques Chessex. Et pour l’illustrer, j’aimerais revenir à l’un de ses plus beaux livres, très personnel et très épuré, intitulé L’Imparfait et paru sous l’appellation de chronique en 1996.
L’écrivain s’y retrouve comme à tâtons, comme dans un rêve, mais pour une ressaisie à la fois très concrète et sublimée, qui nous touche de près dès les premières lignes où affleure la maison de l’enfance et de l’adolescence - et d’emblée c’est la musique d’un poète :
 «À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».
«À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».D’emblée nous nous retrouvons en terre connue, du côté de Ramuz. Mais Chessex a sa voix propre, évocatrice pour tous. Nous nous rappelons tous, en effet, ce jardin «en petite pente». Ils sont aussi à nous tous, ces reflets de lac dans les chambres. Or nous voici à l’orée d’un monde dont les images vont émerger peu à peu comme d’une camera oscura et nous relier à la vie et aux livres qui ponctuent cette vie, mais aussi à nos propres ombres et à nos propre lumières.
Tout à l’opposé de mémoires anecdotiques, l’œuvre déploie des images vivantes qui cristallisent les sensations primordiales autant que les questions essentielles: le vertige d’être, la souffrance du manque, le « sentiment aigu de l’inutilité de la vie » et, inversement, cette « force organisatrice de plaisir et de décision » qui va dresser la pyramide de l’œuvre dans le désert, et le sentiment de l’infini, enfin l’aspiration à l’allègement et à l’élévation : «Comme si j’étais capable à la fois de côtoyer le espaces les plus désolés et la clarté, le feu, le torrent, l’air ».
Tel étant le sol physique et métaphysique d’un Jacques Chessex élémentaire. Terrien. Mais esprit subtil. Dont le style est tantôt chargé, jusqu’au baroque, comme dans Carabas, et tantôt fluide, voire cristallin, comme dans L'imparfait, précisément. Poids du monde et chant du monde y alternent, mêlées et fusées.Il y a donc, dans L'Imparfait, cette maison où l’adolescent apprend à écrire et à dessiner, à peindre, à écouter et à jouer le blues, mais sur laquelle pèse déjà le poids d’une menace. Du moins le fils rend-il hommage au père initiateur : « Dedans, l’écriture, c’était mon père, ses livres d’étymologie et d’histoire, sa bibliothèque, ses corrections d’épreuves, le latin, la toponymie, les dossiers des contes, les dictionnaires. Il était mon encyclopédie bienveillante et mon initiateur à toutes sortes de formes et de sens. Je sais que si j’écris aujourd’hui, c’est parce que j’ai imité mon père dès que j’ai eu six ou sept ans ».
Plus tard, il dira sa reconnaissance, aussi, à l’aîné providentiel qui encouragea le garçon dans sa singularité d’écrivain déjà perceptible : le professeur de collège et l’écrivain Jacques Mercanton.
Sa reconnaissance se manifeste encore, à l’autre sens du terme, envers la terra incognita des parents. Et combien de détails déchirants remonteront alors des fonds obscurs. Tout un monde que filtre à distance, dans L’Imparfait, le regard d’un homme désormais plus âgé que son père suicidé.
Une remarque me renvoie, ici, à ma perplexité de naguère, que d'autres ont pu ressentir en voyant l'écrivain ressasser le thème de la mort du père, à commencer par L'Ogre: «On a pu croire, à tel de mes premiers romans, que j’avais un problème littéraire avec mon père, ou que le thème du père était chez moi tout littéraire, et que j’exploitais en homme de lettres une mythologie balisée et confortable ».
Or j’en suis venu à croire, en lisant L’Imparfait, à l’entière sincérité de sa défense: «Il y a en moi un poids de douleur que rien, je le sais calmement, n’épuisera ». Et comment douter, au regard des récits et des poèmes que Jacques Chessex a publiés depuis lors, tels L’économie du ciel, Le désir de Dieu ou Pardon mère, qu’il n’a cessé de vivre la relation au père disparu « comme une élégie interminable ».
Quelque chose a été brisé qui instaure à jamais le règne de l’imparfait, et le ressouvenir du seul mot jardin suffit à exacerber la peine: « Mots douloureux, relève-t-il: « Papa est au jardin », « on goûtera au jardin », « les premières cerises du jardin », toujours cette cloche grêle, fêlée, au fond de la phrase. À jamais le non-réalisé, l’interrompu, le non-vécu – l’imparfait ».
L’imparfait comme temps de l’enfance, mais qui détermine aussi le premier écart et la première tangente personnelle. Je suis seul et vous êtes tous, dit le héros du Souterrain de Dostoïevski, que pourrait lancer aussi le jeune Chessex.
Telle est aussi bien la situation du solitaire qu’on regarde de travers à la pension de la respectable veuve Augustine Lequatre, dans La Tête ouverte, et telle aussi la situation du pasteur Burg et tous les avatars romanesques de l’auteur.
L’imparfait, Jacques Chessex l’évoque en poète aux vertiges physiques et métaphysiques à la fois. Plutôt que le temps sentimental de la mélancolie, c’est celui d’un « vertige nauséeux » dont on doit s’arracher pour survivre.
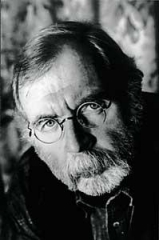
« Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis Dieu devint parole dans un homme. Puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut « Ich hab genug», Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dans les os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de son corps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir. Comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais ».
À cette plongée s'accordant celle de la chair et du désir. Car le temps de la maison sur le jardin «en petite pente» est aussi celui des premières échappées du corps à la recherche d’une certaine odeur entêtante. Odor di femina... Dès l’adolescence s’est ouvert cet autre à-pic, mais à présent c’est dans le temps que va se prolonger cette fringale d’une nourriture terrestre aux implications quasi sacrées. C’est que là aussi s’est révélé le sentiment d’une séparation initiale : «Le corps des femmes est autarcique. C’est-à-dire qu’il est un monde, ou un territoire, un lieu, une circonstance, une évidence qui se suffit à soi-même. Ainsi sa supériorité, sa nuit, sa gloire».
Ce que nous devons à Jacques Chessex
L’œuvre de Jacques Chessex s’est construite, de part en part, sur une faille. Mais celle-ci n’est-elle pas notre part à tous ? D’où peut-être, aussi, le rejet que suscite parfois cette œuvre ? Pourtant son mimétisme fait de l’écrivain un médium de nos exultations et de nos misères, de nos appétits multiples et de nos angoisses, exorcisées par le verbe.
Et puis il faut dire, également le courage, l’obstination et la santé de cette œuvre. Si l’imparfait subi est le temps de l’enfance, l’imparfait retourné, sublimé et dépassé sera celui du baroque et de la vie profuse, du mouvement et de la lumière, des ombres mais signifiant aussi la vie, du chaos vivant mais transmuté par le style.
Reconnaissance alors à Jacques Chessex pour notre langue qui est celle à la fois de Pascal et d’Agrippa d’Aubigné, de Rousseau et de Benjamin Constant, de Ramuz et de Chappaz, de Mallarmé et de Gustave Roud.
Reconnaissance aussi pour notre pays, non pas au sens d’un esthétisme du repli, mais dans la présence proche du Jorat et l’ouverture européenne qui associe Jacques Mercanton et Vladimir Nabokov, Flaubert et Cingria qu’il prolonge également, ou cet ouvert obscur très suisse « par en dessous » qui lie Robert Walser et Louis Soutter, ou Wölffli et Jean-Marc Lovay à l’enseigne de la « société des êtres » dont parle Georges Haldas.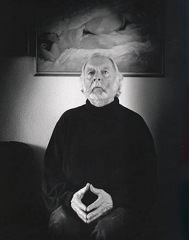
Reconnaissance enfin pour ce que Jacques Chessex nous fait reconnaître en nous. À tout instant la même ruine nous menace, mais il y a le blues et le psaume, et le poète « plein de Dieu » qui n’en finit pas de conjurer l’imparfait : « Me suivra-t-on si j’affirme y voir une vraie résurrection de l’être à l’instant même où il croyait se perdre ? Je me défaisais dans le spectacle du non-visible et l’esprit me revient comme une gorgée neigeuse qui me soulève au-dessus de l’indistinct. Le doute, à chaque fois, cède à cette force et fait place à une joie tout de suite habitable ».
-
D'une échappée l'autre

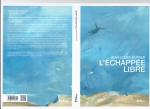
À propos de L'Échappée libre,
par Sergio Belluz.
Nous vivons une époque où le roman est à l’honneur, et c’est très bien ainsi. Il y a de gros vendeurs (Guillaume Musso, Marc Levy, Katherine Pancol, Amélie Nothomb, notre compatriote Joël Dicker…) et une multitude de prix littéraires qui récompensent les romans de l’année et profitent à l’ensemble de l’économie éditoriale. Bestsellers ou confidentiels, géniaux, talentueux ou habiles, certains romanciers créent des univers littéraires particuliers ou extraordinaires, d’autres renouvellent le genre ou l’utilisent pour exprimer la réalité et on voit bien, à l’arrivée, que dans ses multiples subdivisions (jeunesse, formation, amour, aventure, policier, fantastique, historique, autofiction…) et sous ses divers avatars (bande dessinée, cinéma, série télévisée), le roman, et la fiction en général, répondent à la fois à un besoin de représentation, de reformulation, de synthèse, de personnification de la réalité, et à un besoin de divertissement, d’évasion, d’échappatoire, même, en lien direct avec (et en réaction contre) une société qui a fait de l’information un produit comme un autre, vendable et rentable, que les médias transmettent en fil continu, commentée ou brute, quotidienne et constante, proche et lointaine, humaine et déshumanisée, difficile à comprendre et souvent difficile à supporter.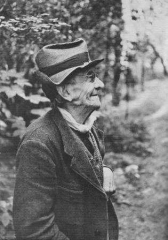 Mais on confond roman et littérature. La littérature n’est pas nécessairement le roman ni la fiction. Casanova et ses Mémoires de ma vie sont au premier rang de la littérature dans ce qu’elle a de plus humain et de plus raffiné, comme les Mémoires de Saint-Simon, comme le Candide de Voltaire, comme les Lettres de Mme de Sévigné, comme les Essais de Montaigne, ou les Journaux littéraires de Gide, de Julien Green, ou de Paul Léautaud. On peut s’y intéresser pour diverses raisons, mais ces œuvres n’auraient jamais passé le temps sans ce quelque chose dans le texte, dans le style, dans la manière de voir et de s’exprimer, qui retient l’attention, qui accroche, qui séduit, qui amuse, qui émeut, qui continue d’intéresser et d’émouvoir bien après la disparition de leur auteur et qui, par l’expression d’un univers à la fois personnel et littéraire, estompe la distinction entre ce qui serait fiction et ce qui serait réalité et rend caduques les jugements de valeur sur la supériorité d’un genre par rapport à l’autre.
Mais on confond roman et littérature. La littérature n’est pas nécessairement le roman ni la fiction. Casanova et ses Mémoires de ma vie sont au premier rang de la littérature dans ce qu’elle a de plus humain et de plus raffiné, comme les Mémoires de Saint-Simon, comme le Candide de Voltaire, comme les Lettres de Mme de Sévigné, comme les Essais de Montaigne, ou les Journaux littéraires de Gide, de Julien Green, ou de Paul Léautaud. On peut s’y intéresser pour diverses raisons, mais ces œuvres n’auraient jamais passé le temps sans ce quelque chose dans le texte, dans le style, dans la manière de voir et de s’exprimer, qui retient l’attention, qui accroche, qui séduit, qui amuse, qui émeut, qui continue d’intéresser et d’émouvoir bien après la disparition de leur auteur et qui, par l’expression d’un univers à la fois personnel et littéraire, estompe la distinction entre ce qui serait fiction et ce qui serait réalité et rend caduques les jugements de valeur sur la supériorité d’un genre par rapport à l’autre.
En fin de compte, seul ce qui est vrai et la manière d’exprimer ce vrai sont intéressants, une vérité qu’on trouve sentie et exprimée tout autant dans un bon roman que dans tout autre genre littéraire, autobiographique ou pas.
Le journal littéraire
Avec son ironie coutumière, Paul Léautaud a intitulé « Journal littéraire » ses notes quotidiennes sur la vie, l’amour et la littérature. Dans le même temps, il y réfléchissait sur la langue française, et y travaillait sans cesse à la forme, sans penser qu’un jour ce serait ce même fameux journal, tenu toute sa vie, qui deviendrait une œuvre littéraire à part entière et son chef-d’œuvre, bien plus que Le Petit ami, In Memoriam et Amours, ses trois « romans » autobiographiques.De son côté, Jean-Louis Kuffer écrivait, dans Les Passions partagées : « Je rêve d’un livre qui ne serait ni journal intime, ni roman, pas plus que recueil d’essais ou d’aphorismes, et qui serait ensemble tout cela ». À la publication du gros dernier, on peut dire que ce rêve est réalisé et que ce livre, ces carnets, ces notes, ce journal kaléidoscopique et littéraire distillé sur plusieurs volumes – L’Échappée libre (1999-2013), Riches Heures (2005-2008), L’Ambassade du Papillon (1993-1999), Les Passions partagées (1973-1992) –, est à la hauteur de cette ambition, une petite merveille qui, par la grâce du style et l’intelligence du regard, restera à la fois comme la chronique fouillée, précise, d’une époque passionnante et comme le témoignage émouvant du parcours personnel d’un écrivain dont on connaît la méfiance à l’encontre des idées toutes faites ou de la critique jargonnante, dont on aime l’humour et la lucidité qui le porte à vivre chaque instant à fond et dont on savoure le style sans fioriture, net, presque sec, mais riche, subtil et virtuose, qui tient en laisse une hypersensibilité qui affleure partout.
Entre parenthèse, on espère que, dans une future réédition, tous les volumes de cet indispensable chronique littéraire seront regroupés et bénéficieront, comme les journaux littéraires des frères Goncourt, d’André Gide, de Léautaud ou de Julien Green, d’un index général des noms cités – il ne figure, pour l’instant, que dans le dernier, L’Échappée libre – qui mettrait en valeur le magnifique travail de mémorialiste de Jean-Louis Kuffer, et permettrait à la fois de trouver facilement une référence, et de s’adonner frénétiquement au plaisir ou au vice d’aller piocher par-ci par-là un portrait ou un ragot. Le journal littéraire est à la littérature ce que Voici est au salon de coiffure : un irrésistible plaisir coupable.
Fermons la parenthèse et revenons à Léautaud, qui a souvent répété que pour lui, « écrire, c’est vivre deux fois ». Lire un journal littéraire de la qualité de celui de Jean-Louis Kuffer, c’est-à-dire une œuvre littéraire qui parle de littérature, c’est, en tant que lecteur, avoir la chance de vivre ou de revivre une troisième vie, qu’on découvre et redécouvre grâce au talent d’un observateur hors pair, dont on aime les notations honnêtes, franches, sans mensonges à soi-même, sur la vie, sur la perte d’un père, sur la naissance d’un enfant, sur la mort d’un ami, sur les doutes quant à sa propre valeur en tant qu’homme et en tant qu’écrivain, sur les moments de bonheur intense, sur les curiosités, sur les amitiés qui naissent et sur celles qui meurent, le tout agrémenté par-ci par-là, presque dans les marges, de délicieux « Ceux qui… », les fameuses improvisations humoristiques et virtuoses de l’auteur autour d’un thème donné, de facétieux exercices de style à la Raymond Queneau et à la Pierre Dac, qui mériteraient à eux seuls, par leur verve et par leur qualité littéraire, une publication à part, entre les aphorismes de Cioran et les Brèves de comptoir de Gourio.
L’Échappée libre (L’Âge d’Homme, 2014)
Le dernier volume en date, L’Échappée libre, couvre la période 1999-2013, et on a la suite de cette superbe chronique littéraire du monde vu de Suisse, dont les dates de publication ne suivent pas une chronologie stricte puisque Riches Heures, le volume précédent, publié en 2008, traite des années 2005-2008 et recoupe en partie la période évoquée dans L’Échappée libre, et que L’Ambassade du Papillon, qui traite des années 1993-1999, a été publié en 2000, avant Les Passions partagées (2004), qui couvre les années 1973-1992. Ça n’a d’ailleurs aucune sorte d’importance et sert même le propos de l’auteur qui, comme tout être humain, revient de manière naturelle, par association d’idées, par réminiscence, par nostalgie, sur les événements qui ont profondément marqué son existence, et les évoque et les analyse sous des angles changeants, en une sorte de « Je est un autre » qui s’appliquerait aux différentes évolutions du moi du narrateur.
En parallèle, au fil de rencontres privées ou professionnelles, et avec ses portraits extraordinairement sensibles et précis, quelquefois drôles et vachards, mais toujours justes, Jean-Louis Kuffer arrive à restituer toute une époque. Dans ce volume, on s’entretient avec Paul Morand, ou Philippe Sollers, on y évoque les relations (houleuses !) avec Jacques Chessex et la mort de l’écrivain, on y découvre Quentin Mouron ou Max Lobe, une nouvelle génération de jeunes auteurs.On y sent aussi la tristesse de Jean-Louis Kuffer lorsqu’il apprend la mort de Dimitrijevic, l’ami et l’éditeur, dont des divergences d’opinion, politiques surtout, l’avaient séparé. C’est Dimitrijevic qui, il n’y a pas si longtemps, lorsque l’URSS condamnait ses meilleurs écrivains, avait fait connaître Vassili Grossman au monde entier et avait fait de L’Âge d’Homme, dans l’aire francophone, la référence absolue pour les magnifiques littératures slaves, que la prestigieuse maison a fait traduire et qu’elle continue à défendre sous la direction de la fille du fondateur.
En passant, Jean-Louis Kuffer y parle aussi, en toute franchise, de ses rapports avec les éditeurs, de ses moments de découragement profond, de ses amitiés remises en cause, de ses doutes, de ses moments de plénitude, en couple, en famille ou en voyage. Et de ses relations compliquées avec sa famille, cette famille qu’on a déjà rencontrée dans d’autres œuvres (Le Pain de coucou, Le Sablier des étoiles …) et qu’on retrouve ici avec émotion, notamment ce père, si délicatement évoqué à travers le souvenir d’une balade sans paroles, à deux, du côté de Begur, sur la Costa Brava.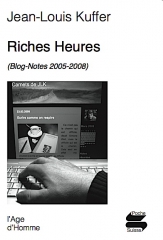 Riches Heures (Poche suisse, L’Âge d’Homme, 2009)
Riches Heures (Poche suisse, L’Âge d’Homme, 2009)
C’est à l’initiative de Jean-Michel Olivier, écrivain et directeur de la collection Poche suisse qu’on doit la Riche Idée de la publication de Riches Heures, qui propose quelques 2000 textes écrits dans les années 2005-2008. Ces Riches Heures, intercalées entre L’Échappée libre et L’Ambassade du papillon, font chronologiquement partie des années couvertes dans l’Échappée libre (1999-2013), mais lui font comme une parenthèse littéraire qui serait une sorte de bande annonce de l’ensemble, puisqu’il s’agit d’un superbe florilège du blog littéraire de Jean-Louis Kuffer (http://carnetsdejlk.hautetfort.com/), créé en 2005.
Ces Riches Heures sont la suite de L’Ambassade du papillon, mais une suite qui prend un nouveau départ, et dont l’écriture s’enrichit de l’immédiateté de l’Internet et de l’interaction avec les lecteurs, fidèles ou ponctuels : « Pasternak disait écrire 'sous le regard de Dieu', et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise. J’écris cependant, tous les jours, 'sous le regard de Dieu', et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK. Cela peut sembler extravagant, mais c’est ainsi que je le ressens. En outre, j’écris tous les jours sous le regard d’environ 500 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 5000 sans que cela ne change rien : je n’écris en effet que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux. »L’Ambassade du Papillon (Campiche, 2000)
Dans L’Ambassade du Papillon, l’ouvrage qui précède L'Échappée libre et les Riches Heures, et qui traite des années 1993-1999, Jean-Louis Kuffer évoque ses rapports personnels, en tant que critique et en tant qu’écrivain, avec le monde littéraire romand, notamment la grande brouille avec Dimitrijevic, la fin d’une très grande amitié et la fin d’une époque. L’auteur y parle aussi de son activité de journaliste au quotidien 24 heures et de rédacteur en chef du Passe-Muraille, son magazine littéraire, un témoignage passionnant sur ce qu’est ou non l’engagement politique – l’information, la désinformation, la manipulation, le nationalisme, les médias, le vrai, le faux – lié aux rapports humains, rendus plus complexes encore par les ambigüités qui font se mêler amitié et édition, sentiment et pragmatisme.
On y retrouve ces magnifiques moments de solitude et d’introspection quelquefois joyeux, quelquefois douloureux, cette lucidité sur soi-même, ces doutes personnels de l’auteur quant à ses qualités humaines ou ses capacités littéraires, cette fantaisie aussi, et ces pages extraordinaires de tendresse triste sur la maladie et la mort de Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier dans L’Usage du monde et superbe peintre. On y savoure cet art du portrait littéraire ou humain, celui, en filigrane, de sa compagne, celui de ses filles, qu’il regarde grandir, mais aussi ceux fins, rageurs quelquefois, désabusés aussi, de Dimitrijevic ou de Jacques Chessex. On y éprouve ce sentiment du temps, et de la mort, cette conscience aigüe de l’importance de ce que l’on vit au moment où on le vit.
En parallèle, on y rend compte de l’intérieur de toute une époque qui se terminait, celle de la guerre froide, et d’une nouvelle époque qui naissait, avec sa géostratégie complexe et sournoise incluant les médias et une partie de l’intelligentsia, dont les populations de l’ex-Yougoslavie et de bien d’autres pays – la Tchétchénie, la Géorgie, l’Irak, l’Egypte, la Syrie, l’Ukraine, le Soudan… –, continuent à faire les frais sous couvert de nationalisme ou de désir de démocratie, pendant que les grandes puissances s’arrangent entre elles pour préserver chacune leur importance régionale, leurs sources d’énergie et leur pouvoir d’achat. Diviser pour mieux régner…
Les Passions partagées (Campiche, 2004)
Dans ce volume, qui retrace les années 1973-1992, c’est la 'période Dimitrijevic' qui est évoquée, avec les grands auteurs serbes qu’on y publiait, et les vedettes-maison, Grossmann, Zinoviev, Volkoff, dont Jean-Louis Kuffer fait des portraits vivants, sophistiqués, musicaux, visuels, tactiles presque, n’hésitant pas à parler de leurs petitesses à plusieurs reprises. Il remarque, à propos de Zinoviev : « Le génie est incapable de se faire un œuf au plat ». Quant à Volkoff, il apparaît en chasseur, et ça lui va comme un gant. Lucien Rebatet fait l’objet d’un étonnant entretien, Denis de Rougemont ne peut s’empêcher de faire semblant d’ignorer l’existence de Friedrich Dürrenmatt, Gore Vidal fait une apparition élégante et pleine d’humour, Michel Tournier reste d’une politesse glaciale et fermée, Patricia Highsmith apparaît au contraire primesautière.
En parallèle, l’auteur assiste à la mort de son père, à celle de sa mère, à la naissance de ses filles. L’enfance est évoquée à travers ses conditionnels – « Le conditionnel de notre enfance, c’était la clef des mondes. On serait sur une île, Toi, tu ferais les Indigènes et moi je serais Surcouf » – et à travers des notes comme « La maison de mon enfance avait une bouche, des yeux, un chapeau. En hiver, quand elle se les gelait, elle en fumait une » ou comme « La douceur bouleversante d’après les larmes de notre enfance, que nous cherchons peut-être à retrouver, de temps en temps, en essayant de pleurer sans raison ». On y parle aussi de voyage – « Le voyage indispensable pour se décentrer, avant de se recentrer » –, des allers-retours « sur » Paris – « J’ai besoin de ces deux pôles, de solitude et de multitude » – , et de la Suisse, enfin, dont il fait un portrait si terrible et si juste : « Les deux faces de la Suisse que je redoute le plus : tea-rooms d’un côté, chiens policiers de l’autre. »
On y parle aussi de voyage – « Le voyage indispensable pour se décentrer, avant de se recentrer » –, des allers-retours « sur » Paris – « J’ai besoin de ces deux pôles, de solitude et de multitude » – , et de la Suisse, enfin, dont il fait un portrait si terrible et si juste : « Les deux faces de la Suisse que je redoute le plus : tea-rooms d’un côté, chiens policiers de l’autre. »
C’est d’ailleurs dans Les Passions partagées qu’on trouve peut-être une des clés de ce magnifique journal littéraire, dont on espère qu’il va continuer encore longtemps : « La seule bonne façon d’écrire me semble d’écrire tout le temps, non par automatisme mais par attention ». -
Divtseserimnet aotomunal

Le creaveu hmauin lit dnas le dsérorde
Sleon une étdue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des lteetrs dans les mtos n’a pas d’ipmortncae. La suele coshe ipmortnate est que la pmeirière et la drenèire ltetre sionet à la bnone pclae. Le rsete puet êrte dans un désrorde ttoal snas cuaser de prbolème de letcure. Cela prace que le creaveu himaun ne lit pas chuaq ltetre dstinciteemnt et à la stuie, mias le mot cmome un tuot.
Cttee rvéélaiton ve-t-lale ficaliter la tchâe des cnacres dans les éocles ? Et les hmomes se cmoprenrdont-ils miuex en s’exrimpant dans le désrorde ? Le dréosdre mnodial va-t-il bnéfiécier de ce nuovaeu mdoe d’exrpession en nuos fisanat vior la réatilé d’un oiel noavueu ? L’vaneir de l’epsèce hamuine s’en truoerva-t-il chngaé, voire aémiolré ?
L’édtue de l’Uerisnivté de Cibramdge plare de leutcre mias pas d’esspreixon olrae. Si vorte ceervau lit chqaue mot cmmoe un tuot, tuot se cpmlioque au memont de vuos empxrier de vvie voix !
Si vuos lsiez : « Le cehin oibét à son mtaîre », vuos ne pvouez oodnrner à votre cbles : « Moédr, dnone la pttapae à pnapouet ! » Le pruave Mdéor n’y pgiera que piouc ! De mmêe la crtlaé du Tjéléouarnl rsqiue de piâtr du pssaage des mtos éicrts aux mtos écnonés à 20 hurees par Pactrik Pvoire de Cazhal. Rien que Mdaame, Msonieur, Boionsr ! » jetetra la csonfuion dnas le caerevu des téésltpeucaters les puls déots en la mtraièe…
On viot arlos la litmie de l’iérntêt de l’édtue fauemse. Ce qui se lit frot bien ne psase pas à la tléé. Est-ce à drie que le cevreau huiamn n’a pas été cçnou pour fonnonctier à plein rmiége en fcae d’un piett écran ? Tllee est puet-êrte la quioestn fonnemdatale à mteédir suos le cauqse de la cousfeife...Peinture: Pierre Omcikous
-
À l'obscur dépli
 (Pour Mario Martín Gijón)Tout perdre aurait été facile,nul besoin d’affecter:au premier retour en ton îlete laisser affaler…Les oiseaux n’ont point de répitaux derniers horizonsoù les vents des anciens récitss’épuisent sans raison…Et pourtant tu as résistécontre vents et maréessans raison non plus d’affronterle dépli des saisons…L’hiver t’accueille en ses alléeset le printemps là-baste fait revenir aux étésqui ne reviendront pas…Là-bas le chant des matelotste ferait rebrousserle chemin vague sur les eauxsi le passé n’était passé...Image: Philip Seelen.
(Pour Mario Martín Gijón)Tout perdre aurait été facile,nul besoin d’affecter:au premier retour en ton îlete laisser affaler…Les oiseaux n’ont point de répitaux derniers horizonsoù les vents des anciens récitss’épuisent sans raison…Et pourtant tu as résistécontre vents et maréessans raison non plus d’affronterle dépli des saisons…L’hiver t’accueille en ses alléeset le printemps là-baste fait revenir aux étésqui ne reviendront pas…Là-bas le chant des matelotste ferait rebrousserle chemin vague sur les eauxsi le passé n’était passé...Image: Philip Seelen. -
Sollers à Salzbourg
Le camouflet le plus cuisant de sa carrière publique serait-il évoqué dans ses Mémoires ? La question en contient une autre : l'écrivain est-il capable d’autodérision ? La lecture d'Un vrai roman, récit autobiographique paru en 2007, n'a pas permis de répondre par l'affirmative...
La publication des Mémoires de Philippe Sollers, intitulés Un vrai roman, n'a pas révélé, à propos d’un épisode de son cursus public vécu par l’écrivain à l’hiver 1983 à Salzbourg, la part d’autodérision qu’on eût pu attendre d’un auteur septuagénaire et qui en a vu d'autres, comme on dit. Tel est le constat que je relance un lustre plus tard et non sans malice, moi qui ai assisté à la scène pour en goûter tout le sel, alors que Sollers lui-même ne pouvait qu’en éprouver la part mortifiante, sans se douter de l’identité de celui qui lui fit subir alors le camouflet le plus cuisant de sa carrière, qui plus est en Autriche.
Je résume les faits : le 31 novembre 1983, au Mozarteum de Salzbourg, Philippe Sollers, qui s’apprêtait à connaître la griseries de la popularité débondée, après la parution de Femmes, était invité par l’Alliance française locale pour une conférence toute consacrée à Mozart, dans la salle dite die Kleine, la Petite. Or ce même soir, dans la salle du Mozarteum dite die Grosse, la Grande, le Goethe Institut conviait l’écrivain autrichien Thomas Bernhard à parler d’un livre en chantier dont la lectures des pages inédites serait, selon le vœu de l’auteur, agrémentée de parties jouées à l’accordéon, en allemand ZiehHarmonika.
Je reste objectif : ainsi ne puis-je que souligner le fait que Philippe Sollers, qui n’avait rien lu de TB à cette date, ne pouvait par ailleurs subodorer l’identité de celui qui allait lui voler la vedette, en attirant irrésistiblement le public salzbourgeois de la Petite vers la Grande, au fur et à mesure que la soirée passait et que s’amplifiaient les improvisations de TB à l’accordéon, parfaitement audibles de la Petite comme l’a compris le lecteur moyen. Or il va de soi que Frau Doktor Gesualdo Von Bock, directrice de l’Alliance française de Salzbourg, autant que moi-même, Herr Doktor Ebehard Safranski, son trésorier, avons tout fait pour empêcher Philippe Sollers de quitter la Petite pour la Grande afin d’y protester contre la nuisance que représentait assurément l’accordéon traité à la manière d’un instrument percussif, entre Bartok et Boulez, tant notre souci d’éviter le moindre désaccord avec le Goethe Institut nous tient lieu d’éthique de proximité.
Philippe Sollers ne subit donc, ce soir-là, qu’une humiliation restreinte, qu’il ne tarda à compenser en séduisant, au dîner qui suivit, la fille aînée de Frau Gesualdo, cette peste de Ludivina à la diabolique beauté, qui se sera fait un plaisir, en l’épuisant sous ses ruades et palotades, de lui révéler QUI était à l’origine de sa déconfiture. En tout état de cause, l’incident a tant fait jaser à Salzbourg que Paris n’a pu qu’en avoir vent, et comme rien de ce qui est de Paris n’est étranger à Sollers… -
Celles qui ont le coeur à l'ouvrage

Celui qui estime sans arrière-pensée que le travail libère / Celle qui chante en faisant les vitres / Ceux qui bossent à plein temps libre / Celui qui à l’instar du docteur Destouches alias Céline ne respecte que les constricteurs / Celle qui a connu Stefan Zweig à l’poque où il envisageait une trilogie consacrée à Dickens, Dostoïevski et Balzac sous le titre de Trois Maître ou Les Constructeurs / Ceux qui ne supportent pas la négligeance que représente la funeste Coquille / Celui qui ne donnera pas son bon à tirer à un peloton d’exécution non attitré / Celle qui affirme qu’elle s’est « fait » la Comédie humaine « à l’époque » / Ceux qui affirment sur Facebook que Gérard Depardieu a fait réécrire Le Colonel Chabert par un nègre / Celui qui sue sang et eau sur des poèmes minimalistes / Celle qui met la dernière main à un sonnet en langue inclusive / Ceux qui poursuivent leurs études genre à l’insu de leurs gendres autoproclamés / Celui qui fait subventionner ses intermittences / Celle qui travaille au noir à la Maison-Blanche / Ceux qui se donnent à leur ouvrage qui le leur rend au centuple / Celui qui se concentre tous azimuts / Celle qui dit que tout l’amuse en tant que nouvelle cheffe de projet au Musée de l’Homme / Ceux qui font le job sans cracher sur le taf, etc.
-
Kaléidoscope

… Quand j’étais môme je voyais le monde comme ça: j’avais cassé le vitrail de la chapelle avec ma fronde et j’ai gardé les morceaux que j’ai recollés comme ça, tout à fait comme ça, j’te dis, et c’est depuis ce moment-là que je vois le monde en couleurs, et c’est réellement comme ça, j’te dis, qu’il est, le monde…
Image : Philip Seelen -
Moi parler joli français...
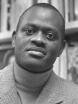
 Les francophones peuvent-ils déjouer le provincialisme parisien ? Note de 2006.
Les francophones peuvent-ils déjouer le provincialisme parisien ? Note de 2006.
La francophonie littéraire est-elle un reliquat du colonialisme hexagonal, ou l’expression d’une réalité multiculturelle en voie de plus ample reconnaissance ? Un festival francophone largement déployé en France, qui fut aussi l’invité d’honneur du récent Salon du livre de Paris, suscitant une quantité de publications et, dans les médias, moult dodus dossiers (tels ceux du Magazine littéraire et de Libération), constituent autant de signes apparemment positifs, notamment pour la meilleure information du public. Celui-ci découvre, chez des auteurs rarement étudiés à l’école ou cités dans les anthologies, un usage de la langue souvent plus proche de son expérience vivante que le français plus « châtié » des écrivains de France. En outre, une circulation transversale s’établit entre les diverses communautés francophones à l’occasion de telles manifestations. « La langue française a un rôle fédérateur pour beaucoup d’auteurs hors de France», remarquait ainsi le romancier congolais Alain Mabanckou lors d’un débat public, où Bernard Pivot se félicitait pour sa part de l’enrichissement de la littérature française actuelle par ses « périphéries ».
Pourtant, la seule opposition d’un « centre » et d’une « périphérie » ne signale-t-elle pas une distinction de fait entre écrivains français de France, ou auteurs « naturalisés » par l’instance de consécration de Paris, et « francophones » d’outremont ou d’outremer dont seul Paris, une fois encore, désigne les mérites ? L’Académicien ex-avant-gardiste Robe-Grillet ne peut réprimer un sursaut d’horreur lorsque le romancier marocain Tahar Ben Jelloun a le front de lui demander s’il se considère lui aussi comme un francophone. Et quand Edmonde-Charle Roux, de l’Académie Goncourt, constate que Maurice Chappaz s’exprime dans « un très joli français », sans doute estime-t-elle lui rendre justice. De la même façon, les rédacteurs des nouveaux dictionnaires de littérature française qui accueillent désormais les francophones se considèrent-ils probablement bons princes en se « penchant » sur tel Vaudois, tel Antillais ou tel Algérien.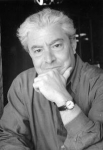
 Du point de vue de l’édition, de la répercussion médiatique et de la diffusion en librairie, les francophones (province française comprise) restent cependant les éternels oubliés du centralisme parisien, et tous les débats lénifiants n’y changeront rien. Le Tunisien vaudois Rafik Ben Salah, dont le talent vaut bien celui de moult auteurs reconnus à l’enseigne de Gallimard ou du Seuil, reste ignoré en France du seul fait qu’il publie à L’Age d’Homme. De la même façon, lorsque Anne-Lou Steininger publie chez Gallimard un premier livre, les médias la célèbrent à Paris, qui ignorent aujourd’hui son nouvel ouvrage paru chez Campiche, pourtant meilleur que le premier…
Du point de vue de l’édition, de la répercussion médiatique et de la diffusion en librairie, les francophones (province française comprise) restent cependant les éternels oubliés du centralisme parisien, et tous les débats lénifiants n’y changeront rien. Le Tunisien vaudois Rafik Ben Salah, dont le talent vaut bien celui de moult auteurs reconnus à l’enseigne de Gallimard ou du Seuil, reste ignoré en France du seul fait qu’il publie à L’Age d’Homme. De la même façon, lorsque Anne-Lou Steininger publie chez Gallimard un premier livre, les médias la célèbrent à Paris, qui ignorent aujourd’hui son nouvel ouvrage paru chez Campiche, pourtant meilleur que le premier…
Est-ce à dire que les francophones n’ont plus qu’à désespérer ? Si la gloire momentanée est leur seul objectif : nul doute. Mais les cultures francophones ont-elles forcément à se couler dans le moule français ? N’est-ce pas au contraire dans leur authenticité respective qu’elles vont produire des œuvres fortes, reconnues ou pas ? Un Georges Haldas, un Maurice Chappaz, un Jacques Mercanton, un Gaston Cherpillod, une Alice Rivaz ont-ils « perdu » quelque chose à ne pas quêter l’assentiment de Paris ?
Le grand écrivain mexicain Carlos Fuentes me disait un jour qu’en Europe, la France lui semblait aujourd’hui le pays le moins ouvert, le plus nombriliste,le plus provincial à certains égards. Et si rester soi-même constituait la meilleure parade au provincialisme parisien ? -
Le virtuel selon JLK: pas joli-joli...
À propos du Viol de l'ange,par Laurent NicoletDans Le Viol de l'Ange de Jean-Louis Kuffer, tout est possible: un romancier rabroué par s es personnages, un sériai killer qui tient son journal secret ou l'amour grandi par le sida. C'est toujours l'innocence qui trinque tandis que le futur, déjà présent, montre son vilain museau.«L'idée d'endosser d'autres peaux remplit le romancier d'une vague horreur, et pourtant c'est cela seul qui l'attire depuisquelque temps.» Dur métier en effet que celui d'écrire des romans, sauf qu'ici le romancier n'est qu'un personnage parmi d'autres et pas celui dont le nom s'étale sur la couverture, Jean-Louis Kuffer.N'empêche: c'est bien cet écrivain fictif, auteur d'un roman virtuel, qui conduit les personnages, pense dans la première partie à une réplique qu'il attribuera à tel ou tel dans la troisième. il arrive pourtant qu'une marionnette se révolte, telle Marjo, une Parisienne traquant l'âme soeur sur minitel, en précisant qu'elle doit, cette âme, dépasser le mètre quatre-vingts et faire preuve d'un sens avéré du romantisme.Allez donc vous mettre dans la peau de ça! Il essaie quand même, le romancier, «alors il pense: être petite, un peu trop de culotte de cheval, les ongles fissurés par les nerfs, plus très jolie because des ans l'outrage mais du charme encore pas mal, et ce terrible besoin d'un bras mâle la soutenant, le désir romantique et l'autre aussi de la pointe virile fichée en elle comme un tenon de solide charpente, et la voici qui se rebiffe en pensée, non mais des fois, moi gynéco, moi larguée, moi communiste déçue, moi faite toute menue et c'est à me bagarrer que j'en suis tous les jours, et dans le mouvement Marjo se met à renauder contre le sort que lui fait le romancier: et de quoi que je me mêle, l'écrivassier, quoi que tu veux piger à mes hormones, quoi que tu entraves à ma vie camouflée et d'abord en quoi ça te regarde crénom de voyeur?»Fichu métier, on vous dit. Qu'importe, le romancier ne renâcle pas: dans son chalet qui surplombe un décor lacustre, ce 12 juillet 1995, en fin d'après-midi, il médite devant sa table en merisier, imagine le plan de la cité virtuelle où le roman virtuel - sauf quelques anicroches parisiennes - est censé se dérouler.Et en effet, le même jour au matin - celui de la chute de Srebrenica -, le roman commence, dans la Cité des Hespérides, sous l'oeil d'un voyeur cul-de-jatte nommé Jobin, ficheur de locataires et accro du Mac: un couple, les Kepler, sainement sportif, s'apprête à débouler en 4X4 vers la Grande Bleue pour des vacances naturellement actives. On verra qu'en route la femme - Muriel - avouera sa séropositivité. Et l'homme alors - Jo - pour toute réponse, inaugure sur-le-champ une toute nouvelle façon de copuler: aimer à mort, «à présent c'est vraiment de la folie pure, bien plus que fourrer, que tringler, que tirer et que tous les mots bêtes.»Ce jour-là, dans le quartier des Hespérides, comme chaque jour,les événements cascadent et grouillent, bien que virtuels, sur lapage blanche et réelle, dont le moindre n'est sans doute pas,puisqu'il donne son titre au livre, la disparition d'un garçonnetblond de 12 ans.Disparition? Meurtre évidemment, d'ailleurs il y en a eu d'autres, un sériai killer rôde, gourmand de blondeur et d'angélisme. On aura même droit régulièrement à des extraits plutôt gratinés de son journal secret, tout en enflure religieuse et prophétique - «or rien n'est comparable, de l'enfllement vulgaire des tripoteurs d'immatures, et de la pénétration de l'Elu»...Au fil des mois - nous voici le 12 juillet 1996 - et avant que le cadavre de l'ange ne soit retrouvé dans un glacier - on saura du monstre qu'il ressemble à Eichmann à Jérusalem, qu'il arborele profil d'un fonctionnaire modèle et que probablement, autrefois, sa mère lui faisait renifler ses pollutions nocturnes en le sommant de demander pardon à Jésus.D'autres personnages encore, nombreux, trop nombreux regrettele romancier pour pouvoir à tous leur donner juste place, s'agitent dans le quartier virtuel: un palefrenier serbo-croate déchiré entre fidélité paternelle et nationale, une veuve au grand coeur, un journaliste quinquagénaire au sourire flottant - tiens donc - alcoolique bien sûr (une sacrée constante dans la prose kufférienne, le folliculaire poivrotant) et qui traquera le tueur jusqu'aux Amériques; un infirmier proche de la sainteté, un homo sidéen et son chien, un corbeau travaillant sur Olivetti, un libraire à l'ancienne et sa femme, permanent miracle de douceur - bref un couple exemplaire; une loque américaine, un gourou mielleux, un fils de concierge portugais bientôt philosophe et tant d'autres. Il y a même, tombé du ciel ou d'allez savoir quelle machine appliquée, un hypertexte qui déchiffre par exemple l'avenir, lorsqu'il sera possible, avec casque, console et palpeurs, sans rien écorner du réel, de satisfaire tout ce qui peut l'être: «Et t'imagines la thérapie pour les tarés genre serial killer? Les mecs ils ont tout à disposition: ils peuvent se défouler tant qu'ils veulent. Tous les complexes que ça explose et les fantasmes pas possibles! Imagine le pire dégueulasse! Il voudrait bouffer des foetus de mômes? Il n'a qu'à louer le programme!»Tout cela on le voit, réel ou virtuel, n'est pas joli-joli, mais c'estdéjà un peu, beaucoup le petit monde d'aujourd'hui, un universde créatures mécaniques faisant face sans arme à la maladie, à la violence qui découpe les anges, à l'amour qui n'est jamais que ce qu'il devrait être, au cynisme facile, aux singeries du jeu social, à ce goût tenace de la vie qui se confond avec celui de la mort.Bref, ce «Viol de l'Ange» tourne au bouillonnement furieux etcontemporain, un livre solidaire qui prend le lecteur par la gueuled'un bout à l'autre, et dont on regrettera juste certaines envoléeshâtives, comme lorsque l'auteur trébuche dans le tapis trop nouédes conjonctions et des relatives («... que le liquide brunâtre qui fumait dans le verre que le physicien tenait de la main gauche, tandis qu'il se massait le paquet génital de la droite...»).Qu'importe, un bel avenir se profile pour le romanvirtuel, à mesure que l'innocence crédule du lecteur et la puissance démiurgique de l'écrivain s'amenuisent de concert, chaque jour un peu plus..Jean.Louis Kuffer, Le viol de l'ange. Bernard Campiche éditeur, 1997.(Ce texte de Laurent Nicolet a paru dans Le Nouveau Quotidien en date du 13 novembre 1997). -
Concerto
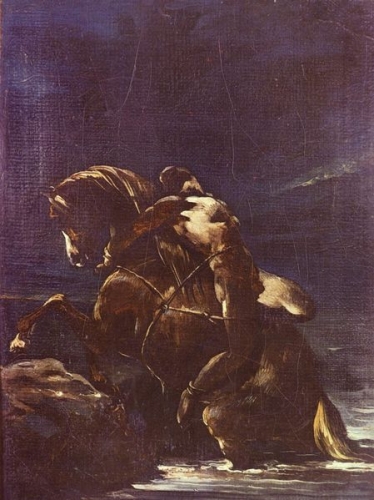 Il n’est plus là même pour moi,quand il est au piano,et j’ai beau me faire oublier:cela même est de tropcomme si l’ombre d’un chevalpiétinait l’idée seuleque je puisse ne pas écouterle divin concerto…L’univers est tout harmonie,tout armes et mélodies,tout vacarme et polyphonies,mais je suis d’avant la musique:je chantais innocente,et parlais doucement aux oragesavant tous vos tapages .À l’usine ils m’auront donnéle nom de Mélusine…Moi je suis plutôt opéra:j’ouvre les bras au monde,j’aime à l’unisson des divasmoi je ne suis que mélodiesde musique légère,moi les fanfares militairesmoi les tendres Lieder -et l’ombre immense danseau piano des années…Peinture: Théodore Géricault, Mazeppa.
Il n’est plus là même pour moi,quand il est au piano,et j’ai beau me faire oublier:cela même est de tropcomme si l’ombre d’un chevalpiétinait l’idée seuleque je puisse ne pas écouterle divin concerto…L’univers est tout harmonie,tout armes et mélodies,tout vacarme et polyphonies,mais je suis d’avant la musique:je chantais innocente,et parlais doucement aux oragesavant tous vos tapages .À l’usine ils m’auront donnéle nom de Mélusine…Moi je suis plutôt opéra:j’ouvre les bras au monde,j’aime à l’unisson des divasmoi je ne suis que mélodiesde musique légère,moi les fanfares militairesmoi les tendres Lieder -et l’ombre immense danseau piano des années…Peinture: Théodore Géricault, Mazeppa. -
Ni les mots pour le dire
 Nous ne savons pas le savoir,ni ne désespérons,nous ne sommes que visiteurs,amateurs de chansonset voyant au gré des couleursce qui du ciel demeure…Nous demeurons les yeux ouverts:comme aux oiseaux passantnous ne savons que demander,nous sommes envoyésd’on ne sait où ni quel poèmesaurait jamais le dire…Vous nous écouterez le soirquand le jour aux ailleursflamboie dans l’ultime lenteurqui va se fondre dans le noiroù l’ange en vous demeure -et le dire ne se dira pas...Paul Klee, Angelus Novus.
Nous ne savons pas le savoir,ni ne désespérons,nous ne sommes que visiteurs,amateurs de chansonset voyant au gré des couleursce qui du ciel demeure…Nous demeurons les yeux ouverts:comme aux oiseaux passantnous ne savons que demander,nous sommes envoyésd’on ne sait où ni quel poèmesaurait jamais le dire…Vous nous écouterez le soirquand le jour aux ailleursflamboie dans l’ultime lenteurqui va se fondre dans le noiroù l’ange en vous demeure -et le dire ne se dira pas...Paul Klee, Angelus Novus. -
Si tu étais là...
(Autres bribes du désarroi)Le silence advenu,juste le souffle de la nuit,et peut-être là-basla rumeur d’une rueou celle de la proche forêt...Ou là-haut, au rebordde notre balcon sur les eaux,l’autre silence du Haut Lac;et dormir et partir -demain nous ferions notre sac...Au-delà du sommeilnous attend un autre voyage;attends-moi donc que je m'éveilleet reprenne courage...La nuit ne peut se taire ainsi:dans l’ombre je t’entends,j’entends la rumeur de la vie -dis-moi que tu m’attends...Je t’entends t’inquiéter, déjà,du temps qui se réveille;je t’entends respirerau tréfonds de ton grand sommeil -dis-moi que tu m'entends...(Peinture: Thierry Vernet) -
Ce mot qui ne se dira pas
 On ne devrait le prononcerque les yeux fermés,sans penser à ce qu’il veut direni vouloir de chair...Ce mot à jamais impossiblene sait se dévoilerpas plus que l’enfant ne sauraitdénommer l’indicible...Lorsque la musique a surgidans ta vie de mendiant,tu t’es agenouillésans savoir rien ni rien vouloir...Le nom de Dieu n’y est pour rien:rien de ce qui se nommene rend vraiment la sommede cela qui sans lieurayonnne absolument...La tête ainsi vous tournera:vous en deviendrez foucomme devant l’enfant donnépar la vie à la vie...Aussi ne le prononcez pas:ne faites que le vivrecomme le rêve d’un enfant ivrede n’être rien que là...
On ne devrait le prononcerque les yeux fermés,sans penser à ce qu’il veut direni vouloir de chair...Ce mot à jamais impossiblene sait se dévoilerpas plus que l’enfant ne sauraitdénommer l’indicible...Lorsque la musique a surgidans ta vie de mendiant,tu t’es agenouillésans savoir rien ni rien vouloir...Le nom de Dieu n’y est pour rien:rien de ce qui se nommene rend vraiment la sommede cela qui sans lieurayonnne absolument...La tête ainsi vous tournera:vous en deviendrez foucomme devant l’enfant donnépar la vie à la vie...Aussi ne le prononcez pas:ne faites que le vivrecomme le rêve d’un enfant ivrede n’être rien que là... -
Woke or not
 À propos de Paul B. Preciado, de Jean-François Braunstein et de notre regretté Snoopy...(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2023)LE CHIEN. - Je me réveille ce matin avec une tête de chien sur mon oreiller, et peu après, dans le livre reposant à côté du chien endormi, je lis le récit d’un type qui parle du matelas de sa chienne Justine avec laquelle il a vécu pendant onze ans, comme d’une sorte d’objet affectif transitionnel : «Ce matelas - les souvenirs qu’il contient - est désormais mon seul véritable amant »...Ce type qui écrit vient de rentrer dans son nouvel appartement parisien où s’entassent des centaines de cartons contenant les milliers de livres qu’il a fait venir des divers points de chute de ses vies antérieures, Athènes et Barcelone, New York ou Kassel ; hier soir je lisais les pages du même livre évoquant la découverte à la télévision, par la petite fille qu’était alors l’auteur à onze ans, à Burgos, dans la cuisine familiale où elle se trouvait avec ses parents, du mot homosexuel prononcé à la télé à propos d’une nouvelle maladie frappant une catégorie de personnes violemment identifiées par le père comme des dégénérés, ce souvenir d’enfance amorçant un chapitre consacré à l’émergence, en 1981, d’un nouvel ordre somatopolitique mondial identifié sous le nom de sida : « La description de la maladie à la télévision avait été une séance de destruction de mon enfance. Là, à cet instant précis, en écoutant ce reportage , tout en mangeant ma soupe , je suis devenu adulte »...
À propos de Paul B. Preciado, de Jean-François Braunstein et de notre regretté Snoopy...(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2023)LE CHIEN. - Je me réveille ce matin avec une tête de chien sur mon oreiller, et peu après, dans le livre reposant à côté du chien endormi, je lis le récit d’un type qui parle du matelas de sa chienne Justine avec laquelle il a vécu pendant onze ans, comme d’une sorte d’objet affectif transitionnel : «Ce matelas - les souvenirs qu’il contient - est désormais mon seul véritable amant »...Ce type qui écrit vient de rentrer dans son nouvel appartement parisien où s’entassent des centaines de cartons contenant les milliers de livres qu’il a fait venir des divers points de chute de ses vies antérieures, Athènes et Barcelone, New York ou Kassel ; hier soir je lisais les pages du même livre évoquant la découverte à la télévision, par la petite fille qu’était alors l’auteur à onze ans, à Burgos, dans la cuisine familiale où elle se trouvait avec ses parents, du mot homosexuel prononcé à la télé à propos d’une nouvelle maladie frappant une catégorie de personnes violemment identifiées par le père comme des dégénérés, ce souvenir d’enfance amorçant un chapitre consacré à l’émergence, en 1981, d’un nouvel ordre somatopolitique mondial identifié sous le nom de sida : « La description de la maladie à la télévision avait été une séance de destruction de mon enfance. Là, à cet instant précis, en écoutant ce reportage , tout en mangeant ma soupe , je suis devenu adulte »... Le type qui écrit à gardé en partie son corps de fille, et parlant du rapport qu’il entretient avec ses livres il se qualifie de lecteurice, terme dont je m’interdis absolument de faire usage tant cette greffe me semble non seulement artificielle mais esthétiquement laide, comme il en irait d’un.e fillarçon, etc.Or je me suis pourtant senti, hier soir , très proche de ce monstre à tête de chien en lisant ses pages consacrées aux rapports intimes ou extimes que nous entretenons avec nos bibliothèques et aux relations qu’entretiennent entre elles les bibliothèques de celles ou ceux (Preciado écrirait celleux) que nous aimons, avec qui nous couchons ou nous rompons - toute une rêverie personnelle me venant alors à la lecture de ces pages existentiellement intenses où les noms de Gomez de La Serna ou de Vila-Matas m’auront rappelé tant de moments magiques; et voici que ce matin ce même auteur-auteure-autorelle-autriceur se rappelle les poèmes de Cernuda qu’il lisait dans son lit d’enfant, juste avant de revenir au présent, dans son nouvel appartement parisien, en 2020, où , nu dans son lit, l’ordinateur sur ses genoux, il regarde le documentaire de Rithy Panh intitulé L’image manquante et décrivant l’atroce répression exercée par les khmers rouges sur le peuple cambodgien - et je me dis ce matin que je pourrais contresigner ces mots, si j’excepte la testostérone et y rajouterais plutôt l’Ukraine: « Je me sens impuissant, terrifié par la conscience d’appartenir à cette histoire, à l’histoire humaine de l’horreur qui se répète encore et encore. Je pleure presque sans interruption bien que je me sois fait une injection de testostérone il y a deux jours - je crois que la testostérone me rend plus résistant à la douleur morale ou psychologique »...
Le type qui écrit à gardé en partie son corps de fille, et parlant du rapport qu’il entretient avec ses livres il se qualifie de lecteurice, terme dont je m’interdis absolument de faire usage tant cette greffe me semble non seulement artificielle mais esthétiquement laide, comme il en irait d’un.e fillarçon, etc.Or je me suis pourtant senti, hier soir , très proche de ce monstre à tête de chien en lisant ses pages consacrées aux rapports intimes ou extimes que nous entretenons avec nos bibliothèques et aux relations qu’entretiennent entre elles les bibliothèques de celles ou ceux (Preciado écrirait celleux) que nous aimons, avec qui nous couchons ou nous rompons - toute une rêverie personnelle me venant alors à la lecture de ces pages existentiellement intenses où les noms de Gomez de La Serna ou de Vila-Matas m’auront rappelé tant de moments magiques; et voici que ce matin ce même auteur-auteure-autorelle-autriceur se rappelle les poèmes de Cernuda qu’il lisait dans son lit d’enfant, juste avant de revenir au présent, dans son nouvel appartement parisien, en 2020, où , nu dans son lit, l’ordinateur sur ses genoux, il regarde le documentaire de Rithy Panh intitulé L’image manquante et décrivant l’atroce répression exercée par les khmers rouges sur le peuple cambodgien - et je me dis ce matin que je pourrais contresigner ces mots, si j’excepte la testostérone et y rajouterais plutôt l’Ukraine: « Je me sens impuissant, terrifié par la conscience d’appartenir à cette histoire, à l’histoire humaine de l’horreur qui se répète encore et encore. Je pleure presque sans interruption bien que je me sois fait une injection de testostérone il y a deux jours - je crois que la testostérone me rend plus résistant à la douleur morale ou psychologique »... Relevant les yeux de ma lecture sur le portrait de Lady L. par le serbe Pierre Omcikous, je me rappelle mon escale à Korcula, ville dalmate natale de notre ami, en pleine guerre balkanique, et tant d’autres horreurs, et tant de larmes amères, et notre amour là-dedans, nos livres et nos enfants - le chien soupire (À la Maison bleue, ce 6 janvier 2023, en lisant Dysphoria de Paul B. Preciado)TRANSITS ET AUTRES TRANSES.- En reprenant ce matin la lecture des admirables Portraits de femmes de Pietro Citati, je me dis qu’en bonne logique woke je devrais rejeter ce livre au motif qu’un mâle blanc ne saurait écrire sur des femmes, pas plus que cet escroc de Flaubert n’est en droit de prétendre qu’Emma Bovary et lui c'est tout un, non mais !Il y a bien vingt ans de ça que l’éditeur Christian Bourgois me disait que, désormais, certains de ses confrères américains refusaient de publier des romans d’auteurs blancs contenant des personnages noirs, mais on n’en était pas encore aux généralisations du wokistan qui voit partout l’abus du pouvoir patriarcal blanc et le règne coercitif de ce que Paul B. Preciado, auteur trans faisant désormais référence au Wokistan, appelle le capitalisme pétro-sexo-racial.Je lis justement ces jours Dysphoria mundi de Preciado, en même temps que je lis les portraits de sainte Thérèse ou de Katherine Mansfield, de Flannery O'Connor ou de Virginia Woolf qui m’intéresseraient tout autant s’ils étaient le fait d’une Pietra au lieu de l’être d’un Pietro Citati dont je lis aussi Le mal absolu qui traverse le XIXe littéraire avec une intelligence sensible toute féminine (!) même si la nature et la biologie viriliste exigent que ce très grand sourcier du génie littéraire bisexuel se rase tous les matins contrairement à la Bienheureuse d’Avila qui se contentait de joindre ses fines mains pour complaire au Seigneur.Béatriz Preciado qui, dans un rêve, à reçu l’ordre de semer sa bonne parole sous le prénom de Paul, moyennant une injection de testostérone tous les douze jours (tout ira par douze dans la nouvelle religion comme dans les anciennes) a vu dans l’incendie de Notre-Dame de Paris un Signe, et c’est pour lui faire écho qu’elle/il invoque, en plurielle multitude, les 1200 avatars de Notre-Dame, à commencer par Notre-Dame des Riches, Notre-Dame du Viol, Notre-Dame du Fascisme - toi qui veilles sur notre sécurité, etc.
Relevant les yeux de ma lecture sur le portrait de Lady L. par le serbe Pierre Omcikous, je me rappelle mon escale à Korcula, ville dalmate natale de notre ami, en pleine guerre balkanique, et tant d’autres horreurs, et tant de larmes amères, et notre amour là-dedans, nos livres et nos enfants - le chien soupire (À la Maison bleue, ce 6 janvier 2023, en lisant Dysphoria de Paul B. Preciado)TRANSITS ET AUTRES TRANSES.- En reprenant ce matin la lecture des admirables Portraits de femmes de Pietro Citati, je me dis qu’en bonne logique woke je devrais rejeter ce livre au motif qu’un mâle blanc ne saurait écrire sur des femmes, pas plus que cet escroc de Flaubert n’est en droit de prétendre qu’Emma Bovary et lui c'est tout un, non mais !Il y a bien vingt ans de ça que l’éditeur Christian Bourgois me disait que, désormais, certains de ses confrères américains refusaient de publier des romans d’auteurs blancs contenant des personnages noirs, mais on n’en était pas encore aux généralisations du wokistan qui voit partout l’abus du pouvoir patriarcal blanc et le règne coercitif de ce que Paul B. Preciado, auteur trans faisant désormais référence au Wokistan, appelle le capitalisme pétro-sexo-racial.Je lis justement ces jours Dysphoria mundi de Preciado, en même temps que je lis les portraits de sainte Thérèse ou de Katherine Mansfield, de Flannery O'Connor ou de Virginia Woolf qui m’intéresseraient tout autant s’ils étaient le fait d’une Pietra au lieu de l’être d’un Pietro Citati dont je lis aussi Le mal absolu qui traverse le XIXe littéraire avec une intelligence sensible toute féminine (!) même si la nature et la biologie viriliste exigent que ce très grand sourcier du génie littéraire bisexuel se rase tous les matins contrairement à la Bienheureuse d’Avila qui se contentait de joindre ses fines mains pour complaire au Seigneur.Béatriz Preciado qui, dans un rêve, à reçu l’ordre de semer sa bonne parole sous le prénom de Paul, moyennant une injection de testostérone tous les douze jours (tout ira par douze dans la nouvelle religion comme dans les anciennes) a vu dans l’incendie de Notre-Dame de Paris un Signe, et c’est pour lui faire écho qu’elle/il invoque, en plurielle multitude, les 1200 avatars de Notre-Dame, à commencer par Notre-Dame des Riches, Notre-Dame du Viol, Notre-Dame du Fascisme - toi qui veilles sur notre sécurité, etc. Jean François Braunstein, que j’ai eu le bonheur un soir de rencontrer à la table de Roland Jaccard, avant qu’il ne m’envoie dédicacée sa Philosophie devenue folle, a-t-il raison de parler du transgenre comme d’un héros de notre temps, dans La religion woke ? Je n’en suis pas sûr sauf à parler une fois de plus d’un antihéros, comme dans la littérature pré-wokiste du XXe siècle fertile en révolutions catastrophiques - jusqu'à celle, combien meurtrière et dorlotée par l'intelligentsia occidentale, des gardes rouges auxquels les gardiennes et gardiens du temple wokiste font parfois penser...
Jean François Braunstein, que j’ai eu le bonheur un soir de rencontrer à la table de Roland Jaccard, avant qu’il ne m’envoie dédicacée sa Philosophie devenue folle, a-t-il raison de parler du transgenre comme d’un héros de notre temps, dans La religion woke ? Je n’en suis pas sûr sauf à parler une fois de plus d’un antihéros, comme dans la littérature pré-wokiste du XXe siècle fertile en révolutions catastrophiques - jusqu'à celle, combien meurtrière et dorlotée par l'intelligentsia occidentale, des gardes rouges auxquels les gardiennes et gardiens du temple wokiste font parfois penser... -
Du côté de la vie
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce jeudi 19 septembre.– Il est 8h du matin par grand ciel bleu, je me suis réveillé, déjà, à 5h du matin, et c’est à ce moment que j’ai eu l’idée d’appeler ce moment le Moment de l’Être, un moment-charnière, un moment qui fait le lien entre le subconscient et la conscience, un moment où le langage venu d’ailleurs afflue, un moment où l’on dirait que l’être même devient langage, un moment qui est en somme le pur moment de la poésie.C’est en effet dans cet état, qu’on pourrait dire, après Haldas et Baudelaire l’état de poésie, le moment de l’involontaire inspiration, le moment de l’émergence du langage, ce moment que je cherche aussi et trouve dans la littérature, dans la poésie, comme la cristallisation de l’être, de la beauté et de la radieuse effusion à mélodies...L’être est, à ce moment-là, « parole de la parole ». J’emprunte cette formule, qui semble tautologique, aux commentaires de la Commedia de Dante, dans les entretiens intitulés La Divine comédie non sans outrecuidance, signés du seul nom de Philippe Sollers alors que Benoît Chantre, son interlocuteur, y est d’une intense présence et parfois contradictoire à bon escient - formule qui semble apparemment du verbiage et qui correspond pourtant à une expérience vécue de la conscience et de la parole, renvoyant ici doctement, par Heidegger et ses bretelles à la tyrolienne, à Parménide et Héraclite.C’était donc ce matin à 5h, à fleur de sommeil, mais je le vis tous les jours, tous les jours je retrouve ce moment, et désormais, je vais concentrer la suite de mes carnets, mes carnets de 2021 en décembre, après la mort de Lady L., et mes carnets d’aujourd’hui, en septembre 2024, en alternance soumise à la même quête simple et limpide, du moment poétique. Ce sera ces prochaines semaines, ces prochains mois, si je survis à ces prochains jours, le fil rouge de mon travail…Je pense à Lambert Schechter mon ami, qui se soumet au même genre de discipline quotidienne, je pense à mon amie la Professorella, dont le récit de vie ne laisse de m’inciter à ne pas me payer de mots, je pense à ceux qui me lisent tous les jours - ce que j’écris recoupant de plus en plus précisément ce que je vis - telles étant aussi bien mes Lectures du monde, et maintenant, je vais me faire du café…À La Désirade, ce vendredi 20 septembre. – C’est demain, il y a trois ans de ça, que l’ami Roland boit la ciguë, ou plus exactement son fameux sirop mexicain, ma bonne amie m’avait appris la nouvelle qu’elle tenait d’un gratuit, j’en avais été impressionné plus que triste - respect Roland, enfin tu t’es montré conséquent – et trois mois après c’était elle, sans avoir jamais flirté avec l’idée de suicide alors que « la vie » se montrait avec elle d’une effroyable cruauté, qui nous quittait en douceur et sans trop de douleurs, tout cela me revenant par l’insomnie de cette nuit de 2 à 3 heures du matin, où j’ai passé de la plus sombre déprime à une sorte de retour de gaîté faisant écho à l' habituel « c pas grave », de Lady L. quand tout était tellement désespérant que la conclusion à la Pollyanna, personnage dont la psychologie l’avait toujours hérissée, devenait son leitmotiv gravement comique – hein quoi, la tuile nous arrive dessus, mais tant que ce n’est pas le toit entier qui menace, c pas grave, hein quoi ?À Roland j'avais « dealé » plusieurs fois du Stilnox, plus accessible en Suisse qu’à Paris, mais je n’ai jamais subi moi-même la hantise froide de l’insomnie, sauf parfois sous l’effet de la lune – comme cette nuit précisément -, et cette fois c’est presque avec curiosité, comme sous l’effet de je ne sais quelle drogue genre mescaline chez un Henri Michaux, que j’ai observé mon transit mental entre désespoir à métastases personnelles (ma nullité de vieille peau ) et mondiales (la société massifiée et vile, partout l’effondrement et la médiocrité réseautée, l’épouvantable Poutine à gueule de vampire et l’abominable patriarche de Moscou concentrant sous sa mitre d’inquisiteur tous les vices de l’hypocrisie cléricale, sans parler de l’ignoble Donald aux troupes imbéciles), et soudain, comme j’ai toujours opposé mon bon naturel au nihilisme de Roland trop gavé de Schopenhauer et autres, le « c pas grave » de ma bonne amie m'est revenu comme un lutin ludique en me faisant valoir l’insupérable beauté candide de notre petite dernière, et l’allègre rebond de nos lascars de cinq et sept ans crépitant de vie bonne entre moutons de laine et sauterelles, enfin basta là-dedans, foin de plaintes loin de Gaza, assez de lamentations et reprenons un peu de cette excellente tarte aux pruneaux de notre querida Hermana Grande… No, la desesperación no pasará, seguimos, con nuestros queridos difuntos, más vivos en muchos sentidos que tantos sonámbulos y otros zombies, del lado de la vida...
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce jeudi 19 septembre.– Il est 8h du matin par grand ciel bleu, je me suis réveillé, déjà, à 5h du matin, et c’est à ce moment que j’ai eu l’idée d’appeler ce moment le Moment de l’Être, un moment-charnière, un moment qui fait le lien entre le subconscient et la conscience, un moment où le langage venu d’ailleurs afflue, un moment où l’on dirait que l’être même devient langage, un moment qui est en somme le pur moment de la poésie.C’est en effet dans cet état, qu’on pourrait dire, après Haldas et Baudelaire l’état de poésie, le moment de l’involontaire inspiration, le moment de l’émergence du langage, ce moment que je cherche aussi et trouve dans la littérature, dans la poésie, comme la cristallisation de l’être, de la beauté et de la radieuse effusion à mélodies...L’être est, à ce moment-là, « parole de la parole ». J’emprunte cette formule, qui semble tautologique, aux commentaires de la Commedia de Dante, dans les entretiens intitulés La Divine comédie non sans outrecuidance, signés du seul nom de Philippe Sollers alors que Benoît Chantre, son interlocuteur, y est d’une intense présence et parfois contradictoire à bon escient - formule qui semble apparemment du verbiage et qui correspond pourtant à une expérience vécue de la conscience et de la parole, renvoyant ici doctement, par Heidegger et ses bretelles à la tyrolienne, à Parménide et Héraclite.C’était donc ce matin à 5h, à fleur de sommeil, mais je le vis tous les jours, tous les jours je retrouve ce moment, et désormais, je vais concentrer la suite de mes carnets, mes carnets de 2021 en décembre, après la mort de Lady L., et mes carnets d’aujourd’hui, en septembre 2024, en alternance soumise à la même quête simple et limpide, du moment poétique. Ce sera ces prochaines semaines, ces prochains mois, si je survis à ces prochains jours, le fil rouge de mon travail…Je pense à Lambert Schechter mon ami, qui se soumet au même genre de discipline quotidienne, je pense à mon amie la Professorella, dont le récit de vie ne laisse de m’inciter à ne pas me payer de mots, je pense à ceux qui me lisent tous les jours - ce que j’écris recoupant de plus en plus précisément ce que je vis - telles étant aussi bien mes Lectures du monde, et maintenant, je vais me faire du café…À La Désirade, ce vendredi 20 septembre. – C’est demain, il y a trois ans de ça, que l’ami Roland boit la ciguë, ou plus exactement son fameux sirop mexicain, ma bonne amie m’avait appris la nouvelle qu’elle tenait d’un gratuit, j’en avais été impressionné plus que triste - respect Roland, enfin tu t’es montré conséquent – et trois mois après c’était elle, sans avoir jamais flirté avec l’idée de suicide alors que « la vie » se montrait avec elle d’une effroyable cruauté, qui nous quittait en douceur et sans trop de douleurs, tout cela me revenant par l’insomnie de cette nuit de 2 à 3 heures du matin, où j’ai passé de la plus sombre déprime à une sorte de retour de gaîté faisant écho à l' habituel « c pas grave », de Lady L. quand tout était tellement désespérant que la conclusion à la Pollyanna, personnage dont la psychologie l’avait toujours hérissée, devenait son leitmotiv gravement comique – hein quoi, la tuile nous arrive dessus, mais tant que ce n’est pas le toit entier qui menace, c pas grave, hein quoi ?À Roland j'avais « dealé » plusieurs fois du Stilnox, plus accessible en Suisse qu’à Paris, mais je n’ai jamais subi moi-même la hantise froide de l’insomnie, sauf parfois sous l’effet de la lune – comme cette nuit précisément -, et cette fois c’est presque avec curiosité, comme sous l’effet de je ne sais quelle drogue genre mescaline chez un Henri Michaux, que j’ai observé mon transit mental entre désespoir à métastases personnelles (ma nullité de vieille peau ) et mondiales (la société massifiée et vile, partout l’effondrement et la médiocrité réseautée, l’épouvantable Poutine à gueule de vampire et l’abominable patriarche de Moscou concentrant sous sa mitre d’inquisiteur tous les vices de l’hypocrisie cléricale, sans parler de l’ignoble Donald aux troupes imbéciles), et soudain, comme j’ai toujours opposé mon bon naturel au nihilisme de Roland trop gavé de Schopenhauer et autres, le « c pas grave » de ma bonne amie m'est revenu comme un lutin ludique en me faisant valoir l’insupérable beauté candide de notre petite dernière, et l’allègre rebond de nos lascars de cinq et sept ans crépitant de vie bonne entre moutons de laine et sauterelles, enfin basta là-dedans, foin de plaintes loin de Gaza, assez de lamentations et reprenons un peu de cette excellente tarte aux pruneaux de notre querida Hermana Grande… No, la desesperación no pasará, seguimos, con nuestros queridos difuntos, más vivos en muchos sentidos que tantos sonámbulos y otros zombies, del lado de la vida... -
Tendres objets
 (Le Temps accordé. Lectures du monde, 2021)À la Maison bleue, ce 16 décembre 2021. - Le plus ancien souvenir qui me revienne, à propos des objets restant là après la mort de quelqu’un, date de l’école primaire, dans la classe de Mademoiselle Chammartin, qui nous apprit un matin que notre camarade Toupie ne reviendrait pas, et je me souviens qu’à cet instant les objets qui se trouvaient sur son pupitre me sont apparus avec une sorte de présence accrue, et j’ai pensé que c’était triste et que c’est ça que me disaient les objets de Toupie, bien rangés comme il les avait laissés, toujours très ordré, avec ce quelque chose d’un peu terne qu’il avait lui aussi, de modestes objets peu voyants, un plumier gris et une gomme, des crayons bien taillés et un taille-crayons qui maintenant avaient un air abandonné ; jamais je n’avais ressenti cela, ce qu’on nous avait dit de la maladie de Toupie, comme quoi son sang avait trop de globules blancs, ne m’avait pas vraiment touché, tellement notre camarade était pâle, mais à présent c’était autre chose, et beaucoup plus réel à mes yeux au point que je m’en souviens tant d‘années après - et ce matin je regarde ses objets à elle et constate que les objets d’une femme sont différents des objets d’un enfant, etc.LES GESTES ADÉQUATS. – Il y en a qui savent y faire, y ayant été formés, et les autres. Ceux qui ont tout de suite le geste approprié, et pour chaque situation. Pompiers et médecins urgentistes, ou mieux : ambulanciers. Formels sanitaires ou d’exercices militaires de base : c’est à peu près tout un. Mais la plupart, citadins d’aujourdh’hui, sont désemparés. N’ont pas appris. Ne s’y attendaient pas, et le blessé grave , lui n’attendra pas non plus. Et le défunt reste là, qu’on ne peut pas laisser comme ça sans rien faire. Mais faire quoi et comment ? Avec notre père, déjà, ce soir-là, après tout un dimanche à nous faire à l’idée que ce serait le dernier, après son dernier râle, nous nous étions regardés, les frères et la mère, avant de nous y mettre, et c’est venu comme ça, « sur le tas », comme si nous retrouvions les gestes des pères de nos pères et des tribus qui continuent, aujourd’hui encore, à savoir y faire…FAIRE-PART. – Cela sortira demain dans le journal où, plus de vingt ans durant, j’ai délivré leur billet de sortie à maints écrivains, non sans y annoncer la mort de nos père et mère, et je m’y désigne comme «son bon ami », ainsi qu’elle m’appelait depuis toujours dans le langage des jeunes gens de ce pays non encore fiancés et moins encore mariés – jamais d’ailleurs je n’ai parlé d’elle comme de «ma femme», comme d’autres parlent de « mon chirurgien » ou de « ma Ferrari », ni non plus de « mon épouse » à la manière bourgeoise, et puis, sans être resté trop attaché à Paul Eluard comme je l’étais à seize ans, partageant le goût marqué des femmes seules, j’ai trouvé bien trouvée la citation du poète que m’a proposée notre fille aînée : « Je cherche par delà l’attente / par delà moi-même / Et je ne sais plus tant je t’aime / Lequel de nous deux est absent »… (Ce 16 décembre)MISS YOU. – Elle me manque déjà, mais elle est déjà partout, je sais qu’elle n’est pas là où elle est, que ce corps allongé et ce visage fermé ne sont plus vraiment celle qu’elle est déjà et sera, je ne vais pas m’attarder à les regarder même si je sais qu’ils sont tout ce qui me reste d’elle, mais j’étais plus proche d’elle quand elle dormait qu’en les regardant à présent, elle me disait il y a quelque temps qu’elle avait l’impression que son corps se glissait hors d’elle après lui avoir été parfois une torture, mais son visage restait le même jusqu’à l’autre soir, après qu’elle est entrée dans le noir, nous ayant signifié qu’elle n’aspirait plus qu’à dormir mais que nous pouvions laisser la lumière, son visage alors s’est comme tourné et comme éteint, et maintenant son visage ne reflète plus rien, son visage ne ressemble plus du tout à elle, jamais je ne lui ai vu ce visage sans lumière alors que sa lumière irradie déjà d’une façon qui n’est qu’à elle.COMPASSION. – Les gens sont souvent mal pris à ces moments-là, mais tu compatis. Ils te disent « courage », ou pire : « on continue », comme ils lui souhaitaient de « remonter la pente » alors qu’ils savaient que nous n’avions plus le moindre espoir de guérison, ils te disaient « ne te laisse pas abattre », d’un ton qui laissait entendre que te voir te laisser abattre leur serait pénible, mais au lieu de leur en vouloir tu avais compati…
(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2021)À la Maison bleue, ce 16 décembre 2021. - Le plus ancien souvenir qui me revienne, à propos des objets restant là après la mort de quelqu’un, date de l’école primaire, dans la classe de Mademoiselle Chammartin, qui nous apprit un matin que notre camarade Toupie ne reviendrait pas, et je me souviens qu’à cet instant les objets qui se trouvaient sur son pupitre me sont apparus avec une sorte de présence accrue, et j’ai pensé que c’était triste et que c’est ça que me disaient les objets de Toupie, bien rangés comme il les avait laissés, toujours très ordré, avec ce quelque chose d’un peu terne qu’il avait lui aussi, de modestes objets peu voyants, un plumier gris et une gomme, des crayons bien taillés et un taille-crayons qui maintenant avaient un air abandonné ; jamais je n’avais ressenti cela, ce qu’on nous avait dit de la maladie de Toupie, comme quoi son sang avait trop de globules blancs, ne m’avait pas vraiment touché, tellement notre camarade était pâle, mais à présent c’était autre chose, et beaucoup plus réel à mes yeux au point que je m’en souviens tant d‘années après - et ce matin je regarde ses objets à elle et constate que les objets d’une femme sont différents des objets d’un enfant, etc.LES GESTES ADÉQUATS. – Il y en a qui savent y faire, y ayant été formés, et les autres. Ceux qui ont tout de suite le geste approprié, et pour chaque situation. Pompiers et médecins urgentistes, ou mieux : ambulanciers. Formels sanitaires ou d’exercices militaires de base : c’est à peu près tout un. Mais la plupart, citadins d’aujourdh’hui, sont désemparés. N’ont pas appris. Ne s’y attendaient pas, et le blessé grave , lui n’attendra pas non plus. Et le défunt reste là, qu’on ne peut pas laisser comme ça sans rien faire. Mais faire quoi et comment ? Avec notre père, déjà, ce soir-là, après tout un dimanche à nous faire à l’idée que ce serait le dernier, après son dernier râle, nous nous étions regardés, les frères et la mère, avant de nous y mettre, et c’est venu comme ça, « sur le tas », comme si nous retrouvions les gestes des pères de nos pères et des tribus qui continuent, aujourd’hui encore, à savoir y faire…FAIRE-PART. – Cela sortira demain dans le journal où, plus de vingt ans durant, j’ai délivré leur billet de sortie à maints écrivains, non sans y annoncer la mort de nos père et mère, et je m’y désigne comme «son bon ami », ainsi qu’elle m’appelait depuis toujours dans le langage des jeunes gens de ce pays non encore fiancés et moins encore mariés – jamais d’ailleurs je n’ai parlé d’elle comme de «ma femme», comme d’autres parlent de « mon chirurgien » ou de « ma Ferrari », ni non plus de « mon épouse » à la manière bourgeoise, et puis, sans être resté trop attaché à Paul Eluard comme je l’étais à seize ans, partageant le goût marqué des femmes seules, j’ai trouvé bien trouvée la citation du poète que m’a proposée notre fille aînée : « Je cherche par delà l’attente / par delà moi-même / Et je ne sais plus tant je t’aime / Lequel de nous deux est absent »… (Ce 16 décembre)MISS YOU. – Elle me manque déjà, mais elle est déjà partout, je sais qu’elle n’est pas là où elle est, que ce corps allongé et ce visage fermé ne sont plus vraiment celle qu’elle est déjà et sera, je ne vais pas m’attarder à les regarder même si je sais qu’ils sont tout ce qui me reste d’elle, mais j’étais plus proche d’elle quand elle dormait qu’en les regardant à présent, elle me disait il y a quelque temps qu’elle avait l’impression que son corps se glissait hors d’elle après lui avoir été parfois une torture, mais son visage restait le même jusqu’à l’autre soir, après qu’elle est entrée dans le noir, nous ayant signifié qu’elle n’aspirait plus qu’à dormir mais que nous pouvions laisser la lumière, son visage alors s’est comme tourné et comme éteint, et maintenant son visage ne reflète plus rien, son visage ne ressemble plus du tout à elle, jamais je ne lui ai vu ce visage sans lumière alors que sa lumière irradie déjà d’une façon qui n’est qu’à elle.COMPASSION. – Les gens sont souvent mal pris à ces moments-là, mais tu compatis. Ils te disent « courage », ou pire : « on continue », comme ils lui souhaitaient de « remonter la pente » alors qu’ils savaient que nous n’avions plus le moindre espoir de guérison, ils te disaient « ne te laisse pas abattre », d’un ton qui laissait entendre que te voir te laisser abattre leur serait pénible, mais au lieu de leur en vouloir tu avais compati… -
L'écrivain peut-il tout dire ?
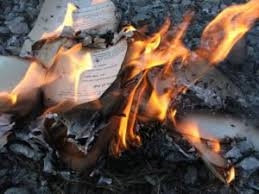 Édito du dossier spécial du Passe-Murailleconsacré aux limites du droit des écrivains à tout dire,par JLK
Édito du dossier spécial du Passe-Murailleconsacré aux limites du droit des écrivains à tout dire,par JLKL’écrivain a-t-il, plus que n’importe quel autre citoyen, le droit de dire tout et n’importe quoi? Tel n’est pas du tout notre sentiment. Mais la liberté d’expression de l’écrivain coïncide-t-elle à tout coup avec celle du quidam ? Certainement pas, dans la mesure où son rapport à la langue et à l’écrit relève d’une implication qui ne se réduit ni à l’idéologie politique ou religieuse, ni non plus aux conventions morales en vigueur dans la société qui l’entoure.
Deux affaires récentes, qui ont défrayé la chronique médiatique, ont alimenté un « débat » vite noyé dans la confusion. D’une part, c’était le refus d’adhésion opposé, par le comité de l’association Autrices et Auteurs de Suisse, à un «requérant» de toute évidence provocateur : le député UDC (droite dure) Oskar Freysinger, auteur d’un premier livre dont le contenu, sûrement discutable, faisait moins problème que ses prises de position publiques. D’autre part, la dénonciation (dans les colonnes du Monde, puis du Temps), par les écrivains Bernard Comment et Olivier Rolin, des propos antisémites tenus par un des personnages de Pogrom, roman du jeune auteur Eric Bénier-Bürckel.Or, peut-on condamner un auteur sur la base de ses positions de citoyen ou d’homme public ? Est-il légitime de stigmatiser un romancier pour la conduite d’un de ses personnages ? Et qu’en est-il de l’éthique de l’écrivain dans sa pratique personnelle?A cette dernière question, treize auteurs sollicités ont bien voulu répondre à l’écart des estrades.Le ton de leurs réponses, autant que leur contenu, le son de leurs voix, le rythme de leurs phrases, méritent la même attention que le poète Fabio Pusterla, dans une belle évocation de notre dossier, prête au rythme, à la voix particulière de Robert Walser. Celui-ci était-il « de gauche » ou « de droite » ? Pusterla nous éclaire également en rappelant la tragédie historique du XXe siècle dont le promeneur inspiré ne s’occupe guère: « Walser nous parle d’autre chose ou mieux : il nous parle d’une autre façon, avec une autre musique ; et dans son altérité se découvre l’une des formes d’opposition les plus extrêmes et lancinantes qu’il nous soit donné d’imaginer »… (JLK)La parole aux écrivainsLa liberté des écrivains a-t-elle des limites ? Telle est la question que nous avons posée à quelques-uns d’entre eux après les turbulences médiatiques provoquées, ces derniers mois, par deux « affaires » illustrant diversement le problème. D’une part, ce furent les démêlés d’Oskar Freysinger, député valaisan de l’UDC et auteur d’un premier recueil de nouvelles, dont la candidature à l’association Autrices et Auteurs de Suisse fit l’objet d’un examen idéologique préalable avant d’être rejetée; d’autre part, la mise en accusation, par Bernard Comment et Olivier Rolin (dans Le Monde du 11 février 2005), du jeune écrivain français Eric Bénier-Biirckel, et de son éditeur Flammarion, au prétexte que des propos violemment antisémites sont tenus, dans le roman intitulé Pogrom, par l’un des personnages de celui-ci. Plus de quinze ans après la Fatwah islamique condamnant Salman Rushdie à mort pour avoir écrit Les Versets sataniques, et alors même que la liberté d’expression reste lettre morte dans tant de pays, la question des limites de celle-ci se (re)pose bel et bien par rapport à certaine éthique de la littérature. Par-delà les débats portant sur lesdites « affaires », le plus souvent bruyants ou confus, et ne visant qu’à l’effet momentané ou à la déclaration plus ou moins convenue ou démagogique, nous tenions à relancer ici une réflexion de fond sur le thème du droit mais aussi du devoir de l’écrivain ; de sa liberté impliquant une égale responsabilité. Les réponses sérieuses et nuancées qui nous sont parvenues témoignent, à l’évidence, que la question valait d’être posée. (JLK)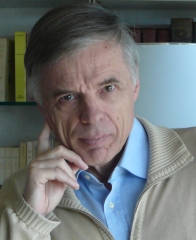 Etienne Barilier: une question de qualité…La question la plus brûlante aujourd’hui, ce n’est peut-être pas celle de la liberté d’expression, mais celle de la qualité littéraire. Car il est hors de doute que la littérature, la bonne, est libre de tout dire : c’est ce qu’elle fait depuis toujours, par définition, par vocation ; et c’est ce qu’elle fait pour le bien de la société, j’en suis convaincu, pour autant évidemment que l’écrivain ne dissimule pas un prêcheur, un politicien, un idéologue ou un publicitaire. Pour autant qu’il ne confonde pas la liberté d’expression avec le goût intéressé de la provocation.Où sont les limites à la liberté de la littérature? Nulle part, dès lors que la littérature est pure de toute volonté de démontrer, de prêcher, d’insinuer ou de provoquer, loin de toute intention de poursuivre un « but moral », comme le disait Baudelaire — il faudrait plutôt dire aujourd’hui, mais c’est la même chose, «un but immoral ». La littérature digne de ce nom ne cherche ni l’édification ni la destruction. Elle est simplement habitée par le souci de l’humain. Et même quand elle est hantée par la mort, elle est du côté de la vie parce qu’elle est créatrice de formes, et que les formes sont ennemies du chaos. C’est encore Baudelaire qui invoque « cet admirable, cet immortel instinct du beau», qui a partie liée avec le goût du bien et le sens du vrai.La pleine liberté d’expression ne saurait nuire, parce que dans la vraie littérature, l’esthétique est solidaire de l’éthique, même lorsqu’elle ne le veut pas, surtout lorsqu’elle ne le sait pas. En revanche, la fausse littérature, ou la mauvaise, quelles que soient ses intentions, ne véhicule que platitudes, illusions, mensonges et provocations vaines, parce que lui fait défaut «l’immortel instinct du beau». La qualité, qui désigne aussi bien la valeur humaine que la perfection esthétique, voilà ce qui distingue la vraie littérature. Et la qualité seule mérite la liberté. E.B.
Etienne Barilier: une question de qualité…La question la plus brûlante aujourd’hui, ce n’est peut-être pas celle de la liberté d’expression, mais celle de la qualité littéraire. Car il est hors de doute que la littérature, la bonne, est libre de tout dire : c’est ce qu’elle fait depuis toujours, par définition, par vocation ; et c’est ce qu’elle fait pour le bien de la société, j’en suis convaincu, pour autant évidemment que l’écrivain ne dissimule pas un prêcheur, un politicien, un idéologue ou un publicitaire. Pour autant qu’il ne confonde pas la liberté d’expression avec le goût intéressé de la provocation.Où sont les limites à la liberté de la littérature? Nulle part, dès lors que la littérature est pure de toute volonté de démontrer, de prêcher, d’insinuer ou de provoquer, loin de toute intention de poursuivre un « but moral », comme le disait Baudelaire — il faudrait plutôt dire aujourd’hui, mais c’est la même chose, «un but immoral ». La littérature digne de ce nom ne cherche ni l’édification ni la destruction. Elle est simplement habitée par le souci de l’humain. Et même quand elle est hantée par la mort, elle est du côté de la vie parce qu’elle est créatrice de formes, et que les formes sont ennemies du chaos. C’est encore Baudelaire qui invoque « cet admirable, cet immortel instinct du beau», qui a partie liée avec le goût du bien et le sens du vrai.La pleine liberté d’expression ne saurait nuire, parce que dans la vraie littérature, l’esthétique est solidaire de l’éthique, même lorsqu’elle ne le veut pas, surtout lorsqu’elle ne le sait pas. En revanche, la fausse littérature, ou la mauvaise, quelles que soient ses intentions, ne véhicule que platitudes, illusions, mensonges et provocations vaines, parce que lui fait défaut «l’immortel instinct du beau». La qualité, qui désigne aussi bien la valeur humaine que la perfection esthétique, voilà ce qui distingue la vraie littérature. Et la qualité seule mérite la liberté. E.B.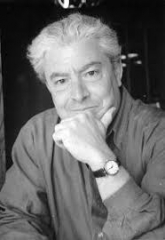 Rafik Ben Salah: une question de sociétéPour moi, il n’y a peut-être pas lieu de séparer le droit de l’écrivain à la libre expression et ce même droit appliqué au citoyen ; la seule différence dans cette affaire me paraît relever du degré de notoriété de l’un par rapport à l’autre. Le problème ne me paraît pas se poser très différemment selon qu’on est écrivain ou non. Aujourd’hui, une multitude de citoyens écrivent. Cependant, un aspect de cette question me paraît devoir être signalé. Jusqu’où peut-on exercer la liberté de s’exprimer ? Cette question ne se pose pas de la même manière, selon qu’on se trouve en pays où les droits de l’homme sont, en principe, respectés, et dans un autre où les Autorités n’ont que faire de ces droits et encore moins de leur respect. C’est une question qui me touche. Dans le premier cas, la société a codifié les excès inhérents à l’exercice de la liberté d’expression; elle a légiféré, réglementé et quiconque se trouve en infraction connaît le salaire de ses forfaits. Il reste tout ce qui est permis et qui est en deçà des limites fixées par la loi. Cela, à mes yeux, relève de la seule appréciation de l’écrivain et se mesure à son sens des responsabilités, à ce qu’il considère comme inséparable de son honneur ou de sa crédibilité. Lui seul sait s’il peut écrire sur tout ou sur rien. On ne doit ni lui interdire, ni l’expulser de quelque cénacle, cercle, club ou société. Dans les sociétés où la parole est étroitement surveillée, cela change du tout au tout. De tout ce que la loi n’interdit pas est permis, on passe à plus rien n’est permis qui n’ait l’assentiment prévisible du Prince. Plus aucune règle, c’est la règle. Il n’est donc plus besoin de mesurer sa liberté à l’aune des lois ou à son code personnel de l’honneur. Dans tous les cas, l’écrivain doit plaire; dans le meilleur des cas, il peut laisser indifférent, mais jamais il ne peut déplaire impunément. Et plaire, c’est aboyer avec la meute, entende le Prince ou n’entende pas, l’humiliation est toujours au bout du calame. Alors tant qu’on le peut, laissons à chacun fixer ses propres limites. RBS.
Rafik Ben Salah: une question de sociétéPour moi, il n’y a peut-être pas lieu de séparer le droit de l’écrivain à la libre expression et ce même droit appliqué au citoyen ; la seule différence dans cette affaire me paraît relever du degré de notoriété de l’un par rapport à l’autre. Le problème ne me paraît pas se poser très différemment selon qu’on est écrivain ou non. Aujourd’hui, une multitude de citoyens écrivent. Cependant, un aspect de cette question me paraît devoir être signalé. Jusqu’où peut-on exercer la liberté de s’exprimer ? Cette question ne se pose pas de la même manière, selon qu’on se trouve en pays où les droits de l’homme sont, en principe, respectés, et dans un autre où les Autorités n’ont que faire de ces droits et encore moins de leur respect. C’est une question qui me touche. Dans le premier cas, la société a codifié les excès inhérents à l’exercice de la liberté d’expression; elle a légiféré, réglementé et quiconque se trouve en infraction connaît le salaire de ses forfaits. Il reste tout ce qui est permis et qui est en deçà des limites fixées par la loi. Cela, à mes yeux, relève de la seule appréciation de l’écrivain et se mesure à son sens des responsabilités, à ce qu’il considère comme inséparable de son honneur ou de sa crédibilité. Lui seul sait s’il peut écrire sur tout ou sur rien. On ne doit ni lui interdire, ni l’expulser de quelque cénacle, cercle, club ou société. Dans les sociétés où la parole est étroitement surveillée, cela change du tout au tout. De tout ce que la loi n’interdit pas est permis, on passe à plus rien n’est permis qui n’ait l’assentiment prévisible du Prince. Plus aucune règle, c’est la règle. Il n’est donc plus besoin de mesurer sa liberté à l’aune des lois ou à son code personnel de l’honneur. Dans tous les cas, l’écrivain doit plaire; dans le meilleur des cas, il peut laisser indifférent, mais jamais il ne peut déplaire impunément. Et plaire, c’est aboyer avec la meute, entende le Prince ou n’entende pas, l’humiliation est toujours au bout du calame. Alors tant qu’on le peut, laissons à chacun fixer ses propres limites. RBS. Jacques-Etienne Bovard: un vain mot?La liberté d’expression n’a de sens que dès lors que sont exprimées des idées déplaisantes, sinon elle n’est qu’un gargarisme. L’absence actuelle de grand débat aurait-elle fait oublier que cette liberté-là, comme toute autre, implique un prix à payer, et un certain nombre de risques, donc de responsabilités de part et d’autre ? On préférerait bien sûr un monde parfait, mais l’histoire montre que toute société, si bien pour-vue qu’elle soit d’écoles, de journaux, de prisons et de cliniques, comptera toujours aussi ses pervers, ses illuminés, ses opportunistes, ses dissidents, ses génies visionnaires, ses artistes — avec ou sans guillemets. Elle montre aussi qu’il faut pourtant les laisser dire, et sans doute contaminer nombre de têtes faibles ou intéressées ; oser regarder de près ce qui suppure sous les mots, en faire l’analyse froide en pleine lumière, et critiquer, condamner, anéantir par d’autres mots, jamais par le silence ; accepter de devoir éternellement recommencer la lutte contre la peste, sans du reste aucune garantie de succès. Du moins évite-t-on d’aller à fins contraires, puisque la censure, qu’elle soit administrée par des fanatiques ou des pleutres, n’a jamais empêché une idée, une croyance ou une angoisse de se répandre. De tout temps, le marteau qui a voulu les écraser les a aiguisées comme des lames, et fait retentir au loin les bonnes comme les abjectes. Non, bien sûr que non, il n’est pas permis de dire n’importe quoi, à l’artiste pas plus qu’à un autre ; mais accepter de débattre de tout est le prix à payer pour pouvoir continuer à dire sérieuse-ment qu’on soutient la liberté d’expression. Cela implique lucidité, vigilance, courage, ainsi qu’une aptitude constante à se remettre en question, exactement ce qui a manqué dans les récentes «affaires» qu’on connaît. On s’est offusqué, on a eu peur; on a été tracassé dans son petit cocon de certitudes proprettes, et, avant même de savoir de quoi il s’agissait, on a censuré, à la sulfateuse. Résultat : on s’est déconsidéré soi-même, et, avec l’aide des médias ravis de l’aubaine, un Prix Nobel n’eût peut-être pas attiré beaucoup plus de publicité à ce qu’on voulait enfouir. On aura au moins réussi à ne pas débattre. Jusqu’à quand? J.-E.B
Jacques-Etienne Bovard: un vain mot?La liberté d’expression n’a de sens que dès lors que sont exprimées des idées déplaisantes, sinon elle n’est qu’un gargarisme. L’absence actuelle de grand débat aurait-elle fait oublier que cette liberté-là, comme toute autre, implique un prix à payer, et un certain nombre de risques, donc de responsabilités de part et d’autre ? On préférerait bien sûr un monde parfait, mais l’histoire montre que toute société, si bien pour-vue qu’elle soit d’écoles, de journaux, de prisons et de cliniques, comptera toujours aussi ses pervers, ses illuminés, ses opportunistes, ses dissidents, ses génies visionnaires, ses artistes — avec ou sans guillemets. Elle montre aussi qu’il faut pourtant les laisser dire, et sans doute contaminer nombre de têtes faibles ou intéressées ; oser regarder de près ce qui suppure sous les mots, en faire l’analyse froide en pleine lumière, et critiquer, condamner, anéantir par d’autres mots, jamais par le silence ; accepter de devoir éternellement recommencer la lutte contre la peste, sans du reste aucune garantie de succès. Du moins évite-t-on d’aller à fins contraires, puisque la censure, qu’elle soit administrée par des fanatiques ou des pleutres, n’a jamais empêché une idée, une croyance ou une angoisse de se répandre. De tout temps, le marteau qui a voulu les écraser les a aiguisées comme des lames, et fait retentir au loin les bonnes comme les abjectes. Non, bien sûr que non, il n’est pas permis de dire n’importe quoi, à l’artiste pas plus qu’à un autre ; mais accepter de débattre de tout est le prix à payer pour pouvoir continuer à dire sérieuse-ment qu’on soutient la liberté d’expression. Cela implique lucidité, vigilance, courage, ainsi qu’une aptitude constante à se remettre en question, exactement ce qui a manqué dans les récentes «affaires» qu’on connaît. On s’est offusqué, on a eu peur; on a été tracassé dans son petit cocon de certitudes proprettes, et, avant même de savoir de quoi il s’agissait, on a censuré, à la sulfateuse. Résultat : on s’est déconsidéré soi-même, et, avec l’aide des médias ravis de l’aubaine, un Prix Nobel n’eût peut-être pas attiré beaucoup plus de publicité à ce qu’on voulait enfouir. On aura au moins réussi à ne pas débattre. Jusqu’à quand? J.-E.B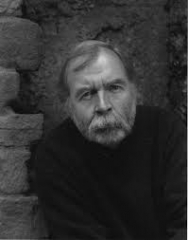 Jacques Chessex: trois réponses qui n’en font qu’une1. Il m’est très difficile de répondre à cette question, parce que ce n’est pas moi qui choisis, c’est le livre qui est en train de s’écrire en moi et par moi. Tout dépend donc du livre, de son ton, de sa densité, de son unité à lui, rien qu’à lui, outre toute décence ou obédience civique, politique, religieuse, etc.2. Ceci dit, l’écriture de ce livre tolère-t-elle l’aberration ? le racisme, non. L’exaltation de la bassesse d’âme, non. Le mépris de l’autre, non. Mais de ces laideurs je n’ai rien à craindre : elles n’occupent pas les âmes bien nées.3. Pour revenir à ma première proposition, celle du livre en train de se faire, elle suppose évidemment la grande part du style. C’est le style qui décide — choisit, élimine, met en place, donne forme et sens. Je crois que j’ai raison de lui faire confiance. J.C.
Jacques Chessex: trois réponses qui n’en font qu’une1. Il m’est très difficile de répondre à cette question, parce que ce n’est pas moi qui choisis, c’est le livre qui est en train de s’écrire en moi et par moi. Tout dépend donc du livre, de son ton, de sa densité, de son unité à lui, rien qu’à lui, outre toute décence ou obédience civique, politique, religieuse, etc.2. Ceci dit, l’écriture de ce livre tolère-t-elle l’aberration ? le racisme, non. L’exaltation de la bassesse d’âme, non. Le mépris de l’autre, non. Mais de ces laideurs je n’ai rien à craindre : elles n’occupent pas les âmes bien nées.3. Pour revenir à ma première proposition, celle du livre en train de se faire, elle suppose évidemment la grande part du style. C’est le style qui décide — choisit, élimine, met en place, donne forme et sens. Je crois que j’ai raison de lui faire confiance. J.C. Anne Cuneo: l’espace de la libertéS’il est vrai que je revendique la liberté d’écrire pour l’écrivain, il est tout aussi vrai que ma liberté d’écrivain est limitée par plusieurs facteurs. Les plus évidents sont ceux que je m’impose à moi-même.Il faudra par exemple attendre longtemps pour que je tienne ou que j’écrive consciemment des propos racistes. Ce n’est pas parce que je me l’interdis. C’est parce que je suis convaincue que le racisme est néfaste. Ou des propos militaristes. Ou des propos machistes. En d’autres termes, ma liberté d’écrire est limitée tout d’abord par ma vision du monde.L’autre barrière à la liberté d’écrire qui me vient de moi-même, c’est l’exigence de qualité : je m’interdis d’écrire n’importe comment, je travaille et retravaille jusqu’à la dernière seconde par respect du lecteur, pour lui offrir ce que je fais de mieux.Le lecteur — voilà l’autre horizon de mon espace de liberté. En tant qu’écrivain, je cherche par définition un public. Qu’on écrive pour soi ou pour la postérité, le simple fait qu’on écrive, cela implique qu’on a envie, aujourd’hui ou demain, d’être lu. Lorsque mon texte arrivera au public, celui-ci peut être indifférent : je sais que cela peut ne pas être définitif. De grands textes de la littérature mondiale sont sortis dans l’indifférence et son devenus des best-sellers par la suite. Sur le moment, cela peut limiter mes possibilités d’être publiée (et lue).Quelqu’un peut se sentir blessé par mes propos, et le faire savoir : dans ce cas-là, il est de mon devoir de les examiner, de les mesurer à mes exigences personnelles et, le cas échéant, de m’expliquer, de me corriger.Mais je sais d’avance que je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Exemple extrême, je ne pour-rai jamais répondre à un raciste qui me reproche de ne pas être raciste : nous ne sommes pas dans le même monde — et dans un sens ce n’est pas pour cette personne-là que j’écris.On pourrait énumérer pas mal d’autres facteurs qui limitent la liberté de l’artiste (l’écrivain n’étant qu’une partie du problème) depuis l’intérieur, si je puis dire. La réponse à la question est, sur ce plan-là, claire : non, l’écrivain n’est pas libre d’écrire n’importe quoi, il est responsable face à sa propre conscience.Il est cependant une autre limitation possible : celle imposée par les pouvoirs. Qu’elle soit politique, étatique, ou parfois même médiatique, face à cette limite-là, qui s’appelle en dernière analyse censure, il n’est qu’une réponse possible : toute liberté en art. A.C.
Anne Cuneo: l’espace de la libertéS’il est vrai que je revendique la liberté d’écrire pour l’écrivain, il est tout aussi vrai que ma liberté d’écrivain est limitée par plusieurs facteurs. Les plus évidents sont ceux que je m’impose à moi-même.Il faudra par exemple attendre longtemps pour que je tienne ou que j’écrive consciemment des propos racistes. Ce n’est pas parce que je me l’interdis. C’est parce que je suis convaincue que le racisme est néfaste. Ou des propos militaristes. Ou des propos machistes. En d’autres termes, ma liberté d’écrire est limitée tout d’abord par ma vision du monde.L’autre barrière à la liberté d’écrire qui me vient de moi-même, c’est l’exigence de qualité : je m’interdis d’écrire n’importe comment, je travaille et retravaille jusqu’à la dernière seconde par respect du lecteur, pour lui offrir ce que je fais de mieux.Le lecteur — voilà l’autre horizon de mon espace de liberté. En tant qu’écrivain, je cherche par définition un public. Qu’on écrive pour soi ou pour la postérité, le simple fait qu’on écrive, cela implique qu’on a envie, aujourd’hui ou demain, d’être lu. Lorsque mon texte arrivera au public, celui-ci peut être indifférent : je sais que cela peut ne pas être définitif. De grands textes de la littérature mondiale sont sortis dans l’indifférence et son devenus des best-sellers par la suite. Sur le moment, cela peut limiter mes possibilités d’être publiée (et lue).Quelqu’un peut se sentir blessé par mes propos, et le faire savoir : dans ce cas-là, il est de mon devoir de les examiner, de les mesurer à mes exigences personnelles et, le cas échéant, de m’expliquer, de me corriger.Mais je sais d’avance que je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Exemple extrême, je ne pour-rai jamais répondre à un raciste qui me reproche de ne pas être raciste : nous ne sommes pas dans le même monde — et dans un sens ce n’est pas pour cette personne-là que j’écris.On pourrait énumérer pas mal d’autres facteurs qui limitent la liberté de l’artiste (l’écrivain n’étant qu’une partie du problème) depuis l’intérieur, si je puis dire. La réponse à la question est, sur ce plan-là, claire : non, l’écrivain n’est pas libre d’écrire n’importe quoi, il est responsable face à sa propre conscience.Il est cependant une autre limitation possible : celle imposée par les pouvoirs. Qu’elle soit politique, étatique, ou parfois même médiatique, face à cette limite-là, qui s’appelle en dernière analyse censure, il n’est qu’une réponse possible : toute liberté en art. A.C. Christophe Gallaz: une (relative) liberté absolueIl est difficile de répondre dans les termes techniques qu’impose la notion de limite. Essayons.D’abord : la liberté d’expression de l’écrivain est absolue. La condition d’artiste requiert de ce der-nier qu’il accomplisse une exploration discrétionnaire des formes et de la pensée. Ce principe est d’autant plus vrai qu’il est impossible de graduer l’usage qui est fait de toute liberté — de même qu’il est impossible de graduer cette liberté-là. Admirer ou mépriser l’oeuvre produite en fonction de cette liberté, oui; la juger et la condamner, non.La spécificité de la littérature renforce d’ailleurs cette impossibilité. La littérature jaillit en permanence hors d’elle-même. D’une part elle est tissée de fictions, générant des significations dont chaque lecteur est l’auteur au moins partiel. D’autre part elle est porteuse d’un style, qui confère au texte un rayonnement sémantique presque autonome.Telle est la situation idéale. La situation sèche. Elle se complique évidemment dès lors que nous glissons la question de la liberté d’expression littéraire dans la pratique. Parmi des humains connus ou non, cultivés ou non, et vivants ou morts. Dans la pâte organique. Il me semble qu’un seul principe doit valoir à ce stade : il faut protéger, contre l’écrivain doué de parole et s’en servant pour agresser les vivants autour de lui, ceux d’entre eux qui ne la possèdent pas. Qui n’ont pas les moyens de lui répliquer. Et ne disposent d’aucun porte-voix pour le faire à leur place. Les secourir alors est sacré.Pour le reste… les signes typographiques ne sont pas des pistolets. Venez donc dans l’arène, messieurs Freysinger et Bénier-Bürckel! On vous répondra sec et sonnant sur la manière et le fond. Ainsi les lecteurs seront-ils de grandes personnes et la littérature adviendra-t-elle — puisqu’on ne la confond pas avec la police, qu’on n’a pas douze pasteurs ou curés dans la tête, et qu’on se méfie de la bien-pensance haineuse et perverse qui ravage notre époque C. Gz
Christophe Gallaz: une (relative) liberté absolueIl est difficile de répondre dans les termes techniques qu’impose la notion de limite. Essayons.D’abord : la liberté d’expression de l’écrivain est absolue. La condition d’artiste requiert de ce der-nier qu’il accomplisse une exploration discrétionnaire des formes et de la pensée. Ce principe est d’autant plus vrai qu’il est impossible de graduer l’usage qui est fait de toute liberté — de même qu’il est impossible de graduer cette liberté-là. Admirer ou mépriser l’oeuvre produite en fonction de cette liberté, oui; la juger et la condamner, non.La spécificité de la littérature renforce d’ailleurs cette impossibilité. La littérature jaillit en permanence hors d’elle-même. D’une part elle est tissée de fictions, générant des significations dont chaque lecteur est l’auteur au moins partiel. D’autre part elle est porteuse d’un style, qui confère au texte un rayonnement sémantique presque autonome.Telle est la situation idéale. La situation sèche. Elle se complique évidemment dès lors que nous glissons la question de la liberté d’expression littéraire dans la pratique. Parmi des humains connus ou non, cultivés ou non, et vivants ou morts. Dans la pâte organique. Il me semble qu’un seul principe doit valoir à ce stade : il faut protéger, contre l’écrivain doué de parole et s’en servant pour agresser les vivants autour de lui, ceux d’entre eux qui ne la possèdent pas. Qui n’ont pas les moyens de lui répliquer. Et ne disposent d’aucun porte-voix pour le faire à leur place. Les secourir alors est sacré.Pour le reste… les signes typographiques ne sont pas des pistolets. Venez donc dans l’arène, messieurs Freysinger et Bénier-Bürckel! On vous répondra sec et sonnant sur la manière et le fond. Ainsi les lecteurs seront-ils de grandes personnes et la littérature adviendra-t-elle — puisqu’on ne la confond pas avec la police, qu’on n’a pas douze pasteurs ou curés dans la tête, et qu’on se méfie de la bien-pensance haineuse et perverse qui ravage notre époque C. Gz Michel Layaz: Une question de sensibilitéIl serait tellement simple d’avoir un avis arrêté, de pouvoir affirmer, comme Vaneigem dans le titre de son dernier livre, rien n’est sacré, tout peut se dire, ou alors d’être capable de définir les avis, les domaines et les mots à bannir. Dans mes textes, je ne suis régi que par ma sensibilité. Bien sûr il faudrait savoir ce qui la forge, la constitue, mais peu importe, disons seulement que je suis allergique à ce que Mallarmé dénonçait sous l’expression du « grand reportage universel ». Là réside fondamentalement ce qui me dégoûte et que, de fait, je m’interdis. Mais dans ces bas-fonds, l’art est beaucoup moins sordide que la réalité. Ceux qui dans les médias se délectent par exemple d’affaires pédophiles — de les écrire, de les décrire, de les commenter, de les détailler, de les donner à lire —, s’en repaissent à longueur de pages. Ce sont les puritains de la pire espèce, toujours prêts à expliquer à la population ce qui est bien et ce qui ne l’est pas alors que leur seule intention est de remuer les instincts les plus bas pour vendre leur camelote. Tentons une expérience : interdisons pendant vingt ans toute liberté d’expression. Plus de livres, plus d’expositions, mais également plus de médias, plus d’Internet, plus de publicité. Une vraie purge. Un silence réflexif. Au bout de vingt ans, j’ai bon espoir que les gens — apaisés, reposés — décrètent à l’unisson que la vraie obscénité, ce sont les paroles de Patrick Le Lay, directeur de TF1, qui l’été dernier expliquait que son métier consiste à « vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible ». Je ne doute pas que l’horreur et le cynisme de ce genre de propos enthousiasme Peter Rothenbühler, le rédacteur en chef du Matin. Mais après vingt ans de purge, du Matin, plus personne n’en voudra et il n’y aura plus un seul abruti pour rire si un quelconque Dieu-donné déclare que les sionistes «c’est toujours dans le dos qu’ils attaquent ». Les gens découvriront que les artistes, eux, ont le droit de dépasser les bornes, qu’ils ont peut-être même tous les droits, mais que pour cela, il faut avoir du génie. Et tout le monde ne s’appelle pas Sade, Apollinaire, Genet, Bataille, ou Klossowski, n’en déplaisent aux Patrick et aux Peter prêts à parler des pires livres et des pires auteurs pour autant qu’il y ait un quelconque pen-chant morbide à mettre en évidence. M. Lz.
Michel Layaz: Une question de sensibilitéIl serait tellement simple d’avoir un avis arrêté, de pouvoir affirmer, comme Vaneigem dans le titre de son dernier livre, rien n’est sacré, tout peut se dire, ou alors d’être capable de définir les avis, les domaines et les mots à bannir. Dans mes textes, je ne suis régi que par ma sensibilité. Bien sûr il faudrait savoir ce qui la forge, la constitue, mais peu importe, disons seulement que je suis allergique à ce que Mallarmé dénonçait sous l’expression du « grand reportage universel ». Là réside fondamentalement ce qui me dégoûte et que, de fait, je m’interdis. Mais dans ces bas-fonds, l’art est beaucoup moins sordide que la réalité. Ceux qui dans les médias se délectent par exemple d’affaires pédophiles — de les écrire, de les décrire, de les commenter, de les détailler, de les donner à lire —, s’en repaissent à longueur de pages. Ce sont les puritains de la pire espèce, toujours prêts à expliquer à la population ce qui est bien et ce qui ne l’est pas alors que leur seule intention est de remuer les instincts les plus bas pour vendre leur camelote. Tentons une expérience : interdisons pendant vingt ans toute liberté d’expression. Plus de livres, plus d’expositions, mais également plus de médias, plus d’Internet, plus de publicité. Une vraie purge. Un silence réflexif. Au bout de vingt ans, j’ai bon espoir que les gens — apaisés, reposés — décrètent à l’unisson que la vraie obscénité, ce sont les paroles de Patrick Le Lay, directeur de TF1, qui l’été dernier expliquait que son métier consiste à « vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible ». Je ne doute pas que l’horreur et le cynisme de ce genre de propos enthousiasme Peter Rothenbühler, le rédacteur en chef du Matin. Mais après vingt ans de purge, du Matin, plus personne n’en voudra et il n’y aura plus un seul abruti pour rire si un quelconque Dieu-donné déclare que les sionistes «c’est toujours dans le dos qu’ils attaquent ». Les gens découvriront que les artistes, eux, ont le droit de dépasser les bornes, qu’ils ont peut-être même tous les droits, mais que pour cela, il faut avoir du génie. Et tout le monde ne s’appelle pas Sade, Apollinaire, Genet, Bataille, ou Klossowski, n’en déplaisent aux Patrick et aux Peter prêts à parler des pires livres et des pires auteurs pour autant qu’il y ait un quelconque pen-chant morbide à mettre en évidence. M. Lz.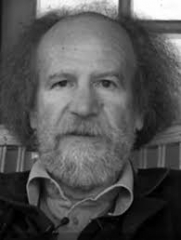 Pierre Yves Lador: liberté d’expressionIl ne s’agit pas tant de jeter des flamboiements sur la liberté immense ou sur sa prochaine extinction, mais plutôt de voir humblement quelques cas concrets. En quarante ans d’expression, je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui fût contre la liberté d’expression, mais des centaines qui censuraient vertueusement, laborieusement, voire joyeusement.Dans les bibliothèques, des maîtres réservaient et réserveront certains livres aux bibliothèques scientifiques et nationales où ils sont introuvables sans montrer patte diplômée. Et pas seulement Mon combat du connu Hitler Adolf, des livres de Le Pen ou d’Escriva de Balaguer, il y a d’autres exemples plus faciles à celer car de plumes moins médiatisées. Dans les librairies et dans la presse on vous dit plus habilement qu’il faut choisir, qu’on manque de place, de temps, qu’ils sont épuisés, qu’il n’y a pas d’amateurs pour des penseurs comme Gomez Davila qui mort il y a plus de dix ans à plus de nonante ans voit avec peine deux livres paraître en France (bien après l’Allemagne qui en a traduit cinq). C’est ça les manques de la liberté d’expression, les prescripteurs à la langue de bois arborent un masque de bois. Je ne crois pas au complot comme Freysinger (le libre chanteur) mais à une contagion rhizomique, une aboulie générale, beaucoup de lâcheté, le goût d’une vertu qui sent les relents des sacristies du PC, le mépris classique de ceux qui veulent protéger le peuple pour ne pas désespérer Billancourt et autres billevesées qui fleurent l’angélisme sans ailes et de sexe indéterminé du type l’un est l’autre…Au nom de l’ouverture, ne parlons plus de portes, ni de murs, ni de toits, ni de frontières, ni des livres de gens que nous ne connaissons pas ou n’aimons pas ou qui disent autre chose que ce que nous savons être juste et vrai, ils peuvent être dangereux, ne méritent aucun respect et sont d’ailleurs des fascistes.Encore un mot du jeune Onfray que j’ai pu entendre dans deux émissions de la RSR et une d’Espace 2. C’est dire si l’on a écarté deux autres auteurs différents au profit de ce falsificateur de l’histoire et de la philosophie, amuseur triste et pompeux qui devait sans doute compenser par anticipation les centaines d’heures consacrées au pape. La liberté c’est la variété…Vous pouvez tout dire, on n’a rien entendu, on ne le redira pas, on ne vous invitera plus et vous pouvez être content d’être en vie car on n’est pas des sauvages contrairement à vos amis. Si on n’était pas pour la liberté d’expression, les gens comme vous on les fusillerait ! Ah Orwell, Tocqueville, Spooner, où êtes-vous? P.Y.L.
Pierre Yves Lador: liberté d’expressionIl ne s’agit pas tant de jeter des flamboiements sur la liberté immense ou sur sa prochaine extinction, mais plutôt de voir humblement quelques cas concrets. En quarante ans d’expression, je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui fût contre la liberté d’expression, mais des centaines qui censuraient vertueusement, laborieusement, voire joyeusement.Dans les bibliothèques, des maîtres réservaient et réserveront certains livres aux bibliothèques scientifiques et nationales où ils sont introuvables sans montrer patte diplômée. Et pas seulement Mon combat du connu Hitler Adolf, des livres de Le Pen ou d’Escriva de Balaguer, il y a d’autres exemples plus faciles à celer car de plumes moins médiatisées. Dans les librairies et dans la presse on vous dit plus habilement qu’il faut choisir, qu’on manque de place, de temps, qu’ils sont épuisés, qu’il n’y a pas d’amateurs pour des penseurs comme Gomez Davila qui mort il y a plus de dix ans à plus de nonante ans voit avec peine deux livres paraître en France (bien après l’Allemagne qui en a traduit cinq). C’est ça les manques de la liberté d’expression, les prescripteurs à la langue de bois arborent un masque de bois. Je ne crois pas au complot comme Freysinger (le libre chanteur) mais à une contagion rhizomique, une aboulie générale, beaucoup de lâcheté, le goût d’une vertu qui sent les relents des sacristies du PC, le mépris classique de ceux qui veulent protéger le peuple pour ne pas désespérer Billancourt et autres billevesées qui fleurent l’angélisme sans ailes et de sexe indéterminé du type l’un est l’autre…Au nom de l’ouverture, ne parlons plus de portes, ni de murs, ni de toits, ni de frontières, ni des livres de gens que nous ne connaissons pas ou n’aimons pas ou qui disent autre chose que ce que nous savons être juste et vrai, ils peuvent être dangereux, ne méritent aucun respect et sont d’ailleurs des fascistes.Encore un mot du jeune Onfray que j’ai pu entendre dans deux émissions de la RSR et une d’Espace 2. C’est dire si l’on a écarté deux autres auteurs différents au profit de ce falsificateur de l’histoire et de la philosophie, amuseur triste et pompeux qui devait sans doute compenser par anticipation les centaines d’heures consacrées au pape. La liberté c’est la variété…Vous pouvez tout dire, on n’a rien entendu, on ne le redira pas, on ne vous invitera plus et vous pouvez être content d’être en vie car on n’est pas des sauvages contrairement à vos amis. Si on n’était pas pour la liberté d’expression, les gens comme vous on les fusillerait ! Ah Orwell, Tocqueville, Spooner, où êtes-vous? P.Y.L. Janine Massard; sous condition d’empathiePour moi, la liberté d’expression n’est pas négociable, il n’est pas question de retourner à l’époque des mises à l’index et autres joyeusetés de ce genre, quand la classe bien-pensante surnommait un vase de nuit un « Zola », parce que la population qui y était représentée la débectait, persuadée sans doute que la littérature était son seul apanage.Je fais partie des écrivains qui s’inspirent de la réalité et pour qui un roman doit montrer des personnages dans leur totalité, qu’ils soient odieux ou angéliques, et dans cet ordre d’idée Dostoïevski nous fournit de beaux exemples : quelles similitudes entre les héros des Démons et ceux des attentats du 11 septembre ! L’écrivain a donc tous les droits dès lors qu’il fait parler une créature, pour autant qu’elle soit cohérente dans sa démarche, et cela, c’est la responsabilité de l’auteur de donner vie à qui est en phase avec les temps qui courent (et changent).Pour développer un personnage, l’auteur doit posséder un pouvoir d’empathie qui permette de l’aimer, même s’il est à la limite de la normalité car comment le rendre crédible et digne d’intérêt au regard des autres sans éprouver soi-même de la compassion ? Pourrais-je laisser parler un cracheur de détestation ? Je ne sais pas même si de curieux personnages s’imposent parfois à moi, et puis, peut-être ai-je un petit côté fleur bleue — ou est-ce un obscur souhait de ne pas mourir pessimiste ? —qui me pousse à croire en un monde où l’humanité serait en train d’évoluer. Les certitudes sont séduisantes, mais où se place-t-on dès lors qu’elles engendrent violence et haine, crime et délation, « nuit et brouillard» ? Ceci dit, en tant que personne persuadée de vivre en démocratie, je refuserai toujours, lorsqu’on me demandera mon avis, d’accorder mon vote à toute personne tenant des propos qui sont des appels au meurtre. J.M.
Janine Massard; sous condition d’empathiePour moi, la liberté d’expression n’est pas négociable, il n’est pas question de retourner à l’époque des mises à l’index et autres joyeusetés de ce genre, quand la classe bien-pensante surnommait un vase de nuit un « Zola », parce que la population qui y était représentée la débectait, persuadée sans doute que la littérature était son seul apanage.Je fais partie des écrivains qui s’inspirent de la réalité et pour qui un roman doit montrer des personnages dans leur totalité, qu’ils soient odieux ou angéliques, et dans cet ordre d’idée Dostoïevski nous fournit de beaux exemples : quelles similitudes entre les héros des Démons et ceux des attentats du 11 septembre ! L’écrivain a donc tous les droits dès lors qu’il fait parler une créature, pour autant qu’elle soit cohérente dans sa démarche, et cela, c’est la responsabilité de l’auteur de donner vie à qui est en phase avec les temps qui courent (et changent).Pour développer un personnage, l’auteur doit posséder un pouvoir d’empathie qui permette de l’aimer, même s’il est à la limite de la normalité car comment le rendre crédible et digne d’intérêt au regard des autres sans éprouver soi-même de la compassion ? Pourrais-je laisser parler un cracheur de détestation ? Je ne sais pas même si de curieux personnages s’imposent parfois à moi, et puis, peut-être ai-je un petit côté fleur bleue — ou est-ce un obscur souhait de ne pas mourir pessimiste ? —qui me pousse à croire en un monde où l’humanité serait en train d’évoluer. Les certitudes sont séduisantes, mais où se place-t-on dès lors qu’elles engendrent violence et haine, crime et délation, « nuit et brouillard» ? Ceci dit, en tant que personne persuadée de vivre en démocratie, je refuserai toujours, lorsqu’on me demandera mon avis, d’accorder mon vote à toute personne tenant des propos qui sont des appels au meurtre. J.M. Jean-Michel Olivier: Les années mollesQuand André Gide, au coeur des années folles, s’aventure à parler, dans Si le grain ne meurt, de son goût prononcé pour les garçons (de préférence mineurs), c’est bien sûr à mots couverts qu’il le fait. La censure officielle sommeille. Mais le regard des lecteurs anonymes le suit depuis longtemps. On peut parler de ces choses-là, en 1927, mais discrètement, en y mettant les formes. La liberté d’expression existe, mais elle a des limites : celles de la bienséance et du bon goût.Pourtant, lorsqu’il publie son livre, Gide sait qu’il va faire scandale et qu’il pousse cette liberté à ses limites.Aujourd’hui, au coeur des années molles, il me semble que les choses ont bien changé. Un auteur peut écrire ce qu’il veut, car, au fond, tout le monde s’en fout. Il peut insulter les hommes politiques, traîner ses contemporains dans la boue et proférer les pires blasphèmes. Au mieux, il recevra une ou deux lettres d’injures (anonymes, comme il se doit). Au pire, il provoquera un haussement d’épaules. Dans les deux cas, son brûlot sera oublié dans les deux mois. Et s’il ne l’était pas, les critiques littéraires veilleraient personnellement à ce qu’il soit enterré.La liberté d’expression, pour un écrivain, aujourd’hui plus que jamais, est intangible et absolue. Elle lui donne droit à la provocation, au blasphème, au cri primai, à l’attentat littéraire — et même à l’erreur, s’il le faut. Car elle ne s’use que si l’on ne s’en sert pas.Et aujourd’hui, me semble-t-il, peu de monde s’en sert.Nous vivons sous la coupe du politiquement correct, c’est-à-dire de la dictature des bons sentiments. Nous sommes tous des anges et nous avons le droit — que dis-je : le devoir — de l’exprimer.Cette croisade morale, qui touche tous les domaines de la société, appauvrit considérablement la littérature, comme les arts en général. Les vraies audaces sont rares. Les auteurs vraiment libres, également. Il faut les chercher loin : Salman Rushdie, Philip Roth, Antonio Tabucchi — et bien sûr quelques autres. Si Gide publiait ses mémoires aujourd’hui, il serait encensé par Le Temps et Le Courrier pour sa défense des groupes minoritaires, et son éloge d’une sexualité alternative. Cela ne veut pas dire qu’il serait beaucoup lu. Bien au contraire. Mais il recevrait certainement le Prix des Droits de l’Homme. J.-M- O.
Jean-Michel Olivier: Les années mollesQuand André Gide, au coeur des années folles, s’aventure à parler, dans Si le grain ne meurt, de son goût prononcé pour les garçons (de préférence mineurs), c’est bien sûr à mots couverts qu’il le fait. La censure officielle sommeille. Mais le regard des lecteurs anonymes le suit depuis longtemps. On peut parler de ces choses-là, en 1927, mais discrètement, en y mettant les formes. La liberté d’expression existe, mais elle a des limites : celles de la bienséance et du bon goût.Pourtant, lorsqu’il publie son livre, Gide sait qu’il va faire scandale et qu’il pousse cette liberté à ses limites.Aujourd’hui, au coeur des années molles, il me semble que les choses ont bien changé. Un auteur peut écrire ce qu’il veut, car, au fond, tout le monde s’en fout. Il peut insulter les hommes politiques, traîner ses contemporains dans la boue et proférer les pires blasphèmes. Au mieux, il recevra une ou deux lettres d’injures (anonymes, comme il se doit). Au pire, il provoquera un haussement d’épaules. Dans les deux cas, son brûlot sera oublié dans les deux mois. Et s’il ne l’était pas, les critiques littéraires veilleraient personnellement à ce qu’il soit enterré.La liberté d’expression, pour un écrivain, aujourd’hui plus que jamais, est intangible et absolue. Elle lui donne droit à la provocation, au blasphème, au cri primai, à l’attentat littéraire — et même à l’erreur, s’il le faut. Car elle ne s’use que si l’on ne s’en sert pas.Et aujourd’hui, me semble-t-il, peu de monde s’en sert.Nous vivons sous la coupe du politiquement correct, c’est-à-dire de la dictature des bons sentiments. Nous sommes tous des anges et nous avons le droit — que dis-je : le devoir — de l’exprimer.Cette croisade morale, qui touche tous les domaines de la société, appauvrit considérablement la littérature, comme les arts en général. Les vraies audaces sont rares. Les auteurs vraiment libres, également. Il faut les chercher loin : Salman Rushdie, Philip Roth, Antonio Tabucchi — et bien sûr quelques autres. Si Gide publiait ses mémoires aujourd’hui, il serait encensé par Le Temps et Le Courrier pour sa défense des groupes minoritaires, et son éloge d’une sexualité alternative. Cela ne veut pas dire qu’il serait beaucoup lu. Bien au contraire. Mais il recevrait certainement le Prix des Droits de l’Homme. J.-M- O. Giovanni Orelli: Un pas de plus et…Il y a aussi un revers à la médaille. J’ai toujours été frappé par cette phrase de Kafka: «Nous autres juifs sommes comme les olives; plus on nous pressure, plus nous donnons le meilleur de nous. » Moi, Suisse, je n’ai pas à déplorer de trop pesantes limitations. Si je me fixe des limites à moi-même, c’est en suivant un conseil de Swift : on ne peut empêcher quelqu’un d’avoir des poisons à la mai-son, mais il faut l’empêcher de les vendre comme remèdes. Mais quand j’ai voulu publier Concertino per rane, (paru en 1990: une traduction française, de Jeanclaude Berger, Concertino pour grenouilles, vient de paraître à La Dogana) ce fut le boycott d’une Fondation «libérale» qui mit son veto à une publication estimée suicidaire, ladite fondation se trouvant dérangée par certains vers par trop «inspirés d’Amnesty». Et cela, pour un écrivain issu d’une minorité telle que la Suisse italienne, pourrait peser… Un pas de plus en avant et l’on retrouve la situation magnifiquement décrite par Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, du pouvoir qu’exerce la majorité en Amérique sur la pensée (voir page 152, coll. Idées Gallimard, 1968). G.O.
Giovanni Orelli: Un pas de plus et…Il y a aussi un revers à la médaille. J’ai toujours été frappé par cette phrase de Kafka: «Nous autres juifs sommes comme les olives; plus on nous pressure, plus nous donnons le meilleur de nous. » Moi, Suisse, je n’ai pas à déplorer de trop pesantes limitations. Si je me fixe des limites à moi-même, c’est en suivant un conseil de Swift : on ne peut empêcher quelqu’un d’avoir des poisons à la mai-son, mais il faut l’empêcher de les vendre comme remèdes. Mais quand j’ai voulu publier Concertino per rane, (paru en 1990: une traduction française, de Jeanclaude Berger, Concertino pour grenouilles, vient de paraître à La Dogana) ce fut le boycott d’une Fondation «libérale» qui mit son veto à une publication estimée suicidaire, ladite fondation se trouvant dérangée par certains vers par trop «inspirés d’Amnesty». Et cela, pour un écrivain issu d’une minorité telle que la Suisse italienne, pourrait peser… Un pas de plus en avant et l’on retrouve la situation magnifiquement décrite par Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, du pouvoir qu’exerce la majorité en Amérique sur la pensée (voir page 152, coll. Idées Gallimard, 1968). G.O. Jean Romain: le tragique de répétition en peu de motsLa question la plus intéressante de la littérature romanesque, celle qui constitue le fait littéraire même est, à mon sens, «Que se passe-t-il ? » Que se passe-t-il dans notre monde ? Qu’arrive-t-il à l’homme ? Les grands romanciers de l’histoire ont posé cette question et ont tous tenté d’y répondre.Aujourd’hui qu’il s’est passé un véritable cataclysme dans le monde, que la destruction systématique de tous les repères s’est effectuée sous la pression de la haine du passé et de la culture, qu’on a organisé le vide le plus total pour que rien ne nous empêche de vivre comme des bulles à la surface des choses, qu’on a mis sur pied une entreprise de purification des âmes et des consciences, et que la fin du monde est derrière nous, nous imaginons mal qu’un écrivain puisse rendre compte par ses écrits de ce qui se passe. On a conspué Renaud Camus, on a craché sur Houellebecq. Quelle horreur, ils ne sont pas comme il faut ! Ils refusent d’applaudir à la marche du monde comme il va. Pas solidaires ! Pas alter-mondialistes ! Pas compatissants ! Ils ne s’associent pas au jamboree tiers-mondiste ! Haro donc, jetons le bobo avec l’eau du bain!Pour faire taire qui refuse de faire la fête et qui l’écrit, qui rechigne à se réjouir de la nouvelle version des « droits humains » (puisqu’il n’y a plus de substance humaine, l’homme est rabaissé à un simple adjectif) et qui le dit, qui n’entend pas associer son phallus à la ronde des joyeux bandeurs et qui les envoie gentiment se faire voir, une néo-censure est née. Il ne s’agit plus d’une censure qui interdit comme c’était le cas à l’époque de l’histoire (vous vous souvenez ? à l’époque où il y avait du temps), mais celle qui intimide, caractéristique de la modernité tardive.Cette censure traite de réactionnaires tous ceux qui tentent soit de limiter soit de décrire les dégâts qu’Homo correctus a infligé au monde, et elle taxe de conservateurs ceux qui contredisent ses antivaleurs à elle. Parce qu’Homo correctus est le champion de la nouvelle vision du monde postmoderne : le relativisme dogmatique.Ce courant est en fait une machine à trier les jugements autorisés et les jugements non autorisés. Il n’est pas autorisé de remettre en cause le dogme de la tolérance ni celui de l’égalitarisme ambiant. En d’autres termes, cette logique aberrante prône :— d’une part, l’affirmation que nul critère objectif ne permet de distinguer les jugements, qui sont ainsi tous légitimes;— d’autre part, l’affirmation d’un argument d’autorité, qui trie dans les jugements ceux qui sont acceptables, c’est-à-dire ceux qui ne heurtent pas l’affirmation dogmatique de l’égalitarisme.Mais que gagne-t-on alors à penser ainsi ? C’est évident : la légitimité d’exister en groupe d’élus autoproclamés dans un monde effondré. Cette censure postmoderne ne fonctionne plus comme l’ancienne censure : en coupant avec des ciseaux. Douce et d’apparence bienveillante, elle met en place un corset d’intimidation par injection massive de moraline. Elle n’avance même pas masquée car elle sait le Bien de son côté : Comment ? Vous pensez qu’il existe une hiérarchie des valeurs ? Bah! Que vous êtes réac!Ne pas entrer dans le prêt-à-penser relativo-dogmatique, c’est ne pas aller dans le sens de l’Histoire, émettre des doutes, résister au monde comme il va, ne rien comprendre à la dictature des sondages d’opinion. Bref, se montrer vieux jeu.Or cette censure n’échappe pas à la croyance que la croyance (en l’égalitarisme) échappe à la censure. Lavenir est déjà là: il tourne en rond. J.R.
Jean Romain: le tragique de répétition en peu de motsLa question la plus intéressante de la littérature romanesque, celle qui constitue le fait littéraire même est, à mon sens, «Que se passe-t-il ? » Que se passe-t-il dans notre monde ? Qu’arrive-t-il à l’homme ? Les grands romanciers de l’histoire ont posé cette question et ont tous tenté d’y répondre.Aujourd’hui qu’il s’est passé un véritable cataclysme dans le monde, que la destruction systématique de tous les repères s’est effectuée sous la pression de la haine du passé et de la culture, qu’on a organisé le vide le plus total pour que rien ne nous empêche de vivre comme des bulles à la surface des choses, qu’on a mis sur pied une entreprise de purification des âmes et des consciences, et que la fin du monde est derrière nous, nous imaginons mal qu’un écrivain puisse rendre compte par ses écrits de ce qui se passe. On a conspué Renaud Camus, on a craché sur Houellebecq. Quelle horreur, ils ne sont pas comme il faut ! Ils refusent d’applaudir à la marche du monde comme il va. Pas solidaires ! Pas alter-mondialistes ! Pas compatissants ! Ils ne s’associent pas au jamboree tiers-mondiste ! Haro donc, jetons le bobo avec l’eau du bain!Pour faire taire qui refuse de faire la fête et qui l’écrit, qui rechigne à se réjouir de la nouvelle version des « droits humains » (puisqu’il n’y a plus de substance humaine, l’homme est rabaissé à un simple adjectif) et qui le dit, qui n’entend pas associer son phallus à la ronde des joyeux bandeurs et qui les envoie gentiment se faire voir, une néo-censure est née. Il ne s’agit plus d’une censure qui interdit comme c’était le cas à l’époque de l’histoire (vous vous souvenez ? à l’époque où il y avait du temps), mais celle qui intimide, caractéristique de la modernité tardive.Cette censure traite de réactionnaires tous ceux qui tentent soit de limiter soit de décrire les dégâts qu’Homo correctus a infligé au monde, et elle taxe de conservateurs ceux qui contredisent ses antivaleurs à elle. Parce qu’Homo correctus est le champion de la nouvelle vision du monde postmoderne : le relativisme dogmatique.Ce courant est en fait une machine à trier les jugements autorisés et les jugements non autorisés. Il n’est pas autorisé de remettre en cause le dogme de la tolérance ni celui de l’égalitarisme ambiant. En d’autres termes, cette logique aberrante prône :— d’une part, l’affirmation que nul critère objectif ne permet de distinguer les jugements, qui sont ainsi tous légitimes;— d’autre part, l’affirmation d’un argument d’autorité, qui trie dans les jugements ceux qui sont acceptables, c’est-à-dire ceux qui ne heurtent pas l’affirmation dogmatique de l’égalitarisme.Mais que gagne-t-on alors à penser ainsi ? C’est évident : la légitimité d’exister en groupe d’élus autoproclamés dans un monde effondré. Cette censure postmoderne ne fonctionne plus comme l’ancienne censure : en coupant avec des ciseaux. Douce et d’apparence bienveillante, elle met en place un corset d’intimidation par injection massive de moraline. Elle n’avance même pas masquée car elle sait le Bien de son côté : Comment ? Vous pensez qu’il existe une hiérarchie des valeurs ? Bah! Que vous êtes réac!Ne pas entrer dans le prêt-à-penser relativo-dogmatique, c’est ne pas aller dans le sens de l’Histoire, émettre des doutes, résister au monde comme il va, ne rien comprendre à la dictature des sondages d’opinion. Bref, se montrer vieux jeu.Or cette censure n’échappe pas à la croyance que la croyance (en l’égalitarisme) échappe à la censure. Lavenir est déjà là: il tourne en rond. J.R. Jacques Roman: répondre ou ne pas répondre?De nos jours, la liberté d’expression fait d’un écrivain inoffensif un bon écrivain… Exit la censure, entrée de la sensure. Pour un peu on regrette-rait le totalitarisme à visage inhumain. Là, pas d’illusion sur la liberté d’expression : interdit ou fusillé ! Reste la liberté de penser.Ce que je peux exprimer en toute liberté est aujourd’hui un produit, une marchandise, une apparence. Quand le sens a pour base la marchandise, il est périssable, si périssable qu’il doit être constamment consommé, renouvelé. Il n’est plus qu’un leurre, le leurre auquel aujourd’hui notre société est prise. Sur la liberté de penser s’exerce l’entraînement d’un mouvement irréversible où notre opposition voit ses effets effacés, diluée dans le consensus.Si j’écris, je veux le dire, c’est pour donner à penser jusqu’au vertige loin de la hargne, de la haine, de l’injure et de l’insulte. Ma liberté est foncière, elle est ma propriété ; limitée elle donnerait de l’assise à la censure, la confiscation de l’activité mentale au profit d’une adhésion servile à l’ordre régnant demeurant la plus sûre garantie du main-tien de cet ordre et, dans la foulée… l’enculture prise pour la culture.Le plus souvent, je n’exprime que ce que je peux et non ce que je veux parce qu’il y aura toujours un incurable retard des mots sur la pensée, un incurable retard de la pensée sur le corps. Du sensé à l’insensé, du pensé à l’impensé, il y a un passage que nous sommes encore quelques-uns à habiter, assez nombreux encore pour que la langue de bois de la haine, la langue de bois du pouvoir et du consensus virent à l’aigre. Nous n’avons que faire d’une illusion de la liberté d’expression. Nous nous risquons pour cela qui grouille de bonheur en l’homme et attend de se lever encore illisible. Peut-être faudrait-il dire: là est notre responsabilité d’expression.Quand aujourd’hui l’apprentissage de la langue passe par le contact avec la mince écume du présent, il m’arrive souvent d’exercer ma liberté d’expression par la pratique du silence, me dégageant de la circonstance pour disparaître et payer de ma vie la foi donnée par le sens de la langue des morts qui encore me dicte l’expression de la liberté.Depuis quelques instants, je me rends compte écrivant ces lignes qu’un tourment, lentement, m’envahit : répondre ou ne pas répondre à votre adresse ? Répondre ou ne pas répondre à cette incitation à exercer ma liberté ?Contre la peur des pièges, responsable au risque de me tendre mon propre piège… J.R.(Le Passe-Muraille, Nos 64-65, Avril 2005)
Jacques Roman: répondre ou ne pas répondre?De nos jours, la liberté d’expression fait d’un écrivain inoffensif un bon écrivain… Exit la censure, entrée de la sensure. Pour un peu on regrette-rait le totalitarisme à visage inhumain. Là, pas d’illusion sur la liberté d’expression : interdit ou fusillé ! Reste la liberté de penser.Ce que je peux exprimer en toute liberté est aujourd’hui un produit, une marchandise, une apparence. Quand le sens a pour base la marchandise, il est périssable, si périssable qu’il doit être constamment consommé, renouvelé. Il n’est plus qu’un leurre, le leurre auquel aujourd’hui notre société est prise. Sur la liberté de penser s’exerce l’entraînement d’un mouvement irréversible où notre opposition voit ses effets effacés, diluée dans le consensus.Si j’écris, je veux le dire, c’est pour donner à penser jusqu’au vertige loin de la hargne, de la haine, de l’injure et de l’insulte. Ma liberté est foncière, elle est ma propriété ; limitée elle donnerait de l’assise à la censure, la confiscation de l’activité mentale au profit d’une adhésion servile à l’ordre régnant demeurant la plus sûre garantie du main-tien de cet ordre et, dans la foulée… l’enculture prise pour la culture.Le plus souvent, je n’exprime que ce que je peux et non ce que je veux parce qu’il y aura toujours un incurable retard des mots sur la pensée, un incurable retard de la pensée sur le corps. Du sensé à l’insensé, du pensé à l’impensé, il y a un passage que nous sommes encore quelques-uns à habiter, assez nombreux encore pour que la langue de bois de la haine, la langue de bois du pouvoir et du consensus virent à l’aigre. Nous n’avons que faire d’une illusion de la liberté d’expression. Nous nous risquons pour cela qui grouille de bonheur en l’homme et attend de se lever encore illisible. Peut-être faudrait-il dire: là est notre responsabilité d’expression.Quand aujourd’hui l’apprentissage de la langue passe par le contact avec la mince écume du présent, il m’arrive souvent d’exercer ma liberté d’expression par la pratique du silence, me dégageant de la circonstance pour disparaître et payer de ma vie la foi donnée par le sens de la langue des morts qui encore me dicte l’expression de la liberté.Depuis quelques instants, je me rends compte écrivant ces lignes qu’un tourment, lentement, m’envahit : répondre ou ne pas répondre à votre adresse ? Répondre ou ne pas répondre à cette incitation à exercer ma liberté ?Contre la peur des pièges, responsable au risque de me tendre mon propre piège… J.R.(Le Passe-Muraille, Nos 64-65, Avril 2005) -
Par les prés et les villes
(Pour L. la nuit venue)Le silence n'a pas duré:nous nous parlons la nuit:dès que je me suis endormi,elle est là dans le préle grand pré d'herbe sous la luneoù nous restons pieds nusseulement à nous écouter...La nuit, l'autre vie continue,l'air a fraîchi la-bas,tous deux revenant sur nos pasembrassés comme au souvenir,nous sourions à la lumièrede la ville endormiede l'autre coté des rivièresoù des gens vivants vont mourir...Peinture: Félix Vallotton -
Le combat de Salman Rushdie est d’un Quichotte voltairien
 Dans un premier récit détaillé, à glacer le sang, de la tentative d’assassinat qu’il a subie le 12 août 2022, puis au fil d’une remémoration de son retour à la vie, secondé par les siens (dont l’admirable Eliza, son épouse), et plus largement ensuite dans la réflexion que lui inspire un acte apparemment dément quoique soumis à la logique implacable des fous de Dieu islamistes, Salman Rushdie, avec Le couteau, laisse entrevoir, avec la possibilité d’une seconde chance, une espérance vitale…27 secondes. C’est à peu près le temps qu’il vous faut, précise Salman Rushdie, pour dire le Notre Père ou réciter un sonnet de Shakespeare. Et l’écrivain en sait quelque chose et y a même perdu un œil, vu que c’est exactement 27 secondes qu’a duré l’attaque sauvage qu’il a subie le 12 novembre 2022 à 10h.45 du matin sur la scène de l’amphithéâtre de Chautauqua, 27 secondes qui auraient dû lui être fatales après la quinzaine de coups de couteau qui lui lacérèrent le visage, le torse et les membres, jusqu’au moment où son agresseur fut maîtrisé et menotté par un policier passant par là en l’absence, par ailleurs, de tout dispositif de sécurité.27 secondes chronométrées : la scène a donc été filmée par tel ou telle des plus de mille spectateurs présents pour entendre la conférence de l’auteur des Versets sataniques – entre vingt autres livres -, censé parler des villes-refuges pouvant accueillir aux States, des écrivains menacés dans leur propre pays, initiative à laquelle Rushdie avait participé entre autres nombreuses activités solidaires, et voilà que le refuge présumé était devenu le piège tendu par un forcené de 24 ans qui avouerait plus tard qu’il n’avait jamais lu que deux ou trois pages des écrits de ce mécréant et vu deux ou trois vidéos sur Youtube consacrées au même « hypocrite », comme il qualifierait Salman Rushdie, décidément pas « une bonne personne », donc à supprimer au nom du Dieu superbon…Comme dans un roman de RushdieEntre les 27 secondes qu’a duré l’exécution ratée et les trente-trois ans de tribulations vécues par Salman Rushdie depuis sa condamnation à mort, en février 1989, par le Grand Inquisiteur chiite Rouhollah Moussavi Khomeini, un abîme fantastique s’est creusé à la barbe posthume de l’ayatollah défunt (il est mort en juin 1989), dans lequel un écrivain aux fictions extravgantes s’est vu rattrapé par « la réalité ».Aux dernières nouvelles, une récompense de deux millions de dollars reste offerte à celui qui, enfin, fera la peau à l’infâme mécréant – mais cet âne d’A. (pseudo vengeur du Libanais Hadi Matar dans Le couteau) n’en verra pas la couleur, alors même qu’il passe pour un héros aux yeux des islamistes radicaux. Au demeurant, son procès a été ajourné au motif que sa défense exigeait d’accéder au livre paru, alors même que l’homme au couteau continue de plaider non coupable et n’a pas émis le moindre signe de repentir envers sa victime « hélas » survivante…D’ailleurs le terme de « victime » se discute aux yeux de certains, et Le couteau illustre, dans un mélange de juste colère et de jubilation sarcastique, quel révélateur de la bassesse humaine aura été « l’affaire Rushdie », où nombre de politiciens – de Jimmy Carter à Boris Johnson, entre autres) et de chers confrères en littérature, ou de journalistes mal intentionnés, n’ont cessé de pointer la caractère « illisible » de ses livres et son opportunisme, son besoin d’être remarqué, sa frivolité de viveur après son installation aux Etats-Unis, bref l’exagération monstrueusement coûteuse qu’aura représenté sa protection alors qu’il était supposé ne plus rien risquer – à cela près que les services secrets britanniques ont quand même déjoué six complots visant à la liquider !Ce que ses détracteurs « éclairés » n’avaient pas vu, guère plus en somme que ses ennemis aveuglés par le fanatisme religieux, c’est la prodigieuse capacité d’amour que recèle l’œuvre littéraire de Salman Rushdie, déployant, en sa foison baroque, les multiples aspects de la vie, et les ressources de bonté et de beauté de celle-ci qui s’opposent à ses penchants mortifères.Comme nous tous, et comme le Candide de Voltaire, le cher Salman, Indien de naissance, métèque de sa Majesté après avoir fui les colères alcoolique de son paternel, et désormais citoyen américain, n’aspire à rien d’autre qu’à la paix et à la liberté, au bonheur consistant à « cultiver son jardin » au milieu des siens, à parler avec ses amis (nous tous ) des livres qu’il lit et à en ajouter puisque tel est son plus vif plaisir. Cela étant, dans une version moderne du Quichotte de Cervantès, l’auteur des Versets sataniques n’en a pas moins continué de se battre contre « l’infâme » (encore ce Voltaire !) qui prétend détenir la seule vérité, et prône la mise à mort de tout mécréant. Or l’Artiste, chez lui, a toujours précédé le polémiste et, souvent, brouillé les cartes.
Dans un premier récit détaillé, à glacer le sang, de la tentative d’assassinat qu’il a subie le 12 août 2022, puis au fil d’une remémoration de son retour à la vie, secondé par les siens (dont l’admirable Eliza, son épouse), et plus largement ensuite dans la réflexion que lui inspire un acte apparemment dément quoique soumis à la logique implacable des fous de Dieu islamistes, Salman Rushdie, avec Le couteau, laisse entrevoir, avec la possibilité d’une seconde chance, une espérance vitale…27 secondes. C’est à peu près le temps qu’il vous faut, précise Salman Rushdie, pour dire le Notre Père ou réciter un sonnet de Shakespeare. Et l’écrivain en sait quelque chose et y a même perdu un œil, vu que c’est exactement 27 secondes qu’a duré l’attaque sauvage qu’il a subie le 12 novembre 2022 à 10h.45 du matin sur la scène de l’amphithéâtre de Chautauqua, 27 secondes qui auraient dû lui être fatales après la quinzaine de coups de couteau qui lui lacérèrent le visage, le torse et les membres, jusqu’au moment où son agresseur fut maîtrisé et menotté par un policier passant par là en l’absence, par ailleurs, de tout dispositif de sécurité.27 secondes chronométrées : la scène a donc été filmée par tel ou telle des plus de mille spectateurs présents pour entendre la conférence de l’auteur des Versets sataniques – entre vingt autres livres -, censé parler des villes-refuges pouvant accueillir aux States, des écrivains menacés dans leur propre pays, initiative à laquelle Rushdie avait participé entre autres nombreuses activités solidaires, et voilà que le refuge présumé était devenu le piège tendu par un forcené de 24 ans qui avouerait plus tard qu’il n’avait jamais lu que deux ou trois pages des écrits de ce mécréant et vu deux ou trois vidéos sur Youtube consacrées au même « hypocrite », comme il qualifierait Salman Rushdie, décidément pas « une bonne personne », donc à supprimer au nom du Dieu superbon…Comme dans un roman de RushdieEntre les 27 secondes qu’a duré l’exécution ratée et les trente-trois ans de tribulations vécues par Salman Rushdie depuis sa condamnation à mort, en février 1989, par le Grand Inquisiteur chiite Rouhollah Moussavi Khomeini, un abîme fantastique s’est creusé à la barbe posthume de l’ayatollah défunt (il est mort en juin 1989), dans lequel un écrivain aux fictions extravgantes s’est vu rattrapé par « la réalité ».Aux dernières nouvelles, une récompense de deux millions de dollars reste offerte à celui qui, enfin, fera la peau à l’infâme mécréant – mais cet âne d’A. (pseudo vengeur du Libanais Hadi Matar dans Le couteau) n’en verra pas la couleur, alors même qu’il passe pour un héros aux yeux des islamistes radicaux. Au demeurant, son procès a été ajourné au motif que sa défense exigeait d’accéder au livre paru, alors même que l’homme au couteau continue de plaider non coupable et n’a pas émis le moindre signe de repentir envers sa victime « hélas » survivante…D’ailleurs le terme de « victime » se discute aux yeux de certains, et Le couteau illustre, dans un mélange de juste colère et de jubilation sarcastique, quel révélateur de la bassesse humaine aura été « l’affaire Rushdie », où nombre de politiciens – de Jimmy Carter à Boris Johnson, entre autres) et de chers confrères en littérature, ou de journalistes mal intentionnés, n’ont cessé de pointer la caractère « illisible » de ses livres et son opportunisme, son besoin d’être remarqué, sa frivolité de viveur après son installation aux Etats-Unis, bref l’exagération monstrueusement coûteuse qu’aura représenté sa protection alors qu’il était supposé ne plus rien risquer – à cela près que les services secrets britanniques ont quand même déjoué six complots visant à la liquider !Ce que ses détracteurs « éclairés » n’avaient pas vu, guère plus en somme que ses ennemis aveuglés par le fanatisme religieux, c’est la prodigieuse capacité d’amour que recèle l’œuvre littéraire de Salman Rushdie, déployant, en sa foison baroque, les multiples aspects de la vie, et les ressources de bonté et de beauté de celle-ci qui s’opposent à ses penchants mortifères.Comme nous tous, et comme le Candide de Voltaire, le cher Salman, Indien de naissance, métèque de sa Majesté après avoir fui les colères alcoolique de son paternel, et désormais citoyen américain, n’aspire à rien d’autre qu’à la paix et à la liberté, au bonheur consistant à « cultiver son jardin » au milieu des siens, à parler avec ses amis (nous tous ) des livres qu’il lit et à en ajouter puisque tel est son plus vif plaisir. Cela étant, dans une version moderne du Quichotte de Cervantès, l’auteur des Versets sataniques n’en a pas moins continué de se battre contre « l’infâme » (encore ce Voltaire !) qui prétend détenir la seule vérité, et prône la mise à mort de tout mécréant. Or l’Artiste, chez lui, a toujours précédé le polémiste et, souvent, brouillé les cartes.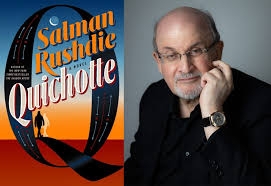 Et voici qu’on le poignarde, comme on a bastonné Voltaire. Et voilà qu’il s’en sort par miracle et que d’aucuns invoquent une protection céleste. Alors lui, intraitable, d’opposer au couteau un livre au titre impliquant le double usage de l’instrument – couteau à pain des familles, couteau suisse des picnics sympas, couteau à cran d’arrêt du voyou, poignard mortel - comme le mot peut détruire ou sauver…« Pendant un demi-siècle, écrit Rushdie à propos de la supposée « force supérieure » qui l’aurait protégé, moi qui croyais en la science et la raison, qui n’avais pas de temps à consacrer aux dieux et aux déesses, j’avais écrit des livres dans lesquels les lois de la science étaient souvent subverties, dont des personnages étaient télépathes, se transformaient en bêtes meurtrières quand venait la nuit ou bien tombaient d’un avion d’une altitude de près de dix mille mètres, survivaient et se voyaient pousser des cornes, des livres dans lesquels un homme vieillissait deux fois plus vite que la normale, où un autre homme se mettait à flotter un centimètre et demi au-dessus de la surface de la terre, où une femme vivait jusqu’à l’âge de deux cent quarante-sept ans. Qu’ avais-je donc fabriqué pendant cinquante ans ? Je voulais dire : je pense que l’art est un rêve éveillé. (…) Je ne crois pas aux miracles mais ma survie est miraculeuse. Bon, d’accord, qu’il en soit ainsi. La réalité décrite dans mes livres, oh appelez-la réalisme magique si vous voulez, est devenue la véritable réalité dans laquelle je vis ». Et comme c’est vrai pour Le couteau !Bienvenue au club des poignardés…Ce qu’on apprend en lisant ce « livre de la vie » tenant à la fois d’exorcisme et de réponse (fermement) pacifique aux violents, c’est qu’avant Salman Rushdie, deux grands écrivains au moins ont subi le couteau et y ont survécu : à savoir le Nobel de littérature égyptien Naguib Mahfouz, coupable d’avoir défendu… un certain Rushdie ( !) dans un ouvrage où une centaine d’écrivains et d’intellectuels avaient pris son parti contre le terrorisme religieux, et poignardé en pleine rue du Caire à l’âge de 82 ans, en octobre 1994 ; et Samuel Beckett, le 7 janvier 1938, qui subit le même sort après avoir refusé de donner de l’argent à un voyou le menaçant dans une rue de Paris - ledit agresseur se prénommant Prudent. Or Beckett tint, au procès de celui-ci, à faire face à son agresseur et à lui demander la raison de son agression, Prudent lui répondant, le neuz baissé, qu’il ne savait pas, et qu’il s’en excusait.Or cette confrontation, que Rushdie appelle « le moment Beckett », et qu’Eliza lui déconseille vivement, le romancier l’imagine de toutes pièces dans un chapitre majeur du Couteau où il dialogue avec A. dont l’essentiel de l’argumentation tient en un mot qui plairait à Michel Houellebecq : soumission. Soumission à Dieu, soumission à l’unique vérité proclamée et ressassé par l’imam Youtubi. Soumission et mort à l’insoumis !
Et voici qu’on le poignarde, comme on a bastonné Voltaire. Et voilà qu’il s’en sort par miracle et que d’aucuns invoquent une protection céleste. Alors lui, intraitable, d’opposer au couteau un livre au titre impliquant le double usage de l’instrument – couteau à pain des familles, couteau suisse des picnics sympas, couteau à cran d’arrêt du voyou, poignard mortel - comme le mot peut détruire ou sauver…« Pendant un demi-siècle, écrit Rushdie à propos de la supposée « force supérieure » qui l’aurait protégé, moi qui croyais en la science et la raison, qui n’avais pas de temps à consacrer aux dieux et aux déesses, j’avais écrit des livres dans lesquels les lois de la science étaient souvent subverties, dont des personnages étaient télépathes, se transformaient en bêtes meurtrières quand venait la nuit ou bien tombaient d’un avion d’une altitude de près de dix mille mètres, survivaient et se voyaient pousser des cornes, des livres dans lesquels un homme vieillissait deux fois plus vite que la normale, où un autre homme se mettait à flotter un centimètre et demi au-dessus de la surface de la terre, où une femme vivait jusqu’à l’âge de deux cent quarante-sept ans. Qu’ avais-je donc fabriqué pendant cinquante ans ? Je voulais dire : je pense que l’art est un rêve éveillé. (…) Je ne crois pas aux miracles mais ma survie est miraculeuse. Bon, d’accord, qu’il en soit ainsi. La réalité décrite dans mes livres, oh appelez-la réalisme magique si vous voulez, est devenue la véritable réalité dans laquelle je vis ». Et comme c’est vrai pour Le couteau !Bienvenue au club des poignardés…Ce qu’on apprend en lisant ce « livre de la vie » tenant à la fois d’exorcisme et de réponse (fermement) pacifique aux violents, c’est qu’avant Salman Rushdie, deux grands écrivains au moins ont subi le couteau et y ont survécu : à savoir le Nobel de littérature égyptien Naguib Mahfouz, coupable d’avoir défendu… un certain Rushdie ( !) dans un ouvrage où une centaine d’écrivains et d’intellectuels avaient pris son parti contre le terrorisme religieux, et poignardé en pleine rue du Caire à l’âge de 82 ans, en octobre 1994 ; et Samuel Beckett, le 7 janvier 1938, qui subit le même sort après avoir refusé de donner de l’argent à un voyou le menaçant dans une rue de Paris - ledit agresseur se prénommant Prudent. Or Beckett tint, au procès de celui-ci, à faire face à son agresseur et à lui demander la raison de son agression, Prudent lui répondant, le neuz baissé, qu’il ne savait pas, et qu’il s’en excusait.Or cette confrontation, que Rushdie appelle « le moment Beckett », et qu’Eliza lui déconseille vivement, le romancier l’imagine de toutes pièces dans un chapitre majeur du Couteau où il dialogue avec A. dont l’essentiel de l’argumentation tient en un mot qui plairait à Michel Houellebecq : soumission. Soumission à Dieu, soumission à l’unique vérité proclamée et ressassé par l’imam Youtubi. Soumission et mort à l’insoumis ! L’amour plus fort (si, si) que la mort…Si son meurtrier raté lui lance qu’il est haï par deux milliards de personnes, Salman Rushdie lui répond qu’il a toujours cru, pour sa part, en la force de l’amour, et c’est la force principale du Couteau, soeurs et frères : c’est l’amour.L’amour d’une femme, d’abord, merveilleuse de présebce angoissée. Laquelle Eliza est accueillie par la famille de Salman, en 2017, avec ce mot plein de tendresse : « enfin ! ». L’amour de ses fils chéris, de sa soeur et des enfants de celle-ci. L’amour de ses amis, à commencer par son agent, dit le Chacal, Andrew Wylie qui l’a défendu mieux que personne à l’époque de sa condamnation à mort. L’amour-amitié de ses amis écrivains, dans un biotope où règnent souvent jalousie et défiance. Et c’est Martin Amis en train de mourir du cancer, et qui lui adresse un message si fraternel. C’est Philip Roth et son propre crabe. C’est Ian Mc Ewan. Ce sont les innombrables messages qui font suite à l’attentat, où Biden et Macron , mais aussi Boris Johnson faisant amende honorable, y vont de leurs hommages à coté de tant d'anonymes émouvants.L’amour qui lui vient, dit-il, lui l’athée, de la Bible autant que de sa culture indo-musulmane. L’amour de la littérature. L’amour de son corps qui a décidé, avec lui voire malgré lui, de vivre. Sait-on assez quelle merveille est un corps ?Tout cela qui fait ressentir, par contraste, la solitude de son agresseur soumis à la haine des imams vociférant sur Youtube. Mais Salman ne va pas jusqu’à absoudre le malheureux. La seule chose qu’on puisse souhaiter à celui-ci, c’est de lire Le Couteau dans sa triste prison et, comme Prudent à Beckett, d’implorer le pardon de son frère humain…Salman Rushdie, Le couteau. Traduit de l’anglais par Gérard Meudal Gallimard, collection « Du monde entier », 268p. 2024.À lire aussi : Quichotte, de Salman Rushdie, aux édition Actes Sud. 2020.
L’amour plus fort (si, si) que la mort…Si son meurtrier raté lui lance qu’il est haï par deux milliards de personnes, Salman Rushdie lui répond qu’il a toujours cru, pour sa part, en la force de l’amour, et c’est la force principale du Couteau, soeurs et frères : c’est l’amour.L’amour d’une femme, d’abord, merveilleuse de présebce angoissée. Laquelle Eliza est accueillie par la famille de Salman, en 2017, avec ce mot plein de tendresse : « enfin ! ». L’amour de ses fils chéris, de sa soeur et des enfants de celle-ci. L’amour de ses amis, à commencer par son agent, dit le Chacal, Andrew Wylie qui l’a défendu mieux que personne à l’époque de sa condamnation à mort. L’amour-amitié de ses amis écrivains, dans un biotope où règnent souvent jalousie et défiance. Et c’est Martin Amis en train de mourir du cancer, et qui lui adresse un message si fraternel. C’est Philip Roth et son propre crabe. C’est Ian Mc Ewan. Ce sont les innombrables messages qui font suite à l’attentat, où Biden et Macron , mais aussi Boris Johnson faisant amende honorable, y vont de leurs hommages à coté de tant d'anonymes émouvants.L’amour qui lui vient, dit-il, lui l’athée, de la Bible autant que de sa culture indo-musulmane. L’amour de la littérature. L’amour de son corps qui a décidé, avec lui voire malgré lui, de vivre. Sait-on assez quelle merveille est un corps ?Tout cela qui fait ressentir, par contraste, la solitude de son agresseur soumis à la haine des imams vociférant sur Youtube. Mais Salman ne va pas jusqu’à absoudre le malheureux. La seule chose qu’on puisse souhaiter à celui-ci, c’est de lire Le Couteau dans sa triste prison et, comme Prudent à Beckett, d’implorer le pardon de son frère humain…Salman Rushdie, Le couteau. Traduit de l’anglais par Gérard Meudal Gallimard, collection « Du monde entier », 268p. 2024.À lire aussi : Quichotte, de Salman Rushdie, aux édition Actes Sud. 2020. -
À la rencontre de Rimbaud par divers sentiers de traverse...

A l’opposé de toutes les formes de récupération du mythe, Sylvain Tesson et Frédéric Pajak, personnellement très impliqués, mais sans narcissisme pour autant, retracent, chacun, des parcours marqués par une commune intelligence du cœur et comme une prescience de ce qu’est vraiment la poésie. Deux livres qu’on peut dire «inspirés» par leur sujet, pour passer d’un millésime à l’autre…
La poésie, ou ce qu’on désigne par ce terme à la fois précis et vague, englobe aujourd’hui tout et son contraire — et particulièrement dans la culture à dominante française —, à savoir l’émotion esthétique primesautière la plus largement partagée (poésie de l’aube, poésie de l’enfance, poésie des couchers de soleil, etc.), parfois limitée à des clichés fleurant le kitsch, ou la manifestation la plus élaborée, épurée et raffinée, du langage humain à sa pointe sensible affleurant l’indicible, aboutissant à des excès de sophistication qu’illustrent certains «poéticiens» et autres «poéticiennes» actuels qui eussent amusé Rabelais autant que Molière, et qu’un certain Arthur Rimbaud, malotru plus que ceux-ci, eût simplement conchiés comme il le fit, de son vivant, des bimbelotiers parnassiens, entre autres confrères plus ou moins éminents auxquels échappaient tout juste Hugo et Baudelaire, ou Verlaine son amant…
Or Rimbaud lui-même, en son angélique et calamiteuse dualité, et par delà le cliché démago de l’ado révolté et les interprétations talmudiques de ses poèmes, illustre bel et bien cette réalité schizophrénique de ce qu’on dit la poésie, que ceux qui l’aiment savent tout ailleurs…
C’est cela: la poésie est ailleurs, et notamment celle-ci: «Lire Rimbaud vous condamne à partir un jour sur les chemins», écrit Sylvain Tesson au début d’un périple amorcé «sur le terrain», dans la foulée du jeune fugueur ralliant Bruxelles depuis Charleville. Signe du temps: le grand voyageur qu’est Tesson doit passer un test sanitaire avant de se mettre en route, remarquant que la «mise en batterie de l’humanité» est en passe de s’accomplir dans le monde sous le régime de la «congélation techno-sanitaire».
A sa première étape belge, il relève incidemment une enseigne qui signale la récupération locale de l’idole: «Rimbaud Tech, incubateur d’entreprises»… Puis c’est l’effigie du poète sur les murs de tel Hôtel de Paris ou de tel bistro. Le ton est donné: très attentif et non moins informé, chaleureux et souvent caustique pour couper court à toute jobardise.
Et quant à l’ailleurs, va-t-on donner dans le tourisme culturel? Absolument pas. Car ledit ailleurs sera, surtout, celui de la poésie, la présence de Rimbaud selon Tesson étant à chercher essentiellement dans ses poèmes. Or les citations de ceux-ci, brèves mais toujours parfaitement choisies (et reproduites en fine typographie bleue) seront comme les cailloux d’un Poucet fort avisé, les mains aux poches et la (dé)marche vive. En allons-nous!
La crâne et tragique marche au réel
Sylvain Tesson n’y va pas par les quatre chemins de la psychanalyse sourcilleuse, de la sociologie à pieds plats, de l’obsessionnelle politisation de tout et n’importe quoi, ni de l’explication explicative de la textualité du texte. C’est un lecteur de grande erre, qui sait le poids des mots et ne s’en paie pas à bon marché mais nous en régale quand il y a de quoi — et l’affreux Arthur est un geyser momentané qui crache des étoiles entre ses glaviots.
Je dis bien: l’affreux Arthur, génial et qui le sait, avec un ange et un serpent en lui qui se mordent et s’emmêlent les ailes et les couilles. Entre seize et vingt ans, l’adolescent à dégaine dangereusement angélique, qui s’en défend par d’immondes grossièretés de défense, est habité par un génie qui ne visite pas tout le monde, au dam de ceux qui prétendent que chaque môme est un Rimbe qui s’ignore — et ses mots le prouvent.
Pas besoin d’avoir un diplôme pour voir que Le Bateau ivre est, dixit Tesson, l’«un des plus mystérieux poèmes» qui soient, jeté sur le papier par un enfant à grosses pognes et zyeux bleu glacier dans la brume. Or l'Arthur n'a jamais vu pouic d'océan...
D’où vient le môme, le père absent, le frère aîné gommé de la photo de groupe, la «mother» à la fois «bouche d’ombre» et giron vers quoi retourner quand ça craint vraiment trop — Tesson l’aime bien quand même, la paysanne aux abois —, le Gavroche du temps de la Commune à Paname chez les zutiques, le fugueur de quinze ans et le fuyard de la vingtaine tardive aux ailes noircies qui voit son salut dans les choses et s’ennuie à crever en Arabie: tout cela, que chacune et chacun sait déjà plus ou moins, notre Sylvain marcheur le rappelle en insistant (exemple à l’appui «sur le terrain») sur l’importance de la marche, justement, éclairée par le génie et non moins contrariée par ce diabolique semeur de poux.
Quant au génie, on «fait avec»…
Qu’on menace Rimbaud du Panthéon ou qu’on en fasse, ce qui ne vaut guère mieux en somme, un «icône gay»; que Claudel le théophore le messianise à l’instar d’Isabelle la sœur cadette très catholique qui eut la charité dernière de l’assister dans son très dégoûtant martyre de Marseille: peu importe, n’est-ce pas? si la joie jaillie de la tragédie de vivre demeure et luit, comme disait l’autre, tel un brin d’espoir dans l’étable, une paille d’or dans le tout-venant, une fleur d’innocence sur le fumier dégôutant.
Citons alors: «Je suis le piéton de la grand’roue par les bois nains; la rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive d’or du couchant». Ou surgis de l’enfance rêveuse dans son trou d'ennui: «J’espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries enfin». Ou se penchant sur Ophélie pour toujours endormie: «Les nénuphars froissés soupirent autour d’elle /Elle éveille parfois, dans un aune qui dort, /Quelque nid, d’où s’échappe un petit frisson d’aile:/ - un chant mystérieux tombe des astres d’or»…
Le génie poétique? Sylvain Tesson en propose, au passage, une esquisse de définition: «savoir avant de voir, connaître avant de goûter, entendre avant d’avoir écouté», etc. Compte tenu du fait, cela va sans dire, que le génie multiforme virevolte, comme son homonyme persan des Mille et une nuits, entre indéfini et défi à l’infini…
Et l’envers du génie, la part d’ombre, voire d’abjection? Sylvain Tesson préfère ne pas trop s’y attarder, sans édulcorer du tout la période plombée par les «hommeries» de la fameuse saison en enfer; et ce qu’il dit de la longue marche finale du Rimbaud revenu à la «case réel», marqué au coin du sens commun et de la compassion non sentimentale, restitue parfaitement la dimension tragique de cette destinée.
«Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées»…
Nés à un siècle de distance, Arthur Rimbaud et Frédéric Pajak, entre autres points communs à détailler un soir autour d’un bock virtuel, ont partagé le goût et l’art (une façon d’art de vivre) de ce qu’on appelle la bohème, mais là encore gare au cliché recyclé: ces deux-là seraient les premiers à moquer le «bourgeois bohème» en sa fade «coolitude»...
Le bon vieux cliché de la bohème parisienne artiste et littéraire, en revanche, comme Puccini l’a chantée, de la bamboche des artistes sous les toits à la mort de Mimi la beauté tubarde, convient parfaitement, pour le décor stylisé, à ce qu’auront vécu le jeune Arthur à l’aube de la Commune, ou Frédéric au temps des barricades de mai 68.
Poésie tocarde que La Bohème chantée par Aznavour ou Léo Ferré dans Quartier latin ou Salut beatnik ? Pas plus que l’imagerie liée aux «vilains bonshommes» auxquels s’agrégea Rimbaud. Mais la réalité que stylise, idéalise ou masque le cliché est la seule chose intéressante. Et si la vraie poésie échappe aux clichés en sublimant «le réel» par la musique et les images ou le «sens augmenté», le poète reste un de nos «frères humains» jusques et y compris dans sa pire dèche, qu’on peut se passer d’exalter.
Cent ans après Rimbaud, Pajak a (re)vécu la révolte dionysiaque de celui-ci en phase avec une génération, et c’est en somme cela qu’il raconte, avec autant de fortes intuitions que de savoir acquis d’expérience, en entremêlant, dans le roman-photo de sa propre histoire, les éléments biographiques reliant trois poètes dont chacun fut «bohème» à sa façon, à savoir Isidore Ducasse, statufié sous le nom de Lautréamont, Germain Nouveau, figure moins connue mais aux foucades et aux folies et repentirs significatifs, dont la quête existentielle et spirituelle tourmentée, parallèle à la marche inexorable de Rimbaud vers son propre «désert», est ressaisie avec autant d’émotion.
Frédéric Pajak, pas plus que Sylvain Tesson, n’est ce qu’on dirait un «spécialiste», au sens technique actuel. Tous deux, cependant, en amateurs (au sens de ceux qui aiment) plus qu’éclairés, ont le mérite de nous ramener à la Poésie dans ce qu’elle de plus pur, en illustrant le «miracle Rimbaud», équivalent en plus foudroyant du «miracle Verlaine», sans jamais découpler ce qui surgit par le Verbe de ce qui se vit par la chair.
Tous deux, avec ce qu’on pourrait dire le sens du «milieu juste» cher à Montaigne, évitent autant la sacralisation que l’acclimatation du poète, lequel s’efface en somme, transmetteur, devant la poésie elle-même: «La main d’un maître anime la clavecin des prés; on joue aux cartes au fond de l’étang, miroir évocateur des reines et des mignonnes, on a les saintes, les voiles, et les fils d’harmonie, et les chromatismes légendaires, sur le couchant»…

«Un été avec Rimbaud», Sylvain Tesson, Equateurs/France Inter, 217 pages.

«J’irai dans les sentiers», Frédéric Pajak, Editions Noir sur Blanc, 293 pages.
-
Ainsi soit-il
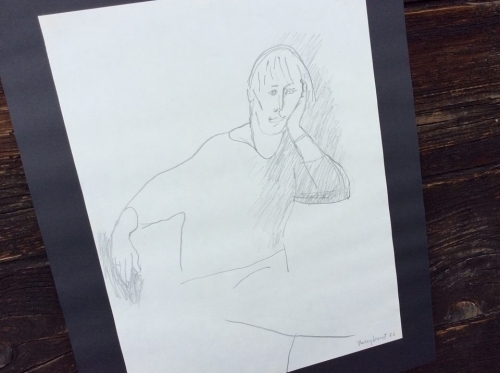 (Le Temps accordé. Lectures du monde, 2021)À La Maison bleue, ce 14 décembre 2021. - Ma bonne amie est mourante, à la fois avec nous et déjà partie, comme notre mère l’a été pendant son long coma. Les visites des anges des soins palliatifs se suivent, je les vois passer comme en rêve, tout ce qui nous arrive, une heure après l’autre (elle disait en mai dernier : avançons désormais un pas après l’autre), me semble irréel et impensable à dire ou écrire, cela se passe comme hors de notre portée et de toute volonté - plus réel tu meurs suis-je tenté de dire mais je m’en abstiens -, c’est à la fois atrocement « comme ça », tout est fait « pour son confort » et la voici au mur des fusillés me dis-je en me reprochant cette formule qu’elle trouverait d’un pathos déplacé, plus juste serait le simple constat : que les heures passent et qu’elle trépasse.Un léger accroc, avec Sophie, sûrement lié à notre état de fatigue et d’émotion, nous a opposés dans une discussion sur le « compostage » des défunts, auquel je suis viscéralement réfractaire et qu’elle défendait, puis nous avons pleuré et sommes tombés dans les bras l’un de l’autre…Vers onze heures ce soir, après le départ de la belle soignante au prénom de Maeva qui lui avait administré une piqûre de morphine, je me trouvais dans la chambre voisine quand Sophie m’a appelé sur un ton alarmé, j’ai regardé ma montre et me suis dit que c’était arrivé, et c’était en effet arrivé : ma bonne amie, ma chérie avait cessé de respirer, et la suite de mes gestes et de mes pensées s’est enchaînée comme ceux d’un automate, j’ai donc appelé la centrale des soins qui m’a promis de nous envoyer quelqu’un, et ce quelqu’un nous a rappelés et a parlé à Sophie « comme à sa secrétaire », puis ce quelqu’un du genre quadra barbu visiblement contrarié par le timing de la prestation s’est pointé et, nous saluant à peine, a demandé où se trouvait « la personne décédée », alors que j’attendais quelques mots d’éventuelle compassion voire de condoléance, mais rien, aussi, me retenant de le prier de foutre le camp, c’est moi qui me suis éclipsé pendant qu’il expliquait à notre fille aînée qu’il lui fallait récupérer ses instruments dans sa voiture afin de retirer le pacemaker du corps dûment identifié, etc.DE L’EFFICACITÉ. - Tel préposé de nuit à la fonction du constat, se montra ce soir-là d’une impassibilité glaciale tranchant dans la mare de pleurs au point que la défunte ou le défunt eussent été tentés de pleurer de concert avec les survivantes et les survivants – mais le constat fut le constat…DE LA FORMALITÉ. – Il n’y a pas, au demeurant, à se formaliser du fait que le professionnel s’exécute selon les normes, ou alors ce serait céder à l’émotionnel informe, voire au pulsionnel difforme…DE LA GESTION DES AFFECTS. – Dès le constat protocolé vous serez pris en charge par les diverses structures professionnelles à disposition, pour autant que vous le souhaitiez, vu que la gestion du deuil reste à option, mais n’hésitez pas à vous sentir libres d’être encadrés…DU PLUS TENDRE AVEU. - Tu m’as manqué dès que j’ai su que je m’en irais, lui avait-elle dit…SES DERNIERS MOTS. - On n’est pas triste : on est abattu, on est mort de fatigue tout en constatant qu’on respire encore. Donc je me suis réveillé ce matin à côté d’une morte enveloppée dans le linceul de son drap de vivante, je me suis rappelé ses derniers mots à Sophie : « À présent je voudrais dormir », et c’est notre fille aînée aussi qui a trouvé l’intitulé de nos adieux prochains : Cérémonie de lumière… (À La Maison bleue, ce mercredi 15 décembre 2021)QUE DES DETAILS. – Le plus ancien souvenir qui me revienne, à propos des objets restant là après la mort de quelqu’un, date de l’école primaire, dans la classe de Mademoiselle Chammartin, qui nous apprit un matin que notre camarade Toupie ne reviendrait pas, et je me souviens qu’à cet instant les objets qui se trouvaient sur son pupitre me sont apparus avec une sorte de présence accrue, et j’ai pensé que c’était triste et que c’est ça que me disaient les objets de Toupie, bien rangés comme il les avait laissés, toujours très ordré, avec ce quelque chose d’un peu terne qu’il avait lui aussi, de modestes objets peu voyants, un plumier gris et une gomme, des crayons bien taillés et un taille-crayons qui maintenant avaient un air abandonné ; jamais je n’avais ressenti cela, ce qu’on nous avait dit de la maladie de Toupie, comme quoi son sang avait trop de globules blancs, ne m’avait pas vraiment touché, tellement notre camarade était pâle, mais à présent c’était autre chose, et beaucoup plus réel à mes yeux au point que je m’en souvient tant d‘années après - et ce matin je regarde ses objets à elle et constate que les objets d’une femme sont différents des objets d’un enfant, etc.Dessin Thierry Vernet: Portrait de Lady L. en 1987.
(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2021)À La Maison bleue, ce 14 décembre 2021. - Ma bonne amie est mourante, à la fois avec nous et déjà partie, comme notre mère l’a été pendant son long coma. Les visites des anges des soins palliatifs se suivent, je les vois passer comme en rêve, tout ce qui nous arrive, une heure après l’autre (elle disait en mai dernier : avançons désormais un pas après l’autre), me semble irréel et impensable à dire ou écrire, cela se passe comme hors de notre portée et de toute volonté - plus réel tu meurs suis-je tenté de dire mais je m’en abstiens -, c’est à la fois atrocement « comme ça », tout est fait « pour son confort » et la voici au mur des fusillés me dis-je en me reprochant cette formule qu’elle trouverait d’un pathos déplacé, plus juste serait le simple constat : que les heures passent et qu’elle trépasse.Un léger accroc, avec Sophie, sûrement lié à notre état de fatigue et d’émotion, nous a opposés dans une discussion sur le « compostage » des défunts, auquel je suis viscéralement réfractaire et qu’elle défendait, puis nous avons pleuré et sommes tombés dans les bras l’un de l’autre…Vers onze heures ce soir, après le départ de la belle soignante au prénom de Maeva qui lui avait administré une piqûre de morphine, je me trouvais dans la chambre voisine quand Sophie m’a appelé sur un ton alarmé, j’ai regardé ma montre et me suis dit que c’était arrivé, et c’était en effet arrivé : ma bonne amie, ma chérie avait cessé de respirer, et la suite de mes gestes et de mes pensées s’est enchaînée comme ceux d’un automate, j’ai donc appelé la centrale des soins qui m’a promis de nous envoyer quelqu’un, et ce quelqu’un nous a rappelés et a parlé à Sophie « comme à sa secrétaire », puis ce quelqu’un du genre quadra barbu visiblement contrarié par le timing de la prestation s’est pointé et, nous saluant à peine, a demandé où se trouvait « la personne décédée », alors que j’attendais quelques mots d’éventuelle compassion voire de condoléance, mais rien, aussi, me retenant de le prier de foutre le camp, c’est moi qui me suis éclipsé pendant qu’il expliquait à notre fille aînée qu’il lui fallait récupérer ses instruments dans sa voiture afin de retirer le pacemaker du corps dûment identifié, etc.DE L’EFFICACITÉ. - Tel préposé de nuit à la fonction du constat, se montra ce soir-là d’une impassibilité glaciale tranchant dans la mare de pleurs au point que la défunte ou le défunt eussent été tentés de pleurer de concert avec les survivantes et les survivants – mais le constat fut le constat…DE LA FORMALITÉ. – Il n’y a pas, au demeurant, à se formaliser du fait que le professionnel s’exécute selon les normes, ou alors ce serait céder à l’émotionnel informe, voire au pulsionnel difforme…DE LA GESTION DES AFFECTS. – Dès le constat protocolé vous serez pris en charge par les diverses structures professionnelles à disposition, pour autant que vous le souhaitiez, vu que la gestion du deuil reste à option, mais n’hésitez pas à vous sentir libres d’être encadrés…DU PLUS TENDRE AVEU. - Tu m’as manqué dès que j’ai su que je m’en irais, lui avait-elle dit…SES DERNIERS MOTS. - On n’est pas triste : on est abattu, on est mort de fatigue tout en constatant qu’on respire encore. Donc je me suis réveillé ce matin à côté d’une morte enveloppée dans le linceul de son drap de vivante, je me suis rappelé ses derniers mots à Sophie : « À présent je voudrais dormir », et c’est notre fille aînée aussi qui a trouvé l’intitulé de nos adieux prochains : Cérémonie de lumière… (À La Maison bleue, ce mercredi 15 décembre 2021)QUE DES DETAILS. – Le plus ancien souvenir qui me revienne, à propos des objets restant là après la mort de quelqu’un, date de l’école primaire, dans la classe de Mademoiselle Chammartin, qui nous apprit un matin que notre camarade Toupie ne reviendrait pas, et je me souviens qu’à cet instant les objets qui se trouvaient sur son pupitre me sont apparus avec une sorte de présence accrue, et j’ai pensé que c’était triste et que c’est ça que me disaient les objets de Toupie, bien rangés comme il les avait laissés, toujours très ordré, avec ce quelque chose d’un peu terne qu’il avait lui aussi, de modestes objets peu voyants, un plumier gris et une gomme, des crayons bien taillés et un taille-crayons qui maintenant avaient un air abandonné ; jamais je n’avais ressenti cela, ce qu’on nous avait dit de la maladie de Toupie, comme quoi son sang avait trop de globules blancs, ne m’avait pas vraiment touché, tellement notre camarade était pâle, mais à présent c’était autre chose, et beaucoup plus réel à mes yeux au point que je m’en souvient tant d‘années après - et ce matin je regarde ses objets à elle et constate que les objets d’une femme sont différents des objets d’un enfant, etc.Dessin Thierry Vernet: Portrait de Lady L. en 1987. -
Ceux qui pensent climat
 Celui que la disparition du permafrost groenlandais inquiète / Celle qui répète à ses amies du groupe tricot du quartier des Oiseaux que c’est surtout aux enfants qu’il faut penser / Ceux qui en concluent que nous vivrons bientôt tous dans des pays chauds comme les Africains à l’époque / Celui qui redoute les particules fines de l’air qui te rentrent jusque dans les poumons précise-t-il / Celle qui suit l’évolution de la déforestation en Amazonie où elle se rend tous les soirs via Google Earth / Ceux qui se méfient des faux anticyclones / Celui qui prétend que la nature reste la nature / Celle qui a rêvé qu’il neigeait dans l’église la nuit de Noël / Ceux qui font leur bilan carbone après chaque « rapport » / Celui qui parle franchement de son ressenti climatique à ses camarades du groupe de conscience / Celle qui a toujours dit qu’il n’y avait plus de saisons / Ceux qui sont en froid avec leurs collègues niant le réchauffement climatique / Celui qui voit dans la dernière pluie un signe de plus / Celle qui impose le zéro déchet à ses locataires immigrés / Ceux qui affirment qu’ils ont mal à la planète / Celui qui se dit une espèce en voie de disparition / Celle qui ne reconnaît plus la mer de glace de son enfance / Ceux qui demandent à leurs héritiers de composter leurs restes dûment triés on est bien d’accord, etc.
Celui que la disparition du permafrost groenlandais inquiète / Celle qui répète à ses amies du groupe tricot du quartier des Oiseaux que c’est surtout aux enfants qu’il faut penser / Ceux qui en concluent que nous vivrons bientôt tous dans des pays chauds comme les Africains à l’époque / Celui qui redoute les particules fines de l’air qui te rentrent jusque dans les poumons précise-t-il / Celle qui suit l’évolution de la déforestation en Amazonie où elle se rend tous les soirs via Google Earth / Ceux qui se méfient des faux anticyclones / Celui qui prétend que la nature reste la nature / Celle qui a rêvé qu’il neigeait dans l’église la nuit de Noël / Ceux qui font leur bilan carbone après chaque « rapport » / Celui qui parle franchement de son ressenti climatique à ses camarades du groupe de conscience / Celle qui a toujours dit qu’il n’y avait plus de saisons / Ceux qui sont en froid avec leurs collègues niant le réchauffement climatique / Celui qui voit dans la dernière pluie un signe de plus / Celle qui impose le zéro déchet à ses locataires immigrés / Ceux qui affirment qu’ils ont mal à la planète / Celui qui se dit une espèce en voie de disparition / Celle qui ne reconnaît plus la mer de glace de son enfance / Ceux qui demandent à leurs héritiers de composter leurs restes dûment triés on est bien d’accord, etc. -
Tel fils, tel père
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce vendredi 6 septembre. – Besoin d’ordre. Grand besoin d’ordre. Très grand besoin d’ordre, me dis-je ce matin en me reprochant de céder trop souvent, ces derniers temps, à la tentation du néant...Hier encore je lisais les pages incomparables d’André Suarès consarées à Bach et à Shakespeare, et précisement je me comparais à cet immense plumitif pour conclure : cloporte...Ce qui me ramène à Bouvard et Pécuchet : cloportes s’il en est. Mais Flaubert en a fait un palais à la manière du facteur Cheval ramenant les cailloux de partout avec sa brouette pour en faire ce qu’il en a fait : le Monumentum à la sainte bêtise, quelque chose à partir de rien, l’imbécillité du Garçon devenant poème à se fendre la malle tout en brossant de l’époque le tableau le plus sérieux, comme qui dirait « en creux » ou « par défaut ».Sur quoi, je ne sais diable pourquoi, je me suis récité le Notre-Père en hésitant sur les derniers mots…Or mon besoin d’ordre de ce matin, c’est plutôt du côté de notre mère qu’il faut en chercher l’origine, et c’est avec notre fille aînée que tout à l’heure nous allons nous régaler à ma nouvelle cantine de la Valsainte - familles !Et toi, cloporte, rappelle-toi le programme du poète (Henri Michaux) au seuil du jour: «Le matin, quad on est abeille, pas d'histoire, faut aller butiner»...
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce vendredi 6 septembre. – Besoin d’ordre. Grand besoin d’ordre. Très grand besoin d’ordre, me dis-je ce matin en me reprochant de céder trop souvent, ces derniers temps, à la tentation du néant...Hier encore je lisais les pages incomparables d’André Suarès consarées à Bach et à Shakespeare, et précisement je me comparais à cet immense plumitif pour conclure : cloporte...Ce qui me ramène à Bouvard et Pécuchet : cloportes s’il en est. Mais Flaubert en a fait un palais à la manière du facteur Cheval ramenant les cailloux de partout avec sa brouette pour en faire ce qu’il en a fait : le Monumentum à la sainte bêtise, quelque chose à partir de rien, l’imbécillité du Garçon devenant poème à se fendre la malle tout en brossant de l’époque le tableau le plus sérieux, comme qui dirait « en creux » ou « par défaut ».Sur quoi, je ne sais diable pourquoi, je me suis récité le Notre-Père en hésitant sur les derniers mots…Or mon besoin d’ordre de ce matin, c’est plutôt du côté de notre mère qu’il faut en chercher l’origine, et c’est avec notre fille aînée que tout à l’heure nous allons nous régaler à ma nouvelle cantine de la Valsainte - familles !Et toi, cloporte, rappelle-toi le programme du poète (Henri Michaux) au seuil du jour: «Le matin, quad on est abeille, pas d'histoire, faut aller butiner»... -
Calet à la paresseuse
 Le Rêveur solidaire (9)Le journalisme français actuel manque terriblement d’un Henri Calet. Entendons par là: d’un homme de plume qui soit à la fois un reporter et un poète, capable de parler du monde actuel et des gens sans cesser de donner du temps au temps, et dont l’expression se reconnaisse comme une petite musique sans pareille.Or Calet, dans une époque certes moins soumise à la frénésie que la nôtre, avait ce double talent du témoin engagé et du rêveur, de l’observateur acéré et de l’humoriste anarchisant. On en trouvera une superbe illustration dans Les deux bouts (Gallimard, 1954), série d’une vingtaines de reportages-entretiens réalisés auprès de gens peinant, précisément, à «nouer les deux bouts», et que le journaliste aborde avec autant de souci du détail véridique que de malicieuse empathie; ou dans le premier recueil de chroniques, souvent merveilleuses, d’Acteur et témoin (Mercure de France, 1959).
Le Rêveur solidaire (9)Le journalisme français actuel manque terriblement d’un Henri Calet. Entendons par là: d’un homme de plume qui soit à la fois un reporter et un poète, capable de parler du monde actuel et des gens sans cesser de donner du temps au temps, et dont l’expression se reconnaisse comme une petite musique sans pareille.Or Calet, dans une époque certes moins soumise à la frénésie que la nôtre, avait ce double talent du témoin engagé et du rêveur, de l’observateur acéré et de l’humoriste anarchisant. On en trouvera une superbe illustration dans Les deux bouts (Gallimard, 1954), série d’une vingtaines de reportages-entretiens réalisés auprès de gens peinant, précisément, à «nouer les deux bouts», et que le journaliste aborde avec autant de souci du détail véridique que de malicieuse empathie; ou dans le premier recueil de chroniques, souvent merveilleuses, d’Acteur et témoin (Mercure de France, 1959). Ecrivain avant que de prêter sa plume au journalisme, Henri Calet se fit connaître en 1935 avec La belle lurette, premier roman très nourri de sa propre enfance en milieu populaire et qui l’apparente, par son ton âpre et vif et sa vision du monde douce-amère, aux écrivains du réalisme «noir» à la Raymond Guérin ou à la Louis Guilloux.Après ce premier livre régulièrement redécouvert, Henri Calet publia Le mérinos en 1937 et Fièvre des polders, en 1940, qui lui valurent l’estime du public lettré sans toucher le grand public. Paru en 1945, Le bouquet, où ses souvenirs de captivité nourrissent l’un des meilleurs tableaux de la France occupée, faillit décrocher le Prix Goncourt, mais ce fut plutôt par le journalisme que le nom d’Henri Calet gagna en notoriété publique à la même époque. Par la suite, l’oeuvre du chroniqueur et celle du romancier-autobiographe n’allaient cesser d’interférer, pour aboutir parfois (notamment dans Le tout sur le tout, l’un des plus beaux livres de Calet, datant de 1948) à des collages inaugurant une forme nouvelle, ainsi que le relève Jean-Pierre Baril, omniconnaisseur de l'oeuvre et de la vie de Calet, dans sa préface à Poussières de la route.Ce dernier recueil, précisons-le, fait suite à la publication d’un autre bel ensemble de chroniques rassemblées par Christiane Martin du Gard, dernière compagne et exécutrice testamentaire de Calet (De ma lucarne, Gallimard, 2001), et le lecteur découvrira, dans les notes bibliographiques, quel jeu de piste et quel travail de recomposition a été celui du jeune éditeur biographe - Jean-Pierre Baril prépare en effet une biographie d’Henri Calet à paraître. Ainsi qu’il me l’a rapporté, les papiers laissée par Calet après sa mort (en 1956), et notamment sa correspondance, constituent une véritable mine, encore enrichie par d’inespérées découvertes sur le passé souvent obscur de l’écrivain.C’est en décembre 1944 qu’Albert Camus, sur proposition de Pascal Pia, invita Calet à collaborer au journal Combat, inaugurant un activité qui allait se disperser (un peu à la manière d’un Charles-Albert Cingria) entre de nombreux journaux et revues, à commencer par les publications issues de la Résistance. De cette période de l’après-guerre en France profonde, où sévissait l’épuration, Calet se fait l’écho dans deux reportages en Avignon et à Dunkerque, en 1945-1946, racontant respectivement une tournée houleuse (et qui faillit très mal tourner) du président Daladier, puis une confrontation de Paul Reynaud avec les communistes enragés et autres veuves de guerre. «On exécute beaucoup ces jours-ci», note Calet en passant, avant que Daladier, évoquant les «mégères exorbitées», ne lui rappelle les furies du Tribunal révolutionnaire.Au passage, le lecteur aura relevé la totale liberté de ton du reporter, qui commence son récit par l’aperçu d’une terrible séance chez un dentiste d’Avignon lui arrachant une dent sans lâcher sa cigarette. De la même façon, qu’il décrive un monument aux morts faisant office simultané de wc public, tire sa révérence à un obscur soldat tombé pour la France en 1940 («Ici repose un inconnu, dit Fenouillet»), acclame la nouvelle tenue des fantassins français «chauffée électriquement à l’intérieur au moyen de piles», raconte ses débuts à Berlin dans l’enseignement non dirigiste selon la méthode de Maria Montessori, visite les «dessous de grand navire» de l’opéra de Paris, échappe de justesse à un pervers lausannois ou vive avec la Garonne une sorte d’idylle poétique, Henri Calet ne cesse de combiner l’observation surexacte et la fantaisie, parfois pour le pur et simple plaisir d’écrire ou de décrire, selon la formule de Cingria, «cela simplement qui est».Comme «notre» Charles-Albert ou comme Alexandre Vialatte, comme un Raymond Guérin ou un Louis Calaferte, Henri Calet se rattachait en somme à cette catégorie peu académique des grands écrivains mineurs, dont le style résiste parfois mieux au temps que celui de maints auteurs estimés suréminents de leur vivant.Ce qui saisit à la lecture de Calet, c’est que le moindre de ses écrits journalistiques est marqué par le même ton, inimitable, qui fait le charme à la fois piqûant et nostalgique de Rêver à la Suisse ou de L’Italie à la paresseuse. Ces promenades littéraires, de fil en bobine, relient enfin la partie digressive de l’oeuvre à sa partie narrative, dont on commence seulement à évaluer l’ampleur, la cohérence et la qualité.Mais Lison, lisez donc Calet: c’est un régal!Henri Calet. Préface et notes de Jean-Pierre Baril. Poussières de la route. Couverture (magnifique) de Massin. Le Dilettante, 317p.A lire aussi : la Correspondance d’Henri Calet avec Raymond Guérin (1938-1955), établie et préfacée par Jean-Pierre Baril. Le Dilettante, 347p.
Ecrivain avant que de prêter sa plume au journalisme, Henri Calet se fit connaître en 1935 avec La belle lurette, premier roman très nourri de sa propre enfance en milieu populaire et qui l’apparente, par son ton âpre et vif et sa vision du monde douce-amère, aux écrivains du réalisme «noir» à la Raymond Guérin ou à la Louis Guilloux.Après ce premier livre régulièrement redécouvert, Henri Calet publia Le mérinos en 1937 et Fièvre des polders, en 1940, qui lui valurent l’estime du public lettré sans toucher le grand public. Paru en 1945, Le bouquet, où ses souvenirs de captivité nourrissent l’un des meilleurs tableaux de la France occupée, faillit décrocher le Prix Goncourt, mais ce fut plutôt par le journalisme que le nom d’Henri Calet gagna en notoriété publique à la même époque. Par la suite, l’oeuvre du chroniqueur et celle du romancier-autobiographe n’allaient cesser d’interférer, pour aboutir parfois (notamment dans Le tout sur le tout, l’un des plus beaux livres de Calet, datant de 1948) à des collages inaugurant une forme nouvelle, ainsi que le relève Jean-Pierre Baril, omniconnaisseur de l'oeuvre et de la vie de Calet, dans sa préface à Poussières de la route.Ce dernier recueil, précisons-le, fait suite à la publication d’un autre bel ensemble de chroniques rassemblées par Christiane Martin du Gard, dernière compagne et exécutrice testamentaire de Calet (De ma lucarne, Gallimard, 2001), et le lecteur découvrira, dans les notes bibliographiques, quel jeu de piste et quel travail de recomposition a été celui du jeune éditeur biographe - Jean-Pierre Baril prépare en effet une biographie d’Henri Calet à paraître. Ainsi qu’il me l’a rapporté, les papiers laissée par Calet après sa mort (en 1956), et notamment sa correspondance, constituent une véritable mine, encore enrichie par d’inespérées découvertes sur le passé souvent obscur de l’écrivain.C’est en décembre 1944 qu’Albert Camus, sur proposition de Pascal Pia, invita Calet à collaborer au journal Combat, inaugurant un activité qui allait se disperser (un peu à la manière d’un Charles-Albert Cingria) entre de nombreux journaux et revues, à commencer par les publications issues de la Résistance. De cette période de l’après-guerre en France profonde, où sévissait l’épuration, Calet se fait l’écho dans deux reportages en Avignon et à Dunkerque, en 1945-1946, racontant respectivement une tournée houleuse (et qui faillit très mal tourner) du président Daladier, puis une confrontation de Paul Reynaud avec les communistes enragés et autres veuves de guerre. «On exécute beaucoup ces jours-ci», note Calet en passant, avant que Daladier, évoquant les «mégères exorbitées», ne lui rappelle les furies du Tribunal révolutionnaire.Au passage, le lecteur aura relevé la totale liberté de ton du reporter, qui commence son récit par l’aperçu d’une terrible séance chez un dentiste d’Avignon lui arrachant une dent sans lâcher sa cigarette. De la même façon, qu’il décrive un monument aux morts faisant office simultané de wc public, tire sa révérence à un obscur soldat tombé pour la France en 1940 («Ici repose un inconnu, dit Fenouillet»), acclame la nouvelle tenue des fantassins français «chauffée électriquement à l’intérieur au moyen de piles», raconte ses débuts à Berlin dans l’enseignement non dirigiste selon la méthode de Maria Montessori, visite les «dessous de grand navire» de l’opéra de Paris, échappe de justesse à un pervers lausannois ou vive avec la Garonne une sorte d’idylle poétique, Henri Calet ne cesse de combiner l’observation surexacte et la fantaisie, parfois pour le pur et simple plaisir d’écrire ou de décrire, selon la formule de Cingria, «cela simplement qui est».Comme «notre» Charles-Albert ou comme Alexandre Vialatte, comme un Raymond Guérin ou un Louis Calaferte, Henri Calet se rattachait en somme à cette catégorie peu académique des grands écrivains mineurs, dont le style résiste parfois mieux au temps que celui de maints auteurs estimés suréminents de leur vivant.Ce qui saisit à la lecture de Calet, c’est que le moindre de ses écrits journalistiques est marqué par le même ton, inimitable, qui fait le charme à la fois piqûant et nostalgique de Rêver à la Suisse ou de L’Italie à la paresseuse. Ces promenades littéraires, de fil en bobine, relient enfin la partie digressive de l’oeuvre à sa partie narrative, dont on commence seulement à évaluer l’ampleur, la cohérence et la qualité.Mais Lison, lisez donc Calet: c’est un régal!Henri Calet. Préface et notes de Jean-Pierre Baril. Poussières de la route. Couverture (magnifique) de Massin. Le Dilettante, 317p.A lire aussi : la Correspondance d’Henri Calet avec Raymond Guérin (1938-1955), établie et préfacée par Jean-Pierre Baril. Le Dilettante, 347p. -
Votre attention s'il vous plaît...
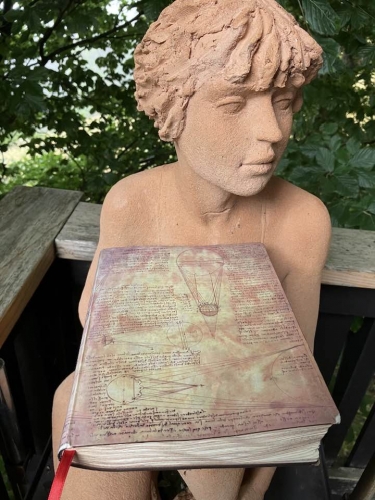 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce mercredi 4 septembre. – Le brouillard était remonté ce matin jusqu’à la Désirade quand je me suis aperçu, damned, que j’avais oublié hier soir, sur le rebord d'un des bacs de permacuture de la terrasse, mon carnet Leonardo de 222 pages rempli de mes notes à l’encre verte et une cinquantaine d’aquarelles que la pluie aurait pu diluer affreusement mais non : la solide couverture de la collection Paper Blanks a tenu bon, et le dommage se limite à quelques coulures vertes ici et là, entre le 30 octobre 2021 et le 27 avril 2022 - avec toutes les pages que j’ai consacrées aux derniers mois de la vie de ma bonne amie, puis à notre deuil…Dans la foulée, cela m’a rappelé un autre « deuil » qu’il m’a fallu faire, et cette fois pour de bon, puisque le carnet n’a jamais réapparu dans les bureaux d’objets trouvés de Paris et environs, lorsque, un certain 11 septembre sortant de chez Marina Vlady que je venais d’interviewer, et juste avant d’apprendre ce qui se passait à New York, j’ai oublié, à un guichet de métro, cet autre carnet contenant des mois de notes et de croquis aquarellés…
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce mercredi 4 septembre. – Le brouillard était remonté ce matin jusqu’à la Désirade quand je me suis aperçu, damned, que j’avais oublié hier soir, sur le rebord d'un des bacs de permacuture de la terrasse, mon carnet Leonardo de 222 pages rempli de mes notes à l’encre verte et une cinquantaine d’aquarelles que la pluie aurait pu diluer affreusement mais non : la solide couverture de la collection Paper Blanks a tenu bon, et le dommage se limite à quelques coulures vertes ici et là, entre le 30 octobre 2021 et le 27 avril 2022 - avec toutes les pages que j’ai consacrées aux derniers mois de la vie de ma bonne amie, puis à notre deuil…Dans la foulée, cela m’a rappelé un autre « deuil » qu’il m’a fallu faire, et cette fois pour de bon, puisque le carnet n’a jamais réapparu dans les bureaux d’objets trouvés de Paris et environs, lorsque, un certain 11 septembre sortant de chez Marina Vlady que je venais d’interviewer, et juste avant d’apprendre ce qui se passait à New York, j’ai oublié, à un guichet de métro, cet autre carnet contenant des mois de notes et de croquis aquarellés…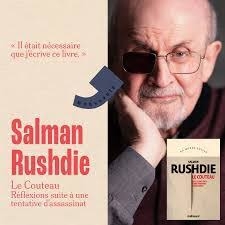 Ce jeudi 4 septembre. - Au temps moche et limite glacial qu’il fait ce matin de la Sainte Rosalie (ermite retirée près de Palerme et morte en 1170, dont le corps ne fut découvert qu’en 1624, et ce fut alors que cessa l’épidémie de peste), j’oppose la plus joyeuse humeur en dépit des détails atroces évoqués par Salman Rushdie dans Le Couteau, récit de la tentative d’assassinat qui a failli lui coûter la vie en août 2022, et que j'ai commencé de lire hier; et ce matin j’ai relu le récit déjà saisissant, daté de 1993, que nous avons publié dans Le Passe-Muraille une année après la fondation de celui-ci, et je lis à l’instant, dans mon Almanach de la mémoire des coutumes que «les plus jolies choses ne sont que des ombres » à en croire Dickens, mais on pourrait dire le contraire et là c’est moi qui signe sans donner dans l’optimisme béat, mais la lecture du Couteau en dit autant sur la bonté des gens que sur leur éventuelle abjection.
Ce jeudi 4 septembre. - Au temps moche et limite glacial qu’il fait ce matin de la Sainte Rosalie (ermite retirée près de Palerme et morte en 1170, dont le corps ne fut découvert qu’en 1624, et ce fut alors que cessa l’épidémie de peste), j’oppose la plus joyeuse humeur en dépit des détails atroces évoqués par Salman Rushdie dans Le Couteau, récit de la tentative d’assassinat qui a failli lui coûter la vie en août 2022, et que j'ai commencé de lire hier; et ce matin j’ai relu le récit déjà saisissant, daté de 1993, que nous avons publié dans Le Passe-Muraille une année après la fondation de celui-ci, et je lis à l’instant, dans mon Almanach de la mémoire des coutumes que «les plus jolies choses ne sont que des ombres » à en croire Dickens, mais on pourrait dire le contraire et là c’est moi qui signe sans donner dans l’optimisme béat, mais la lecture du Couteau en dit autant sur la bonté des gens que sur leur éventuelle abjection.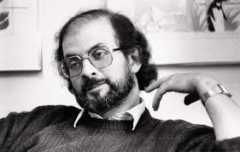 Ce qui est sûr est que l’affaire Rushdie a été un révélateur au niveau mondial, un sismographe de la haine et plus qu’un symbole : un fait qui nous révèle tous les jours, encore et encore, ce qui se passe aujourd’hui dans le monde partout où il y a des prisons pour ceux qui pensent librement, à savoir presque partout...J’ai publié hier, avant de me lancer dans la lecture de Surveiller et punir de Michel Foucault, dont les premières pages sur la torture et les supplices ont de quoi nous réjouir (!), le récit de Rushdie consacré aux années d’après la Fatwah, mais ce matin : que deux likes sur Facebook, à croire que tout le monde s’en fiche, ou peut-être ce texte est-il trop long, ou peut-être les gens en ont-ils leur claque de cet emmerdeur comme les Anglais à l’époque qui ne voyaient en lui qu’un dommage collatéral alors qu’on était en pleine crise des otages…Or les remarques, dans Le couteau sur l’état actuel de la vie privée à l’ère des réseaux sociaux où tout un chacun n’existe qu’en fonction des likes et autres followers, où la privacy est considérée comme un défi à la transparence, où réseaux et médias se liguent pour une inquisition de tous les instants, font que le nom même de Salman Rushdie se confond à mes yeux à la voix secrète et personnelle du sage inconnu, et c’est mon frère humain que j’entends en le lisant ici, au bord du ciel, alors que le brouillard monte et submerge notre val suspendu, etc.
Ce qui est sûr est que l’affaire Rushdie a été un révélateur au niveau mondial, un sismographe de la haine et plus qu’un symbole : un fait qui nous révèle tous les jours, encore et encore, ce qui se passe aujourd’hui dans le monde partout où il y a des prisons pour ceux qui pensent librement, à savoir presque partout...J’ai publié hier, avant de me lancer dans la lecture de Surveiller et punir de Michel Foucault, dont les premières pages sur la torture et les supplices ont de quoi nous réjouir (!), le récit de Rushdie consacré aux années d’après la Fatwah, mais ce matin : que deux likes sur Facebook, à croire que tout le monde s’en fiche, ou peut-être ce texte est-il trop long, ou peut-être les gens en ont-ils leur claque de cet emmerdeur comme les Anglais à l’époque qui ne voyaient en lui qu’un dommage collatéral alors qu’on était en pleine crise des otages…Or les remarques, dans Le couteau sur l’état actuel de la vie privée à l’ère des réseaux sociaux où tout un chacun n’existe qu’en fonction des likes et autres followers, où la privacy est considérée comme un défi à la transparence, où réseaux et médias se liguent pour une inquisition de tous les instants, font que le nom même de Salman Rushdie se confond à mes yeux à la voix secrète et personnelle du sage inconnu, et c’est mon frère humain que j’entends en le lisant ici, au bord du ciel, alors que le brouillard monte et submerge notre val suspendu, etc.