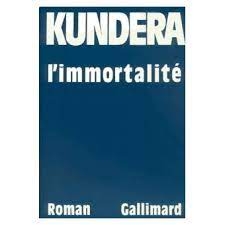 (Le Temps accordé, journal d'une lecture)
(Le Temps accordé, journal d'une lecture)À La Désirade, ce samedi 15 juillet. – J’amorce ce matin, par temps estival splendide sur la conque verdoyante du vallon boisé et l’immensité du lac au bleu dense strié de vert que surmonte, au-desus des monts de Savoie, l’azur plus doux du ciel céleste, ce que j'entrevois déjà comme un important (pour moi) journal de lecture tout consacré à Milan Kundera, trois jours après sa mort et juste une semaine après avoir trouvé, sur les rayons de la ressourcerie de Chailly sur Montreux - hasard ou nécessité ironique -, un exemplaire de L’Immortalité ayant appartenu à une certaine Tereza, homonyme (à une lettre près) de la dernière compagne de Simenon et de la protagoniste de L’Insoutenable légèreté de l’être que son auteur m’a dédicacé à Paris en 1984.
J’ai reçu, hier en fin d’après-midi, un texto de notre médecin traitant, l’excellent Alexandre H. aux chemises toujours très bariolées, me rassurant après la prise du sang du matin en ces termes : vos résultats ne montrent aucune souffrance du coeur après l'épisode d’hier, ni d'anémie, et vos tests hépatiques sont également alignés, parfaits ! Avec mes compliments , etc.
Et de fait, je me suis senti rasséréné après mes vacillements vertigineux de la veille et ma sensation d’étouffer - plus une douleur aiguë peut-être liée à la défection de mes quatre stents coronaires ; et Sophie aussi m’a « texté » son soulagement après notre repas de midi à L’Oasis où elle m’a vu tituber pas mal et m’arrêter pour reprendre souffle, etc.
Or reprenant, trente-trois ans après ma première lecture, cette Immortalité que Bernard de Fallois me reprochait sarcastiquement d’apprécier sans l’avoir probablement ouvert (Kundera ayant déjà ses laudateurs et ses contempteurs, aussi aveugle les uns que les autres, en 1990), j’ai été saisi, après moins d’une cinquantaine de pages, par l’évolution qualitative de cette nouvelle approche dès l’apparition d’Agnès, la sexa solitaire dont le plus grand amour aura probablement été son père secret et mélancolique – le portrait de la mère dominatrice tient à quelques traits impitoyables -, et ce mélange qui caractérise Kundera pour l’essentiel, comme je l’avais relevé dans mon papier de 1990, d’une hypersensibilité (Anima) constante dans sa perception des êtres qu’il tire de son chapeau de romancier, comme par génération spontanée, et d’une lucidité intelligente (Animus) dans sa façon de lier chaque individu à l’époque et à la société, ici le long plan-séquence sur Agnès à la piscine du fitness parisien, puis dans le sauna et les bruits de la rue, l’obsession de l’image et ce que Kundera taxe ailleurs d’ « eau sale de la musique » ; et voici qu’évoquant la famille d’Agnès et ses liens avec la Suisse, puis citant le petit poème de Goethe que lui récitait encore son père à la veille de sa mort, mes propres souvenirs de septuagénaire n’ont cessé de s’ajouter aux perceptions du quadra que j’étais en 1990 – mais là faut que je me prépare à rejoindre, ce midi, mes amis M. à la terrasse du Major, et sûr que nous allons parler ensemble de tout ça…
(Soir) – J’ai retrouvé ce soir les mots, que je n’ai su citer par cœur à mes amis M. , ce midi, sur la terrasse ombragée de Bourg-en-Lavaux, et qu’Antonin eût compris tout de suite en germaniste distingué qu’il est sans que ne s’en doute probablement notre accorte serveuse portugaise Olinda, soit : « Über allen Gipfen / Ist Ruh / In allen Wipfeln/ Spürest du / Kaum einen Hauch ; Die Vögeln schweigen im Walde / Warte nur, balde / Ruhest du auch », ce qui perd toute magie musicale en traduction : « Sur tous les sommets / C’est le silence / Sur la cime de tous les arbres / Tu sens / À peine un souffle ; / Les petits oiseaux se taisent dans la forêt / Prends patience, bientôt / Tu te reposeras aussi», et d’ailleurs la citation, vaguement funèbre sur la fin, aurait tranché sur notre humeur débonnaire ponctuée de rires, lesquels sont la marque de notre vieille amitié si peu pédante et si peu « littéraire » au demeurant malgré le fait qu’Antonin et moi avons publié plus de quarante livres à nous deux – mais Jackie est aussi peu « femme d’écrivain » que l’était Lady L. avec laquelle elle « échangeait » surtout au téléphone…
Du moins, en «œil extérieur » à la Kundera, me demandais-je à quoi pouvaient faire penser ces deux vieilles ganaches en chemise de viscose rose (Antonin) et blouse afghane blanche (moi) flanqués de cette frangine a pull orange un peu cassée sur son coin de table avec son sourire en coin de Jurassienne incessamment moqueuse, et je me disais : ni bohème chic ni vieux de la vieille culturelle, même pas boomers atypiques, rien qu’un trio sympa au jugé d’Olinda...
Jackie se rappelle en tout cas sa lecture de L’Insoutenable légèreté de l’être, comme de la grande littérature de ce temps-là (elle devait avoir la trentaine), et la souvenir d’Antonin semble plus sporadique, surtout lié aux essais de Kundera, dont il convien qu’il s’agit d’un grand écrivain – il est en train de découvrir La guerre des clichés de Martin Amis…
Bref : le vrai sujet « à la Kundera » est ailleurs, et notamment quand nous parlons, avec Jackie, de nos déceptions en matière d’amitié. Sujets de nouvelles, mais nous ne livrerons aucun nom ! D’ailleurs à quoi ça tient : tu passes par une dépression ou une grave maladie, et ça te coûte tant de défections amicales, ou tu fais des enfants, et là « ça craint » aussi...
Je me rappelle, de mon côté, que j’ai commencé à faire ami-ami avec Antonin après l’avoir fait avec son père qui était ami-ami avec Charles-Albert Cingria, et c’était alors un éphèbe à longs cheveux et rêves de gloire théâtrale, Antonin au TNS de Strasbourg et à Paris où il créchait dans une mansarde puant la souris malade, avant son virage dans l’écriture et compagnie...
Lire Kundera, me dis-je ce soir en revenant à L’Immortalité, c’est lire et relire sa propre vie avec un regard plus distant et plus amical à la fois, et demain je retroverai Agnès et sa sœur Laura en pensant à mes propres sœurs en Espagne et dans le quartier de nos enfances, mais à l’instant c’est notre fille Julie qui m'appelle de Kampot au Cambodge où elle « fait avec » ses trois mioches et sept autres gosses de là-bas très insoucieux des dangers de notre drôle de monde…
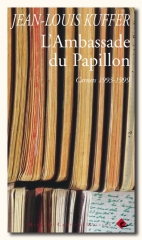
Ce dimanche 16 juillet. – Lorsque je lui ai dit que j’avais découvert que j’étais mortel tel matin d’automne de la venue au monde de notre premier enfant, Milan Kundera a eu un geste de saisissement que je me rappelle, levant soudain ses deux fines mains aux solides attaches et, après un long silence, comme Antonio Lobo Antunes des années plus tard, m’a demandé si moi aussi j’écrivais, puis, se reprenant comme pour s’excuser de cette question peut-être indiscrète, m’a avoué qu’il avait accepté de me rencontrer – ce qu’il faisait de moins en moins - sur la proposition de Vera et se rappelant la tournure personnelle et la vive attention manifestées dans mes papiers consacrés à ses livres.
Je ne sais ce que Sophie a pensé du récit que son père a fait de sa naissance, au matin lustral de novembre 1982, dans L’Ambassade du papillon, mais je suis reconnaissant à nos deux enfants, autant qu’à Lady L., d’avoir changé ma vie en destin personnel – ces trois bonnes femmes me révélant puis me confirmant l’évidence occultée jusque-là que j’étais non seulement mortel mais unique, comme le perçoit Agnès devant son miroir, dans L’Immortalité, me ramenant en somme, les pieds sur terre comme les femmes le savent, à la bonne vie simplement vivante et me permettant en somme de mieux moduler mes vérités dans mes Lectures du monde dont L’Ambassade est le premier des sept volumes représentant aujourd’hui quelque 3000 pages…

Tomas et Tereza, dans L’Insoutenable légèreté de l’être, qui dit beaucoup aussi du poids du monde, ont baptisé leur chien du nom de Karénine, et moi je décide ce matin, dans ce récit d’une relecture de Kundera, d’appeler Oblomov mon vieux compagnon baptisé Snoopy par Lady L., histoire de marquer le passage de la réalité à la fiction, comme on constate que les prénoms d’Agnès et de Laura ou de Paul, dans L’Immortalité, nous font passer de la fiction à la réalité de notre lecture…
Si je fais « retour à Kundera », qui revient lui-même au mythe nietzschéen de l’éternel retour au début de L’Insoutenable légèreté de l’être, ce n’est pas du tout par soumission à un ressassement plus ou moins nostalgique mais au contraire dans l’esprit de redécouverte du jamais vu, ou du jamais lu comme aujourd’hui, et je pourrais faire retour à Cingria comme à Witkiewicz, mes deux premiers mentors de lecteur de vingt ans et des poussières, à Tchekhov ou à Thomas Wolfe, à Balzac ou à Annie Dillard et Alice Munro – les personnages de celle-ci me restant aussi présents que ceux de Kundera, avec plus de chair souvent et plus de lancinante affectivité, moins aussi de pensée en acte ou de désenchantement hédoniste…
À la page 55 de L’Immortalité (première édition de Gallimard en collection Du monde entier), Agnès prend donc conscience d’une double évidence déjà entrevue dans son miroir et vérifiée ce soir-là de « dîner convivial » où elle s’est efforcée de faire bonne figure : qu’elle est unique et qu’elle ne se sent pas solidaire de ses semblables pour l’essentiel même si elle a le cœur sur la main, n’est-ce pas, et combien ça me rappelle ma propre propension à rester à l’écart et mon refus de souscrire jamais à l’expression « il est des nôtres »…
Je compte actuellement 5000 « amis » sur le réseau social de Facebook: pure fiction, sinon foutaise, mais l’intuition d’Agnès, que l’image multipliée – vingt-cinq ans avant Instagram - est en train de ruiner la notion même d’individualité, au dam de ce qu’on appelait hier la pudeur et la discrétion, et au risque de voir s’effondrer la représentation de sa propre personne, rejoint à l’instant tout ce que j’ai tenté d’exprimer dans Nous sommes tous des zombies sympas – que j’ose dire un libelle « à la Kundera »…
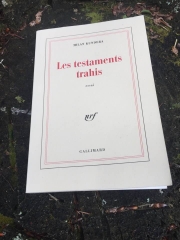
À La Désirade, ce lundi 17 juillet, 4h du matin.- Dans le rêve, un Claudel à stature d’éléphant blanc me sommait de prononcer le mot TUBULURE, et j’ai pensé : Titan. Puis l’image de la bouche d’or m’est revenue malgré son faciès de laboureur aux comices et je me suis réveillé en songeant à sa page lumineuse sur l’Anima de Rimbaud.
Mais caramba: seulement 4 heures ! et cette sensation d’avoir les pieds secs, l’âme de dix-sept ans et les pieds froids…
Sur quoi je tends le main au hasard, qui me ramène Les Testaments trahis, et je lis ce qu’exactement je devais lire à ce moment-là comme souvent quand je pêche un livre au hasard: «Personne n’est plus insensible que les gens sentimentaux. »
Et tout de suite je vois Untel et Unetelle : comme les personnages des romans de Kundera émanent souvent de pensées ou d’intuitions, les pensées et développements de ses essais s’incarnent en personnages...

Au personnage d’Agnès, la sexagénaire que la perte de son visage et de son unicité inquiète, dans la première partie de L’immortalité, j’ai prêté hier soir le visage de Kristin Scott Thomas dans L’ombre d’un soupçon de Sydney Pollack, la femme trompée qui partage son désarroi puis sa tendresse avec Harrison Ford en inspecteur de police dont un certain geste m’a rappelé le vieil acteur rencontré sur le hauts de Lugano en 1993, donc l’année de la parution de la traduction française des Testaments trahis...
Autre trahison, me dis-je à propos des deux amants se crashant dans le même avion après avoir menti à leurs conjoints, et tout le côté sensible du film , réellement émouvant et rendu tel par les deux acteurs, fait oublier le sentimentalisme plus factice de la conclusion, typique du kitsch que Kundera a toujours raillé.
Et voila qu’au lieu de m’endormir, notant au passage les mots d’affectueuse dévotion que l’écrivain voue à Robert Musil (absolument que je revienne aussi à L’homme sans qualités, me dis-je dans la foulée) je tombe sur ce vif hommage à l’humour de Rabelais à propos du Pantagruel que le jeune Tchèque tenait sous son lit dans son dortoir d’ouvriers: « L’humour : l’éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguité morale et l’homme dans sa profonde incompétence à juger les autres ; l’humour : l’ivresse de la relativité des choses humaines ; le plaisir étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitude. Mais l’humour, pour rappeler Octavio Paz, est « la grande invention de l’esprit moderne ». Il n’est pas là depuis toujours, il n’est pas là pour toujours non plus. Le cœur serré, je pense au jour où Panurge ne fera plus rire »...
(À suivre)