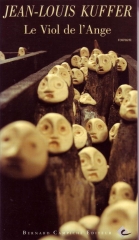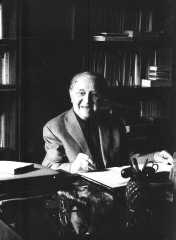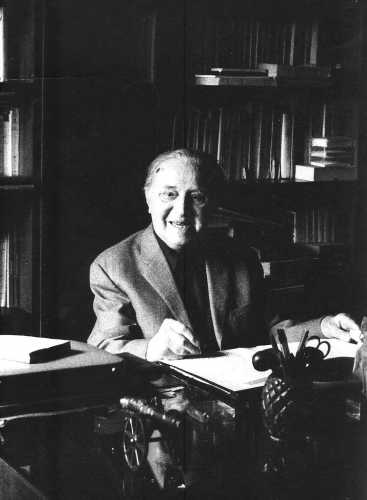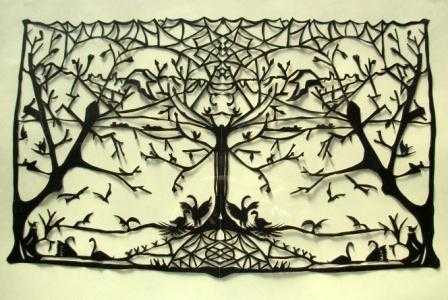Livre - Page 16
-
Loin des zombies sympas
 (Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À La Désirade, ce jeudi 18 juillet. – À six heures du matin, ce matin, le ciel annonçant une grande et belle journée d’été, je m’en suis détourné en me rappelant ma rage d’hier soir dans le tonitruement du festival du Néant, comme j’ai cru juste et bon de le nommer non sans me reprocher en même temps de « noircir le tableau sympa »...J’avais fui le bord du lac où se déchaînaient décibels et acclamations folles de la « foule sympa » déboulée en houles dans la ville assiégée, j’avais calé la petite chienne entre le gros volume relié des Archives du rêve et un pack d’eau minérale ; oui c’est cela le néant m’étais-je dit en subissant, fenêtres ouvertes sur les palmiers d’à côté - des palmiers que l’Etat confédéral aimerait éradiquer en sa profonde imbécillité bureaucratique de surface, avais-je appris le matin même dans le journal -, les premiers coups de boule au front de la maison tremblant sur ses fondations, le néant du bruit qui se donne pour de la musique, le néant de ce défilement incessant de foule sympa en shorts sympas , et fuyant l’invasion et son boucan d’enfer je me suis retrouvé sur les hauts où, le jour déclinant à l’ouest dans l’orangé californien, l’on entendait encore le battement sourd de la Machine, là-bas derrière l’épaulement boisé à la brésilienne, et je me suis répété en vieux sanglier que c’était cela même : la Machine à baratter le vide, le néant binaire des zombies sympas, etc.LILOU.- La petite chienne de Julie, actuellement à Phuket avec les siens, a ses humeurs, plus affirmées et déroutantes que ne l’étaient celles de Snoopy, ainsi a-t-elle éventré hier un coussin avant de filer dans la forêt où elle a aboyé je ne sais quel revenant des terriers - pas vu un renard ni un blaireau ou un lynx ces derniers temps- pour revenir ensuite l’air préoccupé et sans daigner m’accorder un regard, gémir au pied de mon lit en me faisant comprendre qu’elle y veut pioncer auprès de moi - et moi si faible avec les bêtes et les enfants, d’attraper d’une main cette peste aux yeux de chauve-souris et de la caler dans un oreiller en lui promettant le bâton si elle attente à son intégrité de commodité du sommeil innocent. Gare ! Sur quoi , la gredine accoisée, je reviens en pensée à Michaux qui a parfois parlé du chien avec sagesse - mais ce n'est pas du chien que parle le Michaux de Qui je fus auquel je reviens à l’instant: c’est de Clodomir l’assassin de Jouhandeau...À La Désirade, ce vendredi 19 juillet. - L’idée m’est venue ce matin de remplir les pages vides du livre relié hérité de nos tantes de Lucerne, dont la tranche annonce un Gästebuch, donc un Livre d’or, avec le fatras quotidien de mes listes, de mes contrerimes, de mes notes de toute sorte et des citations que je glâne au fil de mes lectures - ainsi aurai-je sous la main, et reliées à l’ancienne sous couverture à belles marbures vertes et or, les quelque 333 pages d’une sorte de Mémorial ambulant à usages multiples, e sopratutto per non dimenticar la memoria, cosi come l’avrebbe detto il sior Guido - la Liste inaugurale étant dédiée à Ceux qui osent l'immersion:Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.PERSONA. - La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns. Persona : le masque…CE QUE NOUS DISONS QUE DIT LE CIEL. – Je reprends à l'instant, comme au bord du ciel (le balcon de La Désirade se prête à la métaphore un peu pompeuse), la lecture de mon penseur vivant de prédilection (l’autre, René Girard, nous ayant quittés il y a quelques années), en la personne de Peter Sloterdijk dont le dernier essai – formidable d’érudition et d’intuitions fécondes - , intitulé Faire parler le ciel, cristallise la nébuleuse de mes propres réflexions en la matière depuis mes seize ou dix-huit ans, et qu’oriente sa première phrase : « Le lien établi entre les conceptions du monde des dieux et la poésie est aussi ancien que la tradition des premiers temps de l’Europe ; mieux, elle remonte jusqu’aux plus anciennes sources écrites des civilisations du monde entier »...Or on a bien lu « écrites », vu que le ciel est censé nous parler en dictée, et le terme de poésie est à prendre, précise l’héroïque traducteur Olivier Mannoni, au sens allemand goethéen de Dichtung, incluant l’idée de création, de composition littéraire et de fiction qui fait de Proust et de Bernanos, de Claudel et de Rimbaud, des poètes plus ou moins comparables – car tout ne l’est pas vraiment en vérité - aux « théopoètes » à la manière de Jean l’évangéliste et autres visionnaires du sacré…
(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À La Désirade, ce jeudi 18 juillet. – À six heures du matin, ce matin, le ciel annonçant une grande et belle journée d’été, je m’en suis détourné en me rappelant ma rage d’hier soir dans le tonitruement du festival du Néant, comme j’ai cru juste et bon de le nommer non sans me reprocher en même temps de « noircir le tableau sympa »...J’avais fui le bord du lac où se déchaînaient décibels et acclamations folles de la « foule sympa » déboulée en houles dans la ville assiégée, j’avais calé la petite chienne entre le gros volume relié des Archives du rêve et un pack d’eau minérale ; oui c’est cela le néant m’étais-je dit en subissant, fenêtres ouvertes sur les palmiers d’à côté - des palmiers que l’Etat confédéral aimerait éradiquer en sa profonde imbécillité bureaucratique de surface, avais-je appris le matin même dans le journal -, les premiers coups de boule au front de la maison tremblant sur ses fondations, le néant du bruit qui se donne pour de la musique, le néant de ce défilement incessant de foule sympa en shorts sympas , et fuyant l’invasion et son boucan d’enfer je me suis retrouvé sur les hauts où, le jour déclinant à l’ouest dans l’orangé californien, l’on entendait encore le battement sourd de la Machine, là-bas derrière l’épaulement boisé à la brésilienne, et je me suis répété en vieux sanglier que c’était cela même : la Machine à baratter le vide, le néant binaire des zombies sympas, etc.LILOU.- La petite chienne de Julie, actuellement à Phuket avec les siens, a ses humeurs, plus affirmées et déroutantes que ne l’étaient celles de Snoopy, ainsi a-t-elle éventré hier un coussin avant de filer dans la forêt où elle a aboyé je ne sais quel revenant des terriers - pas vu un renard ni un blaireau ou un lynx ces derniers temps- pour revenir ensuite l’air préoccupé et sans daigner m’accorder un regard, gémir au pied de mon lit en me faisant comprendre qu’elle y veut pioncer auprès de moi - et moi si faible avec les bêtes et les enfants, d’attraper d’une main cette peste aux yeux de chauve-souris et de la caler dans un oreiller en lui promettant le bâton si elle attente à son intégrité de commodité du sommeil innocent. Gare ! Sur quoi , la gredine accoisée, je reviens en pensée à Michaux qui a parfois parlé du chien avec sagesse - mais ce n'est pas du chien que parle le Michaux de Qui je fus auquel je reviens à l’instant: c’est de Clodomir l’assassin de Jouhandeau...À La Désirade, ce vendredi 19 juillet. - L’idée m’est venue ce matin de remplir les pages vides du livre relié hérité de nos tantes de Lucerne, dont la tranche annonce un Gästebuch, donc un Livre d’or, avec le fatras quotidien de mes listes, de mes contrerimes, de mes notes de toute sorte et des citations que je glâne au fil de mes lectures - ainsi aurai-je sous la main, et reliées à l’ancienne sous couverture à belles marbures vertes et or, les quelque 333 pages d’une sorte de Mémorial ambulant à usages multiples, e sopratutto per non dimenticar la memoria, cosi come l’avrebbe detto il sior Guido - la Liste inaugurale étant dédiée à Ceux qui osent l'immersion:Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.PERSONA. - La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns. Persona : le masque…CE QUE NOUS DISONS QUE DIT LE CIEL. – Je reprends à l'instant, comme au bord du ciel (le balcon de La Désirade se prête à la métaphore un peu pompeuse), la lecture de mon penseur vivant de prédilection (l’autre, René Girard, nous ayant quittés il y a quelques années), en la personne de Peter Sloterdijk dont le dernier essai – formidable d’érudition et d’intuitions fécondes - , intitulé Faire parler le ciel, cristallise la nébuleuse de mes propres réflexions en la matière depuis mes seize ou dix-huit ans, et qu’oriente sa première phrase : « Le lien établi entre les conceptions du monde des dieux et la poésie est aussi ancien que la tradition des premiers temps de l’Europe ; mieux, elle remonte jusqu’aux plus anciennes sources écrites des civilisations du monde entier »...Or on a bien lu « écrites », vu que le ciel est censé nous parler en dictée, et le terme de poésie est à prendre, précise l’héroïque traducteur Olivier Mannoni, au sens allemand goethéen de Dichtung, incluant l’idée de création, de composition littéraire et de fiction qui fait de Proust et de Bernanos, de Claudel et de Rimbaud, des poètes plus ou moins comparables – car tout ne l’est pas vraiment en vérité - aux « théopoètes » à la manière de Jean l’évangéliste et autres visionnaires du sacré… -
Ceux qui osent l'immersion
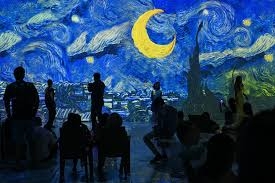 Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.
Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc. -
L’idéologie vertueuse pousse les meutes à la déraison
 De la décapitation « islamiste » de Samuel Paty aux multiples formes de bigoterie politisée enflammant les clans « radicalisés », une vraie folie entretient toutes les confusions sur les thèmes, notamment, de la différence sexuelle, de la race, du genre et de l’identité, avec la même intolérance croissante. La Grande déraison de Douglas Murray, en donne un aperçu tantôt atterrant et tantôt hilarant, appelant Molière et Rabelais au secours…Le hasard des circonstances a fait que nous aurons appris à peu près en même temps, ces derniers jours, la nouvelle de la mort atroce de Samuel Paty, brave prof français dans la quarantaine décapité par un jeune Tchétchène fraîchement acquis à la cause de l’islamisme conquérant, et la proposition benoîte du pontife catholique Francesco de considérer les homosexuels de genres divers comme des sœurs et frères humains dignes d’une évangélique bienveillance.
De la décapitation « islamiste » de Samuel Paty aux multiples formes de bigoterie politisée enflammant les clans « radicalisés », une vraie folie entretient toutes les confusions sur les thèmes, notamment, de la différence sexuelle, de la race, du genre et de l’identité, avec la même intolérance croissante. La Grande déraison de Douglas Murray, en donne un aperçu tantôt atterrant et tantôt hilarant, appelant Molière et Rabelais au secours…Le hasard des circonstances a fait que nous aurons appris à peu près en même temps, ces derniers jours, la nouvelle de la mort atroce de Samuel Paty, brave prof français dans la quarantaine décapité par un jeune Tchétchène fraîchement acquis à la cause de l’islamisme conquérant, et la proposition benoîte du pontife catholique Francesco de considérer les homosexuels de genres divers comme des sœurs et frères humains dignes d’une évangélique bienveillance.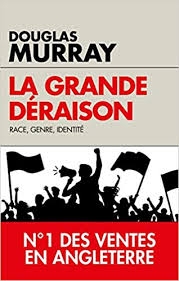 Or l’idée, apparemment discutable, de rapprocher ces deux actes de présumée barbarie et de supposée compassion, m’est venue tandis que je lisais La grande déraison du journaliste anglais Douglas Murray, quadra lui aussi et gay déclaré, dont le vaste aperçu des «sujets qui fâchent» actuellement une partie de la société occidentale - et plus précisément dans la caste intellectuelle anglo-saxonne et la nébuleuse des réseaux sociaux galvanisés par le «politiquement correct» - est précisément marqué par des rapprochements inattendus et non moins révélateurs, impliquant la complexité humaine et pointant le simplisme ravageur des idéologies les plus radicales.Le bon sens de bonne foi laïque voudrait, naturellement, que l’assassinat de «droit divin» d’un enseignant par un fanatique publiquement encouragé, entre autres, par un imam autoproclamé, soit considéré comme un exemple emblématique de la monstruosité de l’islamisme, confondu par certains avec l’islam tandis que le mantra «pas d’amalgame» monte aux cieux.
Or l’idée, apparemment discutable, de rapprocher ces deux actes de présumée barbarie et de supposée compassion, m’est venue tandis que je lisais La grande déraison du journaliste anglais Douglas Murray, quadra lui aussi et gay déclaré, dont le vaste aperçu des «sujets qui fâchent» actuellement une partie de la société occidentale - et plus précisément dans la caste intellectuelle anglo-saxonne et la nébuleuse des réseaux sociaux galvanisés par le «politiquement correct» - est précisément marqué par des rapprochements inattendus et non moins révélateurs, impliquant la complexité humaine et pointant le simplisme ravageur des idéologies les plus radicales.Le bon sens de bonne foi laïque voudrait, naturellement, que l’assassinat de «droit divin» d’un enseignant par un fanatique publiquement encouragé, entre autres, par un imam autoproclamé, soit considéré comme un exemple emblématique de la monstruosité de l’islamisme, confondu par certains avec l’islam tandis que le mantra «pas d’amalgame» monte aux cieux.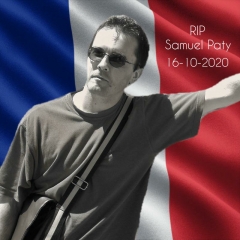 Or ceux qui s’empressent, à gauche comme à droite, de «récupérer» politiquement et surtout idéologiquement, cet acte affreux, seront peut-être les mêmes qui taxeront, pour des motifs idéologico-politiques, l’attitude du «saint père» de joyeusement progressiste ou de coupablement laxiste.Dans les deux cas sans rapport apparent, les idéologies binaires trancheront, les réseaux sociaux s’enflammeront et les chefs d’Etat (le match Macron-Erdogan) se balanceront des caricatures en pleines gueules selon la logique des chaises de coiffeur rivales merveilleusement évoquée dans Le Dictateur de Chaplin et rappelée par René Girard dans sa description de la «montée aux extrêmes».Et que je te rappelle que certains pères de la Sainte Eglise en appelaient au meurtre des infidèles. Et que je te mêle les images de décapitations ou de lapidations des adultères saoudiens ou des homos au Brunei, du mystique vaudois Jean-Abraham Davel ou de Michel Servet cramé par Calvin, présent contre passé, Sud contre Nord ou inversement, Noirs contre Blancs, femmes à barbes contre juifs intégristes, tout devenant si confus que rien n’a plus de sens : à devenir fou.Du syndrome de Saint-Georges à l’hystérie établieLe titre anglais de l’essai de Douglas Murray, The Madness of Crowds, « la folie des foules », rappelle évidemment les gesticulations grimaçantes des meutes musulmanes réagissant à la publication des Versets sataniques de Salman Rushdie ou des caricatures de Charlie-Hebdo, autant que les mouvements de protestation plus dignes (à nos yeux) suscités par les tueries parisiennes de janvier et de novembre 2015, notamment, mais les « foules » visées, qu’on pourrait dire aussi «la meute» ont cela de nouveau dans la société actuelle qu’elles ne se bornent plus à la rue ou aux grandes places à manifs mais s’étendent à la nébuleuse des médias et des réseaux sociaux où la diffusion des opinions et des slogans, des mots d’ordre et des tweets « influenceurs » atteint une vitesse et une intensité nouvelles, agressives sous couvert d’anonymat et jusqu’à l’appel au meurtre aveugle.Or le premier constat de Murray, portant sur la transformation récente de la société, tient à la disparition des « grands récits » idéologiques collectifs qu’ont représenté la religion ou politiquement, en Occident, le communisme, le fascisme et le libéralisme, tous porteurs de sens et tous partis en vrille.Et quel « récit » nouveau pour le XXIe siècle ? Au top de l’esprit d'époque occidental, en termes de grand nombre: le récit d’une nouvelle vertu fondée sur l’exigence universelle de justice (qui n’en voudrait pas ?), avec un nouvel Axe du Bien censé diriger chacune et chacun en matière de droits et de lois, s’agissant de la condition des femmes, des Noirs et des minorités sexuelles, avec une «préférence» inversée par rapport à la domination blanche et patriarcale, etc.Tout cela qui serait en somme légitime et magnifique, si ce n’est qu’on observe, depuis une vingtaine d’années, le remplacement des dogmes et préjugés anciens, bel et bien lestés d’injustice et de cruauté, par de nouveaux préjugés et dogmes revanchards, socialement invivables.« Evoquer le sort des femmes », écrit Douglas Murray, des gays, des individus d’origines ethniques diverses ou des transgenres est devenu non seulement une façon d’afficher sa compassion, mais aussi de démontrer une forme de moralité. Ainsi se pratique cette nouvelle religion. « Lutter » pour ces questions et plaider leur cause est devenu une façon de montrer qu’on est quelqu‘un de bien ».Et d’ajouter cette autre évidence: que ces aspirations reflètent «certaines des plus précieuses conquêtes de nos sociétés - étonnamment rares dans d’autres régions du monde. On compte soixante-treize pays où il est illégal d’être gay, et huit dans lesquels l’homosexualité est passible de la peine de mort. Dans certains pays du Moyen Orient et d’Afrique, les femmes se voient dénier les droits les plus fondamentaux. Des explosions de violence interraciale ne cessent d’éclater en divers points de la planète ».Or le paradoxe est qu’on présente les pays les plus avancés dans ces domaines comme étant parmi les pires. « Seule une société très libre peut autoriser - et même encourager les récriminations sans fin sur ses propres iniquités », commente Douglas Murray. Et de citer le philosophe australien Kenneth Minogue parlant de «syndrome de Saint-Georges à la retraite» à propos de cette surenchère vertueuse.«Après avoir occis le dragon, le valeureux guerrier parcourt la contrée en quête d’autres exploits glorieux : il lui faut de nouveaux dragons ». Et c’est alors qu’on entre dans le vif et le concret du sujet, à l’écart de toute idéologie : dans la chair vive des faits et des actes, pièces en mains.Dans La Philosophie devenue folle (Grasset, 2018), Jean-François Braunstein avait donné un premier aperçu de la déraison croissante des « élites » intellectuelles, plus précisément localisées dans les universités américaines, alors que Murray brasse plus large et propose un panorama très richement documenté, vivant et parfois accablant, souvent drolatique aussi, d’une profondeur très nuancées dans ses parties les plus sensibles.Subdivisé en quatre grands chapitres (Gay, Femmes, Race, Trans) et trois « entractes » évoquant les fondations marxistes de la nouvelle religion, l’impact de la technologie et donc des Big Data et des réseaux sociaux, et la notion de pardon, l’ouvrage, d’une parfaite clarté en dépit du caractère parfois très embrouillé de la matière traitée, est à la fois polémique, courageux et constructif.En lisant son premier chapitre consacré à la dérive du mouvement de défense de l’homosexualité, passé d’un juste combat à une mouvance politisée souvent vengeresse et intolérante dans sa nouvelle exigence de conformité, je pensais aux souffrances réelles, et persistantes, éprouvées par d’innombrables personnes toutes « tendances » confondues, tel le jeune Bobby Griffith suicidé à vingt ans, en 1982, à cause de l’intolérance religieuse de sa mère obnubilée par les préceptes bibliques, laquelle mère devint une militante ardente du mouvement LGBTQ.Ladite Mary Griffith, décédée en février dernier à l’âge de 85 ans, a en somme «pris sur elle» en (re)vivant dans sa chair le désespoir de son fils, sa trajectoire a fait l’objet d’un téléfilm grand public (Tous contre Bobby, avec Sigourney Weaver, en 2009) à la fois poignant et aussi « édifiant » que l’appel à la compréhension du pape Francesco, mais qui dira que le Bobby en question était meilleur que son frère, et qui jettera la pierre aux innombrables parents actuels s’inquiétant des « préférences sexuelles » de leurs enfants ou hésitant à soumettre leur garçon-fille ou leur fille-garçon à tel ou tel traitement hormonal de choc ?Les nouveaux inquisiteurssont autant d’« imams » autoproclamés…Tel est pourtant le constat, et combien étayé, de Douglas Murray (lui-même homo et pas plus fier de l’être que vous d’être né roux ou lesbienne) sur l’évolution et la radicalisation « politique » d’un mouvement désormais porté à sa pointe radicale à la survalorisation des gays, des femmes, des noirs ou des transsexuels, voire à la chasse aux nouveaux « dissidents » osant penser ou ressentir différemment : qu’à la violence intolérante on a fini par substituer son contraire caricatural usant des mêmes ressorts et raccourcis.À cet égard, Douglas Murray multiplie les exemples de nouvelle intolérance, tirés de polémiques parfois délirantes qui incluent des célébrités médiatiques ou universitaires et s’emballent sur les réseaux sociaux - hideux spectacle à vrai dire, où les nouveaux inquisiteurs n'ont rien à envier aux imams autoproclamés de l'islam radical.Mais comment résister à cette vague vertueuse ? Les conclusions du journaliste-essayiste, évidemment classé « à droite » et même menacé physiquement pour ses courageuses prises de position contre l’islamisme et l’hypocrisie européenne en matière d’immigration (dans un autre best-seller intitulé L'étrange suicide de l’Europe), ne sont pas d’un idéologue mais d’un observateur « sur le terrain » aussi sensible et plein de respect humain qu’intraitable à l’égard de la fausse vertu, qui propose d’aborder les vraies questions de la diversité humaine, s’agissant de la différence profonde entre hommes et femmes dans leur perception de l’amour physique ou de la question trop souvent évacuée de la maternité, de la vraie fraternité telle que la prônait un Martin Luther King ou de la prudence requise dans la qualification juste des victimes ou dans l’approche de l’intersexuation.Et si nous nous parlions autrement que par mails et tweets ? Et si nous cessions de tout ramener à de la politique tout en restant citoyens ? « Minimiser la différence ne revient nullement à prétendre que celle-ci n’existe pas », conclut Douglas Murray, « Il serait ridicule de supposer que la sexualité et la couleur de peau ne signifient rien. En revanche, partir du principe qu’elle signifient tout nous sera fatal ».Sur quoi, sœurs et frères, parlons d’autre chose, allons faire un tour dans les bois faute de pouvoir garder la distance sociale dans les bars, baisons tranquillement à la maison ou cultivons nos géraniums comme le vieux Godard, rions avec Rabelais et Molière et soyons réellement déraisonnables sans trop nous décapiter…Douglas Murray, La grande déraison. Race, Genre, Identité. Traduit de l’anglais par Daniel Roche. L’Artilleur, 457p.
Or ceux qui s’empressent, à gauche comme à droite, de «récupérer» politiquement et surtout idéologiquement, cet acte affreux, seront peut-être les mêmes qui taxeront, pour des motifs idéologico-politiques, l’attitude du «saint père» de joyeusement progressiste ou de coupablement laxiste.Dans les deux cas sans rapport apparent, les idéologies binaires trancheront, les réseaux sociaux s’enflammeront et les chefs d’Etat (le match Macron-Erdogan) se balanceront des caricatures en pleines gueules selon la logique des chaises de coiffeur rivales merveilleusement évoquée dans Le Dictateur de Chaplin et rappelée par René Girard dans sa description de la «montée aux extrêmes».Et que je te rappelle que certains pères de la Sainte Eglise en appelaient au meurtre des infidèles. Et que je te mêle les images de décapitations ou de lapidations des adultères saoudiens ou des homos au Brunei, du mystique vaudois Jean-Abraham Davel ou de Michel Servet cramé par Calvin, présent contre passé, Sud contre Nord ou inversement, Noirs contre Blancs, femmes à barbes contre juifs intégristes, tout devenant si confus que rien n’a plus de sens : à devenir fou.Du syndrome de Saint-Georges à l’hystérie établieLe titre anglais de l’essai de Douglas Murray, The Madness of Crowds, « la folie des foules », rappelle évidemment les gesticulations grimaçantes des meutes musulmanes réagissant à la publication des Versets sataniques de Salman Rushdie ou des caricatures de Charlie-Hebdo, autant que les mouvements de protestation plus dignes (à nos yeux) suscités par les tueries parisiennes de janvier et de novembre 2015, notamment, mais les « foules » visées, qu’on pourrait dire aussi «la meute» ont cela de nouveau dans la société actuelle qu’elles ne se bornent plus à la rue ou aux grandes places à manifs mais s’étendent à la nébuleuse des médias et des réseaux sociaux où la diffusion des opinions et des slogans, des mots d’ordre et des tweets « influenceurs » atteint une vitesse et une intensité nouvelles, agressives sous couvert d’anonymat et jusqu’à l’appel au meurtre aveugle.Or le premier constat de Murray, portant sur la transformation récente de la société, tient à la disparition des « grands récits » idéologiques collectifs qu’ont représenté la religion ou politiquement, en Occident, le communisme, le fascisme et le libéralisme, tous porteurs de sens et tous partis en vrille.Et quel « récit » nouveau pour le XXIe siècle ? Au top de l’esprit d'époque occidental, en termes de grand nombre: le récit d’une nouvelle vertu fondée sur l’exigence universelle de justice (qui n’en voudrait pas ?), avec un nouvel Axe du Bien censé diriger chacune et chacun en matière de droits et de lois, s’agissant de la condition des femmes, des Noirs et des minorités sexuelles, avec une «préférence» inversée par rapport à la domination blanche et patriarcale, etc.Tout cela qui serait en somme légitime et magnifique, si ce n’est qu’on observe, depuis une vingtaine d’années, le remplacement des dogmes et préjugés anciens, bel et bien lestés d’injustice et de cruauté, par de nouveaux préjugés et dogmes revanchards, socialement invivables.« Evoquer le sort des femmes », écrit Douglas Murray, des gays, des individus d’origines ethniques diverses ou des transgenres est devenu non seulement une façon d’afficher sa compassion, mais aussi de démontrer une forme de moralité. Ainsi se pratique cette nouvelle religion. « Lutter » pour ces questions et plaider leur cause est devenu une façon de montrer qu’on est quelqu‘un de bien ».Et d’ajouter cette autre évidence: que ces aspirations reflètent «certaines des plus précieuses conquêtes de nos sociétés - étonnamment rares dans d’autres régions du monde. On compte soixante-treize pays où il est illégal d’être gay, et huit dans lesquels l’homosexualité est passible de la peine de mort. Dans certains pays du Moyen Orient et d’Afrique, les femmes se voient dénier les droits les plus fondamentaux. Des explosions de violence interraciale ne cessent d’éclater en divers points de la planète ».Or le paradoxe est qu’on présente les pays les plus avancés dans ces domaines comme étant parmi les pires. « Seule une société très libre peut autoriser - et même encourager les récriminations sans fin sur ses propres iniquités », commente Douglas Murray. Et de citer le philosophe australien Kenneth Minogue parlant de «syndrome de Saint-Georges à la retraite» à propos de cette surenchère vertueuse.«Après avoir occis le dragon, le valeureux guerrier parcourt la contrée en quête d’autres exploits glorieux : il lui faut de nouveaux dragons ». Et c’est alors qu’on entre dans le vif et le concret du sujet, à l’écart de toute idéologie : dans la chair vive des faits et des actes, pièces en mains.Dans La Philosophie devenue folle (Grasset, 2018), Jean-François Braunstein avait donné un premier aperçu de la déraison croissante des « élites » intellectuelles, plus précisément localisées dans les universités américaines, alors que Murray brasse plus large et propose un panorama très richement documenté, vivant et parfois accablant, souvent drolatique aussi, d’une profondeur très nuancées dans ses parties les plus sensibles.Subdivisé en quatre grands chapitres (Gay, Femmes, Race, Trans) et trois « entractes » évoquant les fondations marxistes de la nouvelle religion, l’impact de la technologie et donc des Big Data et des réseaux sociaux, et la notion de pardon, l’ouvrage, d’une parfaite clarté en dépit du caractère parfois très embrouillé de la matière traitée, est à la fois polémique, courageux et constructif.En lisant son premier chapitre consacré à la dérive du mouvement de défense de l’homosexualité, passé d’un juste combat à une mouvance politisée souvent vengeresse et intolérante dans sa nouvelle exigence de conformité, je pensais aux souffrances réelles, et persistantes, éprouvées par d’innombrables personnes toutes « tendances » confondues, tel le jeune Bobby Griffith suicidé à vingt ans, en 1982, à cause de l’intolérance religieuse de sa mère obnubilée par les préceptes bibliques, laquelle mère devint une militante ardente du mouvement LGBTQ.Ladite Mary Griffith, décédée en février dernier à l’âge de 85 ans, a en somme «pris sur elle» en (re)vivant dans sa chair le désespoir de son fils, sa trajectoire a fait l’objet d’un téléfilm grand public (Tous contre Bobby, avec Sigourney Weaver, en 2009) à la fois poignant et aussi « édifiant » que l’appel à la compréhension du pape Francesco, mais qui dira que le Bobby en question était meilleur que son frère, et qui jettera la pierre aux innombrables parents actuels s’inquiétant des « préférences sexuelles » de leurs enfants ou hésitant à soumettre leur garçon-fille ou leur fille-garçon à tel ou tel traitement hormonal de choc ?Les nouveaux inquisiteurssont autant d’« imams » autoproclamés…Tel est pourtant le constat, et combien étayé, de Douglas Murray (lui-même homo et pas plus fier de l’être que vous d’être né roux ou lesbienne) sur l’évolution et la radicalisation « politique » d’un mouvement désormais porté à sa pointe radicale à la survalorisation des gays, des femmes, des noirs ou des transsexuels, voire à la chasse aux nouveaux « dissidents » osant penser ou ressentir différemment : qu’à la violence intolérante on a fini par substituer son contraire caricatural usant des mêmes ressorts et raccourcis.À cet égard, Douglas Murray multiplie les exemples de nouvelle intolérance, tirés de polémiques parfois délirantes qui incluent des célébrités médiatiques ou universitaires et s’emballent sur les réseaux sociaux - hideux spectacle à vrai dire, où les nouveaux inquisiteurs n'ont rien à envier aux imams autoproclamés de l'islam radical.Mais comment résister à cette vague vertueuse ? Les conclusions du journaliste-essayiste, évidemment classé « à droite » et même menacé physiquement pour ses courageuses prises de position contre l’islamisme et l’hypocrisie européenne en matière d’immigration (dans un autre best-seller intitulé L'étrange suicide de l’Europe), ne sont pas d’un idéologue mais d’un observateur « sur le terrain » aussi sensible et plein de respect humain qu’intraitable à l’égard de la fausse vertu, qui propose d’aborder les vraies questions de la diversité humaine, s’agissant de la différence profonde entre hommes et femmes dans leur perception de l’amour physique ou de la question trop souvent évacuée de la maternité, de la vraie fraternité telle que la prônait un Martin Luther King ou de la prudence requise dans la qualification juste des victimes ou dans l’approche de l’intersexuation.Et si nous nous parlions autrement que par mails et tweets ? Et si nous cessions de tout ramener à de la politique tout en restant citoyens ? « Minimiser la différence ne revient nullement à prétendre que celle-ci n’existe pas », conclut Douglas Murray, « Il serait ridicule de supposer que la sexualité et la couleur de peau ne signifient rien. En revanche, partir du principe qu’elle signifient tout nous sera fatal ».Sur quoi, sœurs et frères, parlons d’autre chose, allons faire un tour dans les bois faute de pouvoir garder la distance sociale dans les bars, baisons tranquillement à la maison ou cultivons nos géraniums comme le vieux Godard, rions avec Rabelais et Molière et soyons réellement déraisonnables sans trop nous décapiter…Douglas Murray, La grande déraison. Race, Genre, Identité. Traduit de l’anglais par Daniel Roche. L’Artilleur, 457p. -
Les zombies sont parmi nous
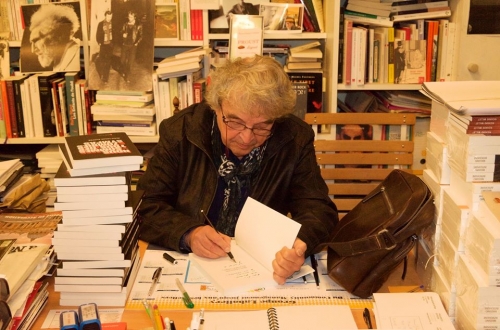
 Entretien, de JLK avec Livia Mattei, à la casa Rossa de Trieste, à l'occasion de la parution d’un libelle carabiné
Entretien, de JLK avec Livia Mattei, à la casa Rossa de Trieste, à l'occasion de la parution d’un libelle carabinéVient de paraître, chez Pierre-Guillaume de Roux, le 25e livre de JLK, intitulé Nous sommes tous des zombies sympas et constituant, sous l’appellation de «libelle», un brûlot virulent visant la massification globalisée (Nous sommes tous des Chinois virtuels), le nivellement de la littérature par les stéréotypes et la quête du succès à bon marché (Nous sommes tous des auteurs cultes), l’acclimatation de tout esprit critique à l’enseigne d’une nouveau conformisme «décalé» (Nous sommes tous des rebelles consentants), l’abaissement de l’Art au niveau d’un produit structuré soumis à la plus juteuse spéculation (Nous sommes tous des caniches de Jeff Koons), le déploiement d’une forme nouvelle de lynchage public à grande échelle (Nous sommes tous des délateurs éthiques), la dégradation du langage poétique devenant bavardage sentimental où chacun se la joue Rimbaud ou Minou Drouet sur les réseaux sociaux (Nous sommes tous des poètes numériques) et enfin le glissement progressif de l’humanité sympathique vers une espèce de plus en plus formatée, uniformisée et fardée à la manière des Anges de la télé et autres sous-produit du feuilleton Kardashian (Nous sommes tous des zombies sympas).
Composé dans l’urgence en moins de trois mois, ce livre dédié à la mémoire de Cristina Campo, Dominique de Roux et Philippe Muray - trois esprits supérieurement éclairés rompant d’avec la veulerie de temps qui courent -, l’ouvrage demandait, tant pour sa conception que pour sa réalisation, quelques explications que Livia Mattei, bien connue en Mitteleuropa cultivée pour l’alacrité sagace et la pénétration de ses lectures, a tenu à recueillir auprès de son vieil ami invité pour l’occasion dans sa demeure, dite Casa rossa, des hauts de Trieste…
1. Nous sommes tous des Chinois virtuels
Livia Mattei: - Votre dernier livre, caro, est immédiatement mordant par son écriture et la charge de son contenu, qui relèvent du pamphlet. Alors pourquoi l’appeler « libelle » alors même que, dès le premier chapitre, vous attaquez durement les deux Présidents de la Chine néo-maoïste et de la Suisse capitaliste participant au déni de mémoire de celle-là par opportunisme ?JLK: - Il se trouve que, par nature tant que par éducation, je préfère le judo au karaté. Autour de mes dix-huit ans, j’ai été marqué par l’enseignement d’un prof d’italien du nom de François Mégroz, qui nous faisait lire la Commedia de Dante et, au titre de ceinture noire, initia les garçons de la classe intéressés aux rudiments des mouvements élémentaires dits Uki-goshi ou Kesa-Gatame. Ce que j’en ai retenu est essentiellement qu’au lieu de frapper pour faire tomber son adversaire, mieux vaut préparer et accompagner sa chute en douceur en combinant Uki-Goshi (6emouvement du premier groupe du gokyo) avant de l’immobiliser au sol (Kesa gatame). En outre, tout s’oppose chez moi à la pratique binaire en matière de langage. Le pamphlet cogne de manière le plus souvent univoque. Le libelle pointe, pique et n’est pas sans s’inspirer, en tançant, de la danse immobilement vibratile de la libellule.
Lorsque Ueli Maurer, le Président de la Confédération helvétique en exercice, de passage à Pékin, déclare servilement qu’il faut « tirer un trait » sur le massacre de Tian’anmen, il incite aussi vivement à la pique que lorsque le président chinois à vie Xi Jinping donne aux Occidentaux plus ou moins pleutres, au forum économique de Davos, des leçons de libre échange. Mais cette entrée en matière « politique » ne tarde à déboucher, dans mon libelle, sur une réflexion beaucoup plus générale opposant ces « chinoiseries » très réelles à ce que j’appelle les Chinois virtuels que nous devenons tous peu ou prou.
L.M. : - Vous distinguez nettement, en effet, le Chinois virtuel du Chinois «plus que réel». Qu’est-ce à dire plus précisément ?
JLK: - Nous nous sommes écrits des billets bleus et verts, chère Livia, pendant plus de cinquante ans, et désormais nous « échangeons » par MESSENGER ou par SKYPE, et d’un CLIC nous « partageons » sur FACEBOOK. C’est ce que j’appelle devenir des Chinois virtuels. Par l’extension de la machine et par sa soumission à l’Empire commercial, quel qu’il soit. Je ne parle donc pas du Péril Jaune mais d’une uniformisation virtuelle qui, par la multiplication des images lisses et des mots sans chair, nous coupe de ce que j’appelle le plus-que-réel. Il va de soi que le massacre de Tian’anmen, ou la catastrophique pseudo-révolution pseudo-culturelle et ses millions de victimes, ne sont que des images symboliques, mais renvoyant à des faits combien réels. Plus-que-réels, mais qui ont été et continuent d’être niés, sauf par les esprits libres que je cite – un Simon Leys dans Les habits neufs du Président Mao,ou un Jean Pasqualini dans Prisonnier de Mao que lisait mon père dans les années 70 alors que je me débarrassais, de mon côté, de mes illusions de progressiste virtuel marxisant…
L.M: - Vous prétendez que vous avez cessé d’être gauchiste en mai 68 après avoir vu de près les barricades parisiennes. N’est-ce pas un raccourci ?
JLK: - Bien entendu. Je me suis éloigné du progressisme en m’efforçant de parler son langage, que j’ai vite ressenti comme une langue de bois, et surtout, à 19 ans, donc en 1966, en découvrant le socialisme réel en Pologne et l’usine à exterminer d’Oswiecim – Auschwitz en bon allemand. Mais j’ai mis bien plus longtemps à me défaire de toute idéologie, gauchiste ou réactionnaire, et c’est essentiellement contre l’idéologie que je ferraille dans ce nouveau livre…
L.M. : Qu’entendez-vous exactement par idéologie ?
JLK: Disons que c’est l’usage des idées soumis à tel ou tel système religieux, philosophique, politique, social ou commercial, plus généralement : utilitaire. L’idéologie marque la pétrification de la pensée. Tout langage argumentatif y succombe. La poésie seule y échappe, sauf quand elle retombe dans le prône, le catéchisme religieux ou politique ou la publicité.
L.M.: Vous vous en prenez violemment à ceux que vous appelez les jobards de l’intelligentsia parisienne, chantres du maoïsme dans les année 70, Sollers et consorts…
JLK: - L’épisode de la visite de la bande de la revue parisienne Tel Quelen Chine maoïste, relaté sans aucun recul par Julia Kristeva dans Les samouraïs, est en effet un moment emblématique de l’aveuglement des idiots utiles occidentaux, immédiatement pointé par Simon Leys, l’exemple à mes yeux de l’intellectuel intègre, mais traîné dans la boue par Le Monde où il était taxé d’agent d’influence américain. Philippe Sollers est retombé sur ses pattes avec l’habileté acrobatique qu’on lui connaît, mais un Alain Badiou n’en démord pas et les témoignages accablants sur cette époque se sont multipliés.
L.M.- Passons donc à la Chine plus que-réelle de Xi Jinping, que vous évoquez à propos du roman China Dreamde l’exilé Ma Jian…
JLK: - Oui, et là encore c’est au très regretté Simon Leys que je suis gré d’avoir découvert cet auteur, dont la satire du bonheur chinois actuel est carabinée, à la fois déchirante et salubre. Ma Jian est certes un intellectuel de haut vol, mais c’est d’abord un écrivain en pleine pâte, et c’est en quoi il relaie les fables contre-utopiques de Zamiatine (Nous autres), des Anglais Aldous Huxley (Le meilleur des mondes), et George Orwell (La ferme des animaux et 1984) ou du Polonais Witkiewicz (L’Adieu à l’automne etL’Inassouvissement), en travaillant sur la langue de bois du néo-communisme hyper-capitaliste de la Chine actuelle, avec laquelle la Suisse prétendument hyper-démocratique fricote par « pesée d’intérêt », comme elle fricote avec l’Arabie saoudite en fermant les yeux sur l’assassinat de Jamal Khashoggi…
L.M.: - Avez-vous honte d’être Suisse ?
JLK: - Pas plus que vous ne devez avoir honte d’être Italienne, bonne femme et restée bien belle. D’ailleurs je ne sais pas trop ce que signifie «être Suisse» dans un pays aussi composite que l’Europe où le paraître compte plus, en nombre, que l’être, et je sais assez quelles tueries séculaires, religieuses ou politiques, claniques ou idéologiques de tous bords ont abouti à cette entité viable qu’est la Suisse réelle d’aujourd’hui, que j’aime de plus en plus…
- Nous sommes tous des auteurs cultes
Livia Mattei:- Après la massification collectiviste, vous vous en prenez à l’idolâtrie publicitaire. Mais où et quand est apparu selon vous ce qu’on appelle l’auteur culte, voire cultissime ?
JLK.- Il me semble que le lancement du jeune Raymond Radiguet, vendu dans les années 1920 comme un savon par Grasset, annonce la couleur, en phase avec la première idolâtrie hollywoodienne d’importation. Le personnage devient plus important que son œuvre, ou plutôt son image fantasmée, comme celle de Sagan en voiture de sport.
L.M.: - Le type de succès même immense qu’ont connu un Victor Hugo ou un Edmond Rostand change alors de nature par le truchement de la publicité et des médias...
JLK: - Exactement, et le culte à l’américaine fabrique des mythes à foison qui seront recyclés dès les années 1960 par des modes impliquant les écrivains autant que les stars du cinéma ou de la chanson. Curieusement cependant les livres cultes et les auteurs cultes ne sont pas forcément les plus lus du grand public, notamment en France où un certain sens de la qualité et un certain snobisme font encore le tri avant le règne de la seule quantité. Un Henri Michaux est célébré comme un auteur culte à sa mort : quinte pages dans Libé ! C’est dire!
L.M.: - Vous amorcez votre aperçu des auteurs cultes contemporains avec Joël Dicker. Pourquoi cela ?
JLK: - Parce que la success story de ce wonderboy suisse idéalement mal rasé me semble emblématique. D’abord du fait de l’indéniable talent de storytellerdu jeune auteur, dont le premier succès est due aux libraires et aux lecteurs plus qu’à la publicité et aux médias , ensuite par le formatage du deuxième roman au niveau d’une série aussi niaise que fade, même si l’habileté technique y était encore. Mais tel est bien l’auteur culte des temps qui courent: c’est un habile. Votre Umberto Eco en est d’ailleurs un exemple probant, en plus smart que notre mini-Federer feuilletoniste...
L.M.:-Selon vous Joël Dicker ne serait pas un écrivain mais plutôt un écrivant...
JLK: - De fait, je reprends la distinction faite par Audiberti entre écrivains - auteurs de pleine pâte qui imposent un ton unique -, écriveurs- gens de plume faisant le meilleur usage de la langue mais sans originalité foncière, et écrivants qui usent d’un langage standard et fabriquent souvent des livres plus vendables que maints écrivains. On ne fera pas de ce classement un système, mais ça peut aider à un repérage graduel qui se perd aujourd’hui faute d’esprit critique ...
L.M : - Vous donnez ensuite l’exemple d’Anna Todd et de ses sex-sellersvendus par millions...
JLK: - C’est le fond de la nullité à succès, sur la base d’un journal de collégienne publié sur Internet, plébiscité par des millions de gamines et récupéré par un grand éditeur américain d’un opportunisme typique. Plus indigente qu’une Barbara Cartland, la bimbo texane préfigure le degré zéro du feuilleton ou la notion même d’auteur n’a plus de sens. L’obsession sexuelle n’y est d’ailleurs plus qu’une sanie de compulsion puritaine mais ça cartonne chez les zombies...

L.M. : - Et voici Michel Houellebecq. Tout autre animal !
JLK: - Et sûrement un écrivain, ça ne fait pas un pli, avec un ton et une tripe sans pareils. Vaut-il pour autant l’appellation d’ écrivain national comme l’a tiré récemment un magazine de la droite française ? Pauvre France alors : «pays défait» comme l’appelle Pierre Mari dans une salutaire lettre ouverte aux élites présumées et autres importants de l’insignifiance établie... Et poète, comme on l’a intronisé ? Mais quelle poésie de gadoue si l’on excepte quelques rayons sur la poubelle genre Bukowski chez les Deschiens. Cela étant le lascar est un médium social et psychologique remarquable, et son observation portée sur le langage actuel et les faux semblants idéologiques et culturels est d’une pertinence unique. Et puis il n’a cessé d’évoluer, et son bilan dermatologique semble s’améliorer...
Mais grand écrivain ? Comparez sa phrase et sa poétique à celles de Céline ou Proust, à Bernanos ou à dix autres stylistes du niveau d’Audiberti ou de Paul Morand, Giono ou Jacques Chardonne et revenons à la considération fine du degreehiérarchique chère à Shakespeare, etc.L.M.: - Vous prenez aussi la défense de l’auteur culte norvégien Karl Ove Knausgaard, contre ses détracteurs français, dont un Pierre Assouline...
JLK: - On a parlé à son propos d’un Proust norvégien, ce qui fait bondir nos chers Parisiens, qui le réduisent au rang d’un graphomane à santiags, ce qui me semble injuste même si son immense journal intime n’a rien de la tenue poétique de la Recherche ni de l’extraordinaire densité de l’univers proustien. Mais l’hypermnésie de son récit a bel et bien quelque chose de proustien, même si l'auteur lui-même se défend de cette écrasante comparaison, et je lui trouve une remarquable honnêteté dans son approche des êtres et un charme de vieux jeune homme plein de tendresse.
L.M. : - Enfin vous vous moquez plutôt de cette étiquette d’auteur culte ...
JLK: - Et comment, carissima ! Culte de quoi ? Plutôt cuculte, pour singer Gombrowicz ! Et qui en décide ? Voyez et concluez, en n’oubliant pas de tirer la chasse d’eau !
3. Nous sommes tous des rebelles consentants
Livia Mattei : - Avec ce troisième chapitre, vous abordez le thème contemporain du simulacre, maintes fois traité par Philippe Muray, et vous introduisez quelques personnages de la comédie médiatico-littérature de votre cru.
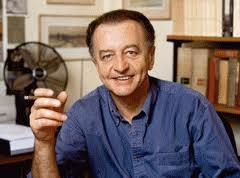
JLK : Philippe Muray, et avant lui un Jean Dutourd – un peu plus à droite – ou un Jacques Ellul – plutôt libéral protestant-, ont eu le mérite, dans le sillage du tonitruant Léon Bloy de l‘increvable Exégèse des lieux communs, de montrer, dans les formules du langage quotidien, comment est vécu et parlé le simulacre des nouveaux bien pensants. Bloy s’en prenait au bourgeois matérialiste et philistin, remplacé aujourd’hui par les faux rebelles qui prétendent « vivre dangereusement », si possible en « bravant les tabous ». Les fameux « bourgeois bohèmes », dits aussi « bobos » - dont on nous rebat un peu trop les oreilles à mon goût vu qu’il y a aussi plein de gogos dans les anti-bobos -, figurent cette posture du pseudo-rebelle célébrant tout ce qui « dérange ». Or j’ai trouvé, dans les rédactions que j’ai fréquentées, et surtout depuis ces vingt ou trente dernières années, les plus belles incarnations du genre. C’est ce qui m’a donné l’idée d’animer, dans un « open space » emblématique, quelques figures de ce petit théâtre de marionnettes sociales dont j’esquisse la satire sans trop forcer le trait…
- LM. :- Toute de même vous n’y allez pas avec le dos de la louche ! Vitre Douairière lettreuse, surveillante sourcilleuse du littérairement correct, ou votre Glandeur, dans le genre du journaliste culturel à tout faire du cynique et désabusé, ne sont pas dans un sac. C’est d’après modèle ?
JLK. : - Pas vraiment. Ou disons qu’il y a plusieurs personnages en un. Sauf celui que j’appelle le Tatoué, qui est unique et dont vous retrouverez l’extravagante figure sur Internet au nom d’Etienne Dumont. Or lui ne donne pas dans le simulacre : d’ailleurs c’est presque un artiste à sa façon, et la critique d’art qu’il pratique est la moins « branchée » qui soit. Quant à sa rébellion, elle se limite à peu près, en littérature, à la célébration aveugle du style de Jean d’Ormesson. Perversion sublime !
L.M. : - En matière de perversion, et pour en revenir au simulacre, c’est surtout le diluement de l’esprit critique que vous pointez sous les dehors d’un nouveau conformisme.
JLK :- Il faut (re)lire aujourd’hui la Lettre ouverte à ceux qui ont passé du col Mao au Rotary, de Guy Hocqenghem, datant de 1986. Cinq ans avant de mourir du sida, Hocqenghem fait le procès des rebelles de sa génération, de Cohn-Bendit à Finkielkraut en passant par Jack Lang, Serge July, BHL, Duras et bien d’autres. Mais les générations suivantes ont-elle tiré profit de cette amère missive ? Bien sûr que non…
L.M. : - Vous refaites aussi la trajectoire qui part du culte de Che Guevara, le révolutionnaire, à la mode des t-shirts ou des posters à la gloire de ce pseudo-messie politique.
JLK : - Et tout le folklore pseudo-rebelle, tout le micmac politico-commercial, et le putanat d’une culture prétendue « décalée » alors qu’elle obéit à tous les poncifs politiquement corrects et au triomphe de l’habileté creuse. À cet égard, le personnage que j’appelle l’Agitée, dans mon « open space » fictif, représente exactement ce nouvel avatar d’un journalisme culturel aux ordres des plans commerciaux de l’édition ou de la distribution cinématographique, revenant en somme à une sorte d’agent de publicité, non sans se dire rebelle évidemment au commerce et à l’industrie… Il va de soi que l’Agitée a son équivalent masculin dans les magazines et es radios, les librairies où elle et il multiplient les coups de cœur imposés par la tendance du moment, tout étant de plus en plus tendance et de plus en plus « du moment »…
- Nous sommes tous des caniches de Jeff Koons
Livia Mattei : - Le quatrième chapitre de votre libelle, consacré à l’art dit contemporain, même s’il n’en représente qu’une partie, démarre à fond de train puisque vous y taxez Jeff Koons, le plus grand «vendeur» actuel de charlatan…
JLK : - Charlatan est bien le mot dans l’absolu que représente l’Art méritant une majuscule et une révérence point forcément pieuse mais non moins sincère, de Lascaux à Nicolas de Staël, mais vous aurez remarqué que je nuance le terme en présentant notre ami Jeff comme un manager capable et un spéculateur cynique aussi avisé que le bateleur actuel de la Maison-Blanche. En fait, plus que cet habile crétin milliardaire qui a su recycler à sa façon toutes les resucées pseudo-avant-gardistes de son époque, dans la lointaine filiation de Marcel Duchamp ou sur les traces plus récentes de Warhol & Co, ce sont ses laudateurs extraordinairement complaisants que je vise, galeristes en vue ou conservateurs, critiques ou historiens d’art, qui ne cessent de glorifier ses babioles de luxe, jusqu’à la dernière enchère du Balloon Dogvendu à plus de 55 millions de dollars. Je vise les pontes de Beaubourg ou de la Fondation Beyeler qui se foutent du public avec des hymnes d’une vacuité prétentieuse sans pareils, et toutes celles et tous ceux qui en rajoutent comme à propos d’un Damian Hirst et de pas mal d’autres stars momentanées du Marché de l’Art. Faites un tour dans les archives de la Toile et vous verrez que pour un Jean Clair, lucide et implacable connaisseur à qui on ne la fait pas, la majorité des commentateurs se couchent…
L.M. - Votre premier coup de gueule date de 1992, à Lausanne. C’était encore du temps de notre délicieuse Cicciolina…
JLK : - C’était l’hiver, il faisait froid, nos amies les Brésiliennes ou les Roumaines se les gelaient sur les trottoirs de l’ancien quartier industriel du Flon, et c’est là, dans un ancien atelier de tanneur recyclé en loft de luxe, j’ai découvert, au milieu de toute une société de snobards de nos régions, les fellations ravissantes et les sodomies reluisantes de Jeff et sa putain mauve, traité en délicates teintes sulpiciennes, à 75.000 dollars la pipe et 150.000 dollars le caniche de bois polychrome, la truie ou la verge du Maître en matière polymère…
L.M.- Vous étiez alors chroniqueur littéraire à 24 Heures,mais vous avez commis un édito d’humeur qui vous a presque valu un procès…
JLK : - Comme je traitais la galerie de porcherie modèle et plaignais les péripatéticiennes de la rue voisine moins bien traitées, l’épouse de trader new yorkais qui tenait la boutique a failli me traîner en justice, mais un abondant courrier de lecteurs m’a valu d’y couper, alors même qu’un artiste branché de la place me taxait de censeur à la Goebbels. Mais ça n’est qu’un début anecdotique, avec la série porno de Made in Heaven, après laquelle Jeffie allait frapper beaucoup plus fort « à l’international »…
L.M. – Ce qui me touche, c’est que vous parlez surtout, entre vos diatribes, de l’Art qui vous tient à coeur…
JLK : Je ne suis pas un spécialiste ni un critique d’art, mais j’aime la peinture depuis l’âge de treize ou quatorze ans, quand j’ai découvert les coulures vert sombre ou les moires à multiples noirs des murs de Paris d’Utrillo, et un bon prof à lavallière m’a entraîné ensuite dans les jardins provençaux de Cézanne, les jardins marins de Gauguin et les jardins méditerranéens de Bonnard, et c’était parti pour rencontrer un jour Joseph Czapski et devenir l’ami de Thierry Vernet, très humbles et très admirables artistes partageant en outre une admiration presque sans bornes pour l’un des derniers représentants de la grand peinture occidentale en la personne de Nicolas de Staël. Donc au pamphlet s’oppose l’exercice amoureux…
L.M. - Comme vous rappelez le conformisme des pseudo-rebelles, dans le chapitre précédent de votre libelle, vous vous en prenez à ce qu’on pourrait un nouvel académisme à verni progressiste, consacré par des collectionneurs fortunés et répertorié comme dans une Bourse…
JLK :- Jean Clair, dans cet essai salubre qui s’intitule L’Hiver de la culture, décrit assez exactement le processus qui a permis à un pseudo-artiste comme Jeff Koons - dont on peut rappeler qu’il a fait lui aussi ses débuts comme trader à Manhattan -, de développer ses sociétés de bricolage de luxe « à l’international », citant ce bunker bâlois, nommé le Schaulager, où sont stockées les œuvres les plus intéressantes du point de la spéculation, au gré des décideurs qui manipulent le Marché de l’Art à leur guise. En Suisse, nous avons ensuite de sports-francs qui facilitent le transit de ces « produits structurés » en 3 D, si j’ose dire. Tout cela pour convenir, carissima Livia, que le prétendu progressisme de Jeff Koons, si proche du peuple n’est-ce pas, célébré par l’impayable Bernard Blistène, lors de la rétrospective Koons à Beaubourg relève de la pure foutaise…
L.M. : Après Lausanne, Bilbao, Versailles, Beaubourg et Bâle, vous revenez en votre pays pour administrer une taloche posthume au très officiel influenceur local que fut Pierre Keller en terre vaudoise…
JLK : Bah, c’est en effet le serpent qui se mord la queue, et je ne vais pas cracher sur le joli cercueil de Pierre Keller décoré par le plasticien millionnaire John Armleder, mais le fait est que, des pissotières de Los Angeles, constituant son premier sujet de photographe-plasticien, au culs de chevaux et autres étapes dans le pseudo-conceptuel, avant sa vraie carrière de manager post-scolaire et de notable concélébré par tous les amateurs de vins et de beaux discours, ce Vaudois parfaitement aligné, jusque dans sa gay-attitude joviale, n’aura pas manqué de célébrer verbalement les idoles du Marché de l’Art que sont devenus un Jeff Koons ou un Damian Hirst, proclamant lui-même en tant que fondateur et directeur de l’ECAL Ecole cantonale d’art de Lausanne) : « Avant de leur apprendre à devenir artistes, j’apprends à nos élèves à se vendre »…
- Nous sommes tous des délateurs éthiques
Livia Mattei : - Après les faux rebelles et les faux artistes, vous vous en prenez aux moralistes à la petite semaine, et là ça semble vous faire plus mal, non è vero caro ?
JLK : - On ne peut rien vous cacher, et c’est vrai que ce chapitre m’a donné pas mal de fil de fer barbelé à retordre vu que le sujet de la dénonciation est aujourd’hui aussi compliqué que délicat. Mais je le devais à Pierre-Guillaume, qui est devenu mon ami principal en un peu plus d’une année et qui a subi, à travers l’un de ses auteurs, un épisode de lynchage médiatico-littéraire d’une indescriptible violence…
L.M. - Vous voulez parler de Richard Millet…
JLK : - Précisément. Un auteur que je connaissais assez mal alors que j’ai dans ma bibliothèque plusieurs de ses livres, et qui m’avait un peu agacé avec ses prises de positions publiques sur la mort du roman et la nullité de la littérature française actuelle. J’avais en outre lu, avec un réel intérêt, son essai intitulé Langue fantôme, où il évoque le délabrement de la langue et du style, et son « éloge littéraire » d’Andres Breivik, malgré son titre évidemment choquant au lendemain de l’ignoble massacre d’Utoya, ne m’était pas apparu pour autant comme une défense du terroriste en question, mais je n’avais guère suivi « l’affaire Millet » que de loin, et voilà que Pierre-Guillaume me raconte en détail ce qu’il en a été et m’offre Ma vie entre les ombres, admirable roman de chair et de terre qui me ramène à La Confession négativeet me fait réviser mon jugement avec pas mal de bémols sur le côté parano et catastrophiste des essais de l’auteur, tel L’Opprobre…
L.M.- Richard Millet n’occupe cependant qu’une partie de votre réflexion sur la délation, qui remonte pour vous en enfance…
JLK. - J’en ai même fait une affaire personnelle, et c’est en quoi mon libelle est autre chose qu’un pamphlet, puisque j’y implique mon infime personne, évoquant la honte que j’ai éprouvée, à dix ans, dans une chambre d’hôpital partagée avec une vingtaine de jeunes lascars très bruyants, après que j’ai alerté la veilleuse de nuit pour qu’elle fasse taire ces emmerdants qui empêchaient de dormir le petit martyr que j’étais au lendemain de mon opération. J’avais dénoncé et plusieurs jours durant j’ai subi le juste mépris de mes compagnons, et le plus fort est que je leur ai donné raison, et le résultat est que j’en ai tiré depuis un onzième commandement personnel : tu ne cafteras point…
L.M. : - Vous ne mettez pas pour autant en cause la dénonciation pour juste cause…
JLK : - J’ai été un lecteur du Canard enchaînédepuis l’âge de 14 ans et ne renie rien des mes indignations, mais la délation est autre chose, et j’en donne des exemples précis…
L.M : - Vous rappelez le sort subi par votre ami Dimitrijevic, dont vous ne partagiez pas pour autant la passion nationaliste…
JLK : - Je me suis éloigné de Dimitri pendant quinze ans, mais jamais ne l’ai dénoncé dans mon journal, et ce sont des raisons humaines bien plus que politiques qui m’ont éloigné de lui. En revanche, j’ai trouvé infâme l’attitude de certains, à commencer par le littérateur Yves Laplace, dans un livre hideux, qui l’a accablé et a vilipendé L’Âge d’Homme en se la jouant justicier vertueux. Par ailleurs, il est très intéressant de voir, à ces moments-là, le délateur sortir du bois – on en apprend alors un peu plus sur l’abjection humaine.
L.M. Vous citez aussi le cas étonnant du cinéaste Fernand Melgar traîné dans la boue par « la profession » alors qu’il dénonçait lui-même les dealers de rue à Lausanne…
JLK : - On peut discuter de la façon un peu maladroite de Melgar de s’en prendre sur Facebook, avec des images non floutées, aux dealers illico assimilés à des victimes par les nouveaux bien pensants, et j’ai trouvé répugnante la lettre collective le dénonçant, mais un autre procès, non moins ignoble, lui avait été intenté au festival de Locarno quelques années plus tôt par le président portugais du jury Paulo Branco - la vertu socialisante incarnée , qui avait taxé son film Vol spéciald’ouvrage fasciste au motif qu’il ne dénonçait pas assez les petits fonctionnaire suisses chargés d’encadrer les requérants d’asile déboutés. Il va de soi que le film en question n’est en rien fasciste, mais Branco illustrait parfaitement les relents de stalinisme de sa génération… Tout ça fait mal quand on pense que Melgar est l’un de nos cinéastes qui documente la réalité d notre pays avec le plus d’attention et non sans sensibilité plutôt « de gauche »…
L.M : - Vous abordez aussi, sans trop vous y attarder, à la vague de dénonciations découlant de l’abus sexuel, et là encore vous y allez d’anecdotes personnelles…
JLK : - De fait, je me sens pas du tout à l’aise dans ce qui se veut un immense et salutaire débat, et je comprends tout à fait que nos filles abondent dans les sens des indignées pour les motifs qu’on sait ; j’évoque d’ailleurs en passant le classique épisode de l’adolescent mignon pris en auto-stop par un adulte barbu et couillu qui lui fait des propositions, puisque je l’ai vécu, ou cet épisode familial qui nous a forcés à traîner un abuseur caractérisé au procès où il a écopé de quatre ans de prison, mais je me méfie des grand mouvements de vertu collectifs, des gesticulations dans un sens ou l’autre, de l’utilisation opportuniste de ces nobles causes et de tout ce que camoufle ce vertueux combat en matière de ressentiment ou de vengeance. Je ne sais pas… J’ai lu il y a quelque temps Mon père, je vous pardonne, le témoignage de Daniel Pittet qui, enfant de chœur issu de famille défavorisée, se faisait violer quatre ans durant par le curé Joël Allaz de si bonne réputation, et le fait est que Daniel Pittet a dénoncé et fait reconnaître d’autres crimes trop souvent enterrés, et comment le lui reprocher ? Cependant je persiste à croire que la délation est autre chose, et la figure humaine du corbeau me reste odieuse, allez savoir pourquoi…
L.M. Ne comptez pas sur moi pour vous répondre, caro, et reprenons donc plutôt un verre de cet excellent Brunello di Montalcino…
- Nous sommes tous des poètes numériques
Livia Mattei : - Il me semble ressentir, dans ce chapitre où vous en prenez à la banalisation de la poésie, autant qu’à ses aspects guindés voire prétentieux, une implication très personnelle, voire affective, de votre part…
JLK : - Je tiens en effet à ce chapitre plus qu’à tous les autres, qui achoppe au noyau de la littérature de tous les temps et de partout, d’abord à l’oral puis à l’écrit. Je me suis adonné sans conseil ni pression de quiconque, entre l’âge de 13 et de 15 ans environ, à l’exercice d’apprendre par cœur des milliers de vers dont j’empruntais le contenu à une vaste anthologie de la Guilde du livre trouvée dans la bibliothèque paternelle, avec une préférence marquée pour la poésie imprégnée de sentiments délicats de Verlaine et de Musset, tous deux musiciens de la langue s’il en fut, mais aussi de Baudelaire et avant lui du sommital Victor Hugo dont Audiberti affirme qu’après lui plus grand chose ne résiste, et des choses d’Apollinaire ou plus longues de Saint-John -Perse dont ce vers qui ne veut rien dire me reste en mémoire : « Les spasmes de l’éclair sont pour le ravissement des princes en Tauride…
- Vous écriviez-vous-même de la poésie ?
JLK : - Non, du tout, ou alors plus tard, quand je me suis passionné pour l’œuvre de René Char, très riche elle aussi en beaux morceaux obscurs, sinon macaroniques voire incompréhensibles à la façon surréaliste, dont je retenais surtout la sensualité tellurique et les aphorismes tranchants ou lumineux, à quoi je m’essayais à mon tour. Entretemps j’avais oublié tout ce que j’avais appris par cœur, mais l’attention la plus vive à la matière et à la musicalité de la langue m’est restée, ressurgie quand j’ai découvert le lyrisme inouï d’un Charles-Albert Cingria, qui n’a pas pondu le moindre vers mais qui écrit et décrit le monde en poète inspiré, en rupture instinctive avec le « voulu poétique »…
L.M. – Le Printemps de la Poésie, que vous attaquez immédiatement dans ce chapitre, c’est du « voulu poétique » ?
JLK. -C’est forcément du « voulu poétique » à partir du moment où l’institution plus ou moins étatique s’impose en subventionnant toute sorte d’actions visant à visibiliser du « voulu poétique » sur les murs de Paris ou dans les couloirs des piscines de province, et je brocarde immédiatement l’Université de Lausanne qui fait de son Printemps de la poésie une opération marketing avec cheffe de projet et flopée d’« events ».
L.M. :-Vous êtes contre la popularisation de la poésie ?
JLK : - Pas du tout, au contraire, mais le « voulu poétique » est le contraire de la poésie, tant au dévaloir quotidien des réseaux sociaux où le moindre coucher de soleil et le moindre état d’âme font ruisseler les sentiments sentimentaux de pacotille, qu’au pinacle de la prétention « poéticienne ». Il existe en effet, ma chère Livia, dans les universités en train de « réseauter » la poésie du monde entier, des unités, voire des pôles de « poéticiennes » et de « poéticiens » qui se prennent très au sérieux – et j’évoque la terrible gravité d’un de ces « poéticiens», du nom de Philippe Beck, ponte respecté de l’institution littéraire française au plus haut niveau et dont je détaille les perles du recueil intitulé Dans de la nature, d’une prétention pseudo-novatrice et d’une nullité musicale confinant au plus haut comique. D’un côté, vous avez donc le « voulu poétique » affligeant du tout-venant numérique, et de l’autre celui des élites se congratulant entre « frères » et « sœurs » de la congrégation poétique où, soit dit en passant, les faux modestes et les vrais teigneux s’affrontent plus fielleusement que dans aucune autre sphère du milieu littéraire.
L.M. : - Mais là encore, carissimo, vous ne vous en tenez pas aux piques, puisque la vraie poésie vous tient à cœur…
JLK : - Je ne sais pas plus que vous ce qu’est exactement la « vraie poésie », mais je sais distinguer, je crois, ce qui n’en est pas. Je cite, à ce propos, un extrait d’un essai d’Adam Zagajewski, poète polonais qui est de de ceux aujourd’hui qui me touchent le plus, et qui formule la même perplexité. Je cite aussi le pamphlet de Gombrowicz Contre la poésie, qui sait lui aussi ce qui n’est pas de la poésie mais dont je crains qu’il ne m’apprenne rien de bien intéressant sur la « vraie » poésie, au contraire d’un Mandelstam ou d’un Brodsky, d’un Yves Bonnefoy ou d’un Claudel qui sont à la fois poètes et penseurs de la poésie sans poser aux « poéticiens ».
L.M. : La poésie est-elle traduisible ? Vous citez un poème de Zagajewski traduit en italien, puis un autre en français. Pensez-vous que l’un ou l’autre restituent la version polonaise ?
JLK : - Probablement pas, mais ce que me disent ces poèmes traduits me touche plus que d’innombrables poèmes composés en vers libres ou réguliers français, et je lis le Canzoniere d’Umberto Saba, votre voisin triestin, dans sa jolie version manuscrite italienne avant de consulter la traduction française pour corriger ou compléter le texte dont j’ai goûté la musique sans percevoir mainte nuances et détails.
L.M. - Que pensez-vous de l’appréciation d’un Michel Houellebecq, qui prétend que la poésie de Prévert est d’un « con ».
JLK : - Je pense que c’est le jugement d’un occasionnel imbécile, lui-même très mauvais poète et jugeant Prévert sous l’aspect de son petit message anar plus que de son lyrisme réel. Houellebecq intronisé dans la collection Poésie de Gallimard, c’est de la pure foutaise, même si quelques-unes de ses strophes ont un certain charme déglingué à la Bukowski, ceci dit je trouve que les romans de l’amer Michel découlent bel et bien d’une certaine « poétique », qi n’a rien précisément de « voulu poétique »…
L.M. - Voulez vous enfin, à l’heure du limoncello. Nous citer ce que vous tenez pour un beau poème.
JLK. Mais bien volontiers, et je le cite d’ailleurs in extenso dans la foulée de mon libelle, que j’emprunte au très pur et très nervalien poète romand Edmond-Henri Crisinel, et qui s’intitule La Folle.
« Elle a les cheveux blancs, très blancs. Elle est jolie
Encore, dans sa robe aux chiffons de couleur.
Elle emporte, en passant, des branches qu’elle oublie :
Les jardins sont absents et morte est la douleur.
Elle a des yeux d’enfant qui reflètent les jours,
eaux transparente où passe et repasse une fuite.
Sa sagesse est donnée avec des mots sans suite.
Des mots divins qui vont mourir dans le vent lourd ».- Nous sommes tous des zombies sympas
Livia Mattei : - Le dernier chapitre de votre libelle achoppe, plus encore que les précédents, aux pires aspects de la crétinisation contemporaine, du feuilleton des Kardashian aux expositions « artistiques » de cadavres plastinés importés de Chine, entre beaucoup d’autres exemples. Cependant, comme votre concept du « Chinois virtuel », vos « zombies » englobent une humanité en déroute qui ne se borne pas aux « freaks » du cinéma américain...
JLK :- Le premier titre du libelle était « Nous sommes tous des génies sympas », par allusion à l’idéologie du tout-culturel chère à Jack Lang, notamment, qui proclamait que tout un chacun est un Rimbaud ou un Mozart en puissance et que le street artdes tags vaut bien les fresques de la Renaissance. Puis, en me rappelant la jeunesse californienne dorée et dévertébrée que décrit Bret Easton Ellis dans un recueil de nouvelles paru en français sous le titre de Zombies, précisément, alors que le titre anglais était The Informers- et cela tombait au moment où je lisais l’espèce de journal rétrospectif autocritique de White, du même « auteur culte », qui disait en interview que les vrais maîtres d la Maison-Blanche étaient actuellement le clan glamour des Kardashian, milliardaires par excellence de l’empire du vide -, ainsi me suis-je dit que l’image du mort-vivant « sympa » serait mieux appropriée à l’évocation d’une humanité en voie de déshumanisation qu’une «star » de la philosophe américaine se félicite de voir accéder au stade suprême de l’épanouissement « naturel » sous forme de compost…
L.M. : Vous achoppez au pire de la culture américaine, mais aussi au meilleur…
JLK : - J’ai cité la géniale Annie Dillard dès le premier chapitre du libelle, et ce n’est pas pour me faire bien voir des néo-féministes d’outre-Atlantique, dont je ne sais d’ailleurs ce qu’elles pensent de cette étrange paroissienne imprégnée par la lecture d’Emerson et des hassidim, de Teilhard de Chardin et des traités de sciences naturelles, sans parler de ses multiples explorations personnelles aux quatre coins du monde. Ce dont je suis sûr est que la pensée d’Annie Dillard – et quand je dis pensée j‘englobe son écriture hautement poétique, ses récits de voyages et ses méditations, ses romans et ses observations sur toutes choses - est à mes yeux, aujourd’hui, l’une des plus vivifiantes et je dirai même l’une des plus belles, comme je le dirai à propos de la pensée et de l’écriture de Cristina Campo que Pierre-Guillaume m’a fait découvrir récemment et à laquelle j’ai aussitôt adhéré: la pensée est portée par la beauté.
L.M.- Vous ne vous réclamez d’aucun système philosophique ?
JLK :Hélas, dès que je perçois le système, j’ai la même réaction de rejet qu’envers l’idéologique : je décline poliment. Cela m’est même arrivé avec un penseur que j’estime du premier rang, à savoir René Girard, dont la théorie relative au mimétisme devient parfois trop systématique, comme je le regrette en lisant la suite de ses essais sur Shakespeare, dans Les feux de l’envie,si passionnant au demeurant. Mes philosophes sont tous des écrivains, et mes penseurs à peu près tous des poètes, de Pascal à Chestov, de Montaigne à Rozanov, ou de Sénèque à cet étonnant brasse-tout de Peter Sloterdijk, de Witkiewicz le catastrophiste à Cingria le psalmiste. Et la perception du monde d’un Tchekhov ou d’un Jules Renard, et leur simplicité toute limpide d’expression, m’ont accompagné dès mes 18 ans alors que l’étudiant raté que j’ai été bâillait aux explications du prof husserlien qui nous chantait de l’Hegel ou de l’Heidegger…
L.M. – Vous vous flattez, cabotin que vous êtes, de n’être titré que de votre université buissonnière, mais ce dernier chapitre accorde un place notable au Sorbonnard Jean-François Braunstein, auteur de La Philosophie devenue folle paru à la fin de l’an dernier…
JLK : J’ai reconnu en Jean-François Braunstein un honnête homme au sens le plus élevé, un prof comme j’eusse aimé en avoir à vingt ans au lieu des bonnets de nuit que j’ai subis ( ou bien apprendre la philo avec un Bachelard, un Jankélévitch ou un Gilson…), je l’ai d’abord rencontré en 3 D chez Yushi, à la table de Roland, ce venu par la suite un ami épistolaire après lecture et présentation de son ouvrage, mais mon enthousiasme n’a rien à voir avec du copinage : sa présentation polémique des dérives mortifères de la philosophie américaine et du nivellisme qu’elle opère au niveau des genres et des gens confrontés à la vie ou à la mort, est des plus toniques. Je ne connaissais mal ou que de loin les théories « starisées » d’un Peter Money, gourou délirant se faisant le chantre « scientifique » de la « pédophilie douce » et de « l’inceste consenti », ou d’une Donna Haraway flanquée de sa chienne Cheyenne qui m’a rappelé les dérives parascientifiques ou pseudo-mystiques d’un Philip K. Dick, et je sais donc gré à notre ami de nous avoir éclairés sur ces diverses théories qui me semblent préfigurer le monde nivelé des zombies… Il me suffit par ailleurs de lire trois pages de Judith Butler, une autre de ses cibles, dont l’écriture est un aussi illisible salmigondis que celle d’un Bourdieu dans ses Méditations pascaliennes,pour m’en détourner autant que des absurdes excès « animalitaires » d’un Peter Singer…
L.M. : Quel rapport avec les Kardashian ?
JLK :À mes yeux bien plus profond qu’on ne croirait, s’agissant d’une sorte de fuite de la vraie Réalité, à la fois mortelle et immortelle. Chez les Kardashian mondiaux je sens le zombie transhumaniste, comme dans les contes de fées flapies de la vieille Barbie Donna Harraway je constate que le survivant est une tautologie. Sacraliser notre compost est la négation même de toute poésie, qui m’horrifie plus encore que la vision des sorcières botoxées du clan Kardashian devenu le clan des pilleurs de tombeaux de partout aux lèvres dégoulinantes de pétrole.
L.M. - La poésie serait alors le contre-poison, plus que la philosophie ?
JLK : - À condition de ne pas « poétiser » la réalité. Ludwig Hohl, génie suisse allemand mal embouché et peu porté à dorer la pilule, affirme que « Celui qui n’a pas vu qu’il est immortel n’a pas droit à la parole », et je trouve le même genre de paradoxes apparents chez une Simone Weil, dans La Pesanteur et la grâce, ou dans cette autre suite d’essais d’Adam Zagajeski intitulée La Trahison et qui postule en passant que nous sommes tous, de naissance, des traîtres à notre vocation, laquelle est de ne rien faire d’autre que de renaître tous les matins et ressusciter comme si c’était Pâques, et c’est en effet Pâques tous les matins au ciel de la poésie, n’est-ce pas Livia ?
-
D'un lecteur l'autre
À propos de L’échappée libre. Feuilleton critique.
 Par Jean-Michel Olivier, écrivain.
Par Jean-Michel Olivier, écrivain.1. Du journal au carnet
L’entreprise monumentale de Jean-Louis Kuffer, écrivain, journaliste, chroniqueur littéraire à 24Heures,commence avec ses Passions partagées (lectures du monde 1973-1992), se poursuit avec la magnifique Ambassade du papillon (1993-1999), puis avec ses Chemins de traverse (2000-2005), puis avec ses Riches Heures (2005-2008) pour arriver à cette Échappée libre (2008-2013) qui vient de paraître aux éditions l’Âge d’Homme. Indispensable…
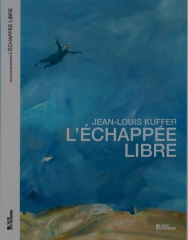 Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens, encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions delecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie.
Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens, encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions delecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie.À la base de tout, il y a les carnets, « ma basse continue, la souche et le tronc d’où relancer tous autres rameaux et ramilles. »
Ces carnets, toujours écrits à l’encre verte et souvent enluminés de dessins ou d’aquarelles, comme les manuscrits du Moyen Âge, qui frappent par leur aspect monumental, sont aussi le meilleur document sur la vie littéraire de ces quarante dernières années : une lecture du monde sans cesse en mouvement et en bouleversement, subjective, passionnée, emphatique.
2. Une passion éperdue
Ces carnets se déploient sur plusieurs axes : lectures, rencontres, voyages,écriture, chant du monde, découvertes.
Les lectures, tout d’abord : une passion éperdue.
Personne, à ma connaissance, ne peut rivaliser avec JLK (à part, peut-être, Claude Frochaux) dans la gloutonnerie, l’appétit de lecture, la soif de nouveauté, la quête d’une nouvelle voix ou d’une nouvelle plume ! Dans L’Échappée libre, tout commence en douceur, classiquement, si j’ose dire, par Proust et Dostoïevski, qu’encadre l’évocation touchante du père de JLK, puis de sa mère, donnant naissance aux germes d’un beau récit, très proustien, L’Enfantprodigue (paru en 2011 aux éditions d’Autre Part de Pascal Rebetez). On le voit tout de suite : l’écriture (ou la littérature) n’est pas séparée de la vie courante : au contraire, elle en est le pain quotidien. Elle nourrit la vie qui la nourrit.
Dans ses lectures, JLK ne cherche pas la connivence ou l’identité de vuesavec l’auteur qu’il lit, plume en main, et commente scrupuleusement dans ses carnets, mais la correspondance.C’est ce qu’il trouve chez Dostoiëvski, comme chez Witkiewicz, chez Thierry Vernet comme chez Houellebecq ou Sollers (parfois). Souvent, il trouve cette correspondance chez un peintre, comme Nicolas de Stäël, par exemple.
 Ou encore, au sens propre du terme, dans les lettres échangées avec Pascal Janovjak, jeune écrivain installé à Ramallah, en Palestine. La correspondance,ici, suppose la distance et l’absence de l’autre — à l’origine, peut-être, de toute écriture.
Ou encore, au sens propre du terme, dans les lettres échangées avec Pascal Janovjak, jeune écrivain installé à Ramallah, en Palestine. La correspondance,ici, suppose la distance et l’absence de l’autre — à l’origine, peut-être, de toute écriture.De la Désirade, d’où il a une vue plongeante sur le lac et les montagnes de Savoie, JLK scrute le monde à travers ses lectures. Il lit et relit sans cesse ses livres de chevet, en quête d’un sens à construire, d’une couleur à trouver,d’une musique à jouer. Car il y a dans ses carnets des passages purement musicaux où les mots chantent la beauté du monde ou la chaleur de l’amitié.
Un exemple parmi cent : « Donc tout passe et pourtant je m’accroche,j’en rêve encore, je n’ai jamais décroché : je rajeunis d’ailleurs à vue d’œil quand me vient une phrase bien bandante et sanglée et cinglante — et c’est reparti pour un Rigodon.. On ergote sur le style, mais je demandeà voir : je demande à le vivre et le revivre à tout moment ressuscité, vu que c’est par là que la mémoire revit et ressuscite — c’est affaire de souffle et de rythme et de ligne et de galbe, enfin de tout ce qu’on appelle musique et qui danse et qui pense. »
3. Aller à la rencontre
Lire, c’est aller à la rencontre de l’autre. Peu importent sa voix ou son visage, que la plupart du temps nous ne connaissonspas. Les mots que nous lisons dessinent un corps, un regard singulier, une présence qui s’imposent à nous au fil des pages. Et la plupart du temps, c’est suffisant…
Mais JLK est un homme curieux. Il dévore les livres,toujours en quête de nouvelles voix, passe son temps à s’expliquer avec ces fantômes vivants que sont les écrivains. Souvent, il veut aller plus loin. C’est ainsi qu’il part à la rencontre du cinéaste Alain Cavalier ou du poète italien Guido Ceronetti. Et la rencontre, à chaque fois, est un miracle. Correspondance à nouveau. Porosité des êtres qui se comprennent sans se vampiriser. JLK n’a pas son pareil pour nous faire partager, par l’écriture, ces moments de grâce.
 Dans L’Ambassade du papillon et dans Les Passions partagées, il y avait les figures puissantes (et parfois envahissantes) de Maître Jacques (Chessex) et de Dimitri(l’éditeur Vladimir Dimitrijevic, , deux personnages centraux de la vie littéraire de Suisse romande. L’Échappée libre s’ouvre sur les retrouvailles avec Dimitri, l’ami perdu pendant quinze ans.
Dans L’Ambassade du papillon et dans Les Passions partagées, il y avait les figures puissantes (et parfois envahissantes) de Maître Jacques (Chessex) et de Dimitri(l’éditeur Vladimir Dimitrijevic, , deux personnages centraux de la vie littéraire de Suisse romande. L’Échappée libre s’ouvre sur les retrouvailles avec Dimitri, l’ami perdu pendant quinze ans.Retrouvailles à la fois émotionnelles et difficiles, car le temps n’efface pas les blessures. Pourtant, JLK ne ferme jamais la porte aux amis d’autrefois et le pardon trouve toujours grâce à ses yeux. Brèves retrouvailles, puisque Dimitri se tuera dans un accident de voiture en 2011 avant que JLK ait pu vraiment s’expliquer avec lui. Mais pouvait-on s’expliquer avec le vif-argent Dimitri, dont la mort fut aussi dramatique que sa vie fut aventureuse ?
D’autres morts jalonnent L’Échappée libre :Maurice Chappaz, Jean Vuilleumier, Gaston Cherpillod, Georges Haldas. Un âged’or de la littérature romande. À ce propos, les hommages que JLK rend à ces grands écrivains (trop vite oubliés) sont remarquables par leur érudition, leur sensibilité et leur intelligence. Et toujours cette empathie pour l’homme etl’œuvre, à ses yeux indissociables.
4. Les secousses du voyage
Sans être un bourlingueur sans feu ni lieu (il est trop attaché à son nidd’aigle de la Désirade et à sa bonne amie), JLK parcourt le monde un livre à lamain. C’est pour porter la bonne parole littéraire : conférences sur Maître Jacques en Grèce ou en Slovaquie, congrès sur la francophonie au Congo,voyage en Italie pour rencontrer Anne-Marie Jaton, prof de littérature à l’Université de Pise, escapade en Tunisie avec le compère Rafik ben Salah, pour juger, de visu, des progrès du prétendu « Printemps arabe ». JLK voyagepour s'échapper, mais aussi pour aller à la rencontre des autres…
Chaque voyage provoque des secousses et des bouleversements, et JLK n’en revient pas indemne.
En allant au Portugal, par exemple, JLK se plonge dans un roman suisse à succès, Train de nuit pour Lisbonne de Pascal Mercier, qui lui ouvre littéralement les portes de la ville.
Sitôt arrivé, il y retrouve le fantôme de Pessoa et les jardins embaumés d’acacias chers à Antonio Tabucchi. La vie et la littérature ne font qu’une. Les frontières sont poreuses entre le rêve et la réalité.
Au retour, « le cœur léger, mais la carcasse un peu pesante », son escapade lusitanienne lui aura redonné le goût (et la force) de se mettre à sa table detravail. Car JLK travaille comme un nègre. Carnets, chroniques, « fusées » ou «épiphanies » à la manière de Joyce. Mais aussi le roman, toujours en chantier, le grand roman de la mémoire et de l’enfance qui hante l’auteur depuis toujours.
« La mémoire de l’enfance est une étrange machine, qui diffuse si longtempset si profondément, tant d’années après et comme en crescendo, à partir defaits bien minimes, tant d’images et de sentiments se constituant en légendeset se parant de quelle aura poétique. Moi qui regimbais, qui n’aimais guère cesséjours chez ces vieilles gens austères de Lucerne, qui m’ennuyais si terriblement lorsque je me retrouvais seul dans ce pays dont je refusais d’apprendre la langue affreuse, c’est bien là-bas que j’ai puisé la matière première d’une espèce de géopoétique qui m’attache en profondeur à cette Suisse dont par tant d’autres aspects je me sens étranger, voire hostile. »
Ce grand livre de la mémoire et des premières émotions, JLK le remetplusieurs fois sur le métier. Il s’appelle L’Enfant prodigue**, et le lecteur participe à chaque phase de son écriture, joyeuse ou tourmentée,exaltée ou empreinte de découragement. JLK nous raconte également lespéripéties de la publication de ce récit aux couleurs proustiennes, en un temps très peu proustien, assurément, obsédé de vitesse et de rentabilité.
À ce propos, JLK rend compte avec justesse des livres, souvent remarquables, qui, pour une raison obscure, passent à côté de leur époque.Claude Delarue et son Bel obèse, par exemple. Ou les romand d’AlainGerber. Ou même la poésie cristalline d’un Maurice Chappaz. Sans parler d’unVuilleumier doux-amer. Ou d’un Charles-Albert Cingria, trop peu lu, qui restepour JLK une figure tutélaire : le patron.
5. Suite et fin
Cette brève plongée dans L’Échappée libre serait très incomplète si je ne mentionnais l’insatiable curiosité de l’auteur, vampire avéré, pour les nouvelles voix de la littérature — et en particulier la littérature romande.
Même s’il n’est pas le premier à découvrir le talent de Quentin Mouron, il est tout de suite impressionné par cette écriture qui frappe au cœur et aux tripes dans son premier roman Au point d’effusion des égouts*. Oui, c’est un écrivain, dont on peut attendre beaucoup. De même, il vantera bien vite les mérites d’un faux polar, très bien construit, qui connaîtra un certain succès : La Vérité sur l’affaire Harry Québert**, d’un jeune Genevois de 27 ans, Joël Dicker. JLK aime allumer les mèches de bombes à retardement qui parfois font beaucoup de bruit…
On peut citer encore d’autres auteurs que JLK décrypte et célèbre à sa manière : Jérôme Meizoz, Douna Loup ou encore Max Lobe, extraordinaire conteur des sagas africaines.
 Toujours à l’affût, JLK est le contraire des éteignoirs qui règnent dans la presse romande, prompts à étouffer toute étincelle, tout début d’enthousiasme, et qui sévissent dans Le Temps ou dans les radios publiques. Même s’il se fait traiter de « fainéant » par un journaliste deL’Hebdo (comment peut-on écrire une ânerie pareille ?), JLK demeure la mémoire vivante de la littérature de ce pays, une mémoire sélective, certes, partiale, toujours guidée par sa passion des nouvelles voix, mais une mémoire singulière, jalouse de son indépendante.
Toujours à l’affût, JLK est le contraire des éteignoirs qui règnent dans la presse romande, prompts à étouffer toute étincelle, tout début d’enthousiasme, et qui sévissent dans Le Temps ou dans les radios publiques. Même s’il se fait traiter de « fainéant » par un journaliste deL’Hebdo (comment peut-on écrire une ânerie pareille ?), JLK demeure la mémoire vivante de la littérature de ce pays, une mémoire sélective, certes, partiale, toujours guidée par sa passion des nouvelles voix, mais une mémoire singulière, jalouse de son indépendante.Si cette belle Échappée libre s’ouvrait sur l’évocation du père et de la mère de l’auteur (sans oublier la marraine de Lucerne, berceau de la mémoire) et les retrouvailles émouvantes avec le barbare Dimitri, le livre s’achève sur la venue des anges. Une cohorte d’anges.
 Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce.
Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce.Dans ce désir des anges, qui marque de son empreinte la fin de cette lecture du monde, on croise bien sûr Wim Wenders et Peter Falk. On sent l’auteur préoccupé par ce dernier message qu’apporte l’ange pendant son sommeil. Message toujours à déchiffrer. Non pas parce qu’il est crypté ou réservé aux initiés d’une secte, mais parce que nous ne savons pas le lire.
Lire le monde, dans ses énigmes et sa splendeur, pour le comprendre et le faire partager, telle est l’ambition de JLK. Cela veut dire aussi : trouver sa place et son bonheur non seulement dans les livres (on est très loin, ici, d’une quelconque Tour d’Ivoire), mais dans le monde réel, les temps qui courent, l’amour de sa bonne amie et de ses filles.
Et les livres, quelquefois, nous aident à trouver notre place…
L’Échappée libre commence le premier jour de l’an 2008 ; et il s’achève le 30 juin 2013. Évocation des morts au commencement du livre et adresse aux vivants à la fin sous la forme d’une prière à « l’enfant qui vient ». Cet enfant a le visage malicieux de Declan, fils d’Andonia Dimitrijevic et petit-fils de Vladimir. C’est un enfant porteur de joie — l’ange qu’annonçait la fin du livre. « Tu vas nous apprendre beaucoup, l’enfant, sans t’en douter, Ta joie a été la nôtre, dès ton premier sourire, et mourir sera plus facile de te savoir en vie. »
Toujours, chez JLK, ce désir de transmettre le feu sacré des livres !
 Chaque livre est une Odyssée qui raconte les déboires et les mille détours d’un homme exilé de chez lui et en quête d’une patrie — qui est la langue. L’Échappée libreexplore le monde et le déchiffre comme si c’était un livre. L’auteur part de la Désirade pour mieux y revenir, comme Ulysse, après tant de pérégrinations, retrouve Ithaque.
Chaque livre est une Odyssée qui raconte les déboires et les mille détours d’un homme exilé de chez lui et en quête d’une patrie — qui est la langue. L’Échappée libreexplore le monde et le déchiffre comme si c’était un livre. L’auteur part de la Désirade pour mieux y revenir, comme Ulysse, après tant de pérégrinations, retrouve Ithaque.Il y a du pèlerin chez JLK, chercheur de sens comme on dit chercheur d’or.Une quête jamais achevée. Un Graal à trouver dans les livres, mais aussi dans le monde dont la beauté nous brûle les yeux à chaque instant.
* Quentin Mouron, Au point d'effusion des égouts, Olivier Morattel éditeur, 2012.
** Joël Dicker, La Vérité sur l'affaire Harry Québert, de Fallois-l'Âge d'Homme, 2012.
Cette suite de séquences critique se retrouve sur le blog personnel de Jean-Michel Olivier, observateur de la comédie romande: http://jmolivier.blog.tdg.ch/
-
Quand Georges Haldas et les Beats se déclinent en abécédaires…

 Une coïncidence éditoriale rapproche, comme la carpe et le lapin, l’un de nos plus vénérables écrivains et, aux bons soins de Jean-François Duval, un mouvement littéraire américain déjanté à l’enseigne de la Beat Generation. Mais la littérature est sans frontières et le jeu du rapprochement, non sans malice, est moins gratuit qu’il n’y paraît…En conclusion de la présentation, à la fois très érudite et très vivante, parce que très personnelle, qu’il a consacrée à la Beat Generation dans la collection le plus souvent didactique intitulée « Que sais-je ? », sous la forme d’un abécédaire dynamique, Jean-François Duval, fasciné en son adolescence par la découverte de Sur la route de Jack Kerouac, rend un bel hommage final à celui-ci, souvent tenu pour un auteur mineur par les « purs » lettrés, en introduisant la notion originale de «résonance» pour qualifier son œuvre, comme on parlerait du «rayonnement» de l’œuvre de Proust ou de l’ «aura» de celle de Joyce, toutes proportions gardées.Or cette qualification « musicale » d’une œuvre littéraire considérée dans son ensemble, pourrait convenir tout aussi bien à celle de Georges Haldas, me suis-dit, lisant l’éloge de Kerouac par Duval, après avoir achevé la lecture de cet autre abécédaire, posthume et conçu par le pasteur en retraite Serge Molla, que constitue le recueil de Fulgurances paru aux éditions Labor et Fides, dans leur Petite Bibliothèque de spiritualité, même si les deux auteurs diffèrent absolument par leur vécu, leur génération, leur façon de nouer leur cravate de laine (Haldas) ou leur foulard bohème (Kerouac) , leur écriture et leurs références existentielles ou poétiques, philosophiques ou religieuses, encore que l’un et l’autre ont trainé dans les mêmes caves métaphysiques de Dostoïevski, notamment.À maints égards, et malgré sa méfiance envers tous les pouvoirs et le peu de cas qu’il faisait des convenances sociales, on n’imagine pas un Haldas vibrer à la lecture des poètes de la Beat Generation, dont un poème aussi emblématique que le fameux Howl d’Allen Ginsberg lui eût sans doute paru du galimatias barbare, mais nombre de ses réflexions et méditations, dans ses Fulgurances, auraient pu en revanche intéresser et séduire les beatniks en quête de sens et de spiritualité, vivant à leur façon ce qu’il appelait « l’État de poésie », et comment ne pas voir que l’expérience baudelairienne des « minutes heureuses » était également au cœur de leurs recherches même diffuses ou confuses ?Minutes heureuses d’un pèlerin de l’AbsoluL’évidence d’un parcours, et plus encore d’un voyage spirituel quotidiennement incarné, s’impose au regard de l’œuvre immense de Georges Haldas (quelque 80 ouvrages répartis en carnets, essais, poèmes et traductions, notamment, mais sans une once de fiction), et c’est également à un parcours fléché que nous invite Serge Molla dans son choix de Fulgurances tirées des dix-huit carnets regroupés sous le titre de L’État de poésie, au fil d’un abécédaire dont les entrées sont souvent assorties de renvois, comme Diable renvoie à Christ, et Christ (l’entrée la plus largement développée) à Moïse, Résurrection et Universalité…Pour couper court à tout malentendu, s’agissant d’un recueil de citations extraites de leur contexte, à savoir des carnets inscrits dans le temps et ses fluctuations souvent contradictoires, gardons-nous, sœurs lectrices et frères lecteurs, de prendre cet Haldas fragmentaire comme un distributeur de vérités ou, pire, un ayatollah de la Pensée unique aux décrets péremptoires.À l’entrée « Péremptoire » juste avant « Permissivité », laquelle « déboussole les êtres au lieu de les enrichir », le scribe le proclame d’ailleurs : « Tout ce qui est péremptoire est le plus souvent faux ». Mais c’est bien lui qui affirmera, à l’entrée de « Sérénité », que « la notion de sérénité est une des plus sottes inventions de la philosophie », ou, à l’entrée de « Convivialité», qu’il ne s’agit là que d’une « stupide invention des sociologues », et d’y aller d’une vraie diatribe : « Une réunion de gens qui se retrouvent avec une soi-disant sympathie, est en fait un aquarium où se meuvent, dans les profondeurs de chacun, le mensonge, la jalousie, les arrière-pensées malveillantes, les sarcasmes secrets, quand ce n’est pas éa haine ou le mépris soigneusement tus. Et mille autres petits monstres qui se cachent sous les espèces d’une hypocrite bonne humeur « conviviale », laquelle n’est qu’une comédie pour moutons aveugles ».Et pan sur le barbecue ! Avec un coup de pied de l’âne évangélique à ceux qui ne trouveraient pas ça très chrétien : « Le Christ n’est pas venu au monde pour langer les bébés, tailler les haies et assurer les fins de mois. Ni pour jacasser avec les bavards »…Lesdits bavards prolifèrent en meutes sur les réseaux dit sociaux, qui ne sont qu’une « dissociété » hagarde, tandis que le poète unifie sans pontifier, et c’est là, dans ce qu’il appelle l’état de poésie (fondamentales entrées de « Poème », « Poésie » et «Poète » et plus encore de « Minutes heureuses ») que nous retrouvons Haldas en son noyau de « petite graine », pour user d'une de ses métaphores de jardinier céleste. D’un côté : « Les minutes heureuses sont, au temps de la vie courante, ce que les oasis sont au désert ». Et de l’autre : « Sans désespoir, pas de minutes heureuses ».Dès le début de l’abécédaire, à l’entrée d’«Abîme», l’ombre se mêlait illico à la lumière : « Qui ne connaît pas les abîmes ne connaît pas les hauteurs ». Et plus loin à l’entrée d’«Amour» : « Tout véritable amour impique la distance. Intègre, autrement dit, l’abîme. Le reste n’étant qu’attachement possessif. Poison mortel pour la relation ».Mot magique, chez le scribe qui vomit la magie et le charme : la Relation. À l’entrée «Solitude» on lira : « convertir le plus de solitude possible en relation », et dans la foulée. « Contrairement à tout ce qu’on peut penser, c’est la solitude qui nous prépare le plus à la relation ».Quoi de commun entre cette relation fondamentale, qui fait sans cesse référence à la Source, mot-clef de l’univers spirituel selon Haldas, et la « sociologie de la relation au monde » que développe le penseur allemand Hartmut Rosa autour du concept de Résonance, où le sentiment religieux se trouve revivifié à l’écart des dogmes et des églises ? Jean-François Duval, à partir des dernières étapes du parcours de Jack Kerouac, dans Vanité de Duluoz, esquisse un possible rapprochement, essentiellement fondé sur « la nécessité de faire vibrer le Verbe » par delà toute certitude…Clochards célestes, anges déchus et rédemption par le Verbe…Jean-François Duval, né en 1947, n’avait que huit ans lorsque La Fureur de vivre est sorti sur nos écrans, mais il en avait quinze ou seize lorsqu’il a lu On the Road de Jack Kerouac, et de James Dean à Elvis Presley, à la même époque, alors que nos profs fronçaient les sourcils en découvrant nos premiers jeans à l’américaine, sans se douter de la vague de fond que représenterait la première génération donnant le ton par sa jeunesse même, après deux carnages mondiaux - la jeunesse consommatrice – clientèle de premier rang – et productrice de ses propres mythes au temps de la libération sexuelle et du rock’n’roll, de la guerre au Vietnam et de la route vers Katmandou, véritable saga de la deuxième moitié du XXe siècle dont la « Beat Generation » cristalliserait sa légende autour de figures d’écrivains et de poètes non académiques, de Jack Kerouac et Neal Cassady à William Burroughs à Allen Ginsbreg, pour ne citer que les protagonistes.Plus encore qu’un « mouvement » littéraire ou culturel, et bien plus qu’une « école » d’époque, la Beat Generation brasse tous les éléments (perceptions nouvelles et contestation, mœurs privées et publiques, croyances, fusion du vivre et de l’écrire, etc.) que Jean-François Duval détaille avec autant de précision dans ses observations de journaliste «sur le terrain » et d’écrivain se disant lui-même « épigone », que d’intelligence critique dans ses mises en rapport des 100 mots où il se raconte lui-même en racontant le phénomène, avec une honnêteté lucide qui fait pièce à pas mal d’idées reçues et de clichés médiatisés.Sur les Beats « fêtards », l’image idéalisée des « clochards célestes », l’épanouissement sexuel de cette jeunesse présumée sans problèmes, leurs errances en matière de politique ou de religion, Duval apporte énormément de nuances en brossant une fresque bien vivante.Kerouac et Cassady magnifiés par la fiction de Sur la route et se cassant la figure dans les embrouilles de la vie, Ginsberg et Burroughs en visite chez Louis-Ferdinand Céline (en 1958) que l'affreux Bill compare à « un vieux concierge réactionnaire enveloppé en plein mois de juillet dans ses écharpes et ses couches de chaussettes », Ferlinghetti défiant la censure avec la publication du sulfureux Howl de Ginsberg aux mythiques presses de City Lights, la part d’ombre de ces « anges de la désolation » aux étonnantes accointances criminelles, et la part sublimée de leurs écrits échappant au Temps (le grand thème proustien de Kerouac), tout cela vit et vibre , comme le Verbe doit vibrer et vivre, entre l’A d’Adolescence et le Z de Ziggurat et de Zones de résonance…Georges Haldas. Fulgurances. Abécédaire. Labor et Fides, Petite Bibliothèque de Spiritualité, 2024, 279p.Jean-François Duval. Les 100 mots de la Beat Generation. Que sais-je ? 2024, 126p.
Une coïncidence éditoriale rapproche, comme la carpe et le lapin, l’un de nos plus vénérables écrivains et, aux bons soins de Jean-François Duval, un mouvement littéraire américain déjanté à l’enseigne de la Beat Generation. Mais la littérature est sans frontières et le jeu du rapprochement, non sans malice, est moins gratuit qu’il n’y paraît…En conclusion de la présentation, à la fois très érudite et très vivante, parce que très personnelle, qu’il a consacrée à la Beat Generation dans la collection le plus souvent didactique intitulée « Que sais-je ? », sous la forme d’un abécédaire dynamique, Jean-François Duval, fasciné en son adolescence par la découverte de Sur la route de Jack Kerouac, rend un bel hommage final à celui-ci, souvent tenu pour un auteur mineur par les « purs » lettrés, en introduisant la notion originale de «résonance» pour qualifier son œuvre, comme on parlerait du «rayonnement» de l’œuvre de Proust ou de l’ «aura» de celle de Joyce, toutes proportions gardées.Or cette qualification « musicale » d’une œuvre littéraire considérée dans son ensemble, pourrait convenir tout aussi bien à celle de Georges Haldas, me suis-dit, lisant l’éloge de Kerouac par Duval, après avoir achevé la lecture de cet autre abécédaire, posthume et conçu par le pasteur en retraite Serge Molla, que constitue le recueil de Fulgurances paru aux éditions Labor et Fides, dans leur Petite Bibliothèque de spiritualité, même si les deux auteurs diffèrent absolument par leur vécu, leur génération, leur façon de nouer leur cravate de laine (Haldas) ou leur foulard bohème (Kerouac) , leur écriture et leurs références existentielles ou poétiques, philosophiques ou religieuses, encore que l’un et l’autre ont trainé dans les mêmes caves métaphysiques de Dostoïevski, notamment.À maints égards, et malgré sa méfiance envers tous les pouvoirs et le peu de cas qu’il faisait des convenances sociales, on n’imagine pas un Haldas vibrer à la lecture des poètes de la Beat Generation, dont un poème aussi emblématique que le fameux Howl d’Allen Ginsberg lui eût sans doute paru du galimatias barbare, mais nombre de ses réflexions et méditations, dans ses Fulgurances, auraient pu en revanche intéresser et séduire les beatniks en quête de sens et de spiritualité, vivant à leur façon ce qu’il appelait « l’État de poésie », et comment ne pas voir que l’expérience baudelairienne des « minutes heureuses » était également au cœur de leurs recherches même diffuses ou confuses ?Minutes heureuses d’un pèlerin de l’AbsoluL’évidence d’un parcours, et plus encore d’un voyage spirituel quotidiennement incarné, s’impose au regard de l’œuvre immense de Georges Haldas (quelque 80 ouvrages répartis en carnets, essais, poèmes et traductions, notamment, mais sans une once de fiction), et c’est également à un parcours fléché que nous invite Serge Molla dans son choix de Fulgurances tirées des dix-huit carnets regroupés sous le titre de L’État de poésie, au fil d’un abécédaire dont les entrées sont souvent assorties de renvois, comme Diable renvoie à Christ, et Christ (l’entrée la plus largement développée) à Moïse, Résurrection et Universalité…Pour couper court à tout malentendu, s’agissant d’un recueil de citations extraites de leur contexte, à savoir des carnets inscrits dans le temps et ses fluctuations souvent contradictoires, gardons-nous, sœurs lectrices et frères lecteurs, de prendre cet Haldas fragmentaire comme un distributeur de vérités ou, pire, un ayatollah de la Pensée unique aux décrets péremptoires.À l’entrée « Péremptoire » juste avant « Permissivité », laquelle « déboussole les êtres au lieu de les enrichir », le scribe le proclame d’ailleurs : « Tout ce qui est péremptoire est le plus souvent faux ». Mais c’est bien lui qui affirmera, à l’entrée de « Sérénité », que « la notion de sérénité est une des plus sottes inventions de la philosophie », ou, à l’entrée de « Convivialité», qu’il ne s’agit là que d’une « stupide invention des sociologues », et d’y aller d’une vraie diatribe : « Une réunion de gens qui se retrouvent avec une soi-disant sympathie, est en fait un aquarium où se meuvent, dans les profondeurs de chacun, le mensonge, la jalousie, les arrière-pensées malveillantes, les sarcasmes secrets, quand ce n’est pas éa haine ou le mépris soigneusement tus. Et mille autres petits monstres qui se cachent sous les espèces d’une hypocrite bonne humeur « conviviale », laquelle n’est qu’une comédie pour moutons aveugles ».Et pan sur le barbecue ! Avec un coup de pied de l’âne évangélique à ceux qui ne trouveraient pas ça très chrétien : « Le Christ n’est pas venu au monde pour langer les bébés, tailler les haies et assurer les fins de mois. Ni pour jacasser avec les bavards »…Lesdits bavards prolifèrent en meutes sur les réseaux dit sociaux, qui ne sont qu’une « dissociété » hagarde, tandis que le poète unifie sans pontifier, et c’est là, dans ce qu’il appelle l’état de poésie (fondamentales entrées de « Poème », « Poésie » et «Poète » et plus encore de « Minutes heureuses ») que nous retrouvons Haldas en son noyau de « petite graine », pour user d'une de ses métaphores de jardinier céleste. D’un côté : « Les minutes heureuses sont, au temps de la vie courante, ce que les oasis sont au désert ». Et de l’autre : « Sans désespoir, pas de minutes heureuses ».Dès le début de l’abécédaire, à l’entrée d’«Abîme», l’ombre se mêlait illico à la lumière : « Qui ne connaît pas les abîmes ne connaît pas les hauteurs ». Et plus loin à l’entrée d’«Amour» : « Tout véritable amour impique la distance. Intègre, autrement dit, l’abîme. Le reste n’étant qu’attachement possessif. Poison mortel pour la relation ».Mot magique, chez le scribe qui vomit la magie et le charme : la Relation. À l’entrée «Solitude» on lira : « convertir le plus de solitude possible en relation », et dans la foulée. « Contrairement à tout ce qu’on peut penser, c’est la solitude qui nous prépare le plus à la relation ».Quoi de commun entre cette relation fondamentale, qui fait sans cesse référence à la Source, mot-clef de l’univers spirituel selon Haldas, et la « sociologie de la relation au monde » que développe le penseur allemand Hartmut Rosa autour du concept de Résonance, où le sentiment religieux se trouve revivifié à l’écart des dogmes et des églises ? Jean-François Duval, à partir des dernières étapes du parcours de Jack Kerouac, dans Vanité de Duluoz, esquisse un possible rapprochement, essentiellement fondé sur « la nécessité de faire vibrer le Verbe » par delà toute certitude…Clochards célestes, anges déchus et rédemption par le Verbe…Jean-François Duval, né en 1947, n’avait que huit ans lorsque La Fureur de vivre est sorti sur nos écrans, mais il en avait quinze ou seize lorsqu’il a lu On the Road de Jack Kerouac, et de James Dean à Elvis Presley, à la même époque, alors que nos profs fronçaient les sourcils en découvrant nos premiers jeans à l’américaine, sans se douter de la vague de fond que représenterait la première génération donnant le ton par sa jeunesse même, après deux carnages mondiaux - la jeunesse consommatrice – clientèle de premier rang – et productrice de ses propres mythes au temps de la libération sexuelle et du rock’n’roll, de la guerre au Vietnam et de la route vers Katmandou, véritable saga de la deuxième moitié du XXe siècle dont la « Beat Generation » cristalliserait sa légende autour de figures d’écrivains et de poètes non académiques, de Jack Kerouac et Neal Cassady à William Burroughs à Allen Ginsbreg, pour ne citer que les protagonistes.Plus encore qu’un « mouvement » littéraire ou culturel, et bien plus qu’une « école » d’époque, la Beat Generation brasse tous les éléments (perceptions nouvelles et contestation, mœurs privées et publiques, croyances, fusion du vivre et de l’écrire, etc.) que Jean-François Duval détaille avec autant de précision dans ses observations de journaliste «sur le terrain » et d’écrivain se disant lui-même « épigone », que d’intelligence critique dans ses mises en rapport des 100 mots où il se raconte lui-même en racontant le phénomène, avec une honnêteté lucide qui fait pièce à pas mal d’idées reçues et de clichés médiatisés.Sur les Beats « fêtards », l’image idéalisée des « clochards célestes », l’épanouissement sexuel de cette jeunesse présumée sans problèmes, leurs errances en matière de politique ou de religion, Duval apporte énormément de nuances en brossant une fresque bien vivante.Kerouac et Cassady magnifiés par la fiction de Sur la route et se cassant la figure dans les embrouilles de la vie, Ginsberg et Burroughs en visite chez Louis-Ferdinand Céline (en 1958) que l'affreux Bill compare à « un vieux concierge réactionnaire enveloppé en plein mois de juillet dans ses écharpes et ses couches de chaussettes », Ferlinghetti défiant la censure avec la publication du sulfureux Howl de Ginsberg aux mythiques presses de City Lights, la part d’ombre de ces « anges de la désolation » aux étonnantes accointances criminelles, et la part sublimée de leurs écrits échappant au Temps (le grand thème proustien de Kerouac), tout cela vit et vibre , comme le Verbe doit vibrer et vivre, entre l’A d’Adolescence et le Z de Ziggurat et de Zones de résonance…Georges Haldas. Fulgurances. Abécédaire. Labor et Fides, Petite Bibliothèque de Spiritualité, 2024, 279p.Jean-François Duval. Les 100 mots de la Beat Generation. Que sais-je ? 2024, 126p. -
Le sage extravagant
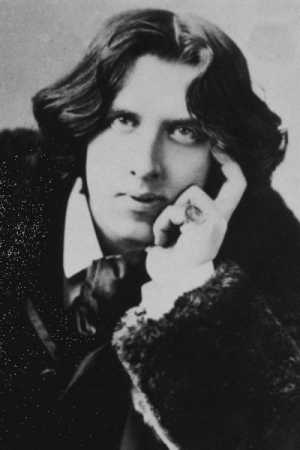
Aphorismes d’Oscar Wilde
Nul ne fut plus adulé, ni plus haï de son temps qu’Oscar Wilde, né le 16 octobre 1854, quatre jours avant Arthur Rimbaud. Prince de l’esprit et des élégances, il fut déclaré corrupteur de la jeunesse et jeté en prison pour s’être affiché en compagnie d’un fils de Lord et fait de sa vie publique un provoquant et constant «coming out », autant qu’il la voulait œuvre d’art à part entière. Et de fait, ses plus proches l’auront souligné : que ce prestidigitateur du verbe était plus merveilleux encore dans sa conversation que dans ses livres, qui le sont déjà dans les tonalités les plus variées, de la fantaisie à la gravité, du brillantissime au tréfonds du désarroi.
Pour revenir à Wilde comme il sied, à savoir le pied léger, on ne saurait trop recommander recueil de ses Aphorismes, préfacé par le très wildien Stephen Fry, qui l’incarna dans le film de Brian Gilbert (1997) et souligne justement le fait que Wilde fut damné, bien plus que pour inversion sexuelle : pour délit de poésie et de génie créateur faisant fi de toutes les hypocrisies morales, sociales, politiques ou pseudo-religieuses.
Souvent paradoxal d’apparence (« Les philanthropes perdent toute espèce d’humanité, c’est leur trait dominant »), Oscar Wilde ne l’est pas pour se distinguer du commun (qu’il respectait bien plus que les bourgeois, fort aimé notamment de ses co-détenus), mais parce que son horreur des bien pensants et des pharisiens vertueux l’y pousse à tout coup avec un pied de nez : « La seule façon de se débarrasser de la tentation, c’est d’y céder »…
Bel esprit postillonnant de bons mots de salon ? Bien plus que ça : certes arlequin mondain, mais aimant, généreux, plus profond souvent que les poseurs et autres raseurs.
Une appréciable postface non signée (établie par Alvin Redman qui a préparé la version originale du recueil) resitue parfaitement Oscar Wilde en sa vie et ses œuvres. Et voilà le travail : « J’ai passé la matinée à relire les épreuves d’un de mes poèmes, et j’ai fini par enlever une virgule. L’après-midi, je l’ai remise »…
Les hommes
« Je me dis parfois qu’en créant l’homme Dieu a quelque peu surestimé ses capacités ».
« Un homme qui fait la morale est le plus souvent un hypocrite, et une femme immanquablement un laideron ».
« Un homme dépravé est un homme qui admire l’innocence, et une femme dépravée est une femme dont les hommes ne se lassent jamais ».
Les femmes
« Les femmes sont faites pour être aimée, pas comprises ».
« Chaque femme est une rebelle, le plus souvent violemment révoltée contre elle-même ».
« Si une femme ne parvient pas à rendre ses erreurs charmantes, ce n’est qu’une femelle ».Les gens
« On peut toujours être gentil avec les gens dont on se moque totalement »
« J’aime les hommes qui ont un avenir et les femmes qui mont un passé ».
L’art
« L’artiste véritable a en lui une absolue confiance, car il est absolument lui-même ».
« A mon avis, Whistler est, assurément, un des plus grands maîtres de la peinture. Et je me permets d’ajouter que cet avis, Mr Whistler lui-même le partage tout à fait ».
La seule bonne école pour apprendre l’art, ce n’est pas la Vie, c’est l’Art ».
La vie
« Vivre est ce qu’il y a de plus rare au monde. La plupart des gens existent, voilà tout. »
« L’ambition est le dernier refuge du raté ».
« Le rire est l’attitude primitive envers la vie – une façon de l’aborder qui ne survit plus que chez les artistes et les criminels ».
La littérature
« Si l’on ne peut pas relire un livre indéfiniment avec plaisir, ce n’est pas la peine de le relire du tout. »
« Un poète peut survivre à tout hormis une faute d’impression »
« J’exècre le réalisme vulgaire en littérature. L’homme qui tient à appeler les choses par leur nom, à dire qu’une bêche est une bêche, par exemple, devrait être forcé de la manier. Il n’est bon qu’à cela ».
La conduite
« Je compte sur vous pour donner une fausse idée de moi ».
« Je ne remets jamais à demain ce que je crois pouvoir faire après-demain ».
« Il est toujours agréable d’être très attendu et de ne pas arriver ».
Le journalisme
« Il convient de préciser que les journalistes modernes s’excusent toujours en privé auprès de celui qu’ils ont vilipendé en public »
« Le journalisme n’est pas lisible, et la littérature n’est pas lue »
« Dans les temps anciens, les hommes disposaient du chevalet de torture. Dorénavant, ils ont la presse ».
Les apparences
« Il n’y a que les gens superficiels qui ne jugent pas d’après les apparences »
« Un masque nous en dit plus long qu’un visage »
La conversation
« J’ai horreur des gens qui parlent d’eux, comme vous, lorsqu’on a, comme moi, envie de parler de soi »
« Quand les gens sont d’accord avec moi, j’ai toujours le sentiment que je dois être dans l’erreur »
L’éducation
De nos jours, c’est un lourd handicap que d’avoir reçun une bonne éducation. Cela vous ferme l’esprit à tant de choses. »
« L’école devrait être le plus bel endroit de chaque ville ou village – si belle que l’on punirait les enfants désobéissants en leur interdisant d’y aller le lendemain ».
Jeunesse et grand âge
« L’âme naît vieille mais elle rajeunit. Voilà la comédie de la vie. Et le corps naît jeune, mais il vieillit. Voilà sa tragédie ».
La critique
« Le critique est celui qui sait transmuer son impression des belles choses en un matériau nouveau. La forme de critique la plus élevée, tout comme la plus basse, d’ailleurs, est une sorte d’autobiographie ».
La critique a besoin d’être cultivée beaucoup plus assidûment que la création »
L’amitié
« Je crois que la générosité est l’essence de l’amitié ».
La vérité
« Ce serait le meilleur des hommes s’il ne disait pas systématiquement la vérité ».
Dans la vie moderne, rien ne fait autant d’effet qu’une bonne platitude. Aussitôt, tout le monde a l’impression d’être en famille ».
La société
« La société pardonne souvent au criminel, mais jamais au rêveur ».
La pensée
« La cohérence est le dernier refuge de ceux qui n’ont pas d’imagination ».
«La sagesse vient avec les hivers ».
« Ce qui nous apparaît comme une cruelle épreuve n’est souvent qu’un bienfait caché ».
Le sport
« Que ces brutes de filles jouent au rugby, j’y consens volontiers, mais c’est un sport qui ne convient guère aux êtres délicats que sont les garçons »
Le travail
« Nous vivons à l’époque du surmenage et du manque d’instruction ; une époque où les gens sont si industrieux qu’ils en deviennent complètement idiots ».
Oscar Wilde
« Je n’écris pas pour plaire à des cliques : j’écris pour me plaire à moi-même ».
« Les louanges me rendent humbles, mais quand on m’insulte, je sais que j’ai tutoyé les étoiles. »
« J’ai les goûts les plus simples du monde. Je me contente toujours de ce qu’il y a de mieux ». Oscar Wilde. Aphorismes. Traduit de l’anglais par Béatrice Vierne. Préfacé par Stephen Fry. Arléa, 269p.
Oscar Wilde. Aphorismes. Traduit de l’anglais par Béatrice Vierne. Préfacé par Stephen Fry. Arléa, 269p. -
Avec Fabrice...
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce vendredi 27 juin. – En fait je ne sais à peu près rien de lui, me disais-je hier soir en le voyant s’éloigner vers la gare avec le sac contenant l’énorme recueil florentin de dessins de Kokoschka qu’il avait acheté tout à l’heure pour 10 balles au musée Jenisch, je sais depuis hier qu’il a la phobie des ascenseurs, mais à part ça à peu près rien sinon qu’il reste toujours aussi coquet avec sa chemise à rayures multicolores ultrachic et ses pompes bleu clair limite ballerines, mais nous n’avons pas encore passé au tutoiement, pas plus que je n’ai passé au tutoiement avec mon ami Gérard rencontré il y a cinquante ans de ça – et c’est en somme parfait, comme l'a été notre après-midi à la terrasse du Major, sous le gingko, puis dans le dédale du musée où j’ai constaté, chose rare et merveilleuse, qu’il voyait la peinture comme je la vois : il a VU les Bocion, il a VU les Hodler et surtout il a vibré comme j’ai vibré devant les portraits de femmes de Kokoschka, et c’est rare, j’te dis pas, un écrivain, un crack de théorie philosophico-scientifique genre chercheur du CNRS invité de Brisbane à Malmö ou Singapour pour des colloques à la mords-moi, un Parisien de surcroît et qui VOIT la peinture…Fabrice m’avait dit qu’il débarquerait à Vevey à 11h07, et je lui avais répondu que je l’attendrais sur le quai 2 dès 11h01 au cas où son train suisse aurait de l’avance, mais quand je m’y suis pointé : pas de Fabrice, vu qu’il avait pris l'omnibus précédent, pourtant nous avons fini par nous retrouver devant la gare et je lui ai proposé un café avant de filer dans les coteaux de Lavaux que j’avais l’intention de lui faire découvrir du chemin de la Dame en lui débitant comme un pédant que ce sont des moines au VIe siècle qui ont commencé le job, et qu’il ne faut pas dire «lac de Genève», mais « Léman » qui veut d’ailleurs dire lac en latin, mais le pléonasme n’empêche que c’est le plus grand d’Europe et environs, plus grand que le Balaton, et lui de m’épargner poliment le couplet de Schopenhauer comme quoi « das Leben ist kein Panorama », c’est vrai quoi, même à Lavaux, patrie du grand Ramuz, l’on ne saurait dire que la vie se réduise à un panorama…Quant à Olinda, toujours aussi pétulante, elle revenait du Chili et du Pérou, mais surtout du Cambodge dont les paysages l’ont bottée, et du Vietnam aussi et de Singapour, elle a trouvé ses trois semaines de tour du monde avec son novinho un peu courtes, et je lui ai demandé ce qu’il en était des moustiques et de la cohabitation avec son bon ami – étant entendu à mes yeux que le voyage est THE test en matière de convivialité amoureuse -, et elle : m’en parlez pas, mais surtout les moustiques !, et de nous montrer des traces de morsures encore visibles sur ses tibias que Fabrice et moi, à la terrasse du Major où elle est redevenue la serveuse la plus cool qui soit, avons fait le constat de visu, sur quoi mon commensal a choisi la truite et moi les suprêmes de poulet comme à mon habitude – et la conversation de rouler en mode nature et culture, nos soucis de plumitifs face à la nouvelle « dissociété », la France qui va dissoudre son président et Paris que vont dissoudre les jeux olympiques, ou plus sérieusement : l’écriture de Cingria que je lui ai révélée et dont il raffole, et je ne sais plus à quel moment ni pourquoi : sa phobie des ascenseurs, un épisode traumatisant, le problème que ça posait à New York, ensuite : le dernier roman de Quentin Mouron dont je lui dis qu’il annonce quelque chose de notable en matière de lecture romanesque fine de la nouvelle société d’après les millenials et consorts, et Fabrice, qui n’est pas du genre morose à tirer l’échelle derrière lui, de noter le nom de Quentin comme il note le nom de Bona dont je lui parle du roman dédié à saint Maurice le Nubien, etc.J’en reviens toujours, s’agissant de relations amicales vraies, à la distinction que fait René Girard entre médiation externe et médiation interne, la première restant ouverte et la seconde vouée au toxique. La médiation externe caractérise le lien de deux individus partageant une même admiration, voire une même passion, qui les sort de leur étroite personne et les fait se rencontrer sans qu’intervienne aucune rivalité. C’est Don Quichotte et le jeune Bachelier, tous deux férus de romans de chevalerie, comme ils pourraient l’être du FC Barcelona ou de la poésie de Garcia Lorca. C'est Fabrice et moi qui parlons de la postérité de Sollers et de la jobardise de l'intelligentsia parisienne en matière politique, de l'évolution prétentieuse des mises en scène de théâtre et d'opéra ou de l'invasion du discours sur l'art par le bavardage conceptuel. C'est l'intelligence généreuse contre la cérébralité close et l'écriture inclusive - c’est chaste et durable, alors que la médiation interne n’échappe pas à la rivalité mimétique, aux occurrences trop personnelles et autres embrouilles psychologiques, qui plombent notamment les relations entre le même Quichotte et son ami Sancho Pança. Comme le disait le chef scout Saint-Exupéry à propos de l’amour : c’est pas de se regarder béat l'un l'autre zyeux dans les zyeux mais de regarder ensemble dans la même direction – ce genre de jolies choses…ImageJLK: Fabrice Pataut au Chemin de la Dame.
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Désirade, ce vendredi 27 juin. – En fait je ne sais à peu près rien de lui, me disais-je hier soir en le voyant s’éloigner vers la gare avec le sac contenant l’énorme recueil florentin de dessins de Kokoschka qu’il avait acheté tout à l’heure pour 10 balles au musée Jenisch, je sais depuis hier qu’il a la phobie des ascenseurs, mais à part ça à peu près rien sinon qu’il reste toujours aussi coquet avec sa chemise à rayures multicolores ultrachic et ses pompes bleu clair limite ballerines, mais nous n’avons pas encore passé au tutoiement, pas plus que je n’ai passé au tutoiement avec mon ami Gérard rencontré il y a cinquante ans de ça – et c’est en somme parfait, comme l'a été notre après-midi à la terrasse du Major, sous le gingko, puis dans le dédale du musée où j’ai constaté, chose rare et merveilleuse, qu’il voyait la peinture comme je la vois : il a VU les Bocion, il a VU les Hodler et surtout il a vibré comme j’ai vibré devant les portraits de femmes de Kokoschka, et c’est rare, j’te dis pas, un écrivain, un crack de théorie philosophico-scientifique genre chercheur du CNRS invité de Brisbane à Malmö ou Singapour pour des colloques à la mords-moi, un Parisien de surcroît et qui VOIT la peinture…Fabrice m’avait dit qu’il débarquerait à Vevey à 11h07, et je lui avais répondu que je l’attendrais sur le quai 2 dès 11h01 au cas où son train suisse aurait de l’avance, mais quand je m’y suis pointé : pas de Fabrice, vu qu’il avait pris l'omnibus précédent, pourtant nous avons fini par nous retrouver devant la gare et je lui ai proposé un café avant de filer dans les coteaux de Lavaux que j’avais l’intention de lui faire découvrir du chemin de la Dame en lui débitant comme un pédant que ce sont des moines au VIe siècle qui ont commencé le job, et qu’il ne faut pas dire «lac de Genève», mais « Léman » qui veut d’ailleurs dire lac en latin, mais le pléonasme n’empêche que c’est le plus grand d’Europe et environs, plus grand que le Balaton, et lui de m’épargner poliment le couplet de Schopenhauer comme quoi « das Leben ist kein Panorama », c’est vrai quoi, même à Lavaux, patrie du grand Ramuz, l’on ne saurait dire que la vie se réduise à un panorama…Quant à Olinda, toujours aussi pétulante, elle revenait du Chili et du Pérou, mais surtout du Cambodge dont les paysages l’ont bottée, et du Vietnam aussi et de Singapour, elle a trouvé ses trois semaines de tour du monde avec son novinho un peu courtes, et je lui ai demandé ce qu’il en était des moustiques et de la cohabitation avec son bon ami – étant entendu à mes yeux que le voyage est THE test en matière de convivialité amoureuse -, et elle : m’en parlez pas, mais surtout les moustiques !, et de nous montrer des traces de morsures encore visibles sur ses tibias que Fabrice et moi, à la terrasse du Major où elle est redevenue la serveuse la plus cool qui soit, avons fait le constat de visu, sur quoi mon commensal a choisi la truite et moi les suprêmes de poulet comme à mon habitude – et la conversation de rouler en mode nature et culture, nos soucis de plumitifs face à la nouvelle « dissociété », la France qui va dissoudre son président et Paris que vont dissoudre les jeux olympiques, ou plus sérieusement : l’écriture de Cingria que je lui ai révélée et dont il raffole, et je ne sais plus à quel moment ni pourquoi : sa phobie des ascenseurs, un épisode traumatisant, le problème que ça posait à New York, ensuite : le dernier roman de Quentin Mouron dont je lui dis qu’il annonce quelque chose de notable en matière de lecture romanesque fine de la nouvelle société d’après les millenials et consorts, et Fabrice, qui n’est pas du genre morose à tirer l’échelle derrière lui, de noter le nom de Quentin comme il note le nom de Bona dont je lui parle du roman dédié à saint Maurice le Nubien, etc.J’en reviens toujours, s’agissant de relations amicales vraies, à la distinction que fait René Girard entre médiation externe et médiation interne, la première restant ouverte et la seconde vouée au toxique. La médiation externe caractérise le lien de deux individus partageant une même admiration, voire une même passion, qui les sort de leur étroite personne et les fait se rencontrer sans qu’intervienne aucune rivalité. C’est Don Quichotte et le jeune Bachelier, tous deux férus de romans de chevalerie, comme ils pourraient l’être du FC Barcelona ou de la poésie de Garcia Lorca. C'est Fabrice et moi qui parlons de la postérité de Sollers et de la jobardise de l'intelligentsia parisienne en matière politique, de l'évolution prétentieuse des mises en scène de théâtre et d'opéra ou de l'invasion du discours sur l'art par le bavardage conceptuel. C'est l'intelligence généreuse contre la cérébralité close et l'écriture inclusive - c’est chaste et durable, alors que la médiation interne n’échappe pas à la rivalité mimétique, aux occurrences trop personnelles et autres embrouilles psychologiques, qui plombent notamment les relations entre le même Quichotte et son ami Sancho Pança. Comme le disait le chef scout Saint-Exupéry à propos de l’amour : c’est pas de se regarder béat l'un l'autre zyeux dans les zyeux mais de regarder ensemble dans la même direction – ce genre de jolies choses…ImageJLK: Fabrice Pataut au Chemin de la Dame. -
Affreux et salutaires
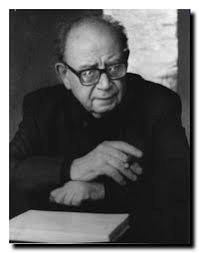
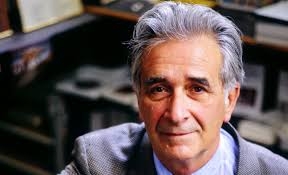 À mes chers enfoirés, Haldas et Dimitri.(Le Temps accordé. Lectures du monde 2024, page 1000 et suivante)À la Maison bleue, ce mardi 25 juin. – Ces vers de rien du tout me viennent ce matin, qui diraient sans doute moins que rien au cher Georges Haldas auquel j’ai fait retour, hier soir, après avoir récupéré mon exemplaire dédicacé de L’Etat de poésie à La Désirade :Je l’aimais d’amour et d’eau clairecomme on aime en Afrique ;je l’aimais au soleil de chair,en ma nuit lunatique…J’imagine la tête que Georges Haldas eût fait si je lui avais dit que j’aimais la vie «comme on aime en Afrique», comme j’imagine rétrospectivement la tête qu’il a faite lorsqu’il a lu Le viol de l’ange dont j’ai eu la naïveté de croire qu’il y entendrait quelque chose, s’agissant d’un roman au fonds évangélique sous ses aspects délurés et déjantés, alors qu’il n’y a vu, comme Dimitri, qu’un livre « sale », et je vois aujourd’hui la tête qu’il ferait en lisant les romans de Quentin Mouron ou de Michel Houellebecq, ou si je lui racontais par le détail les séries coréennes ou thaïlandaise dont je me régale entre deux pages d’Angelus Silesius ou de Montaigne en attendant de reprendre la lecture de L’Etat de poésie, yes sir…Mes rêves ne cessent d’interférer avec mes états de veille diurne, et c’est ainsi que, la semaine passée, après avoir prononcé le nom de Georges Haldas au téléphone – il me semble que c’était par Whatsapp avec la Professorella -, j’ai retrouvé Haldas en rêve sous un immense gingko et l’air détendu, pas du tout le Haldas teigneux et criseux que j’avais entendu morigéner son amie violoniste au café de la Comédie, pas du tout le macho méditerranéen à la Dimitri traitant la philosophe Jeanne Hersch d’«amazone pisseuse», pas du tout le prétendu Chantre de la Relation s’exclamant «toutes des salopes !» à la table de Jean-Georges Lossier le poète humaniste et délicat, mais le bon Georges fraternel, le plus attachant, le plus à l’écoute, le plus incisif et le plus drôle, le plus libre de parole, le plus autocritique, le moins homme de lettres et le plus engagé, au sens profond, des écrivains que j’aie fréquentés et aimé retrouver dans ses cafés successifs et plus encore dans ses livres où sa méchanceté naturelle se décantait et où irradiait la poésie du monde, comme ce matin dont je profite du silence radieux à dix jours des assauts de décibels du prochain festival de jazz se déroulant cette année sous mes fenêtres – et là j’imagine Haldas aux concerts d’Alice Cooper ou de Massive Attack…Je lisais hier, sous la plume de Léon Chestov, l’évocation des turpitudes helvétique de Dostoïevski le grand chrétien « au quotidien », lors de son séjour en Suisse, quand il maltraitait, humiliait, brutalisait physiquement son fidèle domestique, lequel avait beau lui objecter que lui aussi était un humain et non un chien, je me rappelai les vociférations de Dimitri et d’Haldas quand on osait prendre le contrepied de leurs mâles éminences, et le même soir ma grande sœur au téléphone (sur WhatsApp et des Asturies, alors que je sirotais un sprizz à la terrasse du Métropole) m’appelait son hermanito et me racontait la bonne vie que c’était de voir son petit-fils en vacances rentrer le soir du surf avec son pote et dévorer des carrés de boeuf plus gros que leurs ventres - je brassais tout ça comme un potage avant de rentrer a casa à trop petits pas irréguliers, et je me disais une fois de plus qu’en effet j’étais un irrégulier, comme Haldas et Dimitri l’étaient, adorables et infréquentables enfoirés, à leur putain de façon poétique…
À mes chers enfoirés, Haldas et Dimitri.(Le Temps accordé. Lectures du monde 2024, page 1000 et suivante)À la Maison bleue, ce mardi 25 juin. – Ces vers de rien du tout me viennent ce matin, qui diraient sans doute moins que rien au cher Georges Haldas auquel j’ai fait retour, hier soir, après avoir récupéré mon exemplaire dédicacé de L’Etat de poésie à La Désirade :Je l’aimais d’amour et d’eau clairecomme on aime en Afrique ;je l’aimais au soleil de chair,en ma nuit lunatique…J’imagine la tête que Georges Haldas eût fait si je lui avais dit que j’aimais la vie «comme on aime en Afrique», comme j’imagine rétrospectivement la tête qu’il a faite lorsqu’il a lu Le viol de l’ange dont j’ai eu la naïveté de croire qu’il y entendrait quelque chose, s’agissant d’un roman au fonds évangélique sous ses aspects délurés et déjantés, alors qu’il n’y a vu, comme Dimitri, qu’un livre « sale », et je vois aujourd’hui la tête qu’il ferait en lisant les romans de Quentin Mouron ou de Michel Houellebecq, ou si je lui racontais par le détail les séries coréennes ou thaïlandaise dont je me régale entre deux pages d’Angelus Silesius ou de Montaigne en attendant de reprendre la lecture de L’Etat de poésie, yes sir…Mes rêves ne cessent d’interférer avec mes états de veille diurne, et c’est ainsi que, la semaine passée, après avoir prononcé le nom de Georges Haldas au téléphone – il me semble que c’était par Whatsapp avec la Professorella -, j’ai retrouvé Haldas en rêve sous un immense gingko et l’air détendu, pas du tout le Haldas teigneux et criseux que j’avais entendu morigéner son amie violoniste au café de la Comédie, pas du tout le macho méditerranéen à la Dimitri traitant la philosophe Jeanne Hersch d’«amazone pisseuse», pas du tout le prétendu Chantre de la Relation s’exclamant «toutes des salopes !» à la table de Jean-Georges Lossier le poète humaniste et délicat, mais le bon Georges fraternel, le plus attachant, le plus à l’écoute, le plus incisif et le plus drôle, le plus libre de parole, le plus autocritique, le moins homme de lettres et le plus engagé, au sens profond, des écrivains que j’aie fréquentés et aimé retrouver dans ses cafés successifs et plus encore dans ses livres où sa méchanceté naturelle se décantait et où irradiait la poésie du monde, comme ce matin dont je profite du silence radieux à dix jours des assauts de décibels du prochain festival de jazz se déroulant cette année sous mes fenêtres – et là j’imagine Haldas aux concerts d’Alice Cooper ou de Massive Attack…Je lisais hier, sous la plume de Léon Chestov, l’évocation des turpitudes helvétique de Dostoïevski le grand chrétien « au quotidien », lors de son séjour en Suisse, quand il maltraitait, humiliait, brutalisait physiquement son fidèle domestique, lequel avait beau lui objecter que lui aussi était un humain et non un chien, je me rappelai les vociférations de Dimitri et d’Haldas quand on osait prendre le contrepied de leurs mâles éminences, et le même soir ma grande sœur au téléphone (sur WhatsApp et des Asturies, alors que je sirotais un sprizz à la terrasse du Métropole) m’appelait son hermanito et me racontait la bonne vie que c’était de voir son petit-fils en vacances rentrer le soir du surf avec son pote et dévorer des carrés de boeuf plus gros que leurs ventres - je brassais tout ça comme un potage avant de rentrer a casa à trop petits pas irréguliers, et je me disais une fois de plus qu’en effet j’étais un irrégulier, comme Haldas et Dimitri l’étaient, adorables et infréquentables enfoirés, à leur putain de façon poétique… -
Ceux qui ont tout compris
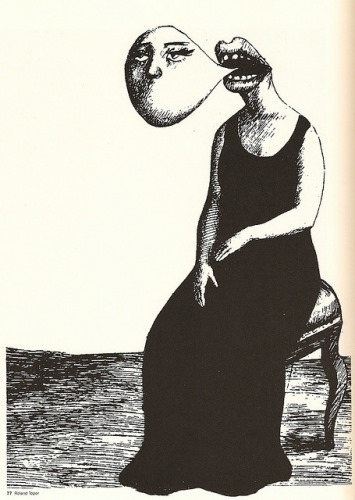 Celui qui t’explique le conflit israélo-arabe comme s’il en avait rêvé les péripéties dès avant 1948 et avec l’extrême précision de certains détails oniriques liés aux crises conjugales aiguës / Celle qui a entrevu le vrai visage du jeune pianiste au double masque social et névrotique / Ceux qui ont la sagesse infuse héritée de leurs aïeules du Haut-Valais super authentique / Celui qui évente les sous-entendus érotiques du psychiatre au double langage correspondant à sa double vie / Celle qui entend ce que veut dire la main de l’aveugle fleurant bon le jasmin / Ceux qui devinent ce que vous allez leur dire et vous laissent le dire avec un sourire particulier / Celui qui a résolu divers théorèmes à votre insu avant de buter sur ce qu’ils appellent avec humilité l’Aporie du Têtu / Celle qui finit tes phrases en hongrois / Ceux qui traduisent les silences théosophiques du vieux Sigmar en rappelant ses accointances avec le Goetheanum et autres lieux de ressourcement / Celui qui n'a pas besoin de toucher pour prendre son pied / Celle qui a compris Charles de Gaulle et lui fait dire au téléphone avec son délicieux accent des Laurentides : merci mon Général / Ceux qui n’ont pas compris que cette liste leur était dédiée , etc.Dessin: Roland Topor.
Celui qui t’explique le conflit israélo-arabe comme s’il en avait rêvé les péripéties dès avant 1948 et avec l’extrême précision de certains détails oniriques liés aux crises conjugales aiguës / Celle qui a entrevu le vrai visage du jeune pianiste au double masque social et névrotique / Ceux qui ont la sagesse infuse héritée de leurs aïeules du Haut-Valais super authentique / Celui qui évente les sous-entendus érotiques du psychiatre au double langage correspondant à sa double vie / Celle qui entend ce que veut dire la main de l’aveugle fleurant bon le jasmin / Ceux qui devinent ce que vous allez leur dire et vous laissent le dire avec un sourire particulier / Celui qui a résolu divers théorèmes à votre insu avant de buter sur ce qu’ils appellent avec humilité l’Aporie du Têtu / Celle qui finit tes phrases en hongrois / Ceux qui traduisent les silences théosophiques du vieux Sigmar en rappelant ses accointances avec le Goetheanum et autres lieux de ressourcement / Celui qui n'a pas besoin de toucher pour prendre son pied / Celle qui a compris Charles de Gaulle et lui fait dire au téléphone avec son délicieux accent des Laurentides : merci mon Général / Ceux qui n’ont pas compris que cette liste leur était dédiée , etc.Dessin: Roland Topor. -
Programme Santé
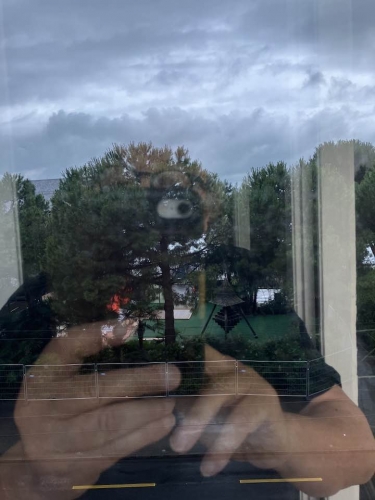 (Le Temps accordé. Feuilleton du jour, 1)Ce samedi 22 juin, entre 9h et 9h.26. – Votre programme Santé se réduit finalement à cela, m’avait dit l’angiologue Noyau – ce terme d’angiologue te fait toujours sourire par son indéniable ambiguité, mais passons -, vous allez donc positiver, marcher et boire de l’eau, comme le conseillait d’ailleurs notre cher Jean-Jacques Rousseau, et tout en me demandant impertinemment ce que ce blaireau en t-shirt blanc marqué WIN-WIN en lettres mauves pouvait savoir de cet enfoiré de Rousseau, je me suis dit okay pour l’eau et la marche, mais ce matin il putain de pleut – tu te reproches une fois de plus le lamentable langage de tribu dégénérée de ton for intérieur - et «ça» va pas le faire même s’il y a aussi de l’eau au robinet et un parapluie à disposition du personnel…C’était le premier jour de l’été et j’étais donc un peu « vénère », pour parler comme mon compère l’écrivain Quentin Mouron, de nouvelles crampes nocturnes, pires que la veille et l’avant-veille, m’avaient cisaillé mollets et jarrets que c’était à maudire d’être né, genre Schopenhauer des mauvais jours, mais en même temps je me souriais à moi-même inexplicablement, comme ça m’arrive plus souvent qu’à mon tour, c’est-à-dire tout le temps, comme je chante tout le temps, et Quentin me trouve d’ailleurs plus joyeux que mélancolique même si l’un découle de l’autre, comme il me l’a fait remarquer l’autre nuit lors de nos interminables échanges sur Messenger, et là je sens que de l’écrire va me soulager autant que de marcher ou de siffler la première des carafes d’eau plate de mon Programme Santé dont la seule formule énoncée m’horripile grave (encore ce langage débile !), le seul mot de PROGRAMME me semblant la quintessence de l’ubérisation en cours du monde prétendu libre, et le mot SANTÉ ne cessant de me faire gerber (ah non !) comme au temps funeste et annonciateur de la Pandémie du début des nouvelles années 20, laquelle constitue d’ailleurs la toile de fond physique et psychique (je suis tenté d’ajouter métaphysique, mais on verra ça plus tard) du dernier livre de mon compère Mouron, ce petit drôle…La pluie avait hier quelque chose de brésilien, comme les hauts boisés de Montreux (pour peu que tu fasses un certain effort d’imagination lyrique), quelque chose de fouaillant et de fouettant non dénué de sensualité alors que ce matin le ciel semble plutôt pleurer son eau saturée de particules fines, et là je pense évidemment à Sixtine, le personnage de mon compère Mouron, qui vit la crise climatique comme on vit un chagrin latent et même patent, à croire que les constats atmosphériques interfèrent désormais avec notre chimie la plus intime limite jouissive, et d’une autre façon que le vivaient nos aïeux quand ils se désolaient bonnement que le mauvais temps les contrariât dans leur jardinage ou leur promenage de retraités pas encore dits Seniors – cet autre mot que j’abhorre…
(Le Temps accordé. Feuilleton du jour, 1)Ce samedi 22 juin, entre 9h et 9h.26. – Votre programme Santé se réduit finalement à cela, m’avait dit l’angiologue Noyau – ce terme d’angiologue te fait toujours sourire par son indéniable ambiguité, mais passons -, vous allez donc positiver, marcher et boire de l’eau, comme le conseillait d’ailleurs notre cher Jean-Jacques Rousseau, et tout en me demandant impertinemment ce que ce blaireau en t-shirt blanc marqué WIN-WIN en lettres mauves pouvait savoir de cet enfoiré de Rousseau, je me suis dit okay pour l’eau et la marche, mais ce matin il putain de pleut – tu te reproches une fois de plus le lamentable langage de tribu dégénérée de ton for intérieur - et «ça» va pas le faire même s’il y a aussi de l’eau au robinet et un parapluie à disposition du personnel…C’était le premier jour de l’été et j’étais donc un peu « vénère », pour parler comme mon compère l’écrivain Quentin Mouron, de nouvelles crampes nocturnes, pires que la veille et l’avant-veille, m’avaient cisaillé mollets et jarrets que c’était à maudire d’être né, genre Schopenhauer des mauvais jours, mais en même temps je me souriais à moi-même inexplicablement, comme ça m’arrive plus souvent qu’à mon tour, c’est-à-dire tout le temps, comme je chante tout le temps, et Quentin me trouve d’ailleurs plus joyeux que mélancolique même si l’un découle de l’autre, comme il me l’a fait remarquer l’autre nuit lors de nos interminables échanges sur Messenger, et là je sens que de l’écrire va me soulager autant que de marcher ou de siffler la première des carafes d’eau plate de mon Programme Santé dont la seule formule énoncée m’horripile grave (encore ce langage débile !), le seul mot de PROGRAMME me semblant la quintessence de l’ubérisation en cours du monde prétendu libre, et le mot SANTÉ ne cessant de me faire gerber (ah non !) comme au temps funeste et annonciateur de la Pandémie du début des nouvelles années 20, laquelle constitue d’ailleurs la toile de fond physique et psychique (je suis tenté d’ajouter métaphysique, mais on verra ça plus tard) du dernier livre de mon compère Mouron, ce petit drôle…La pluie avait hier quelque chose de brésilien, comme les hauts boisés de Montreux (pour peu que tu fasses un certain effort d’imagination lyrique), quelque chose de fouaillant et de fouettant non dénué de sensualité alors que ce matin le ciel semble plutôt pleurer son eau saturée de particules fines, et là je pense évidemment à Sixtine, le personnage de mon compère Mouron, qui vit la crise climatique comme on vit un chagrin latent et même patent, à croire que les constats atmosphériques interfèrent désormais avec notre chimie la plus intime limite jouissive, et d’une autre façon que le vivaient nos aïeux quand ils se désolaient bonnement que le mauvais temps les contrariât dans leur jardinage ou leur promenage de retraités pas encore dits Seniors – cet autre mot que j’abhorre… Pédaler autour de sa chambre(Le Temps accordé. Feuilleton du jour, 2)À la Maison bleue, ce samedi 22 janvier, entre 11h.30 et 12h.53. - Essayé pas pu : la pluie faisant vraiment barrage, du bas en haut du ciel et retour, j’ai fait machine arrière et me suis retrouvé sur ma bécane elliptique avec une nouvelle série polonaise à la fois érotisante et critique, incluant un trio de jeunes gens en train de préparer et vivre à la fois en 3D un film selon les codes des séries espagnoles ou latinos-italiennes (du cul jeune et de la conscience socio-politique), cela sur mes dix kilomètres réglementaires et tandis qu’il continuait de pleuvoir des seilles sur les pins et les palmiers d’à coté, sur quoi je me suis dit que j’allais me préparer un risotto solo comme se les faisait notre ami Thierry rue des Cascades au début de son cancer, et cette vision m’a rappelé le retour d’âge du sexagénaire essayant de rattraper le bon temps sexuel mal vécu en sa jeunesse de Genevois coincé, j'ai pensé : pauvres petits que nous sommes et c’est dans cette disposition magnanime que j’ai continué à penser aux personnages un peu perdus du roman de Quentin Mouron, à Lola la seule à ne pas vivre par procuration, à Sixtine exténuée de sincérité parasitée par le virus numérique, à Quentin lui-même qui me textait ce matin sur Messenger qu’il lisait sur Youtube le dernier post d’André Markowicz sur l’antisémitisme après m’avoir dit hier soir son intérêt pour tout ce que dit le même slaviste sur la guerre en Ukraine, et voici que je constate que les deux paquets de chippolatas de veau que je retrouve dans mon frigo sont marqués aux dates limites respectives du 17 et du 22 juin, me confrontant à l’alternative de la vie dangereuse ou du choix d’un risotto sécure...Tout brasser en coulée simultanée dans le flux de la phrase rappelant le monologue de Molly Bloom ou les dérives du Benjy de Faulkner, ou d'un autre point de vue la façon de mêler narration romanesque et réflexion critique décentrée à la Kundera: c'est le mode panoptique que j'ai choisi dans la suite au Viol de l'ange que représente mon roman achevé mais inédit intitulé Les Tours d'illusion, et c'est le même déroulé d'observations phénoménologiques qui m'a scotché à la lecture des romans de mon compère Quentin, sans équivalent me semble-t-il dans nos aires francophones, alors que j'ai lu déjà les épreuves de son prochain Opus et qu'il s'en promet un de plus grande envergure, crâne gamin dont je n'attends pas moins...Dans le premier épisode de la série polonaise intitulée Les Débuts (à voir sur Netflix), la jolie Lena, impatiente de tourner un film romantique et même plus avec Niko, ne pense qu’à la scène de sexe qui arrimera ce court métrage en costumes au XXIe siècle, mais Niko regimbe, et ce qui se passe à ce moment-là recoupe exactement la situation dans laquelle, plus librement, se sont trouvé les deux influenceurs de Quentin Mouron, Sam et Sixtine, dont la première rencontre répercutée sur les réseaux sociaux a fait exploser leur popularité, alors que Lena, plus naïvement en somme, imagine un scène de sexe imitée des postures du Kama Sutra, qui fonderait leur projet de film en crédibilité, mais Niko sent que l’image va changer la donne de leur relation, et l’on verra que le débat n’est plus du tout entre retenue et liberté, entre pudeur et exhibition, entre morale à l'ancienne et émancipation médiatisée, mais entre vie et simulacre…
Pédaler autour de sa chambre(Le Temps accordé. Feuilleton du jour, 2)À la Maison bleue, ce samedi 22 janvier, entre 11h.30 et 12h.53. - Essayé pas pu : la pluie faisant vraiment barrage, du bas en haut du ciel et retour, j’ai fait machine arrière et me suis retrouvé sur ma bécane elliptique avec une nouvelle série polonaise à la fois érotisante et critique, incluant un trio de jeunes gens en train de préparer et vivre à la fois en 3D un film selon les codes des séries espagnoles ou latinos-italiennes (du cul jeune et de la conscience socio-politique), cela sur mes dix kilomètres réglementaires et tandis qu’il continuait de pleuvoir des seilles sur les pins et les palmiers d’à coté, sur quoi je me suis dit que j’allais me préparer un risotto solo comme se les faisait notre ami Thierry rue des Cascades au début de son cancer, et cette vision m’a rappelé le retour d’âge du sexagénaire essayant de rattraper le bon temps sexuel mal vécu en sa jeunesse de Genevois coincé, j'ai pensé : pauvres petits que nous sommes et c’est dans cette disposition magnanime que j’ai continué à penser aux personnages un peu perdus du roman de Quentin Mouron, à Lola la seule à ne pas vivre par procuration, à Sixtine exténuée de sincérité parasitée par le virus numérique, à Quentin lui-même qui me textait ce matin sur Messenger qu’il lisait sur Youtube le dernier post d’André Markowicz sur l’antisémitisme après m’avoir dit hier soir son intérêt pour tout ce que dit le même slaviste sur la guerre en Ukraine, et voici que je constate que les deux paquets de chippolatas de veau que je retrouve dans mon frigo sont marqués aux dates limites respectives du 17 et du 22 juin, me confrontant à l’alternative de la vie dangereuse ou du choix d’un risotto sécure...Tout brasser en coulée simultanée dans le flux de la phrase rappelant le monologue de Molly Bloom ou les dérives du Benjy de Faulkner, ou d'un autre point de vue la façon de mêler narration romanesque et réflexion critique décentrée à la Kundera: c'est le mode panoptique que j'ai choisi dans la suite au Viol de l'ange que représente mon roman achevé mais inédit intitulé Les Tours d'illusion, et c'est le même déroulé d'observations phénoménologiques qui m'a scotché à la lecture des romans de mon compère Quentin, sans équivalent me semble-t-il dans nos aires francophones, alors que j'ai lu déjà les épreuves de son prochain Opus et qu'il s'en promet un de plus grande envergure, crâne gamin dont je n'attends pas moins...Dans le premier épisode de la série polonaise intitulée Les Débuts (à voir sur Netflix), la jolie Lena, impatiente de tourner un film romantique et même plus avec Niko, ne pense qu’à la scène de sexe qui arrimera ce court métrage en costumes au XXIe siècle, mais Niko regimbe, et ce qui se passe à ce moment-là recoupe exactement la situation dans laquelle, plus librement, se sont trouvé les deux influenceurs de Quentin Mouron, Sam et Sixtine, dont la première rencontre répercutée sur les réseaux sociaux a fait exploser leur popularité, alors que Lena, plus naïvement en somme, imagine un scène de sexe imitée des postures du Kama Sutra, qui fonderait leur projet de film en crédibilité, mais Niko sent que l’image va changer la donne de leur relation, et l’on verra que le débat n’est plus du tout entre retenue et liberté, entre pudeur et exhibition, entre morale à l'ancienne et émancipation médiatisée, mais entre vie et simulacre… Au plus-que-présent(Le Temps accordé, Feuilleton du jour, 3)( À L’Oasis, ce soir, entre 20h33 et 21h 07). – Marchant le long du lac aux quais déserts rincés par la pluie de la journée, le long desquels cygnes et canards vont et vaguent sans se demander si l’existence précède l’essence, je me rappelle les mots de mon occulte sister Annie Dillard, qui rejoignent ceux du physicien rebelle Freeman Dyson, autre compagnon de mes lectures que j’évoquais hier soir sur Messenger, avec Quentin me parlant des siennes (le théâtre de Sartre et les nouvelles de Faulkner), à savoir six ou douze livres lus en parallèle où Flaubert voisine avec Ceronetti et Charles-Abert retrouvé, et Proust à n’en plus finir et le mystique Angelus Silesius et mon bon vieux Chestov et le Giono de Jean le bleu - mais Dillard me reste présente, comme un gage de présence augmentée, avec Au présent, telle une cheftaine de meute de louveteaux avec sa boussole, dont les pages sont comme autant de vertigineux entonnoirs : «N’est-il pas bien tard ? Bien tard pour être en vie ? Nos générations ne sont-elles pas les plus décisives ? Car nous avons changé le monde. Notre époque si mouvementée n’est-elle pas la plus cruciale d’entre toutes ? Ne peut-on dire que notre siècle a une importance particulière qui rejaillit sur nous ? Notre siècle et son Holocauste unique, ses populations de réfugiés, ses exterminations totalitaires en série, notre siècle et ses antibiotiques, ses puces électroniques, ses hommes sur la lune et ses transplantations génétiques ? Non, ni notre siècle ni nous. L’époque qui est la nôtre est une époque ordinaire, une tranche de vie semblable à toute autre. Qui peut supporter d’entedre cela, qui accepte de l’envisager ? Il se peut cependant que nous soyons la dernière génération – voilà au moins qui est réconfortant. Si l’on supprime le menace de la bombe, que sommes-nous ? D’insignifiantes perles sur un collier sans fin. Notre époque n’est qu’un banal brin d’un improbable fil. Nous n'avons aucune chance d’être là lorsque le soleil se sera consumé. Notre époque doit bien avoir quelque chose d’héroïque, quelque chose qui la place au-dessus des toutes les autres. La peste ? Les caprices du climat ? Il se produit de terribles désastres. Nous assistons même à l’extinction massive d’espèces animales. D’après Robert M. May d’Oxford, la plupart des oiseaux et des mammifères que nous connaissons auront disparu d’ici quatre cents ans. Mais la terre a déjà connu cinq autres extinctions du même type, à des vingtaines de millions d’années d’intervalle », etc.
Au plus-que-présent(Le Temps accordé, Feuilleton du jour, 3)( À L’Oasis, ce soir, entre 20h33 et 21h 07). – Marchant le long du lac aux quais déserts rincés par la pluie de la journée, le long desquels cygnes et canards vont et vaguent sans se demander si l’existence précède l’essence, je me rappelle les mots de mon occulte sister Annie Dillard, qui rejoignent ceux du physicien rebelle Freeman Dyson, autre compagnon de mes lectures que j’évoquais hier soir sur Messenger, avec Quentin me parlant des siennes (le théâtre de Sartre et les nouvelles de Faulkner), à savoir six ou douze livres lus en parallèle où Flaubert voisine avec Ceronetti et Charles-Abert retrouvé, et Proust à n’en plus finir et le mystique Angelus Silesius et mon bon vieux Chestov et le Giono de Jean le bleu - mais Dillard me reste présente, comme un gage de présence augmentée, avec Au présent, telle une cheftaine de meute de louveteaux avec sa boussole, dont les pages sont comme autant de vertigineux entonnoirs : «N’est-il pas bien tard ? Bien tard pour être en vie ? Nos générations ne sont-elles pas les plus décisives ? Car nous avons changé le monde. Notre époque si mouvementée n’est-elle pas la plus cruciale d’entre toutes ? Ne peut-on dire que notre siècle a une importance particulière qui rejaillit sur nous ? Notre siècle et son Holocauste unique, ses populations de réfugiés, ses exterminations totalitaires en série, notre siècle et ses antibiotiques, ses puces électroniques, ses hommes sur la lune et ses transplantations génétiques ? Non, ni notre siècle ni nous. L’époque qui est la nôtre est une époque ordinaire, une tranche de vie semblable à toute autre. Qui peut supporter d’entedre cela, qui accepte de l’envisager ? Il se peut cependant que nous soyons la dernière génération – voilà au moins qui est réconfortant. Si l’on supprime le menace de la bombe, que sommes-nous ? D’insignifiantes perles sur un collier sans fin. Notre époque n’est qu’un banal brin d’un improbable fil. Nous n'avons aucune chance d’être là lorsque le soleil se sera consumé. Notre époque doit bien avoir quelque chose d’héroïque, quelque chose qui la place au-dessus des toutes les autres. La peste ? Les caprices du climat ? Il se produit de terribles désastres. Nous assistons même à l’extinction massive d’espèces animales. D’après Robert M. May d’Oxford, la plupart des oiseaux et des mammifères que nous connaissons auront disparu d’ici quatre cents ans. Mais la terre a déjà connu cinq autres extinctions du même type, à des vingtaines de millions d’années d’intervalle », etc. À la table d’à côté, à L’Oasis de ce samedi soir, une famille de Serbes, trois générations à vue de nez, passent la commande au serveur Zoran qui se garde de parler aussi fort qu’eux. Or comment réagiraient-ils si je me levais et leur lisais, dans leur langue, les mots terribles de sister Annie : « Le humains ont également accompli des pas de géants dans l’élimination de leurs congénères, mais c’est là l’ambition de l’homme depuis toujours. Quel besoin avons-nous de regarder les actualités, de suivre les actualités. ? C’est afin de donner corps au fantasme - mensonge nécessaire sans doute – que nous vivons une époque cruciale et que nous sommes dans le coup. À peine la nouvelle est-elle révélée que déjà nous sommes au courant : des fous, des kyrielles de fous »..,La fillette du groupe de Serbes doit avoir cinq ans avec sa Barbie, donc c’est à elle que je m’adresse doucement en me penchant vers elle non sans me rappeler l’épitaphe à la petite fille du pharaon morte au même âge : « De nouvelles maladies, des changements de pouvoir, des inondations ! Se peut-il réellement que les actualités de l’Egypte ancienne dynastique aient été différentes en quoi que ce soit ? », oui mon enfant :« Нове болести, промене власти, поплаве! Да ли је заиста могуће да су се догађаји у старом династичком Египту на било који начин разликовали? »…
À la table d’à côté, à L’Oasis de ce samedi soir, une famille de Serbes, trois générations à vue de nez, passent la commande au serveur Zoran qui se garde de parler aussi fort qu’eux. Or comment réagiraient-ils si je me levais et leur lisais, dans leur langue, les mots terribles de sister Annie : « Le humains ont également accompli des pas de géants dans l’élimination de leurs congénères, mais c’est là l’ambition de l’homme depuis toujours. Quel besoin avons-nous de regarder les actualités, de suivre les actualités. ? C’est afin de donner corps au fantasme - mensonge nécessaire sans doute – que nous vivons une époque cruciale et que nous sommes dans le coup. À peine la nouvelle est-elle révélée que déjà nous sommes au courant : des fous, des kyrielles de fous »..,La fillette du groupe de Serbes doit avoir cinq ans avec sa Barbie, donc c’est à elle que je m’adresse doucement en me penchant vers elle non sans me rappeler l’épitaphe à la petite fille du pharaon morte au même âge : « De nouvelles maladies, des changements de pouvoir, des inondations ! Se peut-il réellement que les actualités de l’Egypte ancienne dynastique aient été différentes en quoi que ce soit ? », oui mon enfant :« Нове болести, промене власти, поплаве! Да ли је заиста могуће да су се догађаји у старом династичком Египту на било који начин разликовали? »… -
Che Bellezza !
 (Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À la Maison bleue, ce vendredi 21 juin. – Je suis fort déçu de matin par mon grille-pain, qui ne fait plus le job. Je l’ai menacé de le remplacer : cette façon de me cracher deux toasts de triste fabrication industrielle sans rien du croustillant odorant que devrait leur donner un grille-pain compétent par manière de compensation, m’a navré et gâché l’humeur. C’est pourquoi, faisant semblant d’être fâché – je crois toujours au possible repentir sincère d’un grille-pain dûment morigéné - , j’ai choisi la fuite par le haut en revenant à Jean le bleu dont j’ai recopié la première page avec l’humilité du Bénédictin savourant sa bénédictine du matin :«Les hommes de mon âge,ici, se souviennent du temps où la route qui va à Sainte-Tulle était bordée d’une épaisse rangée de peupliers. C’est une mode lombarde de planter des peupliers le long des routes. Celle-là s’en venait avec sa procession d'arbres des fonds du Piémont. Elle chevauchait le mont Genèvre, elle coulait le long des Alpes, elle venait jusqu’ici avec sa charge de longues charrettes criantes et ces groupes de terrassiers frisés qui marchaient à grands pas en faisant flotter des chansons et des pantalons housards. Elle venait jusqu’ici mais pas plus loin. Elle allait avec ses arbres, ses tape-culs et ses Piémontais jusqu’à la petite colline de Toutes-Autres. Là, elle regardait par là-bas derrière. Ce qu’elle voyait, de là, c’était dans les fonds brumeux le poudroyant Vaucluse, boueux et torride, fumant comme une soupe au choux. De là, ça sentait le gros légume, le riche et la plaine. De là, par beau temps, on voyait l’immobile pâleur des fermes fardées de chaux et le lent agenouillement des paysans gras dans l’alignée des serres à primeurs. De là, par jour de vent, montait l’odeur bouillonnante des lourds fumiers et le corps déchiqueté et sanglant des orages du Rhône. Les peupliers s’arrêtaient ici. Les charrettes coulaient à gros hoquets dans la gueule des auberges de roulage avec leur chargement de farine de maïs et de vin noir. Les terrassiers disaient : « Porca madona », ils éternuaient comme des mulets à qui on souffle de la fumée de pipe et ils restaient de ce côté-ci de la colline avec les peupliers et les charrettes »…Eh mais quel bien ça fait de recopier ces phrases sûres et belles, comme on recopierait du Colette ! Revenu de mon humeur grinche je constate en outre que le beau temps s’est installé à la fenêtre. Alors le Rital en moi - je n'oublie jamais ma double ascendance piémontaise et toscane - de s’exclamer: « Che bellezza !
(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À la Maison bleue, ce vendredi 21 juin. – Je suis fort déçu de matin par mon grille-pain, qui ne fait plus le job. Je l’ai menacé de le remplacer : cette façon de me cracher deux toasts de triste fabrication industrielle sans rien du croustillant odorant que devrait leur donner un grille-pain compétent par manière de compensation, m’a navré et gâché l’humeur. C’est pourquoi, faisant semblant d’être fâché – je crois toujours au possible repentir sincère d’un grille-pain dûment morigéné - , j’ai choisi la fuite par le haut en revenant à Jean le bleu dont j’ai recopié la première page avec l’humilité du Bénédictin savourant sa bénédictine du matin :«Les hommes de mon âge,ici, se souviennent du temps où la route qui va à Sainte-Tulle était bordée d’une épaisse rangée de peupliers. C’est une mode lombarde de planter des peupliers le long des routes. Celle-là s’en venait avec sa procession d'arbres des fonds du Piémont. Elle chevauchait le mont Genèvre, elle coulait le long des Alpes, elle venait jusqu’ici avec sa charge de longues charrettes criantes et ces groupes de terrassiers frisés qui marchaient à grands pas en faisant flotter des chansons et des pantalons housards. Elle venait jusqu’ici mais pas plus loin. Elle allait avec ses arbres, ses tape-culs et ses Piémontais jusqu’à la petite colline de Toutes-Autres. Là, elle regardait par là-bas derrière. Ce qu’elle voyait, de là, c’était dans les fonds brumeux le poudroyant Vaucluse, boueux et torride, fumant comme une soupe au choux. De là, ça sentait le gros légume, le riche et la plaine. De là, par beau temps, on voyait l’immobile pâleur des fermes fardées de chaux et le lent agenouillement des paysans gras dans l’alignée des serres à primeurs. De là, par jour de vent, montait l’odeur bouillonnante des lourds fumiers et le corps déchiqueté et sanglant des orages du Rhône. Les peupliers s’arrêtaient ici. Les charrettes coulaient à gros hoquets dans la gueule des auberges de roulage avec leur chargement de farine de maïs et de vin noir. Les terrassiers disaient : « Porca madona », ils éternuaient comme des mulets à qui on souffle de la fumée de pipe et ils restaient de ce côté-ci de la colline avec les peupliers et les charrettes »…Eh mais quel bien ça fait de recopier ces phrases sûres et belles, comme on recopierait du Colette ! Revenu de mon humeur grinche je constate en outre que le beau temps s’est installé à la fenêtre. Alors le Rital en moi - je n'oublie jamais ma double ascendance piémontaise et toscane - de s’exclamer: « Che bellezza !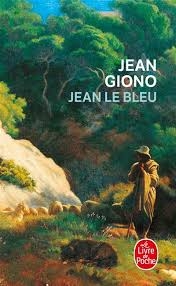
-
Ma position de démissionnaire
 (Mémoire vive, Lectures du monde)Pour Quentin et Stéphane, jeunes cons, et pour Alain Dugrand, ancien de Libé resté libre je crois, donc aussi con que moi...TOUT DIRE. - Un écrivain peut-il tout dire? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables?Je me pose ces questions depuis une cinquantaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre.Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. Rebatet lui-même, à 69 ans, en robe de chambre et vif comme un jeune fou, me dit comme ça, après trois lampées de scotch irlandais, que s'il avait eu mon âge ce jour-là (c'était en 1972) il eût été maoïste...C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique.Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe.J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine.Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires.Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline, etc.En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz?Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’ai plu tout tout Shakespeare que j'ai annoté pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir: que CELA monte.
(Mémoire vive, Lectures du monde)Pour Quentin et Stéphane, jeunes cons, et pour Alain Dugrand, ancien de Libé resté libre je crois, donc aussi con que moi...TOUT DIRE. - Un écrivain peut-il tout dire? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables?Je me pose ces questions depuis une cinquantaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre.Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. Rebatet lui-même, à 69 ans, en robe de chambre et vif comme un jeune fou, me dit comme ça, après trois lampées de scotch irlandais, que s'il avait eu mon âge ce jour-là (c'était en 1972) il eût été maoïste...C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique.Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe.J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine.Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires.Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline, etc.En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz?Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’ai plu tout tout Shakespeare que j'ai annoté pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir: que CELA monte.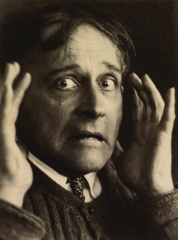 Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à le fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.Images: JLK à Bocca di Magra en juin 2024, Lucien Rebatet en 1972, Charles-Albert Cingria au téléphone, Stanislaw Ignacy Witkiewicz s'écriant: Katastrof !
Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à le fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.Images: JLK à Bocca di Magra en juin 2024, Lucien Rebatet en 1972, Charles-Albert Cingria au téléphone, Stanislaw Ignacy Witkiewicz s'écriant: Katastrof ! -
Quentin Mouron nous introduit aux fluides enfers de l’agréable
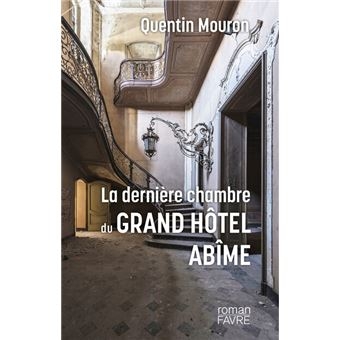 En phase avec son époque, dont il capte l’esprit et décrypte les codes et les fantasmes, tout en rompant avec son conformisme de masse, l’écrivain nous revient avec un roman-scanner d’une pénétration psycho-sociologique saisissante, sur fond de comédie sociale branchée, avec un titre aussi insolite et poétiquement pertinent que ceux de ses ouvrage précédents : La dernière chambre du Grand Hôtel Abîme…Ils et elles ne savent plus trop où « ielles » en sont, mais elles et ils disent que « ça baigne », et l’on ne saurait mieux conclure que par « monstre cool » alors que « ça » nous concerne tous plus ou moins, que nous le voulions ou non.Que le nom du capitaine Nemo, figure majeure de nos enfances de petits lecteurs entraînés vingt mille lieues sous les mers, soit devenu le prénom d’un zombie non binaire en jupon rose en qui les nouveaux techniciens de surface des médias se félicitent de découvrir l’emblème d'un monde à sexualité augmentée, n’est qu’un signe parmi d’autres de la fluidification générale, et d’aucuns paniquent ou réagissent en réacs tandis que d’autres « font avec », comme Sam le premier personnage à surgir dans le miroir aux alouettes du dernier roman de Quentin Mouron, se lançant à lui-même ce défi devant sa glace fissurée : « Sois un chien sombre qui aboie devant les tentes de l’existence », et la caravane de ses followers passe…On ne fait pas plus kitsch dans la tonalité poético-romantique en vogue sur la Toile, mais c’est exactement « ça » qui arrive à Sam et dont seront informés, tout à l’heure, les 200.000 abonnés de son compte Instagram...Pour le dire vite (avant de se dire non moins gravement « à vite ! »), Sam est devenu influenceur sans le vouloir vraiment, à vrai dire « comme tout le monde », vu que c’est effectivement à tous que « ça » arrive depuis que tout un chacun/chacune est connecté (e), d’abord sur Internet et ensuite sur les réseaux et « applis » multiples, surtout les jeunes. Tenez la preuve, la semaine passée : ma petite voisine de sept ans, au prénom d’Océane, devant sa webcam, dansait en pagne arc-en ciel en faisant de la pub pour une marque de blush, à l’insu de sa mère écoresponsable...Tous influenceurs ? Sûrement pas encore, mais quelque chose est bel et bien arrivé, comme on peut le dire aujourd’hui de l’épisode du Covid, et ça vaut d’être raconté…Or, avec son nouveau roman abordant la « vraie vie » et les faux semblants des influenceurs contemporains, Quentin Mouron nous étonne un fois de plus , comme il l’a fait depuis une douzaine d’années avec dix livres à son actif touchant aux genres divers du roman, de l’essai et de la poésie, apparemment différents les uns des autres mais tenus ensemble, en œuvre organiquement cohérente, par une même vision affirmée, une même porosité sensible et une même qualité d’expression - ce qu’on dira sa « papatte ».Bientôt au mitan de la trentaine, ce « millenial » avéré, pétri de la culture de sa génération et s’en distinguant par un constant décentrage intellectuel et affectif, a été situé dans la filiation d’un Michel Houellebecq, ou parfois d’un Bret Easton Ellis, pour sa façon de moduler des observations « sociétales » et de mêler observation clinique et satire, et l’on pourrait aussi relier son dernier livre au Cercle de Dave Eggers, mais le lascar est à vrai dire hors norme et comparaison, comme tout écrivain de vraie singularité.Un témoin du nouveau mondeLe nouveau monde - au propre et au figuré puisque Au point d’effusion des égouts (Morattel, 2011) relatait la traversée des States d’un jeune héritier des beatniks de la Route 66 -, et sa novlangue plus ou moins tribale, constituait la substance vivante du premier livre de Quentin (fils d’artiste et d’enseignante vaudois qui l’ont élevé en exil subtil dans une cabane des Laurentides), et c’est en Amérique aussi que se situait son deuxième roman, plus « tchekhovien » d’âme et de tripe, Notre-Dame de la merci (Morattel, 2012) qui annonçait déjà les qualités de cœur et d’esprit d’un auteur de grand avenir capable de mêler l’observation d’un milieu social donné (la classe moyenne en dérive se réfugiant dans la drogue) et l’impact personnel des désastres affectifs.D’un livre à l’autre, en effet, le thème qu’on pourrait dire de l’amour qui n’est pas aimé, ou de la rupture savourée sur fond de guerre des sexes acclimatée, a connu divers traitements et culmine dans La dernière chambre du Grand Hôtel Abîme, où l’intime et l’indiscrétion généralisée, le très particulier et les généralisations abusives, la vie affective ou sexuelle et les discours à n’en plus finir soumis aux nouvelles normes morales ou politiques, constituent un univers à la fois fantastique et hyperréel que le verbe de l’écrivain ressaisit avec précision.Sam, Lola, Hugo, Sixtine, Rocco et les autres…Lorsqu’il se pointe devant son miroir fêlé, Sam se partage donc entre sa vie de façade, suivie par les 150.000 abonnés de son compte TikTok, et son « ressenti » réel et privé, toujours marqué par sa rupture avec une certaine Sixtine (pas un clone de la chapelle : une influenceuse célèbre dont le nom de réseau pourrait être Sex-teen), dix ans auparavant, au terme d’une année de probable fol amour, et voici que vie réelle et story virtuelle risquent de se percuter du fait que Sam, comme Sixtine, sont tous deux invités à Venise pour une convention européenne d'influenceurs – mais la seule idée d’aller à Venise, cette ville-cliché, le rebute autant que l’horripilent de plus en plus les soirées à boire et se défoncer, alors même qu’il continue à « poster » des images faisant croire que la fête continue, mais « quand Sam postait des photos à cinq heures du matin, à six heures déjà plus de mille personnes avaient liké, ils se demandait qui étaient ces gens qui ne dormaient pas, qui ne fêtaient pas, qui ne lisaient pas, qui regardaient des photos de soirée, qui aimaient qu’il fasse la fête, qu’il soit défoncé, qu’il cite des poètes, il se demandait qui étaient ces femmes et ces hommes du biais, de la procuration, ces femmes et ces hommes de l’aube et du silence »…Soit dit en passant, la citation qui précède, mélange de lucidité triste et de poésie tendre, est du pur Quentin dont on relèvera, tout au long du livre, comme des précédents, qu’il aime ses personnages.Et de fait nous aimerons Sam, non parce qu’il est né coiffé et se montre plus intelligent que la moyenne, qu’il a touché à tout, un peu couché avec Hugo, passionnément aimé Sixtine qui l’a largué malgré leur succès géant auprès de leur communauté virtuelle qui « leur envoyait des cœurs et des flammes en permanence », mais parce qu’il est Sam, enfant du siècle comme l’est aussi Lola à sa façon toute différente, lucide et aimante – aimant les arts et la permanence, déçue plus souvent qu’à son tour, et avec Hugo elle sera servie une fois de plus - Hugo le journaliste plutôt raté qui se remet difficilement d’avoir un peu couché avec Sam et qu’on retrouvera à Venise comme on retrouvera Sixtine et son nouveau mec du moment, ce Rocco roulant ses mécaniques et rêvant de dormir dans des yourtes et de rencontrer un vrai sourcier ou un vrai énergiologue et/ou de lire du Sylvain Tesson au coin d’un vrai feu – mais assez de spoiling, lecteurices respecté(e)s : à vous le job !De la fluidité d’une écriture qui danseDe fait, on n’évoquera pas Sixtine en deux mots : on la « vivra » par les mots de Quentin Mouron, comme on vivra cette espèce de poème-missive envoyé aux humains de tous les sexes, dont la forme même mime, par sa fluidité, toutes les « inclusions » actuelles du discours plus ou moins vidé de sens et des idéologies plus ou moins vidées de contenu, l’Agora du moment se trouvant un squat vénitien où Shakespeare en découd avec les « acteurices » de tout bord et de toute dérive, sur fond beaucoup plus stable et solide qu’on ne croirait, qui est aussi le « fonds » d’un certain Milan Kundera aux anges flapis, ou d’un certain Stanislaw Ignacy Wikiewicz annonçant dans les années 20-30 du XXe siècle ce que quelques auteurs lucides, philosophes ou poètes, constatent aujourd’hui même : le triomphe de tous les nivellements et l’urgence de les combattre, fût-ce en dansant sur le volcan…Quentin Mouron. La dernière chambre du Grand Hôtel Abîme. Editions Favre, 2024.
En phase avec son époque, dont il capte l’esprit et décrypte les codes et les fantasmes, tout en rompant avec son conformisme de masse, l’écrivain nous revient avec un roman-scanner d’une pénétration psycho-sociologique saisissante, sur fond de comédie sociale branchée, avec un titre aussi insolite et poétiquement pertinent que ceux de ses ouvrage précédents : La dernière chambre du Grand Hôtel Abîme…Ils et elles ne savent plus trop où « ielles » en sont, mais elles et ils disent que « ça baigne », et l’on ne saurait mieux conclure que par « monstre cool » alors que « ça » nous concerne tous plus ou moins, que nous le voulions ou non.Que le nom du capitaine Nemo, figure majeure de nos enfances de petits lecteurs entraînés vingt mille lieues sous les mers, soit devenu le prénom d’un zombie non binaire en jupon rose en qui les nouveaux techniciens de surface des médias se félicitent de découvrir l’emblème d'un monde à sexualité augmentée, n’est qu’un signe parmi d’autres de la fluidification générale, et d’aucuns paniquent ou réagissent en réacs tandis que d’autres « font avec », comme Sam le premier personnage à surgir dans le miroir aux alouettes du dernier roman de Quentin Mouron, se lançant à lui-même ce défi devant sa glace fissurée : « Sois un chien sombre qui aboie devant les tentes de l’existence », et la caravane de ses followers passe…On ne fait pas plus kitsch dans la tonalité poético-romantique en vogue sur la Toile, mais c’est exactement « ça » qui arrive à Sam et dont seront informés, tout à l’heure, les 200.000 abonnés de son compte Instagram...Pour le dire vite (avant de se dire non moins gravement « à vite ! »), Sam est devenu influenceur sans le vouloir vraiment, à vrai dire « comme tout le monde », vu que c’est effectivement à tous que « ça » arrive depuis que tout un chacun/chacune est connecté (e), d’abord sur Internet et ensuite sur les réseaux et « applis » multiples, surtout les jeunes. Tenez la preuve, la semaine passée : ma petite voisine de sept ans, au prénom d’Océane, devant sa webcam, dansait en pagne arc-en ciel en faisant de la pub pour une marque de blush, à l’insu de sa mère écoresponsable...Tous influenceurs ? Sûrement pas encore, mais quelque chose est bel et bien arrivé, comme on peut le dire aujourd’hui de l’épisode du Covid, et ça vaut d’être raconté…Or, avec son nouveau roman abordant la « vraie vie » et les faux semblants des influenceurs contemporains, Quentin Mouron nous étonne un fois de plus , comme il l’a fait depuis une douzaine d’années avec dix livres à son actif touchant aux genres divers du roman, de l’essai et de la poésie, apparemment différents les uns des autres mais tenus ensemble, en œuvre organiquement cohérente, par une même vision affirmée, une même porosité sensible et une même qualité d’expression - ce qu’on dira sa « papatte ».Bientôt au mitan de la trentaine, ce « millenial » avéré, pétri de la culture de sa génération et s’en distinguant par un constant décentrage intellectuel et affectif, a été situé dans la filiation d’un Michel Houellebecq, ou parfois d’un Bret Easton Ellis, pour sa façon de moduler des observations « sociétales » et de mêler observation clinique et satire, et l’on pourrait aussi relier son dernier livre au Cercle de Dave Eggers, mais le lascar est à vrai dire hors norme et comparaison, comme tout écrivain de vraie singularité.Un témoin du nouveau mondeLe nouveau monde - au propre et au figuré puisque Au point d’effusion des égouts (Morattel, 2011) relatait la traversée des States d’un jeune héritier des beatniks de la Route 66 -, et sa novlangue plus ou moins tribale, constituait la substance vivante du premier livre de Quentin (fils d’artiste et d’enseignante vaudois qui l’ont élevé en exil subtil dans une cabane des Laurentides), et c’est en Amérique aussi que se situait son deuxième roman, plus « tchekhovien » d’âme et de tripe, Notre-Dame de la merci (Morattel, 2012) qui annonçait déjà les qualités de cœur et d’esprit d’un auteur de grand avenir capable de mêler l’observation d’un milieu social donné (la classe moyenne en dérive se réfugiant dans la drogue) et l’impact personnel des désastres affectifs.D’un livre à l’autre, en effet, le thème qu’on pourrait dire de l’amour qui n’est pas aimé, ou de la rupture savourée sur fond de guerre des sexes acclimatée, a connu divers traitements et culmine dans La dernière chambre du Grand Hôtel Abîme, où l’intime et l’indiscrétion généralisée, le très particulier et les généralisations abusives, la vie affective ou sexuelle et les discours à n’en plus finir soumis aux nouvelles normes morales ou politiques, constituent un univers à la fois fantastique et hyperréel que le verbe de l’écrivain ressaisit avec précision.Sam, Lola, Hugo, Sixtine, Rocco et les autres…Lorsqu’il se pointe devant son miroir fêlé, Sam se partage donc entre sa vie de façade, suivie par les 150.000 abonnés de son compte TikTok, et son « ressenti » réel et privé, toujours marqué par sa rupture avec une certaine Sixtine (pas un clone de la chapelle : une influenceuse célèbre dont le nom de réseau pourrait être Sex-teen), dix ans auparavant, au terme d’une année de probable fol amour, et voici que vie réelle et story virtuelle risquent de se percuter du fait que Sam, comme Sixtine, sont tous deux invités à Venise pour une convention européenne d'influenceurs – mais la seule idée d’aller à Venise, cette ville-cliché, le rebute autant que l’horripilent de plus en plus les soirées à boire et se défoncer, alors même qu’il continue à « poster » des images faisant croire que la fête continue, mais « quand Sam postait des photos à cinq heures du matin, à six heures déjà plus de mille personnes avaient liké, ils se demandait qui étaient ces gens qui ne dormaient pas, qui ne fêtaient pas, qui ne lisaient pas, qui regardaient des photos de soirée, qui aimaient qu’il fasse la fête, qu’il soit défoncé, qu’il cite des poètes, il se demandait qui étaient ces femmes et ces hommes du biais, de la procuration, ces femmes et ces hommes de l’aube et du silence »…Soit dit en passant, la citation qui précède, mélange de lucidité triste et de poésie tendre, est du pur Quentin dont on relèvera, tout au long du livre, comme des précédents, qu’il aime ses personnages.Et de fait nous aimerons Sam, non parce qu’il est né coiffé et se montre plus intelligent que la moyenne, qu’il a touché à tout, un peu couché avec Hugo, passionnément aimé Sixtine qui l’a largué malgré leur succès géant auprès de leur communauté virtuelle qui « leur envoyait des cœurs et des flammes en permanence », mais parce qu’il est Sam, enfant du siècle comme l’est aussi Lola à sa façon toute différente, lucide et aimante – aimant les arts et la permanence, déçue plus souvent qu’à son tour, et avec Hugo elle sera servie une fois de plus - Hugo le journaliste plutôt raté qui se remet difficilement d’avoir un peu couché avec Sam et qu’on retrouvera à Venise comme on retrouvera Sixtine et son nouveau mec du moment, ce Rocco roulant ses mécaniques et rêvant de dormir dans des yourtes et de rencontrer un vrai sourcier ou un vrai énergiologue et/ou de lire du Sylvain Tesson au coin d’un vrai feu – mais assez de spoiling, lecteurices respecté(e)s : à vous le job !De la fluidité d’une écriture qui danseDe fait, on n’évoquera pas Sixtine en deux mots : on la « vivra » par les mots de Quentin Mouron, comme on vivra cette espèce de poème-missive envoyé aux humains de tous les sexes, dont la forme même mime, par sa fluidité, toutes les « inclusions » actuelles du discours plus ou moins vidé de sens et des idéologies plus ou moins vidées de contenu, l’Agora du moment se trouvant un squat vénitien où Shakespeare en découd avec les « acteurices » de tout bord et de toute dérive, sur fond beaucoup plus stable et solide qu’on ne croirait, qui est aussi le « fonds » d’un certain Milan Kundera aux anges flapis, ou d’un certain Stanislaw Ignacy Wikiewicz annonçant dans les années 20-30 du XXe siècle ce que quelques auteurs lucides, philosophes ou poètes, constatent aujourd’hui même : le triomphe de tous les nivellements et l’urgence de les combattre, fût-ce en dansant sur le volcan…Quentin Mouron. La dernière chambre du Grand Hôtel Abîme. Editions Favre, 2024. -
La vie sous le gingko
 (Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À la Maison bleue, ce mardi 11 juin.– Arriverai-je vivant au 14 juin, ce vendredi prochain où je suis censé fêter mes 77 ans avec mes filles sur la terrasse de Bourg-en-Lavaux, sous le ginkgo ? Je l’aimerais bien, mais mon état de ce matin, ma peine à respirer, mes jambes qui flageolent et se dérobent, ma vue troublée et mon oreille interne également perturbée , enfin tout le bâtiment en déglingue me font craindre un possible clash tout prochain alors qu’il y aurait encore tant d’ordre à mettre dans mes affaires et tant de passerelles à lancer en avant...Je relisais hier le journal de Roland Jaccard, Le monde d’avant, de l’année 1983 où notre Sophie achevait sa première année, et je souriais de voir ce cher faux dilettante se dénigrer à bon marché tout en s’accrochant à ce qu’il y a de plus futile et passager dans la vie, mais non sans moduler aussi tant d’observations et de considérations fondées et intéressantes.Je tiens mes carnets de façon régulière depuis ma 18e année environ. Le projet, d’abord non concerté, que constituent mes Lectures du monde représente aujourd’hui cinq volumes publiés, soit plus de 2000 pages, et les deux derniers comptent un peu plus de 1500 pages à l’heure qu’il est.John Cowper Powys pense que la Littérature est le journal de bord de l’Humanité, je le pense aussi et c’est dans cette filiation que s’inscrivent, plus précisément, mes Lectures du monde, comptant actuellement quelque 3500 pages dont 2000 ont été publiées en cinq volumes, de L’Ambassade du papillon à L’échappée libre. La suite se déploie entre Mémoire vive (2013-2019) et Le Temps accordé (2020- ….), dont l’avenir éditorial reste aussi incertain que celui de mes 7 autres manuscrits actuellement publiables dans un contexte éditorial et littéraire où je n’existe quasiment plus.De fait, les deux derniers livres que j’ai publiés n’ont pas eu droit au moindre papier dans les médias où j’ai donné le meilleur de moi-même pendant une cinquantaine d’années, à commencer par 24 Heures où ne sévissent plus que les techniciens de surface du commentaire culturel délayé par l’injonction commerciale - ceci dit sans aigreur car le plaisir me reste, et quelques fins lecteurs aux commentaires de qualité le partagent.Ce mercredi 12 juin. – À mon tribunal secret, je m’accuse ces jours de perdre beaucoup de temps à traîner. Ce n’est pas bien : c’est mal. Notre cher François Mégroz, grand lecteur et commentateur de la Commedia de Dante définissait ainsi le mal : le non-Être. C’est cela même et je dois y penser à tout instant, sans trop réfléchir. Bien entendu, le Fantaisiste se défend en invoquant l’importance du pulsionnel et autres dispositions débonnaires, mais je reste, comme l’ami Roland Jaccard dont je relis Le Monde d’avant, une espèce de puritain compliqué, et le retour au pavé de D.H. Lawrence, qui va m’accompagner ces jours prochains au fil de mes réflexions personnelles sur la poésie, ne va pas simplifier la donne, et c’est tant mieux.Notre prof d’allemand Wilfred Schiltknecht, du genre intellectuel de gauche toujours ouvert à la Zwiespältigkeit, autrement dit à la fondamentale dualité humaine, me disait qu’il avait toujours eu, avec ma personne ne le lâchant pas du regard en face de son pupitre magistral, l’impression d’avoir devant lui sa Conscience, et je me rappelle la définition de celle-ci par Alexandre Zinoviev (« ce machin, la conscience ») en me disant que le surmoi de mes aïeules n’a cessé d’interférer avec mes fantaisies et autres notoires inconduites…Ce jeudi 13 juin. – Reposé, après une nuit de plein sommeil sans trop transpirer, et maintenant (il est 11h.20) je me dis qu’il ne faut plus traîner. Il faut, il ne faut pas, on doit, on ne doit pas : je me le dis depuis mon adolescence consciente, peut-être même avant si je pense à l’éveil de ma conscience, probablemenet avant et sûrement dès ma dixième année.Or quand je dis traîner, je pense à la monstrueuse perte de temps à laquelle j’assiste aux écrans et à leur multiple périphérie, sous le signe de Pandora.Ce vendredi 14 juin. – Malgré mes craintes et tremblements de ces derniers temps, je suis arrivé au 14 juin marquant ma 77e année, sans compter les 9 mois de gestation que la tradition coréenne inclut dans le cycle de vie, j’ai retrouvé ce midi nos deux filles à La Table, où elles m’ont offert des roses, puis j’ai dormi, puis je me suis repointé sur le rivage des baigneurs, et me revoici à L’Oasis où le serveur Zoran, Serbe d’origine installé en Suisse depuis 14 ans, me raconte le périple de sa famille au temps de la guerre. Comme ile vient de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, je lui raconte mon dernier séjour à Dubrovnik, alors que la guerre faisait encore rage sur les hauts, le montage idéologique et médiatique des Croates - qui fomentaient l'exclusion de la section serbe du P.E.N. club en congrès, et la jobardise de mes chers confrères dansant comme des ours au son du violon nationaliste...Ce dimanche 16 juin. - J’éprouve le plus vif besoin, ce dimanche matin, de rompre un certain cercle vicieux dans lequel je me suis laissé entraîner par la seule Habitude, au sens où l’entendait un certain Arthur Rimbaud. Or je me demande précisément, ce matin, qui était le vrai Rimbaud ? comme je me demande qui je suis vraiment ?J’ai esquissé hier soir un poème qui est comme la pointe d’une réflexion encore confuse, mais que je dois clarifier. Or cette question de la « marche au poème », pour parler un peu pompeusement à la manière d’un certain homme de lettres suisse allemand, devrait m’occuper ces prochains jours. Je vais d’ailleurs m’y employer dès aujourd’hui, dans mon cahier argenté. Je dois m’appliquer à tout clarifier. Je dois, il faut, la barbe, etc.Quant à l’esquisse de poème, la voici :La beauté que j’ai vue en toireste notre secretque nul autre n’a devinéque moi, les yeux fermés…Je ne suis rien que ton reflet,je ne sais qui je suis,ni d'où tu viens, ni qui tu esnous sommes là comme une nuit...Je serais celui qui te parle,tu te tairais pour que je disece que tous deux nous ignoronsde ce qu’en nous le ciel divise…Quant à la nébuleuse en toi,l’aube aussi s’y retrouveoù l’Autre deviendra ce moique l’alliance prouve…Et que cela signifie-t-il au juste, comme ça me vient ? Je n’en ai pas la moindre idée… Il est peut-être question d’Animus et d'Anima ? Je ne sais pas.Je vais jouer désormais sur les divers niveaux de confidentialité que requiert l’usage des réseaux sociaux, plus précisément Facebook. Ce sera comme un jeu et je l’inaugure, en russe, avec un constat lié au phénomène mondial de la nouvelle dépendance liant les individus à leurs petits écrans (tablettes ou portabless) qui les fait se regarder en train d’être regardés par leurs semblables usagers se regardant les regarder par milliers et millions.Веб-камера: тысячи, миллионы наблюдают друг за другом, и миллионы наблюдают за собой, наблюдая за ними.Avec les Pages valaisannes de Cingria, je fais retour à Charles-Albert, trouvant une filiation étroite entre Pendeloques alpestres et Le Canal exutoire - ce que j’ai appelé son lyrisme ontologique. comme en convient la Professorella via WhatsApp...Hier soir avec mes vieux amis aux cœurs verts. Tonio m’a invité en évoquant « une circonstace exceptionnelle », du genre « c’est pas tous les jours », etc. Il me fait toujours rire avec ses formules plus ou moins ampoulée, très « homme de lettres », comme lorsqu’il parle de l’amour oedipien qu’il voue à sa mère à titre posthume, après avoir vénéré son Pap’s à outrance – ce que je raille également. C’est l’homme de lettres en moi qu’en me moquant de Tonio je dégomme…Ce lundi 17 juin. – C’est aujourd’hui l’anniversaire de la naissance du deuxième garçom de notre deuxième fille, et comme tout va par deux dans l’univers binaire, puisque aussi bien ils se sont mis à deux pour concevoir ce deuxième enfant avant la troisième, laquelle nous rappelle à juste escient que la vérité duelle n’est avérée en création que dans le débouché du symbole trinitaire, moi qui suis apparu au quaternaire et ne saurais donc me satisfaire du seul chiffre deux ou de la réalité augmentée du seul trois, en attente de l’idéal septuor je lambine – telle étant ma façon artiste de Fantaisiste.Révérence alors au terrible Timothy auquel j’offrirai tout à l’heure, à partager avec ses frère et sœur : un télescope et un microscope, le premier pour se perdre en pensée dans l’Immensité des divers univers recueillie en orbe minuscule, et l’autre pour se retrouver dans l’infime majuscule du Présent - cadeau.Ce mardi 18 juin. – Un poème m’est venu ce matin, découlant de ma reprise de la lecture, hier soir des Révélations de la mort de Chestov, et que j’ai dédié à Pierre-Guillaume et à sa compagne Emilia, que je vais retrouver tout à l’heure au café branché de Grancy.Le poème, d’abord :Ce que dit le silence« Qui sait, dit Euripide,il se peut que la vie soit la mortet que la mort soit la vie »(Léon Chestov, Les révélations de la mort)Pour Emilia, en mémoire de Pierre-Guillaume.La suprême ignorance est là,de ne plus savoir side la nuit avant l’heure,ou du jour et ses leurressont ce qu’ils sont ou ne sont pas…L’étrange chose qu’une rosequi ne parle qu’en soiet dont jamais aucune foin’osa dire qu’elle dispose…Les mots ne voulaient dire que ça:qu’ils savent qu’ils ignorentque le silence dort,et que la mort n’existe pas…(Soir) - Repris ce soir, non pas à mon Oasis de presque tous les soirs mais à une terrasse de Villeneuve où je ne retournerai pas à cause de son serveur narcissique se la jouant copain-copain-olé-olé, la lecture du livre de Quentin, que je prends de plus en plus au sérieux. Les critiques que j’en ai lues me font penser que, justement, on ne le prend pas vraiment au sérieux, concluant notamment à la superficialité de ses personnages. Or c’est inexact, ou disons plus précisément que la « surface » de ses personnages, vivant en effet dans l’immanence au (dé)goût du jour, est traitée par l’auteur avec une rare pénétration psychologique et avec une foison de détails significatifs quant à l’époque et aux particularités de chacun.L’on ne voit pas assez, non plus, le caractère proprement poétique de son travail sur le langage, et plus précisément sur la novlangue des temps qui courent, et quand je dis langage je ne parle pas seulement de ce que disent ses personnages mais de leurs gestes, de leurs postures sociales ou intimes, du langage de leurs corps, de leur idéologie latente ou patente. Tout cela restant à détailler, prénom par prénom, car c’est par là qu'ils se distinguent, se ressemblent ou s’opposent, et c'est à quoi je vais m'exercer dans ma prochaine chronique...
(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À la Maison bleue, ce mardi 11 juin.– Arriverai-je vivant au 14 juin, ce vendredi prochain où je suis censé fêter mes 77 ans avec mes filles sur la terrasse de Bourg-en-Lavaux, sous le ginkgo ? Je l’aimerais bien, mais mon état de ce matin, ma peine à respirer, mes jambes qui flageolent et se dérobent, ma vue troublée et mon oreille interne également perturbée , enfin tout le bâtiment en déglingue me font craindre un possible clash tout prochain alors qu’il y aurait encore tant d’ordre à mettre dans mes affaires et tant de passerelles à lancer en avant...Je relisais hier le journal de Roland Jaccard, Le monde d’avant, de l’année 1983 où notre Sophie achevait sa première année, et je souriais de voir ce cher faux dilettante se dénigrer à bon marché tout en s’accrochant à ce qu’il y a de plus futile et passager dans la vie, mais non sans moduler aussi tant d’observations et de considérations fondées et intéressantes.Je tiens mes carnets de façon régulière depuis ma 18e année environ. Le projet, d’abord non concerté, que constituent mes Lectures du monde représente aujourd’hui cinq volumes publiés, soit plus de 2000 pages, et les deux derniers comptent un peu plus de 1500 pages à l’heure qu’il est.John Cowper Powys pense que la Littérature est le journal de bord de l’Humanité, je le pense aussi et c’est dans cette filiation que s’inscrivent, plus précisément, mes Lectures du monde, comptant actuellement quelque 3500 pages dont 2000 ont été publiées en cinq volumes, de L’Ambassade du papillon à L’échappée libre. La suite se déploie entre Mémoire vive (2013-2019) et Le Temps accordé (2020- ….), dont l’avenir éditorial reste aussi incertain que celui de mes 7 autres manuscrits actuellement publiables dans un contexte éditorial et littéraire où je n’existe quasiment plus.De fait, les deux derniers livres que j’ai publiés n’ont pas eu droit au moindre papier dans les médias où j’ai donné le meilleur de moi-même pendant une cinquantaine d’années, à commencer par 24 Heures où ne sévissent plus que les techniciens de surface du commentaire culturel délayé par l’injonction commerciale - ceci dit sans aigreur car le plaisir me reste, et quelques fins lecteurs aux commentaires de qualité le partagent.Ce mercredi 12 juin. – À mon tribunal secret, je m’accuse ces jours de perdre beaucoup de temps à traîner. Ce n’est pas bien : c’est mal. Notre cher François Mégroz, grand lecteur et commentateur de la Commedia de Dante définissait ainsi le mal : le non-Être. C’est cela même et je dois y penser à tout instant, sans trop réfléchir. Bien entendu, le Fantaisiste se défend en invoquant l’importance du pulsionnel et autres dispositions débonnaires, mais je reste, comme l’ami Roland Jaccard dont je relis Le Monde d’avant, une espèce de puritain compliqué, et le retour au pavé de D.H. Lawrence, qui va m’accompagner ces jours prochains au fil de mes réflexions personnelles sur la poésie, ne va pas simplifier la donne, et c’est tant mieux.Notre prof d’allemand Wilfred Schiltknecht, du genre intellectuel de gauche toujours ouvert à la Zwiespältigkeit, autrement dit à la fondamentale dualité humaine, me disait qu’il avait toujours eu, avec ma personne ne le lâchant pas du regard en face de son pupitre magistral, l’impression d’avoir devant lui sa Conscience, et je me rappelle la définition de celle-ci par Alexandre Zinoviev (« ce machin, la conscience ») en me disant que le surmoi de mes aïeules n’a cessé d’interférer avec mes fantaisies et autres notoires inconduites…Ce jeudi 13 juin. – Reposé, après une nuit de plein sommeil sans trop transpirer, et maintenant (il est 11h.20) je me dis qu’il ne faut plus traîner. Il faut, il ne faut pas, on doit, on ne doit pas : je me le dis depuis mon adolescence consciente, peut-être même avant si je pense à l’éveil de ma conscience, probablemenet avant et sûrement dès ma dixième année.Or quand je dis traîner, je pense à la monstrueuse perte de temps à laquelle j’assiste aux écrans et à leur multiple périphérie, sous le signe de Pandora.Ce vendredi 14 juin. – Malgré mes craintes et tremblements de ces derniers temps, je suis arrivé au 14 juin marquant ma 77e année, sans compter les 9 mois de gestation que la tradition coréenne inclut dans le cycle de vie, j’ai retrouvé ce midi nos deux filles à La Table, où elles m’ont offert des roses, puis j’ai dormi, puis je me suis repointé sur le rivage des baigneurs, et me revoici à L’Oasis où le serveur Zoran, Serbe d’origine installé en Suisse depuis 14 ans, me raconte le périple de sa famille au temps de la guerre. Comme ile vient de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, je lui raconte mon dernier séjour à Dubrovnik, alors que la guerre faisait encore rage sur les hauts, le montage idéologique et médiatique des Croates - qui fomentaient l'exclusion de la section serbe du P.E.N. club en congrès, et la jobardise de mes chers confrères dansant comme des ours au son du violon nationaliste...Ce dimanche 16 juin. - J’éprouve le plus vif besoin, ce dimanche matin, de rompre un certain cercle vicieux dans lequel je me suis laissé entraîner par la seule Habitude, au sens où l’entendait un certain Arthur Rimbaud. Or je me demande précisément, ce matin, qui était le vrai Rimbaud ? comme je me demande qui je suis vraiment ?J’ai esquissé hier soir un poème qui est comme la pointe d’une réflexion encore confuse, mais que je dois clarifier. Or cette question de la « marche au poème », pour parler un peu pompeusement à la manière d’un certain homme de lettres suisse allemand, devrait m’occuper ces prochains jours. Je vais d’ailleurs m’y employer dès aujourd’hui, dans mon cahier argenté. Je dois m’appliquer à tout clarifier. Je dois, il faut, la barbe, etc.Quant à l’esquisse de poème, la voici :La beauté que j’ai vue en toireste notre secretque nul autre n’a devinéque moi, les yeux fermés…Je ne suis rien que ton reflet,je ne sais qui je suis,ni d'où tu viens, ni qui tu esnous sommes là comme une nuit...Je serais celui qui te parle,tu te tairais pour que je disece que tous deux nous ignoronsde ce qu’en nous le ciel divise…Quant à la nébuleuse en toi,l’aube aussi s’y retrouveoù l’Autre deviendra ce moique l’alliance prouve…Et que cela signifie-t-il au juste, comme ça me vient ? Je n’en ai pas la moindre idée… Il est peut-être question d’Animus et d'Anima ? Je ne sais pas.Je vais jouer désormais sur les divers niveaux de confidentialité que requiert l’usage des réseaux sociaux, plus précisément Facebook. Ce sera comme un jeu et je l’inaugure, en russe, avec un constat lié au phénomène mondial de la nouvelle dépendance liant les individus à leurs petits écrans (tablettes ou portabless) qui les fait se regarder en train d’être regardés par leurs semblables usagers se regardant les regarder par milliers et millions.Веб-камера: тысячи, миллионы наблюдают друг за другом, и миллионы наблюдают за собой, наблюдая за ними.Avec les Pages valaisannes de Cingria, je fais retour à Charles-Albert, trouvant une filiation étroite entre Pendeloques alpestres et Le Canal exutoire - ce que j’ai appelé son lyrisme ontologique. comme en convient la Professorella via WhatsApp...Hier soir avec mes vieux amis aux cœurs verts. Tonio m’a invité en évoquant « une circonstace exceptionnelle », du genre « c’est pas tous les jours », etc. Il me fait toujours rire avec ses formules plus ou moins ampoulée, très « homme de lettres », comme lorsqu’il parle de l’amour oedipien qu’il voue à sa mère à titre posthume, après avoir vénéré son Pap’s à outrance – ce que je raille également. C’est l’homme de lettres en moi qu’en me moquant de Tonio je dégomme…Ce lundi 17 juin. – C’est aujourd’hui l’anniversaire de la naissance du deuxième garçom de notre deuxième fille, et comme tout va par deux dans l’univers binaire, puisque aussi bien ils se sont mis à deux pour concevoir ce deuxième enfant avant la troisième, laquelle nous rappelle à juste escient que la vérité duelle n’est avérée en création que dans le débouché du symbole trinitaire, moi qui suis apparu au quaternaire et ne saurais donc me satisfaire du seul chiffre deux ou de la réalité augmentée du seul trois, en attente de l’idéal septuor je lambine – telle étant ma façon artiste de Fantaisiste.Révérence alors au terrible Timothy auquel j’offrirai tout à l’heure, à partager avec ses frère et sœur : un télescope et un microscope, le premier pour se perdre en pensée dans l’Immensité des divers univers recueillie en orbe minuscule, et l’autre pour se retrouver dans l’infime majuscule du Présent - cadeau.Ce mardi 18 juin. – Un poème m’est venu ce matin, découlant de ma reprise de la lecture, hier soir des Révélations de la mort de Chestov, et que j’ai dédié à Pierre-Guillaume et à sa compagne Emilia, que je vais retrouver tout à l’heure au café branché de Grancy.Le poème, d’abord :Ce que dit le silence« Qui sait, dit Euripide,il se peut que la vie soit la mortet que la mort soit la vie »(Léon Chestov, Les révélations de la mort)Pour Emilia, en mémoire de Pierre-Guillaume.La suprême ignorance est là,de ne plus savoir side la nuit avant l’heure,ou du jour et ses leurressont ce qu’ils sont ou ne sont pas…L’étrange chose qu’une rosequi ne parle qu’en soiet dont jamais aucune foin’osa dire qu’elle dispose…Les mots ne voulaient dire que ça:qu’ils savent qu’ils ignorentque le silence dort,et que la mort n’existe pas…(Soir) - Repris ce soir, non pas à mon Oasis de presque tous les soirs mais à une terrasse de Villeneuve où je ne retournerai pas à cause de son serveur narcissique se la jouant copain-copain-olé-olé, la lecture du livre de Quentin, que je prends de plus en plus au sérieux. Les critiques que j’en ai lues me font penser que, justement, on ne le prend pas vraiment au sérieux, concluant notamment à la superficialité de ses personnages. Or c’est inexact, ou disons plus précisément que la « surface » de ses personnages, vivant en effet dans l’immanence au (dé)goût du jour, est traitée par l’auteur avec une rare pénétration psychologique et avec une foison de détails significatifs quant à l’époque et aux particularités de chacun.L’on ne voit pas assez, non plus, le caractère proprement poétique de son travail sur le langage, et plus précisément sur la novlangue des temps qui courent, et quand je dis langage je ne parle pas seulement de ce que disent ses personnages mais de leurs gestes, de leurs postures sociales ou intimes, du langage de leurs corps, de leur idéologie latente ou patente. Tout cela restant à détailler, prénom par prénom, car c’est par là qu'ils se distinguent, se ressemblent ou s’opposent, et c'est à quoi je vais m'exercer dans ma prochaine chronique... -
Au Temps accordé
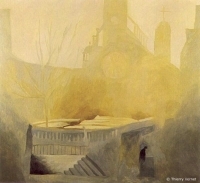 Quand la lumière s’en va dormir,tout se tait aux clairièresde l’être apaisé qui reposeloin des guerres et des choses…Les veilleuses et les veilleurspaisibles sentinelles,contre toute raison rebelle,voient que la joie demeure…Au sommeil levant toute peur,redevenus enfants,dans l’obscure clarté des heures,respire en nous le Temps...Peinture: Thierry Vernet.
Quand la lumière s’en va dormir,tout se tait aux clairièresde l’être apaisé qui reposeloin des guerres et des choses…Les veilleuses et les veilleurspaisibles sentinelles,contre toute raison rebelle,voient que la joie demeure…Au sommeil levant toute peur,redevenus enfants,dans l’obscure clarté des heures,respire en nous le Temps...Peinture: Thierry Vernet. -
Le zombie et l'Artiste
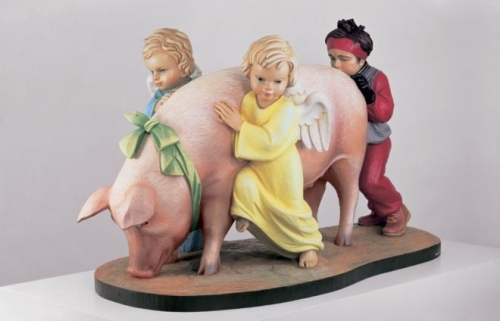
A propos de Jeff Koons et de Nicolas de Staël.
Il faut saluer avec des vivats rétrospectifs, au lieu de s’en indigner à la vertueuse, l’apparition à valeur désormais mythique, au pinacle du Marché de l’Art, du charlatan Jeff Koons et de sa putain politicienne au surnom féerique de Cicciolina.
Cette apparition - plus de vingt ans avant l’intronisation du président atypique Donald Trump, et contemporaine de la montée en puissance du Cavaliere Silvio Berlusconi, lequel aura fait de la télévision l’usage éminemment créatif de son influence impériale, comme il en est aujourd’hui de l’usage de TWITTER par le «locataire de la Maison Blanche», selon l’expression consacrée – me semble à vrai dire plus qu’un épisode de la légende dorée du seul Marché de l’Art en cela que la success story de Jeff Koons, de manière évidemment plus impactante que celle d’un Joël Dicker dans l’univers tout de même confiné du best-seller imprimé ou numérique, réalise à de multiples égards les fantasmes de la société présente et future de l’espèce zombie dont chacune et chacun oublie parfois qu’elle a conservé un cœur d’enfant et que sa disposition matinale, relevant d’une hygiène maîtrisée, suppose la relance de son constant émerveillement. Poil aux dents.

Mais j’ai mal commencé en taxant de charlatan celui qui fut d’abord un jeune courtier d’affaires de Manhattan, fils d’un marchand de meubles accessoirement adonné à la décoration d’intérieur et d’une couturière modeste, donc au fait des réalités de ce bas monde, moins verni à la base que ce fils à papa de Donald Trump et cependant remarqué dès son enfance par ses dessinages joyeusement coloriés sur le thème du lapin Rabbit - alors quoi du charlatan là-dedans ?
Je me reprends donc en langage plus approprié en reconnaissant à Jeff Koons la double expérience initiale, bien avant ses premières interventions sur la Scène Artistique, du plasticien virtuel et du potentiel entrepreneur financier décidé à faire fortune, peut-être sous l’influence directe des fameuses émissions télévisées du futur personnage «le plus puissant de la planète», mais à son modeste échelon, comme Jeff le rappellera lui-même volontiers.
***
Cependant il convient de documenter, brièvement, les tenants du «parcours de rêve» accompli par le rejeton de Gloria et Henry, dont un détail significatif, et quelque part émouvant aussi – ou déjà suspect, diront certains mauvais esprits dont je suis – mérite d’être relevé.
Ainsi ce bon vieil Henry Koons accoutumait-il, pour attirer les clients en son magasin d’ensemblier-décorateur, d’orner ses vitrines de tableaux copiés et signés par son fils de neuf ans seulement, presque aussi précoce que Pablo Picasso recopiant lui aussi les reproductions des maîtres du Prado à sept ans mais sans les signer: nuance.Le fils «prodige» est d’ailleurs loin de snober son paternel, puisqu’on voit l’adolescent, démarcher rubans et dentelles au porte-à-porte, déjà sensible à la beauté du joli qui établira, des années plus tard, sa notoriété de chantre universel du kitsch.
Parenthèse sardonique: un critique morose a pu dire, en des temps heureusement révolus, que le propre du Bourgeois, ou pire : du Petit-Bourgeois, était de trouver beau ce qui est joli et joli ce qui est beau, mais vous savez ce que Jeffie pense de la critique: des nèfles, toujours à rabaisser le génie…
Lui-même , comme souvent les artistes ou les écrivains contraints de faire tous les métiers, n’a d’ailleurs jamais eu le temps de se prendre la tête à propos de ces notions de copie signées ou de critères esthétiques à la flan : il est dans le trend de la vie et va jusqu’à vendre des bouteilles de Coca sur un parcours de golf pour aider ses vieux à payer ses études, bref il paie de sa personne comme il le fera tout au long de sa carrière, et notamment dans sa série Made in Heaven, que je traduira par Label Paradis où, brisant les codes et bravant les interdits, il fait photographier et sérigraphier ses étreintes torrides avec la Cicciolina – mais j’y reviendrai…
Du moins faut-il compléter, tant soit peu, ce trop bref aperçu du transit pour ainsi dire astral de celui qui n’était pas encore, cependant, une étoile montante à la fin des seventies où, élève à Chicago du remuant Ed Paschke, créateur d’une Vaca victoria controversée, il allait commencer d’entrevoir un nouveau concept personnel à développer entre néo-pop art finissant et revival post-surréaliste à la Salvador Dali, etc.
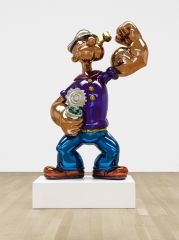
Jeff Koons, immédiatement soucieux de sa «fonctionnalité marchande» - pour emprunter une formule de mon ami sociologue marxiste Jean Ziegler -, est un pur produit de son époque en tant que «plasticien» le plus servilement conformé à un Système schizophrénique intégrant, dès la fin des années 70, la culture et la contre-culture, toute forme de rébellion et son contraire, la prétendue critique de l’académisme et son développement exponentiel en tant que sous-produit, disons pour faire court : un produit-symptôme autant qu’un sous-produit fantôme avant la lettre de la nation zombie.
Jeff Koons sort, métaphoriquement s’entend, du pissoir de Marcel Duchamp et de la série des ready-made, comme son mentor Ed Paschke est sorti des portraits tamponnés d’Andy Warhol avec ses effigies déformées de stars du cinéma (Marilyn Monroe, etc.) ou de l’Histoire de l’art démystifiée (La Joconde, etc.), et tous les produits à venir de la firme Koons, comme ceux de la Factory du cher Andy, ressortiront à un incessant mouvement de recyclage des déchets qu’on pourrait dire insignifiant en termes artistiques alors qu’ils signifient au contraire la Mort de l’Art cautionnée au plus haut niveau par nos élites commerciales, politiques et culturelles.
Avec le financier véreux Bernard Madoff qui l’a kiffé avant tout le monde, pour parler branché, Jeff Koons participe bel et bien à cette course au néant pointée dès les années 20 du XXe siècle par un Stanislaw Ignacy Witkiewicz dans ses écrits sur l’Art en train de se transformer en ornement, vidé de toute substance, des lieux d’aisance du bien-être généralisé.
Bref, le tramway DÉSIR de l’avant-garde du début du XXe siècle n’en finit par de bringuebaler sur la ligne dite progressiste qui conduit à la station CIMETIÈRE, etc.Avant d’en venir à l’évocation de ma première découverte des produits de la firme Koons, en 1992, j’estime loyal de préciser quelque peu en quoi consiste ma perception personnelle de la chose artistique en sa spécificité remontant à la nuit des temps humains, du côté de Lascaux ou Altamira, ou avant, ou ailleurs, peu importe – on m’a très bien compris, merci.
Plus précisément, je voue à la peinture une vraie passion depuis l’âge de douze ou treize ans, ayant longtemps regardé quelques beaux livres de notre bibliothèque familiale, dont me reste le souvenir de rêveries plus ou moins languides à la vue des corps et des visages de L’Éveil du Printemps de Sandro Botticelli, et ensuite sous l’influence d’un prof de dessin à dégaine d’artiste et au parler distingué du nom de Gauthey – je tiens à saluer ici sa mémoire de très bonne personne, qui ne dessinait guère mais aimait à parler de ce qu’il aimait en nous laissant faire ce qui nous chantait.Ma dilection particulière pour les neiges noires et les murs chaulés aux écailles roses ou bleuâtres ou aux verts acides de lierre urbain, dans la lumières jaune laiteux des réverbères trouant la nuit d’hiver, tels que les restituent les évocations montmartroise du peintre Maurice Utrillo, ne laissa d’être remarquée par ce Monsieur Gauthey qui me conduisit bientôt dans la Provence de Cézanne et sur les îles saintement païennes de Paul Gauguin, puis dans les jardins de Monet, les jardins de Manet et les jardins de Bonnard.
J’aimais les leçons de Monsieur Gauthey qui avait une voix douce et une lavallière, je le sentais sensible à ma sensibilité et j’étais tout content de me retrouver une fois par semaine dans son atelier scolaire - et quand on est content dans notre pays on s’exclame : c’est bonnard !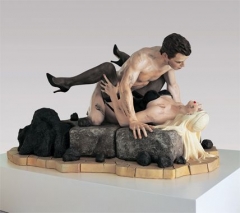
Or le Français Pierre Bonnard, comme les Russes Chaïm Soutine et Nicolas de Staël, les Nordiques Edvard Munch et Emil Nolde, les Anglais Francis Bacon et Lucian Freud, le Polonais Joseph Czapski et le Genevois Thierry Vernet, entre peu d’autres, dessinent aujourd’hui encore, dans mon ciel pictural, la constellation des poètes de la peinture qui me sont proches, chacun à sa façon, avec de variables intensités mais sous le signe de la même fusion passionnelle absolument absente de la plupart des productions plastiques contemporaines, qui sont autre chose ou rien du tout – je dirai prestement en ce qui concerne le pauvre Jeff Koons : rien du tout.
Sur quoi j’entre dans le vif de ma première colère, évidemment motivée par ce que je viens de noter, et remontant à ma visite, un soir de l’année 1992, de la première exposition des produits de la firme Koons dans l’espace très smart d’un ancien entrepôt industriel réhabilité, en pleine ville de Lausanne, où je me pointai par curiosité après avoir pris connaissance d’un article sur l’événement en question assorti d’un entretien dans lequel Jeff Koons affirmait ne jamais toucher de ses propres mains aux produits qu’il exposait, l’artiste selon sa conception ne devant faire que faire faire en sorte d’échapper à un processus d’ordre, selon lui, masturbatoire.
Je ne savais rien alors de beaucoup plus précis sur ce plasticien déjà connu des spécialistes - dont je n’étais aucunement au sens convenu - , et des gens à la page qui se pressaient ce soir–là, débarqués de longues voitures venues des banlieues résidentielles de nos villes lémaniques voire même alémaniques, en ce lieu qui était déjà depuis quelque temps, m’avait-on dit, the place to be.
Autre précision nécessaire à la clarté de l’exposé qui suit : je me trouvais alors, âgé de plus de quarante ans, responsable des pages littéraires du journal 24 Heures, et donc point vraiment appelé, à ce titre à me prononcer sur l’exposition en question, à cela près qu’il m’arrivait de commettre des éditoriaux relevant de la gamberge plus générale où j’avais libre cours de traiter de sujets de mon choix.
Ainsi me revois-je ce soir-là, tout expectatif mais sans m’attendre à vrai dire à rien de trop particulier, longeant les trottoirs enneigés où diverses créatures roumaines ou brésiliennes battaient le pavé en grelottant, puis gagnant l’étage mieux chauffé du vaste penthouse déjà surpeuplée de bruissantes dames à visons et de sémillants messieurs déambulant snobement, verre en main, le regard plus ou moins blasé sur les reproductions sérigraphiées de telle intromission de verge mâle en tell vulve femelle, puis de fellations en sodomies traitées en tons douceâtres proprement sulpiciens, puis encore d’angelots de bois conduisant une truoe ou de caniches sculptés en bois polychrome, constituant aussi bien la matière de la période dite Made in Heaven.
D’un coup m’était apparu l’Apparition, si j’ose dire: d’un seul regard tournant, contournant et retourné, j’avais avisé l’event représenté par tout ce beau monde se pâmant devant ces objets censés le provoquer et le déranger, et ces miaulements , ces jappements, ces minaudements et toussotements entre canapés et flûtes de Champagne, ces ronds-de-jambes autour des bibelots de l’inénarrable camelot.
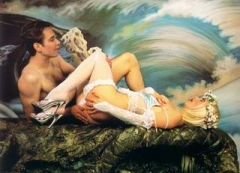
Cependant, agoraphobe et plus encore vomissant physiquement cette clinquance mondaine, je me trissai et me carapatai en douce en me promettant de revenir le lendemain, carnet en main, en sorte de détailler plus sûrement le matériau exposé dont je pressentais déjà ce qu’il signifiait par delà son insignifiance porno; et ledit lendemain je demandai donc, à la digne galeriste et vestale du lieu, une dame Lehmann épouse de trader new yorkais, la liste des prix qu’elle me remit non sans quelque réserve hésitante – « Ah mais seriez-vous donc collectionneur ? » s’inquiétait-elle – « Eh, qui sait ? » lui laissai-je entendre… – sur quoi je vis ce que j’avais aussi à voir, qui nourrirait la chronique que je me promettais d’ores et déjà de tirer de ce micmac.
Dame Lehmann, à lire la prose arriérée du provincial homoncule que je représentai probablement à ses yeux, envisagea de lancer ses avocats à mes trousses et de me conduire au procès, et peut-être y avait-il de quoi, mais l’avocat de notre journal s’entremit pour lui déconseiller cette publicité après l’afflux de lettres de lectrices et de lecteurs survenus en soutien au folliculaire.
Il est vrai que j’y étais allé assez fort, révélant soudain au quidam le détail des choses, et plus précisément le prix détaillé des choses.
J’annonçai ainsi à la lectrice et au lecteur peut-être serrés en fin de mois que tel jet de foutre du sieur Koons, sur le derrière de sa catin mauve, était proposé, en sérigraphie de moyen format au glamour gluant, pour la somme de 60.000 dollars. J’usai de termes sévères à l’endroit de l’exposition dans son ensemble, parlant de «chiennerie pseudo-artistique» et, poursuivant l’inventaire de la fameuse liste réservée au collectionneur, j’informai l’amateur éventuel qu’une fellation de Jeff par Ilona lui coûterait, cette fois en grand format, la somme de 80.000 dollars, que le caniche de bois polychrome ou la truie conduite par des anges, là-bas au fond du penthouse, lui reviendraient à 50.000 dollars pièce, tandis qu’un grand bouquet de fleurs sculptées, préfiguration de célèbres tulipes à venir, se trouvaient offertes pour quelque 149.000 dollars, TVA non comprise.Pour aggraver mon cas, je parlai de «porcherie modèle» à propos de la galerie de Dame Lehmann où avait afflué tout une société de gens sûrement influents des sphères économiques et politiques de nos régions, mais je ne me doutais pas alors que mes anodines imprécations - juste condamnées par le vidéaste radical non moins que régional Jean Otth, qui ne pouvait laisser passer ma chronique intitulée Pourrisseurs de l’Art et s’était donc fait un devoir éthique de me comparer à l’inévitable parangon de censure du nom de Joseph Goebbels -, préludaient à l’extension mondiale de l’empire kitsch de Jeff Koons, jusqu’à des hauteurs proprement béantes.
La révérence tactique du plasticien Jean Otth à l’entreprise de Jeff Koons, qu’il vomissait sûrement, en réalité, tout en me comparant à l’esthète nazi au nom de l’art contemporain pour se faire bien voir de la critique établie et du milieu culturel, mérite d’être relevée au titre, précisément, du consentement général, à tous les étages de la culture et de l’économie, des agences de publicité et de la démagogie politicienne, saluant la réussite manifeste du battant à babines.
Or rompons, un instant, avec ces mornes obscénités, pour nous rappeler une tragédie marquant peut-être, symboliquement tout au moins, la mort d’un certain Art millénairement moderne en voie de dangereuse surexposition.

Je reviens donc en septembre 2018. Lady L. et moi ressentons la peinture d’une manière proche. L. est dénuée du moindre snobisme et chacun fait, à l’instant, son chemin dans les salles de l’Hôtel de Caumont d’Aix-en Provence où sont exposées les toiles de Nicolas de Staël en ses dernières années de 1953 et 1954.
Pas un instant, cela va de soi, je ne pense en ces lieux au monde que résume l’ignoble sourire de Jeff Koons: nous sommes saisis de sereine attention, les visiteurs de l’expo sont comme pénétrés eux aussi de la silencieuse musique de cette peinture, sans qu’on puisse parler de vénération convenue : tout est noble, harmonieux, concentré, transfiguré par la couleur et la perception quasi physique de l’Être, oui : cette peinture nous fait être plus, cette peinture n’est pas abstraite au sens ordinaire même si elle ne figure pas toujours au sens ordinaire, nous savons qu’elle a ressuscité des visions solaires de Provence ou d’Agrigente dans la solitude d’un trou d’ombre ; comme les grands poètes vont au fond des mots Staël est allé à l’essence de ces choses que sont les arbres et les pierres le long des chemins, le ciel et les lointains, l’espace vu de dedans ou de partout - comment dire ?
Je le dis brutalement : à l’ère des fripouilles abjectes du marché de l’art mondialisé, dont le parangon est évidemment un Jeff Koons, l’intime joie de Nicolas de Staël illumine chacun en son humble tréfonds.
Nicolas de Staël se donna la mort en se jetant du haut de son immeuble, à Antibes, dans la nuit du 16 au 17 mars 1955. Le jeudi 17 mars à 4h du matin son ami Pierre Lecuire écrivait à Françoise de Staël : «Oh, Françoise, j’en avais toujours peur. Et pourtant, le voyant plus dur, je pensais que cela serait évité. Nous ne sommes jamais assez bons. Je ne peux plus penser à rien qu’à sa solitude. J’avais horreur qu’il me dise qu’il aimait la mort, tant j’avais peur que ce ne soit vrai».
Et quelques jours plus tard, à une autre amie : «Il tenait de l’archange et de l’enfant, de l’un la profondeur, le chant, l’ouverture aux choses grandes et terrifiantes, de l’autre, la cruauté, les perspectives versatiles, la ruse et finalement l’innocence, la magnétique innocence »…On sait qu’une dramatique relation sentimentale est en partie à l’origine de cet acte désespéré de Nicolas de Staël, qui ne suffit pas pour autant à l’expliquer, pas plus que la panique de l’Artiste devant la montée en flèche de sa cote à la Bourse des marchands du Temple - et comment ne pas se taire à l’évocation de tel mystère personnel ?
Et ensuite, par égard à sa mémoire, comment ne pas faire taire les caquets devant l’idole végétale du pauvre Puppy, dont les avatars suivants constitueront autant d’injures à la face de l’Art, célébrées par cette même meute imbécile que redoutait Nicolas de Staël ?(Ce texte est extrait du quatrième des sept chapitres du libelle intitulé Nous sommes tous des zombies sympas, ledit chapitre ayant pour titre Nous sommes tous des caniches de Jeff Koons).
-
Rebatet le fasciste
Ma visite à l'écrivain maudit
Dix ans après la mort de Céline, Lucien Rebatet passait, au début des années 1970, pour l’écrivain le moins fréquentable de la France littéraire. Condamné à mort pour faits de collaboration, il avait échappé de justesse au poteau après des mois, les chaînes aux pieds, à attendre le peloton. Des propagandistes du fascisme, il avait été le plus frénétique par ses écrits, notamment dans les colonnes de Je suis partout, plus encore dans le pamphlet furieusement antisémite intitulé Les décombres, paru en 1942 et qui lui valut un énorme succès. Connu de ses amis pour sa couardise physique, Rebatet s’était comporté, face à ses juges, avec une indignité complète. Autant dire qu’un tel personnage n’avait rien d’attirant. Mais Lucien Rebatet avait écrit, en prison, un roman magnifique : Les deux étendards. Je l’avais lu à vingt-cinq ans, quelque temps après m’être éloigné du gauchisme bon teint. Un voyage en Pologne, la découverte du Rideau de fer et du socialisme réel, la lecture de Stanislaw Ignacy Witkiewicz et maintes conversations sur les méfaits du communisme, dans le cercle des amis des éditions L’Age d’Homme, à Lausanne, me portaient naturellement à prendre le contrepied du conformisme intellectuel de l’époque, à l’enseigne duquel un Rebatet faisait figure d’ « ordure absolue ». Avec les encouragements de Dominique de Roux et de Vladimir Dimitrijevic, je me pointai donc un jour, moi qui n’était ni fasciste ni antisémite non plus, chez ce petit homme perclus d’arthrose, vif et chaleureux, qui ne tarda à me lancer qu’à mon âge il eût probablement été, lui, un maoïste à tout crin... Les lignes qui suivent reprennent l’essentiel de l’entretien que je publiai au lendemain de ma visite, qui me valut pas mal d’insultes, de lettres de lecteurs indignés et même une agression physique dans un café lausannois. Bien fait pour celui qui se targuait d’indépendance d’esprit…
Entretien avec Lucien Rebatet. Paris, 14 mars 1972.
Vingt ans après la parution de son plus beau livre, Les deux étendards, Lucien Rebatet se trouve toujours au ban de la plupart des nomenclatures du roman français contemporain, son nom ne se trouvant prononcé, par les professeurs de littérature et les critiques, qu’avec le mépris réservé en général aux assassins et aux filous. La raison de cette conspiration du silence : ses opinions politiques. Rebatet fut en effet partisan, jusqu’à la dernière heure, du national-socialisme, « et de l’espèce la plus frénétique », ajoute-t-il lui-même.
Je l’imaginais de haute taille et tonitruant, et je l’ai trouvé plutôt frêle, petit, en robe de chambre et les mains déformées par le rhumatisme, l’œil rieur, d’une gentillesse vous mettant tout de suite à l’aise alors qu’il vous accueille comme s’il vous connaissait depuis longtemps. J’imaginais un intérieur de grand bourgeois cossu (il réside dans l’un des quartiers huppés de Paris) et je suis entré dans un appartement modeste, seuls le bureau et la bibliothèque du maître des lieux en imposant quelque peu. Très vite, le contact allait s’établir : à soixante-neuf ans, Lucien Rebatet m’a sidéré par sa jeunesse d’esprit.
Or il a commencé par évoquer sa condition de proscrit : « Comme on ne m’a pas fusillé, vous comprenez qu’il fallait au moins me clouer le bec. Brasillach liquidé, on pouvait reconnaître son talent. Mais le nazi Rebatet, un écrivain valable ? Pensez donc ! Notez que ma consolation vient des jeunes, qui me semblent beaucoup plus intelligents que leurs aînés. Ils sont ainsi très nombreux à m’écrire, pour me dire qu’ils discutent ferme autour des Deux étendards.
Sans fausse modestie, Lucien Rebatet parle de son chef-d’œuvre avec passion. Il sait bien que les succès annuels de la moulinette littéraire disparaîtront peu à peu des mémoires, et que Les deux étendards demeureront. Pourtant, avant d’aborder plus longuement ce livre qui a motivé ma visite, j’aimerais qu’il s’exprime à propos de ses positions politiques dont je saisi mal les tenants.
« Ah ! vous savez, notre génération a été sacrifiée par la politique. Vous n’avez pas idée, vous qui êtes né après la guerre, de la férocité de la lutte que nous avons dû mener. C’est que la France, en ce temps-là, était dans une pagaille invraisemblable. Vous avez lu Les décombres, hein ? C’était ça, la France : tout y était corrompu, et nous sentions qu’il fallait dire non. Non à la corruption, non au désordre, non au communisme ! Mais allez : à part la lutte contre les « cocos », tout cela est du passé. Un jour, j’ai d’ailleurs écrit dans Rivarol que les gens de mon bord seraient prêts à confesser leurs erreurs, le jours où ceux du bord opposé en feraient autant… »
Suivent quelques propos sur la situation politique actuelle, les « maos » en France, Sartre et la mort tragique d’Overney (« C’est ces intellectuels boutefeu qu’on devrait arrêter, et pas les petits gars qui militent ! », lance-t-il à ce propos), ou le rappel des jours qu’il passa à Sigmaringen en compagnie de Céline : « Il était inénarrable, surtout quand il insultait les Boches. D’une verve prodigieuse ! Il parlait véritablement sa littérature ! »
Dans ses moments d’emportement, Rebatet semble cependant m’adresser un clin d’œil, comme sous l’effet de la distance prise : « Voyez-vous, je ne suis pas un politique. J’ai toujours été mal à l’aise dans ce monde-là. Et je ne suis pas un homme de lettres non plus, Disons que je suis une sorte de propagandiste de certaines idées. » Et comme je m’en étonne, il précise : « Oui, la littérature a toujours été, pour moi, un manifeste, comme dans Les décombres, ou un luxe et une joie, comme dans Les deux étendards. »
Ensuite, comme je lui demande s’il n’y a pas aussi un moraliste chez lui : « Pas moraliste pour un sou s'il s’agit de défendre la Morale ou les Valeurs bourgeoises. Vous le savez bien : le capitalisme est une sorte de vol organisé. Mais si vous le prenez dans le sens où l’entendait un Brice Parrain, alors d’accord : moraliste, si l’on considère que la philosophie doit servir à améliorer l’homme… »
Mais venons-en aux Deux étendards, dont il faut situer d’abord le cadre du grand débat qui s’y développe. Entre Paris et Lyon, trois jeunes personnages à l’âme ardente : Michel Croz, garçon de vingt ans qui débarque à Paris dans les années 1920 pour y achever ses études. Ancien élève des pères, qu’il abhorre, il découvre l’art et la volupté, ainsi que sa vocation d’écrivain. Parallèlement, son ami Régis Lanthelme, resté à Lyon, lui apprend qu’il va entrer chez les jésuites alors même qu’il vient de tomber amoureux fou d’une jeune fille du nom d’Anne-Marie. Michel tombe à son tour amoureux de la belle et, pour s’en approcher, tente de se convertir à la religion qui unit ses deux amis. Peine perdue. Or, fondu dans une histoire d’amour impossible (Anne-Marie ne pouvant suivre ni Régis ni Michel dans leurs croisades opposées pour le Ciel et la Terre), les débat des Deux étendards fait s’empoigner un défenseur de la « religion des esclaves » (le christianisme selon Rebatet) et son contempteur, le nietzschéen Michel.
« Michel Croz, m’explique l’écrivain, est un contestataire avant la lettre. Ce qui le concerne est en partie autobiographique. Il me ressemble. Mais à vingt ans, il est beaucoup plus intelligent que je l’étais, moi. En face de lui, Régis appartient au passé. On pourrait même dire que c’est un personnage historique, comme si le roman se déroulait au XVIe siècle. De nos jours, sa foi d’acier en ferait un intégriste rejeté par l’Eglise romaine, une sorte d’abbé de Nantes. Quant à Anne-marie, c’est vraiment ma fille. Elle a des traits de femmes que j’ai connues, sans doute, mais le personnage, dans sa vie propre et sa manière de s’exprimer, est entièrement inventé ».
A la question, que je lui pose alors, de savoir où il se situe aujourd’hui par rapport à son roman, Lucien Rebatet me répond qu’il lui reste tout proche : « Comme je vous l’ai dit, la jeunesse m’y fait revenir sans cesse. Et puis, les jours où l’on se trouve dans un livre qui marche bien sont les plus beaux de la vie avec l’amour quand on est jeune… »
J’aimerais en savoir plus, cependant, sur les circonstances dans lesquelles son roman a été composé.
« Le 8 mai 1945, j’ai été arrêté par la Sécurité militaire à Feldkirch, en Autriche. J’étais parvenu au chapitre XXVII du livre. Grâce à ma femme, demeurée en liberté, qui se démena pour faire rapatrier mon manuscrit, j’ai pu reprendre mon travail en cellule. A Fresnes, j’étais enfermé en compagnie d’un bandit corse que je bourrais de romans policiers pour le faire taire. La condamnation à mort tomba le 23 novembre 1946. Dès lors, je passai 141 jours les chaînes aux pieds, pendant lesquels j’achevai ce qui allait devenir Les deux étendards. Enfin, sur l’intervention de Claudel, qui estimait qu’on ne pouvait exécuter l’homme qui avait déculotté Maurras, je fus gracié par Vincent Auriol le 12 avril 1947. ma peine étant commuée en travaux forcés, j’allais être transféré à Clairvaux, séparé de mon manuscrit pendant deux ans… »
Evoquant sa captivité, Lucien Rebatet s’en rappelle les affres autant que les aspects positifs : « Sur le plan de l’existence quotidienne, ce fut un enfer stupide, même pour les politiques. Mais pour écrire, c’était extraordinaire. Tous les soirs, on m’enfermait dans une « cage à poules » de 2mx2m où régnait une paix royale. De six heures à minuit, j’écrivais sans discontinuer. En novembre 1949, enfin, la dactylographie de mon roman, représentant 2000 pages environ, me parvint par une voie clandestine. J’y travaillai encore dix mois puis il me quitta, entièrement tapé, par l’entremise d’un charcutier qui fournissait notre cantine. Ma libération eut lieu l’année de la parution du livre, en juillet 1952, après sept ans de prison. »
La conversation, largement arrosée de whisky, s’est prolongée des heures, jusqu’au déclin du jour. Après que Madame Rebatet eut annoncé la nécessité de se préparer pour une séance de cinéma (sous le nom de François Vinneuil, Rebatet tient aujourd’hui encore une chronique cinématographique, avec une pertinence qui n’a d’égale que sa connaissance encyclopédique de la musique), les interlocuteurs se sont levés dans la pénombre et se sont dirigés vers la porte sans que l’écrivain ne cesse de s’adresser à son visiteur: « L’art nous permet de mieux exister, n’est-ce pas ? Voilà ce qu’il nous reste, mon vieux : un certain nombre de valeurs aristocratiques, que ceux qui en ont le désir et la volonté doivent développer. La lucidité, d’abord, et la lucidité partout et à tout instant. Ce qui me paraît très grave, dans l’art d’aujourd’hui, c’est que de nombreux créateurs ne semblent tendre qu’au néant et à la désintégration. Ce qu’il nous faut, au contraire, c’est construire, réinventer des formes correspondant à notre temps, en individus et non en troupe grégaire, avec le « pied léger » cher à Nietzsche… »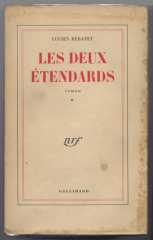 Lucien Rebatet. Les deux étendards. Gallimard, collection Soleil, 1312p.
Lucien Rebatet. Les deux étendards. Gallimard, collection Soleil, 1312p.
A lire aussi : Une histoire de la musique. Robert Laffont, 1969.Photo de Lucien Rebatet en mars 1972: Paule Rinsoz.
Lucien Rebatet est mort en septembre 1972. -
De la folie ordinaire
 (Le Temps accordé, Lectures du monde 2023)À la Maison bleue, ce mardi 24 janvier.- À en croire le visionnaire génial qu’était Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885-1939), ce qui caractériserait le XXe siècle et ses suites actuelles consisterait en une acclimatation graduelle et généralisée - comme on parle d’un cancer généralisé par métastases - de la folie, qui deviendrait la norme collective malgré les sursauts sporadiques de résistance personnelle ou autres mouvements de rejet.Witkacy (son surnom familier) s’est suicidé en 1939 alors que la Pologne allait subir les conséquences du déchaînement des deux folies collectives pas du tout ordinaires qu’étaient le nazisme et le communisme, non sans nous laisser un prodigieux héritage d’écrits (romans, pièces de théâtre, essais philosophiques,etc) redécouverts depuis les années 60 et dont les constats sont plus pertinents aujourd’hui que jamais, à commencer par son aperçu de la folie ordinaire et de ce qu’il appelle, lus particulièrement, le nivellisme, sur lequel se fondera un nouveau parti - et comment ne pas voir que les nivellistes sont aujourd’hui partout ?
(Le Temps accordé, Lectures du monde 2023)À la Maison bleue, ce mardi 24 janvier.- À en croire le visionnaire génial qu’était Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885-1939), ce qui caractériserait le XXe siècle et ses suites actuelles consisterait en une acclimatation graduelle et généralisée - comme on parle d’un cancer généralisé par métastases - de la folie, qui deviendrait la norme collective malgré les sursauts sporadiques de résistance personnelle ou autres mouvements de rejet.Witkacy (son surnom familier) s’est suicidé en 1939 alors que la Pologne allait subir les conséquences du déchaînement des deux folies collectives pas du tout ordinaires qu’étaient le nazisme et le communisme, non sans nous laisser un prodigieux héritage d’écrits (romans, pièces de théâtre, essais philosophiques,etc) redécouverts depuis les années 60 et dont les constats sont plus pertinents aujourd’hui que jamais, à commencer par son aperçu de la folie ordinaire et de ce qu’il appelle, lus particulièrement, le nivellisme, sur lequel se fondera un nouveau parti - et comment ne pas voir que les nivellistes sont aujourd’hui partout ?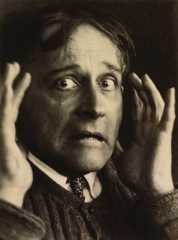 Avant Orwell, mais après Dostoievski et Nietzsche , Witkacy a vécu dans sa chair la bascule d'un monde à l’autre en vivant de près la violence physique et métaphysique, et plus encore verbale et même érotique de la Révolution bolchevique.Sa folie personnelle qui était à la fois d’un artiste et d’un penseur puissamment sexué, d’un acteur en scène à mille masques et d’un farceur, était naturellement incompatible avec les idéologies communiste ou fasciste relevant de la démence la plus ordinaire, au même titre que le taylorisme à l’américaine ou les techniques actuelles de maintien du Bien-Être, comme il l’avait aussi pressenti en prophète du wellness nihiliste - et c’est sa propre folie, choisie comme un destin, et follement inventive parce que mimétique, qui lui aura permis de percevoir la montée en insignifiance de la folie acclimatée, notamment par la publicité normative et la monétisation d’un bonheur obligatoire , et de figurer les grands thèmes du nouveau fantastique social.La folie acclimatée est notre bain quotidien, dans lequel un jeune écrivain de tous les sexes - ce qui signifie inclusivement tous les genres - n’a qu’à puiser pour y trouver les ressources d’une représentation à fonction décapante, selon l’expression des médias.
Avant Orwell, mais après Dostoievski et Nietzsche , Witkacy a vécu dans sa chair la bascule d'un monde à l’autre en vivant de près la violence physique et métaphysique, et plus encore verbale et même érotique de la Révolution bolchevique.Sa folie personnelle qui était à la fois d’un artiste et d’un penseur puissamment sexué, d’un acteur en scène à mille masques et d’un farceur, était naturellement incompatible avec les idéologies communiste ou fasciste relevant de la démence la plus ordinaire, au même titre que le taylorisme à l’américaine ou les techniques actuelles de maintien du Bien-Être, comme il l’avait aussi pressenti en prophète du wellness nihiliste - et c’est sa propre folie, choisie comme un destin, et follement inventive parce que mimétique, qui lui aura permis de percevoir la montée en insignifiance de la folie acclimatée, notamment par la publicité normative et la monétisation d’un bonheur obligatoire , et de figurer les grands thèmes du nouveau fantastique social.La folie acclimatée est notre bain quotidien, dans lequel un jeune écrivain de tous les sexes - ce qui signifie inclusivement tous les genres - n’a qu’à puiser pour y trouver les ressources d’une représentation à fonction décapante, selon l’expression des médias.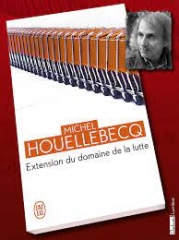 Un bon exemple de cette démarche se trouve dans les premières pages, fondatrices à mes yeux, d’Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, dont le titre même singe le langage de la nouvelle idéologie gestionnaire - et le public l’a bien vu, surtout hors de France où l’on reste assez conventionnel en matière de critique panique et rétif à la franche singerie, pédantisme littéraire hexagonal oblige...Le problème évidemment, pour un jeune auteur multisexe, est de ne pas tomber dans le travers de la moquerie condescendante dans sa ressaisie phénoménologique des donnés de la folie ordinaire - Il lui faut aller au charbon: ne pas se contenter de dire des choses mais s’efforcer de les raconter.
Un bon exemple de cette démarche se trouve dans les premières pages, fondatrices à mes yeux, d’Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, dont le titre même singe le langage de la nouvelle idéologie gestionnaire - et le public l’a bien vu, surtout hors de France où l’on reste assez conventionnel en matière de critique panique et rétif à la franche singerie, pédantisme littéraire hexagonal oblige...Le problème évidemment, pour un jeune auteur multisexe, est de ne pas tomber dans le travers de la moquerie condescendante dans sa ressaisie phénoménologique des donnés de la folie ordinaire - Il lui faut aller au charbon: ne pas se contenter de dire des choses mais s’efforcer de les raconter.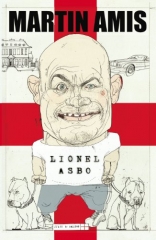 Houellebecq en est là encore un bon exemple, de même que Martin Amis dans Lionel Asbo ou, plus près de nous, l’insolent Quentin Mouron dans un roman encore inédit traitant d’un jeune couple d’influenceurs vivant leur double vie sans bien savoir laquelle est réelle et laquelle virtuelle- ce qui n’a plus la moindre importance à l’époque où nos webcams baisent entre elles sans nous demander de mettre la main à la croupe, n’est-ce pas ?
Houellebecq en est là encore un bon exemple, de même que Martin Amis dans Lionel Asbo ou, plus près de nous, l’insolent Quentin Mouron dans un roman encore inédit traitant d’un jeune couple d’influenceurs vivant leur double vie sans bien savoir laquelle est réelle et laquelle virtuelle- ce qui n’a plus la moindre importance à l’époque où nos webcams baisent entre elles sans nous demander de mettre la main à la croupe, n’est-ce pas ? -
Au profond Aujourd'hui
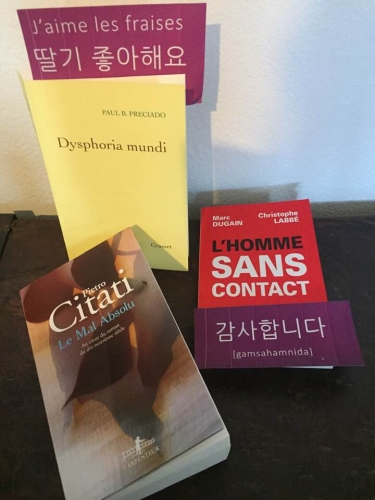 (Le Temps accordé, lectures du monde 2022)« Nous ne sommes pas désespérés: nous sommes dans la perplexité » (Emmanuel Berl)Pages de journal d’un cardiopathe, au tournant de l’année...Ce vendredi 30 décembre.- Je constate ce matin que j’ai oublié hier de prendre mes médicaments, ce dont mon corps et mon sommeil de la nuit dernière ont peut-être pâti ? Je n’en suis pas sûr, mais ce qui est certain est que les trois formules qui me sont venues ce matin découlent d’un mélange de fatigue et de lucidité qui marque une réaction naturelle à ma sempiternelle dispersion et à ma paresse surnaturelle...Je me suis dit : «Plus le temps», «Trop tard» et «Pas envie», pour m’inciter en somme à plus de rigueur dans la distribution de mes énergies.De fait, qu’il me reste trois mois à vivre, trois ou trente ans - que l’Éternel m’en préserve ! -, Le temps de bien faire ce qu’il me reste à accomplir se raccourcit avec les jours qui passent, dont il me semble parfois que je n’ai rien fait de bon, et j’ai beau me dire que j’en fait encore pas mal, jusqu'à apprendre le coréen (!) mais non: ce n’est pas assez !Quant à penser que c’est trop tard pour bien faire, la formule concerne le monde actuel tel que je le perçois, autant sinon plus que mon activité. Ou disons que celle-ci n’est plus vraiment en phase avec la société à laquelle je pourrais être relié, devenue atomisée voire inexistante même s’il existe encore des lecteurs et que des tas de livres paraissent.Enfin de vives envies demeurent , mais plus celle de me forcer à quoi que ce soit, et la simple envie de vivre se réduit en somme à l’envie de voir mes enfants, mes petits enfants et quelques amis, l’envie d’écrire et l’envie de lire, peut-être de publier encore quelques livres - trois sont prêts l'édition et sept autres suivent - et de voyager très loin (peut-être la Corée) ou en quelques villes aimées (Sienne, Cracovie ou Paris), et c’est à peu près tout il me semble...J’ai regardé hier soir un film genre sitcom évoquant la Playlist idéale d’un lycéen américain brillant à force de travail forcé sous l’impulsion de parents obsédés par son accession à la meilleure université - liste de tout ce qu’il n’a pu faire en ses jeunes années, tout occupé qu’il était à ses révisions, et qu’il ferait aujourd’hui après avoir tout envoyé promener.Or, en dépit de la fausse originalité de cette fantasmagorie «dissidente », cela m’a rappelé ce que pour ma part, j’ai évité de m’imposer dès mon rejet viscéral du monde universitaire, et tout ce que j’ai fait par plaisir, à commencer par tout le travail que j’aurai fait par seul plaisir ou presque...Mon manque total d’ambition sociale, mon goût du pouvoir à peu près inexistant, accordés à mon indépendance sans partage, et cependant partagée avec les mêmes dispositions personnelles de ma bonne amie, ont fait que je n’en ai fait qu’à ma tête jusqu’à notre rencontre, à 35 ans, ma seule concession (l’intégration régulière dans une rédaction) n’empêchant pas mon vrai travail de se poursuivre en élargissant par ailleurs mon expérience en société, parfois pour le pire mais plus souvent pour le meilleur.Ainsi ma propre playlist des envies inassouvies relève-t-elle de la fantaisie imaginative d’un enfant gâté regrettant de n’avoir pas été Rimbaud à quinze ans, Proust ou Mozart à la vingtaine, ni vécu à l’époque de Leonard de Vinci ou fait du vélo en Argovie avec Einstein, etc.Je lis ces jours le monstrueux Dysphoria mundi de Paul B. Preciado, représentant à peu près tout ce que je vomis des idéologies contemporaines fondées sur le ressentiment et la quête d’une espèce mutante illusoirement libérée, mais le monstre en question m’intéresse à proportion de son intelligence critique et de sa folie esthétique réellement singulière, il y a chez lui / elle un personnage qui aurait sans doute retenu l’attention de Witkiewicz ou même de Dostoïevski dans leur repérage respectif des démons significatifs de leur époque; enfin affronter le wokisme sans connaître la pensée précise des ses inspirateurs me semble insuffisant - et d’ailleurs tout n’est pas à jeter de l’observation sociale et politique pléthorique de ce cinglé...En alternance avec la lecture de Preciado, celle des essais de Pietro Citati me ramène à ma chambre haute et à ce qui m’a aidé à tenir debout depuis mes quinze-seize ans, à savoir la Littérature avec une grande aile et un seul tenant, une seule étoffe pour envelopper tous les avatars de l’humaine engeance, et ces jours, après la plongée proustienne de La colombe poignardée, c’est Le mal absolu qui brasse beaucoup plus large, de Robinson Crusoe a Potocki et Goethe, en prélude, avant un immense voyage dans les lettres de Jane Austen et les mystère d’Edgar Poe, les vertiges de Thomas de Quincey et les secrets de Pinocchio ou de Bovary, la surface profonde de Dickens et les profondeurs insondées de Freud, etc.Vous croyez avoir beaucoup lu et vous découvrez, ici, l’étendue enthousiasmante de votre ignorance ...
(Le Temps accordé, lectures du monde 2022)« Nous ne sommes pas désespérés: nous sommes dans la perplexité » (Emmanuel Berl)Pages de journal d’un cardiopathe, au tournant de l’année...Ce vendredi 30 décembre.- Je constate ce matin que j’ai oublié hier de prendre mes médicaments, ce dont mon corps et mon sommeil de la nuit dernière ont peut-être pâti ? Je n’en suis pas sûr, mais ce qui est certain est que les trois formules qui me sont venues ce matin découlent d’un mélange de fatigue et de lucidité qui marque une réaction naturelle à ma sempiternelle dispersion et à ma paresse surnaturelle...Je me suis dit : «Plus le temps», «Trop tard» et «Pas envie», pour m’inciter en somme à plus de rigueur dans la distribution de mes énergies.De fait, qu’il me reste trois mois à vivre, trois ou trente ans - que l’Éternel m’en préserve ! -, Le temps de bien faire ce qu’il me reste à accomplir se raccourcit avec les jours qui passent, dont il me semble parfois que je n’ai rien fait de bon, et j’ai beau me dire que j’en fait encore pas mal, jusqu'à apprendre le coréen (!) mais non: ce n’est pas assez !Quant à penser que c’est trop tard pour bien faire, la formule concerne le monde actuel tel que je le perçois, autant sinon plus que mon activité. Ou disons que celle-ci n’est plus vraiment en phase avec la société à laquelle je pourrais être relié, devenue atomisée voire inexistante même s’il existe encore des lecteurs et que des tas de livres paraissent.Enfin de vives envies demeurent , mais plus celle de me forcer à quoi que ce soit, et la simple envie de vivre se réduit en somme à l’envie de voir mes enfants, mes petits enfants et quelques amis, l’envie d’écrire et l’envie de lire, peut-être de publier encore quelques livres - trois sont prêts l'édition et sept autres suivent - et de voyager très loin (peut-être la Corée) ou en quelques villes aimées (Sienne, Cracovie ou Paris), et c’est à peu près tout il me semble...J’ai regardé hier soir un film genre sitcom évoquant la Playlist idéale d’un lycéen américain brillant à force de travail forcé sous l’impulsion de parents obsédés par son accession à la meilleure université - liste de tout ce qu’il n’a pu faire en ses jeunes années, tout occupé qu’il était à ses révisions, et qu’il ferait aujourd’hui après avoir tout envoyé promener.Or, en dépit de la fausse originalité de cette fantasmagorie «dissidente », cela m’a rappelé ce que pour ma part, j’ai évité de m’imposer dès mon rejet viscéral du monde universitaire, et tout ce que j’ai fait par plaisir, à commencer par tout le travail que j’aurai fait par seul plaisir ou presque...Mon manque total d’ambition sociale, mon goût du pouvoir à peu près inexistant, accordés à mon indépendance sans partage, et cependant partagée avec les mêmes dispositions personnelles de ma bonne amie, ont fait que je n’en ai fait qu’à ma tête jusqu’à notre rencontre, à 35 ans, ma seule concession (l’intégration régulière dans une rédaction) n’empêchant pas mon vrai travail de se poursuivre en élargissant par ailleurs mon expérience en société, parfois pour le pire mais plus souvent pour le meilleur.Ainsi ma propre playlist des envies inassouvies relève-t-elle de la fantaisie imaginative d’un enfant gâté regrettant de n’avoir pas été Rimbaud à quinze ans, Proust ou Mozart à la vingtaine, ni vécu à l’époque de Leonard de Vinci ou fait du vélo en Argovie avec Einstein, etc.Je lis ces jours le monstrueux Dysphoria mundi de Paul B. Preciado, représentant à peu près tout ce que je vomis des idéologies contemporaines fondées sur le ressentiment et la quête d’une espèce mutante illusoirement libérée, mais le monstre en question m’intéresse à proportion de son intelligence critique et de sa folie esthétique réellement singulière, il y a chez lui / elle un personnage qui aurait sans doute retenu l’attention de Witkiewicz ou même de Dostoïevski dans leur repérage respectif des démons significatifs de leur époque; enfin affronter le wokisme sans connaître la pensée précise des ses inspirateurs me semble insuffisant - et d’ailleurs tout n’est pas à jeter de l’observation sociale et politique pléthorique de ce cinglé...En alternance avec la lecture de Preciado, celle des essais de Pietro Citati me ramène à ma chambre haute et à ce qui m’a aidé à tenir debout depuis mes quinze-seize ans, à savoir la Littérature avec une grande aile et un seul tenant, une seule étoffe pour envelopper tous les avatars de l’humaine engeance, et ces jours, après la plongée proustienne de La colombe poignardée, c’est Le mal absolu qui brasse beaucoup plus large, de Robinson Crusoe a Potocki et Goethe, en prélude, avant un immense voyage dans les lettres de Jane Austen et les mystère d’Edgar Poe, les vertiges de Thomas de Quincey et les secrets de Pinocchio ou de Bovary, la surface profonde de Dickens et les profondeurs insondées de Freud, etc.Vous croyez avoir beaucoup lu et vous découvrez, ici, l’étendue enthousiasmante de votre ignorance ... -
Le souffle de la vie
Du blog au livre imprimé...
Au lecteur
Ce recueil, établi à la demande de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse aux éditions L'Age d'Homme, rassemble une partie de mes Carnets de JLK, blog littéraire ouvert sur la plateforme HautEtFort en juin 2005. Proposant aujourd’hui quelque 1800 textes, dans les domaines variés de la littérature et des arts, de l’observation quotidienne et de la réflexion personnelle, entre autres balades et rencontres, ces Riches heures de lecture et d’écriture s’inscrivent dans le droit fil des carnets manuscrits que je tiens depuis une quarantaine d’années, qui ont déjà fait l’objet de deux publications : Les Passions partagées (1973-1992) et L’Ambassade du papillon (1993-1999).
En outre, ces Carnets de JLK illustrent plus particulièrement les virtualités nouvelles, et notamment par le truchement de l’échange quotidien avec plusieurs centaines de lecteurs, de cette forme de publication spontanée sur l’Internet, qu’on appelle weblog ou blog.
Dans l’univers chaotique qui est le nôtre, où le clabaudage et la fausse parole surabondent, ces carnets se veulent, au-delà de tous les sursauts de méfiance ou de mépris, la preuve qu’une résistance personnelle est possible à tout instant et en tout lieu pour quiconque reste à la fois attentif à la rumeur du monde et à l’écoute de sa voix intérieure. À l’inattention générale, ils aimeraient opposer un effort de concentration et de réflexion au jour le jour, ouvrant une fenêtre sur le monde.
SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre petit texte de rien du tout dans une grande partition. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, mais je n’en suis même pas sûr. Il n’est pas d’un croyant, au sens des églises et des sectes, mais cela aussi se discute. Il oscille entre la philosophie non académique de penseurs qui n’ont cessé de m’éclairer (de Gustave Thibon à René Girard), le Grand Récit de la science tel que l’évoque un Michel Serres, l’art et la poésie, l’Eros et la tragédie, Apollon et Dionysos, Rabelais et Pascal, le Christ et le Tao, mais je le voudrais à l’instant sans référence aucune.
J’écris tous les jours « sous le regard de Dieu », et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK. Cela peut sembler extravagant, mais c’est vrai. J’écris tous les jours sous le regard d’environ 500 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 500.000 sans que cela ne change rien : je n’écris que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux.
Ecrire «sous le regard de Dieu» ne se réduit pas à une soumission craintive mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».
A LA DESIRADE. – Nous entrons dans la nouvelle année par temps radieux et la reconnaissance au cœur alors que tant de nos semblables, de par les monde, se trouvent en proie au malheur, à commencer par les victimes des terribles tsunamis qui viennent de dévaster les côtes de l’Asie du sud-est.
A La Désirade, la vision de ma bonne amie qui fait les vitres me semble la plus belle image de la vie qui continue…
(1er janvier 2005)
ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.
Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, tout le pantelant de gestes impatients et des semences jetées à la diable, chose facile.
Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…
Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos Ailleurs...
La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté ; et ce travail alors repose.
L’ENFANT. – Edmond Jaloux remarque qu’à quarante ans, peu avant sa mort, Proust était encore un enfant. C’est aussi mon cas à cinquante-sept ans, malgré la paternité dûment assumée et vingt ans de vie conjugale régulière. Pour l’essentiel je suis resté tel que j’étais à dix ans, juste avant la puberté. Ensuite je le suis resté malgré le trouble entêtant du sexe, très sporadique au demeurant jusqu’à l’âge de dix-huit ans, ensuite plus envahissant et parfois obsédant à outrance, par périodes en tout cas.
Or il faudra que je décrive, un jour, cette folie circulaire de l’obsession qui se nourrit elle-même comme la Bête inassouvie de Dante, telle que je l’ai vécue à un moment donné.
(2 janvier)
PASSEUR. - Il en va de la critique littéraire comme du gardiennage de ménagerie, avec les obscures servitudes et les satisfactions jubilatoires qui en découlent assez semblablement. L’on pourrait dire qu’il y a du Noé chez le passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses.
Cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu. Sans doute ne s’étonne-t-on pas, au jardin zoologique, de ce que tel formidable Sénégalais commis au ravitaillement du tigre royal entretienne, à la fois, un sentiment délicat à l’égard de la gazelle de Somalie ou de la tourterelle rieuse. Mais voit-on assez quel amour cela dénote ? De même paraît-il naturel qu’un passeur de livres défende à la fois la ligne claire de Stendhal ou de Léautaud et les embrouilles vertigineuses de Proust ou l’épique dégoise de Céline, ou encore qu’il célèbre les extrêmes opposés de la nuit dostoïevskienne et des journées fruitées de Colette. Or cela va-t-il de soi ?
L’on daube, et non sans raison, sur le flic ou le pion, le médiocre procustéen, l’impuissant enviard à quoi se réduit parfois le critique. Mais comment ne pas rendre justice, aussi, à tous ceux-là qui s’efforcent, par amour de la chose, d’honorer le métier de lire ?
Car il n’est pas facile de distribuer ses curiosités entre toutes les espèces sans tomber dans l’omnitolérance ou le piapia au goût du jour, puis de maintenir une équanimité dans l’appréciation qui pondère à la fois l’égocentrisme de l’Auteur, le chauvinisme non moins exclusif de l’Editeur et les tiraillements de sa propre sensibilité et de son goût personnels. Cet équilibrage des tensions relève du funambulisme, mais c’est bel et bien sur ce fil qu’il s’agit d’avancer pour atteindre le Lecteur.
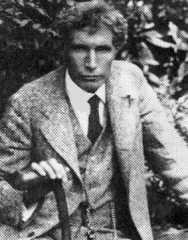 LITTÉRATURE. - C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun au goût du jour. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’une petite secousse ou d’un délassement d’amateur mais relèvent de la plus haute, extatique jouissance, à la fois charnelle et spirituelle. En outre le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.
LITTÉRATURE. - C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun au goût du jour. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’une petite secousse ou d’un délassement d’amateur mais relèvent de la plus haute, extatique jouissance, à la fois charnelle et spirituelle. En outre le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.«Toute bonne littérature est une critique de la vie», affirme John Cowper Powys en citant Matthew Arnold, et cette position, à la fois radicale et généreuse, donne son élan à chacun de ses jugements, et sa nécessité vitale. Pour John Cowper Powys, la littérature se distingue illico des Belles Lettres au sens académique de l’expression. La littérature concentre, dans quelques livres qu’il nous faut lire et relire, la somme des rêves et des pensées que l’énigme du monde a inspiré à nos frères humains, et toutes les «illusions vitales», aussi, qui les ont aidés à souffrir un peu moins ou à endurer un peu mieux l’horrible réalité –quand celle-ci n’a pas le tour radieux de ce matin.
Rien de lettreux dans cette approche qui nous fait revivre, avec quelle gaîté communicative, les premiers émerveillements de nos lectures adolescentes, tout en ressaisissant la substantifique moelle de celles-ci au gré de fulgurantes synthèses. Rien non plus d’exhaustif dans ces aperçus, mais autant de propositions originales et stimulantes, autant de germes qu’il nous incombe de vivifier, conformément à l’idée que «toute création artistique a besoin d’être complétée par les générations futures avant de pouvoir atteindre sa véritable maturité».
Cette idée pascalienne d’une «société des êtres» qui travaillerait au même accomplissement secret du «seul véritable progrès» digne d’être considéré dans l’histoire des hommes, «c’est-à-dire l’accroissement de la bonté et de la miséricorde dans les cœurs» à quoi contribuent pêle-mêle les Ecritures et Rabelais, saint Paul et Dickens ou Walt Whitman, entre cent autres, ne ramène jamais à la valorisation d’une littérature édifiante au sens conventionnel de la morale. D’entrée de jeu, c’est bien plutôt le caractère subversif de la littérature que l’auteur met en exergue. «Une boutique de livres d’occasion est le sanctuaire où trouvent refuge les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l’humanité», relève-t-il avant de préciser que ladite boutique «fournit des armes au prophète dans sa lutte contre le prêtre, au prisonnier dans sa lutte contre la société, au pauvre dans sa lutte contre le riche, à l’individu dans sa lutte contre l’univers». Et de même trouve-t-il, dans l’Ancien Testament, «le grand arsenal révolutionnaire où l’individu peut se ravitailler en armes dans son combat contre toutes les autorités constituées», où le Christ a puisé avant de devenir celui que William Blake appelait le suprême Anarchiste «qui envoya ses septante disciples prêcher contre la Religion et le Gouvernement».
Rebouteux des âmes, John Cowper Powys nous communique des secrets bien plus qu’il ne nous assène des messages. Les ombres, voire l’obscénité de la littérature ne sollicitent pas moins son intérêt que ses lumières et ses grâces, et s’il répète après Goethe que «seul le sérieux confère à la vie un cachet d’éternité», nul ne pénètre mieux que lui les profondeurs de l’humour de Shakespeare ou de Rabelais.
A croire Powys, le pouvoir suprême de la Bible ne tient pas à sa doctrine spirituelle ou morale, mais «réside dans ses suprêmes contradictions émotionnelles, chacune poussée à l’extrême, et chacune représentant de manière définitive et pour tous les temps quelque aspect immuable de la vie humaine sur terre». La Bible est à ses yeux par excellence «le livre pour tous», dont la poésie éclipse toutes les gloses et dont trois motifs dominants assurent la pérennité: «la grandeur et la misère de l’homme, la terrifiante beauté de la nature, et le mystère tantôt effrayant et tantôt consolant de la Cause Première». Mais là encore, rien de trop étroitement littéraire dans les propos de ce présumé païen, dont le chapitre consacré à saint Paul nous paraît plus fondamentalement inspiré par «l’esprit du Christ» que mille exégèses autorisées.
Cet esprit du Christ qui est «le meilleur espoir de salut de notre f… civilisation», et qui se réduit en somme à l’effort séculaire d’humanisation des individus, constitue bonnement le fil rouge liant entre eux les vingt chapitres des Plaisirs de la littérature, courant d’un Rabelais dégagé des clichés graveleux aux visions christiques de Dickens et Dostoïevski, d’Homère fondant un «esprit divin de discernement» à Dante nous aidant à «sublimer notre sauvagerie humaine naturelle pour en faire le véhicule de notre vision esthétique», ou de Shakespeare, à qui l’humour ondoyant et sceptique tient lieu de philosophie, à Whitman qui suscite «une extension émotionnelle de notre moi personnel à tous les autres «moi» et à tous les objets qui l’entourent».
De la même façon, notre «moi» de lecteur, dans cette grande traversée de plein vent ou s’entrecroisent encore les sillages de Montaigne et de Melville, de Cervantès et de Proust, de Milton et de Nietzsche, se dilate sans se diluer, l’énergie absorbée par cette lecture se transformant finalement en impatience vive de remonter à chaque source et de sonder chaque secret.
CÉLINE. - A la fois passionné et constamment exaspéré par le personnage, et presque chaque phrase de Céline. Le type du hâbleur celte. Celui qui la ramène. Le mec. Celui qui en a. L’homme à qui on ne la fait pas. Le cynique. Fort en gueule, mais picaro trouillard. Un peu tout ça…
Ne plus parler de la chose à faire, mais la faire.
 SUR PROUST. - Edmond Jaloux parle du caractère d’anormalité de Marcel Proust, à tous égards extraordinaire, en précisant cependant le type de complexion de l’écrivain, sans pareil au XXe siècle, puis il en détaille les aspects de l’œuvre, la fresque sociale et les insondables intuitions psychologiques, enfin ce qu’il préfère qui ressortit à la poésie et rapproche Proust de Shakespeare: «Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelque chose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»
SUR PROUST. - Edmond Jaloux parle du caractère d’anormalité de Marcel Proust, à tous égards extraordinaire, en précisant cependant le type de complexion de l’écrivain, sans pareil au XXe siècle, puis il en détaille les aspects de l’œuvre, la fresque sociale et les insondables intuitions psychologiques, enfin ce qu’il préfère qui ressortit à la poésie et rapproche Proust de Shakespeare: «Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelque chose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»Celui qui n’a plus de goût à la vie / Celle qui se fixe des programmes / Ceux qui se taisent.
DE NOS ENFANTS. - En resongeant à ce que me disait Nancy Huston à propos de Tzvetan Todorov et de ses rapports avec son enfant d’une première femme, je me dis que le sens est donné à notre vie par l’attention et le souci qu’on lui consacre. Elle voyait cet homme tout faire pour l’enfant dont la mère était absente, et c’est ainsi que la mère ligotée, en elle, par ses préjugés féministes, s’est émancipée au meilleur sens du terme.
De la même façon, la relation entre ma bonne amie et moi n’a cessé de se consolider par l’attention partagée que nous avons consacrée à S. et J., dès leurs premiers jours et jusqu’à maintenant.
ENCORE PROUST. - Ce que dit Edmond Jaloux à propos de la meilleure façon de lire Proust, comme à vol d’oiseau, en ne cessant de considérer à la fois le détail et l’ensemble du temps et des lieux de la Recherche, rejoint ce que je me disais tout à l’heure à propos des accrocs de la vie, que ma sensibilité excessive (même catastrophique, disait Pierre Gripari) tend à grossir trop souvent. Evoquant la «contemplation du temps» à laquelle s’est livré Proust, Edmond Jaloux écrit «qu’on voit aussi à quel point nos sentiments sont, en quelque sorte, des mythes créés par nous-mêmes pour nous aider à vivre, des heures de grâce accordée à notre insatiabilité affectueuse, mais des heures qui n’ont pas de lendemain, puisqu’il nous est parfois impossible de comprendre, quand le vertige que nous communique un être est terminé, de quoi était fait ce vertige».
CHARLES-ALBERT. - La phrase de Céline est certes une musique, mais de savoir le musicien si mythomane et méchant me gâte la mélodie, tandis que je ne cesse d’être enchanté par la musique de Cingria.
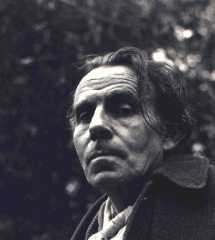 CÉLINE. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefs-d'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Féerie pour une autre fois ou Guignol's Band.
CÉLINE. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefs-d'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Féerie pour une autre fois ou Guignol's Band.Alors même que l'écrivain, rescapé d'une exécution probable (un Brasillach n'y coupa pas, qui fut moins violent que lui et bien plus digne et conséquent), s' ingéniait à réécrire son histoire avec autant de mauvaise foi que de rouerie inventive, les céliniens en nombre croissant se voyaient soupçonnés d'antisémitisme larvé s' ils ne se dédouanaient pas en invoquant le « délire » de l'intempestif, comme s'y est employée sa veuve Lucette Almanzor, accréditant elle-même la thèse de la folie de son cher Louis et bloquant la réédition des pamphlets.
Or, au fil des années, la publication de divers documents plus ou moins révélateurs ou accablants auront contribué à dévoiler le personnage dans sa complexité tordue, dont la créativité est inséparable de la paranoïa, la verve souvent nourrie par l'abjection, la lucidité aiguisée par une angoisse pascalienne ou une plus triviale trouille de couard. Oui, ce merveilleux orfèvre de la langue était à la fois un sale type, un ingrat mordant la main qui le nourrissait, un rapiat obsédé par son or, un délateur et un faux jeton en amitié, notamment. On peut certes, alors, choisir de ne pas le lire en se fondant sur ces jugements moraux, mais le lisant il faut tout lire de lui, n'était-ce que pour saisir d'où il vient et où il va.
Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait / Ceux qui refusent de s’asseoir à la table des moqueurs
CALAFERTE. - Partagé, en lisant Louis Calaferte, entre l’adhésion et la réserve. Il y a chez lui de l’écrivain authentique et du ronchon caractériel qui m’intéresse tout en me déplaisant parfois par l’aigreur que j’y trouve.
Que l’amour est ma seule balance et ma seule boussole, j’entends : l’amour d’L.
DE L’HUMILIATION. - D’où vient le ressentiment? D’où viennent les pulsions meurtrières? D’où vient le crime ? C’est à ces questions que répondent les romans de Patricia Highsmith. Or, lorsque je lui ai demandé ce qui, selon elle, faisait le criminel, elle m’a répondu sans hésiter que c’était l’humiliation. Mais n’est-ce pas faire peu de cas de ce qu’il y a de mauvais en l’homme, lui ai-je objecté ? Alors elle de me regarder comme un adversaire possible et de se taire. Et moi de me taire, aussi, sans oser lui demander si la perversité de Tom Ripley ne lui a pas procuré, à elle également, cette espèce de plaisir trouble que le personnage met à se venger ?
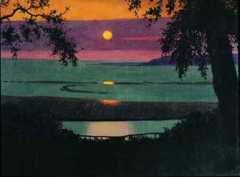 FÉLIX VALLOTTON. - Bien m’en a pris de faire escale à l’exposition Vallotton, dont les couleurs irradient puissamment de salle en salle. Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante. Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.
FÉLIX VALLOTTON. - Bien m’en a pris de faire escale à l’exposition Vallotton, dont les couleurs irradient puissamment de salle en salle. Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante. Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.Vallotton (1865-1925) avait treize ans de plus que Ramuz. Il laisse 500 peintures et une masse de gravures illustrant, avec une virulence expressionniste plus germanique ou nippone que française, la chronique d’une époque. Proche à certains égards d’un Munch, notamment face au désir, mais moins libre et sensuel, moins tragique aussi, que celui-là, du moins en apparence: plus coincé, plus glacé. La ligne plus importante chez lui que les couleurs. Un sourire pincé à la Jules Renard, surtout dans ses gravures. On l’a dit peintre de la raison, mais c’est un jugement par trop français, car la folie couve là-dessous.
(Kunstmuseum de Berne, 26 janvier).
WITKIEWICZ ET LE ROMAN. - A quoi tient le refus du roman manifesté par Witkiewicz? Il me semble que c’est le rejet d’un genre insuffisant à ses yeux. Il cherche certes la simplification en philosophe, il revient du multiple au concept, mais l’écrivain en lui part du singulier pour aller à l’universel. Or la notion de roman elle-même ne pèse plus lourd pour cette nature apocalyptique. Au demeurant, dans les mêmes années et sous le même empire d’un rêve totalisant de tout-dire, la Recherche proustienne est-elle seulement un roman? N’est-ce pas plutôt une immense chronique, comme le sont celles de Céline? À creuser. Mais pour le moment, c’est bel et bien comme des romans que je lis L’Adieu à l’automne ou L’Inassouvissement, tant leur masse organique et leur temps intime relèvent à mes yeux de ce genre-là.
WITKACY CE MATIN. - Lever de soleil d’hiver sur fond de ciel pervenche, tandis que cela se couvre. Voix de ma bonne amie. Jappements du chien Filou. Fumet du café. Oiseaux en nombre au McDo de la Désirade. Toute une bonne vie à côté de laquelle l’agitation intellectuelle, les « débats essentiels» et autres controverses exacerbées, émaillant Une seule issue, de mon cher Witkacy, me semblent un peu vains, dilués dans une certaine confusion.
S’il avait de formidables dons artistiques, Witkiewicz, apôtre de la forme pure, n’a jamais pu, et tant mieux peut-être, aboutir à celle-ci comme un Monet ou un Bacon. Lui qui rêvait de s’accomplir en peinture ou au théâtre, n’y est parvenu à mes yeux que dans ses roman fourre-tout. Avec L’Adieu à l’automne et L’Inassouvissement, c’est ainsi dans le roman, qu’il prétendait un genre hybride et mineur, qu’il a donné le meilleur. Il se voulait essentiellement philosophe, alors qu’il est surtout artiste, je dirais plutôt médium d’une société chaotique.
A propos de l’individu, dont la complexion physique et psychique compte pour beaucoup à la base de cette œuvre, Constantin Regamey, dont je me rappelle la figure de grand spectre lunaire à long manteau, dans les couloirs de la faculté des Lettres de Lausanne, écrit ceci d’éclairant quoique par trop empreint de morgue universitaire: «Il avait des œillères qui ne lui permettaient pas de soutenir une véritable discussion ni de s’informer de ce qui se faisait ailleurs». Et cette conclusion à la fois lucide, cruelle, juste et injuste à la fois: «En fait c’était un insatisfait psychique, un complexé, mais pas un malade, sûrement pas un fou, plutôt un génie».
(A La Désirade, ce 31 janvier)
DE L’AURA. – Certains êtres sont poétiques, je dirais plus exactement : diffusent une aura. Il y a cela chez ma bonne amie et chez tous ceux que j’aime, non du tout au sens d’un clan confiné de quelques- uns mais d’une famille sensible très élargie de gens dont l’âme rayonne à fleur de peau.
CONSTAT. - Je me dis parfois que ma vie actuelle est le résultat d’un malentendu, puis je me dis que non: que cette vie est le produit de tout ce que j’étais à l’origine et de ce que je suis devenu, conduit par une invisible main en dépit de mes errances.
(A la Désirade, ce 4 février)
DES SENTIMENTS ET DES LIEUX. - La lecture de Rien que des fantômes de Judith Hermann, qui évoque, comme personne aujourd’hui, les désarrois intimes de la jeunesse occidentale, de Berlin et de partout, dans un climat de déglingue où se cherchent et se perdent autant d’écorchés vifs - cette immersion sensible m’impatiente d’écrire à mon tour d’autres nouvelles, et plus précisément: des nouvelles de nostalgie, des nouvelles de lieux et de douleur, des nouvelles de bonté et d’apaisement. Je me rappelle à l’instant que Nancy Huston a particulièrement aimé L’Ange du cabanon, qu’elle m’a dit la plus belle histoire du Maître des couleurs, et c’est cela même que je crois avoir donné là: une nouvelle de nostalgie et de lieu, de douleur et de bonté.
A certains moments il n’y a plus que ça de vrai: une ligne après l’autre, une ligne après l’autre. C’est cela qui me relie à moi-même à l’encre verte: une ligne après l’autre.
JUDITH HERMANN. - Judith Herman a en elle un puits de larmes. En tout cas j’avais été saisi, dès son premier recueil de nouvelles, Maisons d’été, plus tard, par l'originalité et la maturité, la clarté et la complexité, la puissance expressive et l'hypersensibilité qui caractérisent son art si singulier consistant à mêler, à des situations vécues au présent avec une grande intensité - tout y est concret, sensuellement palpable, rendu avec une plasticité rappelant parfois les expressionnistes - le tremblement profond du temps et son poids de plus en plus perceptible avec l'âge. S'il y a de la mélancolie dans les nouvelles de Judith Hermann, dont procède le plus lancinant de son blues souvent râpeux, jamais elle ne cède à la délectation morbide. Dans la filiation des nouvelles berlinoises de Nabokov, on est au contraire saisi par la vitalité de ses personnages et par le dynamisme de son écriture. Son exploration des «vies possibles» illustre une imagination romanesque souvent en défaut aujourd'hui. Il ya de la fée chez elle, mais aussi de la sorcière : à la première, elle emprunte la capacité d'enchantement et à la seconde une sorte d'humour grinçant et cette implacable lucidité enfantine (mais jamais infantile) qu'elle promène sur la société en faisant dire à l'un de ses personnages «est-ce qu'il faut vraiment que ce soit comme ça?».
Par-delà l'aura de poésie et, parfois, de magie qui émane de cet univers, c'est aussi bien à la réalité des êtres, et douloureuse, et à tel sentiment d'insuffisance rappelant un Fassbinder, qu’achoppe Judith Hermann.
Avec Rien que des fantômes, son deuxième livre, on retrouve d’ailleurs les même personnages errants et plus ou moins blessés s' agrippant les uns aux autres comme des naufragés, pour autant de rendez-vous manqués ou décalés, non loin des élégies de Peter Handke et dans le ton aussi d'un certain post-romantisme urbain imprégnant le cinéma allemand d'après-guerre, par exemple dans La balade de Bruno S. de Werner Herzog. La nouvelle éponyme du recueil, qui se déroule dans un sinistre motel d'Austin (Nevada), où se retrouve un couple d'amis allemands traversant les Etats-Unis comme deux âmes en peine, s'inscrit aussi bien dans le droit fil de cette observation panique. En revanche, l'approche des personnages est marquée, chez Judith Hermann par une perception plus empathique et chaleureuse, sensuelle et presque animale, des rapports humains, auxquels se mêlent un dévorant besoin d'affection et une constante nostalgie d'on ne sait quel monde plus beau et plus pur, quelque chose qui a été perdu, que l'on chercherait à retrouver au fond d'une «caisse remplie d'objets anciens, absurdes, merveilleux», et dont on ne retrouverait finalement que le souvenir du souvenir …
CLIMATS. - Je suis tout à fait saisi et même plus: hanté par les atmosphères et la substance affective des nouvelles de Judith Hermann. Il y a là-dedans une mélancolie, une tristesse, mais une tendresse aussi que je n’ai rencontrées nulle part ailleurs à cet état de densité et de clarté dans la jeune littérature actuelle.
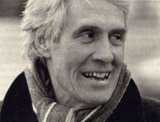 RECONNAISSANCE. - Louis Calaferte est mort à peu près oublié, et j’ai comme l’impression qu’il l’a cherché, guère plus pressé de se montrer aimable avec les uns et les autres, mais à mes yeux il ne cesse de vivre (je poursuis ces jours la lecture de ses Carnets de 1989) et c’est cela aussi que j’aimerais susciter après ma disparition de la part de quelques lecteurs: cette reconnaissance que m’inspire cette citation : «Notre seule honorable mesure est celle de l’amour et de la compassion.»
RECONNAISSANCE. - Louis Calaferte est mort à peu près oublié, et j’ai comme l’impression qu’il l’a cherché, guère plus pressé de se montrer aimable avec les uns et les autres, mais à mes yeux il ne cesse de vivre (je poursuis ces jours la lecture de ses Carnets de 1989) et c’est cela aussi que j’aimerais susciter après ma disparition de la part de quelques lecteurs: cette reconnaissance que m’inspire cette citation : «Notre seule honorable mesure est celle de l’amour et de la compassion.»DE L’AMITIÉ. - Je n’ai qu’à recopier ceci, de Calaferte aussi, pour me sentir proche de cet ami intransigeant: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène».
Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes amis perdus: «l’indifférence froide». Et du même coup, je vois mieux apparaître ce qu’a, parfois, été la mienne…
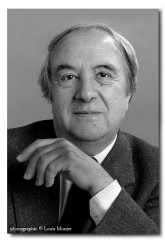 GEORGES PIROUÉ. - C’est une drôle d’impression que j’ai éprouvée aujourd’hui en apprenant que Georges Piroué était mort, et mort déjà le 7 janvier dernier, sans que personne ne se soit avisé d’en faire le moindre communiqué, pas même la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait hérité de son fonds d’archives. Un confrère, dont les parents étaient liés aux Piroué, vient en outre de m’apprendre qu’ils étaient trois à l’enterrement: le mort, son amie très malade et l’employé des pompes funèbres. Pour un homme qui a tant fait pour les autres écrivains, c’est bien affligeant, mais en somme à l’image de cette époque.
GEORGES PIROUÉ. - C’est une drôle d’impression que j’ai éprouvée aujourd’hui en apprenant que Georges Piroué était mort, et mort déjà le 7 janvier dernier, sans que personne ne se soit avisé d’en faire le moindre communiqué, pas même la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait hérité de son fonds d’archives. Un confrère, dont les parents étaient liés aux Piroué, vient en outre de m’apprendre qu’ils étaient trois à l’enterrement: le mort, son amie très malade et l’employé des pompes funèbres. Pour un homme qui a tant fait pour les autres écrivains, c’est bien affligeant, mais en somme à l’image de cette époque.(A La Désirade, ce lundi 7 février)
CLASSE MOYENNE. - Millenium people, de J.G. Ballard, est une véritable mine d’observations et de déductions sur la société atomisée et paralysée d’ennui dans laquelle nous vivons en Occident, tout à fait dans le ton grinçant et détaché qui me convient ces jours. La scène de l’émeute dans le camp de concentration pour chats de luxe attaqué par des furies qui assimilent félidés d’élevage et prisonniers politiques, est un régal. Il y a, là-dedans, une quantité de notations qui en appellent autant d’autres que je consigne au fur et à mesure dans les marges du livre.
C’est qu’il se passe tant de choses, dans la « dissociété » qui nous entoure, dont si peu d’écrivains rendent compte. D’autant plus intéressante, alors, me semble la démarche de Ballard, qui détaille les séquelles du sentiment de mécontentement et de révolte éprouvé par les représentants de la classe moyenne. J’y vois l’essentiel du malaise actuel, omniprésent dans nos villes, nos bureaux et nos journaux. Une espèce de paranoïa sévit dans les têtes. Ballard met le doigt sur le ras-le-bol des gens ordinaires lié à la perte du sens de leur existence et à l’enfermement et à l’étriquement que ressentent de plus en plus de gens supposés de plus en plus libres.
APPRENTISSAGE. – Je reconnais un bon maître au bon effet de sa parole et, plus encore, à la qualité de présence découlant de cette parole, à la chaleur et à la lumière de cette présence, à la façon dont cette parole et cette présence nous dépassent l’un et l’autre et nous délivrent l’un de l’autre. Un bon maître disparaît au moment de l’apprentissage, il n’attend pas que je le regarde mais me regarde regarder La Chose qu’il m’a demandé de regarder, qu’à mon tour je donnerai à regarder. A cet égard, le bon Monsieur Thibon est le parangon du bon maître.
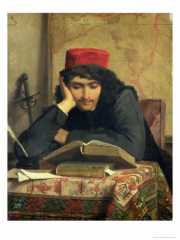 UN LECTEUR HEUREUX. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ». Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années.
UN LECTEUR HEUREUX. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ». Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années.C’est d’abord comme à tâtons que le lecteur-écrivain nous entraîne dans la selva oscura de sa mémoire confondue à une manière de soupe originelle d’où émergent, de loin en loin, tel visage ou telle silhouette, l’esquisse de tel geste annonçant toute une scène ou l’écho de telle voix préfigurant le développement de trois fois trente-trois chants.
Les premiers paysages et les premières figures entrevus par le rêveur-lecteur (le premier terme ne sera pas moins important que le second) dans sa remémoration d’une réalité fondamentale dégagée des ténèbres par ses premières absorptions, évoquent une lande désolée où des bergers se retrouvent autour d’un feu (et bientôt l’un d’entre eux va peut-être parler, et peut-être un Tourgueniev sera-t-il là aussi pour écouter dans le clair-obscur), et se regroupent alors diverses réminiscences, comme aimantées par l’image initiale.
Une lecture orale, par sa mère, lors d’une de ses maladies d’enfant, a-t-elle ancré au cœur de l’écrivain le souvenir de La Prairie de Biega, des Récits d’un chasseur, auquel est liée la vision nocturne (et quasi préhistorique) d’une tête de cheval, ou bien sa première lecture de la nouvelle, vers l’âge de seize ans, a-t-elle marqué la scène du sceau de sa vision d’adolescent ? Ce qui est sûr, et qui fonde le développement de toute la méditation qui suit, rassemblant d’autres souvenirs de lecture (Stevenson et son âne dans les Cévennes, les bergers de Tchekhov dans La Fortune, puis le chasseur Maupassant, la guerre, la chasse au loup), c’est que la lecture et la mémoire ont travaillé de concert à révéler la véracité (un mot que Piroué semble préférer au terme de vérité) de ces motifs à valeur d’archétypes en les éclairant les uns par rapport aux autres pour mieux les faire signifier.
Ce qui émerveille et qui surprend à chaque pas, dans ce parcours, c’est la remarquable liberté que Georges Piroué manifeste dans ses rapprochements, dont la pertinence découle de sa propre autobiographie de lecteur. Le voici par exemple, et avec quelle justesse affectueuse, parler de Thoreau, dont on sent que l’hyperréalisme mystique, et la langue parfaitement transparente, conviennent à sa propre nature contemplative et à son esthétique littéraire peu portée au gongorisme. Or la compréhension en profondeur de Thoreau amène Piroué à une mise en rapport lumineuse (« A travers lui Rousseau et Proust se donnent la main ») qui détermine aussitôt une double mise au point: « Avec cette différence que Rousseau n’est parvenu à son état d’ataraxie qu’après s’être obstiné à échapper à la société de son temps par l’utopie politique. Il voulait d’un réel réformé. Avec aussi, concernant Proust, la différence que celui-ci, en aiguisant ses sens, lorgnait du côté de leur utilisation à des fins artistiques. Il voulait d’un réel esthétique. Et tous deux, de manière différente, conservaient, en bons Français, des attaches avec la société, tandis que Thoreau les avait dénouées. »
Quant à notre lecteur, c’est bien plutôt « en bon Suisse » qu’il progresse avec l’absence de préjugés ou de snobisme des ressortissants des petites nations, l’ouverture à toutes les cultures que favorise naturellement notre éducation multilingue, la modestie des terriens et la défiance envers toute rhétorique creuse. Mais son vice impuni n’est pas moins d’un lettré européen, qui le fait tutoyer Leopardi (« Giacomo, amico mio ») dans une admirable lettre de reconnaissance, au double sens du terme; éclairer Tolstoï d’une lumière révélatrice, cheminer aussi à l’aise avec Henry James qu’avec Jacques Réda, Peter Handke ou Conrad, en rendant à chacun son dû et sa place.
Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se reconnaît « douteur fervent » et dit s’être fait « une religion de l’irréalité narrative », et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.
L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane, tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.
Or c’est à proportion, justement, de ce que ce livre a de très personnellement impliqué qu’à son tour le lecteur de l’heureux mémorialiste s’immerge dans les eaux profondes de sa mémoire, s’interroge et se met à « écrire les yeux fermés ». Femmes de Keller, orages de Faulkner, paysans déchirés de Ladislas Reymont et notre cher Buzzati à l’étage des cancéreux, Oblomov lu et relu sous toutes les lumières, une Vie de Rancé de plus pour se nettoyer de trop de carton contemporain, ou l’autre jour Par les chemins de Marcel Proust d’un certain bon Monsieur Piroué...
DE LA JOIE. - Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dans quel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne.
MATINES. - Je pense à la mort. Je pense au vide. Je pense à la nuit. Je pense à mon père. Je pense à Dieu. Je suis imprégné de cette présence. Je suis plein de cette «voix». Cela parle en moi sans discontinuer. Mais n’est-ce pas moi? N’est-ce pas simplement ma conscience qui me parle? Et qu’est-ce que cette conscience ? Je ne sais. Je sens pourtant que je ne suis pas seul. Je pressens que cela signifie quelque chose. Sans prier je me trouve en état d’oraison. Ouvert à la nuit et au jour. Il est cinq heures et demie du matin. Donc je me lève.
(A La Désirade, ce mercredi 23 février)
 LE BON MONSIEUR THIBON. – Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures, Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon : c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.
LE BON MONSIEUR THIBON. – Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures, Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon : c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.DU NON CONSENTEMENT. - Aux yeux de certains je fais figure d’extravagant, pour d’autres je suis celui qui a cédé au pouvoir médiatique, mais ma vérité est tout ailleurs, je le sais, n’ayant jamais varié d’un iota, ne m’étant soumis à rien d’autre qu’à mes élans et à mes pulsions, à ce qui m’anime et m’agite depuis mon adolescence, et voilà: je me lève ce matin à six heures, j’ai trop bu hier soir, je n’aurais pas dû, etc. Du moins ce qui reste sûr, à mes yeux, c’est que je ne me résignerai jamais, contrairement à tant de compagnons de route d’un temps qui se sont arrêtés en chemin ou que la vie a amortis – jamais ne consentirai ni ne m’alignerai pour l’essentiel.
JACQUES CHESSEX. - Le Désir de Dieu me semble l’un de ses livres les plus libres et les plus aboutis du point de vue de la forme, dans le droit fil de L’Imparfait et de ses étonnantes Têtes, écrit littéralement « sous le regard de Dieu », selon l’expression de Pasternak qui recommandait précisément à Akhmatova d’écrire ainsi.
Ah mais quel bougre d’écrivain et combien je me sens proche de lui en ces pages fluides et un peu délirantes, que j’aurais pu écrire: « Je suis plein de Dieu, croyant le perdre, ne le perdant pas, craignant de ne plus le capter et l’écoutant sans cesse au fond de moi. Parce qu’avec l’exercice de Dieu, le désir de Dieu, la curiosité de Dieu, l’âge venant, je vis avec Dieu une espèce d’état de Dieu qui plus jamais ne s’interrompt».
Jacques Chessex parle ainsi de la présence de Dieu en nous et de notre dispersion devant Dieu – cela même qui me tarabuste si souvent: ma dispersion devant Dieu. Je ne sais pas trop à quoi cela tient mais cela me parle: il y a là une parole vive et une beauté, du sens, de la vigueur et de la profondeur, un homme enfin dépassé par son verbe. Or cela rejoint à la fois Cingria par la découpe de l’écriture (« L’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini»…) et Rozanov par le continuum de la voix.
CARNETS DE VIE. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…
Thierry était un artiste pur, sans rien du cérébral théoricien, ses lettres étaient d’un écrivain mais je trouve, dans ses carnets, qui fait écho à sa vision si singulière, une pensée non moins dense à fulgurances saisissantes, par exemple lorsqu’il note que « c’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie» et quand il constate que «la foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose», ou, sur un autre registre encore, plus obscur et non moins pénétrant, qu’«une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».
Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites ; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issue personnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».
Il y a du protestant Amiel se flagellant dans certaines de ses admonestations, qui me rappellent mes propres repentances : « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer » !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais. »
Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».
DJIAN. - Il y a, dans Impuretés de Philippe Djian, une révolte que je ressens moi aussi par rapport à tout ce qui défait la communauté des personnes, de la famille et de la société. Après Impuretés, je lis Frictions qui me touche également par sa densité émotionnelle. Une fois de plus il y est question d’une relation familiale pourrie, avec ce jeune garçon témoin de la haine de ses parents puis se retrouvant, adulte, entre sa jeune femme top model et sa mère jouant celle qu’on abandonne. Le style de l’écrivain pèche parfois (alors qu’il le croit son point fort, non sans candeur) mais il y a là une quantité d’observations dans la masse qui me semblent d’aujourd’hui, et leur ressaisie traduit une vision juste du délabrement de ce pauvre monde.
PSAUME. – Malgré tout je me sens dans la main de Dieu. Ces aubes pures, aux fenêtres de La Désirade, sont autant de cantiques et tout aussitôt je me sens appelé à en témoigner.
(A La Désirade, ce mercredi 2 mars)
 SOLJENITSYNE. - Ce qui me frappe, à la lecture d’ Esquisses d’exil, c’est la vulnérabilité que montrent les plus costauds devant la vilenie et la bassesse. On pourrait les croire au-dessus de ça: mais non, cela les touche et les blesse comme s’il en allait d’une atteinte d’autant plus sensible que l’accusation est plus injuste ou vile. Ainsi, de la vanité de tel traducteur-biographe à la paranoïa de tel maniaque de la plainte judiciaire, en passant par la diffamation, hier manipulée par le KGB, aujourd’hui relayée par les médias occidentaux, le démon mesquin est-il légion aux basques de Soljenitsyne. Je me sens à vrai dire « pluraliste» en le lisant, donc peu porté à m’aligner sur ses positions rigides de nationaliste russe et d’orthodoxe pur et dur, mais je respecte l’homme, l’écrivain, le héros, et le défendrai toujours contre la meute hideuse de ses détracteurs.
SOLJENITSYNE. - Ce qui me frappe, à la lecture d’ Esquisses d’exil, c’est la vulnérabilité que montrent les plus costauds devant la vilenie et la bassesse. On pourrait les croire au-dessus de ça: mais non, cela les touche et les blesse comme s’il en allait d’une atteinte d’autant plus sensible que l’accusation est plus injuste ou vile. Ainsi, de la vanité de tel traducteur-biographe à la paranoïa de tel maniaque de la plainte judiciaire, en passant par la diffamation, hier manipulée par le KGB, aujourd’hui relayée par les médias occidentaux, le démon mesquin est-il légion aux basques de Soljenitsyne. Je me sens à vrai dire « pluraliste» en le lisant, donc peu porté à m’aligner sur ses positions rigides de nationaliste russe et d’orthodoxe pur et dur, mais je respecte l’homme, l’écrivain, le héros, et le défendrai toujours contre la meute hideuse de ses détracteurs. FABIENNE VERDIER. - Au fulgurant premier regard on se dit que seul un dieu dansant entre ciel et terre, tourbillon d’esprit et de matière, d’un seul trait a jeté cela comme ça : comme c’est. Et c’est ce qu’on se dit : c’est comme ça. Comme l’évidence parfaite d’une pierre ou d’une feuille d’herbe : tel est l’être du monde. Cela s’impose à la vitesse de la lumière et ça n’a pas d’âge. Ou plutôt on pressent la patience des étoiles préludant au geste phénoménal prompt comme la foudre: que cela soit - que la beauté soit.
FABIENNE VERDIER. - Au fulgurant premier regard on se dit que seul un dieu dansant entre ciel et terre, tourbillon d’esprit et de matière, d’un seul trait a jeté cela comme ça : comme c’est. Et c’est ce qu’on se dit : c’est comme ça. Comme l’évidence parfaite d’une pierre ou d’une feuille d’herbe : tel est l’être du monde. Cela s’impose à la vitesse de la lumière et ça n’a pas d’âge. Ou plutôt on pressent la patience des étoiles préludant au geste phénoménal prompt comme la foudre: que cela soit - que la beauté soit.Le feu du mouvement, traversé d’un souffle cosmique et soulevant jusqu’au ciel les pigments mêlés de terre et d’eau de pluie résument l’art essentiel de Fabienne Verdier. Elémentaire et savante, puissamment physique et modulant une non moins évidente démarche spirituelle, cette peinture est à la fois abstraction pure et poésie concrète, culture raffinée et nature primordiale, figures du subconscient et constante évocation du monde visible et sensible. Aussitôt une harmonie « musicale » soulève celui qui la découvre, lui rappelant comme une cantate de Bach que l’homme est « capable du ciel », mais cet envol prend appui sur le sol de fonds inlassablement travaillés, tels les glacis des maîtres anciens ou les couleurs « montées » des figures de contemplation de Rothko ; et l’on se rappelle à la fois les contemplatifs cisterciens auxquels l’artiste rend d’ailleurs hommage explicite, comme à son mentor taoïste, invitant à autant de stations méditatives.
ELLE. – L. ne cesse de m’émouvoir. Elle est essentiellement elle-même. Elle est toujours juste. Toujours elle-même et juste.
Mon réalisme tâtonne entre une déception d’enfance et tous les élans vers le ciel que m’ont inspiré tous les dégoûts.
MALAISE. – Je ne me sens pas bien. Tout à coup il me semble percevoir, de manière écrasante, le caractère vain et vulgaire de mon travail au journal, avec le sentiment accablant d’être submergé par la laideur, telle qu’elle m’a été imposée l’autre jour par la mise en page grossière de ma présentation de Fabienne Verdier, entrelardée de publicités affreuses. Mais ne rien montrer de cette contrariété. Faire comme si de rien n’était. Résister là où je me trouve. Résister à la contamination de l’intérieur…
(Au Buffet de la Gare, ce lundi 22 mars)
DE L’ESPRIT D’ENFANCE. - Plus je vais et plus je constate que je ne suis moi-même qu’en retrouvant ma disponibilité totale à l’esprit d’enfance. Toute autre posture intérieure, qui relativiserait les exigences de celui-là, me disconvient et plus: me contrarie. Jamais je ne serai adulte et responsable au sens où ils l’entendent, même si je me fais une idée aussi conséquente, sinon plus qu’eux, de toute vraie responsabilité.
SANTO SUBITO. - A l’instant (il est 5 heures du matin) j’apprends, sur ma petite radio portative, la mort de Jean Paul II, survenue hier soir à 21 heures 57. Ce fut un grand pape à la fois politique et mystique, un homme de lumière et de fermeté dans une époque de ténèbres et de déliquescence. Peu m’importe qu’il y ait, dans ses positions déclarées, des aspects qui se discutent: il est resté fidèle au Christ pour l’essentiel, une icône vivante pour beaucoup de malheureux et pour beaucoup de jeunes, ce qui l’a limité à nos yeux de pluralistes relevant du dogme et de la tradition catholique qui n’est certes pas tout le christianisme – mais qui de nous est habilité à lui en remontrer ? C’était une sorte de figure paternelle conséquente, et je l’aimerai toujours à ce titre, comme j’aime mon propre père.
En considérant l’incroyable mouvement de reconnaissance qu’a soulevée sa mort, je me demande pourtant ce que cela signifie vraiment ? Le slogan Santo subito en dit long sur le besoin de vénération, même d’adoration de ces braves gens, mais quelle part d’emballement idolâtre n’y a-t-il pas là-dedans ?
(A La Désirade, dimanche 3 avril)
Jean-Jacques Rousseau: «Seul celui qui marche est apte au réel».
MAGMA. - En cherchant La Nouvelle Héloïse dans les rayons de livres de poche de l’Hyper U, je me suis senti soudain submergé par une double sensation contradictoire de dégoût et de vague délivrance, comme si je découvrais soudain le caractère à la fois dérisoire et pour ainsi dire héroïque de mon propre travail d’écrivain. Oui, véritablement, devant une telle masse et une telle hideur on se dit, à la fois, qu’on n’est rien et qu’on est justifié...
(Au Cap d’Agde, ce mercredi 11 mai).
MARE NOSTRUM. - Retrouver la mer est important, pour L. et moi, comme une sorte de respiration fondamentale, physique et spirituelle à la fois, qu’aucun autre lieu ne nous aura jamais donnée. Nous avons besoin de la mer. Ces dunes qui se perdent dans le lointain et cette douce grève aux herbages hirsutes, le long de laquelle les gens vont et viennent, ont quelque chose de tellement apaisant et de si tonifiant aussi, avec la mer roulant là-bas sa litanie infinie.
CHANTIERS. - Pastis au bord de l’Hérault. Le Canal du Midi, le long duquel se succèdent les chantiers navals, me fait penser à Simenon et me rappelle cette province un peu décatie que j’aime retrouver un peu partout, en France, si rare en revanche dans la Suisse trop policée.
(Au Grau d’Agde, ce vendredi 13 mai)
Celui qui estime que l’éloge du bourreau de Joseph de Maistre l’engage à manier la hache / Celle qui menace son fils Dominique de ne plus l’aimer s’il se détourne de Jésus / Ceux qui pensent que la mort de Dieu est un fait accompli, etc.
SIMENON. - Un romancier populaire, et l'un des plus populaires au monde, peut-il être un bon écrivain ? Est-il concevable qu'un auteur, à qui il arrivait d'écrire cinq à dix romans en une année, dont un seul eût suffi à établir une réputation, puisse ne pas être un faiseur, voire un pisse-copie ?
Ces questions n'ont cessé de nourrir, dans le monde littéraire, la suspicion envers l'œuvre extraordinairement fertile de Georges Simenon, même si certains de ses pairs lui vouaient la plus naturelle admiration. André Gide le premier, qui lui manifesta autant de respect professionnel que d'affectueuse attention, l'avait écrit: « Il est le plus grand de tous... le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature ». Et Faulkner de surenchérir: « J'adore lire Simenon. Il me fait penser à Tchékhov ».
Beaucoup cependant, en France surtout où l'on continue de séparer la « pure » littérature, destinée à quelques-uns, de celle qui touche le moins lettré des lecteurs, ont classé une fois pour toutes le romancier prolifique dans la catégorie « policière », autant dire de la sous-littérature. D'ailleurs, prétendent les plus doctes, Simenon n'a « pas de style ».
Le plus cocasse, à ce propos, est cependant que la très stylée Colette fut la première, à la lecture des textes de Georges Simenon, à lui conseiller de « faire moins littéraire », devinant que cet écrivain était de la race rare de ceux qui en disent le plus avec le moins. Jacques Dubois, qui a établi l'édition Pléiade des romans de Simenon, ne dit pas autre chose: que le « style » de Simenon n'a rien certes qui brille comme le style de Proust ou le style de Céline, mais que Simenon n'en est pas moins l'inventeur d'une écriture absolument originale qui passe essentiellement par la sensation et l'intuition, la perception profonde, et souvent subconsciente, des moindres mécanisme du comportement humain, restituées dans une langue limpide mais parfaitement rythmée, avec une poésie qui ne se réduit pas aux clichés de la fameuse « atmosphère Simenon », de trottoirs mouillés en brumes traînantes.
Simenon n'a jamais posé au grand écrivain: il se disait lui-même un artisan, et celui qui a vu, à ses archives de Liège, ses manuscrits et ses tapuscrits, ne peut qu'abonder dans le sens de ce que me disait un jour la romancière Patricia Highsmith, confondue d'admiration devant l'immensité du travail du romancier.
Pour relativiser le mérite de celui-ci, d'aucuns évoquent souvent, comme Georges Haldas, un « phénomène », qui ferait de lui une éponge absorbant tout et le recrachant sans y penser. D'une manière plus triviale encore, les clichés du romancier-record, qui plus est riche à millions et couvert de femmes, achèvent de brouiller l'image réelle d'un écrivain qui a beaucoup travaillé, et non du tout en tâcheron mais en observateur inlassable, et de plus en plus fin, du phénomène humain. Car l'évolution de Simenon, du journaliste-aventurier de seize ans qui reflétait l'idéologie d’époque, antisémite et populiste, de la Gazette de Liège, au romancier compassionnel des « romans de l'homme », révèle la prise de conscience progressive d'un témoin lucide de la condition humaine. L'auteur de l'admirable Lettre à mon juge s'efforce ainsi de « comprendre et ne pas juger », selon sa devise qui ne l'empêche pas, au demeurant, d'avoir une idée très affirmée de la vraie justice (on se rappelle le plaidoyer prodigieux des Inconnus dans la maison, tonné au cinéma par Raimu) et de la vraie fraternité, dont son commissaire Maigret, inspiré par son propre père qui « aimait tout », est l'interprète le plus connu.
DE LA CONVERSION.- A mon rendez-vous matinal de cinq heures, je me dis que la conversion est une décision de tous les jours et de tous les instants. Le déclic n’est entendu que de Dieu. Tu choisis ceci, clic. Tu choisis cela, clac. Chacun sait très bien ce qu’il en est et c’est cela qui compte: c’est le secret de chacun.
Celui qui est toujours furieux / Celle qui croit que son ventre est plein d’une tumeur / Ceux qui ne supportent pas la joie des autres / Celui qui récolte la monnaie oubliée des automates / Celle qui jouit des insinuations qu’elle sème / Ceux qui redoutent les instruits / Celui qui prononce les noms de Heidegger et de Derrida pour bien marquer le territoire sur lequel il accueille ses nouveaux étudiants à jeans leur tombant sur le cul / Celle qui ne sait pas que Stendhal s’écrit avec h et Beyle avec y et que son prof trouve d’autant plus cool / Ceux qui ne savent pas où chercher le bonheur, etc.
PLAISIRS DE LÉAUTAUD. - Paul Léautaud se flattait de n’avoir jamais menti de toute sa vie, et c’est sûrement vrai. Jamais en tout cas, à le lire, on n’a l’impression qu’il cherche à plaire au lecteur ou qu’il se ménage lui-même en s’observant. Voici par exemple ce qu’il écrivait dans le dimanche 4 mars 1951 dans son Journal littéraire: «Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. »
Le même jour (l’écrivain avait alors 79 ans) Léautaud remarquait qu’il avait toujours été «fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement», et qu’une seule chose avait compté pour lui: le plaisir précisément.
«Ce mot plaisir représente pour moi le moteur de toutes actions humaines», écrivait-il. Or son plaisir, Léautaud l’avait trouvé avec quelques femmes, avec les poètes dont il fut l’anthologiste au début du siècle (lui qui se prétendait fermé au sentiment, pleurait comme une madeleine quand il récitait par cœur Verlaine, Jammes ou Apollinaire), dans les conversations quotidiennes au Mercure de France dont il était l’employé, avec les flopées de chats et de chiens qu’il recueillait dans son pavillon d’ermite urbain de Fontenay-aux-Roses, et surtout à écrire, tous les soirs à la chandelle, le rapport circonstancié de ses journées, consigné à la plume d’oie sur des feuilles collées les unes aux autres et dont l’ensemble nourrit les dix-huit volumes de la première édition du Journal littéraire.
A part celui-ci, Le petit ami, évoquant sa jeunesse de gandin préférant les lorettes de bals populaires aux bourgeoises, et le poignant In memoriam, écrit au chevet de son père mourant avec autant de ressentiment (justifié) que d’émotion (Léautaud est un émotif extrême sous son rictus), quelques proses stendhaliennes et ses chroniques de théâtre réunies sous le pseudonyme de Maurice Boissard, constituent toute son œuvre, fruit acide et tonique de tout son plaisir.
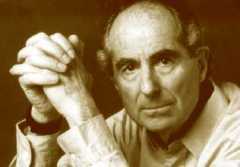 SUBLIMATION. - Il y a un moment très émouvant, dans La Tache de Philip Roth, et c’est celui où le narrateur, Nathan Zuckermann, et Coleman Silk, son vieux voisin en rupture de conformité, deviennent amis en dansant ensemble le fox-trot sur une terrasse nocturne, comme ça, spontanément, et sans rien d’équivoque dans ce contact physique de deux mecs à moitié nus, avant d’échanger diverses confidences, notamment sur les femmes. Alors que Coleman a «repris du service» grâce au Viagra, Nathan sublime « grâce » à l’impuissance où l’a laissé son cancer de la prostate. Cette complicité me fait songer à celle des anciens combattants. Au reste, toute forme de sublimation me semble émouvante, et celle de Nathan me touche particulièrement en cela qu’elle va vers l’œuvre à faire…
SUBLIMATION. - Il y a un moment très émouvant, dans La Tache de Philip Roth, et c’est celui où le narrateur, Nathan Zuckermann, et Coleman Silk, son vieux voisin en rupture de conformité, deviennent amis en dansant ensemble le fox-trot sur une terrasse nocturne, comme ça, spontanément, et sans rien d’équivoque dans ce contact physique de deux mecs à moitié nus, avant d’échanger diverses confidences, notamment sur les femmes. Alors que Coleman a «repris du service» grâce au Viagra, Nathan sublime « grâce » à l’impuissance où l’a laissé son cancer de la prostate. Cette complicité me fait songer à celle des anciens combattants. Au reste, toute forme de sublimation me semble émouvante, et celle de Nathan me touche particulièrement en cela qu’elle va vers l’œuvre à faire…RAMUZ ET CINGRIA. -Le fait de se demander ce qui nous manque chez un auteur nous aide mieux à distinguer qui il est et qui nous sommes. Ce qui me manque chez Ramuz est le jazz verbal et la turbulence, la rondeur et la folie de Charles-Albert, la spontanéité et la fantaisie, la liberté et la saveur. Il y a certes un peu de tout cela, à faible dose, dans Adieu à beaucoup de personnages, mais à son avantage il y a tout le reste, aussi, que Ramuz a, et que Cingria n’a pas…
DE LA « LANGUE » SUISSE. - Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression, la Suisse n’existe pas, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire : il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria ; ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée, essentiellement latine ou franco-provençale.
Celui que tout amuse malgré tout / Celle qui envoie des SMS à sa cousine Arlette pendant la réu des cadres dans la Salle panoramique / Ceux qui rappellent aux jeunes stagiaires qu’ils ont eux aussi « jeté quelques pavés en mai 68, etc.
PARLER DE DIEU. - Ceci de Ramuz que je contresigne: «Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme». Et ceci de Rousseau dans le même sens: «Je veux que les choses soient ce qu’elles paraissent: de bonnes fourchettes de fer et de bonnes cuillers d’étain».
 MATINALES. - Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça, m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde.
MATINALES. - Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça, m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde.L’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.
Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.
Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.
(A La Désirade, ce lundi 20 juin)
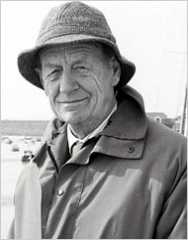 LUCY. - Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de William Trevor. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy.
LUCY. - Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de William Trevor. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy.Or ce nouveau roman ne s’en tient pas à la seule destinée de Lucy. De fait, c’est à tous les personnages directement frappés par ce drame – une enfant qui fugue à la veille du départ de sa famille loin de leur Eden côtier, pour cause d’insécurité, et qui ne réapparaîtra qu’après la mort de sa mère désespérée, tant d’années après -, que l’auteur voue son attention, tous étant à la fois coupables et victimes, responsables à certains égards et innocents. Roman de la fatalité et de la fidélité, de la faute et du pardon, de l’attachement à une terre et de l’exil, de l’amour empêché et de sa sublimation, Lucy entremêle enfin l’histoire d’une femme et celle de l’Irlande contemporaine, du début de l’ère dite « des troubles » à nos jours. « C’est notre drame, en Irlande, dit l’un des personnages du roman, que pour une raison ou pour une autre nous soyons encore et toujours obligés de fuir ce qui nous est cher », et le lecteur le prend pour lui…
 LE POIDS DU MONDE. - Je ne sais pourquoi ce qu’écrit Peter Handke me fait penser, toujours, au travail du ver à soie. A le lire je revois ma mère faufilant avant de coudre. C’est cela même quand il parle de sa mère à lui, dans Le malheur indifférent: Handke faufile. A la fin du livre il note d’ailleurs ceci qui le justifie d’avance: « Plus tard, j’écrirai sur tout cela en étant plus précis ». Or, je me sens à la fois attiré et vaguement agacé par la douceur affectée de cette littérature si fine et si vétilleuse, qui esthétise le malheur autant qu’elle l’affronte, et ne cesse de forcer la note tout en l’atténuant. Ainsi de la naissance de la mère dans une famille de paysans nécessiteux est-elle dramatisée à l’excès: « Naître femme dans ces conditions c’est directement la mort », pour se trouver banalisée aussitôt après: « On peut dire cependant que c’est tranquillisant: aucune peur de l’avenir en tout cas ».
LE POIDS DU MONDE. - Je ne sais pourquoi ce qu’écrit Peter Handke me fait penser, toujours, au travail du ver à soie. A le lire je revois ma mère faufilant avant de coudre. C’est cela même quand il parle de sa mère à lui, dans Le malheur indifférent: Handke faufile. A la fin du livre il note d’ailleurs ceci qui le justifie d’avance: « Plus tard, j’écrirai sur tout cela en étant plus précis ». Or, je me sens à la fois attiré et vaguement agacé par la douceur affectée de cette littérature si fine et si vétilleuse, qui esthétise le malheur autant qu’elle l’affronte, et ne cesse de forcer la note tout en l’atténuant. Ainsi de la naissance de la mère dans une famille de paysans nécessiteux est-elle dramatisée à l’excès: « Naître femme dans ces conditions c’est directement la mort », pour se trouver banalisée aussitôt après: « On peut dire cependant que c’est tranquillisant: aucune peur de l’avenir en tout cas ».Et tout ce « travail littéraire » d’osciller entre l’effroi et son acclimatation, le cri et la glose, un récit de vie poignant et sa déconstruction simultanée, comme s’il y avait quelque chose d’inconvenant dans la simple émotion - comme si tout le tragique de la vie ne servait qu’à prendre des notes, et ces notes qu’à se tisser un cocon…
Au bord de la dépression: ces moments où il semble qu’on ait mal à tous les objets qu’on touche.
Ce personnage qui, après avoir touché le fond de la désolation, se met à s’intéresser passionnément au prix des choses. Il y a là comme un humour du désespoir qui me touche en ce moment précis.
HANDKE. - En d’autres temps j’aurais peut-être rejeté ce livre aux observations parfois si vétilleuses, qui m’évoquent des sortes de flocons sensibles à consistance de peluche, et pourtant je reviens et reviens au Poids du monde de Peter Handke comme à une méditation murmurée qui relance à tout moment la mienne, et j’ai beau me reprocher de gratter ainsi ma plaie: je vois aussi la poésie qu’il y a là-dedans, et cet exercice d’attention qui aboutit à tout instant à la cristallisation d’images ou d’idées comme sécrétées par les gestes, les postures, les mouvements les plus imperceptibles du corps ou de l’esprit, celui-là comptant autant que celui-ci et débordant sur le corps de la nature et de l’univers. On dirait ainsi la conscience de l’écrivain comme à fleur de peau, dont l’écriture paraît émaner en buée. Le lecteur est à la fois dedans et dehors, comme passant sous ses propres fenêtres - et cette phrase buzzatienne me touche alors particulièrement: « Passer devant une fenêtre sombre derrière laquelle un ami a habité autrefois ». Ou encore: « Les voitures mortes devant la fenêtre dans la nuit ». Il y a là une douceur mélancolique dont j’aime la projection en images, et cette sensualité triste, à la limite du lâcher-prise dans laquelle je suis parfois immergé moi aussi: « Un homme assis, affaissé, essaie sans cesse de se redresser pour montrer du maintien, mais chaque fois il s’affaisse de nouveau, finalement il est content comme ça ».
VIEILLIR. - Il y a toujours un certain décalage entre notre âge et notre moi, que je ressens particulièrement aujourd’hui que les jeunes gens m’identifient à un vieil iguane, alors que je me sens plus frais qu’à vingt ans. Or je n’arrive pas à admettre ce fait pourtant indéniable, que je suis bel et bien un vieil iguane. Mais voudrais-je avoir dix ou vingt ans de moins? Certes non, puisque j’étais alors plus vieux qu’aujourd’hui. Donc va pour la comédie du vieil iguane...
 CÉZANNE. - Mon besoin, ce matin, de matière solide, s’est satisfait à la lecture des premières pages du Cézanne de Philippe Dagen. Il y prône le retour à l’œuvre et l’attention aux intérêts du peintre pour la littérature et toutes les formes d’interprétation – il insiste: de lecture. Le fait que Cézanne sache La charogne de Baudelaire par cœur est plus important, à ses yeux, que toutes les théories. Le personnage bougon et entêté, solitaire et saint à sa façon (si peu artiste me semble-t-il) de Cézanne m’a toujours plu. Ceux qui l’approchent le traitent d’«ours intraitable». Il écrit lui-même: «L’isolement, voilà ce dont je suis digne. Au moins, ainsi, personne ne me met le grappin dessus». Et cela que j’aime bien aussi: «Tous mes compatriotes sont des culs à côté de moi»…
CÉZANNE. - Mon besoin, ce matin, de matière solide, s’est satisfait à la lecture des premières pages du Cézanne de Philippe Dagen. Il y prône le retour à l’œuvre et l’attention aux intérêts du peintre pour la littérature et toutes les formes d’interprétation – il insiste: de lecture. Le fait que Cézanne sache La charogne de Baudelaire par cœur est plus important, à ses yeux, que toutes les théories. Le personnage bougon et entêté, solitaire et saint à sa façon (si peu artiste me semble-t-il) de Cézanne m’a toujours plu. Ceux qui l’approchent le traitent d’«ours intraitable». Il écrit lui-même: «L’isolement, voilà ce dont je suis digne. Au moins, ainsi, personne ne me met le grappin dessus». Et cela que j’aime bien aussi: «Tous mes compatriotes sont des culs à côté de moi»…JEUNISME. - J’écoute, d’une oreille, la jactance de la radio portant sur la Street Parade, où un anthropologue explique que la jeunesse se trémousse ainsi et se défonce parce qu’elle n’a aucun avenir. Voilà ce que dit l’anthropologue: la jeunesse n’a pas d’avenir. Si la jeunesse se drogue (parce que la jeunesse ne fait que se droguer) c’est parce que la société (il dit: la société) ne lui offre aucun débouché. Voilà, c’est comme cela que les «faiseurs d’opinion» et autres anthropologues autoproclamés «font l’opinion».
Leçon quotidienne de Cézanne à ma fenêtre.
Ne m’intéresse plus que l’Objet. Cézanne ou l’objectivité sans limite.
Tout devenant festif, il n’y a donc plus de fête.
L’obsession craintive de leur différence en a tiré ce bêlement grégaire.
Cézanne s’ouvre au monde en se coulant dans l’objet.
 RAMUZ EN PROVENCE. - Je viens de relire les douze pages de L’Exemple de Cézanne où C.F. Ramuz, avec une saisissante acuité, et pour évoquer son propre rapport à la terre, raconte le pèlerinage qu’il accomplit en 1914, partant de la Cannebière de Marseille en tramway, gagnant le « haut pays » et là se trouvant lui-même « repaysé » devant la grande chaîne blanchâtre au pied de laquelle Aix se trouve assise, y déjeunant d’olives noires et de saucisson et cherchant ensuite la rue Boulegon, tout humble et là-bas, superposé à un toit, « le cube blanc de l’atelier » découvert avec émotion - mais l'écrivain savait que la vraie présence de Cézanne ne rayonnerait que plus loin encore, dans la « nature presque espagnole » du pays réinventé par le peintre.
RAMUZ EN PROVENCE. - Je viens de relire les douze pages de L’Exemple de Cézanne où C.F. Ramuz, avec une saisissante acuité, et pour évoquer son propre rapport à la terre, raconte le pèlerinage qu’il accomplit en 1914, partant de la Cannebière de Marseille en tramway, gagnant le « haut pays » et là se trouvant lui-même « repaysé » devant la grande chaîne blanchâtre au pied de laquelle Aix se trouve assise, y déjeunant d’olives noires et de saucisson et cherchant ensuite la rue Boulegon, tout humble et là-bas, superposé à un toit, « le cube blanc de l’atelier » découvert avec émotion - mais l'écrivain savait que la vraie présence de Cézanne ne rayonnerait que plus loin encore, dans la « nature presque espagnole » du pays réinventé par le peintre.Ramuz oppose le « Midi facile, extérieur, Midi d’effets », des aquarellistes et paysagistes à la petite semaine (il en croule plus que jamais aujourd'hui entre senteurs et saveurs conditionnées) et le « Midi grave, austère, sombre de trop d’intensité », de Cézanne dont il définit l'art plus précisément encore: « Sourd, en dessous, tout en harmonies mates, avec ces rapprochements de bleus et de verts qui sont à la base de tout , et ce gris répandu partout, qui exprime la profondeur et qui exprime la poussière, parce que la lumière après tout est poussière pour qui voit autre chose que la surface et l’accident ».
Ramuz oppose aussi Cézanne au folklore (coiffes, farandoles et galoubets) d'un Mistral pour montrer combien sa Provence à lui est plus qu’une province : une terre universelle appartenant à tous et où tous peuvent se reconnaître dans l’élémentaire épuré : « Peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, écrivait d'ailleurs Cézanne, c’est réaliser des sensations.
Et Ramuz de conclure : « D’autres ont des bustes, des statues : sa grandeur à lui est dans le silence qui n’a cessé de l’entourer ; sa grandeur à lui est de n’avoir ni buste ni statue, ayant taillé le pays tout entier à sa ressemblance, dressé qu’il était contre ses collines, comme on voit le sculpteur, son maillet d’une main et son ciseau de l’autre, faire tomber le marbre à larges pans ».
AUTOLIMITATION. - Me vient l’idée ce matin que le renoncement, le choix de ne pas faire ceci ou cela, la permission qu’on se refuse, peut être la plus belle manifestation de liberté. Ce que Soljenitsyne appelle l’autolimitation, si contraire à l’esprit du temps…
On ne discute pas avec la médiocrité. Discuter est déjà s’abaisser.
PARIS. - En dînant seul à la terrasse du café de la Place, tout en haut de la rue d’Odessa, je songe à mes multiples escales à Paris et à ce que j’aime toujours dans cette ville si personnelle, à sa vie, à son charme et ses beautés – ce soir, ensuite, le bord de la Seine, la grande roue du côté des Tuileries, la tour Eiffel gainée d’une sorte de résille de lumière, puis les terrasses de la rue de Buci, jusqu’à la touffeur molle de la nuit estivale, propre elle aussi à Paris. Dans la foulée je note que jamais, à ma connaissance, Cézanne n’a représenté aucune rue ni aucune place de Paris, ni d’aucune ville d’ailleurs…
(Paris, ce jeudi 28 juillet)
JARDIN DU LUXEMBOURG. - Les gros nuages saturés d’encre du lever du jour s’étant dissipés, voici le premier soleil dardant entre les feuilles des feuillus. Après avoir salué le sombre Beethoven de Bourdelle dans la pénombre verte de l’antichambre végétal, puis le Verlaine non moins renfrogné émergeant un peu plus loin de mornes fleurs, j’observe longuement la souple, lente, muette gesticulation de quatre adeptes du taï-chi et de leur jeune maître chinois tout de noir vêtu, puis j’avise, tout à côté, la Tonnelle Rolls qu’on vient d’installer là, reproduisant, en bois et au format, une Silver Ghost conçue par l’artiste Dimitri Tsykalov et réalisée par le menuisier Boulanger, selon le projet de celui-là de xylophiliser le monde des machines en le ramenant à la nature. Des fleurs, du lierre, des verdures de toute sorte vont proliférer sur la carène de bois de la Rolls et demain l’automobile disparaîtra sous les follicules et les corolles. Top de la créativité, budgétisé à l’avenant, sponsors cités…
Le Luxembourg le matin est une oasis de vitalité radieuse. Tout le monde y court sans considération d’âge. Une très vieille Chinoise vêtue de vert s’y exerce, en compagnie d’un tout jeune Occidental glabre au jeu du sabre de fer blanc ponctué de cris rauques. Un peu plus loin, devant la statue de Blanche de Castille, décédée en 1252 (sa date de naissance a été effacée), une autre très vieille dame, plutôt Américaine d’allure, se livre elle aussi à une gestuelle méditative.
On est là comme hors du monde, au milieu de ces figures de pierre de cette nature et de ces innocentes personnes, et pourtant un peu plus loin, aux grilles du Jardin donnant sur le boulevard, ont été accrochées de grandes photographies, à l’occasion de 30 ans de Reporters sans frontières, qui nous ramènent aux convulsions du XXe siècle.
La première à me frapper est cette image de Marc Riboud datant de mai 68 et représentant un front de manifestants, drôlement allurés pour certains et brandissant des couvercles de poubelles en guise de boucliers, face à un seul flic casqué. Cela me rappelle notre équipée de camarades, débarqués aux petites aubes en caravane de 2CV avec notre stock de plasma sanguin destiné aux victimes des forces policières.
Comme si c’était d’hier, je me rappelle mon immédiate perplexité devant le déferlement de rhétorique selon laquelle la Révolution était bel et bien accomplie, après laquelle rien ne serait plus jamais comme avant. Or j’avais beau participer, apparemment, à l’élan général: en mon for intérieur notre vieil atavisme terrien me faisait regimber, tout comme regimbe le protagoniste de Ramuz, dans Vie de Samuel Belet, quand son ami le communard l’enjoint de rallier les insurgés.Et d’autres images du siècle se succèdent, devant lesquelles je passe en visant le petit faune de bronze à la danse comme en suspens, dont je note au passage que c’est une copie italienne d’une statue de Pompéi: telle étant la danse de l’humanité sur le volcan de la planète, soudain résumée par ces instantanés de la guerre au Congo ou du Front populaire, des foules en guerre ou des foules en fête, du fameux poulbot à baguette parisienne de Willy Ronis ou de ce gosse au cerf-volant sur un terrain vague de la bande de Gaza - enfin de tant de drames qui perdurent aux quatre vents tandis que je continue de flâner dans le soleil candide.
ROMAIN GARY. - Il y avait des nuées noires, ce matin à cinq heures, montant comme des spectres dansants de la cuve argentée du lac, et tandis que je buvais mon café le titre de ce livre en épreuves non corrigées que m’a envoyé Christian Bourgois a retenu mon attention: La fin de l’impossible. Trois heures plus tard, dans le train longeant les eaux étales sous le ciel bas, j’ai commencé de lire ce nouveau livre à paraître du philosophe Paul Audi qui se donne aussitôt comme un acte de reconnaissance aux «alliés» occultes que sont pour nous certains écrivains ou certains artistes accordés à «l’étrange acoustique du monde spirituel» dont parle Kierkegaard.
Tout de suite j’avais été mis en confiance, ou plutôt en consonance avec la voix de l’auteur et intrigué, touché, réellement ému par la façon d’emblée d’annoncer le besoin d’une «explication avec la vie» passant non par un système ou une doctrine mais par l’expérience d’un écrivain rompant avec le «Moi-même moi-mêmisant», pour embrasser «le Tout de la vie», à savoir Romain Gary, Romain Gary que j’ai peu lu jusque-là, Romain Gary à côté duquel j’ai passé, Romain Gary dont Nancy Huston me disait elle aussi l’importance, Romain Gary qui écrit «j’attends la fin de l’impossible», Romain Gary l’écrivain que Paul Audi, se réclamant de Chestov que j’ai tant fréquenté et aimé, présente comme celui qui l’aide à lutter contre les évidences pour conjurer l’impossible dans nos têtes, l’impossible verrouillé par l’idéologie et la morale, l’impossible verrouillé par les lois de la nature, l’impossible que Chestov le philosophe espérait conjurer avec l’aide de l’écrivain Dostoïevski.
C’était le matin, j’allais à la rédaction, j’entendais cette voix à travers «l’étrange acoustique du monde spirituel», les gens dans le train me semblaient plus beaux, ces mots me parlaient: «Toute la force de l’œuvre de Gary vient de ce qu’il a cherché, sans relâche mais sans non plus se faire d’illusion, à contredire la sagesse de l’Homme manqué. Constamment, derrière les mots, sinon entre les lignes, tous ses romans laissent entendre le cri de l’enfant qui n’est pas encore déçu – ou celui de l’homme mûr qui refuse de comprendre».
Et du même coup j’entrevoyais de nouveaux livres à lire, peut-être un nouvel interlocuteur longtemps inaperçu, et me voici ce soir commençant de lire L’angoisse du roi Salomon tandis que l’ombre se fait sur la montagne…(A La Désirade, ce mercredi 3 août)
BALEINE AU MONT-BLANC. - L’air avait une acuité de cristal, ce matin sur les crêtes dominant la vallée de Chamonix, mille mètres plus bas, face au Mont-Blanc dont la calotte étincelait sous le premiers rayons, et je me suis dit que non: que la première métaphore de Baleine ne collait pas, quand Paul Gadenne parle d’une carrière de marbre à propos de l’animal échoué sur le rivage, et qu’un autre ensuite le compare à une montagne de neige; mais non, le Mont-Blanc n’a rien d’une baleine échouée au bord du ciel, me disais-je en visant le cairn du col du Brévent, et d’ailleurs j’avais pris le petit livre dans mon sac avec l’intention d’en achever la lecture quelque part sur ces hauts gazons exhalant les parfums d’orchis et de gentianes, et c’était cela même me disais-je: l’odeur de la baleine change tout lorsque Pierre et Odile s’en approchent.
C’est le miracle de la lecture de se faire de nouveaux amis en moins de deux, ou de se rappeler soudain ceux qu’on avait oubliés. Car je connaissais Pierre et Odile depuis de longues années, pour avoir déjà lu Baleine, cette nouvelle de Paul Gadenne comptant à peine trente pages, rééditée il y a quelque temps et que j’ai relue avec l’impression de la redécouvrir plus physiquement que la première fois, par le seul fait qu’on ne lit pas, à passé cinquante ans, un texte évoquant la mort comme on le lit à vingt ans.
De fait Baleine, décrivant le cadavre d’une baleine en train de se décomposer sur une grève, est plus qu’un texte symbolique: une espèce de poème métaphysique que vivent deux jeunes gens élégants, juste un peu moins frivoles que les autres, Pierre et Odile qui étaient avec moi cet après-midi dans les rhododendrons des abords du refuge Bel-Lachat quand j’ai ressorti l’opuscule.
La prose de Gadenne est d’une parfaite économie. Sa façon de décrire la féerique bidoche du cétacé aux soieries pourrissantes nous trouble et nous enchante à la fois, comme fascinés par cette grosse fleur puante, mais non pas exactement fleur: animale créature à laquelle nous nous identifions Dieu sait pourquoi, à croire que la baleine nous rappelle notre mère ou des voyages antérieurs, peu importe – cette façon légère et fulgurante me semble la littérature même, qui ramasse en quelque pages toutes nos questions et tous nos vertiges, l’horreur et la splendeur.
NOSTALGIE. - En voyant apparaître les aiguilles de Chamonix, ce matin au col des Montets, une bouffée d’émotion m’a fait vaciller au souvenir de tant d’équipées de notre bon jeune temps, puis je me suis rappelé notre dernière course avec mon ami Reynald, sur l’arête Midi-Plan, et sa mort dans la face nord du Mont Dolent, une semaine après, il y aura juste 20 ans le 15 août prochain, un pas la vie, un pas la mort…
(Chamonix, ce 5 août)
L’agression faite au silence est plus grave qu’on ne saurait dire.Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu. Mais comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi : Il se fait tard, de plus en plus tard...
-
Haro sur les délirants !
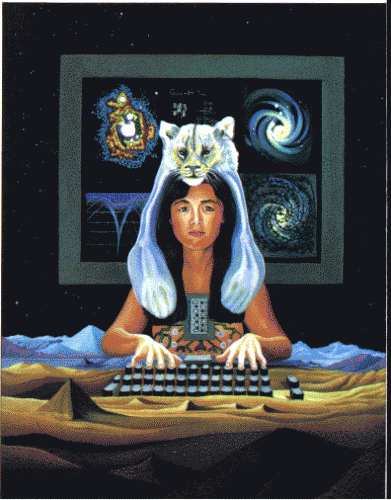
Quand Jean-Francois Braunstein éreinte les gourous du politiquement correct...
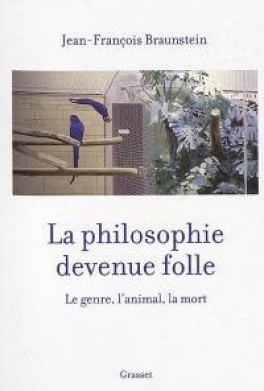 Prof à la Sorbonne, l'auteur de La philosophie devenue folle a lu à fond les idéologues anglo-saxons foldingues représentant un prétendu progressisme – théoriciens du genre, « animalitaires » et eugénistes -, pour mieux en fustiger l’aberrante régression. Son livre très documenté suscite autant l’effroi que le rire et la révolte, avant d’en appeler à une plus amicale sagesse…
Prof à la Sorbonne, l'auteur de La philosophie devenue folle a lu à fond les idéologues anglo-saxons foldingues représentant un prétendu progressisme – théoriciens du genre, « animalitaires » et eugénistes -, pour mieux en fustiger l’aberrante régression. Son livre très documenté suscite autant l’effroi que le rire et la révolte, avant d’en appeler à une plus amicale sagesse…Vous pensez encore, vieilles peaux, que le sexe biologique distingue chattes et matous autant que mecs et nanas ? Vous vous croyez d’une espèce si différente de celles de vos chiens et chèvres que vous vous retenez de forniquer avec elles ? Vous sacralisez la vie humaine au point de discuter du droit d’en disposer à son gré ! Mais dans quel monde vivez-vous donc ? N’avez-vous pas compris qu’il est temps d’en changer ?
C’est du moins à quoi, dans les grandes largeurs d’une croissante ouverture à l’indifférencitation généralisée, en appellent certains idéologues d’une mouvance très influente dans une partie significative de la communauté universitaire surtout américaine, mais pas que.
La visée globale de cette nouvelle «philosophie» est de niveler toutes les frontières entre catégories sexuelles humaines et entre espèces vivantes également «sensibles», de briser tous les tabous liés (notamment) à l’inceste, à la pédophilie, à la zoophilie, au respect des handicapés en particulier ou plus généralement à l’élimination des individus jugés indignes de vivre par les «experts», dans la perspective d’une vie plus dignement jouissive pour tous les individus voués au même compost égalitaire final. Fariboles d’ados surexcités par trop de séries pseudo-futuristes brassant fantasmes et fumisterie ? Absolument pas: théories étayées au plus haut niveau académique par des pontes et pontesses bien établis dans leurs chaires – manquant terriblement de chair hélas -, dont les thèses et les livres à succès ont fait le tour du monde.
Si vous n’avez pas encore entendu parler des très célèbres John Money, Judith Butler, Donna Haraway et Peter Singer, pour ne citer que cet inénarrable quatuor de gourous avérés, c’est le moment de sortir de votre trou quitte à crier «pouce» dans la foulée !
Quand la Sorbonne se la joue Rabelais...
Chacune et chacun, dans la multitude de cette nouvelle abbaye de Thélème virtuelle que figure le Réseau mondial, se rappelle la virulente pétulance avec laquelle un certain Alcofribas Nasier - dit aussi François Rabelais dans les dictionnaires -, fustigea les doctes pédantissimes de la sorbonnicole et sorbonnagre Sorbonne en son Tiers livre, et c’est donc avec un clin d’oeil qu’il faut saluer l’apparition, en la même Sorbonne, d’un émule de l’abbé fripon, en tout cas pour l’esprit, et le remercier d’avoir, tel le routier sympa, roulé pour nous sur les autoroutes de la connaissance.
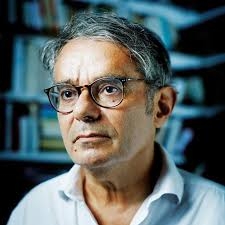
Grâce à lui, c’est en effet une véritable somme de savoir tout frais que nous trouvons dans La Philosophie devenue folle, livrée en langage limpide et souvent relevée de fine ironie ou de bonne fureur. Nul besoin d’avoir un diplôme de philo pour apprécier cet ouvrage salubre frappé au sceau du sens commun, aboutissant à la conclusion que chacune et chacun, au fond, sait ou sent de longue date ce qui est «décent» et ce qui ne l’est pas, quoi qu’elle ou il fasse «de ça».
Mais venons-en au sujet. Qu’est donc cette «folie» pointée par Jean-François Braunstein ? N’est-il pas légitime de remettre en cause les classifications rigides liées à la définition des sexes, après qu’on a laissé tomber le critère de race ? Et comment s’opposer aux défenseurs de la cause animale ? Pourquoi ne pas envisager une légalisation de l’euthanasie ? Une question subsidiaire se pose cependant, et c'est jusqu'à quelle limite et quelles conséquences on efface, précisément, toute limite ?

Exemples à l’appui, Jean-François Braunstein montre alors comment, à partir d’interrogations légitimes et de remises en question en phase avec l’émancipation des moeurs, à la bascule des années 60-70 du XXe siècle, et principalement en Occident, des intellectuels plus ou moins éminents et typiques de l’esprit libertaire de cette époque en sont arrivés à des théories et, parfois, des pratiques effarantes, voire effrayantes.
Un tétramorphe de jobardise
Le premier exemple est celui du psychologue-sexologue John Money, fondateur de la théorie du genre, pour qui l’orientation sexuelle n’a pas de base innée mais relève de la «construction» culturelle. Fondant ses thèses sur l’observation et le «suivi» médical (alors même qu’il n’avait aucune formation spécifique reconnue) de sujets hermaphrodites, Money s’est rendu célèbre en «parrainant» deux jumeaux devenus tristement célèbres à la suite du suicide de celui qui, prénommé David, atteint d’une malformation, fut poussé de force par Money à endosser le rôle d’une fille, hormones et pressions psychologique multiples à l'appui, chirurgie comprise, pour prouver que le genre «choisi» prévalait sur un instinct sexuel inné, l'expérience ratée préludant à d'autres désastres.
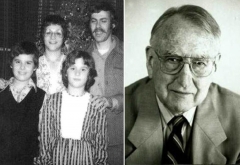
D’abord auréolé de gloire, et jamais revenu sur sa théorie en dépit de la faillite de ses applications, Peter Money alla beaucoup plus loin dans l'abjection en se faisant le chantre «scientifique» de la pédophilie «douce» ou de l’inceste «consenti», avant de perdre tout crédit public.
Cela étant, tout en critiquant ce «pittoresque» charlatan porté, par ailleurs, sur la thérapie de groupe sous forme d’orgies conviviales, une figure plus sévère de la théorie du genre, en la personne de Judith Butler, allait pousser encore plus loin la mise en pièces de la différenciation sexuelle avant d’en arriver à nier même la matérialité du corps, celui-ci n’étant que le résultat de tous les «discours sur le corps» découlant de notre culture et de notre éducation, etc.

Il vaut la peine, à propos de cette immatérielle prêtresse fort en cour dans les hautes sphères de l’université, de jeter un coup d’œil sur ses écrits, dont l’illisible lourdeur et la prétention pseudo-savante eût fait la double joie de Rabelais et de Molière !

Pour détendre l’atmosphère, ensuite, un cinq-à-sept avec Donna Haraway et sa chienne Mademoiselle Cayenne Pepper s’impose, à égale distance entre les lointains cosmiques très new age d’une rêverie dissolvant tous nos corps et leurs attributs dans une sorte de salive échangiste dont la finalité sera d’arroser le compost idéal où, frères et sœurs, nous retournerons la bouche pleine de terre, etc.
 Mais le summum est encore à venir avec la quatrième incarnation de ce tétramorphe du délire pseudo-philosophique avec Peter Singer, parti de la défense combien louable des grands singes pour devenir une référence mondiale des «animalitaires», avant d'accentuer, de plus en plus, la confusion entre l’homme et l’animal dont les souffrances, éminemment égales, l’inciteront non seulement à une conception de l’euthanasie proche des « hygiénistes » nazis de la meilleure époque, mais à une nouvelle pratique de l’infanticide qui devrait, évidemment, régler bien des problèmes auxquels sont confrontés les parents d’enfants malformés ou déficients, sans parler de régulation démographique à grande échelle et, en attendant le Super Cyborg, la nationalisation des organes prélevés sur les vivants inutiles au profit des battants à réparer, etc.
Mais le summum est encore à venir avec la quatrième incarnation de ce tétramorphe du délire pseudo-philosophique avec Peter Singer, parti de la défense combien louable des grands singes pour devenir une référence mondiale des «animalitaires», avant d'accentuer, de plus en plus, la confusion entre l’homme et l’animal dont les souffrances, éminemment égales, l’inciteront non seulement à une conception de l’euthanasie proche des « hygiénistes » nazis de la meilleure époque, mais à une nouvelle pratique de l’infanticide qui devrait, évidemment, régler bien des problèmes auxquels sont confrontés les parents d’enfants malformés ou déficients, sans parler de régulation démographique à grande échelle et, en attendant le Super Cyborg, la nationalisation des organes prélevés sur les vivants inutiles au profit des battants à réparer, etc. Cette vieille guenille de l’Homme Nouveau…
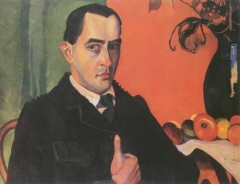 Il y a un peu moins d’un siècle de ça, un génie polymorphe polonais, à la fois peintre, dramaturge, romancier et philosophe, du nom de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, publia un roman prémonitoire intitulé L’Inassouvissement dans lequel, sur fond de société massifiée, un parti dit nivelliste se partageait les faveurs de la multitude avec les adeptes d’une secte orientalisante genre Moon. La notion de «folie ordinaire» y était omniprésente, dans le sillage des prédictions sur le Nouvel Homme esquissées par Dostoïesvski et Nietzsche, une décennie avant celles de l’emblématique 1984 d’Orwell, cité à la fin de l’essai de Jean-François Braunstein.
Il y a un peu moins d’un siècle de ça, un génie polymorphe polonais, à la fois peintre, dramaturge, romancier et philosophe, du nom de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, publia un roman prémonitoire intitulé L’Inassouvissement dans lequel, sur fond de société massifiée, un parti dit nivelliste se partageait les faveurs de la multitude avec les adeptes d’une secte orientalisante genre Moon. La notion de «folie ordinaire» y était omniprésente, dans le sillage des prédictions sur le Nouvel Homme esquissées par Dostoïesvski et Nietzsche, une décennie avant celles de l’emblématique 1984 d’Orwell, cité à la fin de l’essai de Jean-François Braunstein. Or c’est le mérite particulier de celui-ci d’amorcer son tour d’horizon de la «philosophie devenue folle», qui englobe bien d’autres « followers » des idéologues cités plus haut, en citant des auteurs dont les écrits s’opposaient explicitement à ce nivellement généralisé, à commencer par Philippe Muray et Michel Houellebecq.
Dans sa conclusion tout à fait explicite, Jean-François Braunstein, se démarque de ceux qui, trop frileusement, assimilent identité et fermeture ou excluent tout débat (notamment sur les « études genres » ou « queer », etc.) en rappelant que « ce sont justement les limites et les frontières qui constituent des identités multiples et permettent de les faire évoluer ».
La façon pathétique des pseudo-scientifiques (dont une Donna Haraway ou une Anne Fausto-Sterling) de s’en prendre au «virilisme» des sciences dites dures, de la biologie à l’immunologie, pour esquiver les faits trop têtus à leurs yeux, comme au temps de la biologie stalinienne promettant au bon peuple quatre printemps par année, va de pair avec l’enfumage idéologique propre à tous les fantasmes et défiant toute contradiction de bonne foi.
«S’il y a des limites, conclut ainsi l’auteur de La philosophie devenue folle, c’est aussi pour qu’elle puissent être dépassées, mises en question, subverties. Mais il ne s’agit en aucun cas de les effacer. Une frontière permet de vivre en paix de tel ou tel côté, mais aussi de rêver à ce qu’il y a de l’autre côté de la frontière, de la franchir, légalement ou non, et de devenir autre à travers ce passage, ce sont les frontières qui préservent cette diversité qui fait la beauté du monde, qu’il soit humain ou animal. Au contraire, pour la pensée politiquement correcte, la diversité est d’autant plus célébrée qu’elle est niée dans une recherche pathétique du même qui aboutit à plaquer sur la vie animale les exigences d’universitaires américains totalement déconnectée de la réalité. (…) C’est dans cette confrontation à l’altérité, à la négativité, que l’homme prend conscience de lui-même. (…) Il sait qu’il n’est pas un pur esprit, qu’il est indissolublement lié à son corps. Maladies et mort font donc partie de la vie de l’homme, , mais il les combat sans relâche par la science et la médecine qui est, comme disait Foucault, la « forme armée de notre finitude ». Cet homme-là est un être qui affronte le monde pour en repousser les limites. Là est son bonheur, là est ce qui donne un sens à sa vie ».
Jean-François Braunstein. La philosophie devenue folle. Le genre, l’animal, la mort. Grasset, 393p. Paris, 2018.
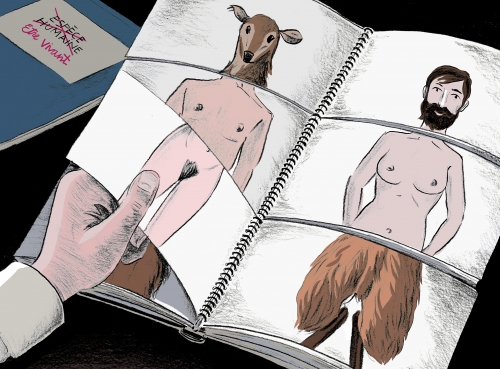 (Dessin de Matthias Rihs. ©Rhis/BPLT)
(Dessin de Matthias Rihs. ©Rhis/BPLT) -
La mort, ma mort...
 (Le Temps accordé, Lectures du monde 2022)À l’hosto, ce jeudi 3 novembre. – Après mon évocation quelque peu taquine de l’usine à soins, tôt ce matin, qui m’a valu pas mal de retours sur Facebook, je me retrouve dans ma chambre à 5 étoiles – alors que je n’ai même pas d’assurance privée…- de la division Fleurs, où le médecin compte me garder jusqu’à demain si mon état encore très flageolant n'en exige pas plus..Passé tout à l’heure à la boutique de l’établissement où j’espérais trouver le moindre livre, j’ai dû déchanter : tintin, rien que des magazines et autres journaux bas de gamme (style Closer ou Détective), avec la seule exception d’une revue de vulgarisation scientifique, intitulée La Recherche et toute consacrée au Réel, et deux livraisons du Courrier international traitant de la bombe démographique et de l’effervescence culturelle de la Corée du sud, laquelle m’intéresse particulièrement après ma découverte, ces derniers mois, d’une vingtaine de séries de qualité.Quant à l’approche du «Réel » par cette revue spécialisée dont le langage me semble immédiatement accessible, alors que je suis un ignare pitoyable en la matière, elle m’intéresse ces jours après la lecture de La Théorie des cordes, ce roman de José Carlos Somoza que m’a offert notre fille licenciées en lettres hispaniques, dont la partie dévolue aux recherches d’un groupe de physiciens sur la possibilité d’ « ouvrir les cordes du temps » et d’obtenir ainsi des images datant de millénaires, m’a passionné, avant que la narration ne se perde, m’a-t-il semblé, dans l’embrouillamini d’une intrigue à base complotiste accumulant crimes et suicides...Même sans avoir le livre sous la main, j’ai esquissé hier soir, après une minute à subir à la télé l’effrayante présence de Cyril Hanouna, parangon de la basse vulgarité et de la crétinerie, une prochaine chronique sur BPLT du superbe roman de Giuliano da Empoli intitulé Le Mage du Kremlin et qui vient d’être couronné par l’Académie française (dame Carrère d’Encausse doit y être pour quelque chose), dont j’ai longuement parlé au téléphone avec mon ami Nicolas le Greco en lui disant que, plus qu’un livre « sur Poutine », il s’agit là d’une vaste projection des visions futuristes de Zamiatine, Orwell et Witkiewicz, très riche en observations sur l’évolution actuelle de nos sociétés capitalistico-communistes (Zinoviev me disait que la société de consommation lui apparaissait comme une forme particulièrement perverse de soft collectivisme), avec un dénouement qui assimile pour ainsi dire les oligarchies parvenues du post-soviétisme et de la Silicon Valley…Tout à l’heure je suis retombé, en consutant mon historique de Messenger, à l’époque d e mon premier infarctus (mi-décembre 2019) sur un message de Roland Jaccard qui se disait « fasciné » par mon « reportage en immersion hospitalière », évoquant en outre nos téléphones quasi quotidiens, avec Pierre-Guillaume, qui lui donnait ainsi de mes nouvelles – deux amis repris depuis lors par celle que Lady L. appelait la « Dame en noir »...Ce qui me rappelle aussitôt les mots de Thierry Vernet dans ses carnets à lui : « La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement »...Aquarelle: Thierry Vernet, Conversation nocturne.
(Le Temps accordé, Lectures du monde 2022)À l’hosto, ce jeudi 3 novembre. – Après mon évocation quelque peu taquine de l’usine à soins, tôt ce matin, qui m’a valu pas mal de retours sur Facebook, je me retrouve dans ma chambre à 5 étoiles – alors que je n’ai même pas d’assurance privée…- de la division Fleurs, où le médecin compte me garder jusqu’à demain si mon état encore très flageolant n'en exige pas plus..Passé tout à l’heure à la boutique de l’établissement où j’espérais trouver le moindre livre, j’ai dû déchanter : tintin, rien que des magazines et autres journaux bas de gamme (style Closer ou Détective), avec la seule exception d’une revue de vulgarisation scientifique, intitulée La Recherche et toute consacrée au Réel, et deux livraisons du Courrier international traitant de la bombe démographique et de l’effervescence culturelle de la Corée du sud, laquelle m’intéresse particulièrement après ma découverte, ces derniers mois, d’une vingtaine de séries de qualité.Quant à l’approche du «Réel » par cette revue spécialisée dont le langage me semble immédiatement accessible, alors que je suis un ignare pitoyable en la matière, elle m’intéresse ces jours après la lecture de La Théorie des cordes, ce roman de José Carlos Somoza que m’a offert notre fille licenciées en lettres hispaniques, dont la partie dévolue aux recherches d’un groupe de physiciens sur la possibilité d’ « ouvrir les cordes du temps » et d’obtenir ainsi des images datant de millénaires, m’a passionné, avant que la narration ne se perde, m’a-t-il semblé, dans l’embrouillamini d’une intrigue à base complotiste accumulant crimes et suicides...Même sans avoir le livre sous la main, j’ai esquissé hier soir, après une minute à subir à la télé l’effrayante présence de Cyril Hanouna, parangon de la basse vulgarité et de la crétinerie, une prochaine chronique sur BPLT du superbe roman de Giuliano da Empoli intitulé Le Mage du Kremlin et qui vient d’être couronné par l’Académie française (dame Carrère d’Encausse doit y être pour quelque chose), dont j’ai longuement parlé au téléphone avec mon ami Nicolas le Greco en lui disant que, plus qu’un livre « sur Poutine », il s’agit là d’une vaste projection des visions futuristes de Zamiatine, Orwell et Witkiewicz, très riche en observations sur l’évolution actuelle de nos sociétés capitalistico-communistes (Zinoviev me disait que la société de consommation lui apparaissait comme une forme particulièrement perverse de soft collectivisme), avec un dénouement qui assimile pour ainsi dire les oligarchies parvenues du post-soviétisme et de la Silicon Valley…Tout à l’heure je suis retombé, en consutant mon historique de Messenger, à l’époque d e mon premier infarctus (mi-décembre 2019) sur un message de Roland Jaccard qui se disait « fasciné » par mon « reportage en immersion hospitalière », évoquant en outre nos téléphones quasi quotidiens, avec Pierre-Guillaume, qui lui donnait ainsi de mes nouvelles – deux amis repris depuis lors par celle que Lady L. appelait la « Dame en noir »...Ce qui me rappelle aussitôt les mots de Thierry Vernet dans ses carnets à lui : « La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement »...Aquarelle: Thierry Vernet, Conversation nocturne. -
Si vous rêvez de Tombouctou, c'est en vous que gît le trésor
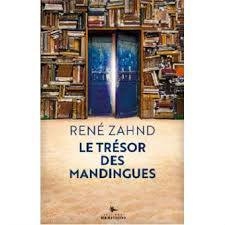
 Ravivant la fraîcheur de nos lectures de jeunesse, avec le supplément d’âme de la maturité, le nouveau roman « africain » de René Zahnd, Le Trésor des Mandingues, nous entraîne dans un périple à double valeur d’hymne à l’amitié, ponctué de belles rencontres humaines, et d’exploration sur le terrain et par l’écrit d’une Afrique méconnue dont le parcours relève de la quête initiatique, sous le patronage occulte de Blaise Cendrars ...Les ruptures ont parfois du bon. Tu te fais larguer et c’est peut-être bien fait, ça te pendait au nez te dit ton compère François qui a toujours le mot pour encourager : tu avais le fil à ta Pat, croit-il malin d’ajouter avant de t’allonger d’autres calembredaines débiles , et patati et patatras – mais tourne donc la page mon poteau, te serine-t-il sévère et facétieux, et c’est parti pour une autre vie n’importe où mais loin de cette « affaire » de Patricia, et pourquoi pas Venise ?Cinq pages plus loin, puisque c’est le début d’un roman dont le titre du premier chapitre annonce la situation « au 36e dessous » et démarre avec une exclamation amicalement indignée dudit François, « Ce n’est plus du chagrin, c’est de la misère », le Narrateur, qu’on pourrait prénommer René tant il évoque l’auteur par divers traits psychologiques, à part sa passion avérée pour l’Afrique et ses connaissances de naturaliste – mais on évitera de l’associer trop précisément à la cata sentimentale du moment – se retrouve donc bel et bien à traîner son spleen dans la lagune, quand, en quête d’un cadeau à ramener à son compère François, le hasard lui fait pousser la porte d’une bouquinerie francophone tenue par un vieil Africain qui, à l’évocation du nom de Cendrars, lui propose, fin lettré, l’acquisition du Latin mystique de Rémy de Gourmont, dont chacune et chacun se rappelle l’intérêt que le cher Blaise portait à son œuvre de grand érudit, avant de lui offrir, en bonus, la première édition de l’Anthologie nègre du même bourlingueur assortie d’une dédicace manuscrite à un certain M. P. , « dans les secrets partagés des montagnes d’or et des remous de Boussa »...Or le compère François aura tôt fait d’identifier ce mystérieux M.P. en la personne d’un certain médecin écossais du nom de Mungo Park, devenu explorateur des régions encore peu connues de l’Afrique de l’Ouest – l’époque où l’on ne savait même pas dans quel sens coulait vraiment le Niger -, et là le roman va vraiment démarrer à l’initiative dynamique du même François qui pousse son ami à sonder de plus près le mystère de ces « montagnes d’or » tout en se défilant, lui, au dernier moment, pour enquêter plutôt sur Internet…Une exploration à deux « vitesses »Quand tel ou tel importun lui demandait s’il avait vraiment pris le Transsibérien, qu’il évoque dans sa célèbre Prose à l’irrésistible tagadam poétique, Cendrars répondait invariablement : et quelle importance que je l’ai pris ou non si mon poème vous l’a fait prendre ? Et l’on sourira, dans la foulée, en se rappelant que le même Blaise, auteur d’une non moins fameuse Anthologie nègre, n’a jamais mis les pieds en Afrique, si l’on excepte une brève escale à Dakar, alors que René Zahnd y a bel et bien crapahuté moult fois, y recueillant autant de sensations et d’observations de toutes espèces (régurgitées à foison dans son roman) que d’anecdotes et autres tournures de langage « tout bien » captées à l’oral quotidien.Cela précisé pour indiquer la double voie du récit déployé par Le Trésor des Mandingues, sur le terrain, entre Bamako et le pays Dogon, via Tombouctou la mystérieuse, où le jeu de pistes tiendra souvent de la course d’obstacles carabinée, et l’exploration « livresque », à laquelle participe l’ami resté devant son ordi, lestée d’innombrables et précieux détails enrichissant notre connaissance de l’Afrique sans pesanteur académique ni pédantisme.Sur une de ces voies, nous ferons la rencontre « incarnée » de deux jeunes filles – une Africaine au prénom de Rokia et Cathy la sémillante ethnologue française – toutes deux ferrées en matière d’anthropologie - jusqu’aux aspects très politisés de la « question noire » - alors que la bibliographie en fin de volume cite une trentaine d’ouvrage qui ont accompagné l’auteur dans la composition de son roman. À la même enseigne « dualiste », l’on relèvera l’alternance très « physique» du récit à ras le quotidien poussiéreux et son épique relance de lieu en lieu, ponctué de dialogues savoureux entre les deux lascars (on skype n’importe où par les temps qui courent), et maintes inflexions plus méditatives de l’ « aventurier mélancolique » que figure le Narrateur, qui nourrissent un véritable parcours initiatique à l’africaine, ponctué de force sages sentences, entre autres formules drolatiques. Tel vieux sage aveugle dira ainsi : « La paroles est la reine de la connaissance. Mais la parole est aussi la reine du mensonge et la reine des secrets ». Et telle Mobylette garée sur la rue portera cette maxime avec sa gouaille populaire : « Le crayon de Dieu n’a pas de gomme »…Enfin la lumière éblouissante du jour, et combien de sonores éclats de rire, iront de pair avec un jeu d’ombres plus inquiétantes liées à la part maléfique de la nature humaine, où l’on verra que les pillards blancs d’hier ressortissent à la même crapule que les tueurs d’aujourd’hui se réclamant du Djihad…Le trésor de l’humaine bontéPour beaucoup d’enfants de tous les âges et d’un peu partout, L’Île au trésor reste l’un des plus beaux livres qui soient, et le lecteur du Trésor des Mandingues ne cesse évidemment d’espérer en savoir plus à propos des « montagnes d’or » évoquées par Cendrars , cher menteur et mentor du non moins cher François, lequel est peut-être le véritable auteur du roman – tels étant les deux lascars férus de farces et attrapes narratives.Dans la foulée du roman, ainsi, l’on apprendre que les initiales du fameux M. P. ne sont peut-être pas celles de Mungo Park mais désignaient un certain Mathieu Portalban, négociant en art nègre que ses menées de pillard ont fait détester des indigènes mais que Cendrars eût pu rencontrer de son vivant; et ce n’est qu’une incertitude de plus ajoutée au mystère de la mort de Mungo Park et à la réalité du trésor peut-être enfoui dans les montagnes de l’Adrar des Ifoghas, d’où le Narrateur candide devra se faire exfiltrer en hélico pour cause de danger djihadiste très actuel…Au jeu du « romanesque », nous avalerons jusqu’à ces péripéties de thriller ou de série télévisée, mais l’enjeu du Trésor des Mandingues est ailleurs, et plus précisément dans le constat du hogon, maître spirituel des Dogons, qui déclare comme ça au Narrateur, sans le connaître que par son intuition supérieure : « Vous êtes un homme bon. Vous avez le ventre clair ». Et de fait, malgré ses tribulations et ses galères, celui qui écrit (qu’il se prénomme François ou René) se révèle notre ami en manifestant son amitié aux multiples beaux personnages qu’il rencontre, jusqu’à ce jeune garçon au prénom de Djibril, fan de foot et rêvant d’être la future star des stade du Mali, au père duquel il promet de payer son écolage…Tu ne sais sûrement pas plus que moi, camarade ce qu’est le « ventre clair ». Un jour tu m’as raconté que, tout nu sur ton lit d’hôpital, entortillé dans les tuyaux de ta survie médicale, en prise avec le Crabe pire que les essaims d’abeilles de Djenné, tu as décidé de vivre. Ce que tu rappelles à la fin de ton superbe roman par la voix de Sid Omar, parce « qu’il n’y a pas de trésor plus grand que la vie, et l’harmonie qu’on peut y trouver ». Poil au nez…René Zahnd. Le Trésor des Mandingues. Editions Herodios, 2024, 327p.
Ravivant la fraîcheur de nos lectures de jeunesse, avec le supplément d’âme de la maturité, le nouveau roman « africain » de René Zahnd, Le Trésor des Mandingues, nous entraîne dans un périple à double valeur d’hymne à l’amitié, ponctué de belles rencontres humaines, et d’exploration sur le terrain et par l’écrit d’une Afrique méconnue dont le parcours relève de la quête initiatique, sous le patronage occulte de Blaise Cendrars ...Les ruptures ont parfois du bon. Tu te fais larguer et c’est peut-être bien fait, ça te pendait au nez te dit ton compère François qui a toujours le mot pour encourager : tu avais le fil à ta Pat, croit-il malin d’ajouter avant de t’allonger d’autres calembredaines débiles , et patati et patatras – mais tourne donc la page mon poteau, te serine-t-il sévère et facétieux, et c’est parti pour une autre vie n’importe où mais loin de cette « affaire » de Patricia, et pourquoi pas Venise ?Cinq pages plus loin, puisque c’est le début d’un roman dont le titre du premier chapitre annonce la situation « au 36e dessous » et démarre avec une exclamation amicalement indignée dudit François, « Ce n’est plus du chagrin, c’est de la misère », le Narrateur, qu’on pourrait prénommer René tant il évoque l’auteur par divers traits psychologiques, à part sa passion avérée pour l’Afrique et ses connaissances de naturaliste – mais on évitera de l’associer trop précisément à la cata sentimentale du moment – se retrouve donc bel et bien à traîner son spleen dans la lagune, quand, en quête d’un cadeau à ramener à son compère François, le hasard lui fait pousser la porte d’une bouquinerie francophone tenue par un vieil Africain qui, à l’évocation du nom de Cendrars, lui propose, fin lettré, l’acquisition du Latin mystique de Rémy de Gourmont, dont chacune et chacun se rappelle l’intérêt que le cher Blaise portait à son œuvre de grand érudit, avant de lui offrir, en bonus, la première édition de l’Anthologie nègre du même bourlingueur assortie d’une dédicace manuscrite à un certain M. P. , « dans les secrets partagés des montagnes d’or et des remous de Boussa »...Or le compère François aura tôt fait d’identifier ce mystérieux M.P. en la personne d’un certain médecin écossais du nom de Mungo Park, devenu explorateur des régions encore peu connues de l’Afrique de l’Ouest – l’époque où l’on ne savait même pas dans quel sens coulait vraiment le Niger -, et là le roman va vraiment démarrer à l’initiative dynamique du même François qui pousse son ami à sonder de plus près le mystère de ces « montagnes d’or » tout en se défilant, lui, au dernier moment, pour enquêter plutôt sur Internet…Une exploration à deux « vitesses »Quand tel ou tel importun lui demandait s’il avait vraiment pris le Transsibérien, qu’il évoque dans sa célèbre Prose à l’irrésistible tagadam poétique, Cendrars répondait invariablement : et quelle importance que je l’ai pris ou non si mon poème vous l’a fait prendre ? Et l’on sourira, dans la foulée, en se rappelant que le même Blaise, auteur d’une non moins fameuse Anthologie nègre, n’a jamais mis les pieds en Afrique, si l’on excepte une brève escale à Dakar, alors que René Zahnd y a bel et bien crapahuté moult fois, y recueillant autant de sensations et d’observations de toutes espèces (régurgitées à foison dans son roman) que d’anecdotes et autres tournures de langage « tout bien » captées à l’oral quotidien.Cela précisé pour indiquer la double voie du récit déployé par Le Trésor des Mandingues, sur le terrain, entre Bamako et le pays Dogon, via Tombouctou la mystérieuse, où le jeu de pistes tiendra souvent de la course d’obstacles carabinée, et l’exploration « livresque », à laquelle participe l’ami resté devant son ordi, lestée d’innombrables et précieux détails enrichissant notre connaissance de l’Afrique sans pesanteur académique ni pédantisme.Sur une de ces voies, nous ferons la rencontre « incarnée » de deux jeunes filles – une Africaine au prénom de Rokia et Cathy la sémillante ethnologue française – toutes deux ferrées en matière d’anthropologie - jusqu’aux aspects très politisés de la « question noire » - alors que la bibliographie en fin de volume cite une trentaine d’ouvrage qui ont accompagné l’auteur dans la composition de son roman. À la même enseigne « dualiste », l’on relèvera l’alternance très « physique» du récit à ras le quotidien poussiéreux et son épique relance de lieu en lieu, ponctué de dialogues savoureux entre les deux lascars (on skype n’importe où par les temps qui courent), et maintes inflexions plus méditatives de l’ « aventurier mélancolique » que figure le Narrateur, qui nourrissent un véritable parcours initiatique à l’africaine, ponctué de force sages sentences, entre autres formules drolatiques. Tel vieux sage aveugle dira ainsi : « La paroles est la reine de la connaissance. Mais la parole est aussi la reine du mensonge et la reine des secrets ». Et telle Mobylette garée sur la rue portera cette maxime avec sa gouaille populaire : « Le crayon de Dieu n’a pas de gomme »…Enfin la lumière éblouissante du jour, et combien de sonores éclats de rire, iront de pair avec un jeu d’ombres plus inquiétantes liées à la part maléfique de la nature humaine, où l’on verra que les pillards blancs d’hier ressortissent à la même crapule que les tueurs d’aujourd’hui se réclamant du Djihad…Le trésor de l’humaine bontéPour beaucoup d’enfants de tous les âges et d’un peu partout, L’Île au trésor reste l’un des plus beaux livres qui soient, et le lecteur du Trésor des Mandingues ne cesse évidemment d’espérer en savoir plus à propos des « montagnes d’or » évoquées par Cendrars , cher menteur et mentor du non moins cher François, lequel est peut-être le véritable auteur du roman – tels étant les deux lascars férus de farces et attrapes narratives.Dans la foulée du roman, ainsi, l’on apprendre que les initiales du fameux M. P. ne sont peut-être pas celles de Mungo Park mais désignaient un certain Mathieu Portalban, négociant en art nègre que ses menées de pillard ont fait détester des indigènes mais que Cendrars eût pu rencontrer de son vivant; et ce n’est qu’une incertitude de plus ajoutée au mystère de la mort de Mungo Park et à la réalité du trésor peut-être enfoui dans les montagnes de l’Adrar des Ifoghas, d’où le Narrateur candide devra se faire exfiltrer en hélico pour cause de danger djihadiste très actuel…Au jeu du « romanesque », nous avalerons jusqu’à ces péripéties de thriller ou de série télévisée, mais l’enjeu du Trésor des Mandingues est ailleurs, et plus précisément dans le constat du hogon, maître spirituel des Dogons, qui déclare comme ça au Narrateur, sans le connaître que par son intuition supérieure : « Vous êtes un homme bon. Vous avez le ventre clair ». Et de fait, malgré ses tribulations et ses galères, celui qui écrit (qu’il se prénomme François ou René) se révèle notre ami en manifestant son amitié aux multiples beaux personnages qu’il rencontre, jusqu’à ce jeune garçon au prénom de Djibril, fan de foot et rêvant d’être la future star des stade du Mali, au père duquel il promet de payer son écolage…Tu ne sais sûrement pas plus que moi, camarade ce qu’est le « ventre clair ». Un jour tu m’as raconté que, tout nu sur ton lit d’hôpital, entortillé dans les tuyaux de ta survie médicale, en prise avec le Crabe pire que les essaims d’abeilles de Djenné, tu as décidé de vivre. Ce que tu rappelles à la fin de ton superbe roman par la voix de Sid Omar, parce « qu’il n’y a pas de trésor plus grand que la vie, et l’harmonie qu’on peut y trouver ». Poil au nez…René Zahnd. Le Trésor des Mandingues. Editions Herodios, 2024, 327p. -
Que tout est possible en ce beau monde
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce jeudi 6 juin. – Ma nouvelle chronique presque achevée, hier soir, a disparu ce matin, et je rappelle alors l’incollable J.P. pour lui demander de ses nouvelles (prétexte) et, à un moment donné, lui poser la question relative à la disparition d’un document. Est-ce possible ? Et lui de me répondre « Tout est possible en ce bas monde ». Il ne me propose pas de faire un réglage à distance, comme souvent par le passé, il se montre distant voire évasif, il m’indique juste une façon improbable de récupérer mon fichier, puis, lorsque je lui propose une revoyure prochaine, que je repousse depuis des mois, il me dit qu’il me relancera en août, étant sur le départ pour Nairobi où il va passer deux mois. Je lui demande ce qu’il va faire au Kénya. Réponse elliptique : « Travail ». J’en serais presque, égoïste que je suis, à lui reprocher de renvoyer notre revoyure à la fin de l’été, alors que c’est moi qui ne lui ai plus fait signe malgré ma promesse de le faire, et nous en restons là poliment mais sans plus, et je me dis à présent que c’est bien fait pour ma poire : c’est ma faute et pas qu’avec J.P. et je devrais réfléchir à ma façon de traiter les gens. Certes c’est le plus souvent moi qui vais vers eux et pas le contraire – c’est comme ça depuis au moins soixante ans - mais le nouveau système de relations instauré par Internet fait qu’on se voit moins en 3D et qu’on ne s’écrit plus de lettres et que donc, malgré nos centaines ou nos milliers d’amis sur Facebook (j’en ai 5000, captés d’un clic et ne signifiant donc à peu près rien sauf une petite cinquantaine), la communication réciproque régulière devient rare sauf à parler de piapia sans substance.Bref, l’inattention se développe, autant que l’incuriosité, et c’est ainsi que la solitude s’accroît dans la multitude. J.P. va partir en Afrique de l’Est alors que j’ai paumé ce matin ma chronique évoquant l’Afrique de l’Ouest, je ne sais rien de ce qu’ont fait et pensé mes 5000 amis ces derniers temps faute de m’en enquérir tous les matins, et je me répète alors gravement la citation du fameux poème de Rilke évoquant le torse d’Apollon : « Tu dois changer ta vie »…Sur quoi je me lance dans la refonte de mémoire de ma chronique, dont la nouvelle version me paraît, d'ailleurs, meilleure que la première…
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce jeudi 6 juin. – Ma nouvelle chronique presque achevée, hier soir, a disparu ce matin, et je rappelle alors l’incollable J.P. pour lui demander de ses nouvelles (prétexte) et, à un moment donné, lui poser la question relative à la disparition d’un document. Est-ce possible ? Et lui de me répondre « Tout est possible en ce bas monde ». Il ne me propose pas de faire un réglage à distance, comme souvent par le passé, il se montre distant voire évasif, il m’indique juste une façon improbable de récupérer mon fichier, puis, lorsque je lui propose une revoyure prochaine, que je repousse depuis des mois, il me dit qu’il me relancera en août, étant sur le départ pour Nairobi où il va passer deux mois. Je lui demande ce qu’il va faire au Kénya. Réponse elliptique : « Travail ». J’en serais presque, égoïste que je suis, à lui reprocher de renvoyer notre revoyure à la fin de l’été, alors que c’est moi qui ne lui ai plus fait signe malgré ma promesse de le faire, et nous en restons là poliment mais sans plus, et je me dis à présent que c’est bien fait pour ma poire : c’est ma faute et pas qu’avec J.P. et je devrais réfléchir à ma façon de traiter les gens. Certes c’est le plus souvent moi qui vais vers eux et pas le contraire – c’est comme ça depuis au moins soixante ans - mais le nouveau système de relations instauré par Internet fait qu’on se voit moins en 3D et qu’on ne s’écrit plus de lettres et que donc, malgré nos centaines ou nos milliers d’amis sur Facebook (j’en ai 5000, captés d’un clic et ne signifiant donc à peu près rien sauf une petite cinquantaine), la communication réciproque régulière devient rare sauf à parler de piapia sans substance.Bref, l’inattention se développe, autant que l’incuriosité, et c’est ainsi que la solitude s’accroît dans la multitude. J.P. va partir en Afrique de l’Est alors que j’ai paumé ce matin ma chronique évoquant l’Afrique de l’Ouest, je ne sais rien de ce qu’ont fait et pensé mes 5000 amis ces derniers temps faute de m’en enquérir tous les matins, et je me répète alors gravement la citation du fameux poème de Rilke évoquant le torse d’Apollon : « Tu dois changer ta vie »…Sur quoi je me lance dans la refonte de mémoire de ma chronique, dont la nouvelle version me paraît, d'ailleurs, meilleure que la première… COMME UN TROUBLE PASSAGER. – C’était l’autre jour à la terrasse ensoleillée, quasiment estivale, de San Stefano al Mare, je venais d’entamer un repas délicieux servi par une belle serveuse au bras tatoué d’une tête de mort fleurie, quand il/elle est apparu(e) avec son compagnon plus grand que lui (ou qu’elle) de deux têtes, tous deux debouts devant ma table en attendant de s’en voir attribuer une autre, et moi saisi comme un peut l’être devant un ange surgi, je n’exagère pas, disons un ange de la peinture italienne, et plus précisément tel ange musicien de Melozzo da Forli dont j’avais découpé l’image dans un bulletin paroissial de je ne sais plus quel bourg de Toscane, donc un ange au sexe sublimé par sa beauté androgyne, et c’était là devant moi, en jeans très larges et le col ceint d’une longue écharpe de soie orangée, il m’a aussitôt évoqué les personnages d’Endymion et d’Adonis, plutôt alors du côté de la Grèce aux garçons fessus, mais voici que le compagnon costaud l’enlaçait comme un Italien classique de la trentaine le ferait plus conventionnellement d’une ragazza lui roulant des yeux tendres, et j’en restais baba, presque scandalisé par tant de grâce naturelle dans la façon de la paire de se diriger vers la table du bout de la terrasse, sur l’indication de la serveuse au bras mortellement fleuri, bref le temps d’une fantasmagorie érotique je me suis laissé troubler ou, comme on dit, transporter aux anges…FANTAISISTE. – À ma chère Professorella, dont je lis à présent le récit de vie de haute tenue, qui requiert toute mon attention car il est rédigé en langue italienne et que je bute souvent sur tel mot ou telle expression, je disais l’autre jour que je ne me considére pas du tout comme un écrivain ou comme un poète, moins encore comme un pro de la critique littéraire (selon l’expression récente de ma libraire préférée), pas plus que je ne me situe politiquement ou sexuellement, toute qualification et détermination sociale ou psychologique me semblant une réduction alors que le terme qui me convient finalement est celui-là seul de fantaisiste, et j’y insiste de la façon la plus radicale, voire la plus orgueilleuse, en prétendant rendre au terme son aura et sa profondeur, d’accord avec Louis Forestier pour souligner la fantaisie essentielle d’un Rimbaud, et j’y ajouterai ce matin : la fantaisie à grands pieds d’elfe lourdaud d’un Walt Whitman, la fantaisie érotique et solipsiste d’un Jean Genet, la fantaisie évhémériste et musicienne d’un Charles-Albert Cingria, la fantaisie paramystique d’une Annie Dillard et d’une Flannery o’Connor, la fantaisie métaphysique et catastrophiste d’un Stanislaw Ignacy Witkiewicz, la fantaisie enfin du charmant Paul-Jean Toulet bel et bien estampillé « fantaisiste » alors qu’il déroge à toute école et auquel je m’affilie essentiellement par l’usage des contrerimes - et j’aurais pu citer Céline et Robert Walser, Thomas Bernhard et Shakespeare, Proust et Musil et cent et mille autres à la même enseigne échappant à toute définition académique comme à toute inquisition médiatique ou « policière », etc.
COMME UN TROUBLE PASSAGER. – C’était l’autre jour à la terrasse ensoleillée, quasiment estivale, de San Stefano al Mare, je venais d’entamer un repas délicieux servi par une belle serveuse au bras tatoué d’une tête de mort fleurie, quand il/elle est apparu(e) avec son compagnon plus grand que lui (ou qu’elle) de deux têtes, tous deux debouts devant ma table en attendant de s’en voir attribuer une autre, et moi saisi comme un peut l’être devant un ange surgi, je n’exagère pas, disons un ange de la peinture italienne, et plus précisément tel ange musicien de Melozzo da Forli dont j’avais découpé l’image dans un bulletin paroissial de je ne sais plus quel bourg de Toscane, donc un ange au sexe sublimé par sa beauté androgyne, et c’était là devant moi, en jeans très larges et le col ceint d’une longue écharpe de soie orangée, il m’a aussitôt évoqué les personnages d’Endymion et d’Adonis, plutôt alors du côté de la Grèce aux garçons fessus, mais voici que le compagnon costaud l’enlaçait comme un Italien classique de la trentaine le ferait plus conventionnellement d’une ragazza lui roulant des yeux tendres, et j’en restais baba, presque scandalisé par tant de grâce naturelle dans la façon de la paire de se diriger vers la table du bout de la terrasse, sur l’indication de la serveuse au bras mortellement fleuri, bref le temps d’une fantasmagorie érotique je me suis laissé troubler ou, comme on dit, transporter aux anges…FANTAISISTE. – À ma chère Professorella, dont je lis à présent le récit de vie de haute tenue, qui requiert toute mon attention car il est rédigé en langue italienne et que je bute souvent sur tel mot ou telle expression, je disais l’autre jour que je ne me considére pas du tout comme un écrivain ou comme un poète, moins encore comme un pro de la critique littéraire (selon l’expression récente de ma libraire préférée), pas plus que je ne me situe politiquement ou sexuellement, toute qualification et détermination sociale ou psychologique me semblant une réduction alors que le terme qui me convient finalement est celui-là seul de fantaisiste, et j’y insiste de la façon la plus radicale, voire la plus orgueilleuse, en prétendant rendre au terme son aura et sa profondeur, d’accord avec Louis Forestier pour souligner la fantaisie essentielle d’un Rimbaud, et j’y ajouterai ce matin : la fantaisie à grands pieds d’elfe lourdaud d’un Walt Whitman, la fantaisie érotique et solipsiste d’un Jean Genet, la fantaisie évhémériste et musicienne d’un Charles-Albert Cingria, la fantaisie paramystique d’une Annie Dillard et d’une Flannery o’Connor, la fantaisie métaphysique et catastrophiste d’un Stanislaw Ignacy Witkiewicz, la fantaisie enfin du charmant Paul-Jean Toulet bel et bien estampillé « fantaisiste » alors qu’il déroge à toute école et auquel je m’affilie essentiellement par l’usage des contrerimes - et j’aurais pu citer Céline et Robert Walser, Thomas Bernhard et Shakespeare, Proust et Musil et cent et mille autres à la même enseigne échappant à toute définition académique comme à toute inquisition médiatique ou « policière », etc. -
Le séducteur de spectres

 Découverte de Gesualdo Bufalino,par Fabio CiaralliConnaissez-vous Gesualdo Bufalino et Le Semeur de peste? Si ce n’est pas le cas, j’aimerais vous faire pénétrer dans l’œuvre de cet auteur merveilleux et vous parler de son premier roman.Gesualdo Bufalino, Sicilien de la province de Raguse – de Comiso précisément – naît en 1920 et meurt, dans la même petite ville, en 1996, au cours d’un terrible accident de voiture. Son père était un forgeron passionné par la littérature, passion qu’il réussit à transmettre à son fils au cours de soirées où ils jouaient avec un vieux dictionnaire et lisaient ensemble les aventures de GuerinMeschino.Eh oui, le dictionnaire... Le mot fait venir à l’esprit l’écriture extrêmement recherchée, la préciosité des paroles, courbes et volutes utilisées comme des pierres serties dans la phrase. On a parlé également de neurasthénie stylistique, à côté de la rengaine sur le baroque antipathique, peut-être à cause d’un des aphorismes du recueil Il Malmenante (Le Mal pensant): «Relire ce qu’on a écrit cinquante fois par jour, ne serait-ce que pour y changer un mot comme on change une fleur dans un vase». Peut-être un peu d’anxiété, peut-être une insatisfaction chronique, mais quel soin véritablement amoureux l’écrivain consacrait-il à la langue!
Découverte de Gesualdo Bufalino,par Fabio CiaralliConnaissez-vous Gesualdo Bufalino et Le Semeur de peste? Si ce n’est pas le cas, j’aimerais vous faire pénétrer dans l’œuvre de cet auteur merveilleux et vous parler de son premier roman.Gesualdo Bufalino, Sicilien de la province de Raguse – de Comiso précisément – naît en 1920 et meurt, dans la même petite ville, en 1996, au cours d’un terrible accident de voiture. Son père était un forgeron passionné par la littérature, passion qu’il réussit à transmettre à son fils au cours de soirées où ils jouaient avec un vieux dictionnaire et lisaient ensemble les aventures de GuerinMeschino.Eh oui, le dictionnaire... Le mot fait venir à l’esprit l’écriture extrêmement recherchée, la préciosité des paroles, courbes et volutes utilisées comme des pierres serties dans la phrase. On a parlé également de neurasthénie stylistique, à côté de la rengaine sur le baroque antipathique, peut-être à cause d’un des aphorismes du recueil Il Malmenante (Le Mal pensant): «Relire ce qu’on a écrit cinquante fois par jour, ne serait-ce que pour y changer un mot comme on change une fleur dans un vase». Peut-être un peu d’anxiété, peut-être une insatisfaction chronique, mais quel soin véritablement amoureux l’écrivain consacrait-il à la langue!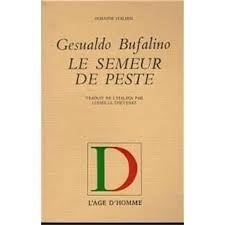 Procédons par ordre. En laissant de côté la période scolaire et les petits travaux pendant l’adolescence où il pei-gnait des chars siciliens dans un atelier d’artisans, nous arrivons en 1940: il s’inscrit à la Faculté des Lettres de Catane puis de Palerme, fréquente bien peu les cours et, deux années plus tard, se retrouve sous les drapeaux, en pleine guerre. En septembre1943 il s’enfuit; après avoir été capturé par les Allemands, il réussit à s’enfuir à nouveau et à échapper à la dernière, terrible période de représailles. En 1944, il découvre qu’il est atteint de tuberculose et il est hospitalisé dans un sanatorium: élément essentiel qui va changer radicalement son existence.Dans la cave de l’institut de Sandiano, dans la province de Reggio Emilia, le médecin-chef, qui cultive les lettres, conserve une très riche bibliothèque. C’est là que le patient Bufalino se plonge dans des lectures et des études approfondies au cours desquelles il lit Proust en français. En 1946 il obtient d’être transféré au sanatorium sicilien de la Conque d’or, entre Palerme et Monreale, «La Rocca», théâtre de ce qui sera son premier, incomparable, roman, Diceria dell’Untore, Le Semeur de peste.Bufalino sortit de la Rocca l’année suivante, mais ce n’est qu’en 1971, vingt ans après, qu’il réussit à mettre un point final à une version complète du texte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il continua à y travailler et à produire des variantes jusqu’en 1981, année où, presque par hasard, grâce entre autres à la ténacité de l’éditrice Elvira Sellerio, le texte fut imprimé pour la première fois.Aujourd’hui nous savons que le Fonds des manuscrits de l’Université de Pavie, auquel l’auteur a fait don de toutes les versions de cet ouvrage, en possède bien sept, avec un patrimoine infini de variantes. Toujours dans Le Mal pensant on peut lire: «Variantes: n’en refuser aucune mais se les réciter ensemble en redoublant le texte et l’extase de le dominer. Un texte multiple est plus vrai que la perfection finale.» Et encore: «L’impatience de Dieu de publier le monde ne finit pas de m’étonner. Il faudrait conserver de telles choses dans son tiroir pour toujours.»Ce n’est qu’après l’immense succès du Semeur de peste (prix Campiello l’année de sa sortie) que Bufalino commen-ça à publier de très nombreux ouvrages, non seulement des récits mais des poèmes, des essais et des mémoires.Son chef-d’œuvre demeure son premier roman. Vivre en symbiose constante avec la mort qu’on sent perpétuellement respirer dans son cou: c’est le sort des personnages-ombres qui hantent les pages du Semeur de peste. Dans le microcosme triste et fermé d’un sanatorium sicilien, des êtres humains en sursis se rencontrent au cours d’instants légers, suspendus sur l’abîme du rien; par le fait que ces moments sont – peut-être – les derniers, ils acquièrent une saveur exaspérée et se teintent d’or et de feu.Le rébarbatif Grand Maigre, médecin cultivé, désenchanté et qui s’adonne à l’alcool, maître de la parole mais à son tour victime du jeu de la vie et de la mort, sauve le patient narrateur grâce aux livres; Marta, la mystérieuse et splendide Marta, peut-être juive et donc victime, peut-être maîtresse d’un Allemand et donc traîtresse et bourreau, peut-être les deux, repliée sur sa propre mort imminente, vit une histoire d’amour avec le narrateur, «contrebandier de vie»; elle l’aime parce que, comme elle, il est sur le point de mourir; et elle éprouve par instants de la haine à son égard parce qu’il pourrait guérir et vivre, malgré son amour pour elle, en la laissant seule devant le néant. L’espérance, d’habitude compagne docile et heureuse, rend les rapports enchevêtrés, éloigne les amants que déjà séparent les lois sévères du sanatorium, prison avec quelques brèches, avant que n’arrive à les séparer à jamais la mort de la jeune femme. Les signes indélébiles de la souffrance se transforment dans l’œuvre en beauté indicible. La consomption, la désillusion, le calvaire deviennent des motifs de légèreté sur fond de mer et d’orangers siciliens, sur des routes brûlées que les deux amants parcourent à la fin dans le seul espoir de vivre encore un instant de passion, un instant de trêve.Survivre à son amour et à ses compagnons est tout sauf une victoire: la guérison est vécue comme une désertion et place la vie future du jeune homme sous le signe ineffaçable de la faute.L’écriture de l’ouvrage, fruit ciselé d’un «séducteur de spectres», comme aimait à se définir l’écrivain, est un incessant flamboiement mortifère. Le Semeur de peste,poème narratif qui pousse la recherche stylistique jusqu’au spasme, en alternant une admirable sécheresse et «des paroles gras-ses, humides, chaudes dont je me farcis», disait Bufalino, est le chant doux-amer de la tragique euphorie de la mort, «paravent de fumée entre les vivants et les autres».«On écrit pour se guérir soi-même, pour se laver le cœur», disait encore l’écrivain. Ainsi soit-il. Mais il est vrai également qu’on écrit «pour dialoguer avec un lecteur inconnu». Et j’espère qu’il en sera ainsi afin d’alléger la prochaine journée «qui nous at-tend au tournant avec sa dose infaillible de dérision et de peine»...F.C(Le Passe-Muraille, No 77. Avril 2009)Images: Gesualdo Bufalino et Fabio Ciaralli (JLK, 2024)
Procédons par ordre. En laissant de côté la période scolaire et les petits travaux pendant l’adolescence où il pei-gnait des chars siciliens dans un atelier d’artisans, nous arrivons en 1940: il s’inscrit à la Faculté des Lettres de Catane puis de Palerme, fréquente bien peu les cours et, deux années plus tard, se retrouve sous les drapeaux, en pleine guerre. En septembre1943 il s’enfuit; après avoir été capturé par les Allemands, il réussit à s’enfuir à nouveau et à échapper à la dernière, terrible période de représailles. En 1944, il découvre qu’il est atteint de tuberculose et il est hospitalisé dans un sanatorium: élément essentiel qui va changer radicalement son existence.Dans la cave de l’institut de Sandiano, dans la province de Reggio Emilia, le médecin-chef, qui cultive les lettres, conserve une très riche bibliothèque. C’est là que le patient Bufalino se plonge dans des lectures et des études approfondies au cours desquelles il lit Proust en français. En 1946 il obtient d’être transféré au sanatorium sicilien de la Conque d’or, entre Palerme et Monreale, «La Rocca», théâtre de ce qui sera son premier, incomparable, roman, Diceria dell’Untore, Le Semeur de peste.Bufalino sortit de la Rocca l’année suivante, mais ce n’est qu’en 1971, vingt ans après, qu’il réussit à mettre un point final à une version complète du texte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il continua à y travailler et à produire des variantes jusqu’en 1981, année où, presque par hasard, grâce entre autres à la ténacité de l’éditrice Elvira Sellerio, le texte fut imprimé pour la première fois.Aujourd’hui nous savons que le Fonds des manuscrits de l’Université de Pavie, auquel l’auteur a fait don de toutes les versions de cet ouvrage, en possède bien sept, avec un patrimoine infini de variantes. Toujours dans Le Mal pensant on peut lire: «Variantes: n’en refuser aucune mais se les réciter ensemble en redoublant le texte et l’extase de le dominer. Un texte multiple est plus vrai que la perfection finale.» Et encore: «L’impatience de Dieu de publier le monde ne finit pas de m’étonner. Il faudrait conserver de telles choses dans son tiroir pour toujours.»Ce n’est qu’après l’immense succès du Semeur de peste (prix Campiello l’année de sa sortie) que Bufalino commen-ça à publier de très nombreux ouvrages, non seulement des récits mais des poèmes, des essais et des mémoires.Son chef-d’œuvre demeure son premier roman. Vivre en symbiose constante avec la mort qu’on sent perpétuellement respirer dans son cou: c’est le sort des personnages-ombres qui hantent les pages du Semeur de peste. Dans le microcosme triste et fermé d’un sanatorium sicilien, des êtres humains en sursis se rencontrent au cours d’instants légers, suspendus sur l’abîme du rien; par le fait que ces moments sont – peut-être – les derniers, ils acquièrent une saveur exaspérée et se teintent d’or et de feu.Le rébarbatif Grand Maigre, médecin cultivé, désenchanté et qui s’adonne à l’alcool, maître de la parole mais à son tour victime du jeu de la vie et de la mort, sauve le patient narrateur grâce aux livres; Marta, la mystérieuse et splendide Marta, peut-être juive et donc victime, peut-être maîtresse d’un Allemand et donc traîtresse et bourreau, peut-être les deux, repliée sur sa propre mort imminente, vit une histoire d’amour avec le narrateur, «contrebandier de vie»; elle l’aime parce que, comme elle, il est sur le point de mourir; et elle éprouve par instants de la haine à son égard parce qu’il pourrait guérir et vivre, malgré son amour pour elle, en la laissant seule devant le néant. L’espérance, d’habitude compagne docile et heureuse, rend les rapports enchevêtrés, éloigne les amants que déjà séparent les lois sévères du sanatorium, prison avec quelques brèches, avant que n’arrive à les séparer à jamais la mort de la jeune femme. Les signes indélébiles de la souffrance se transforment dans l’œuvre en beauté indicible. La consomption, la désillusion, le calvaire deviennent des motifs de légèreté sur fond de mer et d’orangers siciliens, sur des routes brûlées que les deux amants parcourent à la fin dans le seul espoir de vivre encore un instant de passion, un instant de trêve.Survivre à son amour et à ses compagnons est tout sauf une victoire: la guérison est vécue comme une désertion et place la vie future du jeune homme sous le signe ineffaçable de la faute.L’écriture de l’ouvrage, fruit ciselé d’un «séducteur de spectres», comme aimait à se définir l’écrivain, est un incessant flamboiement mortifère. Le Semeur de peste,poème narratif qui pousse la recherche stylistique jusqu’au spasme, en alternant une admirable sécheresse et «des paroles gras-ses, humides, chaudes dont je me farcis», disait Bufalino, est le chant doux-amer de la tragique euphorie de la mort, «paravent de fumée entre les vivants et les autres».«On écrit pour se guérir soi-même, pour se laver le cœur», disait encore l’écrivain. Ainsi soit-il. Mais il est vrai également qu’on écrit «pour dialoguer avec un lecteur inconnu». Et j’espère qu’il en sera ainsi afin d’alléger la prochaine journée «qui nous at-tend au tournant avec sa dose infaillible de dérision et de peine»...F.C(Le Passe-Muraille, No 77. Avril 2009)Images: Gesualdo Bufalino et Fabio Ciaralli (JLK, 2024) -
Délivrez-nous des heures
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce mardi 4 juin.- Si ce n’était mon dernier voyage, je l’aurai vécu comme tel: comme une vraie folie, et sans cesser de me traiter de fou cédant à mes impulsions et compulsions tout en me jugeant avec la lucidité conséquente d’un être plus que raisonnable: comme un enfant lancé en l’air par un vieux dément, et cependant j’écrivais des poèmes, je fredonnais dans mon véhicule d’enfer à la blancheur trompeuse, je claquais des euros sans compter ni jamais oublier la mendiante des églises ordinaires et autres parvis de supermarchés, et mes amis me souriaient sans se douter de mon tourment - quoique de cela aussi je doute à présent.À présent donc, raconte, me dis-je dans la drôle de paix de la Maison bleue dont le voisinage de palmiers et d’agaves acclimatés au biotope pseudo-méditerranéen lémanique me rappellent les pins parasols et les floralies aux exultations polychromes de la Riviera des fiori où je tombai littéralement du ciel ce premier jour d’échappée folle; et te voici d’abord, après tes 500 premières bornes, égaré dans la souricière d’un chantier naval génois où la souris d’ordinateur qu’évoque ton véhicule à consommation contrôlée (la petite Honda Jazz Escort label Hybrid) se retrouve soudain confrontée à une jeune policière à l’air sévère et aux mots effilés comme des poignards : macche Boccadasse non c’e per di qua, ma di là et lassù a sinistra poi di là et a destra - et la dextre de la fonctionnaire de te signifier finalement: de l’air !
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce mardi 4 juin.- Si ce n’était mon dernier voyage, je l’aurai vécu comme tel: comme une vraie folie, et sans cesser de me traiter de fou cédant à mes impulsions et compulsions tout en me jugeant avec la lucidité conséquente d’un être plus que raisonnable: comme un enfant lancé en l’air par un vieux dément, et cependant j’écrivais des poèmes, je fredonnais dans mon véhicule d’enfer à la blancheur trompeuse, je claquais des euros sans compter ni jamais oublier la mendiante des églises ordinaires et autres parvis de supermarchés, et mes amis me souriaient sans se douter de mon tourment - quoique de cela aussi je doute à présent.À présent donc, raconte, me dis-je dans la drôle de paix de la Maison bleue dont le voisinage de palmiers et d’agaves acclimatés au biotope pseudo-méditerranéen lémanique me rappellent les pins parasols et les floralies aux exultations polychromes de la Riviera des fiori où je tombai littéralement du ciel ce premier jour d’échappée folle; et te voici d’abord, après tes 500 premières bornes, égaré dans la souricière d’un chantier naval génois où la souris d’ordinateur qu’évoque ton véhicule à consommation contrôlée (la petite Honda Jazz Escort label Hybrid) se retrouve soudain confrontée à une jeune policière à l’air sévère et aux mots effilés comme des poignards : macche Boccadasse non c’e per di qua, ma di là et lassù a sinistra poi di là et a destra - et la dextre de la fonctionnaire de te signifier finalement: de l’air ! LA SOIRÉE ITALIENNE.- Sur quoi je me suis retrouvé comme hors des heures, seul à ma table en terrasse surplombant la petite anse de galets aux eaux quiètes renvoyant au ciel les reflets des façades en patchwork pastel faisant voisiner les ocres roses et les verts tendres et les murs safran ou les bleus évangéliques, enfin seul: mon œil, car la jeunesse du soir était là en son insouciante chiacchierata me rappelant les soirs de Sienne ou de Sorrente ou plus au noir du sud les tarentelles des nuits d’Amalfi, ma sei contento addesso fratello mi diceva l’alter ego mio, tout à la contemplation vespérale après l'épouvante autoroutière à tunnels meurtriers et dépassement criminels...Mon Italie affective est dans ces couleurs et ces ondulations érotiques, mais l’esprit vif de Buzzati le visionnaire, et l’âme mélancolique de Pavese ne cessent de se faire écho dans ma perception, et tout à l’heure je me retrouvais dans les Enfers du XXe siècle aux préfigurations apocalyptiques, dans le tumulte tueur des camions lancés sur les doubles pistes et se dépassant comme des tamponneuses de Luna Park, où Dino le janséniste alignait ses prémonitions de haut marcheur dolomitique, alors qu’au soir la tendresse songeuse d’éternel jeune homme de Pavese me ramenait à la poésie des lisières de la nuit tandis que je sirotais mon âpre Primitivo signé Notte Rossa…Boccadasse, autant dire Bouche d’âne, et le Saint Esprit s’en trouve lui aussi convié dans le frémissements d’ailes de colombes des quelques nuages d’été de là-haut où divers dieux prennent aussi l’apéro à l’heure délivrée des horloges…TRISTE INJONCTION. – Ils et elles me traiteront encore de lémurien pédant lugubre et de vieux pontife à la Ratzinger, mais je les emmerde et j’y tiens : leur conseil de PROFITER, que dis-je leur ordre, leur essentielle recommadation de PROFITER de l'Italie m’apparaît à la fois comme une relance d’obscène convention consommatrice et comme une injonction à se soumettre aux pires clichés de la bienvivance écervelée, comme au lupanar on ordonnerait : et maintenant jouissez, alors qu’on n’est là que pour ça caramba.Mais PROFITER signifie plus que jouir : on devine que, foi d’expression, faut que ça rapporte au moins le retour sur investissement, faut qu’on en ait pour son dinar, faut profiter du taux momentané du dollar, faut coller aux lois du marché sinon t’es mort.Et ça te gêne que ça me gêne que tu t’abaisses à me dire de PROFITER ? Et que dirai-je tout à l’heure à ma cassata ?LES AMIS RETROUVÉS. – Ces amis-là sont de ces gens qui, revenant de très loin, savent des choses qu’ignorent beaucoup de ceux qui croient en savoir bien plus, et c’est pourquoi les grandes phrases et les beaux mots de l’amitié se voilent de pudeur et de retenue, mais quoique ne nous étant plus vus depuis sept ans, nous nous retrouvons comme si c’était d’hier, et d’ailleurs ce n’est pas d’hier mais de ce matin même que datent nos derniers messages, avec la Professorella, qui partage désormais sa vie avec celui qui fut longtemps l’ange soignant du Gentiluomo, et que je retrouve toute pareille, souriante et douce comme l’était Lady L., aussi présente, au milieu des chats qu’elle a recueillis à travers les années, que lors de notre dernière rencontre à Cetona, en haute Toscane, où Fabio était venu présenter son ouvrage consacré à l’immense Cioran en présence du non moins considérable Ceronetti, son ami.Mais basta les révérences, puisque ladite rencontre, dans une église catholique et apostolique transformée en lieu de conférence plutôt philosophique frottée de gnosticisme, fut plus qu’aucune autre dépouillée de salamalecs académiques au profit (profitez donc !) des accointances du gai savoir et de la connivence humaine.Et comme les mottes de terre qu’on jette sur les cercueils, quelque part dans La Recherche où le baron de Charlus y va de ses lourds constats - profitez de la vie mes amis car telle est sa vanité – sonnent les noms de nos disparus : Emile Cioran, mort ! Guido Ceronetti, mort ! Lady L. et Vanni Cechhinelli, morts ! la chienne Thea et le chien Snoopy, morts !Sur quoi nous reprendrons, de concert, la lecture de La patience du brûlé ou de Pour ne pas oubler la mémoire , du cher Guido, tandis que les livres de la Professorella elle-même (sur Cendrars, Bouvier, Cingria, Chessex, Cohen et Queneau, plus l’ouvrage qu’elle a cosigné avec Fabio Ciaralli sur la littérature concentrationnaire) me font signe sur les rayons, juste sous celui des œuvres complètes de Simenon, etc.
LA SOIRÉE ITALIENNE.- Sur quoi je me suis retrouvé comme hors des heures, seul à ma table en terrasse surplombant la petite anse de galets aux eaux quiètes renvoyant au ciel les reflets des façades en patchwork pastel faisant voisiner les ocres roses et les verts tendres et les murs safran ou les bleus évangéliques, enfin seul: mon œil, car la jeunesse du soir était là en son insouciante chiacchierata me rappelant les soirs de Sienne ou de Sorrente ou plus au noir du sud les tarentelles des nuits d’Amalfi, ma sei contento addesso fratello mi diceva l’alter ego mio, tout à la contemplation vespérale après l'épouvante autoroutière à tunnels meurtriers et dépassement criminels...Mon Italie affective est dans ces couleurs et ces ondulations érotiques, mais l’esprit vif de Buzzati le visionnaire, et l’âme mélancolique de Pavese ne cessent de se faire écho dans ma perception, et tout à l’heure je me retrouvais dans les Enfers du XXe siècle aux préfigurations apocalyptiques, dans le tumulte tueur des camions lancés sur les doubles pistes et se dépassant comme des tamponneuses de Luna Park, où Dino le janséniste alignait ses prémonitions de haut marcheur dolomitique, alors qu’au soir la tendresse songeuse d’éternel jeune homme de Pavese me ramenait à la poésie des lisières de la nuit tandis que je sirotais mon âpre Primitivo signé Notte Rossa…Boccadasse, autant dire Bouche d’âne, et le Saint Esprit s’en trouve lui aussi convié dans le frémissements d’ailes de colombes des quelques nuages d’été de là-haut où divers dieux prennent aussi l’apéro à l’heure délivrée des horloges…TRISTE INJONCTION. – Ils et elles me traiteront encore de lémurien pédant lugubre et de vieux pontife à la Ratzinger, mais je les emmerde et j’y tiens : leur conseil de PROFITER, que dis-je leur ordre, leur essentielle recommadation de PROFITER de l'Italie m’apparaît à la fois comme une relance d’obscène convention consommatrice et comme une injonction à se soumettre aux pires clichés de la bienvivance écervelée, comme au lupanar on ordonnerait : et maintenant jouissez, alors qu’on n’est là que pour ça caramba.Mais PROFITER signifie plus que jouir : on devine que, foi d’expression, faut que ça rapporte au moins le retour sur investissement, faut qu’on en ait pour son dinar, faut profiter du taux momentané du dollar, faut coller aux lois du marché sinon t’es mort.Et ça te gêne que ça me gêne que tu t’abaisses à me dire de PROFITER ? Et que dirai-je tout à l’heure à ma cassata ?LES AMIS RETROUVÉS. – Ces amis-là sont de ces gens qui, revenant de très loin, savent des choses qu’ignorent beaucoup de ceux qui croient en savoir bien plus, et c’est pourquoi les grandes phrases et les beaux mots de l’amitié se voilent de pudeur et de retenue, mais quoique ne nous étant plus vus depuis sept ans, nous nous retrouvons comme si c’était d’hier, et d’ailleurs ce n’est pas d’hier mais de ce matin même que datent nos derniers messages, avec la Professorella, qui partage désormais sa vie avec celui qui fut longtemps l’ange soignant du Gentiluomo, et que je retrouve toute pareille, souriante et douce comme l’était Lady L., aussi présente, au milieu des chats qu’elle a recueillis à travers les années, que lors de notre dernière rencontre à Cetona, en haute Toscane, où Fabio était venu présenter son ouvrage consacré à l’immense Cioran en présence du non moins considérable Ceronetti, son ami.Mais basta les révérences, puisque ladite rencontre, dans une église catholique et apostolique transformée en lieu de conférence plutôt philosophique frottée de gnosticisme, fut plus qu’aucune autre dépouillée de salamalecs académiques au profit (profitez donc !) des accointances du gai savoir et de la connivence humaine.Et comme les mottes de terre qu’on jette sur les cercueils, quelque part dans La Recherche où le baron de Charlus y va de ses lourds constats - profitez de la vie mes amis car telle est sa vanité – sonnent les noms de nos disparus : Emile Cioran, mort ! Guido Ceronetti, mort ! Lady L. et Vanni Cechhinelli, morts ! la chienne Thea et le chien Snoopy, morts !Sur quoi nous reprendrons, de concert, la lecture de La patience du brûlé ou de Pour ne pas oubler la mémoire , du cher Guido, tandis que les livres de la Professorella elle-même (sur Cendrars, Bouvier, Cingria, Chessex, Cohen et Queneau, plus l’ouvrage qu’elle a cosigné avec Fabio Ciaralli sur la littérature concentrationnaire) me font signe sur les rayons, juste sous celui des œuvres complètes de Simenon, etc. -
Que de la joie
 (Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce mercredi 5 juin. - Le lendemain du premier jour à Boccadasse, je m’étais
(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce mercredi 5 juin. - Le lendemain du premier jour à Boccadasse, je m’étais retrouvé à marcher seul le long de l’embouchure marine de Bocca di Magra, d’une bouche à l’autre je m’étais rapproché de mes amis et là, à la hauteur de deux pêcheurs, le plus tout jeune et le pas tout à fait vieux, sans un tatouage au bras ni l’un ni l’autre, voilà que mon portable me couine que j’ai un texto à relever, et chic c’est Quentin qui me hèle en chemin, me disant comme ça qu’en lisant ces jours mes Chemins de traverse il découvre et confirme ce que j’écris à propos de la joie, à savoir bien plus que l’euphorie: cet état chantant qui te vient de la poésie du monde et que tu lui rends en révérence; et tout aussitôt je réponds à Quentin (auquel ce prénom faulknérien va si bien) qu’il ajoute ce matin à ma joie et que je me réjouis de tenir son nouveau livre en main, que j’ai déjà lu sur manuscrit et aimé pour sa lecture du monde à lui qui a le cœur vert et les rages bien noires et rieuses aussi - et quelle joie c’est que « ça » continue ainsi avec ce faux voyou ne donnant jamais dans le faux sérieux des ennuyeux de la paroisse littéraire - et voici la fine cloche là-bas comme assourdie par les couches d’air marin en son carillon matinal , à l'aplomb des falaises de marbre faisant comme des médailles argentées dans la brume, oui la joie serait cette dilatation de l’être qui se fait accueil de parole et complicité des vivants…Sur quoi je tombe sur ces pages de mon barde américain préféré, dans ses Feuilles d’herbe, tout à la célébration de ses joies juvéniles toutes simples et toutes saines, « les joies que procurent les compagnons aimés », « la joie du jour allègre et radieux », la joie du dîner plantureux, de la grande beuverie et de l’ivresse », mais aussi « les joies de la pensée et de la méditation », « les joies de la promenade solitaire, de l’esprit plein d’humilité et cependant fier, les joies de la souffrance et de la lutte », « les joies que procure la pensée de la Mort et des grandes sphères du Temps et de l’Espace », et soudain à cette voix ample et grave de Whitman fait écho cette autre voix non moins ample et généreuse de Thomas Wolfe...L’AFRIQUE AU CORPS. – L’autre soir je me disais, au bord de la nuit marine, qu’une part de l’Italie noire, c’est à savoir au sud de Naples, était comme un doigt d’honneur que l’Afrique fait à l’Europe, et désormais plus qu’avant c’est avec plus d’humanité qu’il faudra le vivre alors qu’on évite d’y penser, se bornant à réagir en ne considérant que le pire, faute évidemement de rien savoir et plus que cela : de ne rien vouloir en savoir, et qui sait quels lendemains se préparent en nos contrées prétendues civilisées, me disais-je tout à l’heure en travaillant à ma chronique consacrée au dernier roman de l’ami René, ce Trésor des Mandingues si riche en aperçus , par les pieds et l’esprit, les narines et l’âme fine, sur ce monde africain à l’approche duquel pas une heure de nos écoles n’a été consacré...L’ARNAQUE DÉJOUÉE. – Nous avons beaucoup ri, avec la Professorella, quand je lui ai raconté, hier au téléphone, ce que venait de me raconter, au téléphone aussi mais depuis l’Espagne, ma sœur aînée m’apprenant que, voici bien des années , à la veille de leur départ pour le Venezuela, son hidalgo s’était pointé dans le chaos du port de Gênes pour y abandonner leur voiture avec l’intention d’en déclarer le vol aux fins de récupération financière - querido Ramon, en muchos sentidos más suizo que nosotros, querido cuñado fuera de toda sospecha… Hélas l’arnaqueur du dimanche ne pouvait se douter que les polices complices, ayant retrouvé le véhicule en l’état où il l’avait laissé, le ramèneraient à leur propriétaire qui en serait pour ses frais - comme notre mère eût estimé juste que cela fût si tant est qu'elle l'eût su...
retrouvé à marcher seul le long de l’embouchure marine de Bocca di Magra, d’une bouche à l’autre je m’étais rapproché de mes amis et là, à la hauteur de deux pêcheurs, le plus tout jeune et le pas tout à fait vieux, sans un tatouage au bras ni l’un ni l’autre, voilà que mon portable me couine que j’ai un texto à relever, et chic c’est Quentin qui me hèle en chemin, me disant comme ça qu’en lisant ces jours mes Chemins de traverse il découvre et confirme ce que j’écris à propos de la joie, à savoir bien plus que l’euphorie: cet état chantant qui te vient de la poésie du monde et que tu lui rends en révérence; et tout aussitôt je réponds à Quentin (auquel ce prénom faulknérien va si bien) qu’il ajoute ce matin à ma joie et que je me réjouis de tenir son nouveau livre en main, que j’ai déjà lu sur manuscrit et aimé pour sa lecture du monde à lui qui a le cœur vert et les rages bien noires et rieuses aussi - et quelle joie c’est que « ça » continue ainsi avec ce faux voyou ne donnant jamais dans le faux sérieux des ennuyeux de la paroisse littéraire - et voici la fine cloche là-bas comme assourdie par les couches d’air marin en son carillon matinal , à l'aplomb des falaises de marbre faisant comme des médailles argentées dans la brume, oui la joie serait cette dilatation de l’être qui se fait accueil de parole et complicité des vivants…Sur quoi je tombe sur ces pages de mon barde américain préféré, dans ses Feuilles d’herbe, tout à la célébration de ses joies juvéniles toutes simples et toutes saines, « les joies que procurent les compagnons aimés », « la joie du jour allègre et radieux », la joie du dîner plantureux, de la grande beuverie et de l’ivresse », mais aussi « les joies de la pensée et de la méditation », « les joies de la promenade solitaire, de l’esprit plein d’humilité et cependant fier, les joies de la souffrance et de la lutte », « les joies que procure la pensée de la Mort et des grandes sphères du Temps et de l’Espace », et soudain à cette voix ample et grave de Whitman fait écho cette autre voix non moins ample et généreuse de Thomas Wolfe...L’AFRIQUE AU CORPS. – L’autre soir je me disais, au bord de la nuit marine, qu’une part de l’Italie noire, c’est à savoir au sud de Naples, était comme un doigt d’honneur que l’Afrique fait à l’Europe, et désormais plus qu’avant c’est avec plus d’humanité qu’il faudra le vivre alors qu’on évite d’y penser, se bornant à réagir en ne considérant que le pire, faute évidemement de rien savoir et plus que cela : de ne rien vouloir en savoir, et qui sait quels lendemains se préparent en nos contrées prétendues civilisées, me disais-je tout à l’heure en travaillant à ma chronique consacrée au dernier roman de l’ami René, ce Trésor des Mandingues si riche en aperçus , par les pieds et l’esprit, les narines et l’âme fine, sur ce monde africain à l’approche duquel pas une heure de nos écoles n’a été consacré...L’ARNAQUE DÉJOUÉE. – Nous avons beaucoup ri, avec la Professorella, quand je lui ai raconté, hier au téléphone, ce que venait de me raconter, au téléphone aussi mais depuis l’Espagne, ma sœur aînée m’apprenant que, voici bien des années , à la veille de leur départ pour le Venezuela, son hidalgo s’était pointé dans le chaos du port de Gênes pour y abandonner leur voiture avec l’intention d’en déclarer le vol aux fins de récupération financière - querido Ramon, en muchos sentidos más suizo que nosotros, querido cuñado fuera de toda sospecha… Hélas l’arnaqueur du dimanche ne pouvait se douter que les polices complices, ayant retrouvé le véhicule en l’état où il l’avait laissé, le ramèneraient à leur propriétaire qui en serait pour ses frais - comme notre mère eût estimé juste que cela fût si tant est qu'elle l'eût su... -
Accroche le mot au nuage
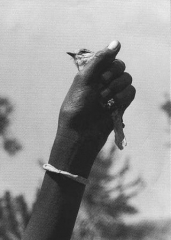 Les mots sont là pour s’étonner,venus du fin des âges,au temps des anges émussans ailes ni messages...La muse a délivré la nuitdes mots les plus secrets,qui retenaient, sous le dénitant d’aveux interdits...Les mots s’embrochent et recomposent,en rondes et en croches,les mélodies, de proche en proche,des enjambées en prose...Les mots n’existent passans le chant qui ruisselle,ou monte vers le cieldont on ne perçoit que l’aura..
Les mots sont là pour s’étonner,venus du fin des âges,au temps des anges émussans ailes ni messages...La muse a délivré la nuitdes mots les plus secrets,qui retenaient, sous le dénitant d’aveux interdits...Les mots s’embrochent et recomposent,en rondes et en croches,les mélodies, de proche en proche,des enjambées en prose...Les mots n’existent passans le chant qui ruisselle,ou monte vers le cieldont on ne perçoit que l’aura.. -
Souvenirs à venir
 (Pour Anthony et Timothy)Les jeux d’enfants abandonnéssous la neige d’antanvous attendaient en matinéedans le jardin du temps,pauvres objets tout décatisaux coloris pâlisqui jamais n’auront oubliévos petites mains accrochéesà la rampe de la fusée…Vous restez un peu interditsà cette apparitiondans la brume du matin grisde l’impassible paonouvrant tout grand son éventailaux ocelles de vitrailreflétant d’autres vies…Plus tard vous vous rappellerezl’éveil de ce jour-là,et cette première visionde la neige inconnuesur vos jouets éparpillés;mais plus tard vous souviendrez-vousde l’oiseau retrouvé ?
(Pour Anthony et Timothy)Les jeux d’enfants abandonnéssous la neige d’antanvous attendaient en matinéedans le jardin du temps,pauvres objets tout décatisaux coloris pâlisqui jamais n’auront oubliévos petites mains accrochéesà la rampe de la fusée…Vous restez un peu interditsà cette apparitiondans la brume du matin grisde l’impassible paonouvrant tout grand son éventailaux ocelles de vitrailreflétant d’autres vies…Plus tard vous vous rappellerezl’éveil de ce jour-là,et cette première visionde la neige inconnuesur vos jouets éparpillés;mais plus tard vous souviendrez-vousde l’oiseau retrouvé ?