
À propos de Riches Heures,
troisième volume des Lectures du monde de JLK.
Ce recueil, établi à la demande de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse, aux éditions L'Age d'Homme, rassemble une partie de mes Carnets de JLK, blog littéraire ouvert sur la plateforme HautEtFort en juin 2005. Proposant aujourd’hui quelque 2000 textes, dans les domaines variés de la littérature et des arts, de l’observation quotidienne et de la réflexion personnelle, entre autres balades et rencontres, ces Riches heures de lecture et d’écriture s’inscrivent dans le droit fil des carnets manuscrits que je tiens depuis une quarantaine d’années, qui ont déjà fait l’objet de deux publications : Les Passions partagées (1973-1992) et L’Ambassade du papillon (1993-1999).
En outre, ces Carnets de JLK illustrent les virtualités nouvelles, et notamment par le truchement de l’échange quotidien avec plusieurs centaines de lecteurs, de cette forme de publication spontanée sur l’Internet, qu’on appelle weblog ou blog.
Dans l’univers chaotique qui est le nôtre, où le clabaudage et la fausse parole surabondent, ces carnets se veulent, au-delà de tous les sursauts de méfiance ou de mépris, la preuve qu’une résistance personnelle est possible à tout instant et en tout lieu pour quiconque reste à la fois attentif à la rumeur du monde et à l’écoute de sa voix intérieure. À l’inattention générale, ils aimeraient opposer un effort de concentration et de réflexion au jour le jour, ouvrant une fenêtre sur le monde.
 SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.
SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.
J’écris cependant, tous les jours, «sous le regard de Dieu», et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK. Cela peut sembler extravagant, mais c’est ainsi que je le ressens. En outre, j’écris tous les jours sous le regard d’environ 500 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 5000 sans que cela ne change rien : je n’écris en effet que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux.
Ecrire «sous le regard de Dieu» ne se réduit pas à une soumission craintive mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».
A LA DESIRADE. – Nous entrons dans la nouvelle année par temps radieux et la reconnaissance au cœur alors que tant de nos semblables, de par les monde, se trouvent en proie à la détresse, à commencer par les victimes des terribles tsunamis qui viennent de dévaster les côtes de l’Asie du Sud-est.
A La Désirade, la vision de ma bonne amie qui fait les vitres, comme on dit, me semble la plus belle image de la vie qui continue…
(1er janvier 2005)
Celui qui n’a plus de goût à la vie / Celle qui se fixe des programmes / Ceux qui se taisent.
 ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.
ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.
Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.
Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, tout le pantelant de gestes impatients et de jouissance à la diable, chose facile.
Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…
Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.
La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté; et ce travail alors repose et fructifie
Celui qui attend une subvention fédérale pour écrire LE livre qui dénoncera enfin l’emprise de l’Etat sur la création / Celle qui affirme penser comme elle danse / Ceux qui adulaient Josef Beuys à vingt ans et qui font aujourd’hui commerce d’icônes avec une organisation mafieuse d’Ukraine centrale, etc.
L'ENFANT. – Edmond Jaloux remarque qu’à quarante ans, peu avant sa mort, Proust était encore un enfant. C’est aussi mon cas à cinquante-sept ans, malgré la paternité dûment assumée et vingt ans de vie conjugale régulière. Pour l’essentiel je suis resté tel que j’étais à dix ans, juste avant la puberté. Ensuite je le suis resté malgré le trouble entêtant du sexe, très sporadique au demeurant jusqu’à l’âge de dix-huit ans, ensuite plus envahissant et parfois obsédant à outrance, par périodes en tout cas.
Or il faudra que je décrive, un jour, cette folie circulaire de l’obsession qui se nourrit elle-même comme la Bête inassouvie de Dante, telle que je l’ai vécue à un moment donné, comme un enfant perdu.
(2 janvier)
PASSEUR. - Il en va de la critique littéraire comme du gardiennage de ménagerie, avec les obscures servitudes et les satisfactions jubilatoires qui en découlent assez semblablement. L’on pourrait dire qu’il y a du Noé chez le passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses.
Cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu. Sans doute ne s’étonne-t-on pas, au jardin zoologique, de ce que tel formidable Sénégalais commis au ravitaillement du tigre royal entretienne, à la fois, un sentiment délicat à l’égard de la gazelle de Somalie ou de la tourterelle rieuse. Mais voit-on assez quel amour cela dénote ? De même paraît-il naturel qu’un passeur de livres défende à la fois la ligne claire de Stendhal ou de Léautaud et les embrouilles vertigineuses de Proust ou l’épique dégoise de Céline, ou encore qu’il célèbre les extrêmes opposés de la nuit dostoïevskienne et des journées fruitées de Colette. Or cela va-t-il de soi ?
L’on daube, et non sans raison, sur le flic ou le pion, le médiocre procustéen, l’impuissant enviard à quoi se réduit parfois le critique. Mais comment ne pas rendre justice, aussi, à tous ceux-là qui s’efforcent, par amour de la chose, d’honorer le métier de lire ?
Car il n’est pas facile de distribuer ses curiosités entre toutes les espèces sans tomber dans l’omnitolérance ou le piapia au goût du jour, puis de maintenir une équanimité dans l’appréciation qui pondère à la fois l’égocentrisme de l’Auteur, le chauvinisme non moins exclusif de l’Editeur et les tiraillements de sa propre sensibilité et de son goût personnels. Cet équilibrage des tensions relève du funambulisme, mais c’est bel et bien sur ce fil qu’il s’agit d’avancer pour atteindre le Lecteur.
 LITTÉRATURE. - C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun au goût du jour. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’une petite secousse ou d’un délassement d’amateur mais relèvent de la plus haute, extatique jouissance, à la fois charnelle et spirituelle; en outre, le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.
LITTÉRATURE. - C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun au goût du jour. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’une petite secousse ou d’un délassement d’amateur mais relèvent de la plus haute, extatique jouissance, à la fois charnelle et spirituelle; en outre, le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.
«Toute bonne littérature est une critique de la vie», affirme John Cowper Powys en citant Matthew Arnold, et cette position, à la fois radicale et généreuse, donne son élan à chacun de ses jugements, et sa nécessité vitale. Pour John Cowper Powys, la littérature se distingue illico des Belles Lettres au sens académique de l’expression. La littérature concentre, dans quelques livres qu’il nous faut lire et relire, la somme des rêves et des pensées que l’énigme du monde a inspiré à nos frères humains, et toutes les «illusions vitales», aussi, qui les ont aidés à souffrir un peu moins ou à endurer un peu mieux l’horrible réalité –quand celle-ci n’a pas le tour radieux de ce matin.
Rien de lettreux dans cette approche qui nous fait revivre, avec quelle gaîté communicative, les premiers émerveillements de nos lectures adolescentes, tout en ressaisissant la substantifique moelle de celles-ci au gré de fulgurantes synthèses. Rien non plus d’exhaustif dans ces aperçus, mais autant de propositions originales et stimulantes, autant de germes qu’il nous incombe de vivifier, conformément à l’idée que «toute création artistique a besoin d’être complétée par les générations futures avant de pouvoir atteindre sa véritable maturité».
Cette idée pascalienne d’une «société des êtres» qui travaillerait au même accomplissement secret du «seul véritable progrès» digne d’être considéré dans l’histoire des hommes, «c’est-à-dire l’accroissement de la bonté et de la miséricorde dans les cœurs» à quoi contribuent pêle-mêle les Ecritures et Rabelais, saint Paul et Dickens ou Walt Whitman, entre cent autres, ne ramène jamais à la valorisation d’une littérature édifiante au sens conventionnel de la morale. D’entrée de jeu, c’est bien plutôt le caractère subversif de la littérature que l’auteur met en exergue. «Une boutique de livres d’occasion est le sanctuaire où trouvent refuge les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l’humanité», relève-t-il avant de préciser que ladite boutique «fournit des armes au prophète dans sa lutte contre le prêtre, au prisonnier dans sa lutte contre la société, au pauvre dans sa lutte contre le riche, à l’individu dans sa lutte contre l’univers». Et de même trouve-t-il, dans l’Ancien Testament, «le grand arsenal révolutionnaire où l’individu peut se ravitailler en armes dans son combat contre toutes les autorités constituées», où le Christ a puisé avant de devenir celui que William Blake appelait le suprême Anarchiste «qui envoya ses septante disciples prêcher contre la Religion et le Gouvernement».
Rebouteux des âmes, John Cowper Powys nous communique des secrets bien plus qu’il ne nous assène des messages. Les ombres, voire l’obscénité de la littérature ne sollicitent pas moins son intérêt que ses lumières et ses grâces, et s’il répète après Goethe que «seul le sérieux confère à la vie un cachet d’éternité», nul ne pénètre mieux que lui les profondeurs de l’humour de Shakespeare ou de Rabelais.
A croire Powys, le pouvoir suprême de la Bible ne tient pas à sa doctrine spirituelle ou morale, mais «réside dans ses suprêmes contradictions émotionnelles, chacune poussée à l’extrême, et chacune représentant de manière définitive et pour tous les temps quelque aspect immuable de la vie humaine sur terre». La Bible est à ses yeux par excellence «le livre pour tous», dont la poésie éclipse toutes les gloses et dont trois motifs dominants assurent la pérennité: «la grandeur et la misère de l’homme, la terrifiante beauté de la nature, et le mystère tantôt effrayant et tantôt consolant de la Cause Première». Mais là encore, rien de trop étroitement littéraire dans les propos de ce présumé païen, dont le chapitre consacré à saint Paul nous paraît plus fondamentalement inspiré par «l’esprit du Christ» que mille exégèses autorisées.
Cet esprit du Christ qui est «le meilleur espoir de salut de notre f… civilisation», et qui se réduit en somme à l’effort séculaire d’humanisation des individus, constitue bonnement le fil rouge liant entre eux les vingt chapitres des Plaisirs de la littérature, courant d’un Rabelais dégagé des clichés graveleux aux visions christiques de Dickens et Dostoïevski, d’Homère fondant un «esprit divin de discernement» à Dante nous aidant à «sublimer notre sauvagerie humaine naturelle pour en faire le véhicule de notre vision esthétique», ou de Shakespeare, à qui l’humour ondoyant et sceptique tient lieu de philosophie, à Whitman qui suscite «une extension émotionnelle de notre moi personnel à tous les autres «moi» et à tous les objets qui l’entourent».
De la même façon, notre «moi» de lecteur, dans cette grande traversée de plein vent ou s’entrecroisent encore les sillages de Montaigne et de Melville, de Cervantès et de Proust, de Milton et de Nietzsche, se dilate sans se diluer, l’énergie absorbée par cette lecture se transformant finalement en impatience vive de remonter à chaque source et de sonder chaque secret.
CÉLINE. - A la fois passionné et constamment exaspéré par le personnage, et presque chaque phrase de Céline. Le type du hâbleur celte. Celui qui la ramène. Le mec. Celui qui en a. L’homme à qui on ne la fait pas. Le cynique. Fort en gueule, mais picaro trouillard. Un peu tout ça…
Ne plus parler de la chose à faire, mais la faire.
 SUR PROUST. - Edmond Jaloux parle du caractère d’anormalité de Marcel Proust, à tous égards extraordinaire, en précisant cependant le type de complexion de l’écrivain, sans pareil au XXe siècle, puis il en détaille les aspects de l’œuvre, la fresque sociale et les insondables intuitions psychologiques, enfin ce qu’il préfère qui ressortit à la poésie et rapproche Proust de Shakespeare: «Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelque chose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»
SUR PROUST. - Edmond Jaloux parle du caractère d’anormalité de Marcel Proust, à tous égards extraordinaire, en précisant cependant le type de complexion de l’écrivain, sans pareil au XXe siècle, puis il en détaille les aspects de l’œuvre, la fresque sociale et les insondables intuitions psychologiques, enfin ce qu’il préfère qui ressortit à la poésie et rapproche Proust de Shakespeare: «Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelque chose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»
DE NOS ENFANTS. - En resongeant à ce que me disait Nancy Huston à propos de Tzvetan Todorov et de ses rapports avec son enfant d’une première femme, je me dis que le sens est donné à notre vie par l’attention et le souci qu’on lui consacre. Elle voyait cet homme tout faire pour l’enfant dont la mère était absente, et c’est ainsi que la mère ligotée, en elle, par ses préjugés féministes, s’est émancipée au meilleur sens du terme.
De la même façon, la relation entre ma bonne amie et moi n’a cessé de se consolider par l’attention partagée que nous avons consacrée à nos filles Sophie et Julie, dès leurs premiers jours et jusqu’à maintenant.
ENCORE PROUST. - Ce que dit Edmond Jaloux à propos de la meilleure façon de lire Proust, comme à vol d’oiseau, en ne cessant de considérer à la fois le détail et l’ensemble du temps et des lieux de la Recherche, rejoint ce que je me disais tout à l’heure à propos des accrocs de la vie, que ma sensibilité excessive (même catastrophique, disait Pierre Gripari) tend à grossir trop souvent. Evoquant la «contemplation du temps» à laquelle s’est livré Proust, Edmond Jaloux écrit «qu’on voit aussi à quel point nos sentiments sont, en quelque sorte, des mythes créés par nous-mêmes pour nous aider à vivre, des heures de grâce accordée à notre insatiabilité affectueuse, mais des heures qui n’ont pas de lendemain, puisqu’il nous est parfois impossible de comprendre, quand le vertige que nous communique un être est terminé, de quoi était fait ce vertige».
Celui qui aime rire au milieu des retraités plombés par une journée de scrabble / Celle qui adapte son sourire à chaque circonstance / Ceux qui se lavent tout le temps les mains, etc.
CHARLES-ALBERT. - La phrase de Céline est certes une musique, mais de savoir le musicien si mythomane et méchant me gâte la mélodie, tandis que je ne cesse d’être enchanté par la musique de Cingria.
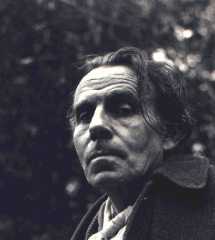 CÉLINE. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefs-d'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Féerie pour une autre fois ou Guignol's Band.
CÉLINE. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefs-d'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Féerie pour une autre fois ou Guignol's Band.
Alors même que l'écrivain, rescapé d'une exécution probable (un Brasillach n'y coupa pas, qui fut moins violent que lui et bien plus digne et conséquent), s'ingéniait à réécrire son histoire avec autant de mauvaise foi que de rouerie inventive, les céliniens en nombre croissant se voyaient soupçonnés d'antisémitisme larvé s' ils ne se dédouanaient pas en invoquant le «délire» de l'intempestif, comme s'y est employée sa veuve Lucette Almanzor, accréditant elle-même la thèse de la folie de son cher Louis et bloquant la réédition des pamphlets.
Or, au fil des années, la publication de divers documents plus ou moins révélateurs ou accablants auront contribué à dévoiler le personnage dans sa complexité tordue, dont la créativité est inséparable de la paranoïa, la verve souvent nourrie par l'abjection, la lucidité aiguisée par une angoisse pascalienne ou une plus triviale trouille de couard.
Oui, ce merveilleux orfèvre de la langue était à la fois un sale type, un ingrat mordant la main qui le nourrissait, un rapiat obsédé par son or, un délateur et un faux jeton en amitié, notamment. On peut certes, alors, choisir de ne pas le lire en se fondant sur ces jugements moraux, mais le lisant il faut tout lire de lui, n'était-ce que pour saisir d'où il vient et où il va.
CALAFERTE. - Partagé, en lisant Louis Calaferte, entre l’adhésion et la réserve. Il y a chez lui de l’écrivain authentique et du ronchon caractériel qui m’intéresse tout en me déplaisant parfois par l’aigreur que j’y trouve.
Que l’amour est ma seule balance et ma seule boussole, j’entends : l’amour de ma bonne amie.
DE L’HUMILIATION. - D’où vient le ressentiment? D’où viennent les pulsions meurtrières? D’où vient le crime ? C’est à ces questions que répondent les romans de Patricia Highsmith. Or, lorsque je lui ai demandé ce qui, selon elle, faisait le criminel, elle m’a répondu sans hésiter que c’était l’humiliation. Mais n’est-ce pas faire peu de cas de ce qu’il y a de mauvais en l’homme, lui ai-je objecté ? Alors elle de me regarder comme un adversaire possible et de se taire. Et moi de me taire, aussi, sans oser lui demander si la perversité de Tom Ripley ne lui a pas procuré, à elle également, cette espèce de plaisir trouble que le personnage met à se venger ?
 FÉLIX VALLOTTON. - Bien m’en a pris de faire escale à l’exposition Vallotton, dont les couleurs irradient puissamment de salle en salle. Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante. Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.
FÉLIX VALLOTTON. - Bien m’en a pris de faire escale à l’exposition Vallotton, dont les couleurs irradient puissamment de salle en salle. Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante. Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.
Vallotton (1865-1925) avait treize ans de plus que Ramuz. Il laisse 500 peintures et une masse de gravures illustrant, avec une virulence expressionniste plus germanique ou nippone que française, la chronique d’une époque. Proche à certains égards d’un Munch, notamment face au désir, mais moins libre et sensuel, moins tragique aussi, que celui-là, du moins en apparence: plus coincé, plus glacé. La ligne plus importante chez lui que les couleurs. Un sourire pincé à la Jules Renard, surtout dans ses gravures. On l’a dit peintre de la raison, mais c’est un jugement par trop français, car la folie couve là-dessous.
(Kunstmuseum de Berne, 26 janvier).
 WITKIEWICZ ET LE ROMAN. - A quoi tient le refus du roman manifesté par Witkiewicz? Il me semble que c’est le rejet d’un genre insuffisant à ses yeux. Il cherche certes la simplification en philosophe, il revient du multiple au concept, mais l’écrivain en lui part du singulier pour aller à l’universel. Or la notion de roman elle-même ne pèse plus lourd pour cette nature apocalyptique. Au demeurant, dans les mêmes années et sous le même empire d’un rêve totalisant de tout-dire, la Recherche proustienne est-elle seulement un roman? N’est-ce pas plutôt une immense chronique, comme le sont celles de Céline? À creuser. Mais pour le moment, c’est bel et bien comme des romans que je lis L’Adieu à l’automne ou L’Inassouvissement, tant leur masse organique et leur temps intime relèvent à mes yeux de ce genre-là.
WITKIEWICZ ET LE ROMAN. - A quoi tient le refus du roman manifesté par Witkiewicz? Il me semble que c’est le rejet d’un genre insuffisant à ses yeux. Il cherche certes la simplification en philosophe, il revient du multiple au concept, mais l’écrivain en lui part du singulier pour aller à l’universel. Or la notion de roman elle-même ne pèse plus lourd pour cette nature apocalyptique. Au demeurant, dans les mêmes années et sous le même empire d’un rêve totalisant de tout-dire, la Recherche proustienne est-elle seulement un roman? N’est-ce pas plutôt une immense chronique, comme le sont celles de Céline? À creuser. Mais pour le moment, c’est bel et bien comme des romans que je lis L’Adieu à l’automne ou L’Inassouvissement, tant leur masse organique et leur temps intime relèvent à mes yeux de ce genre-là.
WITKACY CE MATIN. - Lever de soleil d’hiver sur fond de ciel pervenche, tandis que cela se couvre. Voix de ma bonne amie. Jappements du chien Filou. Fumet du café. Oiseaux en nombre au McDo de la Désirade. Toute une bonne vie à côté de laquelle l’agitation intellectuelle, les « débats essentiels» et autres controverses exacerbées, émaillant Une seule issue, de mon cher Witkacy, me semblent un peu vains, dilués dans une certaine confusion.
S’il avait de formidables dons artistiques, Witkiewicz, apôtre de la forme pure, n’a jamais pu, et tant mieux peut-être, aboutir à celle-ci comme un Monet ou un Bacon. Lui qui rêvait de s’accomplir en peinture ou au théâtre, n’y est parvenu à mes yeux que dans ses roman fourre-tout. Avec L’Adieu à l’automne et L’Inassouvissement, c’est ainsi dans le roman, qu’il prétendait un genre hybride et mineur, qu’il a donné le meilleur. Il se voulait essentiellement philosophe, alors qu’il est surtout artiste, je dirais plutôt médium d’une société chaotique.
A propos de l’individu, dont la complexion physique et psychique compte pour beaucoup à la base de cette œuvre, Constantin Regamey, dont je me rappelle la figure de grand spectre lunaire à long manteau, dans les couloirs de la faculté des Lettres de Lausanne, écrit ceci d’éclairant quoique par trop empreint de morgue universitaire: «Il avait des œillères qui ne lui permettaient pas de soutenir une véritable discussion ni de s’informer de ce qui se faisait ailleurs». Et cette conclusion à la fois lucide, cruelle, juste et injuste à la fois: «En fait c’était un insatisfait psychique, un complexé, mais pas un malade, sûrement pas un fou, plutôt un génie».
(A La Désirade, ce 31 janvier)
DE L’AURA. – Certains êtres sont poétiques, je dirais plus exactement : diffusent une aura. Il y a cela chez ma bonne amie et chez tous ceux que j’aime, non du tout au sens d’un clan confiné de quelques- uns mais d’une famille sensible très élargie de gens dont l’âme rayonne à fleur de peau.
CONSTAT. - Je me dis parfois que ma vie actuelle est le résultat d’un malentendu, puis je me dis que non: que cette vie est le produit de tout ce que j’étais à l’origine et de ce que je suis devenu, conduit par une invisible main en dépit de mes errances.
(A la Désirade, ce 4 février)
DES SENTIMENTS ET DES LIEUX. - La lecture de Rien que des fantômes de Judith Hermann, qui évoque, comme personne aujourd’hui, les désarrois intimes de la jeunesse occidentale, de Berlin et de partout, dans un climat de déglingue où se cherchent et se perdent autant d’écorchés vifs - cette immersion sensible m’impatiente d’écrire à mon tour d’autres nouvelles, et plus précisément: des nouvelles de nostalgie, des nouvelles de lieux et de douleur, des nouvelles de bonté et d’apaisement. Je me rappelle à l’instant que Nancy Huston a particulièrement aimé L’Ange du cabanon, qu’elle m’a dit la plus belle histoire du Maître des couleurs, et c’est cela même que je crois avoir donné là: une nouvelle de nostalgie et de lieu, de douleur et de bonté.
A certains moments il n’y a plus que ça de vrai: une ligne après l’autre, une ligne après l’autre. C’est cela qui me relie à moi-même à l’encre verte: une ligne après l’autre.
 JUDITH HERMANN. - Judith Herman a en elle un puits de larmes. En tout cas j’avais été saisi, dès son premier recueil de nouvelles, Maisons d’été, plus tard, par l'originalité et la maturité, la clarté et la complexité, la puissance expressive et l'hypersensibilité qui caractérisent son art si singulier consistant à mêler, à des situations vécues au présent avec une grande intensité - tout y est concret, sensuellement palpable, rendu avec une plasticité rappelant parfois les expressionnistes - le tremblement profond du temps et son poids de plus en plus perceptible avec l'âge. S'il y a de la mélancolie dans les nouvelles de Judith Hermann, dont procède le plus lancinant de son blues souvent râpeux, jamais elle ne cède à la délectation morbide. Dans la filiation des nouvelles berlinoises de Nabokov, on est au contraire saisi par la vitalité de ses personnages et par le dynamisme de son écriture. Son exploration des «vies possibles» illustre une imagination romanesque souvent en défaut aujourd'hui. Il y a de la fée chez elle, mais aussi de la sorcière : à la première, elle emprunte la capacité d'enchantement et à la seconde une sorte d'humour grinçant et cette implacable lucidité enfantine (mais jamais infantile) qu'elle promène sur la société en faisant dire à l'un de ses personnages «est-ce qu'il faut vraiment que ce soit comme ça?».
JUDITH HERMANN. - Judith Herman a en elle un puits de larmes. En tout cas j’avais été saisi, dès son premier recueil de nouvelles, Maisons d’été, plus tard, par l'originalité et la maturité, la clarté et la complexité, la puissance expressive et l'hypersensibilité qui caractérisent son art si singulier consistant à mêler, à des situations vécues au présent avec une grande intensité - tout y est concret, sensuellement palpable, rendu avec une plasticité rappelant parfois les expressionnistes - le tremblement profond du temps et son poids de plus en plus perceptible avec l'âge. S'il y a de la mélancolie dans les nouvelles de Judith Hermann, dont procède le plus lancinant de son blues souvent râpeux, jamais elle ne cède à la délectation morbide. Dans la filiation des nouvelles berlinoises de Nabokov, on est au contraire saisi par la vitalité de ses personnages et par le dynamisme de son écriture. Son exploration des «vies possibles» illustre une imagination romanesque souvent en défaut aujourd'hui. Il y a de la fée chez elle, mais aussi de la sorcière : à la première, elle emprunte la capacité d'enchantement et à la seconde une sorte d'humour grinçant et cette implacable lucidité enfantine (mais jamais infantile) qu'elle promène sur la société en faisant dire à l'un de ses personnages «est-ce qu'il faut vraiment que ce soit comme ça?».
Par-delà l'aura de poésie et, parfois, de magie qui émane de cet univers, c'est aussi bien à la réalité des êtres, et douloureuse, et à tel sentiment d'insuffisance rappelant un Fassbinder, qu’achoppe Judith Hermann.
Avec Rien que des fantômes, son deuxième livre, on retrouve d’ailleurs les même personnages errants et plus ou moins blessés s' agrippant les uns aux autres comme des naufragés, pour autant de rendez-vous manqués ou décalés, non loin des élégies de Peter Handke et dans le ton aussi d'un certain post-romantisme urbain imprégnant le cinéma allemand d'après-guerre, par exemple dans La balade de Bruno S. de Werner Herzog. La nouvelle éponyme du recueil, qui se déroule dans un sinistre motel d'Austin (Nevada), où se retrouve un couple d'amis allemands traversant les Etats-Unis comme deux âmes en peine, s'inscrit aussi bien dans le droit fil de cette observation panique. En revanche, l'approche des personnages est marquée, chez Judith Hermann par une perception plus empathique et chaleureuse, sensuelle et presque animale, des rapports humains, auxquels se mêlent un dévorant besoin d'affection et une constante nostalgie d'on ne sait quel monde plus beau et plus pur, quelque chose qui a été perdu, que l'on chercherait à retrouver au fond d'une «caisse remplie d'objets anciens, absurdes, merveilleux», et dont on ne retrouverait finalement que le souvenir du souvenir …
CLIMATS. - Je suis tout à fait saisi et même plus: hanté par les atmosphères et la substance affective des nouvelles de Judith Hermann. Il y a là-dedans une mélancolie, une tristesse, mais une tendresse aussi que je n’ai rencontrées nulle part ailleurs à cet état de densité et de clarté dans la jeune littérature actuelle.
RECONNAISSANCE. - Louis Calaferte est mort à peu près oublié, et j’ai comme l’impression qu’il l’a cherché, guère plus pressé de se montrer aimable avec les uns et les autres, mais à mes yeux il ne cesse de vivre (je poursuis ces jours la lecture de ses Carnets de 1989) et c’est cela aussi que j’aimerais susciter après ma disparition de la part de quelques lecteurs: cette reconnaissance que m’inspire cette citation : «Notre seule honorable mesure est celle de l’amour et de la compassion.»
Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait / Ceux qui refusent de s’asseoir à la table des moqueurs, etc.
DE L’AMITIÉ. - Je n’ai qu’à recopier ceci, de Calaferte aussi, pour me sentir proche de cet ami intransigeant: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène».
Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes amis perdus: «l’indifférence froide». Et du même coup je vois mieux apparaître ce qu’a, parfois, été la mienne…
 GEORGES PIROUÉ. - C’est une drôle d’impression que j’ai éprouvée aujourd’hui en apprenant que Georges Piroué était mort, et mort déjà le 7 janvier dernier, sans que personne ne se soit avisé d’en faire le moindre communiqué, pas même la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait hérité de son fonds d’archives. Un confrère, dont les parents étaient liés aux Piroué, vient en outre de m’apprendre qu’ils étaient trois à l’enterrement: le mort, son amie très malade et l’employé des pompes funèbres. Pour un homme qui a tant fait pour les autres écrivains, c’est bien affligeant, mais en somme à l’image de cette époque.
GEORGES PIROUÉ. - C’est une drôle d’impression que j’ai éprouvée aujourd’hui en apprenant que Georges Piroué était mort, et mort déjà le 7 janvier dernier, sans que personne ne se soit avisé d’en faire le moindre communiqué, pas même la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait hérité de son fonds d’archives. Un confrère, dont les parents étaient liés aux Piroué, vient en outre de m’apprendre qu’ils étaient trois à l’enterrement: le mort, son amie très malade et l’employé des pompes funèbres. Pour un homme qui a tant fait pour les autres écrivains, c’est bien affligeant, mais en somme à l’image de cette époque.
(A La Désirade, ce lundi 7 février)
CLASSE MOYENNE. - Millenium people, de J.G. Ballard, est une véritable mine d’observations et de déductions sur la société atomisée et paralysée d’ennui dans laquelle nous vivons en Occident, tout à fait dans le ton grinçant et détaché qui me convient ces jours. La scène de l’émeute dans le camp de concentration pour chats de luxe attaqué par des furies qui assimilent félidés d’élevage et prisonniers politiques, est un régal. Il y a, là-dedans, une quantité de notations qui en appellent autant d’autres que je consigne au fur et à mesure dans les marges du livre.
C’est qu’il se passe tant de choses, dans la « dissociété » qui nous entoure, dont si peu d’écrivains rendent compte. D’autant plus intéressante, alors, me semble la démarche de Ballard, qui détaille les séquelles du sentiment de mécontentement et de révolte éprouvé par les représentants de la classe moyenne. J’y vois l’essentiel du malaise actuel, omniprésent dans nos villes, nos bureaux et nos journaux. Une espèce de paranoïa sévit dans les têtes. Ballard met le doigt sur le ras-le-bol des gens ordinaires lié à la perte du sens de leur existence et à l’enfermement, à l’étriquement que ressentent de plus en plus de gens supposés de plus en plus libres.
APPRENTISSAGE. – Je reconnais un bon maître au bon effet de sa parole et, plus encore, à la qualité de présence découlant de cette parole, à la chaleur et à la lumière de cette présence, à la façon dont cette parole et cette présence nous dépassent l’un et l’autre et nous délivrent l’un de l’autre. Un bon maître disparaît au moment de l’apprentissage, il n’attend pas que je le regarde mais me regarde regarder La Chose qu’il m’a demandé de regarder, qu’à mon tour je donnerai à regarder. A cet égard, le bon Monsieur Thibon est le parangon du bon maître.
 UN LECTEUR HEUREUX. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ». Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années.
UN LECTEUR HEUREUX. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ». Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années.
C’est d’abord comme à tâtons que le lecteur-écrivain nous entraîne dans la selva oscura de sa mémoire confondue à une manière de soupe originelle d’où émergent, de loin en loin, tel visage ou telle silhouette, l’esquisse de tel geste annonçant toute une scène ou l’écho de telle voix préfigurant le développement de trois fois trente-trois chants.
Les premiers paysages et les premières figures entrevus par le rêveur-lecteur (le premier terme ne sera pas moins important que le second) dans sa remémoration d’une réalité fondamentale dégagée des ténèbres par ses premières absorptions, évoquent une lande désolée où des bergers se retrouvent autour d’un feu (et bientôt l’un d’entre eux va peut-être parler, et peut-être un Tourgueniev sera-t-il là aussi pour écouter dans le clair-obscur), et se regroupent alors diverses réminiscences, comme aimantées par l’image initiale.
Une lecture orale, par sa mère, lors d’une de ses maladies d’enfant, a-t-elle ancré au cœur de l’écrivain le souvenir de La Prairie de Biega, des Récits d’un chasseur, auquel est liée la vision nocturne (et quasi préhistorique) d’une tête de cheval, ou bien sa première lecture de la nouvelle, vers l’âge de seize ans, a-t-elle marqué la scène du sceau de sa vision d’adolescent ? Ce qui est sûr, et qui fonde le développement de toute la méditation qui suit, rassemblant d’autres souvenirs de lecture (Stevenson et son âne dans les Cévennes, les bergers de Tchekhov dans La Fortune, puis le chasseur Maupassant, la guerre, la chasse au loup), c’est que la lecture et la mémoire ont travaillé de concert à révéler la véracité (un mot que Piroué semble préférer au terme de vérité) de ces motifs à valeur d’archétypes en les éclairant les uns par rapport aux autres pour mieux les faire signifier.
Ce qui émerveille et qui surprend à chaque pas, dans ce parcours, c’est la remarquable liberté que Georges Piroué manifeste dans ses rapprochements, dont la pertinence découle de sa propre autobiographie de lecteur. Le voici par exemple, et avec quelle justesse affectueuse, parler de Thoreau, dont on sent que l’hyperréalisme mystique, et la langue parfaitement transparente, conviennent à sa propre nature contemplative et à son esthétique littéraire peu portée au gongorisme. Or la compréhension en profondeur de Thoreau amène Piroué à une mise en rapport lumineuse (« A travers lui Rousseau et Proust se donnent la main ») qui détermine aussitôt une double mise au point: « Avec cette différence que Rousseau n’est parvenu à son état d’ataraxie qu’après s’être obstiné à échapper à la société de son temps par l’utopie politique. Il voulait d’un réel réformé. Avec aussi, concernant Proust, la différence que celui-ci, en aiguisant ses sens, lorgnait du côté de leur utilisation à des fins artistiques. Il voulait d’un réel esthétique. Et tous deux, de manière différente, conservaient, en bons Français, des attaches avec la société, tandis que Thoreau les avait dénouées. »
Quant à notre lecteur, c’est bien plutôt « en bon Suisse » qu’il progresse avec l’absence de préjugés ou de snobisme des ressortissants des petites nations, l’ouverture à toutes les cultures que favorisent naturellement notre éducation multilingue, la modestie des terriens et la défiance envers toute rhétorique creuse. Mais son vice impuni n’est pas moins d’un lettré européen, qui le fait tutoyer Leopardi (« Giacomo, amico mio ») dans une admirable lettre de reconnaissance, au double sens du terme; éclairer Tolstoï d’une lumière révélatrice, cheminer aussi à l’aise avec Henry James qu’avec Jacques Réda, Peter Handke ou Conrad, en rendant à chacun son dû et sa place.
Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se reconnaît « douteur fervent » et dit s’être fait « une religion de l’irréalité narrative », et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.
L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane, tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.
Or c’est à proportion, justement, de ce que ce livre a de très personnellement impliqué qu’à son tour le lecteur de l’heureux mémorialiste s’immerge dans les eaux profondes de sa mémoire à lui, s’interroge et se met à « écrire les yeux fermés ». Femmes de Keller, orages de Faulkner, paysans déchirés de Ladislas Reymont et notre cher Buzzati à l’étage des cancéreux, Oblomov lu et relu sous toutes les lumières, une Vie de Rancé de plus pour se nettoyer de trop de carton contemporain, ou l’autre jour Par les chemins de Marcel Proust d’un certain Monsieur Piroué...
DE LA JOIE. - Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dans quel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne.
MATINES. - Je pense à la mort. Je pense au vide. Je pense à la nuit. Je pense à mon père. Je pense à Dieu. Je suis imprégné de cette présence. Je suis plein de cette «voix». Cela parle en moi sans discontinuer. Mais n’est-ce pas moi? N’est-ce pas simplement ma conscience qui me parle? Et qu’est-ce que cette conscience ? Je ne sais. Je sens pourtant que je ne suis pas seul. Je pressens que cela signifie quelque chose. Sans prier je me trouve en état d’oraison. Ouvert à la nuit et au jour. Il est cinq heures et demie du matin. Donc je me lève.
(A La Désirade, ce mercredi 23 février)
Celui qui chemine sans laisser de trace sur le sable / Celle qui traite son frère Rodolphe de fasciste sentimental / Ceux qui conservent un portrait de Lénine dans le chalet d’aisance de leur masure du Périgord noir, etc.
 LE BON MONSIEUR THIBON. – Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures, Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon : c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.
LE BON MONSIEUR THIBON. – Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures, Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon : c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.
DU NON CONSENTEMENT. - Aux yeux de certains je fais figure d’extravagant, pour d’autres je suis celui qui a cédé au pouvoir médiatique, mais ma vérité est tout ailleurs, je le sais, n’ayant jamais varié d’un iota, ne m’étant soumis à rien d’autre qu’à mes élans et à mes pulsions, à ce qui m’anime et m’agite depuis mon adolescence, et voilà: je me lève ce matin à six heures, j’ai trop bu hier soir, je n’aurais pas dû, etc. Du moins ce qui reste sûr, à mes yeux, c’est que je ne me résignerai jamais, contrairement à tant de compagnons de route d’un temps qui se sont arrêtés en chemin ou que la vie a amortis – jamais ne consentirai ni ne m’alignerai pour l’essentiel.
 JACQUES CHESSEX. - Le Désir de Dieu me semble l’un de ses livres les plus libres et les plus aboutis du point de vue de la forme, dans le droit fil de L’Imparfait et de ses étonnantes Têtes, écrit littéralement « sous le regard de Dieu », selon l’expression de Pasternak qui recommandait précisément à Akhmatova d’écrire ainsi.
JACQUES CHESSEX. - Le Désir de Dieu me semble l’un de ses livres les plus libres et les plus aboutis du point de vue de la forme, dans le droit fil de L’Imparfait et de ses étonnantes Têtes, écrit littéralement « sous le regard de Dieu », selon l’expression de Pasternak qui recommandait précisément à Akhmatova d’écrire ainsi.
Ah mais quel bougre d’écrivain et combien je me sens proche de lui en ces pages fluides et un peu délirantes, que j’aurais pu écrire: « Je suis plein de Dieu, croyant le perdre, ne le perdant pas, craignant de ne plus le capter et l’écoutant sans cesse au fond de moi. Parce qu’avec l’exercice de Dieu, le désir de Dieu, la curiosité de Dieu, l’âge venant, je vis avec Dieu une espèce d’état de Dieu qui plus jamais ne s’interrompt».
Jacques Chessex parle ainsi de la présence de Dieu en nous et de notre dispersion devant Dieu – cela même qui me tarabuste si souvent: ma dispersion devant Dieu. Je ne sais pas trop à quoi cela tient mais cela me parle: il y a là une parole vive et une beauté, du sens, de la vigueur et de la profondeur, un homme enfin dépassé par son verbe. Or cela rejoint à la fois Cingria par la découpe de l’écriture (« L’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini»…) et Rozanov par le continuum de la voix.
 CARNETS DE VIE. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…
CARNETS DE VIE. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…
Thierry était un artiste pur, sans rien du cérébral théoricien, ses lettres étaient d’un écrivain mais je trouve, dans ses carnets, qui fait écho à sa vision si singulière, une pensée non moins dense à fulgurances saisissantes, par exemple lorsqu’il note que « c’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie» et quand il constate que «la foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose», ou, sur un autre registre encore, plus obscur et non moins pénétrant, qu’«une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».
Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issue personnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».
Il y a du protestant Amiel se flagellant dans certaines de ses admonestations, qui me rappellent mes propres repentances : « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer» !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais. »
Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».
DEBÂCLE. - Il y a, dans Impuretés de Philippe Djian, une révolte que je ressens moi aussi par rapport à tout ce qui défait la communauté des personnes, de la famille et de la société. Après Impuretés, je lis Frictions qui me touche également par sa densité émotionnelle. Une fois de plus il y est question d’une relation familiale pourrie, avec ce jeune garçon témoin de la haine de ses parents puis se retrouvant, adulte, entre sa jeune femme top model et sa mère jouant celle qu’on abandonne. Le style de l’écrivain pèche parfois (alors qu’il le croit son point fort, non sans candeur) mais il y a là une quantité d’observations dans la masse qui me semblent d’aujourd’hui, et leur ressaisie traduit une vision juste du délabrement de ce pauvre monde.
PSAUME. – Malgré tout je me sens dans la main de Dieu. Ces aubes pures, aux fenêtres de La Désirade, sont autant de cantiques et tout aussitôt je me sens appelé à en témoigner.
(A La Désirade, ce mercredi 2 mars)
 SOLJENITSYNE. - Ce qui me frappe, à la lecture d’Esquisses d’exil, c’est la vulnérabilité que montrent les plus costauds devant la vilenie et la bassesse. On pourrait les croire au-dessus de ça: mais non, cela les touche et les blesse comme s’il en allait d’une atteinte d’autant plus sensible que l’accusation est plus injuste ou vile. Ainsi, de la vanité de tel traducteur-biographe à la paranoïa de tel maniaque de la plainte judiciaire, en passant par la diffamation, hier manipulée par le KGB, aujourd’hui relayée par les médias occidentaux, le démon mesquin est-il légion aux basques de Soljenitsyne. Je me sens à vrai dire « pluraliste» en le lisant, donc peu porté à m’aligner sur ses positions rigides de nationaliste russe et d’orthodoxe pur et dur, mais je respecte l’homme, l’écrivain, le héros, et le défendrai toujours contre la meute hideuse de ses détracteurs.
SOLJENITSYNE. - Ce qui me frappe, à la lecture d’Esquisses d’exil, c’est la vulnérabilité que montrent les plus costauds devant la vilenie et la bassesse. On pourrait les croire au-dessus de ça: mais non, cela les touche et les blesse comme s’il en allait d’une atteinte d’autant plus sensible que l’accusation est plus injuste ou vile. Ainsi, de la vanité de tel traducteur-biographe à la paranoïa de tel maniaque de la plainte judiciaire, en passant par la diffamation, hier manipulée par le KGB, aujourd’hui relayée par les médias occidentaux, le démon mesquin est-il légion aux basques de Soljenitsyne. Je me sens à vrai dire « pluraliste» en le lisant, donc peu porté à m’aligner sur ses positions rigides de nationaliste russe et d’orthodoxe pur et dur, mais je respecte l’homme, l’écrivain, le héros, et le défendrai toujours contre la meute hideuse de ses détracteurs.
 FABIENNE VERDIER. - Au fulgurant premier regard on se dit que seul un dieu dansant entre ciel et terre, tourbillon d’esprit et de matière, d’un seul trait a jeté cela comme ça: comme c’est. Et c’est ce qu’on se dit : c’est comme ça. Comme l’évidence parfaite d’une pierre ou d’une feuille d’herbe: tel est l’être du monde. Cela s’impose à la vitesse de la lumière et ça n’a pas d’âge. Ou plutôt on pressent la patience des étoiles préludant au geste phénoménal prompt comme la foudre: que cela soit - que la beauté soit.
FABIENNE VERDIER. - Au fulgurant premier regard on se dit que seul un dieu dansant entre ciel et terre, tourbillon d’esprit et de matière, d’un seul trait a jeté cela comme ça: comme c’est. Et c’est ce qu’on se dit : c’est comme ça. Comme l’évidence parfaite d’une pierre ou d’une feuille d’herbe: tel est l’être du monde. Cela s’impose à la vitesse de la lumière et ça n’a pas d’âge. Ou plutôt on pressent la patience des étoiles préludant au geste phénoménal prompt comme la foudre: que cela soit - que la beauté soit.
Le feu du mouvement, traversé d’un souffle cosmique et soulevant jusqu’au ciel les pigments mêlés de terre et d’eau de pluie résument l’art essentiel de Fabienne Verdier. Elémentaire et savante, puissamment physique et modulant une non moins évidente démarche spirituelle, cette peinture est à la fois abstraction pure et poésie concrète, culture raffinée et nature primordiale, figures du subconscient et constante évocation du monde visible et sensible. Aussitôt une harmonie « musicale» soulève celui qui la découvre, lui rappelant comme une cantate de Bach que l’homme est «capable du ciel», mais cet envol prend appui sur le sol de fonds inlassablement travaillés, tels les glacis des maîtres anciens ou les couleurs «montées» des figures de contemplation de Rothko; et l’on se rappelle à la fois les contemplatifs cisterciens auxquels l’artiste rend d’ailleurs hommage explicite, comme à son mentor taoïste, invitant à autant de stations méditatives.
ELLE. – Ma bonne amie ne cesse de m’émouvoir. Elle est essentiellement elle-même. Elle est toujours juste. Toujours elle-même et juste.
Mon réalisme tâtonne entre une déception d’enfance et tous les élans vers le ciel que m’ont inspiré tous les dégoûts.
MALAISE. – Je ne me sens pas bien. Tout à coup il me semble percevoir, de manière écrasante, le caractère vain et vulgaire de mon travail au journal, avec le sentiment accablant d’être submergé par la laideur, telle qu’elle m’a été imposée l’autre jour par la mise en page grossière de ma présentation de Fabienne Verdier, entrelardée de publicités affreuses. Mais ne rien montrer de cette contrariété. Faire comme si de rien n’était. Résister là où je me trouve. Résister à la contamination de l’intérieur…
(Au Buffet de la Gare, ce lundi 22 mars)
DE L’ESPRIT D’ENFANCE. - Plus je vais et plus je constate que je ne suis moi-même qu’en retrouvant ma disponibilité totale à l’esprit d’enfance. Toute autre posture intérieure, qui relativiserait les exigences de celui-là, me disconvient et plus: me contrarie. Jamais je ne serai adulte et responsable au sens où ils l’entendent, même si je me fais une idée aussi conséquente, sinon plus qu’eux, de toute vraie responsabilité.
SANTO SUBITO. - A l’instant (il est 5 heures du matin) j’apprends, sur ma petite radio portative, la mort de Jean Paul II, survenue hier soir à 21 heures 57. Ce fut un grand pape à la fois politique et mystique, un homme de lumière et de fermeté dans une époque de ténèbres et de déliquescence. Peu m’importe qu’il y ait, dans ses positions déclarées, des aspects qui se discutent: il est resté fidèle au Christ pour l’essentiel, une icône vivante pour beaucoup de malheureux et pour beaucoup de jeunes, ce qui l’a limité à nos yeux de pluralistes relevant du dogme et de la tradition catholique qui n’est certes pas tout le christianisme – mais qui de nous est habilité à lui en remontrer ? C’était une sorte de figure paternelle conséquente, et je l’aimerai toujours à ce titre, comme j’aime mon propre père.
En considérant l’incroyable mouvement de reconnaissance qu’a soulevée sa mort, je me demande pourtant ce que cela signifie vraiment ? Le slogan Santo subito en dit long sur le besoin de vénération, même d’adoration de ces braves gens, mais quelle part d’emballement idolâtre n’y a-t-il pas là-dedans ?
(A La Désirade, dimanche 3 avril)
Jean-Jacques Rousseau: «Seul celui qui marche est apte au réel».
MAGMA. - En cherchant La Nouvelle Héloïse dans les rayons de livres de poche de l’Hyper U, je me suis senti soudain submergé par une double sensation contradictoire de dégoût et de vague délivrance, comme si je découvrais soudain le caractère à la fois dérisoire et pour ainsi dire héroïque de mon propre travail d’écrivain. Oui, véritablement, devant une telle masse et une telle hideur on se dit, à la fois, qu’on n’est rien et qu’on est justifié...
(Au Cap d’Agde, ce mercredi 11 mai).
 MARE NOSTRUM. - Retrouver la mer est important, pour ma bonne amie et moi, comme une sorte de respiration fondamentale, physique et spirituelle à la fois, qu’aucun autre lieu ne nous aura jamais donnée. Nous avons besoin de la mer. Ces dunes qui se perdent dans le lointain et cette douce grève aux herbages hirsutes, le long de laquelle les gens vont et viennent, ont quelque chose de tellement apaisant et de si tonifiant aussi, avec la mer roulant là-bas sa litanie infinie.
MARE NOSTRUM. - Retrouver la mer est important, pour ma bonne amie et moi, comme une sorte de respiration fondamentale, physique et spirituelle à la fois, qu’aucun autre lieu ne nous aura jamais donnée. Nous avons besoin de la mer. Ces dunes qui se perdent dans le lointain et cette douce grève aux herbages hirsutes, le long de laquelle les gens vont et viennent, ont quelque chose de tellement apaisant et de si tonifiant aussi, avec la mer roulant là-bas sa litanie infinie.
CHANTIERS. - Pastis au bord de l’Hérault. Le Canal du Midi, le long duquel se succèdent les chantiers navals, me fait penser à Simenon et me rappelle cette province un peu décatie que j’aime retrouver un peu partout, en France, si rare en revanche dans la Suisse trop policée.
(Au Grau d’Agde, ce vendredi 13 mai)
 SIMENON. - Un romancier populaire, et l'un des plus populaires au monde, peut-il être un bon écrivain ? Est-il concevable qu'un auteur, à qui il arrivait d'écrire cinq à dix romans en une année, dont un seul eût suffi à établir une réputation, puisse ne pas être un faiseur, voire un pisse-copie ?
SIMENON. - Un romancier populaire, et l'un des plus populaires au monde, peut-il être un bon écrivain ? Est-il concevable qu'un auteur, à qui il arrivait d'écrire cinq à dix romans en une année, dont un seul eût suffi à établir une réputation, puisse ne pas être un faiseur, voire un pisse-copie ?
Ces questions n'ont cessé de nourrir, dans le monde littéraire, la suspicion envers l'œuvre extraordinairement fertile de Georges Simenon, même si certains de ses pairs lui vouaient la plus naturelle admiration. André Gide le premier, qui lui manifesta autant de respect professionnel que d'affectueuse attention, l'avait écrit: « Il est le plus grand de tous... le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature ». Et Faulkner de surenchérir: « J'adore lire Simenon. Il me fait penser à Tchékhov ».
Beaucoup cependant, en France surtout où l'on continue de séparer la «pure» littérature, destinée à quelques-uns, de celle qui touche le moins lettré des lecteurs, ont classé une fois pour toutes le romancier prolifique dans la catégorie « policière », autant dire de la sous-littérature. D'ailleurs, prétendent les plus doctes, Simenon n'a « pas de style ».
Le plus cocasse, à ce propos, est cependant que la très stylée Colette fut la première, à la lecture des textes de Georges Simenon, à lui conseiller de « faire moins littéraire », devinant que cet écrivain était de la race rare de ceux qui en disent le plus avec le moins. Jacques Dubois, qui a établi l'édition Pléiade des romans de Simenon, ne dit pas autre chose: que le « style » de Simenon n'a rien certes qui brille comme le style de Proust ou le style de Céline, mais que Simenon n'en est pas moins l'inventeur d'une écriture absolument originale qui passe essentiellement par la sensation et l'intuition, la perception profonde, et souvent subconsciente, des moindres mécanisme du comportement humain, restituées dans une langue limpide mais parfaitement rythmée, avec une poésie qui ne se réduit pas aux clichés de la fameuse « atmosphère Simenon », de trottoirs mouillés en brumes traînantes.
Simenon n'a jamais posé au grand écrivain: il se disait lui-même un artisan, et celui qui a vu, à ses archives de Liège, ses manuscrits et ses tapuscrits, ne peut qu'abonder dans le sens de ce que me disait un jour la romancière Patricia Highsmith, confondue d'admiration devant l'immensité du travail du romancier.
Pour relativiser le mérite de celui-ci, d'aucuns évoquent souvent, comme Georges Haldas, un « phénomène », qui ferait de lui une éponge absorbant tout et le recrachant sans y penser. D'une manière plus triviale encore, les clichés du romancier-record, qui plus est riche à millions et couvert de femmes, achèvent de brouiller l'image réelle d'un écrivain qui a beaucoup travaillé, et non du tout en tâcheron mais en observateur inlassable, et de plus en plus fin, du phénomène humain. Car l'évolution de Simenon, du journaliste-aventurier de seize ans qui reflétait l'idéologie d’époque, antisémite et populiste, de la Gazette de Liège, au romancier compassionnel des « romans de l'homme », révèle la prise de conscience progressive d'un témoin lucide de la condition humaine. L'auteur de l'admirable Lettre à mon juge s'efforce ainsi de « comprendre et ne pas juger », selon sa devise qui ne l'empêche pas, au demeurant, d'avoir une idée très affirmée de la vraie justice (on se rappelle le plaidoyer prodigieux des Inconnus dans la maison, tonné au cinéma par Raimu) et de la vraie fraternité, dont son commissaire Maigret, inspiré par son propre père qui « aimait tout », est l'interprète le plus connu.
DE LA CONVERSION.- A mon rendez-vous matinal de cinq heures, je me dis que la conversion est une décision de tous les jours et de tous les instants. Le déclic n’est entendu que de Dieu. Tu choisis ceci, clic. Tu choisis cela, clac. Chacun sait très bien ce qu’il en est et c’est cela qui compte: c’est le secret de chacun.
 PLAISIRS DE LÉAUTAUD. - Paul Léautaud se flattait de n’avoir jamais menti de toute sa vie, et c’est sûrement vrai. Jamais en tout cas, à le lire, on n’a l’impression qu’il cherche à plaire au lecteur ou qu’il se ménage lui-même en s’observant. Voici par exemple ce qu’il écrivait dans le dimanche 4 mars 1951 dans son Journal littéraire: «Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. » Le même jour (l’écrivain avait alors 79 ans) Léautaud remarquait qu’il avait toujours été «fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement», et qu’une seule chose avait compté pour lui: le plaisir précisément.
PLAISIRS DE LÉAUTAUD. - Paul Léautaud se flattait de n’avoir jamais menti de toute sa vie, et c’est sûrement vrai. Jamais en tout cas, à le lire, on n’a l’impression qu’il cherche à plaire au lecteur ou qu’il se ménage lui-même en s’observant. Voici par exemple ce qu’il écrivait dans le dimanche 4 mars 1951 dans son Journal littéraire: «Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. » Le même jour (l’écrivain avait alors 79 ans) Léautaud remarquait qu’il avait toujours été «fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement», et qu’une seule chose avait compté pour lui: le plaisir précisément.
«Ce mot plaisir représente pour moi le moteur de toutes actions humaines», écrivait-il. Or son plaisir, Léautaud l’avait trouvé avec quelques femmes, avec les poètes dont il fut l’anthologiste au début du siècle (lui qui se prétendait fermé au sentiment, pleurait comme une Madeleine quand il récitait par cœur Verlaine, Jammes ou Apollinaire), dans les conversations quotidiennes au Mercure de France dont il était l’employé, avec les flopées de chats et de chiens qu’il recueillait dans son pavillon d’ermite urbain de Fontenay-aux-Roses, et surtout à écrire, tous les soirs à la chandelle, le rapport circonstancié de ses journées, consigné à la plume d’oie sur des feuilles collées les unes aux autres et dont l’ensemble nourrit les dix-huit volumes de la première édition du Journal littéraire.
A part celui-ci, Le petit ami, évoquant sa jeunesse de gandin préférant les lorettes de bals populaires aux bourgeoises, et le poignant In memoriam, écrit au chevet de son père mourant avec autant de ressentiment (justifié) que d’émotion (Léautaud est un émotif extrême sous son rictus), quelques proses stendhaliennes et ses chroniques de théâtre réunies sous le pseudonyme de Maurice Boissard, constituent toute son œuvre, fruit acide et tonique de tout son plaisir.
SUBLIMATION. - Il y a un moment très émouvant, dans La Tache de Philip Roth, et c’est celui où le narrateur, Nathan Zuckerman, et Coleman Silk, son vieux voisin en rupture de conformité, deviennent amis en dansant ensemble le fox-trot sur une terrasse nocturne, comme ça, spontanément, et sans rien d’équivoque dans ce contact physique de deux mecs à moitié nus, avant d’échanger diverses confidences, notamment sur les femmes. Alors que Coleman a «repris du service» grâce au Viagra, Nathan sublime « grâce » à l’impuissance où l’a laissé son cancer de la prostate. Cette complicité me fait songer à celle des anciens combattants. Au reste, toute forme de sublimation me semble émouvante, et celle de Nathan me touche particulièrement en cela qu’elle va vers l’œuvre à faire…
A qui me dit que je lui manque, jamais je ne manquerai.
VERTIGE. -Me viennent certains matins ces élans et ces refus étranges. Voudrais prier mais point de mains. M’agenouiller mais point de jambes. Me lever et sortir mais point de porte ni de chemin devant la maison, et d’ailleurs point de maison. J’essaie de chanter mais rien ne vient. Courir une fois encore le long du ruisseau, mais j’ouvre les yeux sans voir, ou plutôt c’est comme si j’étais couvert d’yeux. Que se passe-t-il? Ou a passé ma corde à sauter? Et pourquoi les mots me font-ils si mal ce matin? Encore heureux: je me pose des questions, cependant mon corps ne me brûle plus puisque point de corps.
Je ne sais plus qui disait (je crois que c’est Enesco) que Jean-Sébastien Bach était l’âme de son âme.
La poésie saute une idée sur deux.
Ma vraie base: l’honnêteté et l’amour. Tout le reste: du flan. Ma vraie base: la sincérité et la conséquence, et tout le reste du pipeau.
RAMUZ ET CINGRIA. -Le fait de se demander ce qui nous manque chez un auteur nous aide mieux à distinguer qui il est et qui nous sommes. Ce qui me manque chez Ramuz est le jazz verbal et la turbulence, la rondeur et la folie de Charles-Albert, la spontanéité et la fantaisie, la liberté et la saveur. Il y a certes un peu de tout cela, à faible dose, dans Adieu à beaucoup de personnages, mais, et à son avantage cette fois, il y a tout le reste, aussi, que Ramuz a, et que Cingria n’a pas…
DE LA « LANGUE » SUISSE. - Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression, la Suisse n’existe pas, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire : il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria; ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée, essentiellement latine ou franco-provençale.
PARLER DE DIEU. - Ceci de Ramuz que je contresigne: «Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme». Et ceci de Rousseau dans le même sens: «Je veux que les choses soient ce qu’elles paraissent: de bonnes fourchettes de fer et de bonnes cuillers d’étain».
AL DENTE. - Mes fausses dents, qui se font la malle (mauvaise colle), me rappellemt Miss Lonelyhearts (le personnage qui a tant de prothèses qu’il ne sera bientôt plus qu’un automate) et mon Grossvater (les dents reposant dans leur verre, à la salle de bain), mon père et mon dentiste antisémite que je ne pouvais contredire, cloué que j’étais à ma chaise et la bouche pleine de ses putains d’instruments.
Me méfie instinctivement des habiles, autant que de l’habileté en moi.
MATINALES. - Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça, m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde.
L’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.
Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.
Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.
(A La Désirade, ce lundi 20 juin)
Le Christ purifie et délivre, tandis que le diable disperse et défait.
 LUCY. - Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de William Trevor. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy.
LUCY. - Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de William Trevor. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy.
Or ce nouveau roman ne s’en tient pas à la seule destinée de Lucy. De fait, c’est à tous les personnages directement frappés par ce drame – une enfant qui fugue à la veille du départ de sa famille loin de leur Eden côtier, pour cause d’insécurité, et qui ne réapparaîtra qu’après la mort de sa mère désespérée, tant d’années après -, que l’auteur voue son attention, tous étant à la fois coupables et victimes, responsables à certains égards et innocents.
Roman de la fatalité et de la fidélité, de la faute et du pardon, de l’attachement à une terre et de l’exil, de l’amour empêché et de sa sublimation, Lucy entremêle enfin l’histoire d’une femme et celle de l’Irlande contemporaine, du début de l’ère dite «des troubles» à nos jours. « C’est notre drame, en Irlande, dit l’un des personnages du roman, que pour une raison ou pour une autre nous soyons encore et toujours obligés de fuir ce qui nous est cher », et le lecteur le prend pour lui…
LE POIDS DU MONDE. - Je ne sais pourquoi ce qu’écrit Peter Handke me fait penser, toujours, au travail du ver à soie. A le lire je revois ma mère faufilant avant de coudre. C’est cela même quand il parle de sa mère à lui, dans Le malheur indifférent: Handke faufile. A la fin du livre il note d’ailleurs ceci qui le justifie d’avance: « Plus tard, j’écrirai sur tout cela en étant plus précis ».
Or, je me sens à la fois attiré et vaguement agacé par la douceur affectée de cette littérature si fine et si vétilleuse, qui esthétise le malheur autant qu’elle l’affronte, et ne cesse de forcer la note tout en l’atténuant. Ainsi de la naissance de la mère dans une famille de paysans nécessiteux est-elle dramatisée à l’excès: « Naître femme dans ces conditions c’est directement la mort », pour se trouver banalisée aussitôt après: « On peut dire cependant que c’est tranquillisant: aucune peur de l’avenir en tout cas ».
Et tout ce « travail littéraire » d’osciller entre l’effroi et son acclimatation, le cri et la glose, un récit de vie poignant et sa déconstruction simultanée, comme s’il y avait quelque chose d’inconvenant dans la simple émotion - comme si tout le tragique de la vie ne servait qu’à prendre des notes, et ces notes qu’à se tisser un cocon…
Au bord de la dépression: ces moments où il semble qu’on ait mal à tous les objets qu’on touche.
Ce personnage qui, après avoir touché le fond de la désolation, se met à s’intéresser passionnément au prix des choses. Il y a là comme un humour du désespoir qui me touche en ce moment précis.
 ENCORE HANDKE. - En d’autres temps j’aurais peut-être rejeté ce livre aux observations parfois si vétilleuses, qui m’évoquent des sortes de flocons sensibles à consistance de bourre ou de soie floche, et pourtant je reviens et reviens au Poids du monde de Peter Handke comme à une méditation murmurée qui relance à tout moment la mienne ; et j’ai beau me reprocher de gratter ainsi ma plaie: je vois aussi la poésie qu’il y a là-dedans, et cet exercice d’attention qui aboutit à tout instant à la cristallisation d’images ou d’idées comme sécrétées par les gestes, les postures, les mouvements les plus imperceptibles du corps ou de l’esprit, celui-là comptant autant que celui-ci et débordant sur le corps de la nature et de l’univers.
ENCORE HANDKE. - En d’autres temps j’aurais peut-être rejeté ce livre aux observations parfois si vétilleuses, qui m’évoquent des sortes de flocons sensibles à consistance de bourre ou de soie floche, et pourtant je reviens et reviens au Poids du monde de Peter Handke comme à une méditation murmurée qui relance à tout moment la mienne ; et j’ai beau me reprocher de gratter ainsi ma plaie: je vois aussi la poésie qu’il y a là-dedans, et cet exercice d’attention qui aboutit à tout instant à la cristallisation d’images ou d’idées comme sécrétées par les gestes, les postures, les mouvements les plus imperceptibles du corps ou de l’esprit, celui-là comptant autant que celui-ci et débordant sur le corps de la nature et de l’univers.
On dirait ainsi la conscience de l’écrivain comme à fleur de peau, dont l’écriture paraît émaner en buée. Le lecteur est à la fois dedans et dehors, comme passant sous ses propres fenêtres - et cette phrase buzzatienne me touche alors particulièrement: « Passer devant une fenêtre sombre derrière laquelle un ami a habité autrefois ». Ou encore: « Les voitures mortes devant la fenêtre dans la nuit »...
Il y a là une douceur mélancolique dont j’aime la projection en images, et cette sensualité triste, à la limite du lâcher-prise dans laquelle je suis parfois immergé moi aussi: « Un homme assis, affaissé, essaie sans cesse de se redresser pour montrer du maintien, mais chaque fois il s’affaisse de nouveau, finalement il est content comme ça ».
Ramuz fait partie, à n’en pas douter, de l’école non institutionnelle du vrai.
Celui que tout amuse malgré tout / Celle qui envoie des SMS à sa cousine Arlette pendant la réu des cadres dans la Salle panoramique / Ceux qui rappellent aux jeunes stagiaires qu’ils ont eux aussi « jeté quelques pavés en mai 68, etc.
VIEILLIR. - Il y a toujours un certain décalage entre notre âge et notre moi, que je ressens particulièrement aujourd’hui que les jeunes gens m’identifient visiblement à un vieil iguane, alors que je me sens plus frais qu’à vingt ans. Or je n’arrive pas à admettre ce fait pourtant indéniable, que je suis bel et bien un vieil iguane. Mais voudrais-je avoir dix ou vingt ans de moins? Certes non, puisque j’étais alors plus vieux qu’aujourd’hui. Donc va pour la comédie du vieil iguane...
CÉZANNE. - Mon besoin, ce matin, de matière solide, s’est satisfait à la lecture des premières pages du Cézanne de Philippe Dagen. Il y prône le retour à l’œuvre et l’attention aux intérêts du peintre pour la littérature et toutes les formes d’interprétation – il insiste: de lecture. Le fait que Cézanne sache La charogne de Baudelaire par cœur est plus important, à ses yeux, que toutes les théories. Le personnage bougon et entêté, solitaire et saint à sa façon (si peu artiste me semble-t-il) de Cézanne m’a toujours plu. Ceux qui l’approchent le traitent d’«ours intraitable». Il écrit lui-même: «L’isolement, voilà ce dont je suis digne. Au moins, ainsi, personne ne me met le grappin dessus». Et cela que j’aime bien aussi: «Tous mes compatriotes sont des culs à côté de moi»…
JEUNISME. - J’écoute, d’une oreille, la jactance de la radio portant sur la Street Parade, où un anthropologue explique que la jeunesse se trémousse ainsi et se défonce parce qu’elle n’a aucun avenir. Voilà ce que dit l’anthropologue: la jeunesse n’a pas d’avenir. Si la jeunesse se drogue (parce que la jeunesse ne fait que se droguer) c’est parce que la société (il dit: la société) ne lui offre aucun débouché. Voilà, c’est comme cela que les «faiseurs d’opinion» et autres anthropologues autoproclamés «font l’opinion».
Leçon quotidienne de Cézanne à ma fenêtre.
Ne m’intéresse plus que l’Objet. Cézanne ou l’objectivité sans limite.
Cézanne s’ouvre au monde en se coulant dans l’objet.
 RAMUZ EN PROVENCE. - Je viens de relire les douze pages de L’Exemple de Cézanne où C.F. Ramuz, avec une saisissante acuité, et pour évoquer son propre rapport à la terre, raconte le pèlerinage qu’il accomplit en 1914, partant de la Cannebière de Marseille en tramway, gagnant le « haut pays » et là se trouvant lui-même « repaysé » devant la grande chaîne blanchâtre au pied de laquelle Aix se trouve assise, y déjeunant d’olives noires et de saucisson et cherchant ensuite la rue Boulegon, tout humble et là-bas, superposé à un toit, « le cube blanc de l’atelier » découvert avec émotion - mais l'écrivain savait que la vraie présence de Cézanne ne rayonnerait que plus loin encore, dans la « nature presque espagnole » du pays réinventé par le peintre.
RAMUZ EN PROVENCE. - Je viens de relire les douze pages de L’Exemple de Cézanne où C.F. Ramuz, avec une saisissante acuité, et pour évoquer son propre rapport à la terre, raconte le pèlerinage qu’il accomplit en 1914, partant de la Cannebière de Marseille en tramway, gagnant le « haut pays » et là se trouvant lui-même « repaysé » devant la grande chaîne blanchâtre au pied de laquelle Aix se trouve assise, y déjeunant d’olives noires et de saucisson et cherchant ensuite la rue Boulegon, tout humble et là-bas, superposé à un toit, « le cube blanc de l’atelier » découvert avec émotion - mais l'écrivain savait que la vraie présence de Cézanne ne rayonnerait que plus loin encore, dans la « nature presque espagnole » du pays réinventé par le peintre.
Ramuz oppose le « Midi facile, extérieur, Midi d’effets », des aquarellistes et paysagistes à la petite semaine (il en croule plus que jamais aujourd'hui entre senteurs et saveurs conditionnées) et le « Midi grave, austère, sombre de trop d’intensité », de Cézanne dont il définit l'art plus précisément encore: « Sourd, en dessous, tout en harmonies mates, avec ces rapprochements de bleus et de verts qui sont à la base de tout , et ce gris répandu partout, qui exprime la profondeur et qui exprime la poussière, parce que la lumière après tout est poussière pour qui voit autre chose que la surface et l’accident ».
Ramuz oppose aussi Cézanne au folklore (coiffes, farandoles et galoubets) d'un Mistral pour montrer combien sa Provence à lui est plus qu’une province : une terre universelle appartenant à tous et où tous peuvent se reconnaître dans l’élémentaire épuré : « Peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, écrivait d'ailleurs Cézanne, c’est réaliser des sensations.
Et Ramuz de conclure : « D’autres ont des bustes, des statues : sa grandeur à lui est dans le silence qui n’a cessé de l’entourer ; sa grandeur à lui est de n’avoir ni buste ni statue, ayant taillé le pays tout entier à sa ressemblance, dressé qu’il était contre ses collines, comme on voit le sculpteur, son maillet d’une main et son ciseau de l’autre, faire tomber le marbre à larges pans ».
AUTOLIMITATION. - Me vient l’idée ce matin que le renoncement, le choix de ne pas faire ceci ou cela, la permission qu’on se refuse, peut être la plus belle manifestation de liberté. Ce que Soljenitsyne appelle l’autolimitation, si contraire à l’esprit du temps…
On ne discute pas avec la médiocrité. Discuter est déjà s’abaisser.
Tout devenant festif, il n’y a donc plus de fête.
L’obsession craintive de leur différence en a tiré ce bêlement grégaire.
PARIS. - En dînant seul à la terrasse du café de la Place, tout en haut de la rue d’Odessa, je songe à mes multiples escales à Paris et à ce que j’aime toujours dans cette ville si personnelle, à sa vie, à son charme et ses beautés – ce soir, ensuite, le bord de la Seine, la grande roue du côté des Tuileries, la tour Eiffel gainée d’une sorte de résille de lumière, puis les terrasses de la rue de Buci, jusqu’à la touffeur molle de la nuit estivale, propre elle aussi à Paris. Dans la foulée je note que jamais, à ma connaissance, Cézanne n’a représenté aucune rue ni aucune place de Paris, ni d’aucune ville d’ailleurs…
(Paris, ce jeudi 28 juillet)
 POÉSIE QUOTIDIENNE. - C'est à partir des événements les plus anodins en apparence, que Marius Daniel Popescu compose ce collage de sensations et d'émotions d’Arrêts déplacés dont le premier mérite est de rendre aux mots leur densité première, comme par le truchement d'un rituel.
POÉSIE QUOTIDIENNE. - C'est à partir des événements les plus anodins en apparence, que Marius Daniel Popescu compose ce collage de sensations et d'émotions d’Arrêts déplacés dont le premier mérite est de rendre aux mots leur densité première, comme par le truchement d'un rituel.
Telles des « cellules » poétiques, une suite de petits grains (d'un à onze) cristallisent des instants simultanés, du plus simple (« toutes / les femmes / sont / belles « ) à de plus complexes intersections, comme pour faire percevoir tout ce qui se trame à la même seconde, ici et partout. De la chose vue à l'émotion, il suffit parfois d'un lien de mémoire comme celui qui associe, « événement rare dans ces contrées », ce chien noir et sans laisse errant en ville et l' « un des passages de ta grand-mère parmi une foule d'hommes qui buvaient des bières debout »…
Arrivé en Suisse en 1990, le poète pratique notre langue avec une étonnante maîtrise, alternance de limpidité et de baroquisme inventif, en usant (et parfois en abusant) de procédés formels ou typographiques rappelant les expériences lettristes. Pourtant le noyau vif de cette poésie doit moins aux « trucs » qu' à la perception fraîche (« quand / la pluie sursaute autour de toi / comme une gitane ») et à l'accueil de « cela simplement qui est », selon l'expression d'un Cingria, restituant la présence des proches (les enfants, la compagne ou les amis), de telle vieille dame assise à la gare de Lyon, de tel moribond étendu sous un drap blanc au pied d'un immeuble, de toutes ces vies qui se croisent (« de plus en plus de gens qui parlent seuls »), tout cela rappelant un peu la poésie d'un Raymond Carver ou les icônes profanes d'un Charles Bukowski. Parfois insuffisamment transposée, la matière poétique de ces Arrêts déplacés n'en est pas moins habitée et frémissante, fraternelle en son regard et généreusement accessible à tout un chacun, comme l'était celle d'un Prévert. D'ailleurs « les paroles dorment sous les gouttes d'eau comme des moineaux », écrit encore Popescu, dont les pépites du verbe étincellent dans le tout-venant des jours.
JARDIN DU LUXEMBOURG. - Les gros nuages saturés d’encre du lever du jour s’étant dissipés, voici le premier soleil dardant entre les feuilles des feuillus. Après avoir salué le sombre Beethoven de Bourdelle dans la pénombre verte de l’antichambre végétal, puis le Verlaine non moins renfrogné émergeant un peu plus loin de mornes fleurs, j’observe longuement la souple, lente, muette gesticulation de quatre adeptes du taï-chi et de leur jeune maître chinois tout de noir vêtu, puis j’avise, tout à côté, la Tonnelle Rolls qu’on vient d’installer là, reproduisant, en bois et au format, une Silver Ghost conçue par l’artiste Dimitri Tsykalov et réalisée par le menuisier Boulanger, selon le projet de celui-là de xylophiliser le monde des machines en le ramenant à la nature. Des fleurs, du lierre, des verdures de toute sorte vont proliférer sur la carène de bois de la Rolls et demain l’automobile disparaîtra sous les follicules et les corolles. Top de la créativité, budgétisé à l’avenant, sponsors cités…
Le Luxembourg le matin est une oasis de vitalité radieuse. Tout le monde y court sans considération d’âge. Une très vieille Chinoise vêtue de vert s’y exerce, en compagnie d’un tout jeune Occidental glabre au jeu du sabre de fer blanc ponctué de cris rauques. Un peu plus loin, devant la statue de Blanche de Castille, décédée en 1252 (sa date de naissance a été effacée), une autre très vieille dame, plutôt Américaine d’allure, se livre elle aussi à une gestuelle méditative.
On est là comme hors du monde, au milieu de ces figures de pierre de cette nature et de ces innocentes personnes, et pourtant un peu plus loin, aux grilles du Jardin donnant sur le boulevard, ont été accrochées de grandes photographies, à l’occasion de 30 ans de Reporters sans frontières, qui nous ramènent aux convulsions du XXe siècle.
La première à me frapper est cette image de Marc Riboud datant de mai 68 et représentant un front de manifestants, drôlement allurés pour certains et brandissant des couvercles de poubelles en guise de boucliers, face à un seul flic casqué. Cela me rappelle notre équipée de camarades, débarqués aux petites aubes en caravane de 2CV avec notre stock de plasma sanguin destiné aux victimes des forces policières.
Comme si c’était d’hier, je me rappelle mon immédiate perplexité devant le déferlement de rhétorique selon laquelle la Révolution était bel et bien accomplie, après laquelle rien ne serait plus jamais comme avant. Or j’avais beau participer, apparemment, à l’élan général: en mon for intérieur notre vieil atavisme terrien me faisait regimber, tout comme regimbe le protagoniste de Ramuz, dans Vie de Samuel Belet, quand son ami le communard l’enjoint de rallier les insurgés.
Et d’autres images du siècle se succèdent, devant lesquelles je passe en visant le petit faune de bronze à la danse comme en suspens, dont je note au passage que c’est une copie italienne d’une statue de Pompéi: telle étant la danse de l’humanité sur le volcan de la planète, soudain résumée par ces instantanés de la guerre au Congo ou du Front populaire, des foules en guerre ou des foules en fête, du fameux poulbot à baguette parisienne de Willy Ronis ou de ce gosse au cerf-volant sur un terrain vague de la bande de Gaza - enfin de tant de drames qui perdurent aux quatre vents tandis que je continue de flâner dans le soleil candide.
ROMAIN GARY. - Il y avait des nuées noires, ce matin à cinq heures, montant comme des spectres dansants de la cuve argentée du lac, et tandis que je buvais mon café le titre de ce livre en épreuves non corrigées que m’a envoyé Christian Bourgois a retenu mon attention: La fin de l’impossible. Trois heures plus tard, dans le train longeant les eaux étales sous le ciel bas, j’ai commencé de lire ce nouveau livre à paraître du philosophe Paul Audi qui se donne aussitôt comme un acte de reconnaissance aux «alliés» occultes que sont pour nous certains écrivains ou certains artistes accordés à «l’étrange acoustique du monde spirituel» dont parle Kierkegaard.
Tout de suite j’avais été mis en confiance, ou plutôt en consonance avec la voix de l’auteur et intrigué, touché, réellement ému par la façon d’emblée d’annoncer le besoin d’une «explication avec la vie» passant non par un système ou une doctrine mais par l’expérience d’un écrivain rompant avec le «Moi-même moi-mêmisant», pour embrasser «le Tout de la vie», à savoir Romain Gary, Romain Gary que j’ai peu lu jusque-là, Romain Gary à côté duquel j’ai passé, Romain Gary dont Nancy Huston me disait elle aussi l’importance, Romain Gary qui écrit «j’attends la fin de l’impossible», Romain Gary l’écrivain que Paul Audi, se réclamant de Chestov que j’ai tant fréquenté et aimé, présente comme celui qui l’aide à lutter contre les évidences pour conjurer l’impossible dans nos têtes, l’impossible verrouillé par l’idéologie et la morale, l’impossible verrouillé par les lois de la nature, l’impossible que Chestov le philosophe espérait conjurer avec l’aide de l’écrivain Dostoïevski.
C’était le matin, j’allais à la rédaction, j’entendais cette voix à travers «l’étrange acoustique du monde spirituel», les gens dans le train me semblaient plus beaux, ces mots me parlaient: «Toute la force de l’œuvre de Gary vient de ce qu’il a cherché, sans relâche mais sans non plus se faire d’illusion, à contredire la sagesse de l’Homme manqué. Constamment, derrière les mots, sinon entre les lignes, tous ses romans laissent entendre le cri de l’enfant qui n’est pas encore déçu – ou celui de l’homme mûr qui refuse de comprendre».
Et du même coup j’entrevoyais de nouveaux livres à lire, peut-être un nouvel interlocuteur longtemps inaperçu, et me voici ce soir commençant de lire L’angoisse du roi Salomon tandis que l’ombre se fait sur la montagne…
(A La Désirade, ce mercredi 3 août)
 BALEINE AU MONT-BLANC. - L’air avait une acuité de cristal, ce matin sur les crêtes dominant la vallée de Chamonix, mille mètres plus bas, face au Mont-Blanc dont la calotte étincelait sous le premiers rayons, et je me suis dit que non: que la première métaphore de Baleine ne collait pas, quand Paul Gadenne parle d’une carrière de marbre à propos de l’animal échoué sur le rivage, et qu’un autre ensuite le compare à une montagne de neige; mais non, le Mont-Blanc n’a rien d’une baleine échouée au bord du ciel, me disais-je en visant le cairn du col du Brévent, et d’ailleurs j’avais pris le petit livre dans mon sac avec l’intention d’en achever la lecture quelque part sur ces hauts gazons exhalant les parfums d’orchis et de gentianes, et c’était cela même me disais-je: l’odeur de la baleine change tout lorsque Pierre et Odile s’en approchent.
BALEINE AU MONT-BLANC. - L’air avait une acuité de cristal, ce matin sur les crêtes dominant la vallée de Chamonix, mille mètres plus bas, face au Mont-Blanc dont la calotte étincelait sous le premiers rayons, et je me suis dit que non: que la première métaphore de Baleine ne collait pas, quand Paul Gadenne parle d’une carrière de marbre à propos de l’animal échoué sur le rivage, et qu’un autre ensuite le compare à une montagne de neige; mais non, le Mont-Blanc n’a rien d’une baleine échouée au bord du ciel, me disais-je en visant le cairn du col du Brévent, et d’ailleurs j’avais pris le petit livre dans mon sac avec l’intention d’en achever la lecture quelque part sur ces hauts gazons exhalant les parfums d’orchis et de gentianes, et c’était cela même me disais-je: l’odeur de la baleine change tout lorsque Pierre et Odile s’en approchent.
C’est le miracle de la lecture de se faire de nouveaux amis en moins de deux, ou de se rappeler soudain ceux qu’on avait oubliés. Car je connaissais Pierre et Odile depuis de longues années, pour avoir déjà lu Baleine, cette nouvelle de Paul Gadenne comptant à peine trente pages, rééditée il y a quelque temps et que j’ai relue avec l’impression de la redécouvrir plus physiquement que la première fois, par le seul fait qu’on ne lit pas, à passé cinquante ans, un texte évoquant la mort comme on le lit à vingt ans.
De fait Baleine, décrivant le cadavre d’une baleine en train de se décomposer sur une grève, est plus qu’un texte symbolique: une espèce de poème métaphysique que vivent deux jeunes gens élégants, juste un peu moins frivoles que les autres, Pierre et Odile qui étaient avec moi cet après-midi dans les rhododendrons des abords du refuge Bel-Lachat quand j’ai ressorti l’opuscule.
La prose de Gadenne est d’une parfaite économie. Sa façon de décrire la féerique bidoche du cétacé aux soieries pourrissantes nous trouble et nous enchante à la fois, comme fascinés par cette grosse fleur puante, mais non pas exactement fleur: animale créature à laquelle nous nous identifions Dieu sait pourquoi, à croire que la baleine nous rappelle notre mère ou des voyages antérieurs, peu importe – cette façon légère et fulgurante me semble la littérature même, qui ramasse en quelque pages toutes nos questions et tous nos vertiges, l’horreur et la splendeur.
NOSTALGIE. - En voyant apparaître les aiguilles de Chamonix, ce matin au col des Montets, une bouffée d’émotion m’a fait vaciller au souvenir de tant d’équipées de notre bon jeune temps, puis je me suis rappelé notre dernière course avec mon ami Reynald, sur l’arête Midi-Plan, et sa mort dans la face nord du Mont Dolent, une semaine après, il y aura juste 20 ans le 15 août prochain, un pas la vie, un pas la mort…
(Chamonix, ce 5 août)
L’agression faite au silence est plus grave qu’on ne saurait dire.
Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu. Mais comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi : Il se fait tard, de plus en plus tard...
DE LA NATURE. - Tout songeur devant ce paysage qui me ramène à tout coup à ma vraie dimension. Dominique de Roux me disait qu’on ne pouvait être dupe du monde après avoir accouché d’un enfant - ce qui faisait selon lui la supériorité de la femme -, et de même je me dis qu’on ne peut être dupe devant l’immensité de la nature, et par exemple devant ces montagnes. Là devant, je me dis, une fois de plus, qu’il est aberrant de penser que nous avons dominé la nature; parce que jamais nous ne dominerons la mort - à moins de changer de nature précisément.
(Chamonix, ce 5 août)
Qu’un roman est l’histoire de nos possibles.
Celui qui prétend que son rapport à la finitude a changé depuis que Gilberte est entrée dans sa vie / Celle que le besoin de se réinitialiser (selon son expression) contraint à changer souvent de partenaire et de voiture, etc.
 PAYS DE RAMUZ. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher de Rivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.
PAYS DE RAMUZ. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher de Rivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.
Cette phrase achève Raison d’être, le bref essai que le jeune écrivain publia par manière de manifeste précédant, après un long séjour à Paris, son retour définitif en terre vaudoise.
Avec une œuvre dont la langue est elle-même un geste fondateur, Ramuz investit une position qui marquera une distance croissante, par rapport à la culture française, n’excluant pas la plus vive reconnaissance et n’impliquant pas pour autant la soumission à une idéologie helvétiste par trop artificielle à ses yeux.
«Laissons de côté toute prétention à une littérature nationale: c’est à la fois trop et pas assez prétendre », écrit-il à la fin de Raison d’être, datant de 1914, et de préciser ensuite: « trop, parce qu’il n’y a de littérature, dite nationale, que quand il y a une langue nationale et que nous n’avons pas de langue à nous; pas assez, parce qu’il semble que, ce par quoi nous prétendons alors nous distinguer, ce sont nos simples différences extérieures.» Et l’écrivain, faisant écho à un Faulkner lorsque celui-ci prétendait concentrer l’histoire de l’humanité sur le timbre-poste de sa terre natale, d’appeler de ses vœux une littérature qui soit à la fois d’ici et reconnaissable par delà nos confins cantonaux ou nationaux.
Or voici la phrase fameuse : «Mais qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous.»
Tout ça se discute évidemment, car il n’est pas sûr qu’il n’y ait pas, en Suisse, une voix commune aux quatre régions linguistiques qui dépasse, précisément, la langue tout autant que l’idée figée de nation, pour exprimer une façon de vivre la démocratie et la négociation, le contrat et le rapport à la nature, mille autres choses encore, parfois impalpables, qui cristallisent cet habitus particulier dont parlait Cingria et qui fait qu’à chaque passage de frontière on perçoit, comme je l’ai perçu cet après-midi encore en franchissant celle de Saint-Gingolph, un imperceptible mais très réel changement. En outre, on pourrait trouver bien limitée cette aspiration de Ramuz à rendre le son et le ton d’un coin de terre, à l’instant même où l’Europe allait basculer dans la tragédie...
Pourtant l’œuvre est là, dont certains livres touchent bel et bien à l’universel, et ce soir la courbe de la colline engloutie par le crépuscule, autant que le beau rivage, là-bas, me semblaient signifier beaucoup plus qu’un recroquevillement régionaliste : à la fois ce pays, le pays de Ramuz, mon pays et le pays de chacun…
(Au chemin de la Dame, ce vendredi 12 août)
Devenir ignorant de soi-même - tendre à cela tout le temps.
Sans humilité: rien; sans amour: rien.
Il faut reprendre, tous les matins, la chasse aux dieux.
Ma première pensée de ce matin va aux enfants cancéreux. Ma première pensée à tous ceux qui se réveillent avec la conviction que la mort approche. Ma première pensée à cette pensée en moi de plus en plus constante et de plus en plus tonique aussi: la mort donneuse de vie
 EROS PICTOR. - Lorsque Joseph Czapski m’a dit un jour qu’il bandait pour la couleur, avec un élan juvénile qui sembla soulever tout à coup sa vieille carcasse repliée comme celle d’un grand oiseau en cage, dans la mansarde à plafond bas de l’Institut polonais, à Maisons-Laffitte, je l’ai pris comme un saillie, c’est le cas de dire, sans me douter alors de ce que le rapport physique avec la peinture pouvait avoir effectivement de sensuel et d’excitant, notamment lorsqu’une forme émerge du chaos des couleurs, et surtout dans la pratique dionysiaque de celles-ci. De fait on n’imagine guère Monsieur Bonnard, debout devant sa toile en cravate, bandant pour la couleur, même si celle-ci est chez lui tous les jours à la fête. Mais Bonnard est un apollinien, comme Cézanne, sauf quand celui-ci caresse ses baigneuses et ses baigneurs.
EROS PICTOR. - Lorsque Joseph Czapski m’a dit un jour qu’il bandait pour la couleur, avec un élan juvénile qui sembla soulever tout à coup sa vieille carcasse repliée comme celle d’un grand oiseau en cage, dans la mansarde à plafond bas de l’Institut polonais, à Maisons-Laffitte, je l’ai pris comme un saillie, c’est le cas de dire, sans me douter alors de ce que le rapport physique avec la peinture pouvait avoir effectivement de sensuel et d’excitant, notamment lorsqu’une forme émerge du chaos des couleurs, et surtout dans la pratique dionysiaque de celles-ci. De fait on n’imagine guère Monsieur Bonnard, debout devant sa toile en cravate, bandant pour la couleur, même si celle-ci est chez lui tous les jours à la fête. Mais Bonnard est un apollinien, comme Cézanne, sauf quand celui-ci caresse ses baigneuses et ses baigneurs.
A l’opposé, qu’on imagine le plus souvent ivres et virtuellement en érection dans le bordel de leur atelier: Soutine et Bacon, dont les couleurs sont autant de décharges nous touchant «directement au système» nerveux, comme le notait justement Philippe Sollers à propos de Bacon.
C’est le côté sauvage de la peinture, qui ne se résume souvent qu’à une touche ou à une échappée de liberté folle, comme chez Véronèse ou Delacroix la mèche rebelle dépassant sur le côté…
Peindre est un plaisir sans comparaison avec celui de l’écriture, mais ce n’est pas tant une affaire d’érection que d’effusion dans le tourbillon des odeurs et des couleurs, de quoi surgit la forme. Paul Gadenne montre, dans Baleine, combien la forme créée est belle, émouvante et paradoxale, et d’autant plus belle, en opposant une partie encore intacte de la dépouille, ailerons et gouvernail, qu’elle nous apparaît au milieu du désordre de chairs retournant au chaos originel.
J’avais vu cela en Grèce lorsque je lisais Kazantzaki, tombant soudain, le long d’une plage isolée de l’île d’Ios, sur un chien ensablé, squelette à tête encore pelucheuse et aux yeux de verre éteint.
Nietzsche a montré mieux que personne, je crois, et Berdiaev après lui, cette oscillation entre dionysiaque et apollinien, qui ne se réduit pas au dualisme entre physique et spirituel, loin de là, mais renvoie au corps sans limites de certains Chinois et de tous les vrais mystique qui bandent pour Dieu - les femmes autant que les hommes, cela va de soi…
UN HOMME PERDU. - On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers se plaisant en eaux glauques, mais le personnage est beaucoup plus que cela: un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait ou calmé, même au clavecin.
Il faut lire la série des romans dans l’ordre de leur composition pour bien voir d’où vient Tom Ripley, survivant comme par malentendu à la disparition accidentelle de ses parents. C’est un peu la version thriller de L’homme sans qualités, dont l’écriture apparemment plate de Patricia Highsmith ne tisse pas moins un arrière-monde aux réelles profondeurs. Ripley l’informe rêve d’art et y accède par tous les biais, y compris le faux (l’invention de Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures… Ripley est un humilié qui se rachète en douce, comme il peut, un pas après l’autre. C’est un peu par malentendu qu’il commet son premier meurtre, parce qu’un jeune homme l’a blessé, et pour tout le reste qui justifiait cet énervement du moment: tout ce que symbolisait ce fils de pute d’enfant gâté. Ensuite, le premier pas étant franchi, on croit savoir que le meurtre transforme l’homme en meurtrier et que ce nouvel état suppose de nouvelles lois, avec lesquelles Ripley va jouer, parfois pour la bonne cause, comme on dit, comme dans Ripley s’amuse, peut-être le meilleur de la série, qui a inspiré deux beaux films et deux interprétations (Bruno Ganz et John Malkovitch) dont la meilleure n’est pas celle de L’ami américain, il me semble.
En lisant ces jours Sur les pas de Ripley, je retrouve cette atmosphère de voluptueuse angoisse si particulière, propre à l’auteur, qui m’évoque le besoin de se faire peur des enfants pelotonnés dans leur nid de souris. Il y avait de ça chez la vieille gamine, qui refusait en outre l’ordre des gens dits normaux commettant toutes les saloperies sans froisser rien de leurs costumes de gens au-dessus de tout soupçon.
Un jour que je lui demandais ce qui motivait selon elle les crimes, Patricia Highsmith m’a répondu que c’était cela presque toujours: d’avoir été humilié, de se sentir rejeté du bon camp, de n’être pas admis au vernissage… Ce dont Ripley tire, sans trop le vouloir, tout à son instinct d’animal dénaturé, le parti qu’on voit…
ACULTURATION . - Notre grande petite Sophie est revenue hier de Syrie, les bras surchargés de cadeaux. C’est un vrai souk qu’elle a déballé sous nos yeux ébahis. Nous en avons bien ri et j’étais tout songeur en l’entendant raconter que, là-bas, les femmes se baignent tout habillées; et de la voir, sur les photos, engoncée dans un imperméable comme par mauvais temps, en ces chaleurs torrides, m’a fait sourire aussi et me rappeler mon peu d’attirance pour ces pays et ces mentalités si figées dans les conventions pseudo-religieuses, évidemment claniques et toutes sociales. Dieu sait que je ne suis pas dupe des progrès dont nous nous targuons, mais un imperméable à la plage : non.
(A La Désirade, ce dimanche 14 août)
 LE CHANT DU MONDE. - Charles-Albert écrivait tel jour d’Ouchy, et c’était hier ou ce matin : « Il y a une prairie, avec des bambous. L’herbe est courte, jaune, trouée par des footballs d’enfants. Des merles, à l’encre, y dessinent leur opulence bombée ». Ou bien il notait, en sortant de son logis de la rue Bonaparte, « l’or est tiède sur les façades », ou roulant sur sa bicyclette, « le bitume est exquis », ou cheminant en campagne, « l’herbe est divinement tendre ». Jean Paulhan, qui le défendait contre les pontifes pincés de la NRF (Gide en tête), releva qu’il savait dire « il pleut » comme personne et, des grands événements de ce monde, se « foutait complètement », étant entendu que « le signe du grand écrivain, c’est qu’il peut dire avec naturel les choses les plus simples du monde ». Et de fait, nul ne célébrait mieux que Charles-Albert Cingria « cela simplement qui existe », promeneur émerveillé des villes (Lausanne qu’il a décrit plus génialement que quiconque, Fribourg dont il a modulé les musiques, Paris à l’infini ou San Gimignano dans une lettre de nomade rimbaldien de vingt ans : « Cette ville avec ses quatorze tours s’élevant d’un pâté de maisons ressemble à une vieil orgue de bois ») mais aussi des campagnes qu’il sillonnait à vélo, nanti de sa petite valise de cuir bouilli et ralliant la prochaine étape où il payait ses hôtes (il avait par toute l’Europe des cercles s’ignorant les uns les autres qui le recevaient) de ses propos d’incomparable conteur, avant de franchir une nouvelle « frontière de rossignols » pour faire halte dans telle buvette ou se réfugier dans telle bibliothèque, entre Saint-Gall et Salamanque, où il enrichissait ses manuscrits enluminés de joyeux érudit ès histoire ou musicologie médiévale.
LE CHANT DU MONDE. - Charles-Albert écrivait tel jour d’Ouchy, et c’était hier ou ce matin : « Il y a une prairie, avec des bambous. L’herbe est courte, jaune, trouée par des footballs d’enfants. Des merles, à l’encre, y dessinent leur opulence bombée ». Ou bien il notait, en sortant de son logis de la rue Bonaparte, « l’or est tiède sur les façades », ou roulant sur sa bicyclette, « le bitume est exquis », ou cheminant en campagne, « l’herbe est divinement tendre ». Jean Paulhan, qui le défendait contre les pontifes pincés de la NRF (Gide en tête), releva qu’il savait dire « il pleut » comme personne et, des grands événements de ce monde, se « foutait complètement », étant entendu que « le signe du grand écrivain, c’est qu’il peut dire avec naturel les choses les plus simples du monde ». Et de fait, nul ne célébrait mieux que Charles-Albert Cingria « cela simplement qui existe », promeneur émerveillé des villes (Lausanne qu’il a décrit plus génialement que quiconque, Fribourg dont il a modulé les musiques, Paris à l’infini ou San Gimignano dans une lettre de nomade rimbaldien de vingt ans : « Cette ville avec ses quatorze tours s’élevant d’un pâté de maisons ressemble à une vieil orgue de bois ») mais aussi des campagnes qu’il sillonnait à vélo, nanti de sa petite valise de cuir bouilli et ralliant la prochaine étape où il payait ses hôtes (il avait par toute l’Europe des cercles s’ignorant les uns les autres qui le recevaient) de ses propos d’incomparable conteur, avant de franchir une nouvelle « frontière de rossignols » pour faire halte dans telle buvette ou se réfugier dans telle bibliothèque, entre Saint-Gall et Salamanque, où il enrichissait ses manuscrits enluminés de joyeux érudit ès histoire ou musicologie médiévale.
Dans une société cultivée que le tournis médiatique n’avait pas encore écervelée, la qualité d’un génie aussi peu « visible » que celui de Cingria, qui ne se manifestait ni par le roman ni par le théâtre, mais par quelques livres surfins ou savants et, bien plus, par une myriade de textes éparpillés entre revues et journaux grands ou petits, se distinguait encore par la découpe et la musicalité d’un style sans pareil. Ainsi ce dandy ruiné, ce zéro social, ce paria bedaineux, ce bateau ivre monté sur roues aura-t-il accompli dans la dèche quotidienne et l’humiliation, la pauvreté croissante et mille maux dont jamais il ne se plaint, ce Chef-d’œuvre de savoir subtil et d’improvisation jaillissante.
Il ne faut pas ajouter au malheur de la pauvre humanité, et je l’entends à tous les sens du terme, car il y a une moquerie qui ajoute, une haine qui ajoute tandis que l’humour vise plutôt à la guérison, l’humour et à la rigueur la bonne ironie, disons de Candide. Il ne faut plus se laisser prendre au piège de la hargne, qui est elle-même fille de la haine. Il faut être bon, non pas sentimental ni jobard mais bon.
.
 UN LECTEUR. - Cocteau disait que, sur l’île déserte fameuse, c’est le dictionnaire qu’il emporterait en désignant, par manière de boutade, ce qu’on pourrait estimer «le livre des livres», mais cette formule convient aussi à certaines sommes de lecture dont celle que je préférais jusque-là était le formidable recueil des Plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, que vient rejoindre aujourd’hui l’épatant Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, lequel me fait regretter qu’il n’y ait pas plus d’égoïstes en ce monde d’altruistes déclarés.
UN LECTEUR. - Cocteau disait que, sur l’île déserte fameuse, c’est le dictionnaire qu’il emporterait en désignant, par manière de boutade, ce qu’on pourrait estimer «le livre des livres», mais cette formule convient aussi à certaines sommes de lecture dont celle que je préférais jusque-là était le formidable recueil des Plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, que vient rejoindre aujourd’hui l’épatant Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, lequel me fait regretter qu’il n’y ait pas plus d’égoïstes en ce monde d’altruistes déclarés.
J’aime pourtant assez ce décalage entre le mot qui juge d’avance et ce qu’on découvre qu’il désigne: c’est déjà tout un programme. On verra vite qu’égoïste ici signifie surtout personnel, non pas du tout d’un Moi narcissique mais d’un Je qui s’affirme en absorbant à la fois tous les Nous et dont le dandysme consiste à ne penser comme personne dans les mots de tout le monde.
Charles Dantzig a le sens très français, entre La Bruyère, Saint-Simon et Jules Renard, de la formule qui ramasse et sonne clair, mais ce n’est pas ce que je préfère chez lui. Je le préfère dans les développements subtils et les jugements au débotté, surtout je raffole de ce lecteur à sa pointe, pour reprendre ce terme cher au cher Baltasar Gracian.
 AU DEVERO. - Pietro Citati se lamente aujourd’hui, dans La Repubblica, en évoquant le saccage progressif des plus beaux sites d’Italie, à propos des petits villages du Tyrol méridional chers à Mahler et Hofmannstahl, et plus précisément de Versciago di Sopra (Obervierschach) qu’on est en train de dénaturer par un développement immobilier intempestif.
AU DEVERO. - Pietro Citati se lamente aujourd’hui, dans La Repubblica, en évoquant le saccage progressif des plus beaux sites d’Italie, à propos des petits villages du Tyrol méridional chers à Mahler et Hofmannstahl, et plus précisément de Versciago di Sopra (Obervierschach) qu’on est en train de dénaturer par un développement immobilier intempestif.
Or c’est le mouvement inverse que nous venons d’observer en découvrant, dans les hauts du val d’Ossola, le parc naturel du Devero dont les grands espaces d’une somptueuse sauvagerie évoquent l’Amérique plus que l’Europe, à cela près que, dans les villages en train de (re) prendre conscience de leur patrimoine, l’effort de résister au nivellement et à l’uniformisation se ressent comme un nouveau sursaut de ces populations alpines à longue mémoire.
A tous les étages habités du Devero, qu’on atteint par une route très escarpée en bifurquant, sur la route sur Simplon, à quelques kilomètres en aval de Domodossola, l’on est ainsi frappé par le goût des reconstructions à toits de pierre et boiseries dans le style des Walser, autant que, passé le barrage à toute circulation automobile, par la qualité des chemins piétonniers. Le céleste bleu pur du 18 août a fait affluer, de Milan et de partout, une inconcevable procession d’automobiles, toutes garées le long de la route de montagne, sur des kilomètres et des kilomètres. Vision buzzatienne des enfers du XXe siècle que cet interminable scolopendre multicolore, mais au-delà d’un hallucinant tunnel non éclairé traversant la montagne de part en part: halte-là, tout le monde continue pedibus. La foule est encore dense sur la moquette de gazon du vaste amphithéâtre du premier val Devero, mais au fur et à mesure qu’on s’élève, par les paliers successifs d’une espèce d’escalier montant vers le ciel à travers les forêts de châtaigniers dominant des lacs vert émeraude, et par d’immenses hauts plateaux de tourbières traversées de ruisseaux d’une traînante limpidité, jusqu’aux citadelles rocheuses découpant là-haut leurs créneaux dentelés, les marcheurs se font plus rares et, en fin de journée, c’est dans une solitude absolue que nous serons redescendus à travers ces jardins suspendus coupés de falaises à pic, de cascades aux eaux fumantes et de vertigineuses vires.
Ce que nous aurons apprécié le plus, cependant, au terme de cette balade, c’est de retrouver de vrais hôtes à l’italienne, le soir, à l’Albergo della Baita (ce nom signifiant maison), sur l’alpage de Crampiolo, entre la sainte petite chapelle et le torrent; cet accueil jovial et sans chichis, et cette cuisine généreuse et variée, servie sans compter et sans cesser de sourire par les gens de la Signora Rosa: cette Qualité, cette civilisation naturelle, cette vraie culture transmise, cela même que l’esprit de lucre ou le seul souci de rentabilité altèrent un peu partout, mais dont certains retrouvent aujourd’hui la valeur.
Je trouve juste et bon que Pietro Citati, grand lecteur de Proust et de Kafka, l’exemple à mes yeux de l’honnête homme, prenne à cœur de s’indigner contre l’atteinte, justement, à ce qui a fait la Qualité de ce pays, dans la mesure où la civilisation et la culture englobent l’aspect des maisons et des jardins, la cuisine autant que la conversation, le souci une fois encore de perpétuer ladite Qualité. J’espère seulement ne pas idéaliser celle que j’ai ressentie, n’était-ce qu’en passant, chez les Piémontais de ce haut-lieu du Devero où nature et culture semblent encore en consonance.
(Alpage de Crampiolo, ce vendredi 19 août)
DE L’ADMIRATION. - Charles Dantzig admire et c’est assez rare par les temps qui courent, mais plus encore il fait l’éloge de la transmission, et c’est ce qui me le rend infiniment proche, quand notre époque d’atrophie répand le nouveau provincialisme dans le temps (dont parlait T.S. Eliot) qui nous fait rejeter tout ce qui nous a précédés.
Nous sommes tous contemporains de Lucrèce et de Pascal, de Proust ou de Max Jacob au moment de les lire, tandis que le temps passé dans une page insignifiante est déjà ce qu’on dit un temps mort.
Proust ou l’enfant despote.
 ROMANCIÈRE. - Il a fait ce dimanche le temps le mieux approprié à la lecture de L’Adieu au nord, le nouveau roman de Pascale Kramer, achevé dans un train fuyant le nord, précisément, et l’énorme pluie faisant déborder les rivières et les lacs, après qu’une très vieille dame, droite comme une figure de Beckett, m’eut fait remarquer qu’il n’avait jamais si bien plu cette année, soulignant ensuite que «quand il pleut il pleut»…
ROMANCIÈRE. - Il a fait ce dimanche le temps le mieux approprié à la lecture de L’Adieu au nord, le nouveau roman de Pascale Kramer, achevé dans un train fuyant le nord, précisément, et l’énorme pluie faisant déborder les rivières et les lacs, après qu’une très vieille dame, droite comme une figure de Beckett, m’eut fait remarquer qu’il n’avait jamais si bien plu cette année, soulignant ensuite que «quand il pleut il pleut»…
Or il se dégage, de ce dernier livre de Pascale Kramer, et plus encore que les précédents, Les vivants et Retour d’Uruguay, une sensation de malaise voluptueux qui relève à la fois de l’atmosphère extérieure et de la température des corps des personnages, de l’air et de la peau, de la mer et des humeurs à tout instant changeantes d’Alain, le trentenaire fou de désir à l’approche de la femme-enfant Patricia, et de tous ceux qui gravitent autour de ce couple mal parti, qui m’évoque ces deux amants de L’Enfer de Dante s’accrochant follement l’un à l’autre et s’entraînant mutuellement dans une chute à n’en plus finir.
C’est l’histoire d’une passion confuse dont le climat rappelle celui du Coup-de-vague de Simenon, avec ce même quelque chose de moite et de sensuel, de tendre et de maladroit, de très physique et d’à fleur de peau où tout est exprimé sans un dialogue, par des gens qu’on pourrait presque dire sans langage mais dont la romancière nous fait ressentir toutes les nuances des sensations et des émotions, de la manière à la fois la plus directe et la plus diffuse, la plus crue et la plus sensible aussi.
Rien n’est jamais sûr dans les romans de Pascale Kramer, sauf qu’on est là et que ça fait mal, surtout ce désir lancinant qu’il y a entre l’homme et la femme et tous les malentendus qui en découlent et l’exacerbent, avec pour Patricia la rage initiale d’échapper à son salaud de père et chez Alain une sorte de «tyrannie masochiste» qui le torture et le pousse à des violences insensées
C’est une bête étrange qu’un romancier, et là ça ne fait pas de doute: Pascale Kramer, à l’instinctive et avec une croissante puissance d’expression, qui n’exclut pas ici et là quelque pesanteur, s’impose comme un véritable médium du roman, proche une fois encore du meilleur Simenon mais avec son registre tout personnel doux et dur, tendre et vrai.
NOTHOMB. - On a déjà parlé de scandale à propos du nouveau roman d’Amélie Nothomb, mais je ne vois pas, pour ma part, qu’il y ait de quoi s’indigner du fait qu’elle situe Acide sulfurique dans un camp de concentration devenu le lieu de mise en spectacle télévisuelle de la souffrance. La conjecture romanesque a toujours consisté, et notamment dans le domaine de la fable, a pousser une situation à son extrémité, et l’auteur des Combustibles ne fait pas autre chose qu’illustrer, ici, la tendance répandue dans notre société à donner en pâture, à un public supposé vampire, les images du malheur et de la misère.
Amélie Nothomb imagine que, pour le tournage d’une série de télé-réalité intitulée Concentration, toute une organisation se met en place, qui va planifier la déportation d’une population dont la seule caractéristique sera d’appartenir au genre humain, dans un camp où tout sera filmé, du Tunnel inutile qui sera creusé par les détenus aux latrines et aux moindres recoins où les uns et les autres se réfugieront.
D’aucuns taxeront peut-être Amélie Nothomb de cynisme, alors que c’est ceux qu’elle ne fait que singer qui le sont évidemment, cyniques: les organisateurs de reality-shows débiles, qui vampirisent la vie au seul bénéfice du spectacle.
La notion de bon génie de la Cité, pour l’écrivain ou l’artiste, me plaît assez, surtout depuis que des gens comme Berdiaev ou Chesterton m’ont aidé à me délivrer du ressentiment que nourrit la révolte des fils de bourgeois. Entre incendiaires et sauveteurs, je me préfère sauveteur.
 MORALISTES U.S. - Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subi vers leur dixième année de la part de leur entraîneur de football.
MORALISTES U.S. - Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subi vers leur dixième année de la part de leur entraîneur de football.
Dénoncer la pédophilie est une chose, mais faire ressentir quasi physiquement de quoi il retourne est une autre affaire, qui me semble réussie dans Mysterious skin, non du tout de façon moralisante mais de manière à la fois sourde et très directe. Lorsque, à la fin du film, l’un des deux garçons, devenu prostitué après que son abuseur l’eut en somme «élu», raconte comment, comme un jeu, le grand sportif lui avait enseigné à lui enfiler son petit poing et son petit bras dans l’anus, selon la pratique connue du fist fucking, nul jugement n’est formulé mais le sentiment physique de l’énormité de l’abus, bien plus encore que l’éventuel dégoût, nous fait partager la stupéfaction de l’autre garçon qui, pour sa part, a englouti ces péripéties dans un trou noir de sa mémoire.
Il y a dans Mysterious skin une scène très belle où l’on voit un vieux sidéen à catogan, l’air artiste décavé, demander au jeune prostitué de le masser, ce que le jeune homme fait tout chastement comme il le ferait à son père ou au père de son père dont son client à l’âge, et c’est à la fois triste à mourir et beau. Tout est triste et beau dans Mysterious skin, comme dans Ken Park, et c’est pourquoi je parle de films moraux, au sens d’une dignité défendue avec plus d’amour et de respect humain que par les ordinaires sermons.
Ni l’un ni l’autre, sans doute, ne sont des chef-d’oeuvre, mais chacun d’eux est un beau film, de la même radicale honnêteté. De tous deux émane la même sombre poésie et la même vérité humaine que de jeunes acteurs modulent avec une rare justesse.
CRÉPUSCULE. - Il a fait ce soir un crépuscule indicible où le rose bleuté du lac aux airs de fleuve immobile, le mauve orangé des montagnes de Savoie et le ciel pervenche flammé d’or doux, par delà tous les verts du val suspendu que surplombe notre nid d’aigle, semblaient flotter hors du temps, et c’est ainsi que ma lecture de La possibilité d’une île, amorcée cet après-midi dans le triple bleu du bord du lac exténué de soleil, sur la plage interdite de la réserve naturelle où je défie les vigiles à chiens allemands, se poursuivait en oscillant de l’instant présent au lointain futur.
(A La Désirade, ce mardi 30 août)
 GOYA. - Chacun de ses portraits m’apparaît comme une rencontre: à chaque fois on est surpris par la folle individualité du personnage représenté, et chaque fois on remarque que de sa propre rencontre a découlé la manière du peintre, tantôt protocolaire et tantôt plus familière, subtilement narquoise dans le mise en valeur du Comte de Fernan Nunez en jeune héros romantique dont on subodore la suffisance, ou vibrant de tendresse filiale lorsqu’il représente son petit-fils Mariano Goya.
GOYA. - Chacun de ses portraits m’apparaît comme une rencontre: à chaque fois on est surpris par la folle individualité du personnage représenté, et chaque fois on remarque que de sa propre rencontre a découlé la manière du peintre, tantôt protocolaire et tantôt plus familière, subtilement narquoise dans le mise en valeur du Comte de Fernan Nunez en jeune héros romantique dont on subodore la suffisance, ou vibrant de tendresse filiale lorsqu’il représente son petit-fils Mariano Goya.
Jamais Goya ne triche à ce qu’il semble, s’exposant lui-même à l’instant de traduire tout ce que lui inspirent ses modèles, sans les flatter le moins du monde. Ainsi de Charles III en tenue de chasse dont la tronche rubiconde se détache sur la conque rose bleuté d’un ciel immense, alors que l’esquisse du Duc de San Carlos capte au vol la dureté et la trouble complexité d’un autre grand personnage.
La rencontre la plus émouvante m’a paru celle de la Comtesse de Chinchon en son nuage de soie presque immatérielle, dont la douceur de l’expression est accentuée par le fait qu’on la sait en espérance.
Touchant de vérité jusque dans ses travaux de cour, Goya nous bouleverse dans ses représentations plus spontanées et véhémentes de la détresse humaine, comme dans cet asile de fous dont les visions angoissantes font pendant à celles des Désastres de la guerre.
Il y a là tout l’homme du haut en bas de la société, avec ses joies et ses angoisses, ses âges en balance (Célestina et sa fille, sur ce même balcon qu’on retrouvera chez Manet) et le mélange de souffrance et de confiance que me semblent symboliser les bras grand ouverts du Christ de La prière au jardin des Oliviers, dont le dépouillement pascalien vibre de la plus humble humanité.
Un romancier devrait oser être bête autant que poreux et précis. Certaine idiotie (mais rusée, s’entend) est pour ainsi dire la clef de son rapport avec la réalité et les gens. Il ne doit pas être trop intelligent ni trop lucide. Sans faire la bête, il doit se laisser aller à la naïveté ou aux élans irraisonnés, à tout ce qui fait l’imprévu de la vie et des êtres.
 HOUELLEBECQ. - Il me semble que c’est un livre sérieux que La possibilité d’une île, ce roman déjà «mythique» de Michel Houellebecq, dont les 100 premières pages sont beaucoup plus finement tressées que celles de Plateforme, que j’ai pourtant apprécié mais qui virait au feuilleton démonstratif, plus nourries aussi de nuances que celles de Particules élémentaires, d’une prose peut-être moins immédiatement «originale» que celle d’ Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus loin et avec plus d’énergie.
HOUELLEBECQ. - Il me semble que c’est un livre sérieux que La possibilité d’une île, ce roman déjà «mythique» de Michel Houellebecq, dont les 100 premières pages sont beaucoup plus finement tressées que celles de Plateforme, que j’ai pourtant apprécié mais qui virait au feuilleton démonstratif, plus nourries aussi de nuances que celles de Particules élémentaires, d’une prose peut-être moins immédiatement «originale» que celle d’ Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus loin et avec plus d’énergie.
Cela surtout me saisit d’emblée, comme à la lecture de la dernière trilogie américaine de Philip Roth. Houellebecq n’en est pas à ces hauteurs mais il y tend: il nourrit son roman d’un souci d’expliquer le siècle et les gens, tels qu’il les voit, comme il en souffre, avec une profusion d’observations qui en impose. Mais il n’y a pas que ça: tout cela vit et vibre. Les personnages ont gagné en étoffe, et la langue traduit la jubilation de l’auteur, sûr qu’il est en train de nous jouer un bon tour.
A la TV, reportage sur les animaux abandonnés à la SPA. Les regards de ces chiens: celui qui a le cou littéralement scié (plaie ouverte sur tout le pourtour par une laisse en fil de fer) ou le petit clebs tremblant comme une feuille, rendu fou par on ne sait quoi ou qui, entre autres victimes de l’impitoyable sentimentalité humaine.
Je dois lutter moi aussi contre le sentiment de l’homme ridicule, observé par Dostoïevski, selon lequel tout est égal. Une vraie diablerie là-dedans. Pour ma part je suis également tenté par ce relativisme absolu, mais je lutte contre cela.
En regardant ma fille cadette je constate son souci et cela me fortifie. Même souci chez ma fille aînée et chez ma bonne amie. Modèles de bonne volonté naturelle contre la résignation ou la désespérance.
 AU PRÉSENT ABSOLU. - Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: « Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ? »
AU PRÉSENT ABSOLU. - Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: « Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ? »
Je vois ces idéogrammes sans les comprendre, mais c’est alors qu’il m’apparaît que les mots parlent en deça et au-delà des mots, comme le corps se fait âme lorsqu’il danse, et quand je dis le corps “en chinois” je pressens qu’il est corps du pain et du vin et que son âme le déborde et le prolonge tant dans les sept sens que dans les songes de la mélancolie.
Tout à l’heure, et c’était en l’an 700, là-bas à la corne du bois je fermais les yeux dans le parfum du soir et je traduisais en murmure ces traits ailés de pinceau depuis des siècles redevenu poussière: « Des jeunes filles se sont approchées de la rivière; elles s’enfoncent dans les touffes de nénuphars; on ne les voit pas, mais on les entend rire; et le vent se charge de senteurs en passant dans leurs vêtements ».
Et mille deux cents ans plus tard, rentré dans ma trappe, j’avais les yeux ouverts sur le journal et je me rappelais les mots de Tou Fou: « A la frontière, le sang humain se répand, formant des lacs. Mais l’ambition de l’Empereur n’est pas satisfaite! »
LA FORMULE. - Ne parvenant pas à remettre la main sur mon exemplaire, sûrement prêté et non rendu d’En ce moment précis de Dino Buzzati, j’en reviens à la version italienne et me relis ce premier fragment intitulé LA FORMULE et que je traduis à la diable: «De qui as-tu peur, imbécile? De la postérité peut-être? Alors qu’il te suffirait tout simplement de cela: être toi-même, avec toutes les stupidités que cela suppose, mais authentique, indiscutable. La sincérité absolue serait, en soi, tel un document? Qui pourrait t’opposer la moindre objection? Voici l’homme, un parmi tant d’autres, mais celui-ci. Et pour l’éternité les autres, interdits, seraient contraints à en tenir compte ».
NE PAS DÉRANGER. – Telle est l’inscription que je lis au front de tant de blasés et de paresseux, de prétendus beaux esprits et de bien pensants suant l’ennui - ceux-là même qui, l’air grave, se pâmeront devant tel film ou tel livre «dérangeant»
UN RÊVE. - J’ai fait cette nuit ce rêve étrange en langue italienne, ce rêve de vraie vie révélée dans la lumière oblique. Je me trouvais dans la grande nuit italienne, revenant d’un long voyage et tout à coup je me trouvais à proximité d’une maison dont une fenêtre ouverte était restée allumée et, m’approchant, je reconnaissais la chambre que j’avais quittée je ne savais depuis combien de temps, et sur la table il y avait ce livre ouvert dont je déchiffrais ces mots en langue italienne dans la lumière oblique: «Un calendrier restreint, ponctué d’épisodes suffisants de mini-grâce (tel qu’en offrent le glissement du soleil sur les volets, ou le retrait soudain, sous l’effet d’un vent plus violent vent du Nord, d’une formation nuageuse aux contours menaçants) organise mon existence, dont la durée exacte est un paramètre indifférent».
Sous le souffle lunaire les pages se tournaient et je lus encore «C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre, /Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir…», je lus encore au vol «Je n’entendais même plus ma propre respiration, et je compris alors que j’étais devenu l’espace», enfin ces derniers mots scintillèrent dans la nuit italienne: «Il existe au milieu du temps/La possibilité d’une île»…
A mon réveil, à fleur de conscience, lorsque la mémoire est encore un obscur océan aux haleines mêlées, j’ai resongé à cet autre voyage dans cette nuit étrangère qu’a représenté pour moi la lecture de La possibilité d’une île de Michel Houellebecq, dont le son unique retentit encore en moi. Je n’ai cessé de sourire tout au long de cette lecture, avec une sorte de nostalgie anticipée qui me rappelait à tout instant l’amour que j’ai de la vie et des gens, comme aiguisé par la haine que Daniel 1 prétend nourrir pour la vie et les gens, que je voyais avec le recul de Daniel 25, de son promontoire du quarantième siècle. Tout au long de cette lecture je n’ai cessé de songer avec plus de tendresse à notre pauvre humanité mal fichue et, me rappelant nos interminables débats métaphysiques ou pseudo-métaphysiques de jeunes gens, dans la tabagie des bars, à tous les futurs qu’on aura imaginés jusqu’à ce quinzième chapitre du roman où Daniel 25 écrit: «Parfois, la nuit, je me relève pour observer les étoiles».
FELLINI. - Toute l’Italie est là, et toute notre adolescence de lecteurs de romans-photos, en ces années cinquante où nous collectionnions, assorties à chaque paquet d’odorant chewing-gum, les effigies polychromes d’Ava Gardner et de James Dean, de Gary Cooper ou de Nathalie Wood, dont les plus âgés avaient vu, au cinéma de quartier Le Colisée, La loi du Seigneur ou La fureur de vivre.
Il n’y avait alors qu’une télévision dans le quartier où les plus jeunes, une fois par semaine et moyennant le versement de cinquante centimes, suivaient les épisodes de Lassie chien fidèle, mais déjà les plus grands s’en allaient en stop de par les routes - et jusqu’en Italie parfois...
 REBATET LE FASCISTE. - Dix ans après la mort de Céline, Lucien Rebatet passait, au début des années 1970, pour l’écrivain le moins fréquentable de la France littéraire. Condamné à mort pour faits de collaboration, il avait échappé de justesse au poteau après des mois, les chaînes aux pieds, à attendre le peloton. Des propagandistes du fascisme, il avait été le plus frénétique par ses écrits, notamment dans les colonnes de Je suis partout, plus encore dans le pamphlet furieusement antisémite intitulé Les décombres, paru en 1942 et qui lui valut ( !) un énorme succès. Connu de ses amis pour sa couardise physique, Rebatet s’était comporté, face à ses juges, avec une indignité complète. Autant dire qu’un tel personnage n’avait rien que de rebutant. Mais Lucien Rebatet avait écrit, en prison, un roman magnifique : Les deux étendards. Je l’avais lu à vingt-cinq ans, quelque temps après m’être éloigné du gauchisme bon teint. Un voyage en Pologne, la découverte du Rideau de fer et du socialisme réel, la lecture de Stanislaw Ignacy Witkiewicz et maintes conversations sur les méfaits du communisme, dans le cercle des amis de L’Age d’Homme, me portaient naturellement à prendre le contrepied du conformisme intellectuel de l’époque, à l’enseigne duquel un Rebatet faisait figure d’« ordure absolue ». Avec les encouragements de Dominique de Roux et de Dimitri, je me pointai donc un jour, moi qui n’était ni fasciste ni antisémite non plus, chez ce petit homme perclus d’arthrose, vif et chaleureux, qui ne tarda à me lancer qu’à mon âge il eût probablement été, lui, un maoïste à tout crin...
REBATET LE FASCISTE. - Dix ans après la mort de Céline, Lucien Rebatet passait, au début des années 1970, pour l’écrivain le moins fréquentable de la France littéraire. Condamné à mort pour faits de collaboration, il avait échappé de justesse au poteau après des mois, les chaînes aux pieds, à attendre le peloton. Des propagandistes du fascisme, il avait été le plus frénétique par ses écrits, notamment dans les colonnes de Je suis partout, plus encore dans le pamphlet furieusement antisémite intitulé Les décombres, paru en 1942 et qui lui valut ( !) un énorme succès. Connu de ses amis pour sa couardise physique, Rebatet s’était comporté, face à ses juges, avec une indignité complète. Autant dire qu’un tel personnage n’avait rien que de rebutant. Mais Lucien Rebatet avait écrit, en prison, un roman magnifique : Les deux étendards. Je l’avais lu à vingt-cinq ans, quelque temps après m’être éloigné du gauchisme bon teint. Un voyage en Pologne, la découverte du Rideau de fer et du socialisme réel, la lecture de Stanislaw Ignacy Witkiewicz et maintes conversations sur les méfaits du communisme, dans le cercle des amis de L’Age d’Homme, me portaient naturellement à prendre le contrepied du conformisme intellectuel de l’époque, à l’enseigne duquel un Rebatet faisait figure d’« ordure absolue ». Avec les encouragements de Dominique de Roux et de Dimitri, je me pointai donc un jour, moi qui n’était ni fasciste ni antisémite non plus, chez ce petit homme perclus d’arthrose, vif et chaleureux, qui ne tarda à me lancer qu’à mon âge il eût probablement été, lui, un maoïste à tout crin...
Les lignes qui suivent, datant de mars 1972, reprennent l’essentiel de l’entretien que je publiai dans La Feuille d’Avis de Lausanne au lendemain de ma visite, qui me valut pas mal d’insultes, de lettres de lecteurs indignés et même une agression physique dans un café lausannois. Bien fait pour celui qui se targuait d’indépendance d’esprit…
« Vingt ans après la parution de son plus beau livre, Les deux étendards, Lucien Rebatet se trouve toujours au ban de la plupart des nomenclatures du roman français contemporain, son nom ne se trouvant prononcé, par les professeurs de littérature et les critiques, qu’avec le mépris réservé en général aux assassins et aux filous. La raison de cette conspiration du silence : ses opinions politiques. Rebatet fut en effet partisan, jusqu’à la dernière heure, du national-socialisme, « et de l’espèce la plus frénétique », ajoute-t-il lui-même.
Je l’imaginais de haute taille et tonitruant, et je l’ai trouvé plutôt frêle, petit, en robe de chambre et les mains déformées par le rhumatisme, l’œil rieur, d’une gentillesse vous mettant tout de suite à l’aise alors qu’il vous accueille comme s’il vous connaissait depuis longtemps. J’imaginais un intérieur de grand bourgeois cossu (il réside dans l’un des quartiers huppés de Paris) et je suis entré dans un appartement modeste, seuls le bureau et la bibliothèque du maître des lieux en imposant quelque peu. Très vite, le contact allait s’établir : à soixante-neuf ans, Lucien Rebatet m’a sidéré par sa jeunesse d’esprit.
Or il a commencé par évoquer sa condition de proscrit : « Comme on ne m’a pas fusillé, vous comprenez qu’il fallait au moins me clouer le bec. Brasillach liquidé, on pouvait reconnaître son talent. Mais le nazi Rebatet, un écrivain valable ? Pensez donc ! Notez que ma consolation vient des jeunes, qui me semblent beaucoup plus intelligents que leurs aînés. Ils sont ainsi très nombreux à m’écrire, pour me dire qu’ils discutent ferme autour des Deux étendards.
« Sans fausse modestie, Lucien Rebatet parle de son chef-d’œuvre avec passion. Il sait bien que les succès annuels de la moulinette littéraire disparaîtront peu à peu des mémoires, et que Les deux étendards demeureront. Pourtant, avant d’aborder plus longuement ce livre qui a motivé ma visite, j’aimerais qu’il s’exprime à propos de ses positions politiques dont je saisi mal les tenants.
« Ah ! vous savez, notre génération a été sacrifiée par la politique. Vous n’avez pas idée, vous qui êtes né après la guerre, de la férocité de la lutte que nous avons dû mener. C’est que la France, en ce temps-là, était dans une pagaille invraisemblable. Vous avez lu Les décombres, hein ? C’était ça, la France : tout y était corrompu, et nous sentions qu’il fallait dire non. Non à la corruption, non au désordre, non au communisme ! Mais allez : à part la lutte contre les « cocos », tout cela est du passé. Un jour, j’ai d’ailleurs écrit dans Rivarol que les gens de mon bord seraient prêts à confesser leurs erreurs, le jour où ceux du bord opposé en feraient autant… »
Suivent quelques propos sur la situation politique actuelle, les « maos » en France, Sartre et la mort tragique d’Overney (« C’est ces intellectuels boutefeu qu’on devrait arrêter, et pas les petits gars qui militent ! », lance-t-il à ce propos), ou le rappel des jours qu’il passa à Sigmaringen en compagnie de Céline : « Il était inénarrable, surtout quand il insultait les Boches. D’une verve prodigieuse ! Il parlait véritablement sa littérature ! »
Dans ses moments d’emportement, Rebatet semble cependant m’adresser un clin d’œil, comme sous l’effet de la distance prise : « Voyez-vous, je ne suis pas un politique. J’ai toujours été mal à l’aise dans ce monde-là. Et je ne suis pas un homme de lettres non plus, Disons que je suis une sorte de propagandiste de certaines idées. » Et comme je m’en étonne, il précise : « Oui, la littérature a toujours été, pour moi, un manifeste, comme dans Les décombres, ou un luxe et une joie, comme dans Les deux étendards. »
Ensuite, comme je lui demande s’il n’y a pas aussi un moraliste chez lui : « Pas moraliste pour un sou s'il s’agit de défendre la Morale ou les Valeurs bourgeoises. Vous le savez bien : le capitalisme est une sorte de vol organisé. Mais si vous le prenez dans le sens où l’entendait un Brice Parrain, alors d’accord : moraliste, si l’on considère que la philosophie doit servir à améliorer l’homme… »
Mais venons-en aux Deux étendards, dont il faut situer d’abord le cadre du grand débat qui s’y développe. Entre Paris et Lyon, trois jeunes personnages à l’âme ardente : Michel Croz, garçon de vingt ans qui débarque à Paris dans les années 1920 pour y achever ses études. Ancien élève des pères, qu’il abhorre, il découvre l’art et la volupté, ainsi que sa vocation d’écrivain. Parallèlement, son ami Régis Lanthelme, resté à Lyon, lui apprend qu’il va entrer chez les jésuites alors même qu’il vient de tomber amoureux fou d’une jeune fille du nom d’Anne-Marie. Michel tombe à son tour amoureux de la belle et, pour s’en approcher, tente de se convertir à la religion qui unit ses deux amis. Peine perdue. Or, fondu dans une histoire d’amour impossible (Anne-Marie ne pouvant suivre ni Régis ni Michel dans leurs croisades opposées pour le Ciel et la Terre), les débat des Deux étendards fait s’empoigner un défenseur de la « religion des esclaves » (le christianisme selon Rebatet) et son contempteur, le nietzschéen Michel.
« Michel Croz, m’explique l’écrivain, est un contestataire avant la lettre. Ce qui le concerne est en partie autobiographique. Il me ressemble. Mais à vingt ans, il est beaucoup plus intelligent que je l’étais, moi. En face de lui, Régis appartient au passé. On pourrait même dire que c’est un personnage historique, comme si le roman se déroulait au XVIe siècle. De nos jours, sa foi d’acier en ferait un intégriste rejeté par l’Eglise romaine, une sorte d’abbé de Nantes. Quant à Anne-marie, c’est vraiment ma fille. Elle a des traits de femmes que j’ai connues, sans doute, mais le personnage, dans sa vie propre et sa manière de s’exprimer, est entièrement inventé ».
A la question, que je lui pose alors, de savoir où il se situe aujourd’hui par rapport à son roman, Lucien Rebatet me répond qu’il lui reste tout proche : « Comme je vous l’ai dit, la jeunesse m’y fait revenir sans cesse. Et puis, les jours où l’on se trouve dans un livre qui marche bien sont les plus beaux de la vie avec l’amour quand on est jeune… »
J’aimerais en savoir plus, cependant, sur les circonstances dans lesquelles son roman a été composé.
« Le 8 mai 1945, j’ai été arrêté par la Sécurité militaire à Feldkirch, en Autriche. J’étais parvenu au chapitre XXVII du livre. Grâce à ma femme, demeurée en liberté, qui se démena pour faire rapatrier mon manuscrit, j’ai pu reprendre mon travail en cellule. A Fresnes, j’étais enfermé en compagnie d’un bandit corse que je bourrais de romans policiers pour le faire taire. La condamnation à mort tomba le 23 novembre 1946. Dès lors, je passai 141 jours les chaînes aux pieds, pendant lesquels j’achevai ce qui allait devenir Les deux étendards. Enfin, sur l’intervention de Claudel, qui estimait qu’on ne pouvait exécuter l’homme qui avait déculotté Maurras, je fus gracié par Vincent Auriol le 12 avril 1947. Ma peine étant commuée en travaux forcés, j’allais être transféré à Clairvaux, séparé de mon manuscrit pendant deux ans… »
Evoquant sa captivité, Lucien Rebatet s’en rappelle les affres autant que les aspects positifs : « Sur le plan de l’existence quotidienne, ce fut un enfer stupide, même pour les politiques. Mais pour écrire, c’était extraordinaire. Tous les soirs, on m’enfermait dans une « cage à poules » de 2mx2m où régnait une paix royale. De six heures à minuit, j’écrivais sans discontinuer. En novembre 1949, enfin, la dactylographie de mon roman, représentant 2000 pages environ, me parvint par une voie clandestine. J’y travaillai encore dix mois puis il me quitta, entièrement tapé, par l’entremise d’un charcutier qui fournissait notre cantine. Ma libération eut lieu l’année de la parution du livre, en juillet 1952, après sept ans de prison. »
La conversation, largement arrosée de whisky, s’est prolongée des heures, jusqu’au déclin du jour. Après que Madame Rebatet eut annoncé la nécessité de se préparer pour une séance de cinéma (sous le nom de François Vinneuil, Rebatet tient aujourd’hui encore une chronique cinématographique, avec une pertinence qui n’a d’égale que sa connaissance encyclopédique de la musique), les interlocuteurs se sont levés dans la pénombre et se sont dirigés vers la porte sans que l’écrivain ne cesse de s’adresser à son visiteur: « L’art nous permet de mieux exister, n’est-ce pas ? Voilà ce qu’il nous reste, mon vieux : un certain nombre de valeurs aristocratiques, que ceux qui en ont le désir et la volonté doivent développer. La lucidité, d’abord, et la lucidité partout et à tout instant. Ce qui me paraît très grave, dans l’art d’aujourd’hui, c’est que de nombreux créateurs ne semblent tendre qu’au néant et à la désintégration. Ce qu’il nous faut, au contraire, c’est construire, réinventer des formes correspondant à notre temps, en individus et non en troupe grégaire. »
DE LA COULEUR. - Les mots sont une chose, mais la couleur me manque depuis quelque temps, et l’aquarelle n’est pas autre chose à mes yeux: c’est la couleur. C’est une énigme que la couleur. J’ai beau savoir qu’elle s’explique scientifiquement: je ressens tout autre chose avec la couleur, et qui n’a rien à voir avec la symbolique, la psychologie ou l’ésotérisme.
Chez moi la couleur est une composante de l’affectivité et de l’Eros, c’est une manifestation dionysiaque, mais pas en aquarelle – ou rarement, car l’aquarelle telle que je la pratique est essentiellement apollinienne. Il y a cependant une aquarelle qu’on pourrait dire de fusion et qui rejoint alors l’huile la plus «érotique», ainsi que l’illustre le mieux, me semble-t-il, un Turner.
 DANTEC. - On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais vraiment apprécié Dantec jusque-là, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose sans voir vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant à l’évidence de substances nocives.
DANTEC. - On va de surprise en surprise à la lecture de Cosmos incorporated, et je m’en étonne d’autant plus que je n’avais jamais vraiment apprécié Dantec jusque-là, qui me semblait trop touffu dans ses romans, trop mégalo dans son journal, vraiment trop tout. Mais j’ai dû mal lire: j’ai dû trop voir les défauts de sa prose sans voir vraiment le projet de chaque livre et la vision de l’olibrius, que je classais dans la classe des timbrés intéressants à la Philip K. Dick, parano à outrance et abusant à l’évidence de substances nocives.
Or Cosmos incorporated correspond à ce que j’attends d’une nouvelle forme de narration, à la fois entée sur le Grand Récit des littératures et de la science dont parle Michel Serres, poreux au présent et pariant pour une possible écriture à venir, qui passe ici par la (ré) incarnation d’un personnage de notre monde déchu (genre tueur russe de téléfilm) en figure de héros vivant une «nouvelle enfance». Il y a là-dedans du génie visionnaire à la Tarkovski dans l’exploration de la ville contaminée de Neon Park, à la fois dépotoir électrifié en surface et souterrain dostoïevskien.
Ce livre peut donner l’impression d’un fumeux échafaudage de conjectures techno-scientifiques et de spéculations mystico-philosophiques, voire d’un indigeste brouet mêlant rogatons de contre-culture (de Burroughs aux Stooges), visions catastrophistes et relents de théologie patristique, dans le genre bric-à-brac new age, mais une lecture sérieuse révèle, je crois, un livre sérieux.
NOSTALGIE. - De seize à vingt ans ils ont tous rêvé d’Amérique mais seuls quelques-uns sont partis, et, maintenant que le temps a passé, ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus voient le pays autrement du fait que ceux qui sont revenus parlent de ce qu’ils ont vu là-bas et du pays dont ils se sont langui avant de le retrouver, et le pays est embelli d’avoir été quitté parce que le pays est vu d’Amérique, un garçon tendre encore voit l’homme dur qu’il admire en secret lui dire que les femmes de là-bas ne valent pas celles de la montagne ici quand le printemps fait bander les gars, et celui qui est revenu pose sa main sur l’épaule du plus jeune et lui murmure que nul pays n’est plus beau que les Langhe les soirs d’été, mais ce qu’il raconte est aussi fait pour chasser le plus jeune de l’ennui de ces collines, fous le camp mon garçon, ne reste pas, réponds à l’appel de la rue, ne reste pas seul avec les vieux, va tenter ta chance, va vivre ta vie…
(En relisant Travailler fatigue de Pavese)
NOCTURNE. - Les éléphants sont arrivés ce matin à Bellerive, sur la place du cirque jouxtant la plage fermée depuis peu. Ils étaient sept, encadrés de cornacs indiens, et cette apparition, au bord du lac embrumé, dans les premiers froids de la saison morte, m’a soudain rappelé l’évocation que Thomas Wolfe fait des petites aubes où, vendant son lot de journaux avant de se rendre à l’école, il assistait au montage du cirque dans sa petite ville d’Altamont, telle qu’il l’évoque dans l’une des nouvelles de De la mort au matin.
Ce souvenir du garçon courant chercher son frère à travers les ténèbres d’avant l’aube pour vivre avec lui l’arrivée des gens du cirque est immédiatement suivi d’une des ces scènes pleines de ce haut lyrisme mélancolique dont l’œuvre de Thomas Wolfe regorge: «Talking in low excited voices we would walk rapidly back toward town under the rustle of September leaves, in cool streets just grayed now with that still, that unearthly and magical first light of day which seems suddenly to re-discover the great earth out of darkness, so that the earth emerges with an awful, a glorious sculptural stillness, and one looks out with a feeling of joy and disbelief, as the first men on this earth must have done, for to see this happen is one of the things that men will remember out of life forever and think of as they die…»
L’arrivée des éléphants, ce matin, au milieu des voitures bloquées, n’avait rien de cette magie crépusculaire ni de cette grandeur muette, mais la présence d’une petite troupe d’enfants escortant les sept sages m’a fait sourire à l’idée que, dans une trentaine ou une quarantaine d’années, cette matinée revivrait peut-être dans quelques mémoires comme un moment sauvé de la grisaille des jours.
Peut-être la désinvolture est-elle encore pire que l’indifférence ?
En piochant l’autre jour dans ma bibliothèque française, je me disais «non, pas celui-ci», puis «celui-là m’embête», jusqu’au moment où je suis tombé sur Ces Merveilleux nuages de Sagan. Et là, oui, là j’ai retrouvé ce «quelque chose» de vivant et de vrai (et de surprenant à chaque épithète) que je trouve si rarement dans les livres actuels, et de moins en moins dans mes relectures, sauf chez un Simenon, dont la phrase est cependant moins électrique que celle de Sagan.
Mot d’ordre du moment: «Il faut que vous affirmiez votre position citoyenne».
 LE GRAND RECIT. - Les montagnes de Savoie ont ce matin un relief saisissant, alors que l’oblique lumière d’automne éclaire chaque détail des deux rives, du port de Clarens à celui de Saint-Gingolph, en face, avec une netteté qui cisèle aussi la fine dentelle des feuillages d’or rouillé et souligne les verts encore intenses du val suspendu que nous surplombons de notre balcon en lisière de forêt.
LE GRAND RECIT. - Les montagnes de Savoie ont ce matin un relief saisissant, alors que l’oblique lumière d’automne éclaire chaque détail des deux rives, du port de Clarens à celui de Saint-Gingolph, en face, avec une netteté qui cisèle aussi la fine dentelle des feuillages d’or rouillé et souligne les verts encore intenses du val suspendu que nous surplombons de notre balcon en lisière de forêt.
Or contemplant cette image tissée de temps et me rappelant ce que dit Michel Serres des multiples temps, justement, qui tissent un paysage, je me retrouve dans un état de silencieuse songerie qui me remplit à la fois de reconnaissance et me conforte dans la conviction que ce tissage quotidien de tous les temps du Grand Récit de la nature ou de l’Histoire (le château médiéval de Chillon jouxtant là-bas le viaduc de l’autoroute), des vies singulières des braves gens qui vaquent alentour, et de nous aussi, de nos enfants qui s’en vont pour en amener peut-être d’autres au monde, du chien Fellow et de la mésange Zoé, enfin des dizaines de milliers de livres dont les voix bruissent autour de nous, constitue à la fois le livre du jour et le nuancier approprié à l’écriture ou à la peinture du jour.
(A La Désirade, ce 8 octobre)
DE LA NUANCE. - En repensant aux intempestifs et aux péremptoires que j’ai lus (ou relus) ces derniers jours, de Houellebecq à Joseph de Maistre ou de Dantec à Léon Bloy, je me suis dit que c’est cela qui me manquait chez ceux-là: le détail et la nuance, ou plus encore: l’intimité et le silence. Des imprécateurs que je connaisse, seul Vassili Rozanov allie, avec son génie de l’immédiateté saisie dans l’instant, l’Idée et le Sentiment; et la femme est toujours proche chez l’auteur de Feuilles tombées, incarnation même de l’intimité.
Celui qui se lave du bruit par l’aquarelle / Celle qui est émue rien qu’à prononcer le nom de Schubert / Ceux qui associent de préférence le vert et le gris, etc.
CONTRE L’INSIGNIFIANCE. - Dantec s’en prend souvent et violemment, dans Le théâtre des opérations, - dont le titre guerrier annonce la démarche, et qui m’intéresse sans me convaincre -, au nombrilisme de la littérature française actuelle. Je partage en partie son point de vue, mais en partie seulement, car la réalité est mille fois plus riche et nuancée, autant que le paysage de ce matin, comme est plus riche et nuancée la littérature anglo-saxonne contemporaine, qu’il réduit à peu près au roman «pop», sans trop savoir de quoi il parle puisqu’il mélange Burroughs et Don DeLillo, qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre…
LE REGARD TIERS. - J’aime que la littérature française oppose le fulminant Léon Bloy et les non moins tonitruants Tailhade ou Vallès, conformément au dualisme propre au pays de Descartes, mais j’aime aussi me rappeler cette bonne conversation avec François Cheng qui me faisait l’éloge du regard tiers, et voici le paysan parisien Marcel Aymé ou le docteur Anton Pavlovitch Tchekhov, ou ce maître de toutes les nuances nettement dessinées que figure à mes yeux William Trevor, pour s’inscrire en faux contre tel esprit réducteur, tel froid de tels discours à la française.
 ACHOPPEMENTS. - Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros bide – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa stupidité. Ensuite, pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit une fois de plus la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.
ACHOPPEMENTS. - Je me sentais un peu flotter, ce matin, puis j’ai repris la lecture de Flannery O’Connor, dans le petit recueil de deux nouvelles tiré, pour 2 €uros, des Braves gens ne courent pas les rues, pour me retrouver aussitôt dans cette espèce de cinglante parole dont chaque mot pèse son poids de chair tout en irradiant une lumière sans pareille. Dans Un heureux événement, où il est question d’une femme qui se traîne dans sa pauvre viande et ne veut pas savoir ce que signifie son gros bide – elle a pensé que c’était un cancer et se rebiffe presque plus violemment lorsque sa voisine lui suggère que c’est peut-être un enfant -, on sent toute la révolte de Flannery contre l’égoïsme hédoniste, comme il prolifère d’ailleurs aujourd’hui, tout en nous faisant sentir l’empêtrement de cette pauvre femme dans sa crasse et sa stupidité. Ensuite, pour ce qui est de La personne déplacée, c’est au bout du déni de charité, à l’extrémité du rejet de l’autre que nous conduit l’implacable confrontation de quelques fermiers blancs et leurs domestiques noirs du Sud profond (Flannery décrit une fois de plus la campagne de Géorgie, ses populations frustes et ses prédicateurs allumés, entre autres…) et d’un Polonais arrivant en ces lieux avec les siens après avoir échappé aux camps de la mort.
On a parlé de Flannery O’Connor comme d’une sorte de Bernanos au féminin, et c’est vrai qu’il y a de ça, à cela près que l’écriture de Flannery est d’une densité poétique et d’une violence, d’un humour et d’une acuité sans pareils. On peut lire ses histoires au «premier degré», comme de fantastiques morceaux d’observation des comportements humains, dans cette Amérique de la paysannerie pauvre en butte aux conflits de races et de classes, où les prêcheurs de tout acabit foisonnent. En outre, sous les dehors les moins lénifiants qui soient (d’aucuns lui ont même reproché d’être cynique, ce qu’elle n’est pas du tout – mais il est vrai qu’elle ne s’en laisse pas conter), c’est une véritable arène d’affrontement du Bien et du Mal que les histoires de cette féroce catholique claudiquant (une horrible maladie l’a détruite encore jeune) au milieu de ses poules et de ses paons, plus souvent du côté des supposés coupables que des prétendus vertueux…
En lisant L’Outlaw de Simenon je me dis: voilà, c’est cela, le roman, il n’y avait personne et tout à coup il y a des personnages, il y a Paris et la dèche, le travail des hommes et les odeurs de la vie.
LA VIE FILTRÉE. - Je ne sais trop ce que j’aime particulièrement dans les nouvelles de William Trevor, mais je crois que c’est simplement la vie, c’est à dire la vérité singulière de la vie incarnée par tel être ou mise en évidence par telle situation, la vie médiocre et chère à la fois, non pas tant ce qu’on voudrait mais ce qui est et qui vaut aussi par référence à ce qu’on aurait voulu, ce qui est à la fois triste et qui fait sourire, ce qui nous fait dire communément que «c’est la vie»...
Nouvelle dénomination pour les pompes funèbres: l’Espace funétique.
Dans le TGV. - La Côte d’or n’a jamais si bien porté son nom qu’en cette fin de matinée d’automne aux irradiants flamboiements, et c’est comme un visage que je reconnais tout en reprenant la lecture amorcée ce matin d’un livre abordant immédiatement ce phénomène de la reconnaissance, au multiple sens du terme, d’un paysage, d’un visage ou de quelque image retrouvée de notre d’enfance, petite musique ou picturale odeur de cage d’escalier où des fantômes montent au ciel de notre mémoire comme à l’échelle de Jacob, du côté de Proust, de Freud et de Spinoza.
Je sais toujours ce que j’ai à faire du côté de Proust, surtout en TGV descendant sur Paris, avec l’idée qu’en glissant plus bas je verrai Chartres et plus bas sous les nuages tendres l’église là-bas aux vitraux mythiques, et je saurai proche la Vivonne, mais Freud et Spinoza: moi pas savoir.
Or ce matin Max Dorra m’y emmène, et là encore il est question de «retrouver la force d’exister» chez ceux qu’a menacés l’écrasement, le déni et l’excommunication. Dans le TGV il y a plein d’hommes-machines qui crépitent de formules. Un voisin disait tout à l’heure à son compère qu’il fallait gérer l’historique de l’Entreprise ou mourir.
Ne préfère-t-on pas mourir dans ces cas-là, en écoutant un peu de musique. Ah oui: le livre s’intitule: Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être?
(Dans le TGV, ce mercredi 26 octobre)
Alain Gerber me disait qu’il n’avait pas voulu d’enfant par crainte d’avoir, à ses côtés, une pendule qui lui rappelle à tout moment l’heure de sa mort. Il a compris que nous allions mourir dès l’âge de la maternelle, frappé par l’évidence, à un moment donné, que tous les parents qui l’entouraient seraient morts lorsqu’il aurait atteint leur âge... Cela me frappe d’autant plus que, pour ma part, je n’ai pris conscience de la réalité de la mort qu’à la naissance de Sophie, et que ça m’a donné une nouvelle raison de vivre..
Celui qui dit avoir enfin trouvé complémentarité et convivialité dans son nouveau job à statut flexible / Celle qui te soigne les pieds par imposition des mains / Ceux qui se déchirent dans le club des nouveaux sosies de Claude François, etc.
DE LA POROSITÉ. - Accueillir l’inattendu: quel plus beau programme pour un écrivain et, plus généralement, pour n’importe quel lecteur. Rozanov l’a saisi mieux que quiconque: je m’assieds pour écrire telle chose, et c’est telle autre qui me vient de tout ailleurs, de plus profond ou de la simple apparition de la nuque de ma bien-aimée dans telle lumière de telle instant.
Un soir à la radio, le comédien Jacques Weber disait que Shakespeare était à ses yeux le poète absolu de la porosité, incarnant l’aptitude à tout absorber et tout transmuter. Tout cela va contre tous les savoirs claquemurés, tous les pouvoirs jaloux, tous les fanatismes aussi, tous les spécialismes enfin. Ce n’est pas l’ouverture à n’importe quoi ni l’omnitolérance, mais c’est la connaissance à fleur de peau et donc à fleur d’âme
L’alcool pour pallier le froid du monde et la platitude de tout.
W.G. SEBALD. - Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, que je retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire de Séjours à la campagne, nouveau recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre: «Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer: un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en céleste clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté»…
Cette comète qui passe là-haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir basculer de son ciel idéal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une complexion culturelle et de trajectoires sociales comparables.
Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, il fallait donc voir ailleurs, et c’est ainsi que nos aïeux se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald. Celui-ci prolonge la tradition des grands promeneurs européens qui va de Thomas Platter, le futur grand érudit descendu pieds nus de sa montagne avec les troupes d’escholiers marchant jusqu’en Pologne, Ulrich Bräker le berger du Toggenburg qui traduira Shakespeare, ou Robert Walser se mettant «pour ainsi dire lui-même sous tutelle», comme l’écrit Sebald, sans cesser de griffonner de son minuscule bout de crayon sous les étoiles…
L’ENFANT. - On se sent très pur en sortant de L’Enfant des frères Dardenne: on se sent purifié, on se sent comme lavé par les larmes de Bruno et Sonia, après deux heures dures et sans autre répit que quelques jeux de gamins, deux heures comme la vie de ces deux gamins naufragés s’accrochant l’un à l’autre et se retrouvant finalement dans les larmes après trop de galère et de mensonge.
C’est un film de jungle urbaine où Bruno, qui n’a rien reçu, vole, ment, vend l’enfant que Sonia lui ramène, puis revient. C’est un film d’amour sous couvert de nécessité désastreuse et d’expédients, où l’on revient. Rien ne me touche plus que le geste de quiconque qui revient. Rien n’est jamais condamné pour celui qui revient. Et lorsque Bruno a entraîné le petit Steve si loin que celui-ci tombe aux mains des flics, là encore il revient par loyauté. C’est un film d’enfants perdus rappelant, en version contemporaine, les Uccellini uccellacci de Pasolini ou Los Olvivados de Bunuel, dont me revient à l’instant la séquence où Bruno, tabassé par des mafieux et rejeté par Sonia, se réfugie dans une espèce de cercueil en carton, au bord du fleuve - et comme un éclair de lucidité le traverse alors de part en part et le fait revenir, jusqu’à cette catharsis finale des larmes partagées.
MON CHRIST. - «Si le Christ surgissait aujourd’hui, je ne lui donnerais pas deux jours», écrivait Maurice G. Dantec dans Le Théâtre des opérations, au printemps 1999. Il en était alors à une vision très nietzschéenne du christianisme, voyant en le Christ à venir une sorte de post-homme supérieur, en lequel je ne reconnais absolument pas mon Christ à moi.
Mon Christ à moi est au milieu de nous jusqu’à la fin du monde. L’autre soir il se trouvait à genoux, au milieu d’un trottoir parisien, et son regard de terrible imploration m’a forcé, après lui avoir passé devant, à revenir en arrière puis à me présenter à lui, les yeux baissés, pour lui offrir de quoi apaiser ce que proclamait le petit carton posé devant lui: J’AI FAIM.
Ce Christ-là avait les mêmes longs cheveux sales que celui qui s’est jeté du pont aux suicidés, en plein Lausanne, il y a trente ans de ça, et dont la vision de la tête ensanglantée, dépassant de la couverture jetée sur son cadavre, me reste présente comme de ce matin.
Un autre Christ m’est apparu une autre nuit, à Paris, quand les nautoniers de la Seine ont relevé, des eaux huileuses, ce corps qui s’est défait de ses derniers vêtements au moment où il est apparu dans la lumière lunaire, blanc comme l’ivoire des statues.
Le Christ est en agonie jusqu’à la fin du monde, et pendant ce temps il ne faut pas dormir, disait à peu près Pascal.
Je l’ai vu en agonie aux soins intensifs d’un service de pédiatrie, crucifié dans le corps d’une petite fille dont les tortures furent notablement amplifiées par l’incurie prétentieuse des supposés patrons, mais soignée tous les jours par des anges. Mon Christ à moi est cette petite fille, mon église vivante est celle des compatissants qui se sont agenouillés autour de sa tombe, et tout le reste n’est qu’un bal de vampires.
Mon Christ est cette petite fille martyre à laquelle je pense en me levant dans la splendeur de ce matin d’automne, présente lorsque je ferme les yeux face à la mer ou lorsque des amants jouissent, je revois son pauvre sourire au milieu des milliers de visages défilant aux murs des couloirs d’Auschwitz, je pense moi aussi que le Christ est notre humanité en devenir, notre salut avant la mort, non pas la force du «Christ des nations» mais la faiblesse du plus humilié et du plus offensé, amen.
(1er novembre)
LECONS DE TÉNÈBRES. - Une magnifique évocation posthume de W.G. Sebald, par son ami l’artiste Jan Peter Tripp, conclut Séjours à la campagne en situant le grand art de l’écrivain dans la tradition des graveurs de la manière noire.
«Homme enseveli sous les ténèbres, ce maître du temps et de l’espace dont le regard s’animait au royaume des Ombres, n’était-il pas devenu lui-même, au fil des ans, dans son Royaume mélancolique, une sorte de plante de l’ombre? D’ailleurs, dans son pays d’adoption, l’Angleterre, la manière noire avait connu au XVIIIe siècle un épanouissement unique, porté par les plus grands artistes. Travailler en partant des ténèbres pour aller vers la lumière est une question de conscience – ôter de la noirceur au lieu d’apporter la clarté. Aussi l’habitant de l’ombre devait-il ne s’exposer qu’avec précaution à l’éclat de la lumière».
C’est exactement le processus par lequel Sebald, dans cette suite de plongées dans le temps que constituent ses approches des œuvres de Hebel, Rousseau, Möricke, Keller, Walser ou Tripp lui-même, qui sont à chaque fois des approches de visages engloutis dans la nuit du Temps, révèle progressivement les traits d’une destinée particulière cristallisant les éléments dominants de telle ou telle époque en tel ou tel lieu.
Après la terrifiante traversée de l’Allemagne en flammes, dans Une destruction, Sebald rassemble ici plusieurs avatars de la culture préalpine et du mode de vie propres à l’Allemagne du Sud et à la Suisse, dont un élément commun est cette Weltfrömmigkeit (une sorte de métaphysique naturelle ou de mystique panthéiste caractéristique du romantisme allemand) qu’il trouve chez Gottfried Keller, dont le chapitre qu’il lui consacre, à propos de Martin Salander et d’Henri le Vert, est une pure merveille.
Je n’en retiendrai que cette mise en évidence d’une scène emblématique d’Henri le Vert, aussi profondément poétique que l’évocation proustienne des livres de Bergotte survivant à celui-ci dans une vitrine à la manière d’angéliques ailes déployées, où l’on voit Henri ajuster, sur le cercueil de sa cousine Anna, une petite fenêtre de verre sur laquelle, en transparence, il découvre le reflet d’une gravure de petits anges musiciens. Et Sebald de préciser aussitôt: «La consolation qu’Henri trouve dans ce chapitre de l’histoire de sa vie n’a rien à voir avec l’espérance d’une félicité céleste (…) La réconciliation avec la mort n’a lieu pour Keller que dans l’ici-bas, dans le travail bien fait, dans le reflet blanc et neigeux du bois des sapin, dans la calme traversée en barque avec la plaque de verre et dans la perception, au travers du voile d’affliction qui lentement se lève, de la beauté de l’air, de la lumière et de l’eau pure, qu’aucune transcendance ne vient troubler»…
DU SENS. - De plus en plus conscient, et à tout moment, du côté néant de toutes nos petites entreprises. Mais là, précisément, dans la tension de cette conscience, que faire devient réellement intéressant et je dirai presque: facile. En tout cas sensé et motivant. Et cela compte à cette époque de démission et de consentement massif. Retrouver le sens de sa vie, ou plus exactement: retrouver le sens de LA vie en redonnant un sens à SA vie.
Rozanov a l’air d’écrire sur des feuilles d’air.
DIEU. – C’est le soir, ce matin je lisais ce qu’écrit Max Dorra sur l’heureuse rencontre que constitue le Dieu de Spinoza, j’y ai pensé toute la journée, j’y ai pensé en nageant 500 mètres en brasse coulée, j’y ai pensé en faisant l’acquisition d’un Bouddha de l’époque Song entièrement rongé par les termites à l’exception de l’impassible visage au sourire doux qui a traversé sept siècles avant de rayonner ce soir dans notre maison au bord du ciel, et j’y pense encore à l’instant en lisant le Manuel de contemplation en montagne d’Yves Leclair ou je copie à l’instant: «Tout le monde dort dans la paume d’un Dieu qui rêve», et je lis en moi: «Tout le monde rêve dans la paume d’un Dieu qui dort», et Dhôtel cité par Leclair: «L’univers vagabonde comme un enfant à travers ses abîmes. Mais il n’y a rien, absolument rien que le temps de Dieu, que chacun mesure à sa façon.»
(A La Désirade, ce 12 novembre).
CONFORMISME. - Bien plus que la différence, dont on nous rebat les oreilles et qui signifie peu de chose à mes yeux, c’est la ressemblance qui m’importe en cela qu’elle surmonte les particularismes raciaux, sociaux ou sexuels au bénéfice de valeurs plus fondamentales.
L’exaltation de la différence fleure déjà, à mes yeux, l’esprit de clan ou de secte, avec ce relent de ressentiment et de revendication qui cherche à forcer la main, alors que la découverte de la ressemblance seule aboutit à une vraie rencontre.
TRANSSUBSTANTIATION. - Le Christ mort de Holbein est un cadavre jaunâtre tirant sur le vert à barbiche de fil de fer, mais je n’y perçois aucun ricanement de l’artiste. Cela va-t-il ressusciter nom de Dieu ? Oui, cela ressuscite à l’instant. A l’instant je ressens, sur ma peau, la beauté de cette horreur. Le diable enrage, et moi je me sens plein de vie éternelle.
DE LA RENCONTRE. – «Une bonne rencontre est celle qui permet de co-renaître», écrit Max Dorra, «chacun apportant à l’autre, malgré la différence des instruments, des timbres, la note qui manquait à un accord enfin résolutif». Or lisant tout haut cette phrase à celle que j’ai rencontrée pour de bon après divers essais infructueux de part et d’autre à travers les années, je l’entends me dire: «c’est pile mon sujet de mémoire, ça recoupe Damasio et Varela sur quoi je bosse, faudra que je m’achète ce bouquin parce que tes notes au crayon bleu ça devient pas possible… »
Et du coup je me rappelle cette rencontre et toutes celles, «résolutives» pour un moment décisif d’évolution personnelle, qui ont précédé et suivi et que je m’obstine à ne pas croire le fruit du hasard: nécessaires à ce moment précis.
Avec ma bonne amie on se rencontre à dix-huit ans, on flirte, on se bécote, on va presque plus loin mais le moment n’est pas venu. L’année du bac on se rencontre presque, on aurait fait des enfants avant le divorce probable, mais non: je vais de mon côté, elle se trouve un autre complice avant de divorcer, elle me relance (coiffure afro, engagée un max à gauche dans le groupe Mozambique) entre temps j’ai rencontré XYZ que j’ai aimés et lâchés faute de co-renaissance réciproque, ainsi de suite.
Cette notion de co-renaissance est devenue la base de toutes mes relations, fondées sur la réciprocité. Toutes les amitiés qui n’ont pas été tissées de co-renaissance se sont étiolées avant de défunter. On me juge sans doute un piètre ami selon les codes de la répétition, mais tant pis, je n’aime pas faire semblant ni ne tolère le chantage à l’amitié qui force à se trahir.
Je fréquente Max Dorra depuis moins d’un mois. Pas idée de qui il est. Jamais vu son visage. Mais plus proche de lui ces jours que de tant de gens qui prétendent me connaître, par les petites phrases que son livre relaie, vraie rencontre occulte, comme celle de Proust tous les matins que je lis aux «lieux», le Salon Proust de la Désirade où s’empilent tous les écrits de et sur Marcel Proust.
A l’instant, à la fenêtre, le paysage est divisé en deux: ciel céleste et mer de brouillard. Gloire apparente du dessus, mais c’est à l’enfant sous la table que je pense…
(A La Désirade, ce 13 novembre)
 GORKI ET TCHEKHOV. - Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque le Pouvoir rebaptisa sa ville natale de Nijni-Novgorod de son nom, en pensant à son ami Tchekhov. Ainsi le jeune homme a-t-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Pouvoir. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchekhov.
GORKI ET TCHEKHOV. - Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque le Pouvoir rebaptisa sa ville natale de Nijni-Novgorod de son nom, en pensant à son ami Tchekhov. Ainsi le jeune homme a-t-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Pouvoir. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchekhov.
J’avais repris depuis quelques jours la lecture de Gorki, dont vient de paraître le premier volume des Oeuvres en Pléiade. Je m’étais rappelé ma lecture, une nuit à Sorrente, de la correspondance du jeune Gorki et de Tchekhov, où celui-là dit à peu près ceci au cher docteur: tout ce qui se fait aujourd’hui en Russie semble un raclement de bûches sur du papier de sac de patates à côté de ce que vous écrivez vous de tellement sensible et délicat. Je pestais contre mes putains de chaînes que mes mains glacées ne parvenaient pas à désentortiller dans la nuit plus russe que russe, et je pensais à Tchekhov, mon âme chantonnait tandis que le chien Filou se tirait des lignes de neige en twistant comme un fol autour de moi, le rat. Et j’imaginais le docteur partant seul dans la nuit sur son traîneau, à l’appel d’un malade à dix verstes de là, et flûte pour ces putains de chaîne, me suis-je alors dit, je rentre à l’isba, à peine trois verste pedibus, ça me donnera le temps de penser à Tchekhov, et voilà que me revenait cette phrase d’Anton Pavlovitch au jeune Gorki: «On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part»…
Celui qui connaît par cœur la composition de la palette de Paul Cézanne / Celle qui brode La Vierge au Rocher au point de croix / Ceux qui sortent du musée Van Gogh avec le même tee-shirt cool de l’homme à l’oreille coupée / Celui qui rebondit toujours sur ce que dit sa cheffe des RH / Celle qui ratisse large en matière de spiritualité New Age / Ceux qui se branchent respect des minorités perverses, etc.
Tout ce que je fais relève en somme de la mise en ordre, ou plus exactement: de la mise au clair. C’est cela: je tire les choses au net.
POESIE. - Je lis ceci: «Pluie de printemps/toute chose en devient/plus belle.» Des mots calligraphiés par Chyo-ni, une noble Japonaise du XVIIIe siècle. Puis je lis cela : «Un matin glacé/sur mon vélo/j’admire les champs». Des mots de Catherine Sancet, de la classe de 6e B du collège Gérard-Philipe de Carquefou.
Je viens de me lever dans la nuit glaciale et je lis Le soleil de l’après-midi de Constantin Cavafy. C’est l’histoire du type qui se rappelle la chambre dans laquelle il a aimé quelqu’un «tant de fois». C’est d’une plate banalité et pourtant, en lisant ce qui suit, tout à coup je me sens plus réel: «Sont-ils encore quelque part, ces pauvres meubles?/A côté de la fenêtre était le lit./Le soleil de l’après-midi arrivait à la moitié. Un après-midi, à quatre heures, nous nous sommes séparés,/ Rien que pour une semaine… Hélas,/Cette semaine-là devait durer toujours».
Ah mais, il fait un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant: «Je ne suis rien./Je ne serai jamais rien./Je ne peux vouloir être rien./A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde./Fenêtres de ma chambre,/Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont/Personne ne sait qui il est/(Et si on le savait, que saurait-on?),/Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,/Une rue inaccessible à toutes pensées,/Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres, Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,/Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.»
Cela s’intitule Bureau de tabac et c’est signé Fernando Pessoa, puis je lis ceci en me rappelant l’odeur de tout à l’heure de quelqu’un que j’aime et qui dort encore, sous la plume d’Anna Akhmatova: «Les jours les plus sombres de l’année/Doivent s’éclairer/Je ne trouve pas de mots pour dire/La douceur de tes lèvres».
 DES VISAGES. - Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.
DES VISAGES. - Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.
Or curieusement, plus je les regarde et plus je me surprends à les accueillir tous.
En regardant de tout près le visage de quelqu’un qu’on aime, on se sent parfois défaillir de tendresse. Ce seul visage n’a pas au monde son pareil, se dit-on, et tous les visages y délèguent cependant un reflet. Un instant, on se figure qu’on perdrait tout en le perdant, puis à le regarder vraiment on s’aperçoit que sa lumière n’est pas que de lui: que sa présence n’est qu’allusion à l’on ne sait quoi d’éternel.
PHILOSOPHIE DE LA SEICHE. - Une mentalité me révulse, et c’est celle de la seiche philosophique, qui n’a rien à voir avec la seiche animale, se défendant comme elle le peut et à bon droit. Mais en quoi consiste la particularité de la seiche philosophique? La seiche philosophique a cela de particulier que, plongée dans un bac d’eau claire, elle y diffuse un jet d’encre noire avant de déclarer qu’il n’y a pas plus noir que le monde dans lequel elle, seiche de malheur, a été plongée.
Il y a la seiche du tout est moche. Lui désignez-vous une chose belle, un paysage ou un tableau, un film ou un livre, qu’elle en dénonce aussitôt le défaut.
Il y a la seiche de rien ne vaut le coup qui, arguant que tout a été fait ou que rien ne puisse plus advenir, n’a de cesse de ruiner tout projet et de dénigrer même toute idée de projet, pour mieux se complaire dans son amer bocal.
Enfin il y a la seiche du tout est foutu, dont le goût du noir touche à l’absolu, le seul fait d’être au monde lui semblant la calamité d’origine.
Or comment faire pièce à cette philosophie de la seiche? Essentiellement par un redoublement d’attention, je crois, au détail des choses. Cela seul compte en effet: le détail des choses. Ce qu’on appelle la réalité. L’origine des choses. Le Grand Récit. Les écritures multiples du grand palimpseste de la mémoire.
DE LA CRITIQUE. - «Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre», écrivait Mallarmé. Cela fait-il du monde un cabinet de rat des lettres ? Nullement. Car «l’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini», écrivait Charles-Albert Cingria, qui disait aussi que la meilleure critique ne fait que coudre ensemble des citations. Lui-même ne s’y tenait pas, mais l’art de la citation est en effet une composante de la bonne critique, et voici que Léon Bloy suggère une initiative non moins opportune: «On devrait fonder une chaire pour l’enseignement de la lecture entre les lignes».
EN FAMILLE. - C’est Noël et je me réjouis, ce soir et demain, de me retrouver en famille, comme dans nos enfances heureuses et chrétiennes, autour du sapin, lorsque nous tremblions un peu de réciter devant le sapin: «La bougie à l’œil pointu a dit/C’est la fête à Jésus/ Sois gentil.»
Depuis hier soir, dans notre isba sous la neige, cela sent de nouveau bon Noël, cela sent la grand-mère à la pommade camphrée et ce soir nos filles et leur oncle ex-taulard nous prépareront un frichti avant les cadeaux. Il n’y aura pas de poésie devant l’arbre puisque les enfants restent à venir mais le sapin est là et les santons de terre cuite et tout le bazar de Noël qu’aucun de nous n’aurait l’idée de démystifier, comme on dit à la télé.
(A La Désirade, ce 24 décembre)
Celui qui s’est promis d’écrire un poème sur les vaincus à la fin de la semaine / Celle qui aime sortir nue sous sa pelisse de ragondin et parcourir ainsi la rue des Abattoirs / Ceux qui vont passer une semaine aux Moluques pour se ressourcer au niveau du senti
DE LA POESIE. - Dans son inépuisable Dictionnaire égoïste de la littérature française, Charles Dantzig écrit ceci qui me paraît juste et bon : « La poésie est précision. Un poème qui utilise les mots « âme », « quintessence » ou « ineffable » est probablement un poème malhonnête. Loin de chercher à enfumer la connaissance par des mots vagues et intimidants, la poésie la perfectionne. La poésie sert à mieux voir, et plus vite ».
Est-il interdit pour autant d’user du mot « âme » ? Je ne le crois pas, mais il importe alors d’en préciser l’acception. On le voit bien en Suisse romande, pays de tradition protestante où « l’âme » est une de ces fleurs vagues qui se cultivent en serres par force pasteurs et professeurs, poétesses de l’après-midi et autres vestales du Temple, sans le moindre rapport avec cette réalité charnelle et spirituelle qu’il est convenu d’appeler âme au sens physique et métaphysique, définissant l’émanation personnelle d’un être précis, portant nom et prénom, socquettes armoriées et couleur d’yeux unique in the world.
L’ «âmelette ronsardelette » n’est pas vague mais précise, tandis que l’âme « ineffable » des prétendus poètes relève en effet d’une intimidation malhonnête.
J’aime bien me rappeler à ce propos Le canal exutoire de Charles-Albert Cingria, qui distingue l’être précis de l’être vague en ces termes fulminants : « L’être qui se reconnaît – c’est un temps ou deux de stupeur insondable dans la vie – n’a point de seuil qui soit un vrai seuil, point de départ qui soit un vrai départ : cette certitude étant strictement connexe à cette notion d’individualité que je dis, ne pouvant pas ne pas être éternelle, qui rend dès lors absurdes les lois et abominable la société ».
Et pour distinguer ensuite l’homme vague (auquel certains mettent encore une majuscule…) de l’homme-humain (ce sont les Chinois qui parlent d’homme-humain), Cingra précise: « L’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste -, une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. Mais déjà ce domicile est attrayant ; il doit le fuir. A peine rentré, il peut s’asseoir sur son lit, mais, tout de suite, repartir. L’univers, de grands mâts, des démolitions à perte de vue, des usines et des villes qui n’existent pas puisqu’on s’en va, tout cela est à lui pour qu’il en fasse quelque chose dans l’œuvre qu’il ne doit jamais oublier de sa récupération ». C’est cela la poésie : c’est de la récupération de vieux ressorts servant à faire du flambant neuf de fine horlogerie. Ponge disait à peu près : je prends les choses dans mon atelier, pour les réparer, voilà tout. La poésie est un objet. « Une émotion devenue objet », précise Charles Dantzig.
FÊTES. – Chaque fin d’année est comme une fin de vie, on meurt, on coule, on va toucher le fond, on se dit que c’est affreux, quelle horreur ces cadeaux, quelle horreur ces fêtes, quelle horreur ces gens qui vont se réjouir, on se plaint en se goinfrant de douceurs, on se lamente en se tassant la cloche, on est plus malheureux que les malheureux qui battent la semelle dans la rue glaciale, après quoi sonne Minuit et c’est le lendemain qui chante, rien ne sera plus comme avant, on prend des tas de résolutions, on se sent déjà meilleur rien que d’y penser…
(A La Désirade, ce 31 décembre 2005)
On n’a pas besoin de grades, disait à peu près Ramuz: on a plutôt besoin d’égards. A quoi j’ajouterai: et de regards. On a besoin d’égards et de regards.
Celui qui se sait mortel depuis la naissance de son premier enfant / Celle qui chine dans l’appart du défunt / Ceux qui trouvent à la morte une sérénité qui lui ressemble / Celui qui te recommande de gérer ton deuil sans états d’âme / Celle qui sanglote sans savoir pourquoi / Ceux qui ont choisi le cercueil First Class eu égard au standing du Vieux, etc.

 « En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».
« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».









 Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges.
Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges. Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005.
Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005. Les chagrins magnifiques – Plus grave de tonalité qu’Une chambre pleine d’oiseaux, premier recueil des chroniques de l’auteur, cet ensemble de proses reprend les thèmes récurrents du malaise existentiel et de la difficulté de communiquer dans le couple et dans la société, avec un regard plus personnel et nostalgique sur les « légères hypothèses d’enfance », et des inflexions mélancoliques accentuant et poétisant à la fois un sentiment de déréliction quasi omniprésent. Du moins les bonheurs d’écriture, et le ton si particulier du chroniqueur-écrivain valent-ils à ce livre sa vertu paradoxalement tonique. Christophe Gallaz. Les chagrins magnifiques. Zoé Poche, 2005 (1986).
Les chagrins magnifiques – Plus grave de tonalité qu’Une chambre pleine d’oiseaux, premier recueil des chroniques de l’auteur, cet ensemble de proses reprend les thèmes récurrents du malaise existentiel et de la difficulté de communiquer dans le couple et dans la société, avec un regard plus personnel et nostalgique sur les « légères hypothèses d’enfance », et des inflexions mélancoliques accentuant et poétisant à la fois un sentiment de déréliction quasi omniprésent. Du moins les bonheurs d’écriture, et le ton si particulier du chroniqueur-écrivain valent-ils à ce livre sa vertu paradoxalement tonique. Christophe Gallaz. Les chagrins magnifiques. Zoé Poche, 2005 (1986). Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981.
Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981. Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005.
Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005. L’enfant secret - Les destinées croisées des aïeux de l’auteur, de la Côte vaudoise à l’Italie de Mussolini, et l’Histoire dramatique du siècle, se vivifient dans cette autofiction constituant sans doute l’un des plus beaux livres de l’auteur. Les personnages d’Emilie et Julien, qui vivent sur les bords du Léman, et le couple formé par Nora et Antonio, assistant (et participant, puisque Antonio est le photographe attitré du Duce) à la montée du fascisme en Italie, constituent le cercle familial multiculturel dans lequel va grandir l’enfant, dont la mémoire restituera ce microcosme si caractéristique de notre pays. Jean-Michel Olivier. L’enfant secret. L’Age d’Homme, 2003.
L’enfant secret - Les destinées croisées des aïeux de l’auteur, de la Côte vaudoise à l’Italie de Mussolini, et l’Histoire dramatique du siècle, se vivifient dans cette autofiction constituant sans doute l’un des plus beaux livres de l’auteur. Les personnages d’Emilie et Julien, qui vivent sur les bords du Léman, et le couple formé par Nora et Antonio, assistant (et participant, puisque Antonio est le photographe attitré du Duce) à la montée du fascisme en Italie, constituent le cercle familial multiculturel dans lequel va grandir l’enfant, dont la mémoire restituera ce microcosme si caractéristique de notre pays. Jean-Michel Olivier. L’enfant secret. L’Age d’Homme, 2003. L’été des Sept-Dormants. – Relevant à la fois de l’exorcisme autobiographique, du roman symphonique et du testament spirituel, ce livre allie, étrangement, les fantasmes obsessionnels et presque maniaque, dans leur expression, d’un esthète amoureux des éphèbes, et la ressaisie magistrale, poétique et religieuse la fois, de quelques destinées réunies dans le creuset existentiel et affectif d’un institut de jeunes gens tenu par une maîtresse femme, Maria Laach, et son pittoresque époux. Roman de l’apprentissage à l’ample mouvement de fleuve, ce livre majestueux laisse en mémoire un double souvenir de fraîcheur juvénile et de lancinante mélancolie. Jacques Mercanton. L’Eté des Sept-Dormants, Galland 1974. Réédition en Poche Suisse, Nos 9 et 10.
L’été des Sept-Dormants. – Relevant à la fois de l’exorcisme autobiographique, du roman symphonique et du testament spirituel, ce livre allie, étrangement, les fantasmes obsessionnels et presque maniaque, dans leur expression, d’un esthète amoureux des éphèbes, et la ressaisie magistrale, poétique et religieuse la fois, de quelques destinées réunies dans le creuset existentiel et affectif d’un institut de jeunes gens tenu par une maîtresse femme, Maria Laach, et son pittoresque époux. Roman de l’apprentissage à l’ample mouvement de fleuve, ce livre majestueux laisse en mémoire un double souvenir de fraîcheur juvénile et de lancinante mélancolie. Jacques Mercanton. L’Eté des Sept-Dormants, Galland 1974. Réédition en Poche Suisse, Nos 9 et 10. La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1.
La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1. Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999.
Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999. L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205.
L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205. Journal intime – Parangon du genre, ce monument de l’introspection ne se borne pas, loin s’en faut, à la rumination stérile d’un professeur esseulé et velléitaire, mais constitue la chronique extrêmement variée d’une fin de siècle genevoise, vue par un écrivain aussi ouvert à la culture européenne qu’à la nature, à la philosophie et aux nouvelles doctrines sociales, au milieu littéraire local ou parisien. Lecteur et promeneur infatigable, Amiel est surtout un prosateur d’une merveilleuse porosité, du moins quand il échappe au ressassement quotidien et à l’autoflagellation. Ses paysages, ses portraits (notamment de femmes) et ses réflexions de toutes espèces constituent un inépuisable trésor. Henri-Frédéric Amiel. Journal intime, L’Age d’Homme, 12 volumes.
Journal intime – Parangon du genre, ce monument de l’introspection ne se borne pas, loin s’en faut, à la rumination stérile d’un professeur esseulé et velléitaire, mais constitue la chronique extrêmement variée d’une fin de siècle genevoise, vue par un écrivain aussi ouvert à la culture européenne qu’à la nature, à la philosophie et aux nouvelles doctrines sociales, au milieu littéraire local ou parisien. Lecteur et promeneur infatigable, Amiel est surtout un prosateur d’une merveilleuse porosité, du moins quand il échappe au ressassement quotidien et à l’autoflagellation. Ses paysages, ses portraits (notamment de femmes) et ses réflexions de toutes espèces constituent un inépuisable trésor. Henri-Frédéric Amiel. Journal intime, L’Age d’Homme, 12 volumes. Le miel du lac. – En chroniqueur pratiquant un type d’observation et une langue imagée à la Vialatte, son maître avéré, l’auteur évoque, dans cette manière de d’autoportrait étoilé, son passé de gosse levantin aux souvenirs d’enfance à la fois pittoresques et parfois douloureux. Rompant avec le tout-venant du journalisme, il enlumine, avec un mélange de candeur blessée et d’humour souvent cocasse, les heures riches de ses flâneries et de ses rencontres, dans ce pays de Vaud qui est devenu sa terre d’adoption. Gilbert Salem. Le miel du lac. Campiche, 1998.
Le miel du lac. – En chroniqueur pratiquant un type d’observation et une langue imagée à la Vialatte, son maître avéré, l’auteur évoque, dans cette manière de d’autoportrait étoilé, son passé de gosse levantin aux souvenirs d’enfance à la fois pittoresques et parfois douloureux. Rompant avec le tout-venant du journalisme, il enlumine, avec un mélange de candeur blessée et d’humour souvent cocasse, les heures riches de ses flâneries et de ses rencontres, dans ce pays de Vaud qui est devenu sa terre d’adoption. Gilbert Salem. Le miel du lac. Campiche, 1998. Mortelle maladie - D’une voix encore fragile, mais chaleureuse, nouée par la souffrance, l’auteur exprime à la fois sa révolte contre le mal qui la ronge et contre la société des hommes, où la femme est parfois encore une esclave. La première partie du livre est attente de l’enfant, d’abord intrus, puis vie désirée, jusqu’au jour de l’accident qui laisse la mère de nouveau seule dans le monde des survivants, contrainte de s’inventer de nouvelles raisons de vivre. Mère frustrée, la narratrice devient femme-écrivain tentant d’assumer le sort de ses semblables, en racontant notamment le calvaire d’Annunziata, la mère italienne, pour donner à son propre drame une résonance plus universelle. Anne Cuneo. Mortelle maladie. En Campoche, 2005.
Mortelle maladie - D’une voix encore fragile, mais chaleureuse, nouée par la souffrance, l’auteur exprime à la fois sa révolte contre le mal qui la ronge et contre la société des hommes, où la femme est parfois encore une esclave. La première partie du livre est attente de l’enfant, d’abord intrus, puis vie désirée, jusqu’au jour de l’accident qui laisse la mère de nouveau seule dans le monde des survivants, contrainte de s’inventer de nouvelles raisons de vivre. Mère frustrée, la narratrice devient femme-écrivain tentant d’assumer le sort de ses semblables, en racontant notamment le calvaire d’Annunziata, la mère italienne, pour donner à son propre drame une résonance plus universelle. Anne Cuneo. Mortelle maladie. En Campoche, 2005. Un prince perdu. – Tenant à la fois du conte épique et du roman en prise directe avec les tribulations du monde contemporain, ce roman évoque fortement les destinées de l’Afghanistan, que l’auteur connaît bien pour y avoir été délégué du CICR, sans que le pays ne soit jamais nommé. Le jeune Jahan, unique rescapé du massacre de la famille royale du Karaba, entreprend le récit de sa vie à l’initiative de son ami portugais Jorge, afin de laisser témoignage et d’affirmer une identité remise en cause. A la fois tendre et amer, pétri d’humanité et impressionnant par ses évocations de la nature et du chaos de la guerre civile, ce livre est de ceux qui marquent. Jean-François Sonnay. Un prince perdu. Campiche, 1999.
Un prince perdu. – Tenant à la fois du conte épique et du roman en prise directe avec les tribulations du monde contemporain, ce roman évoque fortement les destinées de l’Afghanistan, que l’auteur connaît bien pour y avoir été délégué du CICR, sans que le pays ne soit jamais nommé. Le jeune Jahan, unique rescapé du massacre de la famille royale du Karaba, entreprend le récit de sa vie à l’initiative de son ami portugais Jorge, afin de laisser témoignage et d’affirmer une identité remise en cause. A la fois tendre et amer, pétri d’humanité et impressionnant par ses évocations de la nature et du chaos de la guerre civile, ce livre est de ceux qui marquent. Jean-François Sonnay. Un prince perdu. Campiche, 1999. Le sourire de Mickey – Il y a quelque chose de panique dans le regard que l’auteur promène sur nos semblables plus ou moins empêtrés dans les embrouilles de la société contemporaine, où les modèles du battant et de la superwoman font figure de référence. Les personnages décrits dans ces nouvelles peinent à telle identification, à moins de s’aliéner comme ce couple pour lequel la naissance d’un enfant fait figure de péripétie « non appropriée ». Observateur redoutable des tics de comporteent ou de langage, dans la parenté d’un Michel Houellebecq, Antonin Moeri excelle à ressaisir, sous forme narraative, les névroses et les psychoses de l’homme actuel, sans trop le caricaturer. Antonin Moeri, Le Sourire de Mickey. Campiche, 2003.
Le sourire de Mickey – Il y a quelque chose de panique dans le regard que l’auteur promène sur nos semblables plus ou moins empêtrés dans les embrouilles de la société contemporaine, où les modèles du battant et de la superwoman font figure de référence. Les personnages décrits dans ces nouvelles peinent à telle identification, à moins de s’aliéner comme ce couple pour lequel la naissance d’un enfant fait figure de péripétie « non appropriée ». Observateur redoutable des tics de comporteent ou de langage, dans la parenté d’un Michel Houellebecq, Antonin Moeri excelle à ressaisir, sous forme narraative, les névroses et les psychoses de l’homme actuel, sans trop le caricaturer. Antonin Moeri, Le Sourire de Mickey. Campiche, 2003. Le viol de l’ange - Le terme de « roman virtuel » convient à cette ressaisie des multiples possibles de la vie contemporaine, captée dans son surgissement, dès le lendemain de la prise de Srebrenica, en juillet 1995. Dans un grand ensemble suburbain, un drame se prépare : l’agression sexuelle et le meurtre d’un enfant par un mystérieux tueur, dont le journal ponctue les pages du roman. Traversée des ténèbres, ce roman foisonnant et mêlant toutes les formes d’écriture, se veut aussi quête de gestes humains et de lumière. Jean-Louis Kuffer. Le viol de l’ange. Bernard Campiche, 1997.
Le viol de l’ange - Le terme de « roman virtuel » convient à cette ressaisie des multiples possibles de la vie contemporaine, captée dans son surgissement, dès le lendemain de la prise de Srebrenica, en juillet 1995. Dans un grand ensemble suburbain, un drame se prépare : l’agression sexuelle et le meurtre d’un enfant par un mystérieux tueur, dont le journal ponctue les pages du roman. Traversée des ténèbres, ce roman foisonnant et mêlant toutes les formes d’écriture, se veut aussi quête de gestes humains et de lumière. Jean-Louis Kuffer. Le viol de l’ange. Bernard Campiche, 1997.


 Ce texte est extrait de Par les temps qui courent, publié en 1995 chez Bernard Campiche, et reéédité en 1996 au Passeur, à Nantes. Il a obtenu le Prix Rod 1996.
Ce texte est extrait de Par les temps qui courent, publié en 1995 chez Bernard Campiche, et reéédité en 1996 au Passeur, à Nantes. Il a obtenu le Prix Rod 1996.








 En conclusion à sa postface au dernier volume paru du théâtre de Witkiewicz, Alain van Crugten se pose une question, qui nous renvoie à la problématique globale de l’écrivain que Witold Gombrowicz taxait, non sans amicale perfidie, de « graphomane de génie » : « Son théâtre », écrit van Crugten, (et nous pourrions ajouter : son art et son oeuvre) peut-il contribuer à combler le vide de cet univers sans âme qu’il annonce ? Encore faudrait-il vérifier que ses drames, avec leur forte dose de dérision, ne se prêtent pas uniquement à un jeu comique sans profondeur. Mais peut-on faire en sorte que le grotesque et la parodie moderne agissent sur tous à la manière de la tragédie antique ? Peut-on arriver à la catharsis par la parodie ? »
En conclusion à sa postface au dernier volume paru du théâtre de Witkiewicz, Alain van Crugten se pose une question, qui nous renvoie à la problématique globale de l’écrivain que Witold Gombrowicz taxait, non sans amicale perfidie, de « graphomane de génie » : « Son théâtre », écrit van Crugten, (et nous pourrions ajouter : son art et son oeuvre) peut-il contribuer à combler le vide de cet univers sans âme qu’il annonce ? Encore faudrait-il vérifier que ses drames, avec leur forte dose de dérision, ne se prêtent pas uniquement à un jeu comique sans profondeur. Mais peut-on faire en sorte que le grotesque et la parodie moderne agissent sur tous à la manière de la tragédie antique ? Peut-on arriver à la catharsis par la parodie ? »
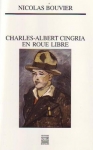

 -
- -
- -
- -
-












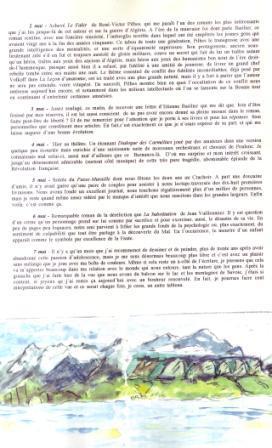
 de Lausanne-City... 7) Carnets publiés aux éditions Bernard Campiche; L'Ambassade du papillon et
de Lausanne-City... 7) Carnets publiés aux éditions Bernard Campiche; L'Ambassade du papillon et  Les Passions partagées, recouvrant les années 1973 à 1999.
Les Passions partagées, recouvrant les années 1973 à 1999.

 On croit Shitao peintre et poète, mais c’est surtout un lieu. Shitao est ce matin pour moi ma table de vieux bois lustré (héritée par mon aïeul du grand chirurgien lausannois César Roux, médecin des pauvres protestant et ingénieux inventeur comme le fut Blaise Pascal à ses heures) à laquelle je travaille en gardant un œil sur les monts bleus de Savoie flottant sur le lac bleu et que traversent une lente traîne de brumes aquarellées, Shitao est ici et partout et toujours et dans ces mots en cet instant d’éternité : « Le plus important pour l’homme, c’est de savoir vénérer. Car celui qui est incapable de vénérer les dons de ses perceptions se gaspille lui-même en pure perte, de même que celui qui a reçu le don de la peinture mais néglige de recréer se réduit à l’impuissance. (…) Comme il est dit au Livre des Mutations, à l’image de la marche régulière du cosmos, l’homme de bien œuvre par lui-même sans relâche et c’est ainsi véritablement que l’on honorera la réceptivité ».
On croit Shitao peintre et poète, mais c’est surtout un lieu. Shitao est ce matin pour moi ma table de vieux bois lustré (héritée par mon aïeul du grand chirurgien lausannois César Roux, médecin des pauvres protestant et ingénieux inventeur comme le fut Blaise Pascal à ses heures) à laquelle je travaille en gardant un œil sur les monts bleus de Savoie flottant sur le lac bleu et que traversent une lente traîne de brumes aquarellées, Shitao est ici et partout et toujours et dans ces mots en cet instant d’éternité : « Le plus important pour l’homme, c’est de savoir vénérer. Car celui qui est incapable de vénérer les dons de ses perceptions se gaspille lui-même en pure perte, de même que celui qui a reçu le don de la peinture mais néglige de recréer se réduit à l’impuissance. (…) Comme il est dit au Livre des Mutations, à l’image de la marche régulière du cosmos, l’homme de bien œuvre par lui-même sans relâche et c’est ainsi véritablement que l’on honorera la réceptivité ».

 — Quelles ont été vos premières lectures marquantes ?
— Quelles ont été vos premières lectures marquantes ?
 Je suis arrivé au bout, ce matin, des Nouvelles et morceaux de Ramuz, avec deux évocations du paradis, dans Le pauvre vannier et La paix du ciel, qui traitent la même idée que celle de Chute d’un saint de Dino Buzzati, à savoir le regret qu’un homme peut éprouver dans ce lieu saint et parfait, où l’on n’a plus rien à faire qu’à chanter des cantiques et où le charme des misères est dissipé… Ce qui me frappe aussi, en notamment en songeant à l’âge de l’écrivain (trente ans quand il publie ce recueil, en 1919), c’est le mélange de noirceur et d’attention compassionnelle qui se dégage de l’ensemble des romans et des nouvelles publiés jusque-là.
Je suis arrivé au bout, ce matin, des Nouvelles et morceaux de Ramuz, avec deux évocations du paradis, dans Le pauvre vannier et La paix du ciel, qui traitent la même idée que celle de Chute d’un saint de Dino Buzzati, à savoir le regret qu’un homme peut éprouver dans ce lieu saint et parfait, où l’on n’a plus rien à faire qu’à chanter des cantiques et où le charme des misères est dissipé… Ce qui me frappe aussi, en notamment en songeant à l’âge de l’écrivain (trente ans quand il publie ce recueil, en 1919), c’est le mélange de noirceur et d’attention compassionnelle qui se dégage de l’ensemble des romans et des nouvelles publiés jusque-là. En reprenant en outre Vie et destin, de Vassili Grossman, j’ai relu les pages consacrées aux feuillets d’Ikonnikov et y ai trouvé, en substance, la base même de la morale de mes parents et des parents de mes parents, que je perpétue à ma façon plus irrégulière. C’est aussi les figures de Juste et de Monsieur Loup, de Vie de Samuel Belet, que j’ai retrouvés en ces pages sur la bonté « sans idées », avec le relief nouveau que mes expériences personnelles donnent à cette conception modeste du bien. Enfin j’ai reconnu, dans celle-ci, la morale de toute une Suisse flétrie aujourd’hui par une clique de profiteurs et de démagogues.
En reprenant en outre Vie et destin, de Vassili Grossman, j’ai relu les pages consacrées aux feuillets d’Ikonnikov et y ai trouvé, en substance, la base même de la morale de mes parents et des parents de mes parents, que je perpétue à ma façon plus irrégulière. C’est aussi les figures de Juste et de Monsieur Loup, de Vie de Samuel Belet, que j’ai retrouvés en ces pages sur la bonté « sans idées », avec le relief nouveau que mes expériences personnelles donnent à cette conception modeste du bien. Enfin j’ai reconnu, dans celle-ci, la morale de toute une Suisse flétrie aujourd’hui par une clique de profiteurs et de démagogues. Qu’est-ce qui, en fin de compte, distingue l’idéologie du jeu des idées? Zinoviev prétendait lutter contre l’idéologie, alors qu’il y était empêtré jusqu’au cou, de même que Dimitri. De la même façon, lorsque je relis mes carnets de toutes ces années, jusque vers 1993-1994, je constate que j’ai été moi-même prisonnier de ce carcan de l’idéologie, à la fois dans ses incidences religieuses et politiques. Il me semble que j’en suis désormais libéré, du moins en grande partie. Est-ce à dire que je ne crois plus à rien? Tout au contraire.
Qu’est-ce qui, en fin de compte, distingue l’idéologie du jeu des idées? Zinoviev prétendait lutter contre l’idéologie, alors qu’il y était empêtré jusqu’au cou, de même que Dimitri. De la même façon, lorsque je relis mes carnets de toutes ces années, jusque vers 1993-1994, je constate que j’ai été moi-même prisonnier de ce carcan de l’idéologie, à la fois dans ses incidences religieuses et politiques. Il me semble que j’en suis désormais libéré, du moins en grande partie. Est-ce à dire que je ne crois plus à rien? Tout au contraire. Une histoire d’amour et de ténèbres d’Amos Oz me semble aussitôt un livre d’envergure. Il s’agit d’une vaste chronique familiale où l’on rencontre, sur l’arrière-fond d’Israël au début des années 50, les personnages de lettrés hauts en couleurs constituant l’entourage de l’enfant. Il y a d’abord le père, érudit et polyglotte, mais confiné dans un poste de bibliothécaire, puis il y a le grand-oncle Yosef Klausner, savant et vénéré dans les plus hautes sphères du pays, la grand-mère Shlomit obnubilée par la présence des microbes en ces terres « asiatique », le grand-père Alexandre vivotant de petits négoces mais toujours tiré à quatre épingles et se donnant de grands airs — et c’est toute une société composite qui apparaît en même temps, où l’on apprend que les kibboutzim, héros du jeune garçon sont en revanche très mal vus par une partie plus traditionaliste de la population, à laquelle ils apparaissent comme des révolutionnaires aux moeurs dissolues. Bref, tout ça vit et vibre dans un ample mouvement de remémoration.
Une histoire d’amour et de ténèbres d’Amos Oz me semble aussitôt un livre d’envergure. Il s’agit d’une vaste chronique familiale où l’on rencontre, sur l’arrière-fond d’Israël au début des années 50, les personnages de lettrés hauts en couleurs constituant l’entourage de l’enfant. Il y a d’abord le père, érudit et polyglotte, mais confiné dans un poste de bibliothécaire, puis il y a le grand-oncle Yosef Klausner, savant et vénéré dans les plus hautes sphères du pays, la grand-mère Shlomit obnubilée par la présence des microbes en ces terres « asiatique », le grand-père Alexandre vivotant de petits négoces mais toujours tiré à quatre épingles et se donnant de grands airs — et c’est toute une société composite qui apparaît en même temps, où l’on apprend que les kibboutzim, héros du jeune garçon sont en revanche très mal vus par une partie plus traditionaliste de la population, à laquelle ils apparaissent comme des révolutionnaires aux moeurs dissolues. Bref, tout ça vit et vibre dans un ample mouvement de remémoration. Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase et juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus». Je trouve cela vraiment épatant. Je voudrais être capable de cette netteté et de cette sécheresse émue, si j’ose dire. J’aimerais dire ainsi, ne serait-ce qu’à moi-même, ce que c’est par exemple que de se sentir vieillir et de se sentir à la fois plus faible et plus fort. A l’instant précis, à côté de petits enfants tout gais (la petite fille chantait tout à l’heure « vive la vie », je vois mon reflet dans la vitre du TGV, et j’y décèle un peu de mon père dans l’affaissement des traits, avec le sentiment intérieur d’être resté une espèce de jeune homme, n’étant jamais devenu le Monsieur que mon père fut dès ses jeunes années, portant cravate et costume décent.
Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase et juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus». Je trouve cela vraiment épatant. Je voudrais être capable de cette netteté et de cette sécheresse émue, si j’ose dire. J’aimerais dire ainsi, ne serait-ce qu’à moi-même, ce que c’est par exemple que de se sentir vieillir et de se sentir à la fois plus faible et plus fort. A l’instant précis, à côté de petits enfants tout gais (la petite fille chantait tout à l’heure « vive la vie », je vois mon reflet dans la vitre du TGV, et j’y décèle un peu de mon père dans l’affaissement des traits, avec le sentiment intérieur d’être resté une espèce de jeune homme, n’étant jamais devenu le Monsieur que mon père fut dès ses jeunes années, portant cravate et costume décent. La seule face de George W. Bush, de poulet de batterie en costume de ville, suffit à me convaincre de l’imbécillité du gouvernement actuel des Etats-Unis. Comme un Carter paraît humain, sympathique et intéressant, à côté d’une telle nullité. Ce qui est tout dire…
La seule face de George W. Bush, de poulet de batterie en costume de ville, suffit à me convaincre de l’imbécillité du gouvernement actuel des Etats-Unis. Comme un Carter paraît humain, sympathique et intéressant, à côté d’une telle nullité. Ce qui est tout dire… J’ai regardé ce matin plusieurs des Portraits réalisés par Alain Cavalier, qui me plaisent beaucoup. Il y a la matelassière au beau visage lumineux et aux mains toutes déformées, qui dit tranquillement que son travail a été sa vie. Son mari ne fichait rien. Elle a élevé seule ses cinq enfants sans aide sociale. Elle ne se plaint pas pour autant. Ensuite il y a la fileuse qui prépare une copie de la tapisserie de Bayeux. Elle prépare elle-même les teintures de sa laine. On la voit extraire la garance de l’arbuste, puis un certain violet d’un coquillage. Elle a un visage de Rembrandt dans le clair-obscur. Elle cite la Bible à propos de certains mélanges de matériaux déconseillés. Puis il y a Mauricette la trempeuse, qui réalise des pétales de fleurs artificielles en soie, en coton ou en mousseline. Elle exerce son « métier de fleurs » depuis la guerre. Ell a « appris la fleur » à Paris. Je pourrais entendre un artisan me parler de son travail des heures et des heures durant. Alain Cavalier prête une attention réellement religieuse à ces dames.
J’ai regardé ce matin plusieurs des Portraits réalisés par Alain Cavalier, qui me plaisent beaucoup. Il y a la matelassière au beau visage lumineux et aux mains toutes déformées, qui dit tranquillement que son travail a été sa vie. Son mari ne fichait rien. Elle a élevé seule ses cinq enfants sans aide sociale. Elle ne se plaint pas pour autant. Ensuite il y a la fileuse qui prépare une copie de la tapisserie de Bayeux. Elle prépare elle-même les teintures de sa laine. On la voit extraire la garance de l’arbuste, puis un certain violet d’un coquillage. Elle a un visage de Rembrandt dans le clair-obscur. Elle cite la Bible à propos de certains mélanges de matériaux déconseillés. Puis il y a Mauricette la trempeuse, qui réalise des pétales de fleurs artificielles en soie, en coton ou en mousseline. Elle exerce son « métier de fleurs » depuis la guerre. Ell a « appris la fleur » à Paris. Je pourrais entendre un artisan me parler de son travail des heures et des heures durant. Alain Cavalier prête une attention réellement religieuse à ces dames. En lisant L’exemple de Cézanne, je me dis que ce pèlerinage aux sources du peintre est pour Ramuz un repérage de sa propre situation, de sa solitude et d’une même ambition inaperçue, nimbée de silence. Il y a ceux, d’un côté, qui ont leurs stèles et leurs bustes, et puis il y a Cézanne qui se fond dans le pays de Cézanne, Cézanne qui s’est agrandi par son oeuvre aux dimensions d’un pays, Cézanne que Ramuz retrouve partout dans ce pays qui est lui-même comme un agrandissement de son pays à lu
En lisant L’exemple de Cézanne, je me dis que ce pèlerinage aux sources du peintre est pour Ramuz un repérage de sa propre situation, de sa solitude et d’une même ambition inaperçue, nimbée de silence. Il y a ceux, d’un côté, qui ont leurs stèles et leurs bustes, et puis il y a Cézanne qui se fond dans le pays de Cézanne, Cézanne qui s’est agrandi par son oeuvre aux dimensions d’un pays, Cézanne que Ramuz retrouve partout dans ce pays qui est lui-même comme un agrandissement de son pays à lu
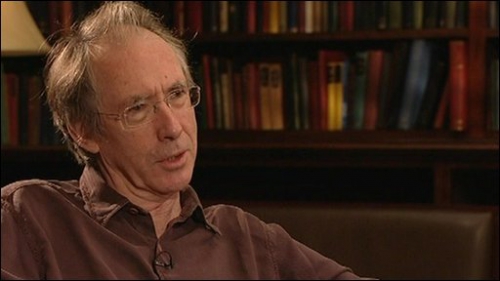




 SOUS LE REGARD DE DIEU
SOUS LE REGARD DE DIEU ÉCRIRE COMME ON RESPIRE
ÉCRIRE COMME ON RESPIRE LITTÉRATURE.
LITTÉRATURE. SUR PROUST
SUR PROUST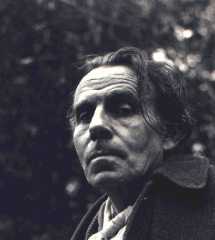
 FÉLIX VALLOTTON.
FÉLIX VALLOTTON. WITKIEWICZ ET LE ROMAN
WITKIEWICZ ET LE ROMAN JUDITH HERMANN
JUDITH HERMANN GEORGES PIROUÉ.
GEORGES PIROUÉ. UN LECTEUR HEUREUX
UN LECTEUR HEUREUX LE BON MONSIEUR THIBON. –
LE BON MONSIEUR THIBON. – JACQUES CHESSEX.
JACQUES CHESSEX. CARNETS DE VIE.
CARNETS DE VIE. SOLJENITSYNE
SOLJENITSYNE FABIENNE VERDIER
FABIENNE VERDIER MARE NOSTRUM.
MARE NOSTRUM. SIMENON
SIMENON PLAISIRS DE LÉAUTAUD.
PLAISIRS DE LÉAUTAUD. LUCY
LUCY ENCORE HANDKE.
ENCORE HANDKE. RAMUZ EN PROVENCE. -
RAMUZ EN PROVENCE. - POÉSIE QUOTIDIENNE.
POÉSIE QUOTIDIENNE. BALEINE
BALEINE
 EROS PICTOR.
EROS PICTOR. LE CHANT DU MONDE.
LE CHANT DU MONDE. UN LECTEUR.
UN LECTEUR. AU DEVERO.
AU DEVERO. ROMANCIÈRE
ROMANCIÈRE MORALISTES U.S.
MORALISTES U.S. GOYA.
GOYA. HOUELLEBECQ.
HOUELLEBECQ. AU PRÉSENT ABSOLU
AU PRÉSENT ABSOLU REBATET LE FASCISTE
REBATET LE FASCISTE
 LE GRAND RECIT.
LE GRAND RECIT. ACHOPPEMENTS.
ACHOPPEMENTS. GORKI ET TCHEKHOV. - Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque le Pouvoir rebaptisa sa ville natale de Nijni-Novgorod de son nom, en pensant à son ami Tchekhov. Ainsi le jeune homme a-t-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Pouvoir. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchekhov.
GORKI ET TCHEKHOV. - Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque le Pouvoir rebaptisa sa ville natale de Nijni-Novgorod de son nom, en pensant à son ami Tchekhov. Ainsi le jeune homme a-t-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Pouvoir. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchekhov. DES VISAGES
DES VISAGES


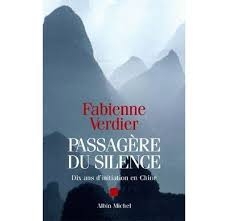 RENCONTRE Dans Passagère du silence, Fabienne Verdier raconte son apprentissage du grand art de la Chine, au prix d'inimaginables difficultés.
RENCONTRE Dans Passagère du silence, Fabienne Verdier raconte son apprentissage du grand art de la Chine, au prix d'inimaginables difficultés. Au chemin de la Dame
Au chemin de la Dame








 Chaque flèche qui le pénètre me pénètre. Ils ne visent que la chair pleine, en évitant les os et les organes vitaux, de sorte que cela pourrait se prolonger des heures, mais je sais que ce sont eux qui flancheront les premiers et que pendant leur sieste je pourrai m’approcher de lui.
Chaque flèche qui le pénètre me pénètre. Ils ne visent que la chair pleine, en évitant les os et les organes vitaux, de sorte que cela pourrait se prolonger des heures, mais je sais que ce sont eux qui flancheront les premiers et que pendant leur sieste je pourrai m’approcher de lui. Personne ne me voit lui planter le couteau de cuisine au coeur. Personne ne l’a entendu me supplier de lui donner le coup de grâce. Sa queue se libère enfin du pagne quand ma lame s’enfonce en lui, mais le bleu de ma robe de pucelle se confond à celui du ciel et personne n’y verra la tache
Personne ne me voit lui planter le couteau de cuisine au coeur. Personne ne l’a entendu me supplier de lui donner le coup de grâce. Sa queue se libère enfin du pagne quand ma lame s’enfonce en lui, mais le bleu de ma robe de pucelle se confond à celui du ciel et personne n’y verra la tache


