
II
Le champ de vision de l’observateur englobait les trois façades frontales des Blocs A, B et C du niveau le plus bas de la Cité des Hespérides, dont la situation en quinconce, par rapport au Bloc E, au troisième étage duquel se trouvait son studio, limitait quelque peu sa visibilité.
Le regard de l’observateur était en outre déformé par le ressentiment pathologique qui le hantait depuis que celui qu’il appelait le Grand Salopard l’avait privé, en sa douzième année gracieuse, du couple qui l’avait engendré et de sa paire de jambes. La fascination morbide qu’il vouait à toute forme de médiocrité allait de pair, chez lui, avec une crainte-attirance panique des individus diffusant la moindre lumière. C’est pourquoi, sans doute, il n’avait osé établir le fichier de Madame Léonce, la vieille salutiste du Bloc C.
Le mode d’expression le plus courant de l’observateur était le ricanement, et ses constats se voulaient dénués de toute nuance émotive. Ainsi l’état d’hébétude dans lequel il se trouvait à la fin de chaque nuit convenait-il à la mise à jour de ses notes.
Les plus simples à compléter étaient les fichiers des retraités, dont les Motier (au Bloc B) figuraient le modèle représentatif, et les Vermont (du Bloc C) la variante atypique.
Ce début de splendide journée (on sait l’importance particulière de la météo pour les retraités), les Motier prenaient leur café complet sur le balcon de leur appartement donnant, de l’autre côté de l’immeuble, sur la toiture bitumée du Centre Com. De ce fait, l’observation se réduisait à des séquences sans cesse interrompues, qui permettaient cependant de contrôler simultanément les déambulations d’autres sujets.
Ainsi le physicien était-il apparu en combi de vélocipédiste au balcon du huitième gauche (Bloc A), tout noir de poil et luisant comme une otarie. L’observateur lui vouait une attention soutenue depuis qu’il avait constaté que le personnage collectionnait les armes et les drapeaux. De surcroît, l’hygiénisme de son existence, réglée au chronomètre, ne laissait d’aiguiser sa curiosité et sa répugnance instinctive, un peu comme il en allait des Kepler.
À l’instant, le physicien regardait en direction du bois de feuillus que dominait la tour de la Résidence G et dans lequel on avait retrouvé, l’année précédente, les restes d’un adolescent blond jamais identifié. L’observateur savait, pour avoir croisé le personnage dans les travées du Centre Com, que le liquide brunâtre qui fumait dans le verre que le physicien tenait de la main gauche, tandis qu’il se massait le paquet génital de la droite, était un breuvage synthétique au goût rappelant le Viandox – le produit avait été testé récemment dans la rubrique Consommation du quotidien Le Quotidien dont l’observateur avait gardé la coupure.
Du physicien aussi l’observateur se croyait capable de prévoir les faits et gestes journaliers, qui l’apparentaient à la catégorie des célibataires monomaniaques. Dans le même ordre d’idée, il estimait que la typologie des Kepler ou des Motier était reproductible à des millions d’exemplaires, comme il l’avait déduit d’un songe récurrent dans lequel il avait pour fonction de tenir à jour les rapports d’un incommensurable Fichier.
Dans le rêve en question, l’observateur retombait souvent sur des notes qu’il avait établies de sa propre main. Il en éprouvait alors un mélange d’orgueil et de gêne. Sur le document concernant, par exemple, le fonctionnaire à la retraite Félicien Motier, l’observateur avait déchiffré plusieurs annotations manuscrites qui touchaient à certaines manies de l’intéressé, ignorées même de son épouse légitime, du style : M. s’envoie des baisers dans le miroir du living, M. parle au portrait de sa mère défunte, M. passe des heures à broder des motifs imaginaires sur des napperons.
Les fantaisies du subconscient ne cessaient d’interférer, dans le songe du Fichier, avec les éléments consignés par l’observateur dans les dossiers de son Mac, modifiant les profils d’une manière parfois éclairante. C’était en rêve, ainsi, que l’observateur avait découvert le trait de caractère décisif du journaliste alcoolique Pascal Ferret du Bloc A (F. ne supporte pas la dureté du métal dans les voix) et l’origine probable de la propension fugueuse du fils du concierge Cardoso dont le squelette (dans le rêve, l’observateur le radiographiait gravement en tablier de caoutchouc) accusait une légère fragilité (V. nourrit une irrépressible répulsion à l’égard de la norme sportive), et c’était de la même façon que se fondaient ses intuitions de brute compliquée et ses réactions souvent imprévisibles, notamment à l’égard du sosie de Jim Morrison domicilié au Bloc B (C. me porte d’une rive à l’autre sans cesser de sourire) auquel son seul aspect de Christ en nippes valait la défiance de la plupart des habitants présumés recommandables du quartier.
D’un point de vue neutre, la Cité des Hespérides représentait le type du grand ensemble suburbain. Sise sur les hauts de la ville virtuelle – laquelle figurait la localité centre-européenne de moyenne importance, avec son Vieux Quartier et ses banlieues où s’entassaient immigrés et indigènes paupérisés, ses étages en corniches dominant le Haut Lac et son arrière-pays forestier, son centre d’affaires et son campus universitaire excentré, ses bas-fonds et ses jardins splendides –, la Cité se divisait en blocs dont les niveaux reproduisaient les strates sociales, non sans passages et possibilités déambulatoires de toute sorte.
Logiquement, du montant des loyers dépendait la répartition des habitants entre les blocs inférieurs et les hauteurs de la Résidence G où se concentraient professions libérales et fortunes diverses, personnalités à la mode du type Kevin Lefort et autres gagneurs de plus ou moins fringante volée.
À propos de Kevin Lefort, jamais l’observateur n’eût pu se douter, sauf à fréquenter la galerie Artefact, comptant au nombre des espaces artistiques les plus en vogue de la ville, que ses propres rapports se trouvaient virtuellement doublés par le dispositif photographique installé par le plasticien sur la terrasse de son luxueux attique de la Résidence G, au moyen duquel il avait réalisé ses lucratives séries de Scènes/Obscènes.
Ce matin même, si Kevin ne s’était pas trouvé en déplacement à Tanger, où il avait un pied-à-terre, ses appareils eussent fort bien pu balayer les façades du Bloc A pour enregistrer, en plans multicadrés, tout ce qui s’était manifesté à la surface de la scène-concept dès l’apparition de Muriel Kepler et jusqu’au geste du physicien de se palper l’entrejambes, que le manipulateur d’images n’aurait plus eu ensuite qu’à reformater en sérigraphies grand module propres à orner les murs des établissements bancaires ciblés par son agent.
L’observateur ignorait, pour tout dire, que Kevin Lefort n’était autre que l’individu qu’il avait remarqué un jour au Centre Com, flanqué de deux gigolos fardés, dont la veulerie désarmée de l’expression l’avait vaguement troublé ; et de même n’avait-il pas idée de la considération remarquable dont jouissait le plasticien dans les milieux établis de la ville, où l’on voyait en lui le nec plus de l’avant-garde internationale.
Au demeurant, le personnage méritait plus que le regard de mépris teigneux que l’infirme paraplégique Martial Jobin, alias l’observateur, lui avait vrillé le jour de leur rencontre au Centre Com.
La haine secrète vouée par Kevin Lefort à son père depuis la mort d’Amanda, première femme en titre de l’avocat d’affaires et mère légitime du plasticien, avait aiguisé la lucidité de celui-ci, déjà très vive chez l’enfant hypersensible qu’il avait été ; et dans cette perspective, la conscience nette que Maître Lefort ne céderait qu’à celui qui le battrait sur son propre terrain avait développé, chez Kevin, un besoin de revanche qui ne tarda à s’employer dans le nouveau réseau du marché de l’art en pleine relance. Tôt convaincu de la médiocrité de ses propres dons artistiques – sa virtuosité de copiste, capable de brosser en moins de deux un faux Greco ou un Van Dongen mieux que le vrai, lui avait cependant servi à imposer à son père l’idée d’une vocation, puis à séduire les éphèbes que repoussait son physique de chien de mer –, Kevin Lefort s’était lancé avec détermination dans l’étude des mécanismes de la spéculation en matière d’art. Ainsi, peu après qu’il eut sagement obtenu son diplôme à l’école locale d’art visuel sur le thème du Doll’Art, dont la série de multiples qu’il en tira ultérieurement devait établir sa première notoriété (l’idée qu’on pût vendre un faux dollar signé Kevin Lefort pour le prix de cent avait paru subversive à divers critiques en place, et son stock fut épuisé en quelques semaines), l’habile jeune homme s’employa à tisser patiemment un réseau de relations dans les hautes sphères de la finance internationale et du show-business, de la critique spécialisée et de la vie nocturne. Sa première opération sérieuse n’advint cependant qu’après quelques années, qu’il disait de galère dans ses interviews, consistant en agrandissements, enrichis de rehauts de pastel, de clichés au polaroïd réalisés au flash dans les backrooms des boîtes gays de Californie où une bourse officielle du Ministère de la culture lui avait permis de séjourner durant quelques mois – il parlerait plus tard, à son premier biographe, de ses décisives années américaines.
Quant aux goûts esthétiques de l’observateur, ils étaient plus sommaires mais non moins agressifs que ceux de Kevin Lefort, concentrés sur les icônes autocollantes à caractère satanique des groupes de Heavy Metal, les culottes de boxe anglaise dont il faisait collection et qu’il portait, en été, à l’exclusion de tout autre vêtement, les bracelets de force, les tatouages et tout l’appareillage de musculation qui lui avait permis de sculpter la moitié supérieure de son corps.
Chez l’un comme chez l’autre, cependant, de ces personnages apparemment adonnés au fétichisme de l’époque, se percevait le courant sous-jacent d’une mélancolie lancinante qui les isolait du reste du monde et parait leur monstruosité respective d’une glauque beauté.
Littérature - Page 36
-
L'observateur
-
Lumière de Matisse
ou la peinture du bonheur
Jamais il n’a représenté la douleur, d’aucuns lui reprochent d’avoir été le peintre du luxe et de la volupté, mais Aragon préfère Matisse qui embellit à ceux-là qui enlaidissent le monde, et qui lui donnerait tort en suivant la ligne de ce crayon dansant « à tâtons » avec la sûreté du génie ?« Le dessin dit l’infinie complexité du trait pur », écrit Aragon, il est « écriture à chaque point de sa course », et c’est dans cette complexité limpide, dans cette écriture merveilleuse que nous immergent à la fois le verbe de l’écrivain, par la voix de Jacques Weber, et les images de la peinture et des photographies de l’artiste, de Nice en 1941 jusqu’à la fin des années 40 à Vence, et de fenêtres en jardins, d’objets en visages à n’en plus finir.
Comme il l’a fait plus récemment de Kafka, avec la même sensibilité et le même point de vue personnel qui l’orienta dans son portrait de Rimbaud (si peu conforme au cliché du poète que son film est bonnement maudit en France), Richard Dindo a monté, à partir du « roman » d’Aragon consacré à Matisse, un double hommage qui nous fait aller et venir entre le livre et ses lieux, l'artiste et ses objets, les portraits d’Aragon par Matisse et l’évocation de leurs rencontres par l’écrivain.
Surtout, avec le motif récurrent d’une mélodie cristalline et un peu mélancolique de César Franck, c’est dans la pure « musique » de deux styles, celui d’Aragon aux images et aux formules souvent magnifiques, et celui de Matisse qui se déploie sans autre commentaire sous nos yeux, dans l’art incomparable de sa ligne et de ses ellipses, ses inventions, son équilibre et sa folie, sa sensualité et ses efflorescences, son effusion de couleur enfin – son bonheur sans mélange.
Aragon, le roman de Matisse. Un film de Richard Dindo.
-
Le souffle de la vie
Voir et revoir Vitus de Fredi M. Murer
On est parfois tenté de désespérer, accablé par le poids du monde, et notamment devant les images affreuses de celui-ci que diffusent les médias, et voici qu’un beau geste ou qu’un bon regard, ou la seule lumière du jour, un arbre, la mer, un square, un air de musique, un tableau, un beau livre nous irradient et nous traversent comme d’un souffle vital et régénérateur – or tel est l’effet vitalisant de Vitus, les mots disent ce qu’ils ont à dire : tel est le bienfait de ce film de Fredi M. Murer qu’il faut voir et revoir.
Vitus est une sorte de conte heureux, dont l’esprit d’enfance est le fil rouge incandescent.C’est l’histoire d’un garçon surdoué, dont la monstruosité du talent artistique et de l’intelligence font un être d’exception. Ses parents, la mère surtout, se mettent en quatre pour favoriser l’épanouissement de ces extraordinaires dispositions, qui ne tardent pas cependant à isoler le gosse, rêvant bientôt de redevenir normal et rusant, jusqu’à jouer, à la suite d’un accident, celui qui a perdu son don de pianiste prodige et de super-cerveau. Ce refus instinctif de la gloriole, ce besoin surtout d’être aimé pour autre chose que son QI, Vitus en trouve l’écho et le soutien chez son grand-père, veuf non conformiste avec lequel le garçon va manigancer divers bons plans.
Vitus pourrait se réduire, avec tous ses ingrédients propres à séduire le grand public, à une jolie fable flatteuse au happy end sirupeux, mais à cela Fredi M. Murer échappe avec la grâce de son art. Sans être idéalisés, tous ses personnages ont en eux un potentiel de bonté et de beauté, que les acteurs réunis modulent avec un égal bonheur. Le jeu des deux garçons (Fabrizio Borsani et Teo Gheorghiu), de six et douze ans, qui incarnent Vitus, est d’une justesse absolument sans faille, mélange de candeur et de gravité rebelle, d’ingénuité pure et de sensibilité à vif. Fredi M. Murer a beaucoup attendu avant de trouver le Vitus ideal, qu’il a finalement rencontré en la personne d’un jeune pianiste prodige. Dans le rôle du grand-père, Bruno Ganz est merveilleux de drôlerie bougonne et de tendresse, complice parfait du môme mais sans trace de mièvrerie. La parents aussi, la mère (Julika Jenkins) ambivalente (tentée de pousser la carrière de son petit génie mais non sans en voir les pièges) et le père (Urs Jucker), inventeur embarqué dans l’exploitation industrielle d’un appareil pour mal entendants, sont également impressionnants d’authenticité.
Voilà d’ailleurs ce qui fait, de ce grand film (à budget modeste, il faut le préciser) d’une substance émotionnelle richissime, et qui aborde de nombreux thèmes importants, une œuvre si belle et bonne : l’authenticité. Vitus parle de la passion de la musique, de l’amour vécu ou rêvé, du besoin de se dépasser, de la complicité tendre entre tout jeunes et tout vieux, du sens de la vie enfin, avec autant de légèreté que de malice, de sagesse souriante. Sa beauté formelle, jamais ennuyeuse, jamais ostentatoire, et la bonté du regard de Fredi M. Murer, font de ce film un poème de cinéma sans trace d’effets spéciaux, sauf celui de l’éternel bon génie humain.
Fredi M.Murer. Vitus. Ours de bronze à la Berlinale 2006. Prix du meilleur film suisse de fiction 2007. Prix du public aux Journées de Soleure. DVD Frenetic.
Sortie de Vitus dans les salles de Suisse romande et de France: le 28 février 2007.
-
L'écriture aux doigts de rose
Maurice Chappaz commente deux contes d'Afrique archaïque et donne ses versions définitives des Géorgiques de Virgile et des Idylles de Théocrite.
A quoi cela tient-il que certaines œuvres nous semblent écrites, ou peintes, ce matin ? Comment expliquer que la fraîcheur inaltérée des figures de Lascaux nous touche aujourd’hui encore, quand tant de productions contemporaines nous semblent déjà flétries ? Dans un essai évoquant, précisément, l’art anonyme de Lascaux, Maurice Blanchot situait à ce moment-là la « réelle naissance de l’art » qui pourrait ensuite « infiniment changer et incessamment se renouveler, mais non pas s’améliorer », annonçant ainsi une « perpétuelle naissance ».
« Si nous entrons dans la caverne de Lascaux », poursuivait Blanchot, « un sentiment fort nous étreint que nous n’avons pas devant les vitrines où sont exposés les premiers restes des hommes fossiles ou leurs instruments de pierre. C’est ce même sentiment de présence – de claire et brûlante présence – que nous donnent les chefs-d’œuvre de tous les temps ». Or nous retrouvons cette «claire et brûlante présence » en nous replongeant, grâce à Maurice Chappaz – nonagénaire frais émoulu – dans deux contes populaires de l’Afrique ancienne découverts par l’ethnologue Leo Frobenius qu’il commente avec une vivacité intacte (ses deux gloses datent de 1955 et 2006), et dans ses nouvelles versions (avec Eric Genevay) des Géorgiques de Virgile et des Idylles de Théocrite.
Le poète en éclaireur
Maurice Blanchot oppose le « monde » de Lascaux, « d’obscure sauvagerie, de rites mystérieux et de coutumes inapprochables », et les peintures de cette nuit des temps qui « nous frappent tout au contraire par ce qu’elles ont de naturel, de joyeux et, à la faveur des ténèbres, de prodigieusement clair ». La même allègre clarté, dans une proximité qu’on pourrait dire l’expression même de la ressemblance humaine, irradie également les contes noirs intitulés Le luth de Gassire et La chute de Kash, autant que le monde paysan des Géorgiques, proche à son tour du «Valais de bois» que Maurice Chappaz a chanté dans Testament du Haut-Rhône à l’instant de pressentir sa perte. A ce propos, les contes noirs préfigurent d’ailleurs nos préoccupations contemporaines sur un retour à la barbarie (par la vanité, l’infidélité, la cupidité et la discorde) que Chappaz n’a cessé de stigmatiser à sa façon, notamment dans Les maquereaux des cimes blanches.
De Lascaux à notre époque « de l’encerclement, de la numérotation du globe » où l’on a commercialisé le bonheur, l’artiste ou le poète reste ainsi ce témoin d’un premier bond hors de la nature et ce garant d’une civilisation toujours à venir, que ce soit au temps d’Auguste, à celui des « cours dépravées et cruellement autoritaires » que traversait Théocrite sans que son chant pur n’en fût altéré, ou en notre siècle.
L’été de ses 90 ans, avec son compère Eric Genevay et son épouse Michène l’aidant à peaufiner ses traductions sur la base de versions anglaises (!), Maurice Chappaz travaillait encore d’arrache-pied à ces deux ouvrages publiés dans les années 50 sous l’égide d’André Bonnard. Traductions complètement remaniées, fraîcheur ajoutée à la fraîcheur, saveur à la saveur, révélation grâce à Michène Chappaz d’un émouvant Héraclès enfant : telle est l’Antiquité de ce matin
Le poète écrivait en août dernier : « Je ne happe qu’un petit coin d’une civilisation qui chavire, ou qui se suicide par son colossal développement. Les mots en poésie doivent retrouver le rythme de l’eau ou du vent, puis cueillir ce qui se glisse dans la nuit car la nature parle, gémit d’une même attente : celle de l’Esprit ». Et cinquante ans plus tôt, comme si c’était tout à l’heure : « La réalité doit être atteinte dans les faits. Nos plus simples actes : manger, fumer, travailler, ses sucer les lèvres comme dit le conte, doivent être rattachés par une liturgie peut-être, par une correspondance intérieure à la totalité des êtres par exemple à ces deux truites qui fuient sous un petit pont, à ces nuages jaunes qui traversent la plaine lors de la migration des pollens de peupliers, aussi bien que les plus petites joies de l’existence doivent nous unir nous-mêmes, les individus, les multitudes qui respirons, qui buvons tous l’air, « le cognac du Père Adam »…
Maurice Chappaz et Leo Frobenius. Orphées noirs. Préface de Jacques Chessex. L’Aire bleue, 125p. Théocrite. Idylles. Version française de Maurice Chappaz et Eric Genevay. Dessins de Palézieux. Sltakine, 261p. Virgile. Géorgiques. Version de Maurice Chappaz et Eric Genevay. Slatkine, 213p.
-
Blues du Delta et environs
Le nouvel opus d’Eric Bibb
Sa voix veloutée est profonde et belle, le son de sa guitare acoustique d’une musicalité aussi claire que l’instrumentation souvent originale de ses compositions, et dès Tall cotton, le premier morceau de ce nouvel album, Eric Bibb séduit par la touche d’authenticité de son blues frotté de folk. Proche du style Delta illustré par Taj Mahal, le fils du chanteur Leon Bibb (et filleul du légendaire Paul Robeson), fait partie des nouvelles figures du blues acoustique qui jouent sur l’intensité de l’émotion et la simplicité plus que sur les effets de rythme ou de décibels. Au demeurant, Eric Bibb ne se prive pas de prendre ici diverses tangentes, que ce soit dans un funk à la Stevie Wonder (Shine on), dans la romance de quasi crooner (So glad) ou la ballade bluesy (Diamond Days) très agréable certes mais aux angles un peu trop arrondis. Un blues plus âpre, résonnant comme un appel lointain, reprend ses droits sur un tempo plus vigoureux dans le splendide In my Father’s House, avant que Forgiveness is Gold ne module sa méditation douce à la Tracy Chapman. Très appréciable chose aussi, quant à l’interprétation, que la reprise du Buckets of Rain de Bob Dylan, pour conclure en beauté avec un blues mélancolique (Still livin’on) et le supplément (à voir aussi en clip vidéo) de Worried Man Blues.
Eric Bibb. Diamond Days. TelarcBlues -
Dessins pour mémoire
Charlotte, vie ou théâtre ? de Richard Dindo
Entre 1939, à Villefranche-sur-Mer où ses parents l’avaient envoyée pour la protéger, et l’été 1943, à la fin duquel elle fut déportée à Auschwitz avec son compagnon, Charlotte Salomon a consigné « toute sa vie » dans un ensemble de 769 dessins à la gouache qu’elle confia à un docteur français en lui recommandant d’en prendre soin. Cette œuvre étonnante, aujourd’hui déposée au Musée juif d’Amsterdam, revit dans un film de Richard Dindo datant de 1992, disponible sur DVD.
Comme une sorte de chronique dessinée, Vie ou théâtre, ainsi que Charlotte intitula elle-même l’entreprise « extraordinaire ou folle » qu’elle devait réaliser pour échapper à sa tentation du suicide (sa grand-mère venait de l’accomplir en se jetant par la fenêtre, comme sa mère des années plus tôt), déploie une frise magnifiquement vivante et émouvante, d’une force d’expression plastique rare.
En découvrant cette merveille, je me suis rappelé les dessins au quotidien de Joseph Czapski, avec lesquels ceux de Charlotte ont une ressemblance saisissante – tous deux tenant ainsi comme une sorte de journal enluminé où les mots inscrits comptent aussi beaucoup.
De son enfance à Berlin - entre une mère dépressive et un père chirurgien, qui se remaria avec une cantatrice après le suicide de son épouse -, aux premières manifestations antijuives de 1933, c’est en effet tout un théâtre, à la fois intime et collectif, parfois émouvant et parfois violent, qui s’anime sous nos yeux. Richard Dindo rappelle lui-même quel fut le destin de l’artiste, en entremêlant ensuite les gouaches de celle-ci et, en contrepoint, les images des lieux et des gens évoqués au fil de ce récit de vie « pour mémoire ».
Richard Dindo. Charlotte, vie ou théâtre ? DVD La Sept/Vidéo, Mémoires juives.
-
Une arnaque de JLK

Ou comment j’ai (si bien) parlé des Bienveillantes avant d’avoir lu tout le livre…
Première question : faut-il lire les 903 pages très tassées des Bienveillantes de Jonathan Littell pour en parler ? Les visiteurs de ce blog auront pu constater qu’il n’en est rien : la plupart de ceux qui se sont exprimés à ce propos n’avaient manifestement pas lu le livre. Plus précisément, ceux qui l’avaient le moins lu en parlaient le plus !
Deuxième question : faut-il avoir lu Les Bienveillantes en entier pour en parler ? Je dirai que c’est préférable, mais pas obligatoire.
Troisième question : faut-il avoir lu Les Bienveillantes, et en entier, pour présenter le livre convenablement dans un journal ? A cela, je réponds tranquillement en révélant un scoop mondial : à savoir que j’ai écrit, en date du 2 septembre 2006, un article dans le journal 24 Heures, sur Les Bienveillantes, intitulé La sarabande du démon, que j’estime un papier convenable, alors même que je n’avais lu réellement que les deux tiers du livre, disons 600 pages au total, d’un bout à l’autre mais avec de longs chapitres juste survolés.
J’affirme aujourd’hui avoir lu Les Bienveillantes de A à Z, comme en témoigne le carnet de notes que j’ai publié sur ce blog, mais cette lecture intégrale m’a pris trois mois alors que je n’avais qu’une semaine pour préparer l’article que ma rédaction m’a commandé dès que les médias ont commencé de « tirer »… Or peut-on lire Les Bienveillantes en une semaine ? On le peut en ne faisant que ça, mais il se trouve que je n’avais pas que ça à faire cette semaine-là.
N’empêche : j’estime avoir compris, en sept minutes, que Les Bienveillantes était un livre à lire, j’en ai entrepris la lecture pour comprendre, après 150 pages, que ce livre était si important qu’il fallait le lire de A à Z et que ça me prendrait des semaines, mais ma rédaction ne l’entendait pas ainsi, c’était lundi et l’article était à paraître le samedi suivant, allez coco manie-toi.
Et coco a fait ce qu’il a pu : il a lu les 312 premières pages des Bienveillantes, jusqu’à la fin des grands chapitres Allemandes I et II, après quoi il s’est livré à une suite de « carottages» représentant à peu près 300 autres pages, et c’était vendredi, coco, la panique, à toi de « tirer »...
En relisant ce papier intitulé La sarabande du démon, je me dis que je suis un vieux pro roué qui « assure ». Personne, évidemment, des lecteurs de 24 Heures convaincus (mais si, mais si) que j’avais lu les 903 pages du livre, n’avait de raison d’en douter en lisant cet article évidemment trop court (la faute à la rédaction), légèrement amélioré lors de l’attribution du Goncourt aux Bienveillantes. Pour la défense de coco, je dirais que les circonstances l'obligeaient, en l’occurrence, à cette arnaque, alors même que je continuais de lire Les Bienveillantes et de les annoter de A à Z. De cette lecture complète, j’ai tiré un article beaucoup plus personnel et complet, il me semble, intitulé Le cauchemar de l’homme fini et paru dans Le Passe-Muraille de janvier 2007.
Cela dit, pour en revenir au livre de Pierre Bayard sur les vertus de la non-lecture, j’ajouterai ceci à propos des Bienveillantes : qu’il est possible de parler de ce livre sans l’avoir lu en entier, mais que c’est moins intéressant que de le lire de A à Z ; qu’il est sans intérêt d’en parler sans l’avoir lu ; qu’il est sans intérêt de ne pas le lire en entier, même s’il compte parfois des « longueurs », autant qu’on en compte dans A la recherche du temps perdu...
Si j’ai consacré des semaines et des mois à la lecture et à l’annotation des Bienveillantes, ce n’est pas pour me donner bonne conscience mais par seuls plaisir et intérêt. J’ai récemment parlé sur ce blog des Microfictions de Régis Jauffret, qui fait la Une du Monde des livres de cette semaine, après avoir constaté, sur la base de 30 pages (les sept minutes d’examen ou un peu plus) que les 1000 pages de ce livre étaient de trop. J’en lirai un peu plus pour argumenter tout le mal que je pense de ce livre, qui nous éloigne de nous-mêmes et du monde en prétendant nous en rapprocher, mais j’estime d’avance que lire ces 1000 pages de trop serait un grave manquement à la plus élémentaire hygiène de vie selon les règles du Dr Wilde…
-
Metaphysical Fiction
 Cormac McCarthy, le film des frères Coen et la critique parisienne. Note de Juan Asensio
Cormac McCarthy, le film des frères Coen et la critique parisienne. Note de Juan Asensio Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si les frères Coen se sont trompés. Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si les célèbres réalisateurs, en adaptant le dernier roman traduit en français de Cormac McCarthy, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, n’ont réalisé qu’un film idiot privilégiant, banalement, la violence extrême qui exsude de ces pages écrites en quelques mois. Il est ainsi piquant de remarquer que, anticipant toutes les possibles, voire très probables erreurs d’interprétation, la prestigieuse Library of Congres a catalogué ce roman sous les entrées suivantes : 1) Drug traffic-Fiction, 2) Treasure-trove-Fiction, 3) Sheriffs-Fiction et enfin 4) Texas-Fiction… Apparemment, nul ne semble avoir songé au fait que la catégorie Metaphysical-Fiction, si d'aventure elle existe, rendrait assez bien compte, sans toutefois en épuiser la richesse, de l’histoire contée par Cormac McCarthy. Je me console cependant en pariant sur le fait suivant : nous n’attendrons en revanche que quelques jours (mieux, elles se tiennent déjà, l’œil vitreux et l’écaille blafarde, sous nos yeux, avant d’avoir, sur les étals de notre glorieuse République des Lettres aussi peu achalandés que ceux d’une épicerie de la Roumanie communiste, le déplaisir de lire les critiques dites littéraires qui évoqueront ce roman, le dépeignant, tout aussi banalement et sottement que le ferait n’importe quel demi-solde journalistique amateur des romans de Chandler, Cain ou Ellroy, comme un «polar pur et dur» ou, pourquoi pas, un «western moderne ultra-violent», stigmatisant au passage, comme il se doit, les réflexions quelque peu réactionnaires qui émaillent le roman, puisque c’est désormais dans ce genre de plastique sale que le chroniqueur moderne emballe la carne de sa sottise.
(suite sur: http://stalker.hautetfort.com/)
-
Cristal d'Engadine

On lit vingt-cinq lettres sur le mur blanc d'une maison d'Ardez, en Basse- Engadine, "IL .MAINT.ES.RAI.DE.L'ETERNITA", relevées par Corinne Desarzens qui les traduit dans la foulée ("le moment est roi de l'éternité"), et se les rappellera plus tard en accentuant "cette note mineure, inconsolable, qu'on entend aussi en Irlande et qui décline le sang, la faim, l'herbe, l'émigration au loin, cette face sombre si bien brassée à la volupté solaire du champ que j'en retiens moins le regret que la légèreté", et voilà, tout est dit. Ou plutôt disons que la mèche est allumée, après quoi l'on n'a plus qu'à suivre le fil Bickford fulgurant à travers prés "vert fluo" et par les traboules des villages aux maisons "harnachées de ferronnerie, bombées, griffées de dragons", jusqu'aux petits paquets de poudre planqué de loin en loin et destinés à la fois à faire péter les clichés et à illuminer la face cachée des choses.
Corinne Desarzens écrit en général à plat ventre, par terre ou dans l'herbe, mais elle dessine aussi (cinq ou six beaux croquis émaillent d'ailleurs sa prose) et ce qu'elle dit du dessin vaut pour son écriture: "Dessiner met des yeux ai bout des doigts, la vie se concentre, palpite, le reste disparaît, et c'est un peu comme l'amour, qui fait sortir de soi..." De fait, tout ce qu'elle écrit est plein d'amour, non pas au sens sentimental mais au sens de l'élan curieux hors de soi et d'une curiosité qui sonde le secret et l'âme des choses. Elle note ainsi que les maisons grisonnes ont une petite fenêtre pour laisser l'âme s'envoler, et que le mot secret désigne, en langue romanche, les lieux d'aisance...
Curieuse au point d'apprendre l'un des cinq idiomes du romanche et de nous en servir au passage une louche de chuintantes ("Tschinch chatschaders van a chatscha da tschinch chamuoschs e tchinchtchient tschiervis", ce qui signifie bien sûr "cinq chasseurs vont chasser cinq chamois et cinq cents cerfs"), Corinne Desarzens ne cesse de lier saveurs et savoirs, sensations et sonorités verbales. Du même coup elle nous apprend des Grisons une foultitude de détails, et par exemple qu'on y appelle les migrants hirondelles (randulinas) et les chemins de traverse palingorenas, que les sauterelles d'Engadine sont "vert pois", ou que "le ciel est noir, la neige bleue, l'instant jaune citron" et qu'une certaine église "pourtant minuscule a une antichambre avec une potence, pour suspendre le gibier à bénir".
Afin de lui rendre la pareille, gibier de cette chasseresse au pied léger et au gai savoir, le lecteur bénit à son tour Corinne Desarzens qui lui a rappelé que "les sirènes ne se montrent qu'à ceux qui sont prêts à partir avec elles"...
Corinne Desarzens. Sirènes d'Engadine. Editions du Laquet, coll. Terre d'encre, 123p. -
Lolo style Deschiens

Le théâtre d’Antoine Jaccoud (1)
Il y a sept ans que je passe à côté de cet auteur dont je me sens étrangement proche, non du tout parce qu’il est lui aussi Lausannois ou que nous publions chez le même éditeur, mais du fait que ce qu’il perçoit et qu’il exprime est de partout où l’on trouve des gens ordinaires, plus ou moins cabossés par la vie, plus ou moins beaufs, comme on dit, mais regardés avec affection, avec humour et sensibilité, saisis dans leur vérité mouvante au fil de dialogues d’une justesse sans faille à quoi s’ajoute une sorte de musique aigrelette.
Un recueil de plus de 400 pages permet aujourd’hui de se faire une bonne idée de ce théâtre qu’on pourrait situer dans la mouvance du répertoire dit naguère « du quotidien », du côté d’un Jean-Marie Piemme, en plus astringent et en plus fou, en plus imaginatif aussi quant aux situations, et d’ailleurs sans que cela participe d’une quelconque école.
Le premier monologue intitulé Je suis le mari de…, datant de 2000, nous vaut une irrésistible entrée en matière, avec la confession de celui qui, par attirance fétichiste autant que par compassion, est devenu le factotum et le compagnon de la deuxième plus belle poitrine du monde, cette Lolo en laquelle on identifie évidemment une personne célèbre, mais qui devient ici toute familière, même petite fille, émouvante en somme.
C’est à la fois tordant et tendre, grandiose dans le tragi-comique, d’un véritable humour tel qu’on en trouve plus souvent dans les pays sinistrés, telle l’Irlande ou la Belgique, que dans les paradis fiscaux. Mais on sait que le fantasme mammaire est universel et qu’il est de braves gens prêts, en Suisse aussi, à prendre sur eux la souffrance de martyrs inaperçus quoique exhibés comme des monstres de foire. Tout cela que l’auteur module avec un mélange d’acuité, dans l’observation, et de gentillesse « panique », qui réjouit véritablement. Et ce n’est qu’un début… (A suivre)
Antoine Jaccoud. En attendant la grippe aviaire et autres pièces. Théâtre en Campoche, 462p. -
Les amours différées

La disparition de Richard Taylor, le nouveau roman tendre et noir d’Arnaud Cathrine
On ressort de ce beau roman polyphonique avec l’impression d’avoir traversé plusieurs vies ou reçu autant de confidences, toutes de femmes, s’entrecroisant pour composer le portrait en creux d’un homme perdu, mélange d’enfant et d’artiste qui aurait renoncé à jouer le rôle que les autres attendaient qu’il tînt.
Richard Taylor, en ses jeunes années, aimait peindre et jouer du piano, à quoi il renonça pour couper aux foudres paternelles, avant de se conformer en apparence à une existence petite-bourgeoise, au côté de sa femme Susan, qu’il exècre en réalité. Or, comme le Monsieur Monde de Simenon, voici qu’il disparaît tout à coup en ne laissant à sa mère et sa femme qu’une lettre leur révélant qu’il se sent «à leurs griffes » et qu'il a décidé de casser net et de se casser: qu’elles ne le reverront plus, en partance qu'il est fissa pour Tokyo. Sa dérive ne le mènera pas si loin, que nous suivons tout au long du roman, évoquée par les femmes qui le rencontrent, le recueillent momentanément, l’aiment et le perdent comme il semble que lui-même se soit perdu à jamais, n’était un bonheur revenu à peindre ou des essais de retour dont le plus douloureux est celui qui lui fait découvrir la fin tragique de sa femme et de leur enfant.
Si le protagoniste, qui se juge lui-même lâche, imposteur et indigne d’intérêt, nous touche par sa fragilité et son intégrité, c’est à travers le regard des femmes qu’il nous intéresse à vrai dire et, dans la foulée, c’est à ce que vivent ces femmes que nous nous intéressons plus encore, comme à autant de modulations de l’amour espéré et le plus souvent différé.
De l’amour terre à terre de Susan, l’épouse conformiste, à la passion complexe de Rebecca, collègue de Richard à la BBC, en passant par l’attachement charnel et affectif de la jeune Lydia O’Lear, la gamme des sentiments est riche, qui se déploie plus largement encore à l’approche d’autres beaux personnages féminins chez lesquels le protagoniste trouve refuge ou ne fait que passer. Ainsi de l’attachante Molly Hunter, chez laquelle il se pointe car elle vit dans la maison où il a passé son enfance, qui imagine un instant que « quelque chose » pourrait se passer entre eux, tout en devinant qu’il n'en sera rien. Sur les traces du fugitif, on croise également la trajectoire de la dramaturge Sarah Kane, amie de la transsexuelle Vanessa, qui croit rencontrer l’amie rêvée dans le métro avant de tomber par hasard, en pleine crise de désarroi, sur Richard qui a l’air aussi perdu qu’elle. Dans la foulée, Sarah se fait la réflexion que, dans ses pièces, elle n’aura jamais en somme fait que parler d’amour…
On pourrait en dire autant de ce roman à multiples voix, dont les dialogues signalent d’ailleurs un grand talent théâtral virtuel, et que sa densité émotionnelle et sa pénétration intuitive, sa vivacité d’observation et son tonus interne tirent du côté de la vie en dépit de sa noirceur. Rien cependant de complaisant en celle-ci, qui relève plutôt de la lucidité et de l’honnêteté de l’auteur, d’une impressionnante maturité à tous égards.
Arnaud Cathrine. La disparition de Richard Taylor. Verticales, 194p. -
Le carton du cinéma suisse
Une scène de Vitus, de Fredi M. Murer, avec le jeune pianiste prodige Theo Gheorghiu et Bruno Ganz
Aux 42es Journées de Soleure, pros et public fêteront une féconde année 2006
Le nouveau chef de la Section Cinéma de l’Office fédéral de la culture a de quoi pavoiser : l’année de son intronisation coïncide avec une embellie spectaculaire du cinéma helvétique dans le domaine privilégié de la fiction. Mais Nicolas Bideau y est-il pour quelque chose ?
Rappel des chiffres : en 2006, les films suisses, avec 1,5 million d’entrées, se sont taillé une part de marché record de plus de 10%, certes très loin derrière le cinéma américain (60% des 16,6 millions d’entrées) mais devant la France (8,7%) ou la Grande-Bretagne 8,3%). Dans le top-ten national, seul le Vaudois Jean-Stéphane Bron marque la présence romande avec Mon frère se marie (23.300 entrées), à la dixième place, derrière Grounding de Michael Steiner (367.000 entrées) ou Vitus de Fredi M. Murer (166.000 entrées). Avec 55 films – 18 films de fiction, 15 documentaires et 22 courts métrages -, la présence helvétique s’est en outre notablement accrue dans les festivals internationaux où de nombreux lauriers ont été glanés. Est-ce à dire qu’y en a point comme nous et que « ça baigne » ?
Ce qu’il faut relever, en premier lieu, à l’ouverture des Journées de Soleure, constituant l’aperçu annuel et le forum professionnel du cinéma suisse, c’est que ces « fruits » ne procèdent pas de la nouvelle politique de Bideau, sauf du point de vue de la communication. En outre, le rayonnement international du cinéma suisse, hors des festivals, reste très limité.
« Il est clair, précise Ivo Kummer, que 2006 a été une grande année pour la fiction suisse, et que les films nominés pour la meilleure fiction au Prix du cinéma suisse sont tous d’un niveau remarquable, toutes générations confondues. Par ailleurs, il est évident que le niveau technique et le langage de Grounding, ou de Vitus, correspondent mieux au standards internationaux, et que le public et les médias suisses sont plus réceptifs à notre cinéma, grâce aussi à la politique de communication et au travail des distributeurs. Mais il ne faut pas se griser pour autant : le hasard compte là-dedans, comme le fait que nombre de fictions ont été conçues pour la télévision. La situation reste sensible, et nous devons être attentifs aussi à la défense du film documentaire, l’un des fleurons traditionnels du cinéma suisse. » Cette réserve est également le fait de René Gerber, directeur de ProCinéma, association des exploitants et distributeurs de films, pour qui la production cinématographique est « une affaire cyclique qui connaît des hauts et des bas », réduisant 2006 à « une année normale ».Et Bideau là-dedans ?
Vitrine annuelle du cinéma suisse drainant un public averti (nettement moins populaire à cet égard que le festival de Locarno), les Journées de Soleure privilégient aussi les débats entre professionnels. Cette année, nul doute que les discussions rouleront (notamment) sur la politique et les méthodes du nouveau Monsieur Cinéma de l’OFC, qui commence à susciter de rudes grognes, surtout outre-Sarine. Communication clinquante d’un haut fonctionnaire qui agit en patron de studio, favoritisme pro-Romand, « jeunisme », interventionnisme excessif sur le contenu des projets : tels sont, entre autres, les reproches que réalisateurs et producteurs adressent (à voix encore basse) à celui qui ne laisse personne indifférent.
«On ne pourra juger de la politique de Bideau que dans deux ou trois ans, pondère Jean-Stéphane Bron, qui note aussi, comme ses pairs Lionel Baier ou Frédéric Choffat, que l’exigence d’un cinéma plus ouvert au public est une bonne chose, et que l’effort de communication a contribué à battre en brèche l’image d’un cinéma suisse mortifère.
N’empêche : l’impression que Nicolas Bideau en « fait trop » pour la galerie, sans avoir les moyens de ses proclamations, relançant le vœu de Pascal Couchepin d’un cinéma suisse qui « cartonne », est partagée même par ceux qui ont salué son arrivée. « On parle trop du cinéma suisse et pas assez des films », remarque Lionel Baier, alors qu’Ivo Kummer rappelle qu’il en est du cinéma comme du sport : défendre ainsi les seules disciplines spectaculaires est insuffisant, voire dommageable pour l’ensemble de la production. Et Frédéric Choffat de comparer le cinéma d’auteur à l’agriculture de montagne, dont le soutien n’a pas à être sacrifié à la course aux chiffres…
Atouts et découvertes
Limousines et tapis rouge pour la cérémonie relookée du Prix du cinéma suisse : on va voir ce qu’on va voir le 24 janvier au soir, où cinq films sont en lice pour la meilleure fiction 2006, notamment. Favoris : Vitus de Fredi M.Murer, sélectionné pour les Oscars, Grounding de Michael Steiner et Das Fraülein d’Andrea Staka, déjà couronné à Locarno. Vaillants nominés vaudois : Lionel Baier et Jean-Stéphane Bron.
Entre autres nouveautés à découvrir dont parle la rumeur: Das wahre Leben du très prometteur Alain Gsponer, évoquant les désarrois exacerbés d’un adolescent dans une famille contemporaine « surbookée ».
Dans les grandes largeurs, la rétrospective consacrée au maître imagier Renato Berta (lire 24Heures du ) jouxte une nouvelle bourse aux clips, un (chiche) hommage à Daniel Schmid (avec la seule Paloma…), le (riche) Panorama de la production suisse (235 films), la section transfrontalière Passages, des débats, etc.
Ouverture aujourd’hui en présence du Conseiller fédéral Samuel Schmid et d’une escouade de parlementaires.
Romands en lice
Au nombre des films de réalisateurs romands présentés à Soleure, il en est dont on a déjà parlé l’été dernier, tels Mon frère se marie de Jean-Stéphane Bron, La liste de Carla de Marcel Schüpbach, La traductrice d’Elena Hazanov, Qué viva Mauricio Demierre de Stéphane Goël ou Jeu de Georges Schwizgebel, présentés à Locarno. D’autres ont été révélés entretemps, de Comme des voleurs de Lionel Baier à La vraie vie est ailleurs de Frédéric Choffat. A ceux-là s’ajoutent plusieurs dizaines de « longs » ou « courts » à découvrir, comme la dernière réalisation de Claude Goretta, Sartre, l’âge des passions, un bref docu de notre consoeur Anne Cuneo intitulé Max Bollag, galerist, ou l’évocation, dans Vivement samedi ! d’Emmanuelle de Riedmatten, du parc de Vidy-Lausanne, haut-lieu de rencontres multiculturelles.
Fort attendu enfin: Voler est un art, le film d’investigation de Pierre-André Thiébaud, consacré au « casse» perpétré à Genève en 1990 contre l’UBS, et racontant les tenants et aboutissants de ce hold-up, témoins à l’appui. Une sorte de docu-thriller…
Soleure. 42es Journées du cinéma suisse, du 22 au 28 janvier. Infos : 032 625 80 80. Ou http://www.journeesdesoleure.ch/
-
L'ange de la Seine
Une chenille de métal traverse la Seine sur un pont squelettique.
Le soleil danse sur l’eau miroitante, sur les multiples facettes d’un immense diamant de béton.
Un homme marche sur le quai. Fasciné.
Il erre entre les arbres, le long des péniches houillères, les yeux rivés sur les flots.
Une mouette passe en criant.
Dans ses yeux mouillés, la crête des vagues léchée par la lumière, scintille.
Les longs chalands amarrés s’entrechoquent doucement.
Les filins étirés cinglent leurs flancs en rythme.
Un silo déglutit du minerai : la pyramide s’écroule par son milieu, grand sablier du temps.
L’homme progresse. Pas à pas, il gagne la rive, s’immobilise.
Ses pieds n’accrochent pas la pierre : il tombe.
L’eau fangeuse le caresse, l’enveloppe.
Il sombre dans les profondeurs…
Le remous projette encore les bateaux l’un contre l’autre.
Le soleil pleut, inonde la ville.
La chenille repasse en sens inverse,
Des enfants jouent sur le chemin de halage…
Frédérique, lycéenne(1981)
-
Fugues de la trentaine
 Frédéric Choffat signe son premier "long", La vraie vie est ailleurs.
Frédéric Choffat signe son premier "long", La vraie vie est ailleurs. Dès le splendide générique de La vraie vie est ailleurs, en long plan-séquence d'un ample mouvement tournoyant sans coupe, tourné dans les couloirs de la gare de Genève, Frédéric Choffat et sa camérawoman Séverine Barde nous coulent dans la foulée des trentenaires de ce premier long métrage, avec empathie et vigueur. Il y a là un jeune type mal rasé style bohème (Dorian Rossel) qui va rejoindre à Berlin son amie venant d'accoucher de leur petit Lucas; une femme du genre «qui assure» (Sandra Amodio) en route pour un colloque scientifique à Marseille; et cette femme-enfant (Antonella Vitali) mutine et râleuse, fille d'Italiens (30 ans en Suisse et pas encore le droit de voter !) qui rejoint Naples avec son chat et un caquelon à fondue que lui ont offert ses amies. Chacun de ces personnages, suivis en alternance, va faire, le temps d'un voyage nocturne, l'expérience d'une rencontre qui aura valeur, à chaque fois, de retour sur soi. A partir d'un scénario apparemment ténu, La vraie vie est ailleurs se développe comme une triple fugue émotionnellement riche, où le réalisateur et sa co-scénariste, Julie Gilbert, brossent six portraits de jeunes gens d'aujourd'hui en forme d'interrogation existentielle.
«Ce que nous voulions dès le départ avec nos regards croisés, explique Frédéric Choffat, c'est aborder la relation féminin-masculin. Plus précisément, dans la première de ces histoires, nous avons abordé la condition de ces femmes de la trentaine finissante qui ont énormément investi dans leur affirmation professionnelle, quitte à sacrifier leur vie affective ou leur part féminine. En l'occurrence, le personnage masculin rencontré est un de ces garçons qui, au contraire, ont plutôt développé leur part féminine et que la demande de l'autre incite à se réaffirmer. Ce qui nous a intéressés ensuite, était de développer ce thème en privilégiant le non-dit et en impliquant les acteurs dans la construction des personnages.»
 La vraie vie est ailleurs tient en effet, beaucoup, au jeu très engagé des comédiens, tous très convaincants. «Si les personnages étaient typés à l'avance, aucun dialogue n'a été écrit. C'est sur le tournage même que tout s'est fixé à mesure». Certaines séquences «flottent» parfois, mais l'intensité émotionnelle et la spontanéité des comédiens pallient ce défaut. Ainsi de la relation joyeusement conflictuelle de l'Italienne et du couchettiste incarné par Roberto Molo, ponctuée de saillies verbales (improvisées) irrésistibles. Egalement étonnants malgré leurs rôles «taiseux»: Vincent Bonillo en doux paumé «sauvant» à sa façon la superwoman fatiguée; ou la sauvage Jasna Kohoutova, belle figure de Balkanique endiablée qui fouette le sang du jeune père.
La vraie vie est ailleurs tient en effet, beaucoup, au jeu très engagé des comédiens, tous très convaincants. «Si les personnages étaient typés à l'avance, aucun dialogue n'a été écrit. C'est sur le tournage même que tout s'est fixé à mesure». Certaines séquences «flottent» parfois, mais l'intensité émotionnelle et la spontanéité des comédiens pallient ce défaut. Ainsi de la relation joyeusement conflictuelle de l'Italienne et du couchettiste incarné par Roberto Molo, ponctuée de saillies verbales (improvisées) irrésistibles. Egalement étonnants malgré leurs rôles «taiseux»: Vincent Bonillo en doux paumé «sauvant» à sa façon la superwoman fatiguée; ou la sauvage Jasna Kohoutova, belle figure de Balkanique endiablée qui fouette le sang du jeune père.
A 33 ans, Frédéric Choffat, Lausannois par sa mère et formé à l'ECAL, réussit un premier «long» qui confirme les promesses de son début de carrière, marquée par divers prix.
Avec un petit budget (un peu plus de 500 000 francs, soit la moitié de la norme en matière de fiction), une équipe hyperlégère et beaucoup de talent (dont celui du musicien Pierre Audétat), La vraie vie est ailleurs honore le cinéma d'ici.
La vraie vie est ailleurs. Dans les salles romandes. Aux Journées de Soleure, Reithalle, le 25 janvier.

-
Berger de mots

Caeiro ! évoque Pessoa en finesse
Qui était vraiment Fernando Pessoa (1888-1935), ce fascinant écrivain portugais du début du XXe siècle dont les hétéronymes principaux (Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Bernardo Soares et Ricardo Reis) défient notre besoin d’identification de l’auteur en un seul « moi-je » ? L’écrivain orthonyme était-il le « vrai » Pessoa, plus que l’auteur du Livre de l’intranquillité, très prisé depuis quelques années, ou que le savoureux matérialiste terrien du Gardeur de troupeaux, ce Caeiro que Pessoa tenait pour son maître, « mort » en 1915 ? Et pourquoi ne pas voir en ceux-là autant de facettes d’un même cristal à la fois réel et fictif ?
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a du Pessoa et du Soares dans le Caeiro évoqué au fil du spectacle éponyme présenté ces jours au théâtre Kléber-Méleau, dans une mise en scène ludique et inventive d’Hervé Pierre, un bel écrin scénographique (Daniel Jeanneteau) et des lumières (Marie-Christine Soma) et costumes (Isabelle Flosi) d’un même bonheur, avec lequel les deux comédiens (Clotile Mollet et Gilles Paris) sont également en phase.
Ebahissement candide d’être au monde, raisonnements philosophiques oscillant entre humour absurde et doux lyrisme, pas-de-deux verbaux ou gestuels poético-loufoques, tout cela glisse un peu en surface mais avec grâce, laquelle se fait soudain plus incisive dans l’histoire de l’enfant éternel (Jésus désertant le paradis et ses paris stupides pour retomber en enfance et sur la terre « qui est parfois si jolie », comme disait l’autre) cher à Pessoa autant qu’à Caeiro…
Tout en douceur malicieuse, à fines touches et avec des talents conjugués, ce Caeiro ! se déguste volontiers mais sans rester bien longtemps en bouche…
Théâtre Kléber-Méleau, jusqu’au 28 janvier. Ma, me, je à 19h. Ve, sa à 20h.30. Relâche lundi et mardi 21 et 22 janvier. Réservations : 021 / 625 84 29. -
Whispering Safonoff
A La Désirade, ce dimanche 14 janvier. – Cette évocation hivernale de la baie de Montreux vue des hauts, par Varlin, rend bien la tonalité de ce dimanche d’hiver et fait écho, à l’instant, à ces mots que je lis dans le dernier livre de Catherine Safonoff, intitulé Autour de ma mère et me rappelant à tout moment les notes sensibles du livre que je préfère de Peter Handke, Le poids du monde : « Je me rappelle l’hiver dernier, un hiver gris et froid tendu par une sorte de courage mécanique. On écrivait tous les jours, à 16 heures on rangeait les papiers et on partait marcher. J’allais d’un bon pas dans le froid, toujours le même parcours, la nuit tombait, de retour je montais le chauffage, faisais du thé, un peu de ménage, des exercices de grec, écoutais la radio – oui, un bon hiver régulier et les longs soirs étaient assez heureux, tout autour de la maison c’était un beau froid noir et muet ».
Voilà, c’est exactement ça que nous avons ce dimanche matin, ce « beau froid noir et muet », et le murmure de Safonoff me touche et me fait lever les yeux à tout moment, comme hier soir et tous ces soirs le Journal de Kafka, qu’elle dit elle aussi lire en continu, me rappelant également ce seul titre de Handke que ces pages illustrent précisément : L’heure de la sensation vraie
« Une seule chose a compté dans ma vie, écrit Safonoff, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un ». C’est exactement ce que dit aussi Sarah Kane dans le dernier roman d’Arnaud Cathrine, et c’est ce que j’ai écrit dans mes carnets de l’année dernière, et cela aussi du murmure de Safonoff trouve un immédiat écho en moi : « Je n’aime pas ne pas revenir à quelqu’un ». C’est pourquoi j’en ai tant bavé, moi, de ne pas voir certains de mes amis ne jamais revenir. Moi je serais toujours revenu mais le sentiment qu’ils ne reviendraient jamais ni sur ce qu’ils ont dit ni sur ce qu’ils ont fait, parce que leur hubris, leur orgueil, leur paresse, la face à ne pas perdre les en empêchait, cette évidence qu’ils ne reviendraient pas sauf à revenir où ils étaient restés, autant dire une petite mort, m’ont paralysé. Ici, chez Safonoff, on est dans la fragilité pure de qui aime et qui aimerait aimé.
Voici ce qu’elle écrit d’un enfant, elle la vieille petite fille. « Après-midi avec Rémy, quinze mois. Il a un grand attachement pour Doudou, un hippopotame mou recouvert de tissu éponge verdâtre. La peluche est devenue morveuse, croûteuse, malodorante. Parfois l’enfant me la tend mais sans la lâcher. Sucé, cajolé, trituré, Doudou est la chair d’une chair originelle. Je me demande quand Rémy quittera son Doudou et par quoi il le remplacera. Il s’endort, tétant la queue de son hippopotame. Je me demande quels sont mes objets transitionnels et vers quoi ils me transitionnent ».
Mon objet transitionnel de ce dimanche froid noir et muet est ce livre qui filtre la vie avec une justesse de chaque mot et de chaque silence. C’est un livre proustien à l’état de notes apparemment éparses, mais tenues ensemble par-dessous ou dedans, qui pourrait avoir 100 ou 1000 pages. C’est un livre qui ne se discute pas. Je dois aller en parler mercredi prochain à la radio et voilà ce que je dirai : on ne discute pas ce livre, ce livre est ce qu’il est, c’est un objet transitionnel qui a la couleur de la tristesse et d’une joie discrète…
Catherine Safonoff, Autour de ma mère. Zoé, 264p.
-
Le barbare «communique»
Sur Le dieu du carnage de Yasmina Reza
Après que le jeune Ferdinand, onze ans et des bricoles, a bastonné le non moins jeune Bruno, qui refusait de l’admettre dans sa bande et se retrouve avec deux incisives amochées et le visage en semi-compote, les parents des deux lascars se réunissent chez Véronique et Michel Houillié, géniteurs de la victime. Lui est un commercial sans trop d’états d’âme et elle fait dans la littérature humanitaire – son prochain écrit traitera du Darfour. En face, Annette et Alain Reille plaident coupables, mais on verra que leur tolérance aux charge moralisantes de Véronique ont des limites. Plus précisément, les relations de celle-ci et d’Alain, avocat d’affaires très sûr de lui et qui ne cesse de communiquer sur son portable avec les relations publiques de la firme pharmaceutique qu’il représente, ne vont pas tarder à se crisper avant de plus graves éclats, quand le conflit généralisé mettra fin à la séance de conciliation dont la nouvelle pièce de Yasmina Reza détaille les tenants et aboutissants.
En gros, ce qui y est révélé n’est un secret pour personne, relevant même du lieu commun d’époque : c’est que le barbare est toujours prêt à bondir de sous le masque du civilisé et qu’il faut peu pour faire, de parents dits adultes et responsables, piqués dans leur susceptibilité de classe, de genre ou de couple, des sauvages pires que leur progéniture. Dans le cas de cette double paire, le conflit opposant initialement les conjoints se corse au moment où l’entente entre mecs et la fureur des chipies fait apparaître les failles de chaque couple, jusqu’à l’horreur vomitive et les gestes fous dont un portable « vital », jeté dans l’eau des tulipes, fera les frais avant celles-ci…
On se rappelle la verve satirique d’Art, qui fit un des premiers succès un peu convenus de la dramaturge, mais ici c’est du plus grave et du plus subtil aussi, du plus douloureusement significatif : ça fait vraiment mal, avec la même verve endiablée, sur fond de révolte légitime, que dans le récit tendrement dévastateur d’Une désolation…
Je préfère, quant à moi, le versant tchékhovien de Yasmina Reza, dans Conversations après un enterrement ou L’Homme du hasard. Mais Le dieu du carnage est à lire vite pour le méchant plaisir qu’il procure, avant de le découvrir toutes griffes dehors sur une ou l’autre scène…
Yasmna Reza. Le dieu du carnage. Albin Michel, 124p. -
Jouvence de Maurice Chappaz

« Si Paul Eluard avait été Suisse romand, disait un jour Etiemble à propos de Maurice Chappaz, personne ne connaîtrait son existence outre-Jura», et c’est à peu près la situation dans laquelle se trouve, aujourd’hui encore, l’un des plus grands écrivains apparus en Suisse romande dans la postérité de Ramuz, dont l’œuvre poétique nous semble, du seul point de vue de l’apport à la langue française, d’une vigueur et d’une originalité qui n’a cessé de se renouveler jusqu’à l’âge avancé de l’écrivain, comme l’illustre la prose inspirée et folle de l’Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), dont l’extraordinaire liberté d’invention verbale va de pair avec la profondeur de pensée. Or cette oeuvre si dense, à la fois si cohérente et si variée dans ses expressions (poèmes, proses, lettres, journaux personnels, récits, pamphlets, reportages) n’a pas droit à la moindre mention dans l’Anthologie de la poésie française publiée à l’enseigne de la Pléiade en l’an 2000 ! Autant dire que c’est avec reconnaissance qu’il faut accueillir la première étude sérieuse consacrée en France à Chappaz, assortie d’un choix de textes conforme à la lecture « pour l’essentiel », très érudite et très pénétrante de Christophe Carraud, latiniste et spécialiste de Pétrarque qui se situe assez nettement dans une optique spiritualiste d’inspiration catholique « augustinienne ».
Le moins qu’on puisse relever alors est que son approche de grand style et de profonde sensibilité (autant du point de la réflexion que de l’expression) ne sacrifie pas à l’esprit du temps, au risque même d’écarter plus d’un lecteur qu’effarouchera la crainte (injustifiée selon nous) d’une œuvre trop « difficile ». Du moins, coupant à tout folklore anecdotique, Christophe Carraud a-t-il le premier mérite de rappeler que toute œuvre classique – car c’est à cette hauteur qu’il place celle de Chappaz – est foncièrement exigeante. D’emblée, il est dit en outre que l’œuvre de Chappaz « vient de plus loin que lui et va vers une fin dont seule la préfiguration nous est offerte ». Ce n’est pas l’arracher à l’humus qui l’a nourrie non plus qu’à son temps, bien au contraire : le premier souci de Christophe Carraud, en virtuel « lecteur très ancien », est de resituer le « lieu de permanence » qu’a représenté le Valais ancestral soudain en mutation dont Chappaz est à la fois l’héritier et le chantre partagé entre adhésion (témoin proche de la construction de la Grand Dixence) et rejet fulminant (l’attaque écologiste contre les promoteurs rapaces), auquel on n’aura cependant rien compris en le classant tantôt vagabond anarchisant proche des hippies ou proprio terrien réactionnaire.
Qualifiant la pensée sous-jacente de Maurice Chappaz, de l’initial Testament du Haut-Rhône aux Maquereaux des cimes blanches ou à La haine du passé, entre tant d’autres écrits, Carraud affirme que « ce n’est pas une pensée du retour ; c’est une pensée de la continuité du temps, contre ceux qui en figent l’imprévisible déroulement dans un progrès sans archè, sans mystère et sans vie, exacte antithèse du mouvement qu’il prétend être. Un progrès sans réponse ni responsabilité, sans questionnement ni mémoire ».
Sans raconter la vie de Chappaz en détail, Christophe Carraud en resitue les étapes successives : la première naissance difficile et la seconde qu’a représenté la formation des chanoines augustiniens de Saint-Maurice ; le choix d’une vocation et l’émancipation d’une lourde généalogie de notaires et d’avocats ; la première rupture « franciscaine » du poète de L’homme qui vivait couché sur un banc, et sa réinsertion ultérieure dans la communauté des hommes, dont témoigne le Chant de la Grande-Dixence ; la rencontre de Corinna Bille, la famille, les difficultés et la transmutation continue des œuvres nourries de vie ; enfin la méditation sans cesse reprise sur la mort, les voyages et plus encore : le pèlerinage de tous les jours, avec ses rites répétés et ses liturgies, la poussée « résurrectionnelle » de sa poésie faisant miel de toutes choses. Ainsi : « Pour connaître une vie, il suffit peut-être d’un instant, juste de naître, j’imagine le pullulement de New York dans le bébé qui ouvre la bouche, où entrent aussitôt les constellations »…
D’aucuns reprocheront, peut-être, à Christophe Carraud d’ « enfermer » l’œuvre de Maurice Chappaz dans une eschatologie catholique, mais ce serait ne pas voir l’évident héritage spirituel du poète et ce qui l’« aspire » vers le futur, ni le « ciel ouvert » au lecteur, souscrivant ou non à ce déchiffrement, par les pages du poète rassemblées ici et qui semblent écrites ce matin…
Christophe Carraud. Maurice Chappaz. Préface de Bruno Doucey. Editions Seghers, collection « Poètes d’aujourd’hui », 333p.« La beauté nous fera pénétrer dans les ailleurs, à en perdre son nom .» (Maurice Chappaz)
-
Naissance d’un poète

Lecture de Maurice Chappaz (1)
« Le jour vient, d’ailleurs le soleil entame. »
(Charles-Albert Cingria)
« On le vit se déshabiller derrière une haie, on le vit faire un petit paquet de sa chemise, de sa cravate, de son habit fort civil, coton ou alpaga, envoyer ça dans un coin du parc après plusieurs jurons : des « damned », des « christo », des « morbleu ». Il libéra ses souliers d’une secousse et un instant il fut tout nu (rudement étrange, bonnes gens, Cicérons !) et un instant après chaussé d’espadrilles, vêtu d’un pantalon de toile bleue, d’un chandail et d’une vieille casquette, c’est-à-dire comme Jacques et comme Pierrot ses amis. De cambouis, du plâtre, de la terre tachent ses vêtements, mais le cambouis, le plâtre, la terre, sont de bonnes choses, de celles qui existent à tout coup dans le monde. Et les semelles de chanvre aussi, qui vous collent au pied et vous permettent de sentir le sol. Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment beau, ce qui est extra comme disent les enfants et les poètes, c’est la liberté ! Et on voyait bien qu’il la humait, la respirait dans l’ombre bleue et violente des séquoias du jardin public de L. Il buvait à longs traits dans cette ombre qui était comme du champagne noir et lui battait le sang d’une gaîté, d’une ivresse pareille à celle que ce vin prodigue aux Heureux. Mille pensées explosent dans la tête, mille sujets de plaisirs. Puis un vent violemment froid, mais odorant et sauvage, dissipe ces fumées. C’est Muscat noir qu’il faut appeler l’ombre à cause de l’été, à cause du goût du raisin et de cet air frais et glaciaire qu’on les arbres. Ah ! oui, c’est la liberté qu’il savoure, il s’était enfui de la commune où son père remplissait des fonctions administratives, quelque chose comme notaire ou shérif. Il avait résolu de ne plus se casser la t’été avec les devoirs incongrus que chacun dans sa famille ou dans la société s’ingéniait à lui imposer. Maintenant il venait de renaître au hasard, là près de cette haie, quelqu’un qui n’avait jamais connu les leçons d’une école. Il se met à regarder avec des yeux neufs les choses autour de lui, elles ont cette paix qu’ont les fossés, le matin, il les salue toutes en disant « ô », soufflant sur elles et leur refaisant comme un cœur, comme une aube, comme un firmament, l’espace où elles glissent et où elles éclatent, où l’oiseau chante en sa langue :
Ô l’arbre, ô l’écorce
dans le jardin semé d’ombre et de soleil… »
Ainsi commence le texte d’une quinzaine de pages intitulé Un homme qui vivait couché sur un banc, premier écrit de Maurice Chappaz publié, en 1940 dans la revue Suisse romande, sous le pseudonyme de Pierre. Maurice Chappaz avait vingt-trois ans lorsqu’il composa cette nouvelle envoyée au concours lancé par la revue en question, dont le jury (notamment composé de Jacques Chenevière, C.F. Ramuz et Gustave Roud), eut à examiner 153 textes.
A relire aujourd’hui Un homme qui vivait couché sur un banc, l’on peut y voir, en raccourci, à part le don plus qu’évident du jeune poète, comme une sorte de « programme » rimbaldien que, de fait, Chappaz allait suivre tout au long d’une vie essentiellement consacrée à la poésie, avec la même exigence de rupture opposée à la société des pères établis, la même effusion partagée par quelques compères bohèmes dans une nature heureuse, la même salutation à telle humanité élémentaire d’artisans et de chemineaux, le même appel d’air et de simplicité balayant « la dérisoire hiérarchie du bien-être », la même « sérénité contemplative » vécue avec une espèce de candeur d'avant la Chute, mais qui n'allait pas durer, entamée qu'elle serait des les dernières pages de Verdures de la nuit, son premier recueil paru sous son nom en 1945.
« O Poésie, sois ma maison natale à présent, sois une enfance nouvelle et vraie, bénie par ta tendresse, ô ma mère noire. Viens, je sors, erre avec moi dans les rues où je fume, où je m’assieds, gagne pour finir la place en haute de la ville. Là, les maisons s’alignent un peu délabrées, aux façades simples. Jaunes, brunes, presque ocres au soleil. Il y a des granges, des entrepôts, le char des paysans et les camions chargés de vivres qui démarrent dans les goudrons, tout un bazar d’étoffes, de charges de légumes, d’enfants des rues et les rudes travailleurs manuels ; la vie du peuple déballé magnifique avec ses odeurs, sa peinture – odeur de foin, peinture de fruits.
Moi je m’étends sur un banc pour toute la journée. Rien faire, absolument rien faire. Quand vient midi ou toute autre heure, je me lève, j’ai une gamelle de polente et dans un petit sac de toile, voilà du pain de seigle, du fromage et une bouteille de fendant. La polente cuit en plein air. Un bâton fixé entre deux pierre : la broche et le foyer. Les ménagères me donnent quelques bûches, des fois j’ai un bout de lard. J’aime manger et, après avoir mangé, me mettre le dos au mur de façon à tenir le haut du corps dans l’ombre et les jambes au soleil. Fumer une pipe de Garibaldi, se rouler des sèches, finir sin vin, à l’occasion s’endormir »…
Maurice Chappaz. Une homme qui vivait couché sur un banc. Suivi de Verdures de la nuit et Les Grandes Journées de Printenps. Préface de Marcel raymond. Postface de Jean-Luc Seylaz. Castella, 192p. 1988. -
Le vieux sage et les collégiens

A la veille de son 90e anniversaire, le 21 décembre 2006, Maurice Chappaz est revenu à Saint-Maurice où il a fait ses classes
«Vive Chappaz!» pouvait-on lire, il y a quelques années, en grandes lettres blanches peintes sur la falaise dominant le Collège de Saint-Maurice. Tel fut le signe de soutien manifesté par les collégiens à l’écrivain vilipendé, dans son pays, par les bien-pensants qu’offusqua son pamphlet écolo-politique Les maquereaux des cimes blanches. Si cette trace de complicité est aujourd’hui presque effacée, la relation de l’écrivain avec «son» collège ne s’est jamais distendue pour autant, relancée à l’occasion d’une magnifique rencontre.
Dans un premier temps, le professeur et critique français Christophe Carraud, auteur de la première monographie consacrée en France à Maurice Chappaz (parue chez Seghers, en 2005), a présenté l’œuvre en soulignant sa «puissance de vie» et, aussi sa «qualité de pensée» en consonance avec les grands problèmes d’un siècle marqué par les camps de la mort et Hiroshima, où l’humanité est devenue «tuable». De fait, si Chappaz n’a jamais été le porte-voix de grandes idées, ni un écrivain engagé au sens marxisant, sa démarche de poète autant que son œuvre n’ont cessé d’affirmer une position critique fondamentale, à la fois contre le développement inconsidéré de la technique et contre toute forme de déshumanisation. «Continuateur médiéval» de la grande tradition augustinienne, a relevé Christophe Carraud, Maurice Chappaz est un guide pour la jeunesse actuelle, qui adresse «un oui pur et simple au bonheur et au malheur d’être né»…
La meilleure preuve du bel exemple qu’incarne le poète nonagénaire a été, dans la foulée, sa rencontre avec les collégiens de Saint-Maurice, préparés par la lecture du Garçon qui croyait au paradis.
En préambule, Maurice Chappaz a rappelé aux jeunes gens que ses maîtres, quand il entra au collège de Saint-Maurice, en 1927, lui firent valoir que ses études ne seraient en rien utilitaires, ne servant qu’à répondre à telle interrogation essentielle: qui suis-je? A la question, posée ensuite par un collégien, de savoir s’il se considérait comme un intellectuel, Chappaz répond: «C’est l’animal qui écrit! Pas le psychologue ni le professeur… mais l’animal humain se distingue par l’intelligence, c’est vrai!». Puis à la grande question du bonheur, tel qu’il l’aura vécu lui-même: merveilleuse réponse du vieil homme, évoquant la carrière d’un Malraux, soumis aux effrayantes tragédies personnelles qui l’endeuillèrent et faisant face à sa façon. «Je serai très prudent en la matière, très prudent…», conclut le poète à ce propos, immédiatement compris par les jeunes gens.
Or, à l’un d’eux l’interrogeant plus prosaïquement sur l’utilité de la dissertation, Chappaz répond sans hésiter: «C’est la base de tout». Et de rappeler la leçon d’un de ses maîtres, qui flanqua un zéro à toute la classe après un premier exercice de composition, sous le seul prétexte qu’aucun des collégiens n’avait exprimé son sentiment spontané…
Une heure de partage vibrant et ces mots en guise de leçon non académique: «Plus vos études seront inutiles, plus elles vous serviront. Aimer est inutile, comme le bonheur, la beauté, la musique, la poésie, notre présence à l’instant – tout cela est inutile, mais c’est cela même qui compte le plus dans notre vie, autant que ce verre d’eau»… -
La blanche de sa vie
La pêche à rôder, de Jacques-Etienne Bovard
C’est toujours un bonheur que de voir un écrivain gagner en liberté dans le développement de ses thèmes et de son expression, comme il en va des quatre récits de La pêche à rôder de Jacques-Etienne Bovard, après les avancées déjà très remarquables du Pays de Carole et de Ne pousse pas la rivière, ses deux derniers romans. D’aucunes et d’aucuns, sans même y aller voir de plus près, auront fait cette petite moue des gens sérieux pour qui la Littérature ne saurait se complaire dans l’anecdote, en avisant cet album assorti de photographies « maison », genre cadeau de fin d’année, où l’on voit la fille de l’auteur, un ami à lui pêchant de dos, son matériel exposé, un long poisson dans la rivière, que sais-je encore de plus inspirant pour les belles âmes de la paroisse littéraire romande ?
Quant à moi, déjà ferré par l’enthousiasme véhément de notre compère l’éditeur, mais demandant pourtant à y voir, j’ai bel et bien culbuté dans ce livre à l’unisson de l’auteur, puisque c’est par une chute dans la nuit matinale, suivie d’un empêtrement ponctué de jurons, que Bovard marque son ouverture, au double sens du terme tant il est vrai que la première des quatre séquences du livre, intitulée La grande blanche, coïncide avec le première jour légal de la pêche, non loi de l’embouchure de la Venoge.
Or tout de suite on y est : on y est physiquement, comme aux petites aubes les conquérants de l’inutile sortant de la cabane d’altitude, tout de suite on flaire la rivière après en avoir perçu la rumeur entre les feuilles, tout de suite on est comme happé par cette Attente dans laquelle va se dérouler tout un combat compliqué dont l’enjeu est une fuyante merveille, mi chair-mi fantasme, vivant défi qui ne peut qu’être dans l’absolu du pêcheur, aujourd’hui où c’est la mort, la « blanche de sa vie »…
La quête de l’absolu, chez Jacques-Etienne Bovard, ne va pas sans patauger, s’embrouiller le fil et le matos, surtout risquer de faire mayaule, l’expression vaudoise signifiant tout louper et rentrer bredouille. A cette sainte salope de poisse, l’écrivain consacre de formidables pages, dignes d’un grand écrivain. Deux passages, déjà, de Ne pousse pas la rivière avaient atteint cette intensité de fusion d’une perception très physique et d’une aspiration quasi métaphysique à vivre sa passion jusqu’aux confins de l’extase et de la mort, dont l’inatteignable blanche était déjà le symbole. Dans La pêche à rôder, où il gagne encore en liberté narrative et en puissance d’évocation - salut Hemingway, salut Jim Harrison -, Bovard touche à toutes les gammes de sensations et de sentiments, de la tendresse filiale (la belle initiation de Retrouvailles) à l’amitié scellée par l’Aventure, en passant par la relation profonde avec la nature ou la reconnaissance manifestée à ceux qui l’ont initié, le ressouvenir personnel d’épisodes familiaux révélateurs, enfin tous ces petits côtés et tous ces beaux moments constituant les facettes de son Grand Jeu.
Jacques-Etienne Bovard. La pêche à rôder ; un art de l’impatience. Bernard Campiche, 130p.
-
« J’ai servi la beauté …»

Les incantations de Sappho, portées par la voix sublime d’Angélique Ionatos
Le grand art consiste parfois à sublimer les maux de ce bas monde, et c’est à quoi s’est vouée Angélique Ionatos à la première de Sappho de Mytilène, son spectacle dédié tout entier à l’antique poétesse grecque, palliant l’impossibilité de chanter de Katerina Fotinaki pour cause de pharyngite, et la défaillance d’une de ses guitares… Or le public, sans besoin d’aucune «indulgence », a fait un triomphe à cette extraordinaire traversée des millénaires sur les ailes de la beauté pure, où le verbe étincelant de Sappho (adapté en grec moderne par Odysseus Elytis) et les mélodies à la fois suaves et sauvages de la « démoniaque » Angélique, la voix et la présence expressives de celle-ci, et quatre musiciens complices de grand talent se sont fondus en parfaite symbiose.
« J’écris mes vers avec de l’air/Et on les aime/J’ai servi la beauté/Etait-il en effet pour moi quelque chose de plus grand ?/Même dans l’avenir/Je le dis/On gardera de moi le souvenir »… Telle est la « lettre » que rédigeait dame Sappho il y a de ça 2500 ans et des bricoles, qui nous arrive dès le premier morceau (Aérion épéon archomai) de cette suite lyrique faisant alterner douceur extrême et violence, sensualité et mystère, allégresse et fureur, tendresse maternelle (Cléis) ou lancinant érotisme (Pali pali o érotas).
Quinze après sa création, dont une trace enregistrée témoigne, Sappho de Mytilène revit ici avec une palette instrumentale élargie (où s’accentuent l’exubérance orientalo-balkanique autant que les modulations les plus dépouillées) qui doit beaucoup aux talents en fusion d’Henri Agnel (cordes pincées et percussions) et de son jeune fils Idriss (étincelant percussionniste), du clarinettiste Bruno Sansalone et de Katerina Fotinaki à la guitare, à laquelle les dieux seraient avisés de rendre sa voix pour un surcroît de beauté…
Lausanne-Renens. Théâtre Kléber-Méleau, jusqu’au 17 décembre, à 19h (me-je), 20h.30 (ve-sa) et 19h-30 (di). Relâche lundi et mardi. Durée : 1h.30. Location : 021 / 625 84 29 et 021/ 619 45 45
Angélique Ionatos et Nena Venetsanou. Sappho de Mytilène. CD Auvidis/Chorus. -
Coups de coeur
Les choix de 3 libraires
Maryjane Rouge
Librairie Payot, Lausanne
 Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.
Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.
«Ce thriller politique est mon coup de cœur ! Très intéressant par son aperçu de la nouvelle réalité sud-africaine, après la fin de l’apartheid, où l’on voit qu’il y a encore beaucoup à faire en matière d’égalité raciale et de justice, il est en outre superbement écrit. Le protagoniste, surnommé P’tit, est en réalité un immense gaillard qui fait figure de héros malgré son passé de tueur des services spéciaux. Au moment où il a décidé d’assagir, amoureux et en charge du gosse de son amie, voilà qu’on l’appelle au secours, et c’est reparti… »
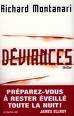 Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.
Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.
«Tous les ingrédients du polar noir haletant se retrouvent dans cette histoire de serial killer à délire mystique, dont la première victime est une adolescente retrouvée mutilée et en posture de prière. Cela se passe à Philadelphie, où un flic un peu rétamé et bordeline enquête avec la jeune Jessica, laquelle assure « un max ». Très bien construit et d’une écriture non moins convenable, ce roman intéresse à la fois par son aperçu des dérives violentes de la religion et par ses personnages, réellement attachants. »
 Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.
Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.
«Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas l’enquêteur favori de l’auteur que nous retrouvons ici, mais un jeune inspecteur angoissé par le cancer qu’on vient de déceler chez lui. A cette mauvaise nouvelle s’ajoute celle de l’assassinat d’un ancien collègue, sur lequel il va enquêter pour se trouver bientôt plongé dans le milieu glauque des anciens nazis et de leurs émules actuels, avec un deuxième crime corsant encore l’affaire. Mêlant suspense et investigation sur un thème de société, Henning Mankell nous captive une fois de plus… »
Claude Amstutz
Librairie Payot, Nyon.
 Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.
Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.
«Le double intérêt de ce livre tient aux contrées qu’il évoque, des Indes aux Marquises ou de Turquie en Bretagne, entre beaucoup d’autres, et aux écrivains qui « accompagnent » l’auteur dans ses pérégrinations, tels Rimbaud ou Cendrars, Loti ou Segalen. Cette double bourlingue nous fait croiser le sillage des mutins du Bounty autant que Paul Gauguin en ses îles, au fil d’un récit littéraire agréable de lecture et très bien écrit, où la réalité est souvent ressaisie par le petit bout de la lorgnette ».
 Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.
Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.
« Ces chroniques ont valeur de fresque d’époque, qui recouvrent la deuxième partie du XXe siècle et sont marquée par le ton très personnel et la « patte » de ce marginal mélancolique qu’était l’auteur d’Un singe en hiver. A ce propos, il revient ici sur les reproches qu’on lui a faits d’exalter l’alcoolisme, avec des nuances aussi malicieuses que justifiées. L’amitié (pour Marcel Aymé, Roger Nimier ou René Fallet) va de pair avec la liberté d’esprit, comme lorsqu’il s’en prend à la haine des « justiciers » de l’épuration. »
 Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.
Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.
« Il vaut la peine de redécouvrir ce roman datant des années 50 dont les observations vives, voire féroces, contrastent avec son écriture un tantinet fleur bleue. Il y est question des tribulations d’une veuve qui ouvre une librairie dans la province anglaise, suscitant la réprobation croissante des gardiens de la conformité vertueuse, et notamment lorsque éclate le scandale lié à la publication du Lolita de Nabokov. Comme on dit que son chien a la peste pour le noyer, tout est bon pour couler la librairie en question… »
Nicolas Sandmeier
Librairie du Midi, Oron-la-Ville
 Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.
Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.
« On retrouve ici les deux vieux frangins du précédent Chant des plaines dans leur ferme perdue du Colorado, après l’épisode qui les a vus accueillir une jeune fille-mère, laquelle est repartie vivre de son côté. La mort d’un des frères est l’événement central de cette suite, qui verra réapparaître la jeune fille auprès du frère survivant. Par ailleurs, l’auteur brosse un tableau plein de relief de la société provinciale, en s’intéressant surtout aux plus démunis dont il détaille de beaux portraits. »
 Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.
Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.
« Le protagoniste de ce roman est un traîne-patins qui se fait virer de la multinationale moscovite où il travaille, dont le boss le récupère aussitôt pour qu’il s’occupe de son jeune fils trop sage, qu’il aimerait encanailler. Le rapport entre le tuteur et son pupille sera marquant pour celui-là plus encore que pour celui-ci, jusqu’à ce que se pointe une femme évoquant Audrey Hepburn. Sur fond de nouvelle société russe, l’auteur de La soif entraîne ses personnages dans de nouvelles virées très arrosées… »
 Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.
Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.
« Après son premier roman à succès, Les soldats de Salamine, Javier Cercas endosse ici son propre rôle en se rappelant un séjour qu’il a fait, dans sa vingtaine, aux Etats-Unis où il a été marqué par la rencontre d’un certain Rodney, ancien du Vietnam qui l’influence notamment par les étonnantes considérations qu’il développe sur la création littéraire, avant de disparaître soudain. Revenu en Espagne, le jeune auteur, auquel son succès donne la « grosse tête », va retrouver par hasard son mentor et en nourrir une réflexion lucide sur sa vie ».
-
Poète de l'instant
Hommage à Pierre-Alain Tâche. Une exposition et un nouveau livre marquent 40 ans de poésie.
« Le poète est un jeune homme aux cheveux blancs, il est myope avec de gros yeux et il y a toujours quelqu’un qui vient de marcher sur ses lunettes », notait Roland Dubillard dans ses carnets, et cette image nous est revenue en lisant Roussan de Pierre-Alain Tâche, qui vient de paraître en même temps qu’un bel hommage est rendu au poète lausannois au palais de Rumine.
On nous objectera que rien, au premier regard, ne rapproche le jeune poète de Dubillard et le digne Pierre-Alain Tâche, figure éminente de la poésie romande qu’on pourrait dire le double héritier de Gustave Roud et de Philippe Jaccottet, dont le personnage de notable bien établi, magistrat en retraite, n’a guère du bohème à lunette fendues.
Or à y regarder de plus près, sans fard social, c’est bel et bien le poète frais émoulu que nous retrouvons dans ce que nous préférons des fusées lyriques de ce Pierre-Alain Tâche qui, il y a quarante ans de ça, avec Greffes puis La boîte à fumée, incarnait le jeune poète à nos yeux adolescents. Depuis lors, l’écrivain régulier a produit son œuvre, riche aujourd’hui d’une trentaine de titres. Or sa poésie, à travers son évolution vers moins de fioritures précieuse et plus de simplicité, a conservé cette fraîcheur du verbe à sa source (laquelle a des cheveux d’écume blanche et des éclats de lunettes en miettes) qui se joue des âges.
D’un recueil à l’autre, Pierre-Alain Tâche a cartographié, bien au-delà de nos régions, une géographie poétique qui sait ressaisir le génie du lieu (autant que Charles-Albert Cingria, Michel Butor ou Jacques Réda) et magnifier l’instant vécu. De notre Cité lausannoise à l’île d’Orta ou, dans Roussan, des bleus salés-sableux de Vindilis (Belle-Île-en-Mer) à tel jardin perdu d’une enfance ou à telle maison close de Semur-en-Auxois, le poète nous lave le regard au fil de mots comme rénovés. Francis Ponge disait qu’il prenait les objets du monde pour les réparer dans son atelier. Tâche s’y emploie lui aussi, avec une sorte d’enjouement amoureux et de gravité légère. Tantôt limpide et tantôt baroque, ludique ou pensive, musique et peinture en contrepoints subtils, la poésie de Pierre-Alain Tache est éloge serein. D’aucuns lui reprocheront d’ignorer l’effondrement des tours de Manhattan. C’est que son horloge est réglée sur le temps des forêts qui repoussent, dont les allées résonnent comme celles de cathédrales…
Pierre-Alain Tâche. Roussan. Empreintes, 109p.
Lausanne. Palais de Rumine. Pierre-Alain Tâche, une poétique de l’instant. Exposition, jusqu’au 31 mars 2007. -
Pépères sur la route

Eric Clapton et JJ Cale réunis
Quand un nonchalant vieillissant de la guitare-broderie rencontre un maxi-relax de la guitare-dentelle, cela ne peut donner dans la frénésie, mais ce n’est pas vraiment ce qu’on attend de la rencontre des deux légendes du blues-rock réunies ici en studio, au son aussi « cool » que le bitume de la route d’Escondido (Californie) un après-midi de soleil mâchant son chewing-gum. On savait l’admiration de Clapton pour l’auteur de Cocaïne et d’After Midnight, qu’il a dignement défendus naguère, et c’est lui-même qui a pris l’initiative de cette rencontre au sommet… de moyenne hauteur. Du moins les deux « pattes », et les deux voix au même moelleux, se mêlent-elles agréablement au fil de ces quatorze compositions, dont JJ Cale signe la plupart.
Cela part avec un Danger sans risque, et la suite genre country-folk, avec Heads in Georgia et cinq ou six autres titres, reste fort sage et même lisse, avec de beaux moments tout de même (le solo frémissant d’Albert Lee sur Dead End Road, avec Taj Mahal à l’harmonica) pour rejoindre (dès Hard to Thrill) un blues-rock plus fusionnel qui trouve sa meilleure expression à la toute fin, avec Ride The River, d’un lyrisme country chaleureux où les deux voix et la paire de six cordes flambent doucement et sûrement, scellant une rencontre plus « historique » qu’inoubliable…
J.J. Cale et Eric Clapton. The Road to Escondido. Warner Music -
Actualité de Cendrars
Dernières parutions
L'actualité de Cendrars est relancée ces jours par la publication de quatre livres marquant, du même coup, la fin de la réédition des Oeuvres annotées par Claude Leroy, chez Denoël. Avec les volumes 13, 14 et 15 de cette série s'achève ainsi une édition assortie d'un appareil critique léger. Le dernier volume, reprenant les fameux entretiens de Cendrars avec Michel Manoll, Blaise Cendrars vous parle... illustre parfaitement le travail de mise en perspective de Claude Leroy, qui détaille par exemple les circonstances dans lesquelles ont été réalisés ces entretiens et l'énorme travail de refonte accompli par Cendrars pour le passage de l'oral à l'écrit.
Autre transcription passionnante relevant du même genre: Celle de Qui êtes-vous ?, émission de radio qui rassemble ici, autour de Cendrars, divers interlocuteurs (dont les écrivains Emmanuel Berl et Maurice Clavel) qui s'affairent à pousser le poète dans ses derniers retranchements, d'où il échappe le plus souvent avec des prodiges de malice affabulatrice ou de mauvaise fois. Un certain Dr Martin, jouant les psychanalystes, parvient cependant à le transporter, soudain, sur le terrain de l'absolue sincérité, et tout l'entretien s'en trouve éclairé d'une autre lumière. La pauvre Berl ne semble pas bien comprendre à quelle sorte de vérité se réfère Cendrars, alors que les propos de celui-ci tissent une véritable profession de foi poétique sur fond, quelque peu inattendu, de pessimisme philosophique nourri de Schopenhauer.
Le continent Cendrars n'a cessé, ces dernières années, de se trouver cartographié par moult diligents chercheurs tous plus ou moins liés au Fonds Cendrars des Archives littéraires suissses. Ces travaux ont nourri, comme elle le révèle d'entrée de jeu, la nouvelle édition de la grande biographie de son père dont Miriam Cendrars avait publié une première mouture en 1984. Monumentale, cette biographie entremêle le récit d'une vie et les innombrables écrits procédant de celle-ci ou la réinventant, d'une manière incessamment créatrice. Fils d'un inventeur raté qui s'inventait déjà tout un monde dans ses palabres de bistrot, le jeune Sauser devenu Cendrars a passé par une multitude d'avatars souvent peu connus, parfois peu glorieux, mais dont l'ensemble constitue bel et bien une légende de la littérature du XXe siècle.
Deux affabulations du poète, rapportées par Claude Roy
"Blaise Cendrars, quand je le rencontrai, était un vieil homme. Manchot, boucané, la trogne d’un adjudant de la Coloniale qui aurait eu du génie dix minutes avant Apollinaire. La prose du Transsibérien, les Pâques à New-York : mon cœur bat toujours en lisant ces poèmes.
Un grand malheur avait frappé Cendrars : la mort de son fils. Un peu de hargne aussi l’avait atteint, comme un peu de mal-mûri gâte une vieille pomme rouge : Cendrars était, tout compte fait, un célèbre méconnu. Il consolait sa grande peine, et ses petits ressentiments, en fabulant à sa machine à écrire. Un de ses livres d’alors s’intitule Histoires vraies. C’est hâbler dès le titre. Cendrars galopait au large du réel.
Un jour, j’avais été lui rendre visite à Aix-en-Provence. Pendant tout le déjeuner il m’avait parlé du célèbre tableau du Maître de l’Annonciation d’Aix. Je n’avais pas de chance. La toile était justement en voyage. Elle avait quitté l’église de la Madeleine, envoyée il ne savait où pour une de ces expositions temporaires qui font voir du pays aux chefs-d’œuvre. Mais ça ne faisait rien : Cendrars avait exactement le tableau dans l’œil. Il le connaissait comme sa poche. Il l’avait étudié pendant des mois et des mois. Il avait même fait à son sujet des découvertes capitales. Il avait acquis la certitude que l’auteur de cette Annonciation était un de ces satanistes déguisés en peintres pieux qui abondaient au XVè siècle.
Ils camouflaient sous une orthodoxie apparente leurs blasphèmes et leurs défis. La preuve, c’est que le bouquet qui, dans l’Annonciation d’Aix se trouve aux pieds de la Vierge est composé sournoisement de toutes les fleurs chères à Satan, et aux treize mille démons, Séddim, Schirim, Bélial, Belzébuth et leur cohorte sulfureuse.
Le peintre avait rassemblé dans un pot de cuivre la flore de l’enfer : le chardon stérile, la racine de houx, la mandragore, l’iris noir, toutes les fleurs du jardin du mal. Cendrars était intarissable sur ses découvertes. Il les étayait d’une scintillante érudition où les traités de démonologie, les Pères de l’Eglise, les descriptions des théologiens de l’Eglise syriaque, l’Histoire de la Magie en France du bon Garchet et les traités persans d’astrologie venaient à la rescousse.
Après le déjeuner, nous allâmes en flânant jusqu’au Musée, et dans la seconde salle, je tombai sur la toile de l’Annonciation d’Aix. Elle y était accrochée temporairement, parce qu’on faisait des travaux dans l’église de la Madeleine. Je me précipitai sur le bouquet dont Cendrars m’avait entretenu pendant une bonne partie du déjeuner. Pour découvrir que le peintre avait représenté avec autant d’amour que de minutie, non pas les végétaux vénéneux que m’avait décrits le poète, mais (plus innocemment) deux lys blancs, une campanule bleue et une rose rouge.
« Regardez, Cendrars ! » M’écriai-je.
Il se pencha, examina avec un œil stupéfait le bouquet que je lui désignai, se releva avec une expression souveraine d’indignation :
« Ah les salauds !s’écria-t-il : ils ont fait des repeints ! »
L’année suivante, après une journée à Aix en compagnie de Cendrars, il m’emmena boire à la fin de l’après-midi le verre des adieux dans un petit bar du cours Mirabeau. Il ne pouvait m’accompagner jusqu’à la gare, où j’allais prendre le train, mais avait décidé de faire un bout de chemin avec moi.
« Vous avez vu, me dit-il, le patron de ce petit bar devant lequel nous venons de passer ? C’est Charlot, un vieil ami à moi. Ah si nous avions eu le temps, j’aurais aimé que vous bavardiez avec lui ! C’est un personnage étonnant. Il est bistrot, mais il a en même temps la passion de l’archéologie, des vieilles pierres, de l’histoire. Pendant l’occupation, c’est lui qui a organisé l’évasion des résistants de la prison d’Aix. »
« Quelle évasion ? » demandai-je.
« Oh ! tous les journaux en ont parlé. On a même décoré Charlot après la Libération . Il était peut-être le seul aixois à connaître l’existence du souterrain creusé au Moyen Age, un souterrain qui réunissait le Palais de Justice à la place où avaient lieu les exécutions capitales. Charlot a réussi de sa cellule à en trouver le tracé, à creuser au bon endroit pendant des nuits avec ses camarades, et finalement à y faire passer douze personnes avec lui, qui attendaient d’être fusillées par les Allemands. Une nuit, ils ont filé et les Allemands ne les ont jamais rattrapés. »
Je quittai Cendrars, arrivai à la gare, pour m’apercevoir que j’avais raté mon train. Schéhérazade ne donne pas la vertu d’exactitude à ceux qui l’écoutent. J’avais deux heures à tuer en attendant le prochain départ, et je décidai de retourner bavarder avec le nommé Charlot.
Il fut très aimable. Dommage : il n’avait jamais été en prison sous l’occupation. Il n’y avait malheureusement eu aucune évasion de la prison ni du Palais de Justice. Personne n’avait entendu parler du fameux souterrain qui réunissait la Conciergerie à la place des exécutions capitales.
Mais quoi ? Quel mal y avait-il là ? Cendrars avait été heureux deux heures. Je l’avais été avec lui..."
Propos rapportés par Claude Roy in Somme toute, anatomie du mensonge. Paris Gallimard.1976. Page 215-217.
Photo de Robert Doisneau: Blaise Cendrars et les Gitans d'Aix-en-Provence.
Cette citation de Claude Roy a été retrouvée par Bona Mangangu, citée sur son blog (cf liens ci-contre). -
Avec vue sur la mer

Je m’en suis tenu, maman, à ta règle de ne pas s’en laisser conter. J’ai résolu, en me rappelant ce que tu m’as appris, de ne suivre que mon instinct, sans m’occuper de ce que les autres pensaient ou disaient. Je ne me suis pas laissé piétiner, et c’est à cause de ça que nous nous sommes trouvés finalement elle et moi, je te parle de Marie-Ange.
Mon projet c’était d’assumer, comme ils disaient. J’avais été ébranlé par le départ de Vera. Je ne m’étais pas rappelé tes préventions à son égard. Je m’étais dit que peut-être elle avait raison - que c’était moi qui déraillais. J’ai donc hésité, puis je me suis ressaisi.
Elle m’a dit que j’étais un taré. Elle m’a dit: tu dois être un pervers, oui c’est cela tu es un pervers, tu me fais gerber. Elle a dit ça. Elle voulait me faire mal. Elle ne supportait pas l’idée que j’aie mes propres goûts. C’était comme en musique: elle n’admettait pas que j’apprécie Frankie Laine et Dolly Parton. Elle aurait voulu que je m’en remette entièrement à elle: elle prétendait que la country était barjo et qu’elle, Vera, ne pouvait simplement pas tolérer qu’on joue de la country ou du folk sous son toit. Par rapport à mon goût particulier, elle m’a dit que j’étais un vicieux, mais là je me suis défendu en lui rappelant que c’était elle qui m’avait conseillé de me libérer quand on s’était rencontrés, puis que c’était elle qui me l’avait fait la première fois.
A part ça, même si ma tendance n’était pas tellement revendiquée alors en tant que telle, j’avais pour moi toute le nouveau trend de l’époque. Partout, à ce moment-là, tout le monde ne faisait que répéter: vivez votre fantasme, affirmez votre désir, affichez votre différence. Tout le monde s’assumait en long et en large. Il n’y en avait partout que pour la différence et c’est ce qui m’a poussé à sortir du bois à mon tour.
Mais là-dessus, pour y parvenir, il est vrai qu’il m’aura fallu du temps et du cran. C’est qu’il faut dire, et là vraiment je ne vais rien te cacher, que ma différence à moi était un peu spéciale.
La réaction de Vera m’avait mis sur mes gardes. Alors même que c’était elle qui m’avait fait flasher là-dessus, je m’étais aperçu que ce jeu amoureux que j’avais redécouvert en sa compagnie, et qui me semblait tout ce qu’il y a d’innocent, ne lui était apparu comme ça que le temps d’une séance alors qu’il deviendrait, d’après ce qu’elle disait, un vice ou une perversion à se répéter.
Quant à moi, je ne voyais pas du tout les choses ainsi. J’avais découvert un truc hyperfort et je m’y tenais. J’avais retrouvé une sensation géniale et je ne vois pas pourquoi j’aurais culpabilisé. D’une certaine manière, aussi, je t’avais retrouvée. Peut-être que je n’aurais pas osé te le dire comme ça, quand tu étais encore là. Peut-être que ça t’aurait choquée, comme quand je t’ai avoué que j’avais bu un verre de notre urine avec Timothée, autour de nos sept ans, mais à présent je te dois cette vérité, c’est une question entre nous, maman, puisque ces moments-là me restent aussi comme mes plus anciens souvenirs de toi, je crois bien.
Je me les suis rappelés surtout à l’odeur. Tout n’était plus alors qu’une affaire de sensation, mais c’est sacrément important: les psychologues le répètent tant et plus. En tout cas moi ça restait le lien le plus fort entre nous.
Tout de suite, quand Vera me l’a fait, je me suis retrouvé tant d’années en arrière, dans une lumière qui devait être celle de la salle de bain aux vitres dépolies de la maison des Oiseaux, je me suis rappelé le dur et le doux de la planche à langer que tu avais installée en travers de la baignoire à pieds de fonte, je me suis rappelé la petite flamme bleutée de la veilleuse du chauffage à gaz que je distinguais d’en dessous et je me suis rappelé des sons lointains qui devaient être ceux de la vie dans le quartier, je me suis rappelé l’odeur de la grosse commission, comme tu l’appelais avec une sorte de reconnaissance, comme si ça te prouvait que j’existais, et peu après je me suis rappelé l’odeur de la crème Nivea qu’on pourrait simplement dire l’odeur de propre en ordre et de sécurité que j’associe aussi à ta présence à chaque fois que j’avais transpiré au cours de mes chères maladies d’enfant et que tu me changeais avant de m’apporter ma tisane, je me suis rappelé tout ça mais je n’en ai pas parlé à Vera, et je me le suis parfois reproché, mais c’était avant de rencontrer Marie-Ange.
Ensuite, par l’imagination, ça a été encore plus géant. Au fur et à mesure que je revivais cette première séance, je retrouvais d’autres sensations et d’autres détails qui me rappelaient notre vie tout au début aux Oiseaux.
Et c’est ça, peut-être, c’est sûrement ça qui a fait paniquer Vera, avec cette intuition que vous avez toutes.
Elle a dû se dire, probablement, que ce que je lui demandais de me faire, là, nous ramenait à autre chose qu’à notre histoire.
Ce qui est certain c’est que c’est à cause de ça que cela s’est gâté entre nous et qu’elle m’a jeté, mais c’est aussi vrai qu’après m’être posé des questions j’en ai eu marre de tout prendre sur moi et que j’ai décidé, avec l’aide de Jean-Yves, d’assumer mon fantasme.
J’avais alors plus de trente ans, mais je me sentais un peu flottant à quelque part. Je n’estimais pas avoir encore trouvé la voie particulière dont tu disais que j’étais digne - toi qui me rêvais plus ou moins soliste dans un orchestre de danse parce que tu m’avais payé des leçons de piano toutes ces années et que ma façon de jouer du Richard Clayderman te semblait fantastique -, mais je sentais que je devais faire quelque chose qui tranche avec la routine de l’agence où je travaillais en intérimaire.
Déjà, d’avoir rompu avec Vera m’a fait du bien, contrairement à ce que j’avais craint. Plus j’y pensais et plus je me disais que cette femme m’aurait empêché de respirer à la longue. Notre collage durait depuis plus de trois ans, avec deux ou trois crises qui t’avaient plutôt réjouie, puis ça a été ton attaque foudroyante qui m’a tellement secoué que je me suis rendu compte que sans Vera je me serais effondré, mais j’avais aussi remarqué, durant cette période où je commençais mon travail de deuil, comme l’appelait Jean-Yves, que Vera était hyperdure et combien aussi, matériellement parlant, elle se montrait calculatrice.
Jean-Yves m’a aidé à me faire à la solitude, c’est lui qui a commencé à me donner à lire des trucs en psycho, il m’a écouté et je lui en ai raconté de plus en plus, un jour que je lui ai dit ma terreur de voir papa débarquer dans son cabinet j’ai fondu en larmes comme un môme et il m’a pris dans ses bras, après quoi les vannes se sont ouvertes et je lui ai tout déballé, toutes nos années, toutes les fois où papa se pointait et finissait par te menacer, d’une séance à l’autre je descendais le courant selon son expression et puis j’ai commencé de le remonter et c’est tout à la fin que j’ai cassé le morceau, un jour j’allais tellement mal qu’il m’a dit que j’avais besoin de quelqu’un et qu’il m’a posé la main sur la cuisse, mais moi je me suis retiré tout de suite en me veillant de ne pas le blesser, il ne l’a d’ailleurs pas du tout mal pris, il m’a même dit que c’était mieux comme ça et c’est alors qu’en toute confiance je lui avoué mon fantasme.
Quand Jean-Yves m’a dit qu’on allait travailler ce sujet-là, je me suis dit, surtout après le coup de la main sur la cuisse, que je devais une fière chandelle à ce type et d’autant plus qu’il avait lui-même une vie à problèmes à ce qu’il semblait.
Pourtant j’étais encore bien loin, à l’époque, d’envisager un coming out que Jean-Yves lui-même ne me conseillait pas. Ensuite de quoi, et ça aussi m’a salement secoué, mais peut-être aussi libéré d’une certaine façon, Jean-Yves a disparu sans crier gare. Comme nous avions espacé les séances, il se passait parfois deux ou trois semaines sans que nous ne nous rencontrions, puis il m’a parlé d’un autre poste qu’il pourrait peut-être décrocher au sud de la France, et finalement c’est par une lettre un peu distante, sur un ton qui m’a plutôt déçu, qu’il m’a expliqué que nous ne nous reverrions pas et que je pouvais continuer la thérapie avec Glenda, après quoi ses adieux étaient plus affectueux et il me laissait son adresse, mais jamais je ne lui ai récrit et d’ailleurs je n’avais plus tellement besoin d’une aide de ce côté, je venais de vendre les Oiseaux, j’avais de quoi survivre quelques années sans travailler, puis j’ai eu envie de revoir du monde et j’ai passé d’un job à l’autre par l’agence et je me suis mis à chercher une partenaire qui me comprendait sans même que j’aie forcément besoin de lui confier mon secret.
Plus précisément, lorsque j’ai commencé de fréquenter les minorités, un sentiment compliqué, joint à ma timidité naturelle, m’empêcha de me livrer.
Un samedi matin que ces groupes défilaient dans les rues du centre ville, je leur avais emboîté le pas, je m’étais mis à manifester avec eux en faveur de la différence, puis un type qui distribuait des tracts m’en a filé quelques-uns à remettre aux passants, et le soir je me suis retrouvé à ce qu’ils appelaient une prise de parole dans le cadre du Collectif Fusion.
Je dois te le dire alors sans détour: tout de suite ça m’a plu. Tout de suite, ces filles et ces garçons qui disaient ce qu’ils vivaient sans tricher, ça m’a vraiment superplu. Je me suis dit: là, Roland, tu vas pouvoir t’assumer.
Cela se passait dans un loft: moi je n’avais rien contre a priori, tu sais, malgré le joli cadre dans lequel nous avons vécu aux Oiseaux. J’étais sûrement le plus vieux du groupe, mais je m’étais fait un look western, j’avais les cheveux longs et je m’étais mis au banjo. On était tous assis à des étages différents, il y avait de la musique qui tournait toute seule et des filles aux pieds nus distribuaient des tasses de thé de menthe. Ensuite de quoi s’est déroulée la prise de parole.
Il y avait un garçon aux cheveux décolorés et aux lèvres noires (je ne te mens pas), appuyé contre un type baraqué en veste de cuir, qui racontait ce qu’il avait enduré en milieu ouvrier, et j’étais touché de voir que tous avaient le même air concerné en l’écoutant.
Il y avait une fille chauve à la voix rauque qui racontait l’abus qu’elle avait subi: elle disait que tout venait de là, mais qu’en somme elle ne le regrettait pas vu qu’elle préférait être comme ça que pareille aux blaireaux, et tout à coup je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment plusieurs façons d’être différent.
Enfin, après deux ou trois autres, un certain Brahim a expliqué ce que ça représentait de voir dans le regard de l’autre le mot bougnoule, et je me suis alors demandé si je pourrais, avec ma différence, être aussi bien accepté que lui et les autres.
En tout cas je n’étais plus tellement à l’aise. J’étais content de m’être rapproché de ces gens que je pouvais écouter et auxquels je montrais ma propre compréhension, mais je les ai observés aussi et j’ai vu comment cela se passait entre eux, et j’ai noté que, très vite, les uns et les autres se rapprochaient ou s’éloignaient au contraire les uns des autres, s’attiraient ou se rejetaient carrément.
Bientôt, en plus, certains ont voulu savoir où je me situais, intrigués qu’ils étaient par mon allure et mes silences. Sans faire trop de mystère je me disais plutôt en recherche et déviais la conversation en promettant de m’expliquer lorsque je m’y sentirais disposé. Comme je ne répondais aux avances ni des uns ni des autres, et que je répandais autour de moi ce fluide que la première tu as identifié chez moi, chacun des camarades se figurait que ma différence s’apparentait plus ou moins à la sienne et que de toute façon je finirais bien par m’exprimer.
Mais comment passer à l’acte ? Comment m’expliquer sans me faire exclure comme je l’avais été par Vera ? Comment leur dire ma différence ?
Toi tu l’aurais compris, ça ne faisait pas un pli, que j’aimais plus que tout être langé, que j’aimais faire dans mes couches et que rien ne me plaisait autant que d’être torché et changé: tu aurais accepté mon fantasme qui, d’une certaine manière, me rapprochait de toi par delà les années; surtout tu aurais apprécié la probité avec laquelle j’étais résolu à l’exposer et à la défendre - mais comment la leur faire accepter si moi-même je m’en gênais encore ?
Eh bien, mon intuition ne m’a pas trompé, puisqu’à la première prise de parole où, enfin, je m’exprimai dans un groupe de conscience du Collectif Fusion, je remarquai aussitôt comme un courant de réprobation passer, ainsi que je l’avais éprouvé avec Vera. Dès que les gens eurent compris de quelle nature était ma différence, je constatai qu’ils se regardaient, puis ils commencèrent de murmurer et il fallut que Régis rappelle que dans le groupe on respectait l’outing de chacun pour que cela se calme.
Depuis ce soir-là, pourtant, j’ai remarqué qu’un fossé s’était creusé entre nous.
Après mon intervention, déjà, les gens m’ont tous plus ou moins évité à la fin de la séance et l’ami de Régis, me prenant à part, m’a parlé de psycho-réparation sur ce même ton de bienveillance accablée qui avait été celui de Vera.
C’est ainsi que je m’éloignai du Collectif Fusion et que, malgré le soutien passé de Jean-Yves et la possibilité de recourir à sa collègue, j’entrai peu après, en dépression.
Je n’ai pas besoin de te faire un dessin: tu as connu cela des années durant. Même si ce n’est qu’aujourd’hui que je commence d’imaginer ta propre dérive, je n’en reviens pas encore de l’avoir supportée moi-même: ça a vraiment été la totale, mais j’ai toujours pensé que tu reçois ce que tu donnes et c’est exactement ce que nous nous disons à présent que nous sommes installés aux Mésanges, Marie-Ange et moi.
Bref, des mois ont passé, et l’internement, les médics et tout ça, mais une fois encore j’avais mon idée et, dès que je m’en suis tiré, je n’ai plus pensé qu’à vivre mon obsession jusqu’au bout non sans avoir remis mes compteurs à zéro.
J’avais d’abord cru, stupide que j’étais, ce que disaient les gens, puis j’avais vu ce qu’ils faisaient; et maintenant je me rappellais que tu m’avais toujours dit de ne jamais me fier qu’à ce que les gens font, et là je peux dire que tu avais raison: j’ai vu que ce qu’ils font n’a rien à voir avec ce qu’ils disent mais je me suis obstiné et désormais, avec Marie-Ange, nous n’avons plus à rendre de compte à personne.
Si je me suis assumé finalement en pratiquant publiquement mon coming out, et si j’ai rencontré Marie-Ange par la même occasion, je ne regrette pas d’y être arrivé par un moyen qui t’aurait déplu de ton vivant, toi qui voyais en l’exhibition la pire calamité de l’époque. J’ai bien mis quelque temps à te l’avouer, mais je ne saurais m’y soustraire. Toi-même me disais que jamais je ne pourrais rien te cacher, même après, et c’est pourquoi je n’ai jamais douté que je finirais par te l’avouer.
C’est pourtant vrai, maman: je me suis exhibé, nous nous sommes exhibés Marie-Ange et moi, nous nous sommes pliés tous deux à la règle du jeu de l’émission télévisée Fantasmes fous, consistant à jouer sur le plateau, en présence de l’animateur et de la psy, la scène de son goût assumé, et probablement cela t’aurait-il contrariée de me voir ainsi langé par Marie-Ange devant des millions de téléspectateurs, comme de me voir ensuite téter Marie-Ange pour accomplir sa propre fantaisie.
Souvent je me suis pris à t’imaginer au milieu du public de ce soir-là. Or, qu’aurais-tu vraiment pensé de tout ça ? Je ne sais pas: je n’en suis pas sûr mais je te demande de le comprendre où tu es à présent.
Ce qu’il y a de sûr, c’est que c’est bel et bien pour m’être assumé que j’ai rencontré Marie-Ange et que c’est notre différence revendiquée qui nous a permis de participer, ensemble, à la finale de Fantasmes fous, au Lavandou, où nous avons gagné Les Mésanges.
Nous avons choisi le nom de notre pavillon avec vue sur la mer en mémoire du quartier des Oiseaux où nous avons passé tant d’années, ce qui nous fait, toi et moi, nous retrouver d’une autre façon encore.
Te souviens-tu, à ce propos, de ce que tu m’avais raconté du premier poste de télévision du quartier ? Les enfants, vous aviez été invités chez des voisins qui avaient les moyens afin d’y voir un épisode de Lassie chien fidèle que tu m’as raconté vingt ans après.
Or, il y a déjà sept ans que nous nous sommes rencontrés, moi et Marie-Ange. Si questions rapports nous en sommes encore au top, nos fameux fantasmes fous nous ont bientôt lassés, et nous savons à présent que nous ne pourrons avoir d’enfant. Un temps, j’ai pensé que nous pourrions prendre un Lassie en mémoire de toi, mais Marie-Ange m’a fait remarquer que le collie laissait trop de poils dans la maison, et tu sais que ce que femme veut...
Ce que je regrette un peu aujourd’hui, c’est que l’extension du lotissement fait que nous ne voyons plus la mer depuis le printemps dernier. Mais rassure-toi: nous sommes très occupés tous les deux par la petite boutique de produits bios que le père de Marie-Ange nous a permis d’ouvrir au Lavandou, et nous avons choisi de renoncer à la télévision pour être encore plus près de la nature, ce qui doit te faire plaisir. Enfin, la maxinouvelle que tu attends sûrement, c’est que je me suis remis au pianola. Où tu es, d’ailleurs, tu dois te réjouir de mes progrès...
Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le maître des couleurs, paru en 2001 aux éditions Bernard Campiche.
-
Ramuz côté court
ŒUVRES COMPLETES Deux nouveaux volumes de Nouvelles et morceaux (plus de 1000 pages) enrichissent l’édition universitaire du grand écrivain
C.F. Ramuz, qui publia quelque 170 nouvelles et autre « morceaux » de son vivant, fut-il pour autant un maître du genre au même titre que Tchekhov ou Maupassant, Pirandello ou Hemingway ? Les lecteurs familiers de son œuvre se rappellent, assurément, l’histoire bouleversante du Cheval du sceautier, relatant l’agonie d’un animal-esclave avec la même émotion et la même puissance allégorique qu’on trouve chez Tolstoï sur le même thème, ou la fascinante errance de L’homme perdu dans le brouillard, sur les hauts du col de Jaman, qui devient l’image même de l’égarement de l’homme dans le cosmos.
Ramuz, pourtant, se disait lui-même mal à l’aise dans le genre strict de la nouvelle, dont le rebutaient les « difficultés de composition » et ne correspondant guère à sa nature « contraire à la pure narration ». Plus que d’« histoires » développant un motif au fil d’une rigoureuse intrigue, ses « nouvelles et morceaux » relèvent souvent, ainsi, du portrait, du tableau « d’après nature », de l’évocation ou de la prose poétique. La production de ces textes plus ou moins courts (on verra que les éditeurs y incorporent Le village dans la montagne, comptant plus de cent pages et relevant du « reportage » ethno-littéraire, à la manière de La steppe de Tchekhov) ne l’occupa pas moins tout au long de sa vie et représentent aujourd’hui, dans l’édition critique de Slatkine (La Pléiade s’en tenant à une édition semi-critique), cinq tomes dodus incorporant cinquante inédits jugés significatifs et un appareil de notes pléthorique.
10 centimes la ligne…
Dans la longue et (parfois trop) savante introduction du premier tome de ces Nouvelles et morceaux (1904-1908), Céline Cerny et Rudolf Mahrer expliquent le triple intérêt de ces compositions pour le jeune écrivain révélé en 1905 par Aline : financier, « publicitaire » et expérimental. Tôt résolu à faire carrière d’écrivain de sa seule plume, Ramuz composera, en marge de la composition de ses romans, des nouvelles ou morceaux destinés à une publication rétribuée dans les quotidiens et revues de l’époque, essentiellement en Suisse romande. «Si tu peux avoir le Journal de Genève c’est très bien, on dit que ça paie » lui souffle un ami après ses débuts à La Semaine littéraire, où sa première nouvelle publiée, inspirée par une légende, paraît en 1904 sous le titre de La langue de l’abbesse. L’hebdomadaire est alors un pilier de la vie littéraire romande, campé sur de solides principes moraux et patriotiques et dirigé par Louis Debarge, une des « vieilles lunes » régnantes (c’est ainsi que Ramuz appelle ses premiers commanditaires). N’empêche : le jeune prodige sera vite reconnu et n’aura pas à faire trop de concessions, mais la revue genevoise paie moyennement : 10 centimes la ligne. Le Journal de Genève, dont le directeur cherche à damer le pion à la Gazette de Lausanne en s’alliant les meilleures plumes romandes, lui proposera de meilleures conditions : 30 francs par texte, si possible court. A Neuchâtel, Philipe Godet, autre « vieille lune » qui fera le meilleur accueil à ses romans, lui commande également des textes pour Au foyer romand , mais c’est dans la très littéraire Voile latine que l’écrivain donnera ce qu’il estime (à juste titre) la meilleure nouvelle de ses débuts, Le Tout-vieux, autre bel exemple de l’art bref du romancier-poète.
Excès de jargon
A qui s’adressent les Oeuvres complètes de la présente édition ? Aux seuls spécialistes, ou à l’ensemble du public ? La question se pose surtout à la lecture des Introductions de ces deux nouveaux tomes.
Si la « stratégie » de Ramuz pour survivre et se faire reconnaître est expliquée de manière claire et vivante, et si les grandes lignes de son « programme » poétique, visant à se dégager du régionalisme pour aller « du particulier à l’essentiel » tout en fondant une nouvelle langue sont nettement tracées, les préfaciers du premier tome (et plus encore Vincent Verselle, dans le second) n’échappent pas, hélas, à l’usage d’un jargon technique relevant du charabia pour un lecteur moyen. Ramuz lui-même eût-il été ravi d’apprendre, à propos de la multiplication des « et » au début des paragraphes du Village dans le montagne, que « la récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité » ? N’y a-t-il pas là un signe d’impolitesse et de cuistrerie à l’égard du public non initié ?
Au moins, ne pouvait-on y échapper dans ces introductions supposées donner envie de lire ? Assurément intéressante, même indispensable, pour l’étudiant, le prof de lettres, le critique littéraire ou le lecteur lettré, cette édition critique pèche cependant, ici, par élitisme. Le tir pourra-t-il être rectifié ?
C.F. Ramuz. Œuvres complètes, volumes V et VI. Nouvelles et morceaux, tome 1 (1904-1908) et tome 2 (1908-1911). Editions Slatkine. 525 et 515pp.Portrait de Ramuz,en 1936: photographie de Gustave Roud.
-
Littérature
Où il est question des péripéties finales inattendues d’un congrès de gens de lettres. Que la poésie n’exclut pas le kitsch, et que le whisky peut y ajouter certain frémissement de bon aloi.
J’imagine une espèce de fable qui leur flanquerait un vertige subit et salutaire à la fois, du genre de celui qu’éprouve le plus imbu d’entre eux (vous le reconnaissez à la peau de chamois qui dépasse de sa vareuse, avec laquelle il fourbit chaque matin son petit monument) quand il découvre que son nom ne figure pas dans tel ou tel nouveau dictionnaire des lettres contemporaines, ce même vertige qu’on peut éprouver dans l’une des cinq cents librairies japonaises du quartier de Kanda, au beau milieu de la nébuleuse de Tôkyo, ou en évaluant le nombre de gens vivant à l’instant à la surface de la planète dans l’ignorance complète des noms et des oeuvres de Carlo Emilio Gadda, Juan Carlos Onetti ou Ramon Gomez de La Serna.
Je vois un clair de lune à la Musset sur le Haut Lac. A précédé ce qu’on peut dire un crépuscule divin d’arrière-été. L’eau de satin, le ciel de soie rose mauve, tout le bazar propice au jaillissement des citations à la Byron, mais voici que se disloque la compagnie des congressistes du P.E.N. rassemblés sur le pont arrière du bateau à aubes où s’est tenue la conférence de clôture de la nobélisable albanaise Bessa Djirka dont les mots incandescents se détachent encore sur le fond cendreux de tous les autres discours.
Je note sur un bout de facture: faire sentir que Bessa, à la dégaine de vieille fille salutiste, est physiquement (et donc métaphysiquement) mille fois plus présente que quiconque en ces lieux et que chacun de ses mots participe de cette extraordinaire acuité, à vrai dire insupportable à la plupart.
Il y a donc du scandale dans l’air, et je vais le ressentir avec une violence particulière lorsque je serai littéralement pris à partie, à la proue où je me suis isolé pour en fumer une, par notre diaphane poétesse Aube du Perroy flanquée de son inévitable époux légitime à fonction de factotum.
Je ne les ai pas entendus venir mais soudain ils sont là, elle dans sa tunique de vestale du Temple et lui tout empressé petit groom lunetteux; et c’est alors que je suis censé graver dans le marbre la sentence fameuse, lâchée d’une voix blanche:
- Malgré tout la Poësie restera...
C’est adressé à l’Univers dont je ne suis qu’un infime brimborion, mais ça vise aussi le «frère en littérature» (sa dernière dédicace) dont Aube attend qu’il partage le courroux qu’a visiblement suscité chez elle la conférence de la Balkanique.
Je comprends à vrai dire le désarroi de celle que la dame patronnesse de la critique académique locale appelle «notre Emily Dickinson», à qui les propos de la conférencière ont dû paraître iconoclastes au possible. La façon de Bessa de fustiger tout idéalisme lyrique, la violence avec laquelle elle s’en est prise aux idolâtres valéryens de la Forme et autres versificateurs en chambre, enfin sa longue médiation finale sur les illusions de la littérature: tout cela ne pouvait manquer de déranger l’élégant parterre de nos gens de lettres.
Comme je reste impassible, Aube se figure peut-être que je n’ai pas bien reçu son S.O.S. alors que mes radars sont braqués sur elle et que je reçois 5 sur 5 les ondes qui signifient sa blessure d’amour-propre, sa détresse de vieille petite fille dont on a ébréché la poupée de porcelaine, et son juste courroux de croisée d’une cause qui voit son étendard souillé par une infidèle.
Je me suis moqué plus souvent qu’à mon tour des poses d’Aube du Perroy, mais à présent je la vois comme à nu, comme à la douche d’un asile, toute menue fretin livrée aux pluies acides. Je la vois comme je nous vois à l’instant, et c’est encore l’effet des paroles de Bessa: l’Helvétie est un autre radeau de la Méduse et nous dérivons, enfin dépouillés de nos vanités, sous la conflagration silencieuse des astres.
Mais tout cela relève de la fiction, car Aube reste bel et bien, en ce moment, toute figée dans sa réprobation vertueuse, n’attendant que mon assentiment. Quoi que je lui dise, aussi bien, qui ne viendrait la conforter, serait taxé de malséance; et de même en va-t-il des autres mandarins chuchotant ici et là dans la nuit d’été. Non mais vous l’avez entendue ? Mais cette mal élevée que nous recevons avec les pompes! Mais cette espèce de nihiliste!
Je laisse cependant Aube à sa fureur et je pars à la recherche de Bessa que je trouve bientôt seule au bar de seconde classe, devant une bouteille de Chivas déjà plus qu’à moitié vide, et j’en recommande une autre en me présentant comme le nouvel Homère encore inconnu, le Dante lacustre et le Shakespeare potentiel du canton, ce qui la fait sourire et m’accorder une petite place à côté de ses vieilles osses.
Là je me donne le beau rôle, c’est entendu: je fais celui qui serait l’unique à avoir déchiffré la juste parole de la conférencière, quand tous les autres n’y auraient compris que pouic. Mais c’est pour la fable: pour simplifier, juste pour ce qui suit, parce que c’est surtout ce qui suit qui compte - j’imagine en effet une sorte de féerie enfantine à laquelle le scotch va donner sa crâne tournure.
Cela commence au dernier coup de minuit, lorsque la pucendron de Gyrokäster se transforme soudain en belle de nuit. Je lui propose d’abord le tour des chapelles, et Djirka me répond: va pour l’inspection. Donc nous nous mettons en route, je fais le Virgile et nous tanguons de cercle en cercle, de la table des romancières intimistes à celle des prosateurs postmodernes, avec des salamalecs à tous les chefs et cheffes de file, le dramaturge qui monte et l’ enfant terrible qui stagne, les ambitieux et les désabusés, les joyciens et les célinomanes, les vieilles haridelles et les jeunes paons.
Puis nous avisons le chemin de lune, et là-dessus nous allons bras deci bras deça, faisant soudain pencher bas l’Helvétie sous le poids des plumassiers tous accourus à tribord et sidérés à la vision de ces deux-là marchant sur les flots.
Je sais bien que l’image a du plomb dans l’aile, surtout que ça murmure de moins en moins discrètement à l’entour du bar où dame Djirka qui-nous-a-bien-déçus-ce-soir, et ce pauvre K., sont en train d’entacher gravement la dignité du P.E.N.- Club.
Mais c’est alors que l’autre miracle advient, quand Bessa commence de vaticiner à voix haute. Alors là ça change carrément de registre. Là ça devient Bouche d’Or et les enfants sages. Là resurgit tout à coup la poésie vieille comme le monde et toutes et tous vont se rapprocher bientôt mine de rien pour écouter The Voice.
On se fichait pas mal, n’est-ce pas, de ce que Bessa pouvait avoir vécu ou pas jusque-là, n’était la décorative mention de sa dissidence. De ce qu’elle avait réellement enduré, de ses années de proscription ou de cachot, des humiliations publiques, des trahisons de supposés amis, de tout ce qui avait été son lot ordinaire durant toute sa vie jamais alignée: on n’avait à peu près rien à cirer. Et qui connaissait le moindre de ses poèmes ? Qui savait, sur l’Helvétie, plus que quelques formules publicitaires à propos de la fameuse invitée ?
Mais à présent tout prenait chair, tout prenait verbe et chair. Toute menue fretin dans la sorte de sac que figurait sa robe, Bessa s’était mise à psalmodier dans notre langue et tout à coup le temps s’ouvrait comme une conque vaste aux échos de toutes les voix de tous les âges et de partout. Et la pauvre Aube du Perroy, bien soupçonneuse encore, s’était approchée à son tour en se demandant ce que chantait cette sauvage enivrée, puis elle avait demandé de qui étaient ces vers, puis elle avait eu un frisson en reconnaissant quelque chose qu’elle-même aurait peut-être pu chanter, et voici qu’Aube fermait les yeux et qu’une mer de visages aux yeux clos ondulait sous la brise des mots.
La fable serait incomplète si je ne précisais qu’elle m’est venue le matin même où j’ai reçu l’invitation à participer au congrès du P.E.N.- Club qui devait se tenir au Plaza de Montreux et dont le thème serait L’Avenir de la Littérature. De sa plus belle écriture, la secrétaire du comité suisse, Aube Du Perroy, notait qu’elle comptait beaucoup sur ma présence, ayant fort apprécié ma dernière chronique sur la réédition de ses Poésies 1952-1994. Or à l’instant même, l’arrivée de Bessa Djirka, la jeune requérante d’asile de Gyrokastër à qui ma compagne enseigne le français depuis quelques temps, fut le déclencheur qui me fit jeter l’invitation au panier en envoyant au diable tout ce qui ressemble de près ou de loin aux gens de lettres.
-
La grâce d’une écriture
Connaissez-vous Hervé Chesnais ? Moi non plus, jusque tout à l’heure, quand je suis tombé, dans le labyrinthe de desordre.net, sur une sorte de petit roman d’amour-catastrophe à fines touches me rappelant Fou de Vincent d’Hervé Guibert, tant par la grâce de son écriture que par la force des images et des objets narratifs de celle-ci, d’une fine et belle concentration.
Cela commence comme ça :
1/
Parce que l’absence n’admet pas de demi-mesure, que le souvenir ne pèse pas le poids : la grâce du col de ta chemise jamais plié net, le jean toujours en train de tomber plus bas, la perspective émouvante de ton passage, tout ça ne vaut qu’au présent.
2/
Parce que tu avais toujours faim.
3/
Parce que le manque n’est pas blessure, qu’il n’est pas de frontière au manque, on n’en pourrait pas dessiner les contours, parce que le manque n’est jamais fini, le manque est invisible, sans cicatrice à la surface, sans lèvres de chair jointoyées, sans suture sur le lisse des peaux.
4/
Parce que tu t’es brossé les dents avant de m’embrasser.
5/
Parce que les machines qui nous meuvent nous interdisent la stupeur mélancolique, nous garantissent notre lot quotidien de stimuli, d’anecdotes.
6/
Parce qu’à ton passage, quelque chose est advenu, que nous avons connu ensemble des illusions d’épiphanies.
7/
Parce que ton départ m’a laissé interdit, altéré, parce que j’ai cru mourir de ta mort, que je n’en suis pas mort, ta mort m’a traversé comme le caillou l’eau, et comme l’eau je me suis refermé, et comme l’eau nulle trace de ton passage, nul indice que je me sois refermé sur toi, que je t’aie gardé dans le secret de mon ventre. Ensuite il y a 93 autres fragments de cette eau, puisque l’ensemble s’intitule 100 Raisons.
Ensuite il y a 93 autres fragments de cette eau, puisque l’ensemble s’intitule 100 Raisons.
De fil en aiguille, curieux d’en savoir plus sur ce Chesnais Hervé, j’ai appris qu’il était d'origine bretonne et normande, né en 1963, et découvert, sur le site remue.net, une autre série de petites proses intitulées Tentative d’équilibre dont je capture illico celle-ci :
La gloire de mon père
Dans l’armoire de mon enfance – marqueterie rustique- un fusil mitrailleur dont je trouvais les balles en volant des bonbons ; c’était le temps de mes dents saines et de mon père aux cheveux roux.
Il aimait parler en arabe aux colporteurs de ces pays ; que disait-il ? – Les mots que je sais aujourd’hui, qui enchantaient les exilés. Ils repartaient pauvres, ravis, mais moi j’avais tremblé pour eux qu’il ne ressorte son fusil, pas les mots d’adieux ni d’usage, le fusil. Les balles ailées; les balles.
Les photos je les avais vues. Cadavres de bergers exécutés ; mon père assassin qui se targuait de preuves. Avant après, vivants puis morts, abattus là les mains liées dans la montagne qui était leur. Et je trouvais des balles en cherchant des bonbons. Et j’avais peur pour les vendeurs berbères, tant ils ressemblaient aux cadavres, aux trophées de mon père. Ah mais ceci encore : que, dans un contrepoint heureux, les textes de 100 Raisons sont accompagnés de vignettes d’artiste signées Emmanuelle Anquetil, d’une poésie elliptique qui s’apparie parfaitement à celle d’Hervé Chesnais. Dernière piste enfin: le site d'Hervé Chesnais himself, à l'enseigne de La position du scribe.
Ah mais ceci encore : que, dans un contrepoint heureux, les textes de 100 Raisons sont accompagnés de vignettes d’artiste signées Emmanuelle Anquetil, d’une poésie elliptique qui s’apparie parfaitement à celle d’Hervé Chesnais. Dernière piste enfin: le site d'Hervé Chesnais himself, à l'enseigne de La position du scribe.



















