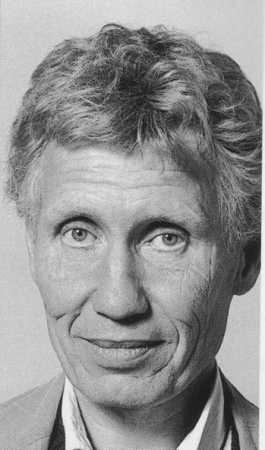
EMMANUEL François. Regarde la vague. Seuil 2007.
- Exergue d’Henry Bauchau : « Je sais que je ne suis qu’un lierre, je sais que je ne suis qu’un lien, j’étreins mon arbre et je ne le connais pas ».
- Généalogie des Fougeray : Père et mère décédés.(Georges et gabriela) Six enfants (Marina, Olivier, Pierrot )décédé), Grâce , Alexia et Jivan (adopté)
- LA VEILLE
- Jivan. Arrive à Chavy en voiture.
- Avec la sensation retrouvée de communier avec la beauté.
- Ressent encore la « main noire » de Noah sur son cœur. Noah qu’il vient de quitter. Se rappelle le père. Sa mère silencieuse.
- Pense qu’ils seront tous là. Y compris Alexia toujours en mission.
- Olivier a investi la grange pour son mariage.
- Les chevaux d’Olivier apparaissent.
- Tout de suite un flux mental impérieux. Musique intime.
- Il est question d’un tableau, signé Micha. Crépuscule sur la mer. Emporté par Grâce.
- Va déposer son bagage avant de chercher Alexia à l’aéroport de Cherbourg.
- Aperçoit ses neveux. Hyacinthe la farouche. Qui lit Moi qui n’ai pas connu les hommes.
- Elle a un « sourire perdu ».
- Alexia. Rêve qu’Olivier brusque leur père.
- Elle a été mariée à Nathan
- Consigne ses rêves dans un cahier de moleskine pour son psy. Lequel est « obnubilé par le sexe ».
- Rien de cela dans ses souvenirs du père.
- Elle travaille dans l’humanitaire.
- Se rappelle l’Afrique.
- Elle a un petit garçon prénommé Ulysse.
- Grâce. Genre bourgeoise d’intérieur.
- Elle a été opérée d’un cancer du sein.
- En pince pour son chirurgien russe.
- Toute délicatesse et fragilité forte.
- Jivan. Raconte l’arrivée d’Alexia. Une ombre dans son regard.
- Le questionne sur Noah.
- Lui dit seulement de la tête : non, non, non.
- Elle lui dit que Noah lui aurait plombé la vie. Evoque le « mal noir des femmes ».
- Il cherche les « écorchées de la vie2.
- Marina. Note un geste affectueux de son prof de piano aveugle.
- Qui l’a beaucoup aimée. Et lui sourit "A quoi sourient les aveugles ? »
- Elle l’interroge sur Hyacinthe, sa fille taiseuse.
- Il la dit « un être tendu, magnifique, mais qu’il ne faut pas perdre ».
- Non pas feu dormant mais comme elle « feu noir ». Et lente à céder…
- Alexia . - Retrouve la famille réunie dans la cuisine de la ferme.
- Avec la vieille Lili.
- Olivier est absent. Il a voulu que les femmes s’habillent en bleu, la mariée (enceinte) en blanc.
- Elle dérogera.
- Jivan parle avec Marina de l’enquête sur la disparition du père en mer.
- Son corps introuvable après le retour du bateau.
- Le sourire de Marina dénote « la force souveraine, la puissante impassibilité des Fougeray ».
- Le fils d’Olivier, Gil, ne sera pas là. Zone à Paris.
- Le petit Ulysse parle anglais.
- La TV déverse ses images tragiques qui lui rappellent « la geste sanglante » du monde.
- Grâce l’interroge sur Nathan.
- Grâce qui ne peut se lâcher. Coincée.
- Marie-Doune, fille aînée de Marina, la cuisine sur son job.
- Jivan. Il entre dans le bureau du père. Dont il se dit qu’il n’a jamais été pour lui que l’enfant indien de la mère, adopté après la perte de Pierrot.
- Olivier. Pense à ses attelages. Cinq pour le mariage. Qui feront l’image « dream ».
- Un fou de chevaux. Homme à femmes aussi.
- Lynn est angoissée, mais c’est elle qui le soutient.
- Désire que l’action soit « ronde ».
- Le mec qui assure en apparence. Mais qu’on sent fêlé.
- Marina. A son tour dans le bureau du père. A la recherche d’une photo de jeune fille. Mihaela, liaison secrète du père.
- Elle a contacté la jeune femme. Pour l’inviter.
- Conversation touchante entre les deux femmes.
- Se rappelle les derniers mots de son père sur le tarmac de Caen.
- Lui a dit rêver d’une « fin légère ». Elle a 46 ans.
- Jivan. Assiste à la colère d’Olivier contre le fils du traiteur.
- Observe ses trois sœurs de loin.
- Constate que ce qui les unit est plus fort que ce qui les distingue.
- Lui n’est pas de leur sang.
- Le rire à distance d’Alexia le glace.
- Scène à forte valeur visuelle, proprement cinématographique.
- Tout se déroulant comme un film intérieur à multiples points de vue alternés.
- Grâce. Se rappelle le prénom de son docteur. Sergueï.
- Y pense avec bonheur et gêne à la fois.
- Alexia. Lit Ulysse avec Ulysse.
- Il exige ce livre pour s’endormir.
- Hyacinthe entre pendant la lecture.
- Lui adresse un sourire doux.
- Le mutisme d’Hyacinthe engage Alexia à lui dire qu’elle la comprend, mais la jeune fille s’esquive.
- Olivier. Il lui faut appeler Lynn. Qui est encore à l’hôtel.
- Dans sa chambre, avise un trou noir dans le miroir.
- Lui rappelle ses « crises ».
- Suit un traitement médical. Violence latente en lui.
- Lili lui reproche d’en vouloir trop.
- Jivan. Alexia lui a parlé de la dernière lettre, « magnifique », du père.
- Alexia voudrait lui dire ce que le père désirait transmette, mais Jivan n’écoute pas.
- Il aimerait lui parler d’autre chose.
- Elle subodore que c’est de Noah. Parle de « saleté d’amour ».
- Alors lui se braque.
- Grâce. Se rappelle la pesante présence sexuelle de Franz.
- La seule fois qu’elle pousse un cri, c’est en pensant à Sergueï.
- Franz le prend pour lui…
- Marina. Rejoint Hyacinthe. Se rappelle comme l’enfant a été laissée à Chavy.
- Une fille hors du commun. Sauvage.
- Songe au « petit corps d’avant l’autre corps »…
- Alexia. Jivan lui a demandé si elle-même a jamais connu l’amour.
- Jivan. Se retrouve seul dans son ancienne chambre. Repense au temps où Alexia l’appelait dans la sienne.
- Olivier. Tout à ses pensées terre à terre d’homme pratique.
- S’est disputé violemment. S’est déstressé en picolant trop.
- Ulysse. - Dernière image de cette première partie, du petit garçon courant en rêve et murmurant « catch him, catch him ».
- Tout cela très beau, très doux, très musical et pictural en même temps. L’espace admirablement « construit » par les voix.
- 2. LE JOUR
- Olivier. Auprès de la splendide Lynn, Olivier Fougeray sera « le grand maître du dream », yes sir.
- Marina. Voit son tour cette image de la famille aux cinq tilburys.
- Grâce. Pense aux absents et aux morts. Toute fière que son couple ait tenu, avec Franz et les jumelles.
- Alexia. Son point de vue est plus narquois sur le « grand film » d’Olivier.
- JIVAN. Se rappelle, sur son tilbury, l’enterrement de sa mère, et le père alors « seul au monde ».
- ALEXIA. Réagit aux formules du sacrement religieux. Pensées grinçantes dans la chapelle.
- JIVAN. Son regard est plus serein. Sent une joie en lui.
- Se rappelle que cette famille blanche l’a adopté à l’autre bout du monde, à l’orphelinat de Cochin.
- MARINA. Lutte contre l’ennui de la messe. Se rappelle un voyage en Suisse avec le père. Qui lui a transis divers objets préhistoriques. Comme un legs personnel. Leur secret.
- GRÂCE. Au moment de l’échange des anneaux, reprend le fil du récit, qui glisse d’un personnage à l’autre, sans aucun accroc.
- ALEXIA. A présent Jivan rit. On s’est retrouvé sur la route. On prendrait bien la tangente au lieu de rejoindre le vin d’honneur…
- GRÂCE. Joue son rôle de femme organisée au vin d’honneur.
- OLIVIER. Ne pense qu’aux images objectivées de la fête. Pensées érotiques au passage, quand le frôle Dolly avec laquelle il a souvent fait Oli-Dolly.
- L’auteur rend parfaitement tout ce qui se passe en deça des mots, dans le for de chacun. Toutes les sensations, observations, impressions, gestes, échanges de regards, tout enrichit le récit.
- ALEXIA. Glisse d’un groupe à l’autre. Tout ça rappelle un peu Dolce Agonia de Nancy Huston, en moins chargé existentiellement mais en plus musical.
- Une voix chaude s’adresse à elle. Un homme en noir en lequel elle reconnaît un beau jeune homme de jadis.
- MARINA. Un homme lui parle pendant qu’elle observe sa Hyacinthe à une fenêtre.
- Se dit que sa fille lui a échappé comme son mari, parti pour une plus jeune.
- JIVAN. Se revoit enfant dans une fête pleine de monde. Comment on l’a arraché à sa honte dans les rires partagés. Comment il « faisait bébé » avec Alexia.
- ALEXIA. Reconnaît le bel homme à la voix grave. Le fils d’un ouvrier polonais qui venait à la maison.
- Il se passe quelque chose entre leurs regards.
- GRÂCE. « Grâce avait l’impression que chacun était à sa place dans la polyphonie du monde ».
- Tout à fait le sentiment qui se dégage du livre aussi.
- Elle sent que quelque chose s’est passé en elle.
- Comme si elle était prête pour l’amour. Elle pense à ses morts et se dit qu’elle ne pourra plus parler qu’é Sergueï.
- MARINA. Surprend, avec stupéfaction, une conversation entre Jivan et Hyacinthe la muette.
- Mais sa fille se tait dès que cette intimité est troublée.
- Elle s’effondre dans un divan.
- JIVAN. Constate l’effondrement de sa sœur aînée. A qui il confie qu’Hyacinthe perçoit la vente envisagée de la maison comme une sorte de fin du monde. Lui aussi en est très affecté.
- Jivan est impressionné par Marina qui incarne la « tranquillité souveraine » des Fougeray.
- MARINA. Dit à Jivan qu’elle a laissé Hyacinthe à Chavy pour la commune sauvagerie de l’enfant et de son grand-père.
- OLIVIER. Lynn le panse comme un cheval fou.
- La remarque d’une invité, à propos de l’absence de son fils Gil, l’a piqué au vif.
- ALEXIA. Observe les convives avec ironie. Des conversations nourries par le « consumérisme ambiant » qui « finiraient par communier au dernier tohu-bohu médiatique, l’époque était d’un conformisme affligeant ».
- JIVAN. Fait parer sa vieille tante Lucia pour qu’elle lui raconte un peu plus de détails de son adoption.
- Se demande pourquoi on l’a choisi lui.
- Aimerait élucider le mystère d’une petite cicatrice en croix à son bas-ventre.
- Se rappelle son retour adulte à Cochin.
- La vieille femme qu’il a baisée une nuit et un jour durant.
- MARINA. Eprouve le besoin de quitter les convives et de se retrouver seule.
- Se rappelle le tableau de Micha.
- Se rappelle les jeux de lumière du tableau auxquels son père l’a rendue attentive.
- Son père qui aimait dire « regarde la vague »…
- ALEXIA. Regarde l’homme noir la regarder. Loin l’un de l’autre, « chacun comme une image pour l’autre, un rêve ou un rêve de rêve ».
- MARINA. Retrouve Hyacinthe en rêve.
- Puis se rend dans sa chambre où elle tombe sur un cahier noir, écrit par son père.
- Qu’elle commence à lire.
- Et tout aussitôt le récit se charge d’une nouvelle gravité.
- Le père évoque son besoin d’écrire (p.94)
- « Ici, j’écris comme on parle seul, à Dieu peut-être, si ce mot a un sens, et non pas ce Dieu de Gabriela que je n’ai jamais vraiment compris, mais plutôt à cet inconnu de moi, qui demeure sans image, effacement même de l’image, et prend ma main quand je la tends vers l’ombre ».
- Evoque son père et sa génération de héros.
- Note que « plus rien ne nous unit que le sentiment de la foule »
- ALEXIA. Ecoute l’éloge débile d’Olivier par un sien ami.
- Olivier est quasiment un étranger pour elle.
- Se dit qu’il doit la trouver « bien roulée » et par trop idéaliste.
- Remarque que le discours de l’ami a fait l’impasse sur l’existence de Gil.
- Gil qui erre à Paris entre squats et asiles de nuit.
- Le Père. - Devient un élément constitutif du récit.
- Evoque ses relations avec la fidèle Lili. « Lili est la charge infatigable du temps.
- Evoque ses souvenirs de bonheur « dans le temps ».
- Très belles séquences.
- Se rappelle son enfance, Gabriela, ses enfants à travers les années.
- « Ce sont les fragments de mon archéologie ».
- Très belle mise en abyme du roman, avec la voix si proche de l’absent.
- OLIVIER. – Son complexe quand on lui demande un discours. « Rien à voir avec le père ».
- Se sent « grand piteux misérable.
- Voudrait se reposer sur Lynn.
- Raconte le dressage de Takia par Lynn.
- Lui aussi « grand cheval indomptable ».
- En parlant il avise une silhouette noire à la porte.
- Redoute que ce soit on fils Gil.
- Journal du père. – Evoque son âge. 75 ans. Qu’il ne sent guère.
- Evoque les petits vieux de son âge. « Ils ssont devenus des vieux enfants qui jouent à des jeux et dansent autour des tables au moindre mirage de la lucarne d’abondance ».
- « Je crois que c’est l’inaccompli de nos vies qui nous rend si oeu aptes à partir ».
- Se reproche de n’avoir jamais su parler à Olivier.
- Evoque le Dieu de Gabriela, sa femme, qu’il n’a jamais compris.
- « Mais l’Ange a toujours eu pour moi un autre visage, j’aurais dû grandir dans un monde où le vent, le fleuve, le feu portent la parole sacrée, où le ciel nous recouvre, où le terrible et le doux se confondent ».
- JIVAN. – Pense à Noah, qui lui dit ne pas le mériter. Se sent à la fois elle et lui quand ils font l’amour.
- Journal du Père. – Evoque ses enfants petits. Revoit Pierrot, son fils disparu dont la mort l’a terrassé.
- « C’est l’encombrant privilège de la vieillesse que de mélanger les générations, comme le rêve qui ne s’embarrasse pas du temps » (p. 105)
- ALEXIA. – Remâche son agacement envers Hubert, qui la cherche sur le thème de la psychanalyse.
- Rend magnifiquement ce passage dansé et dansant de l’un à l’autre des personnages, dans le vacillement de la danse.
- Journal du père. – Evoque les « chambres du temps » qu’il a parcourues en étudiant les grottes du magdalénien.
- « Rien ne m’a plus appris ou désappris que ces chambres du temps. Tout y était sacré, même et surtout l’animal mis à mort, sa mort exigeant de rendre par les rites ce qui lui était ôté. »
- Suit une méditation amère sur notre perte du sacré.
- « Nous qui avons accumulé un savoir immense sur le monde, nous ne savons plus être dans le monde »
- Il a mesuré « l’étendue du désastre auquel la modernité nous expose ».
- Les filles le trouvent un très, très vieil homme ».
- ALEXIA. – Remarque à son tour cette femme, une étrangère vêtue de noir qui lui rappelle quelque chose.
- Cette présence annonce une bascule de la fête.
- Journal du père. – Il aimerait rappeler ses enfants et leur dire ce qu’i n’a jamais su leur dire.
- Se rappelle à la fois la pudeur des Fougeray à l’égard des choses graves.
- Pense à Hyacinthe, la jeune indomptable.
- MARINA. – Se trouve soudain surprise par sa fille, en train de lire le journal du père.
- L’apostrophe sur un ton inquisiteur : « Comment tu l’as eu, ce cahier ».
- Ce qui provoque la fureur muette de sa fille.
- Elle s’enfuit à la fois honteuse et mécontente d’elle.
- ALEXIA- S’étonne de voir Marina « comme elle ne l’avait jamais vue ».
- Mais sa sœur se dérobe, prétendant qu’il ne s’est rien passé.
- JIVAN. – Noah l’appelle de nouveau sans qu’il sache d’où. Elle le supplie de ne pas la rejeter.
- Trois mots sur son portable : Miyako est morte.
- Lui rappelant leur rencontre, dont la vieille Japonaise fut témoin.
- Jivan lui lisant des auteurs japonais, et Noah, servante de Miyako, y assistant un jour.
- Se rappelle la beauté de Noah quand il lisait Pluie d’orage d’Inoué.
- Avec la mort de Miyako ils redeviennent « orphelins du monde »
- Il hésite avant de lui répondre.
- OLIVIER. – Songe à la beauté lisse, de magazine, de Lynn – une beauté pour tous qu’il aimerait pour lui seul.
- Se sent jaloux et inquiet.
- Voudrait la tenir et la posséder rien que pour lui.
- Comme quand il la possédait au fond du box de son cheval.
- MARINA. – Voit en cette femme vêtue de noir un « oiseau de malheur ».
- Se rappelle les mots du journal de son père à son propos.
- Elle l’aborde et lui propose une promenade.
- Se retrouvent sur la plage.
- Mihaela désirait la rencontrer depuis des années.
- La rencontre avec Alexia, ménagée par le père, à Genève, a tourné court.
- Mihaela se sent marquée du sceau de l’étrangère.
- La question lancinante: pourquoi le père s’est-il laissé prendre par la mer.
- GRÂCE. Se rappelle que « tout doit disparaître ». Ce que lui a communiqué le notaire avec sa « sale petite voix »
- Elle attend toujours, fébrilement, le docteur V.
- Son jardin secret.
- Elle a 41 ans. Se donne encore « 15 ans de beauté »
- ALEXIA. Monte au grenier pour lire Ulysse à Ulysse.
- Elle aimerait lui transmettre la magie légendaire de son enfance.
- Il y a là un cerf-volant. Le dragon de Pierrot que son père a violemment arraché des mains de Jivan.
- Toute la tristesse de son père refluée dans ce souvenir
- Ulysse : « Hey look, mum, look, her comes the music ».
LA NUIT
- JIVAN. – Alexia l’a invité à l’inviter à danser.
- Pense à Noah qui revient.
- Va la laisser attendre un peu.
- ALEXIA. – Durant la valse avec Jivan, elle se rappelle leurs rapports d’enfants et d’ados, au bord de l’inceste.
- Ils n’ont jamais vraiment fait l’amour, quoique presque.
- Jivan est resté pour elle une sorte de « garde du corps ».
- OLIVIER. – On glisse ensuite vers Olivier.
- Qui se sent ,dansant avec Lynn, « dans l’œil du cyclone».
- Jivan. Revenu seul dans la cour, il pense à Noah et tremble de la perdre
- MARINA. – Dans la nature endiablée avec Mihaela, mais elle sent que le contact ne se fera pas vraiment, tout occupée qu’elle est mentalement par Hyacinthe et l’épisode du cahier.
- GRÂCE. – Se retrouve en face de Sergueï qui vient de débarquer avec sa femme.
- On sent comme un malaise de jalousie entre les deux femmes.
- Mais l’attention se reporte ailleurs, Olivier venant de provoquer un esclandre. Il vient en effet de brutaliser Hyacinthe.Alexia. – Voit ressurgir la « vieille chose de la famille ». On pense évidemment à l’épilepsie.
- JIVAN. – La violence d’Olivier lui fait revivre une scène de violence opposant le père et Olivier. Il avait alors pensé « c’est la guerre », ou plus précisément « ils sont dans la guerre »
- Il a vu Hyacinthe partir vers la mer.
- OLIVIER. – Ne peut soutenir le regard de Lynn. Pour sa défense, il explique à Alexia qu’Hyacinthe « le cherche », comme son fils Gil.
- ALEXIA. – En espérant que le bal reprenne, elle pense à l’ »ancestrale violence des hommes envers les femmes »
- MARINA. – « Voit » le corps de sa fille, qui a filé vers la mer, au pied de la falaise.
- Se rappelle Hyacinthe à sa naissance, qu’elle a failli perdre.
- ALEXIA. – Sur la piste de danse, retrouve le fils du Polonais Milan, un personnage de son enfance qui lui rappelle qu’elle aimait soigner les oiseaux blessés.
- Elle ressent une attirance, tout en pressentant un probable malentendu : « Un début fulgurant sans doute, puis assez vite une sorte d’embourbement ».
- MARINA.- Descend à la plage à travers les rochers.
- Et là, voit flamber la petite maison sauvage d’Hyacinthe, héritée de son grand-père.
- La voit ensuite là-bas sur la plage et court pour la rejoindre.
- Et retrouve bientôt « sa grande jeune fille toute molle au milieu du combat ».
- Tout cela très fort, avec des éléments quasi faulknériens. Une grande force d’évocation très physique et sensible à la fois.
- GRACE. – Gamberge devant la repro de La lutte avec l’ange, que son père aimait fort.
- Vera lui raconte Louxor. Bavardage mondain.
- Sergueï n’en a plus que pour Frantz.
- Se rend compte qu’elle a fantasmé dans le vide et annonce qu’elle va s’étendre.
- MARINA. – Augustino l’aveugle, et son ami Tam, se pointent en voiture sur la plage.
- ALEXIA. – Se rappelle la première apparition de Milan.
- MARINA. – Voit Augustino s’éloigner avec Hyacinthe. Une complicité particulière les attache. Augustino lui a conseillé de ne pas trop s’inquiéter.
- OLIVIER. – Il aimerait maintenant que Lynn lui accorde la moindre attention, dont on sent que sa crise l’a déstabilisée
- JIVAN. – Son portable grelotte. Tout lui semble avoir retrouvé la douceur de l’espoir.
- Le romancier rend admirablement le décor, l’espace et la « musique » de la soirée, avec son concert de voix distribuées sur divers plans.
- MARINA. – Se retrouve vers le brasier de la cabane. Voit de loin la Mercedes de Tam et Augustino, qui ont pris Hyacinthe en charge.
- JIVAN. – Il a l’impression que Noah l’appelle de tout près. En fait elle est là, qui implore son pardon et dans les bras de laquelle il se jette.
- GRACE. – Finalement n’est pas allée se coucher.
- Décide de ne plus accorder un regard à Sergueï.
- Rejoint Olivier qui a un drôle de sourire.
- Et qui tombe soudain en transe épileptique.
- Grace s’en remet à Frantz, l’homme fort
- MARINA – Est restée près du brasier. Pense qu’elle s’est toujours protégée de la vie.
- Ensuite rejoint Agustino dans sa voiture. Qui lui explique la douleur d’Hyacinthe.
- Qui voudrait savoir absolument ce qu’« ils » ont fait à Pachou.
- Ainsi appelle-t-elle son grand-père chéri.
- Augustino : « On n’enseigne plus le vide dans le monde, ce monde est devenu trop plein ».
- OLIVIER. – Sous sédatif, il voudrait que Lynn comprenne.
- Se rappelle Black Beauty.
- Se demande s’il arrive aux juments de pleurer.
- Se rappelle un traumatisant souvenir d’enfance.
- Enfermé avec « la bête » par son père.
- Alexia. – Passé minuit. Sent que Mihaela voudrait lui parler.
- Elle l’a rencontrée déjà, notamment à Brasov.
- Mihaela - lui montre la photo d’un petit garçon, qui lui rappelle aussitôt Pierrot.
- Un garçon de 12 ans prénommé Martin.
- Fils naturel du père on le comprend.
- Mais déjà le taxi de Mihaela est prêt à l’emmener…
- JIVAN. – Si mon souvenir est bon, Jivane signifie le vivant en serbo-croate.
- Jivan et Noah fond un grand tour autour de Chavy.
- « Qui es-tu pour me tuer d’amour, toi ? »
- Cela finit par une étreinte passionnée, dans le vent et les clameurs de la mer.
- OLIVIER. – Se rappelle la punition paternelle. Sa peur d’enfant. La bête crainte et les bottes de papa au soupirail.
- A toujours été considéré comme la tête brûlée des enfants.
- GRACE – Pallie l’incurie de Lynn, et Lili apporte les noyaux de cerises chauds. « son éternel petit sac guérisseur ».
- Ma mère-grand pratiquait de même : cataplasme dégoûtants à la purée grise et oreillers pleins de noyaux de cerises.
- Elle voit Sergueï partir avec sa tigresse, sans regret.
- Crois ensuite Alexia la « merveilleusement intelligente », avec laquelle elle ne peut plus parler qu’en leurs enfance dans leurs lits jumeaux , tournées « chacune vers leur grand mur noir ».
- ALEXIA. – Fin de bal fellinien en plus sombre, sur du Leonard Cohen.
- Se rappelle que sa mère après la mort de Pierret a proposé de donner les vêtements de celui-ci au fils du Polonais.
- Se rappelle son père pleurant Pierrot.
- Se rappelle l’arbre arraché.
- Danse avec Milan Oposzewski avec un double sentiment d’accord physique et de distance, comme si elle dansait ailleurs dans ces bras protecteurs.
- Pleure en se rappelant l’expression du médecin, « assommé par la barre ».
- MARINA. – A son tour de réagir au « vieux mélancolique ».
- Lynn, à côté d’Olivier, a un visage défait par « cet ahurissement morne de ceux qui n’attendent plus rien ».
- On voit d’avance le joli couple…
- On voit le couple d’Alexia et de Milan danser seul et semblant vivre quelque chose rien qu’à lui.
- Alexia voudrait échapper à Milan, mais les chansons de Cohen ajoutent au sortilège. Pourtant il lui dit lui-même qu’elle est une femme seule et qu’il sera toujours ainsi.
- Elle n’en pleure que plus.
- JIVAN. – Le silence revenu sur les lieux, Noah lui parle d’elle, non sans difficulté. Lui raconte sa « vieille envie de détruire », liée à ce que lui a fait subir son beau-père attoucheur.
- Comment Miyako l’a désenvoûtée.
- Et comment Miyako a choisi Jivane comme lecteur « pour sa seule voix ».
- Comment elle lui a recommandé de ne pas détruire cet homme au « cœur immense ».
- Or Jivane sait maintenant qu’elle va repartir sans approcher sa « famille bourgeoise ». (p.172)
- Tout ça est d’une extrême douceur et d’une grande force en même temps.
- Me rappelle Hugo Claus mais en plus tendre et en plus mélodieux.
- Me font sourire ceux qui prétendent que la littérature est morte.
- C’est qu’ils ne l’aiment pas ou ne savent plus lire.
- ALEXIA. – L’au revoir se fait sans aucune démonstration. Juste.
- « Il s’en va lentement par le Chemin des Bêtes. »
- MARINA. – Cinq heures du mat. Pluie d’été.
- Resonge au « trésor de transmission » du journal de son père.
- Va voir dans la chambre d’Hyacinthe, qui sort, et où elle ne voit trace du cahier toilé. Pense que sa fille l’a brûlé.
- « Paix sur vous ».
- Jivan rentre tout trempé.
- JIVAN – Voit en Marina la réincarnation de leur mère.
- « C’est toi qui veille », pense-t-il.
- Sur son portable s’inscrivent les lettres d’un poème de Lorand Gaspard : « Nous fouillerons les pierres claires jusqu’à l’extrême limite de l’obscur ».
- Puis s’inscrit le mot amour, que Noah n’a jamais prononcé.
- GRÂCE. – Repense à ce que Vera lui a dit en aparté, à la place de Sergueï qui n’a pas osé, dit-elle : qu’il faudra tout enlever, avec un « faux regard de compassion ».
- OLIVIER. – Tout apaisé auprès de Lynn qui, finalement, n’a pas l’air fâché.
- Lili lui a dit que les gens ne s’étaient aperçus de rien.
- ALEXIA. – Réalise que Milan n’est venu que pour elle.
- Revit la mort occultée de Pier rot.
- La conclusion de cette partie apartient à Ulysse : « Day’s coming, mum, day’s coming ».
Le Lendemain
- Jivan. Séance avec le notaire. Qui annonce que le partage ne se fera pas avant des mois.
- Olivier s’impatiente.
- Grâce écoute plus que les autres.
- Le temps est comme suspendu dans la maison.
- Jivan pense que quelque chose va peut-être se dire.
- Marina. – Alexia et elle se forcent à être présentes, tandis qu’Olivier s’impatiente et que Jivan est ailleurs.
- Alexia. – Déclare qu’elle ne s’intéresse qu’à un objet et pas du tout à l’argent: le tableau de Micha, qui n’est plus sur le mu, la Grande marine au couchant. En souvenir de ses rêveries d’enfant et de son père.
- Grâce le prend mal.
- Jivan. Observe la réaction de Grâce, qui accuse Alexia d’avoir toujours fait ce qu’elle voulait et de n’aimer personne.
- Une déchirure se fait alors entre les frères et sœurs. Grâce a dit ce qu’il ne fallait pas selon le code de pudeur du clan.
- Se pose incidemment « la terrible question de ce qui les liait encore ».
- Mais Grâce, Jivan le sait, sera blessante sans aller jusqu’à la querelle.
- L’ombre de la mère veille sur le maintien du lien entre les Fougeray.
- Marina. – Grâce se fait jérémiante pour expliquer qu’elle a fait restaurer à réencadrer le tableau à ses frais.
- Rappelle en outre tout ce qu’elle a fait pour la maison.
- Grâce la prévenante terre à terre.
- Olivier la remercie pour la noce.
- Grâce. – Mais Grâce de récuser ce soutien et de dire un peu plus de ce qu’elle ne voudrait pas dire…
- Jivan. – Alors Alexia de sortir une lettre du père, dont elle lit quelques fragments. Il y est question de son legs, non pas d’objets mais de ce qu’il estime important de transmettre é chacun.
- Et Grâce de balbutier, puis de s’excuser.
- Tout cela très juste et très émouvant.
- Marina.- Sur quoi le notaire range ses affaires.
- Et comme Olivier fait mine lui aussi de s’en aller, lui aussi, Marina et Alexia l’enjoignent de rester.
- Suit « un incroyable silence ».
- Olivier. – Se rappelle que Lynn l’attend pour leur voyage de noces. S’agit de pas manquer l’avion pour les îles.
- Jivan. – Marina évoque ce qui restera, ou pas, après le partage.
- Elle réclame soudain l’attention d’Olivier à propos d’Hyacinthe.
- Elle évoque ce qui manque du père, qu’on oubliera bientôt. Mais qu’Hyacinthe continue à sa façon.
- Alexia. – Guette la réaction d’Olivier, l’étenel « enfant fautif ».
- Jivan. – Sur quoi Marina se lève, annonçant que Lili a préparé un frichti pour ceux qui resteraient encore.
- Sur quoi les uns et les autres se lèvent.
- Alexia. – Se demande pourquoi elle a lu ce bout de lettre.
- Elle voit les mômes heureux, et là-bas Grâce un peu perdue, visiblement touchée, « cruellement accablée ».
- Femme blessée.
- Puis elle surprend un conciliabule entre Marina et Lili. Celle-ci se voyant proposé de l’emploi par celle-là, et le refusant.
- Tout cela noté avec une précision proustienne (les servantes de Proust)
- Jivan. – Alexia l’entraîne vers la mer.
- L’a percé à jour : « Tu l’as revue, n’est-ce pas ? »…
- Ulysse patauge dans la vague.
- Suit l’image du père se prenant les pieds dans les cordages, avec toute la mer autour de lui.
- Olivier. – Se retrouve « dans le bleu ». Bleu de l’espoir que tout s’arrange aux îles.
- « Rien de grave », se dit-il en repensant à la soirée avec le besoin de se rassurer.
- Se dit qu’en vacances Lynn se laisse « ouvrir » facilement.
- Ce genre de pensées simples…
- Pense aussi à la vente et à un « crédit de raccord ».
- Alexia. – Lit un rapport professionnel.
- Ecrit, non sans hésiter, quelques mots à Milan : « C’est vrai, les enfants ne s’endorment pas facilement ».
- Et la vie continue.
- Marina. – En voiture avec Hyacinthe et sa cadette Maya, Marina se demande : « Nous sommes-nous retrouvées, ma petite Hya ? »
- « Et quel cette part aveugle, quel corps en nos corps, dans la nuit de nos corps ? »
- Grâce. – Sa conclusion délicatement émouvante.
- Grâce ou la fidélité et la « petite besogne ».
- Que sa mère disait « la plus courageuse de toutes mes filles ».
- Grâce qui me rappelle tant ma petite mère.
- Jivan. - Et cela finit comme cela a commencé, sur la vague de Jivan.
- Le dernier mot du roman étant : lumière.
- Un roman des lumières du cœur.
- « Si le roman n’est pas mort, écrivait Georges Nivat, c’est que l’homme ne l’est pas. »
- Ni le poète, ni le médium d’un chacun. A mes yeux le plus beau livre lu ces semaines, avec celui de Mikhaïl Chichkine. Beaucoup moins ample certes, mais d’une justesse sans faille, d’une musique prousto-woolfienne, d’une mélancolie et d’une générosité égales.
- François Emmanuel. Regarde la vague. Seuil, 2007.





 A la même enseigne, dans un registre d’observation et d’expression très vif et fouaillant le « quotidien » de 2001, Antonin Moeri nous revient avec son neuvième livre, après Le sourire de Mickey, intitulé Juste un jour et passant au scanner verbal, sur fond de « monde nickel dominé par l’urgence et la proximité », un quatuor familial en séjour dans le paradis programmé d’une station de sports d’hiver. Il y a du Houellebecq, en moins nihiliste et en plus nuancé, chez cet ironiste walsérien qui a l’art de prendre les lieux communs au piège de sa lucidité, et de jouer avec l’oralité de manière nouvelle.
A la même enseigne, dans un registre d’observation et d’expression très vif et fouaillant le « quotidien » de 2001, Antonin Moeri nous revient avec son neuvième livre, après Le sourire de Mickey, intitulé Juste un jour et passant au scanner verbal, sur fond de « monde nickel dominé par l’urgence et la proximité », un quatuor familial en séjour dans le paradis programmé d’une station de sports d’hiver. Il y a du Houellebecq, en moins nihiliste et en plus nuancé, chez cet ironiste walsérien qui a l’art de prendre les lieux communs au piège de sa lucidité, et de jouer avec l’oralité de manière nouvelle.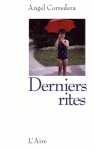 Si la relève juvénile brille par son absence, le deuxième roman d’Angel Corredera (37 ans) à L’Aire, après une entrée remarquée en littérature avec La confrontation, était attendu et tient ses promesses dans une narration beaucoup plus ouverte qui explore, en perspective cavalière, le monde de la fin des « seventies ». De son côté, également à L’Aire, Loyse Pahud évoque les années 60-75 dans le récit choral de Casse-tête. Plus directement autobiographique et enjouée, La vallée de la jeunesse d’Eugène, publiée à La Joie de lire, revisite une enfance et une adolescence partagées entre la Roumanie d’origine de l’auteur et sa découverte du monde, par le truchement de vingt objets qui lui ont fait du bien ou du mal.
Si la relève juvénile brille par son absence, le deuxième roman d’Angel Corredera (37 ans) à L’Aire, après une entrée remarquée en littérature avec La confrontation, était attendu et tient ses promesses dans une narration beaucoup plus ouverte qui explore, en perspective cavalière, le monde de la fin des « seventies ». De son côté, également à L’Aire, Loyse Pahud évoque les années 60-75 dans le récit choral de Casse-tête. Plus directement autobiographique et enjouée, La vallée de la jeunesse d’Eugène, publiée à La Joie de lire, revisite une enfance et une adolescence partagées entre la Roumanie d’origine de l’auteur et sa découverte du monde, par le truchement de vingt objets qui lui ont fait du bien ou du mal. Comme souvent, « nos » écrivains brillent autant sinon plus dans l’essai digressif que dans le roman, mais c’est entre les deux genres que Jean-Bernard Vuillème module la narration très originale d’Une île au bout du doigt, paru chez Zoé où le nomadisme cher à Bouvier rebondit. De la même façon, Jil Silberstein, à L’Age d’Homme, combine profession de foi
Comme souvent, « nos » écrivains brillent autant sinon plus dans l’essai digressif que dans le roman, mais c’est entre les deux genres que Jean-Bernard Vuillème module la narration très originale d’Une île au bout du doigt, paru chez Zoé où le nomadisme cher à Bouvier rebondit. De la même façon, Jil Silberstein, à L’Age d’Homme, combine profession de foi Au même rayon des regards croisés, rappelons enfin la publication, en mai dernier chez Metropolis, d’un épatant Petit guide de la Suisse insolite, sous la plume de Mavis Guinard. Autant dire que la rentrée ne se fait pas à un mois près…
Au même rayon des regards croisés, rappelons enfin la publication, en mai dernier chez Metropolis, d’un épatant Petit guide de la Suisse insolite, sous la plume de Mavis Guinard. Autant dire que la rentrée ne se fait pas à un mois près… Un livre absolument magnifique m'est arrivé ce midi, que j'ai lu d'un souffle en une heure, et que je relirai trois fois avant d'en écrire quoi que ce soit. Il s'agit du deuxième ouvrage de Philippe Rahmy, après Mouvement par la fin, portrait de la
Un livre absolument magnifique m'est arrivé ce midi, que j'ai lu d'un souffle en une heure, et que je relirai trois fois avant d'en écrire quoi que ce soit. Il s'agit du deuxième ouvrage de Philippe Rahmy, après Mouvement par la fin, portrait de la  douleur, paru chez Cheyne en 2005. En soixante pages étincelantes, belles à pleurer mais sans une once d'auto-compassion ou de ressentiment tournant à vide, Demeure le corps sublime le chaos et la catastrophe avec une puissance verbale extraordinaire, alternant le cri et le blues, l'imprécation et la supplique enfantine. Philippe Rahmy, né à Genève en 1965, est-il un auteur romand et fait-il encore partie de la relève ? On s'en bat l'oeil, mais on se l'arracherait aussi bien de ne pas lire Demeure le corps.
douleur, paru chez Cheyne en 2005. En soixante pages étincelantes, belles à pleurer mais sans une once d'auto-compassion ou de ressentiment tournant à vide, Demeure le corps sublime le chaos et la catastrophe avec une puissance verbale extraordinaire, alternant le cri et le blues, l'imprécation et la supplique enfantine. Philippe Rahmy, né à Genève en 1965, est-il un auteur romand et fait-il encore partie de la relève ? On s'en bat l'oeil, mais on se l'arracherait aussi bien de ne pas lire Demeure le corps. 


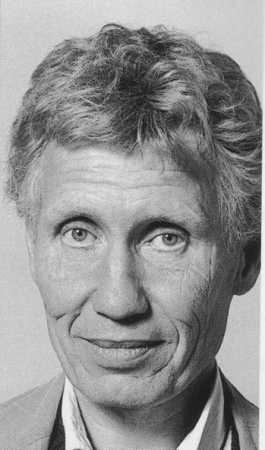

 Lecteur de tous les pays, lisez la rubrique littéraire de L'Humanité:
Lecteur de tous les pays, lisez la rubrique littéraire de L'Humanité: 
 Le premier est dévolu à l’art et à la pratique de celui-ci, dans son nouvel atelier de la région parisienne, de Fabienne Verdier, approchée par Charles Juliet et accompagnée dans sa geste picturale par les photographes Dolorès Marat et Naoya Hatakeyama. Après L’Unique trait de pinceau, illustrant le travail de la calligraphe, c’est le peintre à part entière qui nous accueille dans l’univers de signes et de fulgurances formelles de sa peinture qu’on dirait dansée – et c’est d’ailleurs bien ainsi quelle procède, manipulant d’énormes pinceaux suspendus entre ciel et terre. J’y reviendrai sous peu, en espérant une visite prochaine à la Sente des Fouines.
Le premier est dévolu à l’art et à la pratique de celui-ci, dans son nouvel atelier de la région parisienne, de Fabienne Verdier, approchée par Charles Juliet et accompagnée dans sa geste picturale par les photographes Dolorès Marat et Naoya Hatakeyama. Après L’Unique trait de pinceau, illustrant le travail de la calligraphe, c’est le peintre à part entière qui nous accueille dans l’univers de signes et de fulgurances formelles de sa peinture qu’on dirait dansée – et c’est d’ailleurs bien ainsi quelle procède, manipulant d’énormes pinceaux suspendus entre ciel et terre. J’y reviendrai sous peu, en espérant une visite prochaine à la Sente des Fouines. Du second, intitulé Histoire de la laideur et rassemblant une prodigieuse iconographie,
Du second, intitulé Histoire de la laideur et rassemblant une prodigieuse iconographie, Fabienne Verdier. Entre ciel et terre. Avec un texte de Charles Juliet, 86 œuvres et 56 photos en couleurs. Albin Michel, 272
Fabienne Verdier. Entre ciel et terre. Avec un texte de Charles Juliet, 86 œuvres et 56 photos en couleurs. Albin Michel, 272 Umberto Eco. Histoire de la laideur. Flammarion, 451p
Umberto Eco. Histoire de la laideur. Flammarion, 451p


 Bernard Delvaille
Bernard Delvaille




 - Certainement pas : nous avons beaucoup improvisé avec les acteurs, mais toujours en complicité avec l’auteur. Si je reste le patron, car il faut une transposition des mots en termes de cinéma, je crois que chacun, de l’écrivain aux acteurs, a beaucoup à m’apporter. Dans son rôle si délicat, toujours au bord du burlesque, Alan Tudyk m’a ainsi fait des quantités de propositions improvisées dont j’ai beaucoup retenu. En revanche, certaines improvisations ont tourné court parce qu’elles ne me semblaient pas « honnêtes » par rapport à l’histoire.
- Certainement pas : nous avons beaucoup improvisé avec les acteurs, mais toujours en complicité avec l’auteur. Si je reste le patron, car il faut une transposition des mots en termes de cinéma, je crois que chacun, de l’écrivain aux acteurs, a beaucoup à m’apporter. Dans son rôle si délicat, toujours au bord du burlesque, Alan Tudyk m’a ainsi fait des quantités de propositions improvisées dont j’ai beaucoup retenu. En revanche, certaines improvisations ont tourné court parce qu’elles ne me semblaient pas « honnêtes » par rapport à l’histoire. - N’est-ce pas délicat de rire de la mort ?
- N’est-ce pas délicat de rire de la mort ?






 Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 400 p.
Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 400 p.

 Lyonel Trouillot. L’amour avant que j’oublie. Actes Sud, 182p.
Lyonel Trouillot. L’amour avant que j’oublie. Actes Sud, 182p.

