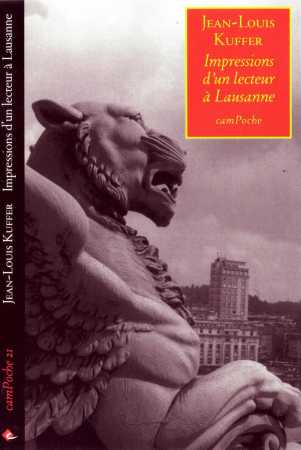Du désespoir juvénile et de L’élégance du hérissson.
Le spectacle m’a semblé tout à fait obscène, la semaine dernière, des médias se jetant sur la nouvelle de la double défénestration d’adolescentes corses amies. L’air profondément concerné des professionnels de l’information faisant illico recours à des professionnels de l’explication à l’air sincèrement préoccupé, semblait essentiellement destiné à ramener, au plus vite, ce double drame extravagant aux dimensions d’un phénomène accidentel d’ores et déjà pallié par la mise en place d’une cellule psychologique destinée à rassurer l’entourage des jeunes filles et, par voie de conséquence, tout le monde raisonnable et civilisé. Or toute l’agitation médiatique de ce soir-là et du lendemain ne m’a semblé destinée qu’à cela: rassurer les non concernés à l’air concerné. C’était d’autant plus incongru, pour ne pas dire hypocrite, que nul ne savait ce qui s’était réellement passé, qu’il me semble d’ailleurs impossible d’exposer ainsi sans trahir le récit personnel qui pourrait en être fait.
Il y a deux chose qu’une mère ou qu’un père ne peuvent pas comprendre: le fait que leur enfant se drogue ou le fait que leur enfant soit tenté par le suicide. Je suis convaincu, pour ma part, que si j’avais basculé dans les drogues dures, vers ma vingtième année, ou que si j’avais mis à exécution mes pulsions suicidaires, vers la trentième, mes parents, probes et bons, auraient été les derniers à me comprendre, après avoir été les derniers à pouvoir m’en protéger. Je suis persuadé que ce sont mes parents, probes et bons, qui m’ont aidé à déjouer ces dangers, mais tout cela s’est fait malgré eux, ou plus exactement: parce que nous étions nous, parce qu’ils étaient eux, parce que j’étais moi…
Le très beau livre de Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, parle de ces questions avec la délicatesse requise. L’un de ses personnages est une adolescente supérieurement intelligente qui a résolu, constatant l’absurdité de la vie et la mocheté des gens, de flanquer le feu à l’appart de luxe de ses parents (en leur absence) et de se donner la mort de la façon la plus douce.
Paloma, douze ans, est une fille conséquente. Elle prend les choses tellement au sérieux qu’elle ne peut pas prendre au sérieux ce que les adultes tiennent pour leur raison de vivre. Je ne sais pas si les deux adolescentes corses se sont défénestrées pour des raisons aussi sérieuses, peu importe à vrai dire. Ce qui m’importe, c’est ce qu’elles (se) raconteront après, et comment on les écoutera et, rêvons, comment on les comprendra.
L’élégance du hérisson raconte l’histoire d’une adolescente qui renonce au suicide. Ce n’est pas une romance faite pour rassurer à bon marché, mais un chemin, qui passe par l’attention à cela simplement qui est, à la beauté des choses, à la présence des « toujours dans le jamais ». Surtout : c’est beaucoup plus que l’histoire d'une adolescente qui renonce au suicide : c’est notre histoire de gens un peu perdus qui essayons d’apprendre à vivre, les uns avec les autres. C’est un livre à vivre autant qu’à lire que L’élégance du hérisson, et son succès me semble fait pour nous rassurer bien mieux que je ne sais quelle cellule de crise…
-
-
Jack le crack

Hommage à un frondeur poète
« La mort, ce serait le rêve si, de temps en temps, on pouvait ouvrir un œil », écrivait Jules Renard dans son Journal. C’est la phrase que Jack Rollan a fait reproduire sur le faire-part de son décès, survenu le 3 mai 2007 et annoncé aux médias après la dispersion de ses cendres à la surface des eaux du Léman.
Jack Rollan, en Suisse romande, était connu comme le loup blanc. Ce fut le chroniqueur satirique le plus talentueux de nos régions, d’abord à la radio, puis dans les journaux où, durant près d’un demi-siècle, il distilla un Bonjour irrévérencieux envers tous les pouvoirs établis. Aventureux de nature, mais peu doué pour l’organisation durable, il fonda un cirque, une maison d’édition et, avec son compère Roger Nordmann, cette entreprise extraordinaire que fut La Chaîne du bonheur, par le truchement de laquelle des millions furent collectés, à travers les décennies, pour aider les victimes de toutes les catastrophes, guerres et misères. Il écrivit aussi des livres, composa des chansons, se mit beaucoup de gens « bien» à dos et ne s’en trouva pas plus mal, mais pas plus riche non plus. Souvenir très personnel : Jack Rollan habitait, au temps de sa popularité sulfureuse, dans une somptueuse maison se dressant non loin de la nôtre, toute modeste. Sur sa porte était apposée une inscription solennelle : ON NE REçOIT QUE SUR RENDEZ-VOUS. Jack devait avoir trouvé cette plaque dans une brocante, mais c’est au sérieux que mon père la prenait. Ah le saltimbanque, ah le Don Juan, ah le directeur de cirque à la manque, mais pour qui se prenait-il donc !? Les deux voisins étaient nés la même année 1916. Je présume que, le ciel se faisant étroit, ils ont dû se retrouver là-haut et rient ensemble de tout ça en fumant leurs clopes. Ce qui est sûr, c’est que, des années, nous n’aurons manqué aucun de ses Bonjour...
On le revoit avec son chapeau sur l’œil, un peu canaille. On se rappelle la gouaille de son Bonjour légendaire à la radio, puis dans son canard du même nom, un peu boiteux. Ceux qui l’ont connu se rappelleront entre eux ses frasques et ses folies, si peu dans le grave goût romand, mais au fond qui était Jack Rollan ?
Il y a quelques semaines, il m’avait envoyé une brassée de poèmes inédits, qu’il avait tirés « d’un grand désordre » dû à son « génie personnel et à celui des femmes de ménage ». Hélas j’ai trop tardé à lui en parler, ne connaissant pas sa mauvaise santé, mais d’emblée m’avait frappé l’élan amoureux qui les traversait (leur titre d’ailleurs est Je t’aime – et variations), et la grâce ciselée de leur forme, leur mélange de naturel primesautier et d’élégance à l’ancienne, de vitalité joyeuse et de mélancolie aussi.
Jack Rollan écrivait ainsi dans un poème intitulé Coup de foudre, daté de 1998 : « C’est affreux de penser à vous/sachant qu’il faut y renoncer/puisque ma vie arrive au bout/alors que vous la commencez », et qui finissait sur ces vers exprimant bien le versant généreux de sa nature : « C’est affreux de penser à vous / mais plus affreux est de penser / que j’aurais pu mourir sans vous / avoir vue un instant passer »…
Parce qu’il était gouailleur et batailleur, on a souvent considéré Jack Rollan comme un bateleur plaisant mais en somme sans consistance. Or la beauté intérieure se révélant dans ses poèmes, qui lui fait par exemple écrire « Je t’aurais fait l’amour /en écoutant Ravel /A genoux, sans bouger, comme on fait sa prière », dévoile un aspect plus secret de sa personnalité, entre fantaisie et nostalgie. Jack Rollan qui saluait toute une époque passée en chantonnant Addio Vespa, écrivait aussi : « Je n’aime pas mon cœur/tabernacle d’un culte/où mon enfance en pleurs/déteste cet adulte/qui rate son bonheur », ou sous le titre d’Insomnie : « Je ne supporte pas/le bruit de cette rue, où je m’endors tout seul/où je m’endors sans toi/Je ne supporte pas/mon drap de toile écrue/ qui me fait un linceul/ puisque j’y dors sans toi »…
Coup de foudre
C’est affreux de penser à vous
Sachant qu’il faut y renoncer
Puisque ma vie arrive au bout
Alors que vous la commencez…
C’est affreux qu’un regard si doux
Puisse à ce point vous transpercer
Que le cœur en a comme un trou
Que plus rien ne pourra panser…
C’est affreux de savoir que tout
Nous sépare et peut vous blesser
Qu’un mot trop fort, qu’un mot trop fou
Pourrait à jamais vous chasser…
C’est affreux de rêver de vous
Vous caresser, vous enlacer
Et de se réveiller debout
Tandis que vous disparaissez…
C’est affreux de penser à vous
Mais plus affreux est de penser
Que j’aurais pu mourir sans vous
Avoir vue un instant passer… -
Neige à la Désirade

Du meilleur moment de parler de l’été selon Audiberti. De L’élégance du hérisson et d’une apparition onirique de René Char et d’Eric Rohmer barbu.
« Le meilleur moment pour parler de l’été c’est quand la neige tombe », écrit Audiberti au début de L’Opéra du monde, et c’est en regardant la neige tomber ce lundi de Pentecôte sur La Désirade que, me rappelant deux rêves de la nuit passée, je me suis enfin lancé dans la lecture de L’ Elégance du hérisson de Muriel Barbery, sous l’impulsion de la foule du premier rêve.
Ils étaient 200.000 à scander sous mes fenêtres : « Hérisson Pré-si-dent, Hérisson, Pré-si-dent », et du coup je me suis rappelé ce roman que j’avais commencé de lire une première fois à la rentrée d’automne et qui m’avait immédiatement fait sourire, mais qui se trouva bousculé par l’arrivage suivant et, comme trop souvent, resta sur le rayon kilométrique des « à lire bientôt» alors que le livre, oublié des prix de fin d’année, faisait son chemin et caracole aujourd’hui encore, plébiscité par le public, en tête de gondole.
Il y a dans L’élégance du hérisson tout ce que j’aime dans la France de Marcel Aymé : une écriture claire et fluide, un allant narratif apparemment débonnaire et qui bouge aussi aristocratiquement qu’une danseuse de Degas, un appareillage d’observation qui scanne illico les milieux contigus les plus divers (ici la loge d’une concierge et huit apparts de grande bourgeoisie où l’on croit comprendre le peuple), joue de malice avec les paradoxes (la concierge lit Marx pour mieux en relever les impasses et compte une petite fille géniale au nombre des enfants des ses patrons), satisfaisant en outre aux deux conditions que Pierre Gripari me disait le B.A BA du roman, à savoir : avoir des choses à dire et avoir quelque chose à raconter. Muriel Barbery, sous les apparences d’une femme française de notre temps, est une fabuliste alerte à la La Fontaine ainsi qu’une poétesse japonaise, une conteuse berbère des ruelles chics de Barbès et l’avatar dégraissé d’un Jules Romains lancé dans le premier tome des Femmes de bonne volonté…
Son roman est un pur délice, que rehausse le confort de se trouver à l’abri quand la neige tombe à poings fermés. Je ne l’eusse pas lu avec autant de ravissement sur les dunes ventées de Cap d’Agde. Je vais l’achever et y reviendrai en ces carnets virtuels par le détail, car c’est le détail qui compte dans un tel livre. Fine mouche au possible, Muriel Barbery a quelque chose aussi d’Amélie Nothomb, mais c’est Amélie avec plus de détails et plus de pâte humaine, plus de grâce ailée dans la manière et plus de tonus dans le développé, plus d’élégance dans le hérisson.
Le second rêve de la nuit dernière m’a fait me trouver à la table de René Char et d’Eric Rohmer, tous deux en manteaux d’hiver, donc ce devait être l’été. Tous deux faisaient plus de deux mètres et dépassaient donc toutes les têtes, dans ce café populaire de France latérale. C’est ainsi qu’ils se sont reconnus et embrassés par-dessus tout le monde. Eric Rohmer était barbu et souhaitait bon anniversaire à René Char. Donc ce devait être le 14 juin, jour de mon propre anniversaire et veille de l’anniversaire de Johnny Hallyday, sept jours avant celui de Jean-Sol Partre, mais je me la suis coincée…
Muriel Barbery, L’élégance du hérisson. Gallimard, 359p. -
La Quadrature du Cercle
Un fichu questionnaire circule ces nuits sur la blogosphère. Juan Asensio, dit Le Stalker ( http://stalker.hautetfort.com/ ) m’ayant défié d’y jouer, j’y joue, en dépit du caractère incompossible de l'exercice.
 Les quatre (entre 40 autres) livres de mon enfance :
Les quatre (entre 40 autres) livres de mon enfance :
Londubec et Poutillon
Les Aventures de Papelucho
Mayne Red, Winnetou
Jules Verne, Michel Strogoff
Les quatre écrivains (entre 400 autres) que je lirai et relirai encore :
 Charles-Albert Cingria
Charles-Albert Cingria
Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Vassily Rozanov
Ramon Gomez de La Serna
 Les quatre auteurs (entre 4000 autres) que je ne lirai [de toute évidence] plus jamais :
Les quatre auteurs (entre 4000 autres) que je ne lirai [de toute évidence] plus jamais :
Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine, Les insectes nuisibles ou comment s’en débarrasser.
Joseph Dougatchvili, dit Staline. Les purges de Babouchka et autres recettes.
Adolph Hitler. Für eine Totale Lösung aller Kleinen Problemen.
Mao Tsé-toung, Le Club des Quatre.
Les quatre premiers livres (entre 40.000 autres) de ma liste à (re)lire :
Léon Tolstoï, Don Quichotte.
Maurice G. Dantec, La Divine Comédie.
Blaise Pascal, Les Essais.
Louis-Ferdinand Céline, A la Recherche du Temps perdu.
 Les quatre « livres » (entre 400.000 autres) que j'ai emportés sur l’île déserte où je réponds à ce fichu questionnaire :
Les quatre « livres » (entre 400.000 autres) que j'ai emportés sur l’île déserte où je réponds à ce fichu questionnaire :
Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey
La Bibliothèque de Babel, édition virtuelle de 2033.
La Bibliothèque d’Alexandrie, avant l’incendie, réédition clandestine sur papier Bible, avec La Bible en bonus, 666 e-books.
Ma Bibliothèque de La Désirade numérisée, avec copie en braille pour le cas où…
 Les derniers mots d'un de mes livres préférés :
Les derniers mots d'un de mes livres préférés :
« Demain, demain, tout sera fini ! ». Dans Le Joueur de Dostoïevski (le seul que j’aie sous la main sur l’ile déserte où je réponds à ce fichu questionnaire…)
Les plus de quatre lecteurs (entre 4.000.000 d’autres) que je prie de mettre en ligne leurs réponses sur leurs blogs respectifs:
Joseph Vebret : http://vebret.typepad.fr Joël Perino: http://perinet.blogspirit.com Raymond Alcovère : http://raymondalcovere.hautetfort.com Bona Mangangu:http://etsilabeaute.hautetfort.com Pierre Cormary: http://pierrecormary.blogspirit.com/ Christian Cottet-Emard: http://cottetemard.hautetfort.com/ Jean-Jacques Nuel: http://nuel.hautetfort.com/ Nicolas Verdan: http://byblos.hautetfort.com/ Mike: http://deathpoe.hautetfort.com/ Alain Bagnoud: http://www.blogg.org/blog-50350.html L'Ornithorynque: http://ornithorynque.hautetfort.com/ -
A fleur de ciel
Aquarelles de mai


La même émotion quasiment enfantine chaque fois que nous retrouvons la mer. Le même sentiment que le paysage court sus à l'été en déboulant plein sud. La même sensation physique et psychique que le ciel s’ouvre.
Sable doux que sarcle la Tramontane à grands coups de cornes. Dunes aux croupes d’ânes, douces et pelées. Herbes folles. Rouleaux d’argent. Pères et fils aux cerfs-volants martelant le ciel au-dessus des vagues. Grâce des petites filles creusant leurs nids de souris. Belle est la Terre au bord du ciel...

-
Lecture de Slavoj Zizek
ZIZEK Slavoj. Plaidoyer en faveur de l’intolérance. Climats, 2007, 157p.
- Ce livre est l’actualisation de celui qui parut en 2004.
- Evoque d’abord la matière à penser des trois types basiques de cabinets : la chasse d’eau latérale des Allemands, le trou vertical des Français et la cuvette « mixte » des Américains.
- Enchaîne sur le triangle hégélien de la minutie réfléchie allemande, de l’ irréflexion révolutionnaire française et du pragmatisme utilitariste anglo-saxon.
- Puis s’arrête au nouvel avatar de cette trinité : Le Français soucieux de son héritage culturel, l’Allemand de son économie flageolante et l’Anglais de ses relations avec l’Europe.
- S’interroge sur la prétendue dépolitisation de l’humanitaire, qui devient l’idéologie de l’interventionnisme militaire au service d’objectifs économico-politiques très clairs. Comme dans les Balkans et en Irak.
- « La politique antipolitique humanitaire, consistant à simplement prévenir la souffrance, se résume effectivement, en conséquence, à l’interdiction implicite d’élaborer un projet collectif positif de transformation sociopolitique ».
La gauche et la droite aujourd’hui
- Nous vivons des « temps étranges ».
- Où les plus grands adversaires de l’Etat ne sont plus les extrémistes de gauche mais les fondamentalistes américains.
- Alors que les gauchistes soutiennent un Etat fort.
- Et que la gauche modérée (type Blair) accepte silencieusement la dépolitisation de l’économie.
- On a vu comment la tolérance multiculturelle est devenue l’idéologie hégémonique du capitalisme global.
- Estime qu’un renouveau de la gauche est inimaginable sans une « critique virulente, fortement intolérante, de la civilisation capitaliste globale ».
L’hégémonie et ses symptômes
- Rappelle la catégorie des types représentatifs, tels que les prônait le réalisme socialiste.
- Le type, dans la cristallisation idéologique, est à deux temps.
- Exemple de la femme donnée en type par les adversaires de l’avortement, ou par leurs partisans. Comment tel ou tel type va devenir l’emblème idéologique, le type hégémonique.
- La lutte pour l’hégémonie idéologico-politique vise à l’appropriation des termes transcendant les clivages politiques.
- Exemple de Solidarité en Pologne.
- Une unité populaire apparente a été érigée en type hégémonique le temps d’un combat spécifique.
- Note la composante de l’honnêteté dans la typologie idéologique des « gens ordinaires ».
- Et la plasticité de cette notion d’honnêteté.
Pour quelles raisons les idées dominantes ne sont-elles pas les idées de dominants ?
- Selon Z. les universaux hégémoniques doivent incorporer au moins deux composantes : la composante populaire « authentique » et sa « distorsion » liée aux relations de domination et d’exploitation (cf. Balibar, dans La crainte des masses).
- Dans une cristallisation hégémonique, les désirs de la majorité dominée cohabitent avec l’expression des intérêts des dominants.
- Analyse le glissement sémantique de la notion de fascisme par rapport à sa réalité socio-historique et à son usage polémique.
- Montre comment l’affirmation de la non-idéologie peut servir l’idéologie la plus radicale (ex. du nazisme).
- Le nazisme correspondait à l’aspiration à une authentique vie de communauté, dont la distorsion a été opérée en intégrant (notamment) la chasse aux juifs.
- Affirme que « les idées dominantes ne sont jamais directement les idées de la classe des dominants ». Vrai pour le communisme autant que pour le fascisme ou le néo-libéralisme.
- Donne en outre l’exemple du christianisme.
- Devenu idéologie dominante « en incorporant une série de motifs et d’aspirations propres aux opprimés (la vérité est du côté de ceux qui souffrent et sont humiliés, le pouvoir corrompt, etc.) et les réarticulant de telle façon qu’ils deviennent compatibles avec les relations de domination existantes ».
- Evoque ensuite la position et le rôle de la classe moyenne par rapport aux deux extrêmes opposés.
- La classe moyenne incarne, selon Z., le déni de l’antagonisme et « le mensonge incarné ».
La politique et ses désaveux
- Comment échapper à la clôture de l’hégémonie ?
- Jacques Rancière (dans La Mésentente) affitme que cette résistance constitue le cœur même de l’instant politique.
- Evoque la naissance de la démocratie grecque avec l’exigence d’une part accordée aux sans-part.
- Une exigence à la fois particulière et universelle, non fondée sur une majorité mais sur un principe collectif acquis pour l’ensemble du demos.
- Cite le glissement du premier acte démocratique est-allemand (« Nous sommes LE peuple ») à la réappropriation du slogan (« Nous sommes UN peuple ») par les multinationales.
- Détaille les divers avatars de l’exercice politique, dont le dernier est la postpolitique.
- « Dans la postpolitique, le conflit entre des visions idéologiques globales incarnées par différentes parties en lutte pour le pouvoir est remplacé par la collaboration entre technocrates éclairés (économistes, experts ès opinion publique, etc.) et tenants du multiculturalisme libéral.
- Décrit l’évolution du New Labour de Tony Blair.
- Désormais, les bonnes idées seront « les idées qui marchent ».
- Le Nouvel Ordre mondial est global mais pas universel.
- Chaque part reste confinée dans l’espace qui lui est assigné.
- Il n’existe pas d’universel démocratique sans « part des sans-part».
- Or l’instant politique consiste justement en l’expression des sans-part.
- Montre ensuite comment la violence est « gérée » par inclusion dans la postpolitique.
- On l’a vu dans le changement de tactique par rapport aux Afro-Américains.
- A l’exclusion de fait, dans les années 60-70, a répondu le mouvements des droits civiques, expression des « sans-part » conduite par Martin Luther King.
- Aujourd’hui, le problème est « géré » par une vaste trame de mesures juridico-psychologico-sociales qui ne procède pas directement du politique.
- Cette procédure de tolérance déjoue même le geste politique.
Existe-t-il un eurocentrisme progressiste ?
- Z. aborde la question du socialisme est-européen.
- Comment le sublime enthousiasme de la chute du communisme a tourné au ridicule.
- Introduit les notions de sot et de coquin.
- « Après la chute du socialisme, le coquin est un défenseur néoconservateur du marché libre qui rejette avec cruauté toutes les formes de solidarité sociale », tandis que le sot fait de la critique sociale multiculturelle qui renforce l’ordre existant ».
- Cite les exemples du Neues Forum et sa propre expérience de dissident en Slovénie.
- Montre comment la postpolitique ne promeut que des « affirmative actions » atomisées, qui n’ont pas de signification politique réelle.
- La galaxie des « politiques identitaires » n’existe que sur le socle de la globalisation et sa représentativité politique est un leurre.
Les trois universels
- La structure de l’universel est complexe.
- Distingue 1) l’Universalité « réelle » de la globalisation,
- 2) L’universalité de la fiction régulant l’hégémonie idéologique (l’Etat ou l’Eglise)
- 3) L’universalité d’un Idéal, illustré par la demande d’ « égaliberté ».
- Actuellement, l’universalité « réelle » de la globalisation induit, à travers le marché, sa propre fiction hégémonique (ou même idéale9 de tolérance multiculturelle, de respect et de protection des droits de l’homme, etc.
- Revient à l’émergence de l’Etat-nation.
- Et à l’équilibre qui a découlé (temporairement au moins) de sa construction.
- Evoque la fin du monopole de l’usage légitime de la violence (définition de l’Etat moderne selon Max Weber) en citant l’exemple des prisons privées américaines, qu’il qualifie d’« institutions obscènes ».
La tolérance répressive du multiculturalisme
- Comment se construit l’« autocolonisation » du capital multinational.
- Le pouvoir colonisateur a passé de l’Etat-nation aux multinationales, dont l’idéologie hégémonique est un multiculturalisme de façade, lequel cache une sorte de « racisme avec une distance », sur une base eurocentriste.
- La tolérance libérale du multiculturalisme tolère l’Autre tant qu’il n’est pas le vrai Autre. Donne l’exemple de l’excision ou de la peine de mort. « Nous savons ce qui est bon pour vous ».
Pour une suspension de gauche de la loi
- The very question is : comment réinventer le geste politique dans le contexte de la globalisation ?
- Relève que l’impartialité du libéral est « toujours-déjà partiale ».
- La gauche devrait réaffirmer le caractère radicalement antagonique de la vie sociale.
- Accepter la nécessité de « prendre parti », selon Z., est la seule manière d’être effectivement « universel ».
- Ne dénie pas pour autant les avancées de la postpolitique en matière sociale.
- Mais affirme que la dépolitisation de l’économie freine les avancées à caractère vraiment « universel ».
La société du risque et ses ennemis
- Revient sur la théorie de la société du risque (Ulrich Beck)
- Réintroduit les notions d’indétermination et d’incertitude dans le domaine de la décision.
- Cite le fossé croissant entre la connaissance et la prise de décision.
- La réalité du fait que « personne n’est aux manettes ».
- Les premières Lumières tablaient sur la décision fondée par la Raison.
- Les secondes intègrent les variables liées à l’incertitude.
- Reproche à la théorie d’être à la fois trop spécifique et trop générale.
- Estime que le marxisme et la psychanalyse peuvent aider à y voir plus clair.
Malaise dans la société du risque
- Critique la théorie dans son approche de la famille.
- Evoque les conséquences observables et non encore observées de l’effondrement de l’autorité paternelle. (p.116)
- Parle de la décomposition et de la recomposition des relations dans le contexte évolutif.
- Passe ensuite à la figure emblématique de Bill Gates, image acclimatée de l’homme ordinaire, du héros-comme-tout-le-monde dans sa variable d’ex-hacker qui-a-réussi.
- Du nouveau surmoi cristallisé dans la société selon Bill Gates & Co.
La sexualité aujourd’hui
- Analyse la nouvelle opposition entre sexualité « scientifique » et spontanéisme New Age.
- La sexualité « scientifique » l’intéresse sous deux aspects : l’abolition de la fonction créatrice par le clonage, qui nous confronte « à l’alternative éthico-ontologique la plus fondamentale », et les conséquences psycho-socio-ontologiques de l’usage du Viagra.
- Estime que l’usage de celui-ci va désexualiser l’acte de copuler.
- En observe les conséquences sur les représentations réciproques du couple. Où le pénis mécaniquement commandé n’a plus valeur symbolique de phallus.
- Aborde ensuite la vision New Age de Celestine prophecy.
- Montre comment cette vision tend à réduire toute tension dans l’altérité, voire à nier celle-ci par une sorte de retour solipsiste.
- Parle ensuite du cas de Mary Kay, cette enseignante américaine tombée amoureuse d’un adolescent de ses élèves.
- Détaille les réactions à cette affaire médiatisée à outrance.
- Comment l’élément passionnel de l’histoire a été nié, pour aboutir à une médicalisation du cas et à l’autocritique de Mary.
C’est de l’économie politique, crétin !
- Revient au cas de Bill Gates.
- « La grande nouvelle de la « fin de l’idéologie » de l’âge postpolitique contemporain est la dépolitisation radicale de la sphère de l’économie : la manière dont l’économie fonctionne (la nécessité de mettre un terme à la sécurité sociale, etc.) est acceptée comme une simple manifestation de l’état des choses objectif.
- Le retrait de l’engagement civique donne libre cours au consumérisme sans « états d’âme »…
Conclusion : le tamagoshi comme objet interpassif
- Introduit la notion d’interpassivité.
- Evoque l’exemple des ires enregistrés de la TV.
- Décrit le type des relations établies avec le tamagoshi.
- L’Autre mécanique qui émet constamment des demandes sans avoir aucun désir propre ».
- « Il est facile de démontrer comment cette notion d’interpassivité est liée à la situation globale actuelle ».
- Définit la postpolitique actuelle comme « fondamentalement interpassive ».
- Tout cela passionnant par la matière autant que par les observations. Parfois un peu touffu, saturé de références, notamment à la psychanalyse, qui n’en simplifient pas la lecture, mais l’effort de lecture est productif. Stimulant. -
Le degré zéro de l’Eros

Des Particules élémentaires à la baise de cinq à sept.
Cela se passe tous les jours sous nos fenêtres, ou plus précisément à trois cent mètres de notre balcon donnant sur la mer et les dunes, avec le Mont-Clair sétois en horizon : tous les jours entre cinq et sept, le long du sublime rivage de sable doux qui forme l’anse liant le Cap d’Agde à Sète, se donne désormais le spectacle couplé de la baise et du branle.
Les lecteurs des Particules élémentaires de Michel Houellebecq se le rappellent : que cela baisait déjà pas mal dans les dunes de Marseillan, aux abords de la cité naturiste de Cap d’Agde. Dix ans après le progrès est considérable : ce n’est plus à l’abri des regards des baigneurs ordinaires que cela baise, mais sur la plage même où tout un chacun va et vient, enfants compris. Le spectacle se donne ordinairement entre cinq et sept. Il se signale de loin par un attroupement de mâles et de femelles en station verticale, qui forment un cercle plus ou moins dense (de cinquante à deux cents individus environ) autour d’un couple hétéro ou homo en plein exercice de copulation. Rituellement, la fin de la prestation est saluée par les applaudissements de l’assistance…
Le spectacle est intéressant : pas tant celui des sexeurs, qui ne font évidemment que sexer, que celui de la composition de l’assistance. Pour se dire « libertins », ce que sont visiblement les plus jeunes (30-45) et les plus visiblement dans leur élément, les attroupés ressortissent à l’évidence à la classe moyenne la plus ordinaire, qui s’encanaille momentanément. De la secrétaire au chef de bureau, en passant par le commercial un peu seul et la modiste sur le retour d'âge, c'est l'Europe moyenne qui salive en ces lieux.
Il y a vingt-cinq ans que, presque chaque année, nous passons dix jours de printemps ou d’automne dans la cité naturiste d’Heliopolis, où nous ont amenés mes beaux-parents, lui culturiste notoire et elle Hollandaise non moins héliophile. Les studios en ruche de la cité, ses kilomètres de plage où se balader à poil, la proximité des commerces et la mer convenaient à un petit break annuel plutôt bon marché. Tant qu’elles étaient enfants, nos petites filles n’étaient guère gênées par la nudité ambiante, d’ailleurs facultative à l’entre-saisons. Actuellement, les demoiselles évitent ces lieux autant que la plupart des jeunes dont on sait la pudeur, nullement paradoxale.
Au fil des années, avec une forte accélération récente, un clivage net s’est marqué entre l’ancienne population des naturistes purs et durs, plutôt stricts en matière de morale, et une nouvelle catégorie de gens de tous âges et de toutes nationalités qu’on pourrait dire des consommateurs de sexe actif ou passif, incluant des échangistes, des gays, quelques professionnels de la chose et une foule de plus ou moins frustrés plus ou moins furtifs.
Ces nouveaux clients, avec leurs désirs et leurs obsessions, amenaient beaucoup d’argent. Leur présence parfois intempestive, avec de plus en plus de boîtes de nuit bruyantes et d’exhibitions occasionnelles (bien avant le spectacle de cinq à sept), n’a pas manqué de susciter la grogne des vieilles peaux naturistes, au point d’engager des affrontements médiatiques, légaux ou policiers. L’an dernier étaient ainsi apparus des placards interdisant tout débordement sexuel public, et des gendarmes à cheval patrouillèrent les dunes. Cette année, la répression semble retombée au point mort, alors que s’achève la construction d’un nouvel ensemble hôtelier, au cœur du vaste hémicycle « futuriste » d’Héliopolis, réservé à la seconde clientèle friquée et bâtie au dam des résidents propriétaires.
L’équation vaut d’ailleurs pour l’ensemble de la situation décrite : tolérance because pognon, à laquelle je n’ai cessé de penser ces derniers jours en lisant le passionnant Plaidoyer en faveur de l’intolérance de Slavoj Zizek, qui montre comment les impératifs du profit s’accommodent de la tolérance la plus opportuniste, voire la plus hypocrite, étant entendu que les autorités locales restent ce qu’elles sont en matière de morale publique.
Slavoj Zizek, qui serait sans doute passionné par la matière à réflexion que nous donne ce qui se passe sous nos yeux, ne condamnerait sûrement pas les « acteurs » de la chose plus que nous n’y sommes portés : il constaterait.
Or ce qu’il écrit dans son chapitre intitulé La sexualité aujourd’hui, trouverait d’utiles compléments à cette observation, dans le sens d’une destruction de la sexualité par sa banalisation sidérante. Toute la réflexion de Zizek sur la négation de l’Autre, ou plus exactement sur le gommage de l’altérité, se trouve illustrée par la baise publique de cinq à sept, à côté de laquelle un tea for two resplendit de fin érotisme virtuel. Négation de l’intimité, négation de la séduction personnelle, négation du secret et de toute parole - sinon de tout langage puisque piercings, breloques et tatouages ont fonction de messages -, négation de toute tendresse autre que ce sentiment moite de poisser et de mouiller de conserve, négation de toute forme d’amour: tel est bien le progrès…
Slavoj Zizek. Plaidoyer en faveur de l’intolérance. Climats, 156p. -
Archipel de l’insomnie
Ces parages où la vie s’impatiente, de Jacques Roman
L’image est un peu éculée, du poète considéré comme un veilleur, et pourtant c’est bien cela qu’incarne Jacques Roman toutes les nuits à sa lucarne, à poursuivre son Ouvrage de l’insomnie dont vient de paraître le troisième volume, tissé de fragments d’une sorte de continuel murmure où la pensée et la langue ne cessent de travailler la matière. Il y a là quelque chose de très physique et d’intensément poétique à la fois dans le sens là encore d’un travail de transmutation.
« J’ai appris à vivre comme un compositeur qui s’entendrait dire chaque jour que son œuvre ne sera jamais jouée », écrit Jacques Roman qui n'en finit pas de publier et d’apparaître sur nos scènes à lire notamment les textes des autres (il prépare une lecture d'Une bruyante solitude de Bohumir Hrabal), mais c’est autre chose qu’il signifie là: comme si l’écriture vécue à sa pointe lui était encore insuffisante, toujours en avant de la vie mais en manque d’un autre absolu : « On eût voulu se faire aimer non pour soi mais pour ce qui nous traversait immense et qui à tous appartenait ».
C’est ainsi comme un auteur anonyme, éminemment personnel mais comme parlant en nos noms multiples, que nous suivons dans ses tâtons éclairés de loin en loin par des fulgurances ou par des sortes d’oasis de simplicité lumineuse, ainsi : « Il y a des êtres et des lieux rencontrés dont je n’ai plus mémoire de noms mais bonheur ! Dans leurs parages je me souviens d’escaliers embaumant la cire, de draps frais, de café au lait, de petit jour et de douce hospitalité ».
Le seul mot de betterave lui rappelle un monde, à l’enfant abandonné par sa mère qui se rappelle le travail d’aller aux betteraves: « Au lieu où je fus placé en nourrice, le champ des morts, sa place est en plein champ de betteraves. » Et le goût du mot de se mêler à celui d’ entrave et de commander…
Dans le même ordre des épiphanies familières, je relève ceci : « Le petit tableautin qu’était l’ardoise : le plaisir de la mouiller à l’aide de l’éponge, en tirer le noir profond puis, lentement, la voir se voiler de gris : L’expression de la pensée a toujours ce gris-là » Ou cela d’aussi physique et méta : « Le toucher contient plus de visages qu’un miroir ». Ou cela encore : « J’ai la mémoire de la joie intense à faucher l’herbe, à entendre siffler la faux qu’accompagne mon souffle, ma respiration, tandis qu’un pied après l’autre on avance en travail. » Ou cela : « Ma vie doit beaucoup à la littérature et, les années passant, j’ai toujours plus chagrin de ne pouvoir lui acheter la robe promise ».
Allons donc, cher vieux, elle ne lui va pas si mal, la robe que tu lui tisses tous les soirs, avec autant de grâce ici que de rage et d’humour. De cette rage que je partage aussi bien: « J’écris, moi, depuis un pays qui se méfie des pays. La Suisse (c’est le nom du pays où je survis) draine une avarice que masque sa richesse ». Et cela que je contresigne itou : « Ce pays semble assimiler l’artiste à un « cas social ». Et comme la folie y est répandue, enfin, une folie calme une folie d’au bout de la route quand la bête est matée (un bon fou y est un fou mou), on se demande si le Suisse ne soupçonne pas l’artiste d’être la cause de toute cette folie et pire ! celui qui pourrait en ébranler la masse folle et molle. L’artiste est donc un dissimulateur dangereux qu’il convient de remettre à sa place : nulle part. »
Jacques Roman. Ces parages où la vie s’impatiente. L’Aire bleue, 283p. -
Sollers à Sète
De Ludivine la cane, de la Nouvelle Librairie Sétoise, de Montaigne et de Slavoj Zizek
C’est toujours un bonheur vif que de se retrouver dans cette ville ouverte entre mer et ciel où tout semble à la fois simple et racé, débonnaire et subtil, accueillant comme un village en ses places ombragées et traversé d’une constante pétarade, avec quelque chose de Naples à l’heure de pointe et de simultanément nonchalant, de très marin et de très humain, où les chances semblent à vrai dire minces de rencontrer Sollers, et c’est pourtant à Sollers que j’ai pensé en observant la cane Ludivine remontant en se dandinant la rue Paul Valéry.
On sait qu’il y a à Sète une rue Paul Valéry et une rue Georges Brassens, qui grimpent toutes deux le long des pentes du Mont Saint-Clair, vaguement parallèles et ne se rejoignant probablement pas; mais je ne l’ai pas vérifié, tout occupé que j’étais à suivre la gracieuse Ludivine que je venais d’affubler du nom de la maîtresse de Sollers pour un mélange de grâce mutine et crâne que l’animal montrait en se dirigeant vers une terrasse à moules-frites dont les clients accoutumaient sans doute de la sustenter. Or suivant Ludivine, c’était bien à Sollers que je pensais, venant de lire, au lever du jour, l’introduction à la nouvelle édition en Pléiade des Essais de Montaigne et m’étonnant de ce que Sollers n’en ait point encore écrit quelque chose. Ce n’était pas tant que j’eusse envie de lire quoi que ce fût de Sollers à propos de Montaigne, que je ne sens pas tout à fait son rayon, pas plus que je ne me serais attendu à rencontrer Sollers à Sète sous une autre forme que celle, allusive, de la cane Ludivine, mais Montaigne m’avait fait penser à Sarlat, et de Sarlat à Sollers il n’y a qu’un pas, comme de La Boétie au foie gras ou de la terrasse à moules-frites de la cane Ludivine à l’admirable Nouvelle Librairie Sétoise, sise rue Alsace-Lorraine et tenue par le couple Isch où chaque année nous venons acheter quantité de beaux et bons bouquins...
Cette fois n’a pas fait exception, puisque nous en sommes repartis avec de grands sacs pleins de livres que nous ne pensions pas y trouver, comme les dernier romans d’Antonio Lobo Antunes et de Michael Connelly, le volume de la collection Quarto consacré à René Char (Dans l’atelier du poète) et le nouvel essai de Slavoj Zizek, dont le titre paradoxal, Plaidoyer en faveur de l’intolérance, ne pouvait que m’intriguer et m’affrioler, convaincu que je suis que l’omnitolérance est plus dommageable à la forme humaine que l’intolérance, enfin divers autres ouvrages que nous avons commencé de feuilleter sous les frondaisons en dégustant force sorbets.
Déguster force sorbets est une façon de revenir à Sollers, que je n’avais d’ailleurs pas quitté, en pensée tout au moins. A la librairie, c’est en effet ce nom-là que j’avais donné lorsque la libraire, Noëlle Isch, m’avait proposé d’inscrire trois commandes pour la fin de la semaine. «Seriez-vous un homonyme de l’écrivain », me demanda-t-elle ? « Nullement », répondis-je, « c’est juste pour la commande. Si je venais à l’oubliez, vous engueuleriez Sollers, mais je n’oublierai pas, sinon mon vrai nom est Joyaux...» -
Salamalec Olympien
Aux éteignoirs de l’humeur chienne et aux enchifrenés de la morosité, aux dolents blêmes et aux mal lunés, aux sujets de la déprime sublunaire et aux addicts du breakdown, aux maussades et aux blasés, aux piteux et aux poteux, j’adresse, moi la sage Olympe, de mon champ de narcisses narcissiques de la Désirade, mes vœux de gaillardise et de paillardise, de liesse folâtre et d’enjouement badin !
Photo: Philippe Seelen
-
Une passion à contretemps

Ne touchez pas à la Hache, de Jacques Rivette
Elle est terriblement émouvante, la duchesse de Langeais que fait revivre Jacques Rivette dans ce film plein de beaux et gros défauts, qui a le premier mérite de restituer pour l’essentiel le drame tissé de non-rencontres des deux amants séparés à la fois par les convenances sociales, les règles de la morale et de la religion, mais aussi par la morgue de classe et ce qu’il est convenu d’appeler la guerre des sexes, avec ses feux et ses fuites, ses élans et ses esquives, ses alternances de séduction et de cruauté, de mentir vrai et de rage feinte ou réelle, soupirs et trépignements, esquives et retours, malentendus à n’en plus finir et détresse avouée ou ravalée, perte et sacrifice final...
La réussite de Ne touchez pas à la hache, film pénombreux et lent, aux dialogues secondaires parfois bâclés ou artificiels, doit beaucoup à l’interprétation de Jeanne Balibar, dont le visage extraordinairement mobile, du point de vue de l’expression, contraste absolument avec la figure massive, navrée voire prostrée de Guillaume Depardieu qui incarne néanmoins le rôle du général Montriveau avec une intensité de soudard taiseux qui en impose. Si le roman de Balzac, et ici le début du long flash back constituant le corps de l’histoire, mettent l’accent sur les cruautés répétées de la duchesse faisant tout pour attirer à elle le héros bonapartiste et l’éconduisant à tout coup, l’élément le plus fort du film tient à la fois à la bascule violente de l’action marquée par l’enlèvement de la coquette et la scène sadienne de la menace au fer rouge, et par la montée ultérieure de la passion chez la duchesse, que la comédienne rend absolument crédible, et même bouleversante, en dépit des ellipses du scénario (tout ce qui concerne l’histoire des Treize est éludé, qui affaiblit la portée de la scène de torture et rend le dénouement peu compréhensible) et du caractère vraiment sommaire de certaines scènes ou de certains personnages du second rang. N’empêche: le cœur du drame est bien là qui palpite. Cependant il faudrait relire le texte (on peut aussi l’écouter sur CD, lu par Fanny Ardant) pour mieux juger de ce film - à voir assurément, sans en attendre un chef-d’œuvre… -
Dans les nuées

Où apparaît le personnage emblématique de la mère en ses oeuvres. Des vicissitudes ménagères et des litanies qui en découlent. Des appareils symbolisant les avancées du Progrès. De la machine à tout oublier.
Elle m’apparaît en bottes au milieu des bouffées de vapeur savonneuse, mais tu repasseras pour le fantasme freudo-wagnérien, parce que c’est vraiment pas la mère à te faire imaginer des situations oedipiennes et compagnie, même si c’est vrai qu’on peut être étonné.
En tout cas elle n’arrête pas, c’est sûr. Et elle le dit: en tout cas moi je n’arrête pas.
Elle s’est levée avant tout le monde, comme tous les matins, sauf le dimanche où il y a juste le culte à dix heures, et des années après elle le répète encore volontiers aux dames de la gym du troisième âge quand elles se retrouvent au Kibo pour prendre un café croissant: moi je me suis toujours levée avant tout le monde, il a fallu tellement lutter, on n’a plus idée au jour d’aujourd’hui.
Quand elle m’apparaît dans les nuées de la chambre à lessive, ce doit être, ça ne nous rajeunit pas, un printemps du début des années cinquante, c’est ça: je ne vais pas encore à la petite école et elle me dit à tout moment de ne pas rester dans ses jambes - c’est donc bien avant Adora l’adorée puisqu’elle manipule une espèce de batte visqueuse (ça y est, aux abris: alerte à l’indice psy!) et ce sera bientôt parti pour la litanie Engelures: moi pendant des années j’ai fait toutes les lessives été comme hiver et ça vous fait des mains! et l’autre jour encore, comme elle remet le couplet, au même instant pilipili-pilipili, voilà que le portable de mon neveu le tenancier du Shylock la fait bifurquer: moi ces machines je n’y comprendrai jamais rien, et d’ailleurs dans le temps on n’aurait jamais pu se payer tout ça, et du coup elle enchaîne sur la litanie Sou Par Sou.
Moi toute la vie j’ai dû compter sou par sou, nous aura-t-elle seriné à travers les années, mais c’est tout à coup une cohorte de retraités en survêtement bleu pâle que j’entends ronchonner en surimpression: comme que comme vous n’avez pas idée, les jeunes, de ce que c’est que de compter - et ça me poursuit jusque dans un rêve où mon père me surprend au Bancomat.
Tu te figures sa tête, lui que les machines ont toujours épaté, qui les approchait plutôt timidement puis s’intéressait au mécanisme, le contraire de la plupart d’entre nous, les démontait pour comprendre et les réparait volontiers dans son coin; tu le vois tourner et retourner ma Mastercard dorée qu’il tient de ses fins doigts immortels, et je lui sens un frémissement d’ailes (très seyantes, les ailes de papa, soit dit en passant, très simples, très classes) quand il s’exclame: et c’est avec ça que tu paies, non mais tu blagues, c’est avec ça que tu paies ?
En ce qui me concerne, cependant, c’est la honte, parce que vient de m’apparaître le désastre: que nous ne sommes que le quinze et que notre compte, déjà, marque zéro, et même un zeste en dessous du niveau de la mer, mais va donc expliquer à notre angélique visiteur pourquoi la machine refuse d’allonger la monnaie...
Tu te représentes l’énormité: ça a deux salaires, à peine deux kids, et ça rame dans les chiffres rouges ! J’ai beau savoir mon paternel capable de toutes les indulgences, et surtout assez réaliste pour piger la situation (certes nous comptons moins qu’eux, mais la vie est devenue hyperchère et nous faisons ce que nous pouvons), je n’en suis pas moins gêné quelque part, et d’autant plus qu’il ignore encore que ma mère nous a fait une grosse avance pour notre résidence secondaire, du genre qu’il n’a jamais pu que rêver - tu le vois se pointer à La Désirade !
Sur ce, je n’ai même pas le temps de lui proposer de s’attarder un peu (une visite à Madame ne serait pas un luxe après les quinze ans qu’elle a tirés sans lui) que l’ange du Bancomat a disparu dans un imperceptible froissement de plumes. Mais quel dommage: on aurait eu tant d’autres choses à lui faire voir !
Faute de mieux je les revois alors ensemble, et nous les enfants, tous en admiration devant la première machine à laver qu’il est arrivé à lui payer, une Adora, et je me rappelle le baratin du vendeur aux cheveux brillantinés qui surenchérissait: et voici, pour vous servir, Adora l’adorée, l’essayer c’est l’adopter, avec elle vous irez jusqu’au siècle prochain!
Le pauvre type ne parlait pas pour lui: trois semaines après son numéro c’était l’accident à bord de sa 403 grise, même modèle que l’inspecteur Columbo, un virage à trop grande vitesse et droit sur un mur, le fameux coup du lapin.
Mais tu sais aussi ce que c’est que la vie des machines au jour d’aujourd’hui: ça raccourcit de plus en plus, même pas l’espérance de longévité d’un ménage moyen, et d’ailleurs, pour Adora, tu peux courir après les pièces de rechange.
Là-dessus j’en reviens à l’apparition bottée dans les nuées de la vie ancienne, avant leviers et manettes, au temps des déesses lavandières du quartier de nos enfances, et nous revoici dans le dédale des draps à l’étendage.
Il y a plein de voix et de litanies: moi vous allez me tuer, moi si ça continue je vais faire mes valises, moi je me demande ce que vous ferez quand je ne serai plus là ?
La chambre à lessive est un vrai hammam d’où émergent parfois des bras nus, une tête à drôle de turban, une torsade d’étoffe immaculée qui ruisselle dans les rigoles, des bras roses, des mains bleues, et de là-dedans fusent les ordres: mais ne reste donc pas dans le mouillon, ne va pas trop au soleil, ne va pas m’attraper un rhume par cette pluie, et les mains passent du froid de l’hiver des Hongrois à l’eau bouillante et ça fait des gerçures.
Moi dans le temps j’avais de ces mains crevassées, raconte-t-elle encore à ses vieilles comparses du Kibo, et chacune d’y aller de son monologue extérieur: moi mon mari pissait sur la serrure de sa Vespa pour la dégeler, moi ma belle-mère nous a rendu la vie tellement impossible qu’on avait tout arrangé pour le Canada et voilà qu’elle se fait mitrailler par le tueur fou de la Grotte, moi dans le temps je croyais encore aux oeufs à deux jaunes, et les voix s’estompent dans les nuées tandis que, parfaitement silencieuse, s’active la grande machine à tout oublier. -
Le secret du concombre
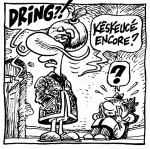
Le bain de minuit, album citoyen dans lequel Mandryka explique entre les signes pourquoi il n'a pas voté Nicolène Sarkoyal. A lire et relire.
Le concombre masqué n'a pas été candidat aux élections présidentielles passées de la République Hexagonale du Centre Multiple. Pourquoi cela ? Le programme politico-potager exposé dans Le bain de minuit, dernier manifeste de son père supputatif, alias Mandryka, le révèle entre les signes a posteriori. L'on y découvre en effet les difficultés de l’applicabilité de ses concepts et l'improbable souhaitabilité desdites applications dans le circonstances actuelles du gouvernorat. En clair pour ne prendre qu’un exemple-clef: on a pu constater au vu des Grands Débats et de ce qui n'en est pas ressorti, qu'il ne suffisait pas de dégraisser le glabougnot pour solutionner les problèmes de ladite République. Bref, le concombre et ses alliés objectifs ont momentanément renoncé à faire avancer les Choses en reconnaissant les droits de celles-ci à la libre disposition d’elles-mêmes. Celles-ci ne sont pas pour autant condamnées à subir la tyrannie des Mots qui fait de l’une une cafetière et de l’autre une cruche, mais le Nouvel Ordre promis par Nicolène Sarkoyal les libérera-t-elles de la dictature du signifiant au terme de ce qu’elles ont justement appelé la glute finale ? Tout dépend désormais des vents changeants du Possible. Tels sont aussi bien les constats qui s'imposent à la fois au concombre masqué après la lecture de ce récit initiatique tout dédié à la quête de la Vérité Ultime, censée sortir du bain de minuit, et qui se matérialise sous une forme encore ouverte au prochain débat des militantes et militants. Mandryka signifie assurément, avec l’apparition du Fantasme incarné, en la personne de la craquante Zaza, que la Pin-Up en bikini représente plus que jamais l’Avenir radieux du plombier-zingueur, sans pour autant relancer une forme obsolète de réification machiste de notre amie la femme.
Tels sont aussi bien les constats qui s'imposent à la fois au concombre masqué après la lecture de ce récit initiatique tout dédié à la quête de la Vérité Ultime, censée sortir du bain de minuit, et qui se matérialise sous une forme encore ouverte au prochain débat des militantes et militants. Mandryka signifie assurément, avec l’apparition du Fantasme incarné, en la personne de la craquante Zaza, que la Pin-Up en bikini représente plus que jamais l’Avenir radieux du plombier-zingueur, sans pour autant relancer une forme obsolète de réification machiste de notre amie la femme.
Et Dieu là-dedans ? Paradoxalement, c’est sur cette question que l’examen herméneutique, voire téléologique, du Bain de Minuit, sera le moins en butte au Doute, tant l’Auteur initie une vraie réflexion, et même jette une amorce de fondation en proposant l’instauration d’un nouveau Savoir constitué sur les ruines de l’ancienne problématique, avec la constitution d’une Science des problèmes insolubles en tant qu’entités transcendantales.
Ne mésestimons pas, sœurs et frères, ainsi que nos beaux-parents et voisins de palier, la mise en garde du Concombre: « Dans l’empressement à nous fuir, l’Horizon recule à mesure qu’on avance et l’Avenir est incertain »…
 Mandryka. Le bain de minuit. Dargaud 2006, 56p.
Mandryka. Le bain de minuit. Dargaud 2006, 56p.
-
La fleur des illusions perdues
Sur les traces de Natacha Klimova, condamnée à mort en 1906 pour sa participation à un attentat meurtrier contre Piotr Stolypine, ministre de l'Intérieur, Maud Mabillard, jeune traductrice genevoise établie à Moscou, brosse le portrait épique de cette femme que l’exil fit séjourner en Suisse.
Une lettre extraordinaire, rédigée en prison par Natacha Klimova dans les jours précédant sa pendaison, finalement commuée en réclusion à perpétuité, marque l’ouverture de La Fleur rouge. Les mots incandescents de l’épistolière de 21 ans, fille de l’avocat Serge Klimov, notable de Riazan plutôt ouvert d’esprit, fixent un premier profil de cette idéaliste romantique, qui se dit aussi une «matérialiste pure et dure» sans espérance en aucun au-delà, assumant le choix qui l’a poussée à l’action révolutionnaire, contre la «barbarie» et l’«arbitraire illimité». De la lecture de cette lettre date le début des recherches que Maud Mabillard, passionnée par la Russie depuis un premier séjour en 1992, a consacrées à ce fascinant personnage.
– Qu’est-ce qui vous a attirée en Klimova?
– C’est sa fille Katia, établie à Genève et que j’ai rencontrée dans les milieux russophones, qui m’a confié la fameuse lettre avant de me demander de la traduire. Le personnage de Natacha m’a tout de suite séduite, malgré la gravité de ses actes. J’ai voulu trouver sa vérité à travers l’écheveau des légendes, qui en faisaient soit une héroïne soit un monstre. Ainsi ai-je traqué les faits dans les archives. Même si j’en ai trouvé de nouvelles facettes, mon sentiment à l’égard de Natacha n’a jamais changé. Il y a chez elle à la fois l’exigence de justice et le souci du bonheur. Elle peut être très dure, mais elle est également simple, même naïve au début. Lorsqu’elle écrit la lettre de 1906, elle est sûre de mourir, ce qui lui donne une force incroyable. Celle-ci l’aidera à survivre. Il fallait aussi montrer comment elle a surmonté ses échecs successifs. Je ne voulais pas la juger mais la comprendre. Si elle ne montre pas de regrets par rapport à ses actes, elle est consciente du fait que ça n’a mené à rien.
– Que pensez-vous du lien fait par André Glucksmann entre les islamistes du 11 septembre et les maximalistes?
– J’ai commencé à travailler sur le sujet avant le 11 septembre, donc le terrorisme était moins d’actualité, mais la question de la justification de la violence s’est toujours posée. A vrai dire, les maximalistes ne s’en prenaient pas à un ennemi à abattre, mais aux excès d’un régime répressif. Les terroristes étaient d’ailleurs une minorité. A la même époque, un Tchekhov a parlé des vagues de suicides qui traduisaient le même désespoir.
– Pourquoi Tolstoï, que Klimova n’a fait que lire, joue-t-il un rôle si important dans votre récit ?
– Cela m’intéressait de mettre la violence en rapport avec la non-violence, et aussi de parler du rapport de l’homme avec la nature. Pour Natacha et Tolstoï, ce qui compte est de trouver l’harmonie, avec un besoin ambigu de justice pour tout le monde et de bonheur pour soi. Le paradoxe de Natacha est qu’elle a rêvé toute sa vie de la propriété de campagne de son enfance, qu’elle a contribué à détruire.
– Comment vivez-vous dans la Russie actuelle?
– J’ai peu de recul, puisque j’y suis installée depuis deux ans et demi. C’est un pays difficile, que chaque époque a frappé d’un nouveau traumatisme. Actuellement, il subit la destruction de toutes les structures. A part Moscou qui vit son capitalisme forcené, et certaines villes de province qui s’en sortent bien, c’est un pays sinistré. Du point de vue des personnes, c’est aujourd’hui le règne de l’individualisme, parce que chacun a dû se battre seul pour survivre…Chemin de croix d’une révoltée Natacha Klimova est morte en exil en novembre 1918, à l’âge de 33 ans. On n’en fera pas pour autant une figure christique, et pourtant rien non plus chez elle de la terroriste fanatique ou perverse à la manière des «démons» de Dostoïevski. La figure qui se dégage du récit magnifiquement orchestré (malgré pas mal de lacunes documentaires signalées au passage) d’une vie romanesque à souhait, est celle d’une femme éprise de justice et d’harmonie, dont l’adhésion initiale à l’Organisation de combat des socialistes-révolutionnaires relève plus de la foucade de jeunesse que du plan réfléchi. On pense aux contestataires et autres activistes des années 60-70 en découvrant les camarades de Natacha, dont le flamboyant Michel Sokolov, dit l’Ours, qui semble avoir été le premier grand amour (mais peut-être chaste ?) de Klimova l’idéaliste. Ce qui est sûr est qu’elle l’assista dans la préparation de l’attentat meurtrier de 1906 contre Piotr Stolypine, qui fit une trentaine de morts (dont les deux jeunes ouvriers kamikazes qui lancèrent les bombes sur les lieux, selon le plan de l’Organisation), sans abattre le ministre de l’Intérieur. Marquée à jamais par une enfance édénique dans une propriété de campagne dite La Métairie, et portée par le désir d’améliorer la condition de son peuple en véritable institutrice tolstoïenne, Natacha Klimova dit avoir découvert SA vérité à la veille de son exécution, comme ce fut le cas pour Fédor Dostoïevski, ainsi que le montre Léon Chestov dans Les révélations de la mort. Or survivre lui sera d’autant plus pénible, mais on sent que cette première épreuve, en attendant celles de la prison, aura blindé la toute jeune fille. La prison justement, une évasion rocambolesque bénéficiant de la complicité d’une geôlière de mélodrame, un immense périple à travers le désert dont le peu de traces qu’il a laissé a nourri maintes suppositions (le personnage de Klimova a également passionné le grand écrivian Michel Ossorguine, auteur d’Une rue à Moscou), quelques années en Suisse – où elle vécut comme la plupart des Russes exilés, de Dostoïevski à Lénine ou Nabokov, c’est à savoir en vase clos, deux filles dont l’aînée retourna en Russie, telles sont les stations de ce chemin de croix retracé par Maud Mabillard, avec le contrepoint constant du récit des dernières années d’un Tolstoï désespérant, de son côté, de ne pouvoir endosser la misère de son peuple…
Maud Mabillard. La Fleur rouge ; Natacha Klimova et les Maximalistes russes. Editions Noir sur Blanc, 294p.
Cet entretien a paru dans l'édition de 24Heures du 10 avril 2007. Maud Mabillard est présente au Salon du Livre de Genève, où les éditions Noir sur Blanc fêtent leurs 20 ans.
-
Les anges de la dèche
Le Paradis des chiots de Sami Tchak, Prix Kourouma 2007.
Avec son cinquième roman, Le paradis des chiots, consacré à Genève par le Prix Kourouma 2007, Sami Tchak donne une polyphonie à trois voix alternées qui marque une avancée importante dans son art de prosateur. D’emblée, par la voix du petit Ernesto, dont la mère vend ses charmes pour survivre, l’écrivain nous plonge dans l’univers à la fois cruel et débordant de vitalité d’une favela sud-américaine, qui a valeur de symbole universel. C’est en effet aux enfants des Damnés de la terre, pour rappeler le titre de l’essai polémique de Frantz Fanon, que l’on pense en lisant ce livre foisonnant dont l’écriture très rythmée, célinienne sur les bords, saisit par sa musicalité et sa puissance expressive.
- Que représente Ahmadou Kourouma pour vous ?
- Lorsque j’ai lu Le soleil des indépendances, j’ai été frappé par sa langue si expressive et si nourrie par notre culture africaine, qui « travaille » la langue française comme je voudrais la travailler. Par ailleurs, il y a un lien de filiation entre mes personnages et les enfants-soldats d’Allah n’est pas obligé, qui remonte aussi à l’enfant de La vie devant soi de Romain Gary, que je citais dans mon premier livre
- Quelle a été la genèse du Paradis des chiots ?
- A l’origine, c’est un travail avec l’artiste colombienne Constanza Aguirre, qui m’a poussé à me plonger, sur place, dans l’enfer d’El Paraìso, un quartier de la périphérie de Bogota dont j’ai rencontré longuement les bandes. J’ai pu fréquenter ces quartiers très dangereux grâce à mon statut personnel d’Africain au visage scarifié, qui leur apparaissait comme un semblable dont il était difficiel de tirer une rançon…
- Pourquoi le roman plutôt que l’étude du sociologue ?
- De la sociologie, mon travail n’emprunte que l’ « observation participante ». Sinon, ce que je voudrais exprimer, au-delà de tous les reportages qui ont été réalisés sur la terrible réalité des gosses de la rue, c’est l’extraordinaire soif de vie que montrent ces enfants, même s’ils ont peu de chance de survivre longtemps. Il y a aussi chez eux de l’amour, de la tendresse, des règles de fidélité qui se recomposent malgré la violence des relations. Or tout cette vie se traduit par le langage, que je m’efforce de restituer à ma façon, pour rappeler aussi que la dèche des enfants est partout pareille, et que la littérature peut l’exprimer par transfert d’émotion.
- Que pensez-vous du nouveau concept de la « littérature-monde » ?
- J’ai d’abord pensé que cela pouvait être intéressant, par rapport au centralisme parisien. Mais je me dis que la littérature véritable a toujours été « le monde », que ce soit le Dublin de Joyce ou Le Caire de Mahfouz. Je me demande en outre si ce manifeste ne cherche pas à pallier le fait qu’actuellement aucune grande voix ne se fait entendre en langue française, qui soit comparables à celles d’un Naipaul, d’un Coetzee, d’un Salman Rushdie ou d’un Philip Roth ?
Propos recueillis par J.-L.K.
Sami Tchak. Le paradis des chiots. Mercure de France, 222p.
Portrait de Sami Tchak: Florian Cella.
Cet entretien a paru dans l'édition de 24Heures du 5 mai 2007.
-
Un lecteur à Lausanne
Vient de paraître aux éditions Bernard Campiche,
Impressions d’un lecteur à Lausanne
Si Lausanne ne fut jamais vraiment un haut-lieu de littérature, la capitale vaudoise n’en a pas moins été, du Moyen Age à nos jours, le cadre d’une activité constante de l’édition et de la vie littéraire, avec des échappées sur l’Europe entière.
Qualifiée de « petite Athènes du nord » au temps de Voltaire, notre ville vit naître au début du XXe siècle, avec C.F. Ramuz et les Cahiers vaudois, une littérature romande à part entière marquée par la triple influence de la Réforme, du romantisme allemand et du goût français. Les grandes aventures de la Guilde du Livre et de Rencontre, avant l’essor impressionnant de l’édition romande dans les années 60, ont permis à plusieurs générations d’écrivains de s’exprimer et de trouver un public.
Après une évocation de Lausanne à travers ce que les écrivains en ont écrit, un portrait caustique de l’âme romande, un bref aperçu de chaque époque et un hommage aux artisans et passeurs du livre, ces Impressions d’un lecteur à Lausanne invitent à la découverte plus détaillée des œuvres contemporaines foisonnant à l’enseigne de la « seconde jeunesse » annoncée.
Infos et commandes : http://www.campiche.chJLK signe ses livres au Salon du livre de Genève, les après-midi, jusqu'au 6 mai. Le Passe-Muraille nouveau y est également présent.
-
Un héros sans arme
Carnets de guerre de Vassili Grossman
L’image contemporaine du Héros à l’occidentale est essentiellement celle d’un prédateur bodybuildé, sans états d’âme et surarmé, incarnant le summum de la Technique à tous égards. Or c’est exactement l’opposé de ce Superman que représentait le Juif bedonnant et binoclard Vassili Grossman lorsque, en 1941, il fit des pieds et des mains pour entrer dans l’Armée rouge. Originaire de Bertitchev en Ukraine, où sa mère allait être massacrée lors d’une des Aktionen des SS que décrit Jonathan Littell au début des Bienveillantes, Grossman, chimiste de formation, avait un début de notoriété comme écrivain, après la publication de deux premiers romans de type « réaliste-socialiste» mais où transparaissaient déjà ses grands dons littéraires et son humanité, qui lui valurent notamment l’admiration de Mikhaïl Boulgakov. Cette renommée lui valut, après avoir été déclaré absolument inapte au service, d’être intégré à l’armée au grade de maréchal des logis, en tant que correspondant de guerre du journal Krasnaïa Zvezda (L’étoile rouge), dont il devint rapidement l’un des rédacteurs les plus populaires. Lorsqu’y parut, en feuilleton, son roman de guerre intitulé Le peuple est immortel, au début de l’année 1942, l’ouvrage fut déclaré le plus véridique par les « frontoviki », soldats du front qu’il savait écouter comme personne d’autre.
Dans son introduction aux Carnets de guerre de Grossman, dont il a choisi les textes en compagnie de Luba Vinogradova, l’historien Antony Beevor dresse un premier portrait du Grossman de trente-cinq ans et détaille plus précisément sa méthode de travail, consistant essentiellement à faire parler les gens et à les écouter, du plus haut gradé au dernier des troufions, en passant par les prisonniers et les civils des campagnes dévastées et des villes en ruines. Après avoir passé à travers les purges staliniennes d’avant la guerre, Vassili Grossman fut le témoin le plus longtemps en poste de la bataille de Stalingrad, dont il imaginait naïvement qu’elle marquerait le grand tournant préludant à une renaissance de l’Union soviétique débarrassée du despotisme. Profondément humilié par la terreur stalinienne, qui fut fatale à divers de ses proches et à laquelle, Juif non affilié au Parti, il échappa, Grossman manifestait une honnêteté dérangeante, qui filtre à chaque page de ses carnets. « Si la police secrète du NKVD avait lu ces carnets, écrit Beevor, il aurait disparu au goulag ». Mais le fluet preneur de notes, sans arme jamais que son stylo, traversa la guerre en ne cessant d’y observer les hommes, apprit en 1944 dans quelles circonstances affreuses sa mère avait été exécutée en parvenant avec l’armée à Berditchev, fut l’un des premiers correspondants à entrer dans les camps libérés de Maïdanek et de Treblinka, enfin assista à la chute de Berlin marquée par des viols massifs d’Allemandes qui l’indignèrent
La matière de ces Carnets fut essentielle, on s’en doute, à la préparation du chef-d’œuvre de Vassili Grossman, Vie et destin. Leur lecture est à la fois prenante, sans discontinuer, tant l’écrivain est précis et prodigue de détails significatifs ou révélateurs, jusque dans la dinguerie surréaliste de la guerre, bouleversante aussi par son constant souci de justice et de justesse, autant que par sa chaleur dénuée de toute emphase sentimentale. On s’en doute : Vassili Grossman est aussi loin de Max Aue, le narrateur des Bienveillantes, qu’il se puisse imaginer, et pourtant l’éclairage qu’il donne, avec de multiples recoupements chronologiques, sur les mêmes péripéties - du martyre des Juifs ukrainiens à Stalingrad, et jusqu’aux camps de la mort et à l’effondrement du Reich – apporte un complément historique et humain inappréciable à la connaissance de ces événements du point de vue russe, autant que ses carnets documentent la genèse de Vie et destin.Vassili Grossman. Carnets de guerre. De Moscou à Berlin (1941-1945). Textes choisis et présentés par Antony Beevor et Luba Vinogradova. Calmann-Lévy, 390p.
-
Un passeur d'énergies
Souvenirs d'un ami, par François Debluë
Comme pour beaucoup d’autres, Georges Haldas aura été pour moi un extraordinaire passeur d’énergies. De combien de rencontres où je m’étais rendu d’humeur sombre ou maussade ne suis-je pas revenu vivifié, ressourcé, étonné d’avoir découvert de nouveaux territoires, de nouvelles raisons d’être – et impatient de me mettre au travail !
Je n’avais pas vingt ans; Haldas venait de franchir ses cinquante ans. Avec une passion contagieuse, engagé qu’il était dans l’aventure de vivre et d’écrire (ce qui ne faisait qu’un), le poète, le prosateur et l’infatigable lecteur que je rejoignais le plus souvent à Genève me révélait des continents entiers : ceux des littératures russe, espagnole, italienne ou américaine, où l’air et l’esprit circulent plus au large que chez les seuls français auxquels l’école et l’académie nous confinaient d’ordinaire.
Au-delà de ces littératures, pourtant, non pas contre elles mais avec elles, c’est le monde même que l’écrivain m’appelait à interroger : ses enjeux politiques, sociaux et spirituels, collectifs aussi bien qu’individuels.
Dans le même temps, c’était son œuvre qu’il m’était donné de découvrir. Ses premiers recueils poétiques, comme aussi, à une époque où il n’avait pas encore publié ses Carnets de L’Etat de Poésie, ses premières « chroniques », celles qui devaient me toucher le plus, de Gens qui soupirent, quartiers qui meurent au Livre des Passions et des Heures, en passant par Boulevard des Philosophes, Jardin des Espérances, La Maison en Calabre, Chute de l’Etoile Absinthe et Chronique de la Rue Saint-Ours. Un monde était en train de naître, des livres où se manifestaient une voix nouvelle et un regard d’une exceptionnelle acuité, à la faveur d’une forme profondément originale.
À ces chroniques, je choisissais bientôt de consacrer une première synthèse (dont Jacques Mercanton avait accueilli généreusement le projet). La prose de Haldas n’était pas toujours appréciée : elle dérangeait les conventions ; sa fécondité même paraissait suspecte ; elle se heurtait au scepticisme, aux réticences et aux silences de certains critiques bien-pensants. Pour moi, l’enjeu en était vital. Ces livres me révélaient à moi-même, angoisses, tourments et émerveillements, ils éclairaient mon chemin.
Loin des bibliothèques (que je fréquentais d’ailleurs assidûment), loin surtout de certains laboratoires formalistes et sectaires, nos soirées étaient aux « petits établissements » de Genève, dont Georges Haldas connaissait par cœur la géographie. Nous mangions d’incomparables entrecôtes mexicaines, buvions quelque savoureux chiroubles, et Georges Haldas, devenu Georges (mais toujours nous nous serons vouvoyés) m’accordait le plus précieux : son temps, son amitié, sa confiance. Mes premiers livres devaient ainsi paraître à l’enseigne de la collection du « Rameau d’Or » dont Vladimir Dimitrijevic lui avait confié la responsabilité aux éditions de l’Âge d’Homme.
Georges Haldas me parlait de ses travaux en cours ; plus allusivement (parce qu’il ne fallait pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué) de ses projets ; de ses lectures. Depuis longtemps, il interrogeait la Bible, le Don Quichotte (ô combien j’aurais souhaité qu’il écrive l’essai dont il me parlait à son sujet !), Homère et les tragiques grecs. Baudelaire, Charles-Louis Philippe, Léon-Paul Fargue, bien d’autres encore, lui étaient des compagnons de vie. Tous lui donnaient ce « courage d’être » dont avait parlé le théologien Paul Tillich. Et ce même courage, sans le savoir peut-être, Georges me le transmettait à son tour. Malgré les doutes, les gouffres, les vertiges – à leur mesure même – la vie reprenait sens ; du moins, la nécessité s’imposait de lui en trouver un. Dire, comme André Breton, que la vie est à « repassionner » ne suffisait pas : elle était urgence et passion !
Dans les rues de Genève, la nuit depuis longtemps venue, nous évoquions Rousseau, Amiel, Tchekhov, Kafka, Reverdy, mais aussi Jean Vuilleumier, notre contemporain, devenu si proche à son tour. D’autres de nos contemporains avaient droit, il est vrai, à quelques féroces et joyeuses méchancetés dont nous savions assez le peu de fondement et la parfaite gratuité. Revenu à plus de gravité, Georges me faisait parler de Proust et de Céline, dont il évitait la lecture : leur fréquentation aurait sans doute interféré avec sa propre écriture. C’est que Georges Haldas est un styliste ; il est de ceux, somme toute très rares, qui se trouvent une voix, un rythme, des inflexions à quoi on les reconnaît désormais sans hésiter.
Mais nous nous relayions alors, dans les rues maintenant presque désertes, pour évoquer tel passage d’Apollinaire :
Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir…
L’heure était à la mélancolie. La voix chargée d’émotion, dans l’impératif et tenace élan de vie qui n’a cessé d’être le sien en dépit des épreuves, Georges me récitait un poème des « Amis inconnus » de Supervielle :
On voyait le sillage et nullement la barque
Parce que le bonheur avait passé par là.
Je me méfiais, je me méfie encore de ce mot « bonheur ». Il m’a toujours paru imprudent sinon indécent de le prononcer, au risque de le compromettre immédiatement.
Aux côtés de Georges Haldas pourtant, je savais pouvoir partager quelque chose qui n’en devait pas être trop éloigné. Un élan. Une présence. Un amour du monde. Comme une intuition de cela même qui nous habitait et nous dépassait.
Je n’ai plus vingt ni trente ans. Le sillage ne s’est pas effacé pour autant. Ce que j’ai reçu continue de vivre en moi. Pour cela, cher Georges, je vous demeure à jamais reconnaissant.
En 1973, François Debluë proposait une première synthèse intitulée Les Chroniques de Georges Haldas, une œuvre au cœur de la relation. Plus tard, outre divers articles, il a dirigé et publié, en collaboration avec Jean Vuilleumier et Vladimir Dimitrijevic, un recueil d’essais et de témoignages sous le titre À la rencontre de Georges Haldas (L’Âge d’Homme, 1987). Poète et prosateur, lauréat du Prix Schiller 2004 pour l’ensemble de son œuvre, François Debluë a publié récemment Conversation avec Rembrandt (Seghers, 2006). -
Nous autres périphériques

La littérature-monde, et après?
Une quarantaine d’écrivains francophones de diverses provenances, emmenés par Michel Le Bris et Jean Rouaud, ont signé en mars dernier un manifeste prônant la «littérature-monde en langue française», qu’illustrera un recueil de textes à paraître à l’occasion du prochain Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo.
Que dit ce manifeste? Qu’il n’est pas de bon bec que de Paris. Que l’institution de la francophonie se ressent de relents colonialistes en ce qu’elle «parque» les francophones dans leurs territoires respectifs. Que la littérature française n’a pas à intégrer ses périphéries mais à s’intégrer elle-même dans l’ensemble des littératures francophones et de toutes les langues.
Tout cela semble bel et bon, et notamment pour ceux qu’impatiente la sempiternelle condescendance de la France à l’égard des francophones.
Méfions-nous, cependant, de ce que le concept de «littérature-monde» pourrait avoir à son tour de réducteur ou de trop opportun pour certains. Enracinés et déracinés ont également droit de cité dans la littérature, qui ne gagne pas à se diluer dans un magma, comme il en a été de la «world music»…
Si la «littérature-monde» contribue à la meilleure circulation des œuvres, alors qu’elle vive et nous autres Romands la défendrons les premiers. Mais gare à la nouvelle mode, gare à la dernière toquade… parisienne.
Ce texte constitue l’éditorial de la dernière livraison du Passe-Muraille, No 72, Mai 2007. Commandes : Le Passe-Muraille, Case Postale 1164, 1001 Lausanne -
La passion du réel

Lecture d’ Un Roman russe d’Emmanuel Carrère, par Antonin Moeri
L'entame du livre est canon. Soutenu dans une posture acrobatique par celle qu'il aime, le narrateur pénètre une Japonaise dont le mari fait remarquer, après les transports de jouissance de Madame Fujimori, que le train n'avance plus. Il s'agit d'un rêve mais le train, lui, est bien réel. Il est arrêté quelque part entre Moscou et Kotelnitch, un trou de la Russie profonde où le héros va tourner un film avec son équipe de télévision pour échapper aux "histoires de folie, de gel et d'enfermement" qui l'ont chaque fois laissé exsangue. Pourtant, il racontera dans ce film l'histoire d'un Hongrois qui, capturé par les Russes à la fin de la seconde guerre, aura passé plus de cinquante ans enfermé dans un asile psychiatrique à Kotelnitch.
Cette enquête débute avec la consultation du dossier médical, la visite de la menuiserie où Andras Toma travaillait et du pavillon où il a passé plusieurs décennies. Le destin de cet Hongrois intéresse beaucoup Emmanuel Carrère car il lui rappelle celui de son grand-père maternel, disparu à Bordeaux en septembre 1944, qu'on n'a jamais revu et dont la mère de l'écrivain, Madame Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie Française, eût préféré qu'on ne révélât pas l'existence. L'histoire "honteuse" de Georges Zourabichvili forme la seconde trame du livre. Sans doute la plus passionnante, la plus bouleversante: une manière d'exorcisme.
Emigré géorgien arrivé en France sans le sou en 1925, il écrit d'interminables lettres d'amour, lit des livres, ne s'occupe pas de sa fille, admire Mussolini et Hitler, déteste la petite-bourgeoisie, le parlementarisme et l'Amérique. Sa qualité d'homme cultivé éveillera le respect des Allemands occupant la France. Il travaillera pour les services économiques allemands. On l'enlèvera sur dénonciation et plus personne ne le reverra. La rumeur en fera un collabo. On racontera au petit Emmanuel qu'il est parti pour un long voyage. Partout dans le monde s'établira la seule vérité: les résistants sont des héros, les collabos des salauds. Il faudra se taire. Se résigner. Remâcher sa honte.
Une étrange histoire d'amour forme la troisième trame. Celle que le narrateur aime, Sophie, souffre des longues absences de son écrivain-cinéaste chéri. Elle hésite. Que préfère-t-elle? Partir avec Arnaud dont elle est sûre qu'il l'aime mais qu'elle n'est pas sûre d'aimer? Ou rester avec Emmanuel qu'elle est sûre d'aimer sans être sûre qu'il l'aime? Comment sortir de ce dilemme? Emmanuel décide alors d'écrire un conte érotique que Sophie devra lire dans le train quand elle viendra le retrouver à La Rochelle au mois de juillet. Il lui demande, dans ce texte écrit pour les 600.000 lecteurs du Monde, d'imaginer son sexe palpitant, l'ouverture des lèvres quand ses doigts caressent longuement le clitoris dans la chaleur du souffle qui s'emballe. Il imagine le regard des lectrices du Monde sur Sophie. L'une d'elle disparaît aux toilettes pour se branler et voir dans le miroir ses doigts glisser entre ses lèvres trempées.
Le lecteur a le sentiment, au terme de ces trois"intrigues" habilement entrelacées, que le piège se referme sur le narrateur. "L'histoire de folie, de gel et d'enfermement" à laquelle il voulait se soustraire en aimant une femme d'un milieu social plus modeste que le sien, en poursuivant son apprentissage du russe, en retournant vers ses "origines", en réalisant son film dans un trou de la Russie profonde, en lisant attentivement les lettres de Georges Zourabichvili que son oncle lui a remises, on pourrait dire que cette histoire de bruit et de fureur l'a rattrapé. Si le réel ne se réduit pas à la réalité mais se conçoit dans son extrême violence comme ce qui reste après qu'on a dépouillé la réalité de son écorce trompeuse, on pourrait alors dire que le réel a rattrapé le fils à maman.
Mais en tentant le diable, en violant un secret de famille, en dévoilant sa propre intimité, en rejetant l'injonction maternelle ("je te demande de ne pas toucher à mon père"), en écrivant Un roman russe et, surtout, en décidant de le publier, le fils à maman accède à un autre statut: il devient celui de sa mère. A ce jeu, l'enfant qui"boude et qui attend qu'on le console, qui joue à haïr pour qu'on l'aime, à quitter pour qu'on ne l'abandonne pas", cet enfant impose sa couronne d'épines, occupe le devant de la scène, règne en souverain blessé. Il prend une sorte de revanche, même si les mots dont il"dispose ne peuvent servir à dire que le malheur".
Dans une lettre saisissante à sa mère, le narrateur revendique sa propre place d'écrivain. Maman eût préféré qu'il devînt un écrivain « heureux »du genre Erik Orsenna. Il n'a pas eu le choix. Heureusement pour nous. L'horreur et la folie, il devait les endosser. IL est devenu JE: "L'horreur et la folie, je les ai dites".
Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L.Ce texte a paru dans la dernière livraison du Passe-Murraille, No 72, Mai 2007. Commandes : Le Passe-Muraille, case Postale 1164, 1001 Lausanne.
-
Le saisissement du monde

Hommage à Ryszard Kapuscinski, par René Zahnd
Dans les années 50, un journaliste débutant – on pourrait l’appeler K – parcourt les régions de son pays natal, la Pologne. Dans ses reportages et comptes-rendus, il témoigne de la réalité qu’il observe : la vie des campagnes, les difficultés d’approvisionnement, les questions propres à l’agriculture, l’existence telle qu’elle se déroule au jour le jour, alors que fument encore les décombres de la guerre et que les Soviets consolident leur empire. Mais en secret, le jeune homme rêve de passer la frontière : d’aller voir de l’autre côté. Et justement un beau jour, sa rédactrice en chef l’envoie non pas en Tchécoslovaquie ou en Hongrie mais… en Inde ! Pour guide, elle lui offre les Histoires d’Hérodote, inusable manuel du pèlerin qui cherche à s’approcher des secrets enfouis dans les plis de la réalité.
Aussitôt K part. Lui qui n’a jamais franchi les limites de son pays, il prend de plein fouet le séisme de l’altérité, est choqué, désarçonné, ébloui, frustré et finalement conforté dans sa vocation : se lancer sur les routes, les pistes, les voies maritimes et aériennes, les sentes de traverses, les tracés ferroviaires et tenter le saisissement du monde. « Le voyageur est en effet contaminé par le voyage, une maladie pratiquement incurable », a-t-il écrit un demi-siècle plus tard, peu de temps avant son dernier départ, franchissant en janvier 2007 une frontière plus improbable que toutes les autres.
L’Inde, la Chine de Mao, l’empire du Négus, le Congo du Cœur des ténèbres, l’Amérique latine, l’Iran du Shah, puis l’Afrique kaléidoscopique sont les territoires où il s’aventure, autant à la quête des autres que de lui-même. Jamais il n’oublie le maître qui lui parle du fond de son antiquité. « C’est pourquoi, fort de sa découverte selon laquelle la culture d’autrui est un miroir permettant de se contempler afin de mieux se comprendre, chaque matin, inlassablement, toujours et encore, Hérodote reprend son bâton de pèlerin. »
 Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles.
Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles.
Aujourd’hui, il nous reste de lui quelques livres, concentrés cristallins des centaines d’articles parus dans la presse (en français notamment dans Le Monde diplomatique). Ebène est sans doute la meilleure introduction à l’Afrique contemporaine écrite par un Occidental. Mes voyages avec Hérodote a la force d’un testament philosophique, qu’on pourrait qualifier d’extraordinairement humaniste, si ce dernier terme n’était souillé par mille gâte-sauce de la pensée.
En lisant K, alias Ryszard Kapuscinski, on a l’impression d’être attablé au bistro, en face de quelqu’un qui te raconte ses voyages, qui en quelques minutes te fait comprendre le génocide du Rwanda ou le fondement historique des déchirements du Libéria. On le sent constamment poussé vers l’autre, curieux, intrigué, se défiant des apparences.
Le désir du monde est peut-être la forme suprême de l’égoïsme. Mais aussi, sans le moindre doute, la plus belle : « L’homme qui cesse de s’étonner est un être creux, son cœur est calciné. L’homme qui considère qu’il est arrivé au bout du chemin, que plus rien ne peut le surprendre, a perdu le joyau de la vie, sa beauté. »
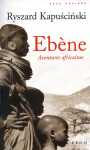 Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)
Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)
Ce texte a paru dans la dernière livraison du Passe-Muraille, No72, Mai 2007. Commandes : Le Passe-Muraille, Case Postale 1164, 1001 Lausanne. -
Et la beauté légère...

Proses inédites de Marc Tiefenauer
Cinquante
Dans le stéréoscope de bakélite j’aperçois Grace Kelly
tellement belle puis monégasque et d’une pression de
l’index défilent des hauts-de-forme et des marins
endimanchés des officiers un peu glamour puis plus du
tout comme ce trou dans l’océan Bikini Test et l’atoll
est foutu les îles Marshall c’est pas Monaco on oublie la
bombe H mais pas Marilyn si blonde en épousant
Miller communiste peut-être quand la Granma accoste
à Cuba à bord Castro et Guevara ils en ont marre
comme Ambedkar et trois cent mille Mahars néobouddhistes
nés intouchables ça en jetait en cinquantesix
mais toi t’es là bien plus qu’Elvis que Mendès
France et les souverains de bakélite.
Coupe du monde
Tout le monde attend. Presque tous. Ce soir ce sera le
ballon la boule à faire tourner le monde tout le monde
dans l’extase de la sphère. Comme un devoir de ne pas
manquer ce rond dans ce rectangle-là. Maillots drapeaux
calicots et masses humaines pressées au bord de l’herbe
des téléviseurs. La messe cathodique ce soir le culte
profane des forces populaires. Ce soir vous allez voir ils
peuvent courir la Terre tourne en rond et rien ne roule
en ville les rues seront vides. Les chaînes télévisées nous
enfermeront impossible d’y échapper. Enfer ce soir
pour qui sort la tête la coupe du monde est annoncée.
Au sol aimé
Au sol aimé les pieds des femmes flattent la rue la
malmènent des talons promenés cliquetants. Au bal des
dactylos les jambes se croisent les yeux touchent les
cuisses du bout de la langue. Les seins balancent entre
les hommes ballants contemplant le rythme des corps.
Gravité tout de même. Impassibles les hommes fascinés
assistent à leurs rêves projetés par-devant eux. L’ombre
est complice quand elle complique l’entr’acte des murs
entre deux salves de chairs. Vivement l’hiver. Après
tout non le supplice est gourmand et la beauté légère
qui cadence les sèves à fleur de goudron.
Au sol mariné
Au sol mariné le pollen fond de teint voile puis dévoile
les pas. Du lac le vent lève une brume qui suit la rue
blonde sur ses rives où l’asphalte est ridé. Au bord de
l’arrêt le goudron se plisse le bus s’en approche ballotte
le long du quai granitique. La nuit reflue. Les jambes
embarquent les mains s’accrochent à l’inox tango des
corps cahotés ondulant sur l’essieu. Les vitres vibrent le
bus crache le flux s’ouvre et la caravane dépasse l’îlot
arrêté parmi les phares. Mais le convoi s’échoue
baleinier au carrefour sous les feux pollinisés.
Marc Tiefenauer est né à Lausanne en 1973. Licencié en lettres indiennes et orientales. Rédacteur publicitaire. Auteur de poèmes, récits fantastiques, textes sur Internet, et traduit des nouvelles anglophones. Anime le site http//:www. rimeur.net.
Ces proses inédites ont paru dans la dernière livraison du Passe-Muraille, No 72, Mai 2007. Commandes: Le passe-Muraille, Cas Postale 1164, 1001 Lausanne. -
La Russie passe par la Suisse

SALON DU LIVRE La grande nation restaurée présente sa production à Palexpo-Geneva, du 2 au 6 mai, reflétant une réalité en mutation, et quelques-uns de ses auteurs. Dont Mikhaïl Chichkine, auteur de La Suisse russe, passionnante chronique à la mémoire de nos chers hôtes villégiateurs, révolutionnaires ou exilés…
Deux tombes majestueuses voisinent au cimetière de Clarens, où reposent Vera et Vladimir Nabokov, l’un des écrivains les plus géniaux du XXe siècle, et, d’autre part, le grand peintre Oskar Kokoschka. A un coup d’aile de pigeon de là : le château de Chillon fut le lieu de pèlerinage de moult Russes cultivés, où Gogol grava son nom. Dans un parc de Montreux, la statue pensive de Stravinsky rappelle sa collaboration avec Ramuz pour L’Histoire du soldat, dont il écrivit la musique à Lausanne. Or c’est à Lausanne, aussi, où séjournèrent le compositeur Scriabine, le philosophe Léon Chestov et le chorégraphe Diaghilev, entre autres, que parurent deux livres majeurs de l’époque soviétique : Vie et destin de Vassili Grossman, chef-d’œuvre échappé aux pattes du KGB et publié à L’Age d’Homme, comme Les Hauteurs béantes d’Alexandre Zinoviev, retourné en Russie où il est mort l’an dernier.
 « Les rives des lacs alpins fourmillent d’ombre russes », écrit Mikhaïl Chichkine dans l’introduction de La Suisse russe, formidable ouvrage qui vient de paraître en traduction, évoquant, avec autant de chaleur érudite que de piquant, plus d’un siècle de relations vives (de pâmoisons devant la nature en bâillements d’ennui) entre les Russes et notre pays.
« Les rives des lacs alpins fourmillent d’ombre russes », écrit Mikhaïl Chichkine dans l’introduction de La Suisse russe, formidable ouvrage qui vient de paraître en traduction, évoquant, avec autant de chaleur érudite que de piquant, plus d’un siècle de relations vives (de pâmoisons devant la nature en bâillements d’ennui) entre les Russes et notre pays.
Des voyageurs romantiques de la fin du XIXe siècle à l’exil médiatisé de Soljenitsyne, en passant par le transit des révolutionnaires (le terroriste Netchaïev, le prince anarchiste Bakounine et Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine), la Suisse a vu passer – même s’ils restaient souvent en cercles fermés – les plus illustres auteurs russes, de Dostoïevski, claquant l’argent de son pauvre ménage au casino de Saxon-les-Bains, au jeune Tolstoï ou au théosophe Andrèi Biély, entre cent autres qui ne virent pas tous, comme un Nabokov, la copie du profil de Pouchkine dans le nez du Matterhorn…
Mikhaïl Chichkine, qui se définit comme « un écrivain russe résidant à l’étranger », établi à Zurich depuis 1995 mais également reconnu dans son pays (lauréat du Booker russe, notamment), fait partie de la délégation d’une quinzaine d’auteurs présents au Salon du livre, aux côtés de quelques écrivains déjà connus des lecteurs francophones, tels Andréi Guélassimov, auteur de La soif et de L’année du mensonge, publiés chez Actes-Sud, Olga Slavnitkova, présente chez Gallimard avec L’homme immortel, ou encore Valéri Popov dont l’attachant Troisième souffle a paru chez Fayard en 2005.
Si les récits de voyageurs russes en Suisse réduisent souvent notre pays à des clichés éculés, l’inverse est avéré, ainsi que le remarquait récemment, dans un entretien avec RIA Novosti, la romancière Olga Stolnikova, déplorant que « toute information véridique sur la Russie ne puisse être que négative». Cela étant, nous pourrions objecter que la vérité de la littérature ne consiste pas forcément à « positiver » et que les meilleures preuves en sont données par deux ouvrages récents, toniques en dépit des dures réalités qu’ils reflètent : les extraordinaires Carnets de guerre de Vassili Grossman, et, passionnante satire de science-fiction politico-historique dont les outrances « pornographiques » lui ont valu un procès et l’opprobre des jeunesses poutinienne : Le Lard bleu de Vladimir Sorokine, enfant terrible de la nouvelle littérature russe dont la réflexion grinçante qu’il propose sur l’utilisation des écrivains par le Pouvoir est aussi à l’honneur de la littérature russe…
Mikhaïl Chichkine. La Suisse russe. Traduit du russe par Marilyne Fellous. Fayard, 516p.
Vassili Grossman. Carnets de guerre ; de Moscou à Berlin, 1941-1945. Calmann-Lévy, 390p.
Vladimir Sorokine. Le lard bleu. Traduit du russe par Bernard Kreise. L’Olivier, 417p.
Cet article a parudans l’édition de 24 Heures du 1er mai 2007