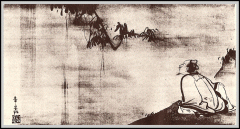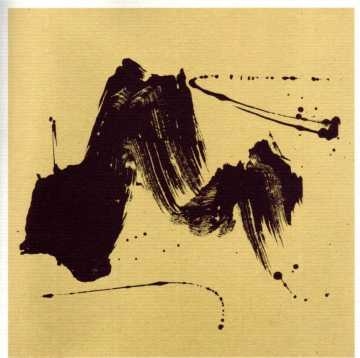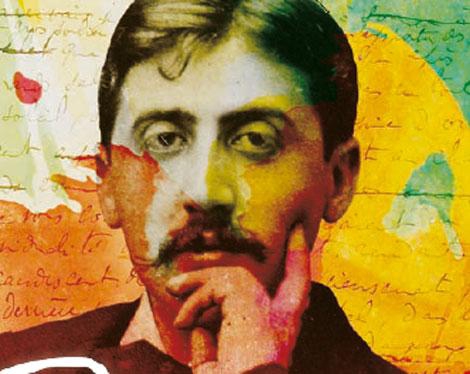Passé et présent des jours à venir
Ces derniers mots que j’écris seront-ils jamais lus ? J’allais écrire que je n’en ai cure, et puis non : je vais plutôt écrire que j’en ai grand souci, et même que sans cela je n’écrirais pas.
Cependant il y avait du vrai dans ma première impulsion de noter que je n’avais cure d’être lu, comme si ça ne me regardait pas, ou que je n’y pouvais rien.
Ce qui est vrai est que je ne cherche pas à être lu, tout en n’écrivant que pour ça, et ces derniers mots seront comme les premiers que j’ai écrits avec cette même intention il y a, je ne sais pas: cinquante ou soixante ans, lorsque j’ai commencé de noter justement ceci ou cela.
J’ai connu, entre seize et vingt ans, dans les années 60 du vingtième siècle, ce temps où le fait d’écrire, dans le pays et le milieu où je me trouvais, était considéré avec une attention particulière, nuancée d’une espèce de respect parfois un peu méfiant, comme il en allait de toute activité artistique. «Ah bon, vous écrivez ?» Et l’on sentait qu’à cette question en pendait une autre qui se voulait plus sérieuse : « Et à côté ? »
Or je ne considérais pas, pour ma part, qu’écrire fût une activité vraiment centrale, moins encore sacrée, et me satisfaisais en somme du fait d’écrire à côté ; mais je constate pourtant, aujourd’hui que de toute ma vie je n’aurai fait qu’écrire à côté, ou plus exactement que j’aurai fait de cet «à côté» le centre et le noyau vital de ma vie.
Je me souviens des derniers jours où mon père se réjouissait encore de pouvoir faire le tour de son jardin, et de sa résignation, plus tard, en constatant qu’il n’en aurait plus la force; mais celle d’écrire me reste encore, et de passer peut-être, comme on dit, le témoin.
Le seul mot de jardin me rappelle un monde, et je revois mon père, en chemise allégée, y retourner la terre pour y établir des carreaux de légumes ou de fleurs, et retirer un jour de la terre un crâne, puis divers os blancs qu’il déposa sur le gazon proche.
La terre de notre jardin provenait en effet d’un cimetière excavé à l’autre bout du quartier de ces hauts de la ville de Lausanne, là-bas juste en dessous du Colisée, le cinéma où je ferais office de placeur en mes années de prime jeunesse – autre jardin d’images ouvrant d’autres fenêtres sur le monde ; et mon père de confier alors le crâne à notre frère aîné, lequel s’empressa d’en faire une figure d’effroi au fronton du poulailler familial, gageant que Maître Renard en serait écarté pour jamais.
Premier jardin du monde, aujourd’hui cerné de béton, mais que ces derniers carnets, sixième volume publié depuis l’an 2000, à l’enseigne de mes Lectures du monde, voudraient une fois encore évoquer comme le milieu affectif, tellurique et poétique d’un monde, non pour l’idéaliser: plutôt afin de rappeler, avec précision, ses saisons dont les cycles auront marqué nos mémoires.
Il y aurait là comme un Amarcord à ma façon, ou disons que j’y reviens une fois encore après en avoir écrit tant de pages. Plus exactement ce sera sous le signe du Temps retrouvé, qui fait du passé et du présent le matériau même d’une mémoire vive en attente de retrouvailles vécues ici et maintenant ou de lecteurs à venir, contre l’insignifiance et l’indétermination, l’indifférence et l’oubli qui sont l’œuvre aujourd’hui d’un démon mesquin aux pesantes paupières.
(Ce texte constitue l'introduction de Mémoire vive, sixième recueil de mes Lectures du monde 2013-2019, en voie de finition)
Dessin: Matthias Rihs