


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.







 GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandisant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chet mes ami d’autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…
GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandisant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chet mes ami d’autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…
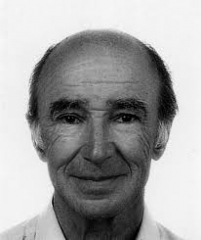

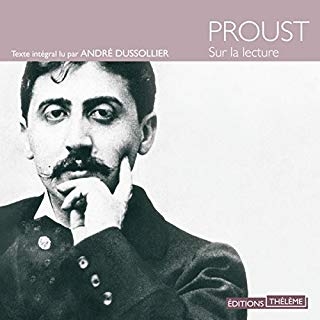
 LEONARDO. – Plus j’avance dans la biographie monumentale de Léonard de Vinci , par Walter Isaacson, et mieux j’évalue la médiocrité de la culture actuelle, ou tout au moins ce qu’on appelle la culture dans les cercles culturels où sévissent les fonctionnaires et les commentateurs attitrés des rubriques dites culturelles, notoirement nulles en ces temps de pandémie où l’on se rengorgeait à l’idée qu’enfin toutes et tous allaient pouvoir se consacrer à la lecture de Montaigne ou de Platon « dans le texte » et à la visite du Louvre ou de l’expo du minimaliste Untel via Youtube, etc.
LEONARDO. – Plus j’avance dans la biographie monumentale de Léonard de Vinci , par Walter Isaacson, et mieux j’évalue la médiocrité de la culture actuelle, ou tout au moins ce qu’on appelle la culture dans les cercles culturels où sévissent les fonctionnaires et les commentateurs attitrés des rubriques dites culturelles, notoirement nulles en ces temps de pandémie où l’on se rengorgeait à l’idée qu’enfin toutes et tous allaient pouvoir se consacrer à la lecture de Montaigne ou de Platon « dans le texte » et à la visite du Louvre ou de l’expo du minimaliste Untel via Youtube, etc.
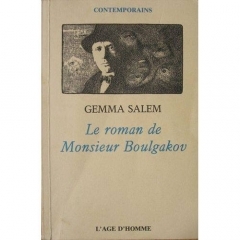

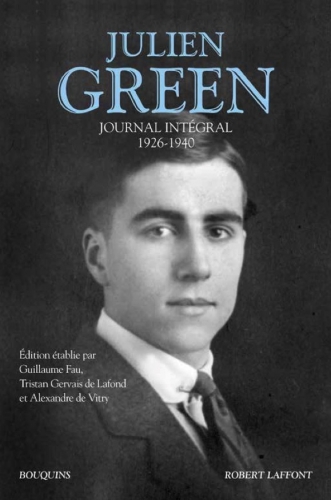


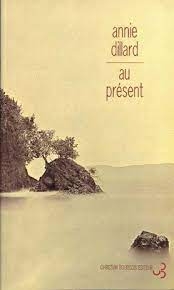


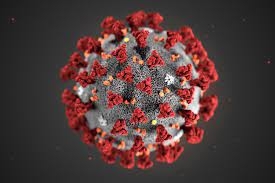









Celui qui affirme qu'il est seul à ne pas se soumettre à la vérité unique / Celle qui est à l'écoute de la rue dans son boudoir / Ceux qui ont ont des relents de bouches d'égouts / Celui qui rue dans les brancards de l'hôpital de charité / Celle qui rappelle qu'elle l'avait déjà dit aux girondins / Ceux qui sont à la révolution ce que le pet est à la nonne / Celui qui retourne à la rue de la Félicité ou son voisin de soupente était un chauffeur de taxi russe relisant le Que faire ? de Techernychevsky / Ceux qui traînent dans la rue le soir sans se presser le citron / Celui qui vend ses opinions aux plus offrants / Celle qui se les roule au square du même nom / Ceux qui aiment les rues désertes de Paris a l'écoute des pas perdus / Celui qui aime les gens mais abhorre la meute / Celle qui n'en fait qu'à sa tête de gondole genre Amélie Nothomb sous son casque à pointe / Ceux qui réseautent le social au niveau du groupe de fusion / Celui qui a tout compris dès son premier cri primal / Celle qu'on dit la pasionaria du jardin d'enfants en rupture idéologique / Ceux qui voient en Donald Trump le garant de leur blanchitude à deux balls / Celui qui met un genou en terre par manière de coup de pied au culte / Celle qui se tait dans l'impasse de l'Homme armé / Ceux qui retournent dans les bois / Celui qui se tient informé à tout instant sur Gmail des retours de ses passages à la télé et dans les médias et autres réseaux sociaux dont il entend contrôler la gestion d’archive sur disque dur /Celle qui s’est payé des talons plus hauts pour sa nouvelle émission win-win / Ceux qui parlent très-très vite pour ne pas qu’on s’aperçoive qu’ils n’ont rien à dire / Celui qui va tous les piétiner pour leurs montrer qu’il est dans le rap djeune le loser qui gagne / Celle qui entretient la paranoïa du produc en lui rapportant les propos dubitatifs du sponsor ultragauchiste de salon / Ceux qui font feu de toute suie / Celui qui observe la traîne de bave humaine laissée par le Conseiller suivi de ses courtisans dans les jardins du Mirador / Celle qui flaire la muflerie de l’arriviste et s’en protège par de vagues sourires / Ceux qui n’aiment pas voir leurs amis céder à la vanité débile / Celui qui pratique le plaisir aristocratique de déplaire mais en société seulement / Celle qui pontifie en sa qualité de conscience conscientisée de l’intelligentsia de centre gauche ménageant ses entrées dans les médias de centre droit / Ceux qui se battent pour défendre ce qu’ils appellent la zone sacrée / Celui qui ne s’est jamais éloigné de la zone sacrée investie à sa première véritable émotion de lecteur / Celle qui ne fréquente que les librairies pourvues d’échelles sur lesquelles on peut rester à lire même après la fermeture / Ceux qui vont en librairie comme d’autres vont à l’église avec dans les poches des adresses de maisons /Celui qui s’est retrouvé hors du temps et loin de tout autre lieu que cette prairie du bord du Neckar en cet été 61 où il a lu Tonio Kröger/ Celle qui associe le goût de la vodka au miel à sa lecture de La Dame au petit chien dans la pénombre carmin du café Florianska de Cracovie /Ceux qui n’ont de cesse que de protéger la zone sacrée des gesticulations des agités et des bruyants / Celui qui enjoint le Gouvernement suisse de fermer les frontières de ce pays de souche blanche et chrétienne / Celle qui au nom de l’UDC recommande qu’on surveille les 400.000 musulmans feignant de vivve paisiblement en Suisse alors qu’on sait ce qu’on sait / Ceux qui se demandent si les imams et les pasteurs protestants et les sociologues et les prêtres de gauche n’ont pas quelque chose de suspect en commun / Celui qui rappelle à ses employés (tous blancs et baptisés comme vérifié) que 42% des patrons des grandes firmes suisses sont étrangers et que c’est donc le moment de se montrer vigilant / Celle qui dit et redit ce que Bernard-Henri Lévy a dit et redit / Ceux qui se rappellent les camps de concentration américains aménagés pour les Japonais suspects / Celui qui comme Kouchner prône la force militaro-humanitaire / Celle qui apprend ce matin chez sa coiffeuse camerounaise que la Suisse compte 24% d’étrangers résidents permanents et pas l’ombre d’un ghetto / Ceux qui découvrant la liste individualisée des victimes des attentats du 13 novembre pensent à celles qu’on pourrait établir de tous les massacres aveugles perpétrés dans le monde (entre les pyramides de crânes humains de Tamerlan et les millions d’Indiens massacrés par la sainte Eglise catholique et apostolique, en passant par les protestants et les cathares et tant d’autres charniers de droit divin ou pas, on a le choix) et qui ramènent l’ « horreur absolue » au rang de tragédie relative même si la douleur personnelle reste incommensurable / Celui qui en revient à la réflexion de Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) sur les civilisations diverses et les fondements variés de la vérité et de la justice possiblement traduits par des lois plus ou moins justes selon les cas / Celle qui se rappelle qu’en 2012 (c’est presque du passé) un tiers des nouvelles entreprises suisses avaient des ressortissants étrangers pour fondateurs / Ceux qui se demandent ce que dirait aujourd’hui un Montaigne de l’état du monde et de ses progrès supposés en France du Sud-Ouest et ailleurs / Celui qui aux gesticulations des uns et des autres répond tranquillement (avec l’ami de La Boétie) que toutes les civilisations se valent en bien comme en mal / Celle qui n’en démord pas à propos des basanés quin’ont même pas lu le dernier Dicker / Ceux qui pensent que quand même Allah n’est pas sympa avec les mousmées / Celui qui aux certitudes partisans ou cléricales des uns et des autres répond tranquillement (avec l’auteur des Essais) qu’une civilisation a toujours tort quand elle use de violence / Celle qui rappelle sur Facebook que la mère de ce fourbe réformiste de Montaigne était non seulement de souche portugaise mais juive / Ceux qui préfèrent avoir tort avec Pascal qui justifie le mensonge de droit divin et l’Etat qui le fait respecter que raison avec Montaigne enjoignant chacun de chercher le moyen juste de ne point trop s’assassiner / Celui qui s’oppose tranquillement (avec Montaigne) à la spirale de la haine en affirmant qu’il n’y a jamais eu nulle part aucune Autorité fondée sur une vérité absolue et qu’il n’ya donc pas plus de souverain Bien politique qu’il n’y a de souverain Bien métaphysique et qu’en conséquence il est conseillé de cesser de gesticuler pour Rien,etc.

Que le mec avait un problème, ça je l’ai repéré dès qu’il m’a matée devant le Paradou, avec le métier c’est le genre de trucs que tu flaires.
C’était le style conseiller de paroisse marié. Tu les vois se couler le long des murs et passer trois fois devant toi comme s’ils cherchaient le confessionnal le plus proche, ensuite de quoi neuf fois sur dix ils te font le coup du grand sensible et te sortent la photo de Maman pour se donner du cran, mais celui-là c’était pire.
Quand je lui ai demandé ce qu’il me voulait, il m’a répondu qu’il était Polonais. Je n’y voyais pas de quoi faire un plat, et nous sommes montés, mais tout de suite ça s’est aggravé quand il a vu la photo de Jean Polski au milieu de mes peluches, et qu’il m’a demandé de la retirer de là pendant le rapport.
Je n’invente rien, c’était son expression: le rapport.
Lequel rapport n’a d’ailleurs rien donné. Je sentais bien que la présence du pape, les bras grands ouverts, lui posait un vrai problème, mais je n’allais quand même pas changer ma déco pour un client, même Polonais.
Juste avant de me quitter, il m’a fait la peur de ma vie avec ce coupe-papier qu’il m’a braqué sur la gorge en m’appelant tentatrice, mais là encore il a flanché au point que j’ai dû le prendre dans mes bras tandis qu’il se reprochait de salir la Pologne.
(Extrait de La Fée Valse)


De la télé aux multiples vecteurs du Net, les séries font aujourd’hui figure de phénomène mondial, notamment sur la planète des « millenials » et autres teenagers. Dans la foulée de Skin et de Skam, notamment, par delà le divertissement superficiel et les romances adolescentes, des thématiques psychologiques et sociales, affectives ou et sexuelles, se modulent en fonction des cultures, avec une liberté et une fraîcheur particulières dans certains pays asiatiques, dont la Corée du sud et la Thaïlande…
On peut n’y voir qu’un sous-produit de consommation de masse mondialisée. Dire qu’une série ne vaut pas un livre ni un film. Pointer la décadence de la culture et l’abrutissement collectif. Invoquer la protection de « nos jeunes » et conclure au néant de « tout ça », comme on l’a seriné depuis des années : que l’Internet serait une poubelle ou un enfer, et c’était avant l’apparition des réseaux sociaux, avant l’apparition multinationale des influenceurs suivis de leurs millions de « followers », avant les plateformes offrant leurs miroirs aux alouettes, donc avant Instagram ou Tiktok et leurs séquelles en matière de représentation de soi, tels les « filtres » à visages qui permettent aujourd’hui à nos kids de tous les sexes de mieux s’identifier à Lady Gaga ou Justin Bieber, entre autres « icônes »…
Et puis quoi ? Et puis moi, vieille peau littéraire relevant du monde désormais déclaré « d’avant », et puis toi, et puis vous, kids compris, et donc nous tous qui sommes censés croire ce matin que rien ne va plus vu que rien n’est comme « avant », justement, nous tous qui sommes supposés avoir « mal au climat » et balançons entre l’aspiration à zéro déchet et l’acquisition de tel ou tel nouveau gadget, la honte et la fierté…
Quand Skam «osait » la franchise à l’international
Les séries « pour ados », ou faisant découvrir les nouvelles mœurs et conduites des diverses tribus juvéniles, ont fait florès à la télé depuis des décennies, mais le genre vit une relance proprement mondiale avec l’apparition de « webséries » diffusées sur la Toile autant que sur les chaînes nationales, dont la plus significative a vu le jour en Norvège en 2015 sous le titre de Skam (la honte), à partir d’un concept revenant à « casser le morceau », ou « crever l’abcès ».

Amorcée sans fracas en Norvège, la série Skam évoquait, par le truchement de brèves séquences jouant sur le «temps réel», un groupe de jeunes gens assez typés non moins qu’attachants , plus ou moins confrontés aux questions de l’estime de soi et du racisme, de l’homosexualité ou de la religion - lesdites tranches de vie se trouvant immédiatement répercutées par une « fan base » interactive sur les réseaux sociaux, où fiction et réalité se mêleraient bientôt dans une flambée mimétique qui déborda bientôt en Italie et aux States, en France et en Allemagne.

Label Skam : la franchise sur les sujets sensibles du sexe et de la race, de la religion ou des failles psychiques (le thème de la bipolarité est récurrent), et la tolérance visant à l’acclimatation des « différences », conforme à l’esprit LGBT. Tout cela « grave sympa », avec de jolis acteurs bien lisses parfois devenus « cultes » sur les réseaux (les glamoureux Eliot et Lucas sur Skam France), mais plutôt court du point de vue des idées et de la narration, flattant finalement le narcissisme des « djeunes » et ne reliant guère ceux-ci à leur entourage social et familial.

Plus riche et originale, à cet égard, paraît la série anglaise Heartstopper, diffusée par Netflix, tirée d’un roman graphique et dont la première saison compte huit épisodes, qui se déroule dans un collège anglais où le jeune Charlie, genre intello hyperdoué au sourire pur et doux, persécuté après son «coming out» forcé, trouve un allié puis un ami et finalement un amant en la personne de Nick Nelson, le plus crack joueur de rugby du « bahut », dont la gentillesse fondamentale s’accorde à celle de son camarade harcelé. Une scène d’une profonde tendresse marque l’une des séquences les plus émouvantes de cette série aux nombreux personnages finement silhouettés : lorsque Nick, en principe hétéro, explique à sa mère (l’adorable Olivia Colman, inspectrice dans Broadchurch, et reine d’Angleterre dans The Crown), que Charlie lui a révélé sa propre bisexualité et qu’il l’assume par amour véritable.
Dans la foulée, et d’une façon plus générale, l’on aura observé que les séries anglo-saxonnes, autant que les nordiques, ont assimilé et dépassé les lois et les écueils du genre, avec une générosité et un humour – un engagement que les séries françaises (et ne parlons pas des suisses) n’ont guère atteints jusque-là, la France restant en somme guindée à cet égard, théâtralement déclamatoire ou binairement moralisante dans ses approches psychologiques et sociales du monde actuel, etc.
À l’Est du nouveau: déroutant, émouvant, voire hilarant…

Cinéphile ou simple amateur de toiles mondiales, vous êtes capable de citer cinquante titres de films et autres noms de réalisateurs américains ou italiens, russes ou français, tchèques ou polonais et, à la limite, indiens, japonais ou chinois, mais combien des dragons asiatiques, combien de Coréens à part le titre Parasite célébré palmé d’or à Cannes mais dont le nom de l’auteur vous échappe à l’instant, combien de Thaïs et de Taïwanais ?
Or c’est cette méconnaissance à peu près générale en Occident qu’est venues meubler, depuis quelques années, la déferlante audiovisuelle asiatique, dont les pointes d’icebergs brûlants apparaissent sur Netflix, via Amazon ou sur Youtube et ses exaspérantes interruptions publicitaires suisses alémaniques…
Depuis lors nous savons mieux ce que sont les K-drama coréens, « nos jeunes » auront découvert les équivalents thaïs ou philippins des teen-drama, les curieux (dont je suis voracement) de psychologie humaine et de fantastique social se seront plongé dans le magma, mêlant daube et pépites, des séries dont la profusion et l’immense popularité, d’abord locale (tout de même quelques centaines de millions de paires d’yeux bridés) et maintenant planétaire atteste l’existence d’une production industrielle incluant vidéos, liens numériques à diffusion exponentielle, produits dérivés, vedettes polyvalentes (les acteurs sont souvent chanteurs ou mannequins, voire portefaix publicitaires), fans clubs et tutti quanti.

Dans cette galaxie où glamour et grotesque cohabitent souvent avec humour et tendresse, pour en revenir aux teen-drama illustrés par les séries Skam et Heartstopper, entre tant d’autres, une saison de SOTUS, qui évoque la vie quotidienne dans une école mixte de futurs ingénieurs thaïlandais, doit retenir notre attention pour son mélange très singulier de férocité satirique et de comique, de tendre émotion et de surprenantes péripéties…
L’acronyme SOTUS (« Seniorité », Ordre, Tradition, Unité, Spiritualité), constituant l’emblème et le « programme » de l’internat en question, désigne un système coercitif de soumission des « juniors » de première année aux « seniors », où le bizutage ordinaire devient à vrai dire extraordinaire, rappelant (un peu) les dérives quasi totalitaires de La servante écarlate, avec l’affrontement immédiat entre le senior teigneux Arthit et le junior rebelle Kongpo, qui va tourner peu à peu au rapprochement des adversaires et, finalement, à leur complicité amoureuse.
Paradoxe assez singulier, mais typique des séries asiatiques : que la « déviance » sexuelle est moins jugée du point de vue moral que sous l’aspect de la cohésion sociale, et que le groupe, les filles et les familles, interviennent très activement dans le «tableau», au point parfois de favoriser les amitiés particulières dans un climat du plus haut romantisme, très pudiques dans la représentation « explicite » des rapports charnels (le baiser du bout des lèvres en est le summum orgiaque, salué par des litanies langoureuses assez hilarantes).
Dans ce contexte apparemment très libéré (vraiment inimaginable, autant que Skam, en Russie poutinienne…), le message est pourtant à l’apaisement hors-genre si l’amour est au-then-tique et plus encore, comme dans SOTUS, si les « déviants » des divers sexes sont de bons enfants aimants leurs aînés et bossant dur pour l’exam prochain…
Bref, il y là comme une alternative souriante au moralisme ambiant tous azimuts et au sectarisme communautaire, et c’est avec un grain de sel qu’on en sait gré aux quatre dragons…
 Une lecture de La Divine comédie (54)
Une lecture de La Divine comédie (54)
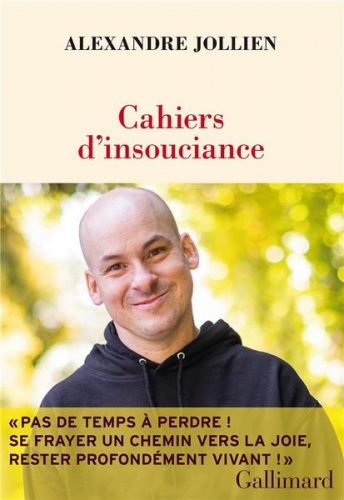
Physiquement « empêché » de naissance, incessamment empêtré dans son corps et sachant même la dégradation de sa santé en voie d’aggravation, celui qui s’est fait connaître par un mémorable Éloge de la faiblesse n’en finit pas, dans ses Cahiers d’insouciance, de parier pour la joie personnelle, d’une part, et pour la solidarité sociale à plus grand échelle, d’autre part, non sans contradictions (sympathiques !) à chaque page de son vade mecum de survie en milieu multiviral où sévit, plus que jamais, le bacille têtu de la Bêtise…
Certains livres – compte non tenu du personnage que représente peut-être leur auteur – sont de véritables personnes et qui vous accompagnent, vous prennent par la gueule ou vous murmurent à l’oreille, cherchent à vous séduire ou en appellent à votre affection avec plus de douceur, en tout cas vous semblent immédiatement plus proches que les autres par leur façon de s’ouvrir et de vous faire tourner leurs pages en vous impliquant vous-même par ce miroir qu’ils vous tendent avant que vos histoires parfois s’entremêlent, et c’est ce que j’aurai personnellement ressenti à la lecture des Cahiers d’insouciance d’Alexandre Jollien, plus de quinze ans après une première rencontre en 3D au lendemain de la parution de La construction de soi qui avait largement confirmé la reconnaissance acquise dès la parution de son Éloge de la faiblesse, en 1999, aux éditions du Cerf.

Le «personnage» de Jollien, figure archi-médiatisée de l’handicapé-philosophe, n’y était pas encore lorsque je le vis apparaître, sur une petite place de La Tour-de-Peilz, juché sur une espèce de gros tricycle, me conduisant jusqu’à une maisonnette dans laquelle il occupait un studio, et, devant la porte de son repaire – scène émouvante qui m’est restée très présente -, me demanda de prendre sa clef et de nous ouvrir la porte d’entrée d’un geste qui lui était difficile…
Or c’est, en deça ou au-delà du personnage médiatique qu’est devenu Jollien, cette personne «empêchée» que nous retrouvons – car c’est à nous tous qu’il dédie son livre, après son épouse et ses trois enfants cités en premier lieu – dès les premières pages de ces carnets que chacune et chacun, à des titres multiples, pourrait croire écrits pour elle ou lui, en complicité proche ou au contraire avec plus de distance, car il faut souligner d’entrée de jeu que ce livre sans fard, d’une sincérité parfois désarmante ou d’un ton qui défrisera peut-être certain(e)s, est bel et bien le «journal à poil» souhaité par l’auteur d’un essai invoquant déjà, naguère, Le philosophe nu (paru au Seuil, en 2010).
À propos de nudité, l’on a appris récemment que Jollien faisait l’objet d’une plainte, déposée par un jeune employé d’édition, de harcèlement sexuel, au motif qu’Alexandre lui aurait demandé un massage et suggéré de se montrer lui aussi tout nu. Or l’obscénité, en l’occurrence, me semble plutôt de dénoncer publiquement, sept ans après les faits, et de traîner en justice un homme qui, en toute transparence, a déjà fait état de goûts sexuels remontant à l’adolescence et qui ne l’empêchent pas d’avoir convolé avec une femme qu’il dit la douceur incarnée, avec laquelle il a conçu trois enfants pour lesquels la bisexualité de papa ne semble pas constituer un trauma… Bref, la justice appréciera si cet avéré mendiant de tendresse doit réellement être livré ainsi en pâture à la meute et « payer » un fois de plus. Quoi qu’il en soit, cette « affaire » s’inscrit assez naturellement dans une suite d’humiliations subies par Jollien dont la plus significative est celle du jeune homme qui, le voyant dans la rue en compagnie d’une jeune fille, lance à celle-ci qu’elle a «oublié la laisse»…
Une lecture de soi grappillant dans le livre du monde
À parler franchement, c’est un peu fortuitement que j’en suis revenu, ces derniers jours, à l’auteur de L’Éloge de la faiblesse, dont j’ai retrouvé l’exemplaire annoté dans la bibliothèque de ma bonne amie, laquelle nous fut cruellement arrachée en décembre 2021 et aura d’ailleurs été la première à me parler de Jollien à la fin des années 1990, alors que son métier d’enseignante spécialisée la portait à s’intéresser, plus que moi, à ce genre d’écrits, à côté de son attention non moindre aux sciences cognitives et aux spiritualités à coloration scientifico-bouddhiste, de l’astrophysicien Trinh Xuân Thuân au moine Mathieu Ricard devenu plus tard complice de Jollien, en passant par une ribambelle de lamas et autres bodhisattwas, etc.

Or, retrouver une personne aimée à travers ses lectures (et dans le cas de ma moitié ce sont Edgar Morin, Jean-Bernard Pontalis, Francisco Varela, Baruch Spinoza, Etty Hillesum ou Elizabeth George, notamment) est une relance de partage chargée de nouvelles affinités à la lecture des Cahiers d’insouciance dont j’ai fait l’acquisition récente – affinités liées à l’expérience de la mort annoncée, à la tristesse surmontée, aux épreuves quotidiennes partagées, à la dégradation physique sur fond de crise sanitaire - bref à tout ce bordel de merde d’existence plombée par la maladie et source encore de putain de joie !
Vous trouvez ces mots peu châtiés ? Eh bien , allez voir du côté de la vie, faites un saut en maternité dans la division des enfants malformés de naissance aux bons soins de la justice divine, et lisez ces lignes des Cahiers d’insouciance : « Après dix-sept ans à l’institution, en milieu quasi carcéral, totalitaire, où tout était décidé pour nous jusqu’à la couleur de nos caleçons, comment devenir un poil libre sans se sentir obligé de rendre des comptes à quelque instance supérieure ? »
Trois pages à se rappeler pour ne pas oublier le « trou noir » de cette mémoire : « Ils m’ont carrément déposé comme un paquet. J’imagine la douleur de mon père et de ma mère. J’entends presque les éducateurs : « Ça va être dur, c’est un sacrifice mais c’est pour son bien…» Et le pire est que , libéré, le sujet « arraché à sa famille, placé arbitrairement à trois ans sans autre forme de procès, continue aujourd’hui à rechercher « l’implacable sécurité de l’institut », genre syndrome de Stockholm.
Tu parles d’insouciance : « Je vis encore dans une espèce de cage psychologique à la recherche d’une consolation. Tout plutôt que le saut dans le vide, dans la liberté ! »
Et c’est, en somme, pour sortir quand même de sa « cage » que le lascar y va de ses recettes éprouvées ou nouvelles pharmacopées, dont son burlesque CCL, en clair Can’t Care Less, à savoir : rien à souder, se « battre les steaks », ou, comme le disait Stendhal avec son fameux raccourci de SFCDT, Se Foutre Carrément de Tout, ce qui n’empêchera en rien les remontées d’angoisse, les paniques paranoïdes et tout le toutim, entre découragement suicidaire et rebond joyeux
Au demeurant, le savant Poucet ne deviendra jamais « grand » à ce qu’il semble (Alexandre est conscient d’être en somme le quatrième enfant dont son épouse à la charge…), mais la lectrice et le lecteur ne perdront rien à suivre la piste de ses cailloux blancs d’aspirant bodhisattwa à l’école d’Epictète et de Spinoza, de Gombrowicz un jour et de Bukowski (mais si !) le lendemain, de Nietzsche depuis longtemps, et de Cioran parfois, sans compter divers maîtres tibétains tel l’auteur de Folle sagesse (Seuil, 1993) au nom de Chögyam Trungpa (1940-1987), dont ma chère Lady L. a très attentivement, elle aussi, étudié les approches de la « santé fondamentale ».
Folle sagesse est, aussi bien, l’oxymore qui rend compte de la quête d’Alexandre Jollien, mais c’est aussi loin de cette folie quelque peu incantatoire et de tout un bric-à-brac de brocante spirituelle ou philosophique que je préfère, pour ma part, retrouver ce frère humain (et ma bonne amie), dans le désordre splendide de la vie aux innombrables sujets de renfrognement passager ou de réjouissance, de peurs vertigineuses et de fusées d’allégresse – tous deux vivant le Carpe diem à la même enseigne qu’avait choisi ma douce sous l’égide de la formule signalant quel courage commun à ces deux belles personnes: sérénité et reconnaissance…
Alexandre Jollien. Cahiers d’insouciance. Gallimard 2022, 218p.

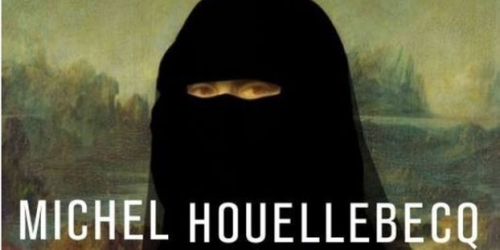
À partir de quel moment le retournement s’opère-t-il, qui fait de la rébellion un simulacre à valeur de consentement ?
Poser la question revient à se demander comment le rebelle sans cause en blouson noir des années 50 du XXe siècle, devenu rebelle à causes multiples au cours de deux décennies suivantes, s’est finalement posé en adulateur ou en contempteur du roman Soumission de Michel Houellebecq dans lequel sont exposés les tenants et les aboutissants de ce dernier avatar de l'Homme Nouveau qu'on peut qu’on peut dire le néo-collabo.
Mais collabo de quoi ? De l’islamisme rampant, du sempiternel carriérisme des universitaires de tous bords, du consumérisme en quête de vins gouleyants et possiblement longs en bouche, de la nouvelle internationale touristique bourgeoise ou anti-bourgeoise prônant tantôt les croisières en villes flottantes surgissant soudain dans la lagune de Venise et tantôt, comme le recommande Sailor toujours prêt à accompagner des groupes de lecteurs du Grand Quotidien aux frais du journal, les expéditions écologiquement concernées à la recherche de telle l’espèce animale en voie de disparition – les images de la tortue à nez de cochon ou du panda géant font toujours fureur sur INSTAGRAM - ou de telle tribu non encore spoliée par le colonialisme prédateur ?
En un autre temps, la question eût peut-être fait débat, comme on disait alors, mais quelque chose s’était passé en ces années qui avaient vu la question même se diluer dans l’obligation proclamée du questionnement, et plus encore dans l’injonction incantatoire de la remise en question quotidienne et permanente que tout un chacun et chacune invoquaient en parole pour mieux l’esquiver en réalité, notamment dans l’Open Space où chacune et chacun se repliaient de plus en plus sur eux-mêmes non sans déplorer l’individualisme de sa voisine ou le narcissisme limite pervers de son voisin.

Tout cela, cependant, ne touchait plus guère le Tatoué, qui n’était d’ailleurs plus souvent présent physiquement en l’Open Space qu’il abhorrait, préférant lire et écrire dans sa mansarde du Vieux Quartier où nul n’avait jamais pénétré mais qui contenait, disait la rumeur, des trésors en matière de gravure ancienne et de bibliophilie.
Avec un peu de distance temporelle, ces divers personnages excessivement caricaturés pour les besoins de la très bonne cause que je crois être celle de la Poésie intemporelle, nous resteront à l’état de figures d’une époque de déséquilibre et de transition qui eussent désorienté même un sage un peu trop sage de la trempe du Monsieur Lesage du Confort intellectuel de Marcel Aymé alors qu’il restait tant d’autres choses à raconter.
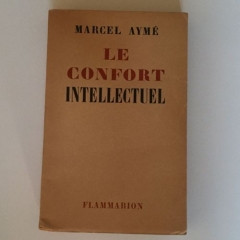
L’on se gardera, bien entendu, de positiver, mais les détails du poème nous nous ferons retrouver la vraie douceur des choses et des personnes que le simulacre et la fausse parole ont altérée.
Je revois ainsi les livres aimés du Tatoué, soigneusement recouverts de papier pergamin, dit aussi papier cristal. Le monstre hallucinant lit ainsi ce matin Septième de Jacques Audiberti, sous sa jaquette de papier semi-transparent, que lui aura probablement recommandé son père le subtil érudit féru de poètes fantaisistes et de prosateurs non pareils, pratiquant lui-même le rituel de fourrer ses chers ouvrages.
Et tant de gestes à sauver : de la main protectrice du Glandeur sur l’épaule de son petit garçon de trois ans au prénom d’Igor ; ou de la tête de la Douairière commençant d’aimer les femmes au tournant de la soixantaine, sur l’épaule de son amie pianiste qui lui aura révélé, d’émotion avérée, la déchirante beauté du mouvement lent de la Sonate posthume de Franz Schubert ; ou l’émoi privé du Frôleur à chaque téléphone à sa mère grabataire en sa prison cinq étoiles, comme elle appelait, entre autres sarcasmes, la vaste chambre de L’Étoile du matin avec vue sur le lac où ses soeurs l’avaient casée «pour son bien», et qu’il était seul à rappeler chaque soir pour s’en faire enguirlander tendrement; et les caresses de l’Agitée à ses chiens de peluche auxquels elle disait tout; et la même attention portée par Sailor à sa dernière compagne ingambe dont il poussait la chaise roulante sous les peupliers de l’allée menant à l’Institution ; et le geste de Sugar Baby de refermer son ordi juste pour voir le soir le ciel noircir et rougir à la fois dans l’indigo flammé d’or du crépuscule sur les toits de Paris – ah mais crénom je vais m’oublier !
Crénom de Baudelaire, que je défendrai contre tous les Lesage et tous les littérateurs de tendance telle ou telle, quand Homère se lève au fond de l’avion de l’aube et m’invite à remonter aux nacelles à pianoter de mes doigts de prose sur mon smartphone.

Vous vous êtes tous retrouvés CHARLIE rebelles présumés de la même cause au lendemain de la calamité que vous savez, de même qu’ils se sont tous prétendus Ricains faisant pièce à l’Empire du Mal tout uniment non moins qu’unanimement désigné, mais voici qu’un ange qui n’a rien de Win-Win me visite à l’instant – et de fait c’est une matinale visitation ce soir que j’identifie en la parole de ce formidable petit brin de femme malingre au prénom de Cristina et à la bouche d’or : « Le style ce fut aussi la danse sacrée des grands Watusis du Rwanda, comparables aux prêtres blancs de Doura-Europos et désormais détruits par des hommes de médiocre stature. Ou cette autre danse (« poings serrés, poignets fléchis ») vue par un poète dans les membres d’un enfant moribond. Lentement ils s’ouvraient, se fermaient comme une corolle. Autant de figures où l’œil a saisi ou transfusé cette seconde vie qu’est l’analogie salvatrice : lys, corolle, danse, mort, étoile ; où l’horreur et la paix s’organisent selon des géométries identiques, innocentes ».

Dites-moi, rebelles de papier mâché que nous sommes, comment vous parlez et comment vous parlent ceux qui vous ont donné la vie, et dites-moi, vous qui osez invoquer les damnés de la terre, ce que vous dit le ciel de la Méditerranée quand vous osez lever les yeux de vos ordis réseautés sur le CLOUD ?
Mais en quel jardin nous retrouvons-donc ce matin ?

Moi qui ne suis encore qu’un Chinois virtuel, et quelque temps sûrement à expier avant d’expulser hors de moi cet autre rebelle par trop consentant, j’entends cette femme de féerie lumineuse – cette Cristina Campo qui m’interpelle dans ses Impardonnables : « Ils ont vu la beauté et ne s’en sont pas détournés. Ils ont reconnu sa perte sur la terre et par mérite l’ont reprise en esprit »…
(Extrait et conclusion du troisième chapitre du libelle intitulé Nous sommes tous des zombies sympas: 1. Nous sommes tous des Chinois virtuels. 2, Nous sommes tous des auteurs cultes. 3. Nous sommes tous des rebelles consentants.4. Nous sommes tous des caniches de Jeff Koons. 5. Nous sommes tous des délateurs éthiques. 6. Nous sommes tous des poèmes numériques. 7. Nous sommes tous des zombies sympas). L'ouvrage a paru en 2019 chez Pierre-Guillaume de Roux.




Pour Sophie et Florent, avec une dernière pensée à la mémoire de Lawrence Ferlinghetti (1919-2021)
L’avant-veille au soir j’avais écrit, sur les hauts de Nobhill où nous créchions dans une chambre kitsch à l’enseigne de l’Hôtel de France, cette espèce de balade bluesy que j’avais intitulée Young memories en m’efforçant de la dégager de tout marshmallow nostalgique; la lumière était à l’embellie de printemps et nous revenions, avec Lady L., d’une longue virée circulaire sur les eaux et par les rues, le matin jusque vers Sausalito dont le nom m’évoquait tout un folklore peace & love, à la proue d’un ferry flottant qui avait viré par-delà le pont suspendu, sous les méplats herbeux à casernes orangées du Presidio d’où étaient partis les appelés du Vietnam, et ensuite dans le fracas oscillant du tramway remontant jusqu’au quartier gay de Castro où des ados de soixante ans se bécotaient encore dans leurs barbes; et l’après-midi s’était éternisé dans le dédale étagé de la librairie City Lights à l’aura plus-mythique-tu-meurs dont le programme survivant annonçait la venue en lecture du poète juif new yorkais David Shapiro qui venait de publier en ce lieu même In memory of an Angel - et pourquoi n’y aurait-il point aujourd’hui encore d’anges à Frisco ? m’étais-je demandé dans notre Chevy de location faisant route le lendemain vers Monterey et Big Sur, autres légendes et loin des parades clinquantes d’Atlantic City et de son Ubu à prénom de canard de cartoon ?
Ensuite la poésie rock and blues de nos jeunes années, relancée par quelques vers du centenaire Lawrence Ferlinghetti régnant toujours sur son arche de City Lights sauvée de tous les déluges, m’était revenue par bribes :
Poets, come out of your closets,
Open your windows, open your doors,
You have been holed –up too long
In your closed words,
la poésie de toutes les déroutes nous avait escortés sous les arbres en voûte des hauts de Carmel, je nous chantonnais d’autres vers du vieux veilleur qui me ramenaient de vertes images des nouvelles de Brautigan ou des litanies de Bob Dylan,
The world is a beautifil place to be born into
if you don’t mind happiness
not always being
so very much fun
if you don’t mind a touch of hell
now ant then
just when everything is fine
because even in heaven
They don’t sing
all the time -
nous montions droit au ciel vers les collines pelées au vert olive me rappelant les crêtes siennoises du côté d’Asciano, et bientôt ce serait la redescente vers les plaines vivrières à Latinos trimant dur dans les champs de tomates et d’asperges, vers San Luis Obispo, et partout s’égrenaient les noms de la conquista et les murs chaulés de blanc pur, les clochers des petites missions catholiques et apostoliques de la côte Ouest où les surfeurs plantaient leurs camps volants sous le soleil recommençant de chauffer à blanc; et maintenant, vautré sur un canapé chamarré d’un salon-bar aux ornements psychédéliques jouxtant la salle de concert de la House of blues de San Diego, j’entendais les paroles reprises par cœur par les kids des kids du temps de Woodstock: Mother do you think they’ll drop the bomb?
Et tu croyais que t’allais, Little Boy , échapper à la tombe ? murmurais-je dans mon sofa défoncé, à lire sur mon smartphone la bio complète du Good Will, mon vieux barde de bonne volonté qui me rappelait que l’Ariel androgyne des Doors avait viré Falstaff avec les années, et tout a côté les kids des anciens kids de l’été 69 reprenaient en douce chorale les paroles répétées par cœur du to be or not to be des générations nouvelles – et pourquoi pas à la mémoire de cette gueule d’ange-là du nom de Jim Morrison ?
°°°
Je me serais attardé des heures, je serais resté des jours dans le dédale de City Lights, me disais-je en lisant, sur mon smartphone, la bio de Shakespeare signée Stephen Greenblatt, tandis que roulaient, tout à côté, les vagues du Tribute to Pink Floyd que déployait je ne sais quel groupe descendu de Los Angeles dont aucun membre n’avait l’âge d’avoir entendu les Doors à Woodstock à l’été 69, mais à l’instant je me sentais sans âge, à la fois proche et très loin des eaux diluées de ce rock planant d’où surgissait parfois, de loin en loin, telle ou telle mélodie qui me faisait me lever et rejoindre la compagnie - j’étais là n’y étais pas: plus je lisais Will le magnifique et plus j’abondais dans le sens de Greenblatt qui s’opposait, vertement et pièces en mains, à la version d’un Shakespeare grand lettré sans rapport avec le théâtreux jugé miteux de Stratford, je venais de me « faire » les 37 pièces enregistrées par la BBC et je sentais, je savais qu’un Shakepeare de cabinet, un Shakespeare de cour et de bibliothèque, un Shakespeare qui n’avait pas riboté et cahoté avec une troupe de cabots ne pouvait avoir fagoté ces personnages, et les reines et les rois, les gueux et les mégères et la nature surnaturelle, sans les avoir ingérés par osmose combien charnelle, et me revenaient une fois encore les mots du beatnik chenu,
Poets, come out of your closets,
Open your windows, open your doors,
You have been holed –up too long
In your closed word,
et dans la foulée m’a ressaisi le souvenir de cet autre barde que fut Allen Ginsberg, tel jour de telle autre année, à Paris, nanti de son minuscule harmonium portatif et psalmodiant, de concert avec son compère Phil Glass, devant une foule à la fois médusée et ravie… et du coup je me rappelle que la première vision poétique est venue au beatnik Allen par cet autre barde, autre William de surcroît, que fut l’incommensurable Blake, et voici que d’un souvenir l’autre me revient que le poème Howl de Ginsberg fut primitivement édité par City Lights Books, tout de même qu’En mémoire d’un ange de David Shapiro, en anglais dans le texte, dont les douces ballades bercent la douleur de ce bas monde, et l’autre ange portier, Jim l’enivré, de murmurer en écho :
Pardonne-moi mon père car je sais ce que je fais :
je veux entendre le dernier poème du dernier Poète…
Je ne sais, pour ma part, ce que disent les poèmes, mais je sais qu’eux le savent les yeux fermés.
Et je sais que le dernier poète n’est jamais celui qu’on croit, me disais-je en nous revoyant, avec Lady L. , dans la lumière poudroyant de lyrique poussière de la librairie City Lights, et je me foutais bien que Shakespeare ne fût pas celui qu’on croyait mais un autre, comme le vieil Homère aux doigts de rose était un autre encore, me répétais-je sur le divan crevé du salon-bar de la House of Blues de San Diego où j’éclusais une énième bière dorée avec le trentenaire adoré de notre fille en fleur aînée, et les jeunes rockers endossant les vieilles peaux de Waters & Gilmour s’en donnaient à cœur joie de relancer comme pour la première fois ce qui avait été vécu et revécu, comme je relisais L’Iliade ou Le Roi Lear lus relus et relus des millions de fois par les kids de tous les âges émus ou pas, et de là-bas, de la scène enfumée de lumières me parvenait la chère rengaine me rappelant je ne sais quels vers de je ne sais quel dernier poète :
Remember when you were young,
you shone like the sun
Shine on you crazy diamond,
et les yeux fermée je me laissais bercer et me remémorais tant d’autres poèmes de derniers poètes étoilant leurs lumières sur les villes des librairies de partout, du Palimugre à Cracovie, ou de Séville à City Lights, et tel soir, par delà les années, tel kid ou sa girlie peut-être, me disais-je enfin, retrouveraient dans mes papiers cette espèce de ballade bluesy qui m’était venue cette année-là sur les hauts de Nobhill et que j’avais intitulée Young Memories :
Nous avions vingt ans d'âge
et le vent jeune aussi,
la nuit au sommet de l'île
nous décoiffait et sculptait nos visages
de demi- dieux que partageait
l'amoureuse hésitation,
sans poids ni liens que nos
ombres dansantes
enivrées au vin de Samos,
les dauphins surgis de l'eau claire,
nos impatiences enlacées,
un consul ivre sous le volcan
et le feu du ciel par delà le dix-septième parallèle...
Et partout, et déjà,
défiant toute innocence,
les damnés de la terre
plus que jamais déniés;
et si vaine la nostalgie
de nos vingt ans,
en l'insolente injonction de nos rebellions.
C'était hier et c'est demain,
et nos vieilles mains sur le sable
retracent en tremblant les mots
qui se prononcent les yeux fermés
au secret des clairières.
(À La Désirade, ce 28 août 2019)
Ce texte a paru dans la revue Instinct Nomade, disponible en librairie et sur commande.
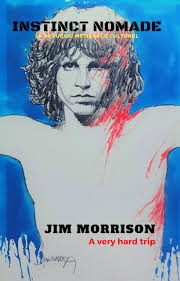

Le chef-d’œuvre « japonais » de Fredi M. Murer. (Re)déclaré plus grand film de l'histoire du cinéma helvétique par l'Académie du film suisse. À revoir et revoir sans doute.
L’Ame sœur de Fredi M. Murer, disponible sur DVD, a été dit « le meilleur film de l’histoire du cinéma suisse », ce qui est fort possible même si son confinement dans le « cinéma suisse » me semble, pour ma part, insuffisant. Je le placerais plus volontiers, quant à moi, au nombre des chefs-d’œuvre du 7e art de l’après-guerre, toutes catégories confondues, et je me disais l’autre soir, en le revoyant, que c’était une sorte de film japonais que cet ouvrage enté sur un thème – l’inceste - de la tragédie grecque, et traité avec une radicalité absolue, du point de vue de la forme, image et verbe fondus en pure unité.
Or rencontrant Fredi M. Murer la semaine dernière dans son antre zurichois de la mythique Spiegelgasse, pour évoquer Vitus, son nouveau film, et lui parlant de cet aspect « japonais » de Höhenfeuer (titre original de L’âme sœur), le réalisateur m’a répondu en riant que son film avait bel et bien été perçu comme tel au Japon même, où il a rencontré un succès considérable, avant d’évoquer sa parenté avec La légende de Narayama d’Imamura…
L’âme sœur est un grand film d’amour tragique, liant un adolescent muet et sa sœur aînée dans une famille de paysans de montagne vivant entre traditions archaïques et modernité perlée. Rien de pittoresque dans les Alpes de Murer, qui a interdit toute figuration style carte postale à son chef op’ Pio Corradi, et rien de régionaliste dans cette famille d’Helvètes alors même qu’ils s’expriment en dialecte uranais à couper au couteau. La fatalité illustrée – la pauvreté et l’endogamie – n’y a rien de dogmatique ou de littéraire non plus, mais s’incarne littéralement à la fois dans la nature sauvage et le naturel des protagonistes, dont le plus jeune reste proche des grands fonds et va retrouver à un moment donné les rituels d’une sorte de chamanisme des hautes terres.
A cela s’ajoute un trait omniprésent dans le cinéma de Murer, à part la patte d’un grand peintre sur pellicule : une immense tendresse qui enveloppe tous les personnages, sans exception, portée jusqu’au sublime dans les dernières scènes du film où le garçon devenu père incestueux, qui a retourné l’arme de son padre padrone furieux contre celui-ci, ensevelit ses parents (la mère a été foudroyée par la mort de son conjoint) dans la neige de cet outrepart utopique d’un rêve éveillé où il est le seul à ignorer que la vie ne sera jamais possible…
Fredi M. Murer. L’âme sœur. DVD Impuls. En Bonus, interview du réalisateur.
Extrait du Storyboard de Fredi M.Murer



Ce qu’on voit de loin se précise :
plus l’enfance s’éloigne
apparemment, comme en incises,
plus les images se rejoignent…
Les après-midi sans rien faire,
et les dents qui font mal,
les derniers souvenirs de guerre
et le petit cheval…
Le petit cheval harcelé
par le valet Pedro -
celui qu’on taxe d’étranger
et qui se croit hidalgo…
Les gens d’alors, en noir et blanc
et les ruines, là-bas ;
nous autres souvent en forêt,
terriblement vivants…
Le temps s’en va par les allées,
tu le vois d’où tu es,
qui te rejoint les yeux fermés
dans sa limpidité…
Entretien avec Henri Godard
La première moitié du XXe siècle fut une période faste de la littérature française contemporaine, et notamment dans le domaine du roman. Avant la mise en coupe critique de celui-ci par le Nouveau Roman, et en réaction contre le classicisme « psychologique » d'un Proust, une série d'écrivains d'inégal génie mais qui ont pour point commun d'avoir été marqués par la guerre de 14-18 et de bousculer l'humanisme bourgeois, constituent ce que le professeur et critique Henri Godard, connaisseur éminent des œuvres de Céline, Giono et Queneau (dont il a établi les éditions respectives à La Pléiade), entre autres, appelle « une grande génération ».
— Selon quels critères avez-vous rassemblé ces écrivains ?
— Mon choix, qui n'est pas exhaustif, correspond initialement à des passions de jeunesse auxquelles je suis revenu dans mes travaux. Très différents les uns des autres, ces auteurs que j'ai « élus » ont en commun, par leur tranche d'âge, d'avoir été marqués par la guerre de 14-18, soit au titre de combattants, soit pour en avoir ressenti les effets au temps de leur adolescence. Céline est blessé au front, mais Louis Guilloux, lycéen à Saint-Brieuc, y découvrira les blessés et les mutilés dans un hôpital installé en Bretagne. A côté du traumatisme lié à la guerre, il y a une prise de conscience de l'Histoire nouvelle par rapport à la génération de Gide ou Valéry. Cette prise de conscience, face à la perte de tout repère, va de pair avec un sentiment existentiel très fort et un questionnement sur le sens de la vie. Cela marquera, je crois, le roman français pendant vingt ou trente ans. Ces écrivains ont été confrontés à des choix décisifs, dont les extrêmes se partageaient entre communisme et fascisme. Ils avaient l'épée dans les reins. En outre, ils ont également pour point commun de travailler le langage au corps et d'être des stylistes vigoureux. C'est pourquoi j'aborde également Louis Guilloux, Jean Malaquais pour ses Javanais ou Claude Simon, qui viendra bien plus tard ...
— Mais alors, pourquoi l'impasse sur Aragon, et pourquoi Queneau ?
— Aragon pourrait naturellement figurer dans cette « grande génération ». Son absence n'est qu'une question de circonstances, car je lui consacre une étude à part dans un autre livre que je prépare sur le roman critique au XXe siècle. Quant à Queneau, dont l'image courante est d'un amuseur qui joue avec le langage et les concepts, je l'ai intégré à cause de ses premiers romans qui traitent bel et bien de thèmes à caractère existentiel. Dans Le chiendent, son premier roman, une serveuse de café en milieu ultra-populaire, qui meurt inopinément le jour de ses noces, se demande ainsi, finalement, ce qu'elle aurait « foutu ici-bas » ...
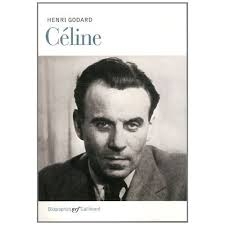
— Qu'est-ce qui vous a fait « élire » Céline ?
— Je l'ai découvert après Malraux et Giono, en 1957, avec D'un château l'autre. Comme beaucoup, j'ai été saisi par son génie verbal, à une époque où il était exclu de parler de lui à l'Université. Sa formidable découverte a été d'inventer une écriture qui mime l'oral dans ce qu'il a de plus profond, avec sa fameuse ponctuation, au fil d'une déconstruction de la phrase qui est aussi une déconstruction de la logique et une nouvelle musique. Il ouvre des vannes extraordinaires. Or, ce qui fait le scandale permanent de Céline, c'est évidemment la collision d'une position raciste insoutenable, dans ses pamphlets, et sa grandeur évidente d'écrivain.
— Comment expliquez-vous que, dans les romans, la part du racisme et de l'antisémitisme de Céline soit quasiment nulle ?
— Deux remarques m'ont frappé à ce propos: la première de Sartre qui dit qu ' « on n'imagine pas un grand roman antisémite », et l'autre de Kundera qui a développé, dans L'art du roman, l'idée d'une « sagesse du roman ». Céline polémiste tend naturellement à la simplification grossière, tandis que, dans une position de romancier, il recourt à la nuance, contre tout stéréotype. Dans Mort à crédit, on voit ainsi le père, antisémite et antimaçon, tourné en bourrique, et les mêmes phénomènes s'observent dans Guignol's band.
— Et Giono ? Pourquoi l'appelez-vous « passeur »?
— Je l'appelle passeur parce que beaucoup de ces écrivains, après la guerre, ont délaissé le roman pour se replier dans une espèce d'auto-fiction. Giono est celui qui a maintenu, pendant toute la période du Nouveau Roman, en lequel il voyait une impasse, le code « naïf » de la fiction, avec l'émerveillement du conte, de l'histoire et des personnages.
— Et Sartre là-dedans ?
— Je l'ai joint de manière un peu forcée, mais La nausée procède bel et bien de ce courant existentiel, même si l'auteur tend à « philosophiser » le roman sur la fin ...

— Vous parlez d'une « grande génération ». Est-ce à dire que cette période soit particulièrement féconde.
— Je le crois. Si l'on envisage même une longue durée, il me semble que cette tranche de la littérature française est réellement fastueuse.
— Est-ce à dire que nous pataugions actuellement en eaux basses ?
— Je ne tiens pas à m'étendre sur ce sujet (rires), mais oui, tout de même, je le crois. Je ne vais pas me faire que des amis en le disant, mais c'est pourtant ce que je pense ...
Henri Godard. Une grande génération. Gallimard, 457 pp.

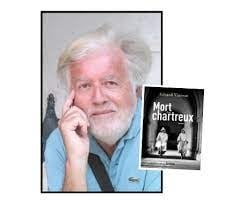
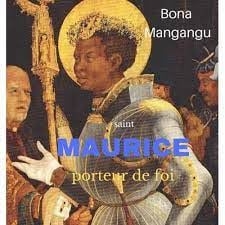 Un contemplatif poète et un saint militaire ont inspiré deux écrivains: Gérard Vincent dans Mort d’un chartreux, compose le journal d’un moine dont la tumeur au cerveau ne lui laisse que quelques mois à vivre ; et Bona Mangangu, dans Saint Maurice Porteur de foi, ressuscite le soldat nubien Maurice, canonisé après son martyre valaisan…
Un contemplatif poète et un saint militaire ont inspiré deux écrivains: Gérard Vincent dans Mort d’un chartreux, compose le journal d’un moine dont la tumeur au cerveau ne lui laisse que quelques mois à vivre ; et Bona Mangangu, dans Saint Maurice Porteur de foi, ressuscite le soldat nubien Maurice, canonisé après son martyre valaisan…







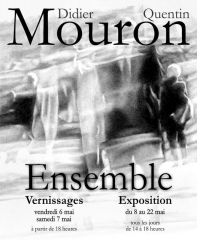 Illustrant un premier Dialogue entre l’Artiste (Didier) et l’écrivain Quentin), une magnifique exposition est à voir ces prochains jours à Giez (nord vaudois), qu’accompagne une publication exhaustive.
Illustrant un premier Dialogue entre l’Artiste (Didier) et l’écrivain Quentin), une magnifique exposition est à voir ces prochains jours à Giez (nord vaudois), qu’accompagne une publication exhaustive.
L’arrière-pays vaudois du pied du Jura est ces jours de toute beauté, avec ses modulations de vert tendre et d’ocres roux, le jaune acide des champs de colza et , par delà les eaux pâles du lac, là-bas, et les méplats de l’autre rive remontant vers l’Est, la ligne brisées des Préalpes qu’on aperçoit des fenêtres d’une grande ferme sise au cœur du village de Giez, sur les hauts du bourg lacustre de Grandson, en cet Espace DM conçu par Didier Mouron et son Isabelle, somptueux écrin pour une expo dont l’accrochage hyper-soigné raconte à lui seul une histoire. Il était une fois trois perfectionnistes…
Sur les murs de pierre apparente, ainsi, et sur plusieurs niveaux reliés par un escalier de solide vieux bois, c’est une autre histoire encore, ou plusieurs histoires même, que fixent 32 tableaux-poèmes flanqués de poèmes-images.
Même s’il a exposé à la Cité interdite (entre autres escales au Japon, en Californie, au Canada et même au Mont Pèlerin) et qu’il n’est pas inconnu en nos contrées, Didier Mouron (né en 1958 à Vevey) devrait être mieux reconnu, et particulièrement aujourd’hui où son art, strictement borné à l’usage du crayon mine, atteint une sorte de plénitude gracieuse, par delà sa parfaite technique et ses références naguère plus ou moins explicites, du côté de Salvador Dali et des surréalistes, du réalisme magique ou du symbolisme « cosmique ».
Ironiquement, c’est épuré de cette «littérature » que l’artiste, pourtant moins « littéraire » que son fils, rejoint Quentin dont la poésie, dès ses variations américaines de Lost accompagnant les formidables photographies de Claude Dussez (Favre, 2016) tend elle aussi à l’épure sans s’assécher pour autant dans le minimalisme…
Quand le cow-boy et l’Indien font ami-ami
Le rêve d’avoir un père à admirer, coïncidant avec l’admiration d’un père laissant librement son fils s’épanouir, la confluence d’un même sang n’excluant pas le parcours en vaisseaux séparés, chacun son âge et sa tête, chacun sa conviction d’être le chef dans sa partie, ni le fils de la fable freudienne impatient de buter son paternel pour se faire Jocaste, ni le père jaloux de ce rival montant en grappe, l’amour des arbres chez le cow-boy Didier et la passion des livres chez l’Indien Quentin - tout cela pourrait faire une assez épique bio croisée sur fond de forêt québécoise et de rivages vaudois, alors que l’artiste et l’écrivain ne se livrent ici, dans ce Dialogue, que par des objets cristallisant leurs communes émotions.
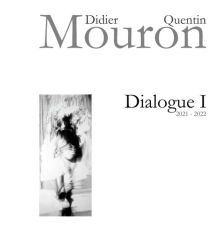
Telle étant la poésie : une sublimation, ici par l’image évocatrice, là par le mot décanté au plus juste. Jocaste ? Isabelle, dédicataire du recueil, inspire Quentin avec Femme et mère, trois vers comme d’un haïku : Elle a l’élégance des séismes / infinis / Qui trembleront encore après la terre, et le tableau de Didier, à double figure féminine, comme en abyme, flanquée d’un arbrisseau fragile, ouvre une troisième dimension au poème, à moins que ce soit l’inverse… Père et fils, au naturel, se chamaillent volontiers. Quentin reproche à son vieux de ne rien comprendre à la politique. Didier trouve ce petit crevé bien cassant parfois, bien sûr de lui, même s’il reconnaît que son propre Ego d’artiste lui est vital (je suis le best dans ma partie, sinon rien) et concède donc au Poète le droit et peut-être le devoir de se prendre lui aussi pour Céline ou Proust, au moins. Bref le Dialogue est la meilleure façon de poursuivre la guerre des générations autrement, et ça donne 32 poèmes étincelants jouxtant 32 tableaux, ou l’inverse. Qui racontent, chacun à sa façon, la foule et la foudre sur un boulevard, les moments de l’amour, caresses et disparitions, l’aïeule qui s’en va et les voleuses de feu, la mort en famille et les travailleuses de l’amour, des rabelaisiens et des rabelaisiennes, de la musique au clair de lune et des amants qui dérivent, rien de banal ou de mièvre, les mots sculptés, le clair-obscur drapé ou du sfumato de brume rêveuse et, de loin en loin, arrêt sur image et merveilles : Le Parfum de l’absente, dont la douceur contraste avec le dessin comme « ressaisi », des évocations frisant l’aporie sensible comme dans L’infini de ta disparition, de plus humbles « minutes heureuses » ramenant Baudelaire au quotidien, de la mélancolie et du fruit, du barbare et de la bête, enfin quoi : 32 fois la vie et ce n’est pas fini - la Poésie survit…
Didier et Quentin Mourom. Dialogue 1 (2021-2022). Préfacé par Bertrand R. Reich. Edition limitée.
Exposition. Dès le 6 mai 2022 (vernissage à 18h), Giez, espace DM.

Rappel : Claude Dussez (photographies) et Quentin Mouron (poèmes), Lost, Favre 2016.
Sur Les Plaisirs de la littérature, de John Cowper Powys.
C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun débile de nos jours. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’un petit délassement d’amateur au sens esthète ou d'un agité hyperfestif mais relèvent de la plus haute extatique jouissance, à la fois charnelle, intellectuelle et et spirituelle.
On connaît déjà John Cowper Powys pour sa révélatrice Autobiographie, les romans tout empreints de sensualité tellurique et de magie visionnaire que représentent Les sables de la mer, Wolf Solent et la tétralogie des Enchantements de Glastonbury, ou encore ses essais diversement inspirés sur Le sens de la culture et L’Art du bonheur. Or le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.
«Toute bonne littérature est une critique de la vie», affirme John Cowper Powys en citant Matthew Arnold, et cette position, à la fois radicale et généreuse, donne son élan à chacun de ses jugements, et sa nécessité vitale. Pour John Cowper Powys, la littérature se distingue illico des Belles Lettres au sens académique de l’expression. La littérature concentre, dans quelques livres qu’il nous faut lire et relire, la somme des rêves et des pensées que l’énigme du monde a inspiré à nos frères humains, et toutes les «illusions vitales», aussi, qui les ont aidés à souffrir un peu moins ou à endurer un peu mieux l’horrible réalité – quand celle-ci n’a pas le tour radieux de ce matin.
Rien de lettreux dans cette approche qui nous fait revivre, avec quelle gaîté communicative, les premiers émerveillements de nos lectures adolescentes, tout en ressaisissant la «substantifique moelle» de celles-ci au gré de fulgurantes synthèses. Rien non plus d’exhaustif dans ces aperçus, mais autant de propositions originales et stimulantes, autant de «germes» qu’il nous incombe de vivifier, conformément à l’idée que «toute création artistique a besoin d’être complétée par les générations futures avant de pouvoir atteindre sa véritable maturité».
Cette idée pascalienne d’une «société des êtres» qui travaillerait au même accomplissement secret du «seul véritable progrès» digne d’être considéré dans l’histoire des hommes, «c’est-à-dire l’accroissement de la bonté et de la miséricorde dans les cœurs» à quoi contribuent pêle-mêle les Ecritures et Rabelais, saint Paul et Dickens ou Walt Whitman, entre cent autres, ne ramène jamais à la valorisation d’une littérature édifiante au sens conventionnel de la morale. D’entrée de jeu, c’est bien plutôt le caractère subversif de la littérature que l’auteur met en exergue. «Une boutique de livres d’occasion est le sanctuaire où trouvent refuge les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l’humanité», relève-t-il avant de préciser que ladite boutique «fournit des armes au prophète dans sa lutte contre le prêtre, au prisonnier dans sa lutte contre la société, au pauvre dans sa lutte contre le riche, à l’individu dans sa lutte contre l’univers». Et de même trouve-t-il, dans l’Ancien Testament, «le grand arsenal révolutionnaire où l’individu peut se ravitailler en armes dans son combat contre toutes les autorités constituées», où le Christ a puisé avant de devenir celui que William Blake appelait le Suprême Anarchiste «qui envoya ses septante disciples prêcher contre la Religion et le Gouvernement».
Mais peu d’anarchistes sont aussi soucieux que Cowper Powys d’harmonie et d’équanimité. Si nous nous référons à la distinction faite par Léon Daudet entre écrivains incendiaires et sauveteurs, sans doute est-ce à la seconde catégorie qu’appartient no tre druide bienveillant. «Ce Celte tout de feu, de féerie et de magie est un bienfaiteur», écrit fort justement Gérard Joulié dont la traduction, soit dit en passant, respire la santé vigoureuse et l’élégance.
tre druide bienveillant. «Ce Celte tout de feu, de féerie et de magie est un bienfaiteur», écrit fort justement Gérard Joulié dont la traduction, soit dit en passant, respire la santé vigoureuse et l’élégance.
Rebouteux des âmes, John Cowper Powys nous communique des secrets bien plus qu’il ne nous assène des messages. Les ombres, voire l’obscénité de la littérature ne sollicitent pas moins son intérêt que ses lumières et ses grâces, et s’il répète après Goethe que «seul le sérieux confère à la vie un cachet d’éternité», nul ne pénètre mieux que lui les profondeurs de l’humour de Shakespeare ou de Rabelais.
A croire Powys, le pouvoir détonant de la Bible ne tient pas à sa doctrine spirituelle ou morale, mais «réside dans ses suprêmes contradictions émotionnelles, chacune poussée à l’extrême, et chacune représentant de manière définitive et pour tous les temps quelque aspect immuable de la vie humaine sur terre». La Bible est à ses yeux par excellence «le livre pour tous», dont la poésie éclipse toutes les gloses et dont trois motifs dominants assurent la pérennité: «la grandeur et la misère de l’homme, la terrifiante beauté de la nature, et le mystère tantôt effrayant et tantôt consolant de la Cause Première». Mais là encore, rien de trop étroitement littéraire dans les propos de ce présumé païen, dont le chapitre consacré à saint Paul nous paraît plus fondamentalement inspiré par «l’esprit du Christ» que mille exégèses autorisées.
Cet esprit du Christ qui est «le meilleur espoir de salut de notre f… civilisation», et qui se réduit en somme à l’effort séculaire d’humanisation des individus, constitue bonnement le fil rouge liant entre eux les vingt chapitres des Plaisirs de la littérature, courant d’un Rabelais dégagé des clichés graveleux aux visions christiques de Dickens et Dostoïevski, d’Homère fondant un «esprit divin de discernement» à Dante nous aidant à «sublimer notre sauvagerie humaine naturelle pour en faire le véhicule de notre vision esthétique», ou de Shakespeare, à qui l’humour ondoyant et sceptique tient lieu de philosophie, à Whitman qui suscite «une extension émotionnelle de notre moi personnel à tous les autres «moi» et à tous les objets qui l’entourent».
De la même façon, notre «moi» de lecteur, dans cette grande traversée de plein vent ou s’entrecroisent encore les sillages de Montaigne et de Melville, de Cervantès et de Proust, de Milton et de Nietzsche, se dilate sans se diluer, l’énergie absorbée par cette lecture se transformant finalement en impatience vive de remonter à chaque source et de sonder chaque secret.
John Cowper Powys. Les plaisirs de la littérature. Traduit de l’anglais par Gérard Joulié. L’Age d’Homme, 444p. Un dossier de la revue Granit a été consacré à Powys en 1973, constituant une bonne introduction à son œuvre.