
Livre - Page 26
-
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, XXVII)De la douce folie.– Et ce matin tu t’abandonnerais une fois de plus enfin à l’étreinte de ton vrai désir qu’annonçait le conditionnel de vos enfances, tu serais tout ce que tu aimerais, tu serais une chambre merveilleuse au milieu de la neige revenue ce matin avec une quantité de téléphones, tu aurais des bottes bleues et un banjo comme à sept ans et tu retomberais amoureux pour la énième fois, elle aurait les yeux bleu pervenche de la fille du shérif de tes dix ans et des poussières et de la femme de ta vie actuelle dont tu reprendrais tout à l’heure le portrait songeur, ce serait la journée incomparable de ce 5 mars 2009, tu jouerais de ta plume verte comme d’une harpe pincée sur les cordes des heures et tout à coups les téléphones frémiraient comme autant de jeunes filles impatientes, autant de douce ondines un peu dingues se dandinant sur leur fil comme autant de choristes de gospel dans la cathédrale de neige irradiant au lever du ciel…Des recoins. – Ce n’est que cela, comprenez-vous, ce n’est que cela qui m’attire chez vous, au milieu des rideaux grenats ou au fond de vos fauteuils crevés, ce sont les angles brisés à coups de marteau par le vieux Renoir endiablé, et votre lumière est bonne, votre bonne lumière de bar étudiant ou de virée le long de la rivière à quelques-uns qui aimaient Neil Young et Léo Ferré, ce ne serait que cette rêverie retrouvée de nos dix-huit ans adorablement accablés à nous aimer – leurs galas ne sont que ramas de vampires banquiers sur les banquises des médias, nous c’est dans les recoins de vos quartiers bohèmes que nous vivrons comme des chats baudelairiens…De l’autre lumière. – Et toujours je reviendrai l’œil secret de cet étang d’étain sous la lumière silencieuse de ce lever du jour qui pourrait en être le déclin, on ne sait trop, Rembrandt lui-même ne savait trop ce qu’il révélait en mâchant ses cigares - et surtout pas d’effets de théâtre, de clair-obscur ou de faux mystère, laissez venir la beauté des choses qui n’a jamais été séparée de son ombre et qui diffuse cette aura sans le chercher…Peinture JLK: Lago delle streghe, al Devero.
(Pensées de l'aube, XXVII)De la douce folie.– Et ce matin tu t’abandonnerais une fois de plus enfin à l’étreinte de ton vrai désir qu’annonçait le conditionnel de vos enfances, tu serais tout ce que tu aimerais, tu serais une chambre merveilleuse au milieu de la neige revenue ce matin avec une quantité de téléphones, tu aurais des bottes bleues et un banjo comme à sept ans et tu retomberais amoureux pour la énième fois, elle aurait les yeux bleu pervenche de la fille du shérif de tes dix ans et des poussières et de la femme de ta vie actuelle dont tu reprendrais tout à l’heure le portrait songeur, ce serait la journée incomparable de ce 5 mars 2009, tu jouerais de ta plume verte comme d’une harpe pincée sur les cordes des heures et tout à coups les téléphones frémiraient comme autant de jeunes filles impatientes, autant de douce ondines un peu dingues se dandinant sur leur fil comme autant de choristes de gospel dans la cathédrale de neige irradiant au lever du ciel…Des recoins. – Ce n’est que cela, comprenez-vous, ce n’est que cela qui m’attire chez vous, au milieu des rideaux grenats ou au fond de vos fauteuils crevés, ce sont les angles brisés à coups de marteau par le vieux Renoir endiablé, et votre lumière est bonne, votre bonne lumière de bar étudiant ou de virée le long de la rivière à quelques-uns qui aimaient Neil Young et Léo Ferré, ce ne serait que cette rêverie retrouvée de nos dix-huit ans adorablement accablés à nous aimer – leurs galas ne sont que ramas de vampires banquiers sur les banquises des médias, nous c’est dans les recoins de vos quartiers bohèmes que nous vivrons comme des chats baudelairiens…De l’autre lumière. – Et toujours je reviendrai l’œil secret de cet étang d’étain sous la lumière silencieuse de ce lever du jour qui pourrait en être le déclin, on ne sait trop, Rembrandt lui-même ne savait trop ce qu’il révélait en mâchant ses cigares - et surtout pas d’effets de théâtre, de clair-obscur ou de faux mystère, laissez venir la beauté des choses qui n’a jamais été séparée de son ombre et qui diffuse cette aura sans le chercher…Peinture JLK: Lago delle streghe, al Devero. -
Ceux qui ont opinion sur rue
 Celui qui se prononce sur tout avec une autorité qui se veut très humble en son insondable prétention genre Michel Onfray sur les limites de la théorie des cordes ou l’application des ventouses à l’ancienne en cas de fluxion / Celle qui se veut influenceuse en matière de choix de lessives écoresponsables / Ceux qui citent Héraclite au saut du lit / Celui qui se dit en recherche d’une éthique du profit assumé / Celle qui formate les futurs cadres issus des cités / Ceux qui ont leur idée du pourquoi des séismes en terres islamistes / Celui qui pense que la race supérieure viendra d’en bas et l’affirme tout haut au risque d’énerver la classe moyenne usagère des réseaux / Celle qui milite pour le noir à lèvres de la marque Goudron / Ceux qui listent les noms des diffuseurs d’opinions inappropriées qui sont souvent des femmes seules il faut le relever / Celui qui se demande si un Adolf Hitler aurait sa chance sur Twitter même en raccourcissant ses discours / Celle qui ose dire sa différence aux milliers de followers qui partagent son ressenti / Ceux qui se disent exclus en langage inclusif / Celui qui en tant que garçon laitier sent la fille en lui quand il hume la première traite / Celle qui cite Heidegger avec les notes en bas de page / Ceux qui estiment qu’on peut tout dire moyennant l’accord tacite de Mark Zuckerberg et toute son équipe / Celui qui brait avec les loups / Celle qu’inquiètent les longs silences de son amie Rebecca si diserte naguère sur Facebook / Ceux qui tapent l’incruste sur TikTok pour reprendre l’expression d’une meuf grave branchée de la rédaction culturelle du journal de nos campagnes / Celui qui pense faire un tiré à part de ses bons mots sur Twitter / Celle qui trouve à Bezos un côté Musk et vice versa / Ceux qui s’abstiennent de tout commentaire en espérant que ça se remarque, etc.Peinture : Neil Rands, Falling man.
Celui qui se prononce sur tout avec une autorité qui se veut très humble en son insondable prétention genre Michel Onfray sur les limites de la théorie des cordes ou l’application des ventouses à l’ancienne en cas de fluxion / Celle qui se veut influenceuse en matière de choix de lessives écoresponsables / Ceux qui citent Héraclite au saut du lit / Celui qui se dit en recherche d’une éthique du profit assumé / Celle qui formate les futurs cadres issus des cités / Ceux qui ont leur idée du pourquoi des séismes en terres islamistes / Celui qui pense que la race supérieure viendra d’en bas et l’affirme tout haut au risque d’énerver la classe moyenne usagère des réseaux / Celle qui milite pour le noir à lèvres de la marque Goudron / Ceux qui listent les noms des diffuseurs d’opinions inappropriées qui sont souvent des femmes seules il faut le relever / Celui qui se demande si un Adolf Hitler aurait sa chance sur Twitter même en raccourcissant ses discours / Celle qui ose dire sa différence aux milliers de followers qui partagent son ressenti / Ceux qui se disent exclus en langage inclusif / Celui qui en tant que garçon laitier sent la fille en lui quand il hume la première traite / Celle qui cite Heidegger avec les notes en bas de page / Ceux qui estiment qu’on peut tout dire moyennant l’accord tacite de Mark Zuckerberg et toute son équipe / Celui qui brait avec les loups / Celle qu’inquiètent les longs silences de son amie Rebecca si diserte naguère sur Facebook / Ceux qui tapent l’incruste sur TikTok pour reprendre l’expression d’une meuf grave branchée de la rédaction culturelle du journal de nos campagnes / Celui qui pense faire un tiré à part de ses bons mots sur Twitter / Celle qui trouve à Bezos un côté Musk et vice versa / Ceux qui s’abstiennent de tout commentaire en espérant que ça se remarque, etc.Peinture : Neil Rands, Falling man. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, XXVI)De l’innocence. - Le mot DANSE m’apparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant, petite, toute nue et belle dans un long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser...Du respect.– Peut-être cela vous manque-t-il seulement, dans le déni de ce que vous faites ou la simple inattention, de ne pas pouvoir partager, non pas l’estime de votre petite personne, mais l’amour de la personne innombrable dont ce que vous faites n’est qu’un des innombrables reflets, mais unique…De notre complicité. – À peine vous êtes-vous retrouvés, les oiseaux et toi qui leur parles ta langue de fée, que retentissent leurs cris froids de calculateurs de points et de résultats réduisant tout à concours et performances du plus fort et du plus vite enrichi, mais de te regarder avec les oiseaux m’éloigne chaque jour un peu de leur bruit et nous voici dans la vraie société des êtres à nous parler de cette journée qui nous attend tous les deux…
(Pensées de l'aube, XXVI)De l’innocence. - Le mot DANSE m’apparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant, petite, toute nue et belle dans un long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser...Du respect.– Peut-être cela vous manque-t-il seulement, dans le déni de ce que vous faites ou la simple inattention, de ne pas pouvoir partager, non pas l’estime de votre petite personne, mais l’amour de la personne innombrable dont ce que vous faites n’est qu’un des innombrables reflets, mais unique…De notre complicité. – À peine vous êtes-vous retrouvés, les oiseaux et toi qui leur parles ta langue de fée, que retentissent leurs cris froids de calculateurs de points et de résultats réduisant tout à concours et performances du plus fort et du plus vite enrichi, mais de te regarder avec les oiseaux m’éloigne chaque jour un peu de leur bruit et nous voici dans la vraie société des êtres à nous parler de cette journée qui nous attend tous les deux… -
Ralentir: chef-d'oeuvre
À propos de Vivre (Ikiru), d’Akira Kurosawa
Akira Kurosawa considérait Ikiru (1952) comme son chef-d’œuvre. C’est en effet un film extraordinaire, dont le thème recoupe celui de La mort d’Ivan Illitch, nouvelle non moins inoubliable de Léon Tolstoï. De quoi s’agit-il plus précisément ? D’un homme soudain confronté à sa mort annoncée, qui fait un bilan tout négatif de la vie qu’il a menée jusque-là et qui essaie de se sauver in extremis.
Le film de Kurosawa retrace d’abord le portrait du personnage surnommé « la momie » par ses collègues de l’Administration dont il dirige la Section des citoyens; c'est type même du bureaucrate sclérosé qui s’oppose à toute réforme et notamment aux requêtes des citoyennes en matière de jardins d’enfants. Apprenant qu’il est atteint d’un cancer inguérissable, il commence par se lancer dans une débauche compulsive qui ne le satisfait guère, puis ce début de récit finit abruptement, et tout recommence alors tout autrement. La suite se passe ainsi dans un local où se trouve réunie une assemblée de femmes et d’hommes, sous le portrait voilé de crêpe de « la momie ». On comprend que c’est une cérémonie du souvenir, après la mort du personnage, l’on y boit beaucoup et les langues se délient. Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura.
Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura. Le film est disponible en DVD.
-
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, XXV)De la forme. – Délivre-toi de ce besoin d’illimité qui te défait, rejette ce délire vain qui te fait courir hors de toi, le dessin de ce visage et de chaque visage est une forme douce au toucher de l’âme et le corps, et la fleur, et les forme douces du jour affleurant au regard des fenêtres, et les choses, toutes les choses qui ont une âme de couleur et un cœur de rose - tout cela forme ton âme et ta prose…De l’infinitésimal toi. – Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…De la réalité. – C’est parfois par le rêve que nous vient la perception physique, terrifiante, de la réalité : de ce qui est réellement réel, sans échappatoire aucune, à ramper dans cette galerie obscure menant Dieu sait où – et soudain le réveil sonne et c’est la nuit d’hiver, et personne on dirait avant que l’odeur du café ne dissipe la réalité du rêve…De l’autre côté du jour.– Tout le jour à chanter le jour tu en es venu à oublier l’envers du jour, la peine du jour et la pauvreté du jour, la faiblesse du jour et le sentiment d’abandon que ressent la nuit du jour, le terrible silence du jour au milieu des bruyants, la terrible solitude des oubliés du jour et des humiliés, des offensés au milieu des ténèbres du jour…Peinture: Floristella Stephani, Ostende.
(Pensées de l'aube, XXV)De la forme. – Délivre-toi de ce besoin d’illimité qui te défait, rejette ce délire vain qui te fait courir hors de toi, le dessin de ce visage et de chaque visage est une forme douce au toucher de l’âme et le corps, et la fleur, et les forme douces du jour affleurant au regard des fenêtres, et les choses, toutes les choses qui ont une âme de couleur et un cœur de rose - tout cela forme ton âme et ta prose…De l’infinitésimal toi. – Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…De la réalité. – C’est parfois par le rêve que nous vient la perception physique, terrifiante, de la réalité : de ce qui est réellement réel, sans échappatoire aucune, à ramper dans cette galerie obscure menant Dieu sait où – et soudain le réveil sonne et c’est la nuit d’hiver, et personne on dirait avant que l’odeur du café ne dissipe la réalité du rêve…De l’autre côté du jour.– Tout le jour à chanter le jour tu en es venu à oublier l’envers du jour, la peine du jour et la pauvreté du jour, la faiblesse du jour et le sentiment d’abandon que ressent la nuit du jour, le terrible silence du jour au milieu des bruyants, la terrible solitude des oubliés du jour et des humiliés, des offensés au milieu des ténèbres du jour…Peinture: Floristella Stephani, Ostende. -
Prends garde à la douceur
(Pensées de l'aube, XXIV)D’un autre chant.– Et si tu n’as pas de mots pour dire cette aube qu’il fait ce matin comme au désert ou sur la page blanche de la mer, chante-là en silence, tout à l’heure une main de lumière s’est posée à la crête des monts et tout ensuite, de l’ubac, une maison après l’autre, s’est allumé, mais comment le dire avec des mots ?De la juste mesure. – Ce que tu te demandes aussi en voyant le rideau se lever sur la scène du jour, c’est quelle pièce va se jouer dans les heures qui viennent, qui tu seras, dans quelle peau, quel autre rôle tu pourrais jouer, si tu pouvais être plus juste qu’hier soir après avoir goûté une fois de plus du Milk of Human Kindness du Big Will - trois heures durant, Mesure pour mesure, la poésie du Big Will t’a traversé et t’habite encore ce matin, or seras-tu ce matin l’intransigeance d’Angelo le taliban ou la clémence du bon gouvernement, seras-tu la vierge ou la catin, seras-tu glapissement de mauvaise langue ou parole de bienveillance ?Des matinaux.– Le silence scandé par leurs pas n’en finit pas de me ramener à toi, vieille frangine humanité, impure et puante juste rafraîchie avant l’aube dans les éviers et les fontaines, tes matinales humeurs de massacre, ta rage silencieuse contre les cons de patrons et tes première vannes au zinc, tout ton allant courageux revenant comme à nos aïeux dans le bleu du froid des hivers plus long que de nos jours, tout ce trépignement des rues matinales me ramène à toi, vieux frère humain…Du fil des jours.– N’est-ce vraiment qu’une affaire de particules et de circuits électriques, te demandes-tu en remontant du souterrain où tu as passé la nuit, n’y aurait-il pas autre chose, te demandes-tu en te dirigeant vers les fenêtres encore aveugles, n’y a-t-il que ce tapage d’âmes mortes dans le silence des rues et des pages vides, n’y aura-t-il plus jamais que ces phénomènes et ces phénomènes, ou le jour va-t-il te surprendre une fois de plus et renouer le fil de ton souffle et de ton encre ?...Peinture: Thierry Vernet. -
Je me souviens de La Doulou
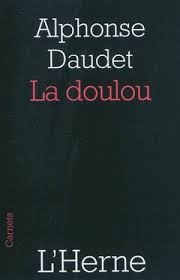
(Pour ceux qui savent ce qu'elle est, et surtout pour les autres))
Je me souviens de ce qu’on m’a dit des cris de douleur de mon frère aîné, renversé par une voiture sur la Route d’En Haut et que j’étais trop petit pour visiter au pavillon de traumatologie avec notre mère « dans tous ses états »…
°°°
Je me souviens, plus encore que de la lecture du Petit Chose et des Lettres de mon moulin, de celle de La Doulou d’un Alphonse Daudet marquée au fer rouge de la torture quotidienne…
°°°
Je me souviens de l’air désolé de notre père, dans les périodes les plus dures de sa maladie, et de son air de s’excuser de « déranger »…
°°°
Je me souviens de la grande salle de l’hôpital cantonal aux vingt-cinq lits de petits lascars dont les plus mal en point étaient les moins bruyants…
°°°
Je me souviens de la douleur muette émanant du visage de cire fondue du petit Toupie, mon camarade de classe leucémique plus habile que moi au jeu du Mikado, auquel j’offris, lors de ma visite que je ne savais pas être la dernière, un Argus bleu ciel pour sa collection de papillons…
°°°
Je me souviens des rugissements de fureur et des hurlements de détresse quasi enfantine de mon vieux voisin de box, aux urgences du CHUV en je ne sais plus quelle année, auquel on venait d’apprendre en pleine nuit qu’on allait l’amputer de sa jambe déjà gagnée par la gangrène, et de son lit vide le lendemain matin.
°°°
Je me souviens, au lendemain de l’accident de moto qui m’amena inconscient au pavillon de traumatologie de l’ancien hôpital cantonal, de la douleur impuissante que j’éprouvai en découvrant l’état de mes jeunes voisins de chambre dont beaucoup ne marcheraient plus jamais – et la vision terrifiante de celui d’entre eux qui passait ses journées à plat ventre dont le dos nu sculpural était celui d’un athlète apprécié de sa société de gymnastique…
°°°
Je me souviens de la lecture de J’ai saigné, évoquant sous la plume de Blaise Cendrars la fin atoce de son jeune voisin de chambre, et du discours imbécile du gradé lui expliquant en passant que son martyre lui était offert par La France…°°°
Je me souviens de la phase consternante de Ramuz, bien au cocon dans sa chambre de littérateur, au moment même où Cendrars se fait amputer, qui dit comme ça que oui, que c’est terrible, ces jeunes qui meurent de l’autre côté des frontières, mais qu’en somme savoir qu’ils meurent est presque aussi douloureux que mourir soi-même , n’est-ce pas…
°°°
Je me souviens de ce que je ne souvenais de rien quand mes camarades m’ont ramassé au pied des trente premiers mètres de la première longueur de l’arête W de l’Aiguille Purtscheller après un chute opportunément adoucie par la neige…°°°
Je me souviens de l’effroi paralysant que j’éprouvai après le téléphone d’Hèlène m’apprenant, à mon bureau de chef de la culturelle du Matin, ce 16 août 1985, que mon ami Reynald n’était pas rentré de la course que nous devions faire ensemble au Mont Dolent et qu’il avait finalement décidé de faire seul…
°°°
Je me souviens du long silence et des larmes que nous avons partagés au sommet du Dolent, un mois près la mort de Reynald, avant que nous ne balancions ses cendres dans la face glaciaire par grand beau temps...
°°°
Je me souviens du corps prêt à être lavé de notre père, et de notre mère désignant ses multiples hématomes comme les stigmates d’un long martyre...°°°
Je me souviens de la remarque de mon ami Dimitri, des mois après le grave accident qui lui valut des souffrances extrêmes, selon laquelle il lui avait fallu cette épreuve pour concevoir les douleurs du Christ sur la croix…°°°
Je me souviens du regard un peu étonné de notre petite Sophie dans la nuit de son premier faux croup…°°°
Je me souviens des éclats de rire argentins de la petite Louise à laquelle nous avions offert un Pégase bleu à crinière violette volant crânement au-dessus de son lit de douleurs à quelques semaines de sa mort annoncée…°°°
Je me souviens que c’est grâce à l’immobiiisation forcée due à mon accident de moto que j’ai écrit mon premier livre en trois mois…°°°
Je me souviens avec une extrême précision de chaque souffrance morale que j’ai pu infliger à ceux que j’aime, je me souviens aussi de leurs occasionnelles douleurs physiques, sans avoir rien retenu des miennes que le surcroît de lucidité et d’attention reconnaissante que mérite la bonne vie…
°°°
Je me souviens que nous aurons bien ri, certain soir à Cetona, au fin fond de la Toscane, quand Guido Ceronetti m’a lancé de sa voix aiguë et grave la fois : «La vie est vache !» , et que je lui ai répondu selon le code millénaire: «Mais rien ne vaut la vie !»…Sur La Doulou…
La Doulou d'Alphonse Daudet est l'un des rares ouvrages traitant directement et uniquement de la douleur physique. Le courage consiste à ne pas effrayer les autres.
Du jour où la Douleur est entrée dans ma vie…
A quoi ça sert, les mots ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs, impuissants ou menteurs...
Douleur toujours nouvelle pour moi et qui se banalise pour eux. Ils s’y habituent, moi pas…Croissance morale et intellectuelle par la douleur, mais jusqu'à un certain point.
Extraits
Retour de la douche avec X, un malade de la tête, que je réconforte — que je « frictionne » en chemin, pour le plaisir si humain de me faire de la chaleur à moi-même.… du jour où la Douleur est entrée dans ma vie…
Ce que j’ai souffert hier soir — le talon et les côtes ! La torture… pas de mots pour rendre ça, il faut des cris.
D’abord, à quoi ça sert, les mots, pour tout ce qu’il y a de vraiment senti en douleur (comme en passion) ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenir, impuissants ou menteurs.Pas d’idée générale sur la douleur. Chaque patient fait la sienne, et le mal varie, comme la voix du chanteur, selon l’acoustique de la salle.
Douleur toujours nouvelle pour celui qui souffre et qui se banalise pour l’entourage. Tous s’y habitueront, excepté moi.
Douleur qui se glisse partout, dans ma vision, mes sensations, mon jugement ; c’est une infiltration.
Et j’imaginais une conversation de Jésus avec les deux larrons sur la Douleur.
Dans ma pauvre carcasse creusée, vidée par l’anémie, la douleur retentit comme la voix dans un logis sans meubles ni tentures. Des jours, de longs jours où il n’y a plus rien de vivant en moi que le souffrir.
Ecrit pendant l’une de ces crises.
Croissance morale et intellectuelle par la douleur, mais jusqu'à un certain point.
La lutte, ce qu’il y a de plus affreux. Au moins, le jour où il n’y a plus moyen de bouger…
Mon sosie. L’homme dont le mal se rapproche le plus du vôtre. Comme on l’aime, comme on le fait parler. Moi, j’en ai deux : un peintre italien, un conseiller à la Cour d’appel, qui, à eux deux, sont ma souffrance.
Des enfants malades. Causé avec un petit. Certaine fierté dans ses douleurs. (Fragilité des os).
Mais je souffre, moi aussi, et en ce moment ; mais j’ai pris l’habitude de garder mes souffrances pour moi ; quand la crise est trop forte et que je me laisse aller à une plainte un peu vive, c’est un tel bouleversement autour de moi ! « Qu’est-ce que tu as ? D’où souffres-tu ? » Il faut avouer que c’est toujours la même chose et qu’on serait en droit de nous dire : « Oh ! alors, si ce n’est que ça ! »
Car cette douleur, toujours nouvelle pour nous, notre entourage y est habitué, elle deviendrait vite une fatigue pour tout le monde, même pour ceux qui nous aiment le plus. La pitié s’émousse. Aussi, ne serait-ce par générosité, c’est par fierté que je retiendrais mes plaintes, pour ne jamais lire dans les yeux les plus chers la fatigue ou l’ennui.
-
Au scalpel, Jérémie André dissèque le corps sociétal...
 Dans La Fabrique du corps humain, Jérémie André, médecin de métier et d’esprit, tant que de méthode, propose une approche clinique et behavioriste d’une partie de la réalité lausannoise actuelle, localisée au quartier du Flon à forte symbolique sociale, avec trois personnages typés de notre drôle de monde...Il manque un Zola au roman romand, affirmait en substance l’éditeur Vladimir Dimitrijevic, directeur de L’Age d’Homme, dans un article paru à la fin des années 1970 dans la Gazette littéraire.Déplorant le manque d’ancrage social de notre littérature, et plus précisément depuis la mort de Ramuz, déjà confiné dans le monde rural, l'éditeur constatait que nos romanciers achoppent aux états d’âme de pasteurs ou de professeurs et autres intellectuels plus qu’aux multiples aspects de la société en mutation, dont notre littérature individualiste et plus ou moins spiritualisante, ou politiquement moralisante, ne garderait aucun témoignage significatif comparable aux romans d’un Zola, d’un Balzac ou, plus récemment, d’un Jules Romains ou d’un Georges Simenon.En macho balkanique bon teint, celui que nous appelions Dimitri faisait l’impasse sur l’implication sociale conséquente de plusieurs romancières, d’Alice Rivaz à Janine Massard ou Mireille Kuttel et Anne Cuneo (toutes deux issues de l’immigration italienne), mais le constat ouvrait bel et bien un débat quasi inexistant dans la critique littéraire du moment.
Dans La Fabrique du corps humain, Jérémie André, médecin de métier et d’esprit, tant que de méthode, propose une approche clinique et behavioriste d’une partie de la réalité lausannoise actuelle, localisée au quartier du Flon à forte symbolique sociale, avec trois personnages typés de notre drôle de monde...Il manque un Zola au roman romand, affirmait en substance l’éditeur Vladimir Dimitrijevic, directeur de L’Age d’Homme, dans un article paru à la fin des années 1970 dans la Gazette littéraire.Déplorant le manque d’ancrage social de notre littérature, et plus précisément depuis la mort de Ramuz, déjà confiné dans le monde rural, l'éditeur constatait que nos romanciers achoppent aux états d’âme de pasteurs ou de professeurs et autres intellectuels plus qu’aux multiples aspects de la société en mutation, dont notre littérature individualiste et plus ou moins spiritualisante, ou politiquement moralisante, ne garderait aucun témoignage significatif comparable aux romans d’un Zola, d’un Balzac ou, plus récemment, d’un Jules Romains ou d’un Georges Simenon.En macho balkanique bon teint, celui que nous appelions Dimitri faisait l’impasse sur l’implication sociale conséquente de plusieurs romancières, d’Alice Rivaz à Janine Massard ou Mireille Kuttel et Anne Cuneo (toutes deux issues de l’immigration italienne), mais le constat ouvrait bel et bien un débat quasi inexistant dans la critique littéraire du moment. D’anamnèse en catamnèse…Or j’y ai repensé en lisant le premier roman de Jérémie André qui, sans la vigueur de perception et d’expression d’un Zola, surprend et intéresse par son regard « sociologique » sur le monde qui est le nôtre, ici et maintenant, avec trois personnages représentatifs d’une certaine génération (ceux qu’on appelle les millenials , dépolitisés et en quête de sens dans leur petite vie bien formatée), à savoir Dominique Mercier, jeune médecin issu d’une famille d’industriels lausannois illustres, Anna, « ex » du précédent que son bac de lettres n’a pas conduit en faculté mais à un poste de responsabilité dans les cuisines d'un fast food, et Jean-Pierre le manager de cette enseigne du Brother Burger, qui rêve de faire de chacun de ses employés un «entrepreneur» virtuel qui s’éclaterait au travail...Notre ami Dimitri déplorait que nos romanciers fissent si peu de cas des métiers de leurs personnages, par ailleurs si peu représentatifs de notre société, faute aussi de détails concrets dans leur observation, alors que c’est par là que Jérémie André impose sa patte et son originalité, à la fois ténues et tenues, dans une sorte de pointillisme hyperréaliste. Cela pourrait être assommant, et c'est au contraire captivant, et quasi fascinant que de (re) découvrir le monde en termes d'anatomie ou de physiologie appliquée, de s'initier à la gestion des friteuses d'un fast food dont les employés sont surveillés par vidéo, de revivre l'année Erasmus d'un étudiant en médecine s'efforçant de concilier ses rudes études et son désir d'Anna en 3 D, bref de voir le monde tel qu'il est, effrayant de réalité réelle, où l'ex Gianpietro, en sympathie avec son employé Samson responsable du nettoyage du Brother Burger, affiche une couleur de peau dite «compatible avec son origine africaine» . Plus woke tu rends ton tablier !La Fabrique du corps humain , dont le titre se rapporte à celui du fameux ouvrage d’anatomie descriptive d’André Vesale (1514-1564), se subdivise en trois parties intitulées Anamnèse familiale, Anamnèse actuelle et Catamnèse, dont le Flon est le fil conducteur.
D’anamnèse en catamnèse…Or j’y ai repensé en lisant le premier roman de Jérémie André qui, sans la vigueur de perception et d’expression d’un Zola, surprend et intéresse par son regard « sociologique » sur le monde qui est le nôtre, ici et maintenant, avec trois personnages représentatifs d’une certaine génération (ceux qu’on appelle les millenials , dépolitisés et en quête de sens dans leur petite vie bien formatée), à savoir Dominique Mercier, jeune médecin issu d’une famille d’industriels lausannois illustres, Anna, « ex » du précédent que son bac de lettres n’a pas conduit en faculté mais à un poste de responsabilité dans les cuisines d'un fast food, et Jean-Pierre le manager de cette enseigne du Brother Burger, qui rêve de faire de chacun de ses employés un «entrepreneur» virtuel qui s’éclaterait au travail...Notre ami Dimitri déplorait que nos romanciers fissent si peu de cas des métiers de leurs personnages, par ailleurs si peu représentatifs de notre société, faute aussi de détails concrets dans leur observation, alors que c’est par là que Jérémie André impose sa patte et son originalité, à la fois ténues et tenues, dans une sorte de pointillisme hyperréaliste. Cela pourrait être assommant, et c'est au contraire captivant, et quasi fascinant que de (re) découvrir le monde en termes d'anatomie ou de physiologie appliquée, de s'initier à la gestion des friteuses d'un fast food dont les employés sont surveillés par vidéo, de revivre l'année Erasmus d'un étudiant en médecine s'efforçant de concilier ses rudes études et son désir d'Anna en 3 D, bref de voir le monde tel qu'il est, effrayant de réalité réelle, où l'ex Gianpietro, en sympathie avec son employé Samson responsable du nettoyage du Brother Burger, affiche une couleur de peau dite «compatible avec son origine africaine» . Plus woke tu rends ton tablier !La Fabrique du corps humain , dont le titre se rapporte à celui du fameux ouvrage d’anatomie descriptive d’André Vesale (1514-1564), se subdivise en trois parties intitulées Anamnèse familiale, Anamnèse actuelle et Catamnèse, dont le Flon est le fil conducteur. Le Flon à travers les âges…À préciser alors, pour les « étrangers du dehors » , comme on les appelle chez nous, que le Flon est un agreste ruisseau sorti de la forêt des hauts de Lausanne, qui s’embourbe un peu à mi-pente citadine et, de géographique, est devenu historique grâce notamment à la diligence capitaliste de la famille Mercier, en tant que quartier industriel de tanneries spécialisées dans la production de veau ciré prisée des Américains, puis de zone d’entrepôts utilitaires où filles de joie et dealers se croisaient dans la pénombre, puis de réserve alternative à dégaine de mini-Soho, enfin de quartier branché en perte d’âme bohème.Industrie, culture et commerce marquent la progression trinitaire du Flon. Un restau autogéré, à l’enseigne du Cancrelat, refuge de squatteurs et désaffecté à la suite d’une rixe, symbolise ici l’évolution du Flon puisque en son lieu et place s’est implanté un restau de la chaîne Brother Burger où, cinq ans après leur rencontre et leur love story, Dominique Mercier et Anna se retrouvent... sans se retrouver vraiment.Il faut dire que ce Dominique-là est plus Mercier que nature, plus grave en fin de race studieux et un brin pédant et péremptoire, et l’on comprend qu’Anna ne lui saute pas au cou, mais elle non plus n’est pas du genre passionné, qui se soumet au formatage du Brother Burger avec une docilité qui n’a d’égale que la conformité fonctionnelle du manager Jean-Pierre...
Le Flon à travers les âges…À préciser alors, pour les « étrangers du dehors » , comme on les appelle chez nous, que le Flon est un agreste ruisseau sorti de la forêt des hauts de Lausanne, qui s’embourbe un peu à mi-pente citadine et, de géographique, est devenu historique grâce notamment à la diligence capitaliste de la famille Mercier, en tant que quartier industriel de tanneries spécialisées dans la production de veau ciré prisée des Américains, puis de zone d’entrepôts utilitaires où filles de joie et dealers se croisaient dans la pénombre, puis de réserve alternative à dégaine de mini-Soho, enfin de quartier branché en perte d’âme bohème.Industrie, culture et commerce marquent la progression trinitaire du Flon. Un restau autogéré, à l’enseigne du Cancrelat, refuge de squatteurs et désaffecté à la suite d’une rixe, symbolise ici l’évolution du Flon puisque en son lieu et place s’est implanté un restau de la chaîne Brother Burger où, cinq ans après leur rencontre et leur love story, Dominique Mercier et Anna se retrouvent... sans se retrouver vraiment.Il faut dire que ce Dominique-là est plus Mercier que nature, plus grave en fin de race studieux et un brin pédant et péremptoire, et l’on comprend qu’Anna ne lui saute pas au cou, mais elle non plus n’est pas du genre passionné, qui se soumet au formatage du Brother Burger avec une docilité qui n’a d’égale que la conformité fonctionnelle du manager Jean-Pierre... La Fabrique du corps humain pourrait être une satire, voire un pamphlet contre la déshumanisation des relations humaines et du travail, mais là encore on est loin du Zola de Germinal ou du pamphlétaire dreyfusard de J’accuse: à ras les faits et les affects, dans une sorte de neutralité objective bien vaudoise et protestante.Du moins l’ironie sous-jacente de l’auteur, et comme une tristesse latente liée à l'adieu à la folle (?) jeunesse, donnent-elles au roman sa dimension critique frottée de mélancolie, qui incite à la réflexion.Est-ce ainsi que les hommes vivent ? interrogeait Aragon. Et le statut de la femme est intégré dans la question par le truchement d’une prof d’anatomie retraitée conspuant le patriarcat en termes « woke », ou par le rôle assigné à Anna qui, dans la foulée, dresse le réquisitoire de l’aliénation objective que représente l’idéologie et la pratique quotidienne de son manager.Par delà la dissection…Dans son Journal littéraire, Paul Léautaud se gaussait de la niaiserie d'un certain professeur de médecine, éminent chirurgien qui ouvrait les corps sans rien comprendre à ce qui se passait dans les coeurs et les âmes des ses patients, et c'est aussi l'expérience qu'est amené à faire, ici, le jeune Dominique, constatant que son désir d’Anna et la réalité de la vie ne sont en rien réductibles à la nomenclature de Vésale.Avec une honnêteté remarquable, qui est là encore celle du médecin, Jérémie André se garde de dorer la pilule du lecteur (et de la lectrice, n'est-ce pas?) en arrangeant un dénouement glamoureux à ce qui ressemble à un épisode de feuilleton, tout en traitant ses trois personnages avec une distance frottée d'ironie - surtout en ce qui concerne le self made man Jean-Pierre, ex-Gianpietro au prénom francisé sur le conseil de son coach de vie - sans aboutir à la satire du brave nouveau monde qui nous entoure.Limites et enjeux d'un premier romanSi l'écrivain Jérémie André doit beaucoup, en l'occurrence, au médecin, celui-ci limite sans doute, aussi, ce qui pourrait faire s'exprimer plus librement et plus amplement l'écrivain, dont plusieurs thèmes du roman mériteraient d'être plus développés. Autant que des grandes fresque em pleine pâte d'un Zola, l'on est loin ici des visions existentielles fusionnées des grands écrivains-médecins que furent un Tchekhov ou un Céline.Mais Jérémie André s'est doté, dès son premier roman, d'un appareil d'observation et de formulation qui pourrait s'étendre à toute la société - par delà les thèmes sociétaux - où l'on verrait l'écrivain, stéthoscope en bandoulière, sillonner toutes les strates du corps social, de tel club de femmes botanistes à telle salle d'attente d'un service d'oncologie, de telle conférence des maîtres de telle Haute Ecole à la buvette de tel camping, de tel open space de rédaction à telle réunion de tel ou tel parti, ainsi de suite.Pérorer sur l'impuissance sexuelle, déclarée la maladie de l'époque, en invoquant Georges Bataille, comme s'y emploie tel doyen de faculté en urologue retiré des touchers rectaux, est une chose, et tout autre chose d'approcher les corps en concurrence avec les machines, les médecins face aux ordinateurs, les caissières de fast food chronométrant leur prises de commande, la folie ordinaire devenue norme redimensionnée en séances de team coaching, en attendant les constats d'obsolescence du matériel humain et les approches de la date de péremption de nos pauvres vies, etc.Jérémie André. La Fabrique du corps humain. Olivier Morattel éditeur, 136p. Janvier 2023.
La Fabrique du corps humain pourrait être une satire, voire un pamphlet contre la déshumanisation des relations humaines et du travail, mais là encore on est loin du Zola de Germinal ou du pamphlétaire dreyfusard de J’accuse: à ras les faits et les affects, dans une sorte de neutralité objective bien vaudoise et protestante.Du moins l’ironie sous-jacente de l’auteur, et comme une tristesse latente liée à l'adieu à la folle (?) jeunesse, donnent-elles au roman sa dimension critique frottée de mélancolie, qui incite à la réflexion.Est-ce ainsi que les hommes vivent ? interrogeait Aragon. Et le statut de la femme est intégré dans la question par le truchement d’une prof d’anatomie retraitée conspuant le patriarcat en termes « woke », ou par le rôle assigné à Anna qui, dans la foulée, dresse le réquisitoire de l’aliénation objective que représente l’idéologie et la pratique quotidienne de son manager.Par delà la dissection…Dans son Journal littéraire, Paul Léautaud se gaussait de la niaiserie d'un certain professeur de médecine, éminent chirurgien qui ouvrait les corps sans rien comprendre à ce qui se passait dans les coeurs et les âmes des ses patients, et c'est aussi l'expérience qu'est amené à faire, ici, le jeune Dominique, constatant que son désir d’Anna et la réalité de la vie ne sont en rien réductibles à la nomenclature de Vésale.Avec une honnêteté remarquable, qui est là encore celle du médecin, Jérémie André se garde de dorer la pilule du lecteur (et de la lectrice, n'est-ce pas?) en arrangeant un dénouement glamoureux à ce qui ressemble à un épisode de feuilleton, tout en traitant ses trois personnages avec une distance frottée d'ironie - surtout en ce qui concerne le self made man Jean-Pierre, ex-Gianpietro au prénom francisé sur le conseil de son coach de vie - sans aboutir à la satire du brave nouveau monde qui nous entoure.Limites et enjeux d'un premier romanSi l'écrivain Jérémie André doit beaucoup, en l'occurrence, au médecin, celui-ci limite sans doute, aussi, ce qui pourrait faire s'exprimer plus librement et plus amplement l'écrivain, dont plusieurs thèmes du roman mériteraient d'être plus développés. Autant que des grandes fresque em pleine pâte d'un Zola, l'on est loin ici des visions existentielles fusionnées des grands écrivains-médecins que furent un Tchekhov ou un Céline.Mais Jérémie André s'est doté, dès son premier roman, d'un appareil d'observation et de formulation qui pourrait s'étendre à toute la société - par delà les thèmes sociétaux - où l'on verrait l'écrivain, stéthoscope en bandoulière, sillonner toutes les strates du corps social, de tel club de femmes botanistes à telle salle d'attente d'un service d'oncologie, de telle conférence des maîtres de telle Haute Ecole à la buvette de tel camping, de tel open space de rédaction à telle réunion de tel ou tel parti, ainsi de suite.Pérorer sur l'impuissance sexuelle, déclarée la maladie de l'époque, en invoquant Georges Bataille, comme s'y emploie tel doyen de faculté en urologue retiré des touchers rectaux, est une chose, et tout autre chose d'approcher les corps en concurrence avec les machines, les médecins face aux ordinateurs, les caissières de fast food chronométrant leur prises de commande, la folie ordinaire devenue norme redimensionnée en séances de team coaching, en attendant les constats d'obsolescence du matériel humain et les approches de la date de péremption de nos pauvres vies, etc.Jérémie André. La Fabrique du corps humain. Olivier Morattel éditeur, 136p. Janvier 2023. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, XXIII)De l’apaisement.– A présent laisse-toi faire par la vie, lâche prise le temps d’un jour en ne cessant de tenir au jour qui va, ne laisse pas les bruyants entamer ta confiance, ne laisse pas les violents entacher ta douceur, confiance petit, l’eau courante sait où elle va et c’est à sa source que tu te fies en suivant son cours…De la pauvreté.- Elles ont une nuit d’avance, ce matin comme les autres, donc c’est hier matin qu’elles dansaient le soir devant leur masure, toute grâce et gaîté, leur dure tâche achevée, les deux femmes, la jeune et la vieille, de ce haut plateau perdu du Zanskar où leur chant disait le bonheur parfait d’avoir tout…De l’abjection. – Pour plaire et se complaire dans son illusion d’être si bon il tire des traites sur la douleur du monde et cela fera, se dit-il, vendre ses livres - tel étant le démon de l’époque et qui grouille de vers aux minois d’innocence, c’est le péché des péchés que cette usure de la pitié feinte et de cela dès l’éveil, petit, refuse d’être contaminé…De la sérénité.– À l’immédiate hystérie des médias relancée avant le lever du jour tu résistes en ouvrant grande la fenêtre à l’air et à la neige de ce matin qui ne fondra pas moins que leur pactole mais tout tranquillement, en lâchant ses eaux comme pour une naissance sans convulsions, et le printemps reviendra, et les gens ce matin continuent de faire leur métier de vivre dont personne ne s’inquiète – alors toi, maintenant, referme la fenêtre au froid…Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire, 1998.
(Pensées de l'aube, XXIII)De l’apaisement.– A présent laisse-toi faire par la vie, lâche prise le temps d’un jour en ne cessant de tenir au jour qui va, ne laisse pas les bruyants entamer ta confiance, ne laisse pas les violents entacher ta douceur, confiance petit, l’eau courante sait où elle va et c’est à sa source que tu te fies en suivant son cours…De la pauvreté.- Elles ont une nuit d’avance, ce matin comme les autres, donc c’est hier matin qu’elles dansaient le soir devant leur masure, toute grâce et gaîté, leur dure tâche achevée, les deux femmes, la jeune et la vieille, de ce haut plateau perdu du Zanskar où leur chant disait le bonheur parfait d’avoir tout…De l’abjection. – Pour plaire et se complaire dans son illusion d’être si bon il tire des traites sur la douleur du monde et cela fera, se dit-il, vendre ses livres - tel étant le démon de l’époque et qui grouille de vers aux minois d’innocence, c’est le péché des péchés que cette usure de la pitié feinte et de cela dès l’éveil, petit, refuse d’être contaminé…De la sérénité.– À l’immédiate hystérie des médias relancée avant le lever du jour tu résistes en ouvrant grande la fenêtre à l’air et à la neige de ce matin qui ne fondra pas moins que leur pactole mais tout tranquillement, en lâchant ses eaux comme pour une naissance sans convulsions, et le printemps reviendra, et les gens ce matin continuent de faire leur métier de vivre dont personne ne s’inquiète – alors toi, maintenant, referme la fenêtre au froid…Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire, 1998. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, XXII)De ces oasis.- Le mot CLAIRIÈRE me revient avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait, la neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit…De ce qu’on voit.- Une fois de plus, à l’instant, voici l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’hiver bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage immobile absolument sur le lac bleu neigeux, l’émouvante beauté de ce que ne voit pas l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...Du retour.– Il fit tellement nuit cette nuit-là, tellement froid et tellement seul que l’éveil leur fut comme un rivage qu’ils atteignirent à genoux, puis il fallut se lever et ils se levèrent, il fallut paraître dans les villages et les villes et sourire, parler, travailler avec tous ceux-là qui s’étaient trouvés tellement seuls dans le froid de cette nuit-là…De la purification.– Le mot aliénation, du mot aliéné, évoquant la maison où l’on tourne en rond en gesticulant à cris terribles, t’était resté de la fin de soirée au zapping halluciné par tant d’imbécillité laide partout, et ce matin tu te purifies la mémoire dans l’eau froide de la fenêtre ouverte de cette page de poésie : « Vallée offerte comme un livre En elle je m’inscris, dans les failles du jour : la montagne y respire au revers de mes mots »…Peinture: Albert Bierstadt. Orage en montagne, vers 1870.
(Pensées de l'aube, XXII)De ces oasis.- Le mot CLAIRIÈRE me revient avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait, la neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit…De ce qu’on voit.- Une fois de plus, à l’instant, voici l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’hiver bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage immobile absolument sur le lac bleu neigeux, l’émouvante beauté de ce que ne voit pas l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...Du retour.– Il fit tellement nuit cette nuit-là, tellement froid et tellement seul que l’éveil leur fut comme un rivage qu’ils atteignirent à genoux, puis il fallut se lever et ils se levèrent, il fallut paraître dans les villages et les villes et sourire, parler, travailler avec tous ceux-là qui s’étaient trouvés tellement seuls dans le froid de cette nuit-là…De la purification.– Le mot aliénation, du mot aliéné, évoquant la maison où l’on tourne en rond en gesticulant à cris terribles, t’était resté de la fin de soirée au zapping halluciné par tant d’imbécillité laide partout, et ce matin tu te purifies la mémoire dans l’eau froide de la fenêtre ouverte de cette page de poésie : « Vallée offerte comme un livre En elle je m’inscris, dans les failles du jour : la montagne y respire au revers de mes mots »…Peinture: Albert Bierstadt. Orage en montagne, vers 1870. -
Juste faire le job
 (Le Temps accordé - Lectures du monde VII, 2023)À la Maison bleue, ce samedi 4 février. – Masque de vieux ce matin. De nouvelles rides autour des yeux et ma vue altérée. Pas joli joli. La toux moins intense que ces derniers jours, mais pas moins présente par éclats spasmodiques. Pensé tout à l’heure : pas question d’hosto. Si c’est la fin, ce sera ici, comme il en a été de ma bonne amie qui avait dit : pas question de finir à l'hosto. Je sais que ça pourrait mal tourner du côté des bronches et des poumons, genre péricardite, mais je me soigne avec du Resyl plus et du paracetamol, lequel commence à manquer dans les pharmacies, ai-je entendu dire l’autre jour de la bouche du pharmacien-chef des HUG de Genève, qui évoquait les ruptures de stock de plus en plus nombreuses et les conséquences de tout ça. Nous devenons de plus en plus dépendants des économies émergentes, selon l’expression, et plus précisément de l’Inde et de la Chine, donc revenons aux fumigations et aux ventouses, etc.Hier soir assez déprimé par le débat, enregistré je ne sais quand, entre Slobodan Despot et Bernard-Henri Lévy. Ténors de la jactance. Très habiles tous les deux. Je sens moins le rance chez Slobodan que chez BHL mais c’est le langage lui-même du débat, commun aux deux beaux parleurs, qui me dégoûte, je dirai : physiquement. Bien entendu, le dernier mot revient au plus retors des deux, qui ne manque d’évoquer le retour de la peste brune en désignant son contradicteur - le coup de poignard du sempiternel Héros de la Bonne Cause que figure le «philosophe» à décolleté narcissique, véritable caricature de lui-même avec sa gueule de faux Greco artistement mal rasée, dont les arguments et les figures de style pourraient être reproduits par un logiciel et répétés par tous les petits robots de la guerre humanitaire à venir, mais moi : juste l’envie de vomir, et pas le coeur non plus de me rallier à la cause de Slobodan, qui reste à mes yeux un idéologue. Mon « camp » est ailleurs : il s’appelle Littérature.
(Le Temps accordé - Lectures du monde VII, 2023)À la Maison bleue, ce samedi 4 février. – Masque de vieux ce matin. De nouvelles rides autour des yeux et ma vue altérée. Pas joli joli. La toux moins intense que ces derniers jours, mais pas moins présente par éclats spasmodiques. Pensé tout à l’heure : pas question d’hosto. Si c’est la fin, ce sera ici, comme il en a été de ma bonne amie qui avait dit : pas question de finir à l'hosto. Je sais que ça pourrait mal tourner du côté des bronches et des poumons, genre péricardite, mais je me soigne avec du Resyl plus et du paracetamol, lequel commence à manquer dans les pharmacies, ai-je entendu dire l’autre jour de la bouche du pharmacien-chef des HUG de Genève, qui évoquait les ruptures de stock de plus en plus nombreuses et les conséquences de tout ça. Nous devenons de plus en plus dépendants des économies émergentes, selon l’expression, et plus précisément de l’Inde et de la Chine, donc revenons aux fumigations et aux ventouses, etc.Hier soir assez déprimé par le débat, enregistré je ne sais quand, entre Slobodan Despot et Bernard-Henri Lévy. Ténors de la jactance. Très habiles tous les deux. Je sens moins le rance chez Slobodan que chez BHL mais c’est le langage lui-même du débat, commun aux deux beaux parleurs, qui me dégoûte, je dirai : physiquement. Bien entendu, le dernier mot revient au plus retors des deux, qui ne manque d’évoquer le retour de la peste brune en désignant son contradicteur - le coup de poignard du sempiternel Héros de la Bonne Cause que figure le «philosophe» à décolleté narcissique, véritable caricature de lui-même avec sa gueule de faux Greco artistement mal rasée, dont les arguments et les figures de style pourraient être reproduits par un logiciel et répétés par tous les petits robots de la guerre humanitaire à venir, mais moi : juste l’envie de vomir, et pas le coeur non plus de me rallier à la cause de Slobodan, qui reste à mes yeux un idéologue. Mon « camp » est ailleurs : il s’appelle Littérature. Revenant l'autre soir au Leviathan de Julien Green, trop longtemps ignoré, je me suis dit: noyau, là est ton noyau, l'âme de notre âme incarnée. L'immédiate plongée dans la détresse d'un errant humain, sa folle passion timide, l'énorme présence de femmes terrifiantes et d'enfants de divers âges, la topologie de la bourgade où tout se sait sous le ciel qui se tait. Cette nouvelle lecture après celle de Périphéries et de La Fabrique du corps humain, et la Littérature fait pièce au discours et à la dialectique - Poésie vaincra...Merci à mon voleur. – Je me suis cru, hier soir, victime d’une hallucination, ou d’un miracle inexplicable, après avoir perdu, sur un premier constat évident, puis retrouvé ma sacoche contenant un carnet plein de notes de ces derniers mois, mon portefeuille et toutes ses cartes de crédit et autres papiers d’identité.
Revenant l'autre soir au Leviathan de Julien Green, trop longtemps ignoré, je me suis dit: noyau, là est ton noyau, l'âme de notre âme incarnée. L'immédiate plongée dans la détresse d'un errant humain, sa folle passion timide, l'énorme présence de femmes terrifiantes et d'enfants de divers âges, la topologie de la bourgade où tout se sait sous le ciel qui se tait. Cette nouvelle lecture après celle de Périphéries et de La Fabrique du corps humain, et la Littérature fait pièce au discours et à la dialectique - Poésie vaincra...Merci à mon voleur. – Je me suis cru, hier soir, victime d’une hallucination, ou d’un miracle inexplicable, après avoir perdu, sur un premier constat évident, puis retrouvé ma sacoche contenant un carnet plein de notes de ces derniers mois, mon portefeuille et toutes ses cartes de crédit et autres papiers d’identité. Cela s’est passé à mon retour de L’Oasis, où je m’étais régalé, autant que le chien, d’un demi-poulet arrosé de pinot noir, sur le parking en plein air où j’avais laissé ma Honda Jazz, le long de laquelle un van noir s’était parqué entretemps en me laissant à peine l’espace pour y entrer. Or ouvrant la porte arrière gauche sans pouvoir y introduire le cher Snoopy, j’ai dû laisser tomber la précieuse sacoche sans m’en rendre compte, dont j’ai constaté l’absence quelques instants plus tard après m’être garé une cinquantaine de mètres plus loin. Alors de là, ayant constaté son absence dans mon véhicule et revenant à la place que je venais de quitter, j’ai beau regarder partout : point de sacoche. Après quoi je reviens à la voiture parquée avec ses feux allumés, l’inspecte en détail, mais pas trace de putain de sacoche non plus, donc je reviens à la place au milieu de laquelle, posée bien droite et que je n’aurais pu ne pas voir la fois précédente, ma sacoche m’attend avec l’air de me dire : eh cloche !Mais non, cela ne se peut pas : en moins de cinq minutes chrono, une honnête sacoche ne peut disparaître et réapparaître comme ça. Du moins ma sacoche est-elle là et je la salue d’un alleluia.Sur quoi, racontant l’inexplicable prodige à Sophie qui m’a téléphoné entretemps, je l’entends me suggérer de vérifier le contenu de la sacoche où je constate alors que, non contente d’avoir disparu et réapparu, la foutue sacoche s’est délestée de tout son contenu d’argent sonnant et trébuchant, soit à peu près deux cents francs en billets et pièces d’argent - et voilà le mystère élucidé, la magie évaporée...Le voleur était-il aux aguets, dans le van mal parqué à dessein, ou juste de passage, profitant de mon éloignement momentané pour s’emparer de ma sacoche tombée de la voiture ? La rapidité du geste m’en impose, et le fait que le larron (ou la larronne, ne lésinons pas sur le genre) ait eu le scrupule de me rendre ma sacoche sans toucher à ses cartes de crédit et autres documents, dont le remplacement m’aurait coûté bien plus de peine que cette ponction de fric, m’a finalement fait remercier le petit malandrin ou la malandrine, qui aura juste « fait le job »…Quant à mon job à moi, c’est mon privilège royal. Et plus précisément, ce samedi nuageux à couvert à l’horizon neigeux : la mise au net finale de mon triptyque poétique, avec la copie complète du Chemin sur la mer, les notes non moins complètes relatives à la lecture de La Fabrique du corps humain et de Périphéries – sujets de ma prochain chronique -, sept piles de documents et journaux divers à trier et poubelliser, la reprise des finitions du roman, entre autres téléphonages amicaux pour se revigorer.
Cela s’est passé à mon retour de L’Oasis, où je m’étais régalé, autant que le chien, d’un demi-poulet arrosé de pinot noir, sur le parking en plein air où j’avais laissé ma Honda Jazz, le long de laquelle un van noir s’était parqué entretemps en me laissant à peine l’espace pour y entrer. Or ouvrant la porte arrière gauche sans pouvoir y introduire le cher Snoopy, j’ai dû laisser tomber la précieuse sacoche sans m’en rendre compte, dont j’ai constaté l’absence quelques instants plus tard après m’être garé une cinquantaine de mètres plus loin. Alors de là, ayant constaté son absence dans mon véhicule et revenant à la place que je venais de quitter, j’ai beau regarder partout : point de sacoche. Après quoi je reviens à la voiture parquée avec ses feux allumés, l’inspecte en détail, mais pas trace de putain de sacoche non plus, donc je reviens à la place au milieu de laquelle, posée bien droite et que je n’aurais pu ne pas voir la fois précédente, ma sacoche m’attend avec l’air de me dire : eh cloche !Mais non, cela ne se peut pas : en moins de cinq minutes chrono, une honnête sacoche ne peut disparaître et réapparaître comme ça. Du moins ma sacoche est-elle là et je la salue d’un alleluia.Sur quoi, racontant l’inexplicable prodige à Sophie qui m’a téléphoné entretemps, je l’entends me suggérer de vérifier le contenu de la sacoche où je constate alors que, non contente d’avoir disparu et réapparu, la foutue sacoche s’est délestée de tout son contenu d’argent sonnant et trébuchant, soit à peu près deux cents francs en billets et pièces d’argent - et voilà le mystère élucidé, la magie évaporée...Le voleur était-il aux aguets, dans le van mal parqué à dessein, ou juste de passage, profitant de mon éloignement momentané pour s’emparer de ma sacoche tombée de la voiture ? La rapidité du geste m’en impose, et le fait que le larron (ou la larronne, ne lésinons pas sur le genre) ait eu le scrupule de me rendre ma sacoche sans toucher à ses cartes de crédit et autres documents, dont le remplacement m’aurait coûté bien plus de peine que cette ponction de fric, m’a finalement fait remercier le petit malandrin ou la malandrine, qui aura juste « fait le job »…Quant à mon job à moi, c’est mon privilège royal. Et plus précisément, ce samedi nuageux à couvert à l’horizon neigeux : la mise au net finale de mon triptyque poétique, avec la copie complète du Chemin sur la mer, les notes non moins complètes relatives à la lecture de La Fabrique du corps humain et de Périphéries – sujets de ma prochain chronique -, sept piles de documents et journaux divers à trier et poubelliser, la reprise des finitions du roman, entre autres téléphonages amicaux pour se revigorer. À fin février, voire fin mars, j’aurai quatre nouveaux livres prêts à l’édition : l’essai sur Czapski, le sixième volume de mes Lectures du monde, intitulé Mémoire vive, le triptyque de La Maison dans l’arbre, enfin mon roman panoptique faisant suite au Viol de l’ange, Les Tours d’illusions – tout cela représentant à peu près 1300 pages - et après ça ne me resteront plus à fignoler que le recueil de chroniques du Rêveur solidaire et les pensées de Prends garde à la douceur, la suite de mes Lectures du monde et tant d’autres sujets d’amusement dont mon cœur essoufflé ne voudra peut-être plus entendre parler pas plus tard que tout à l’heure…
À fin février, voire fin mars, j’aurai quatre nouveaux livres prêts à l’édition : l’essai sur Czapski, le sixième volume de mes Lectures du monde, intitulé Mémoire vive, le triptyque de La Maison dans l’arbre, enfin mon roman panoptique faisant suite au Viol de l’ange, Les Tours d’illusions – tout cela représentant à peu près 1300 pages - et après ça ne me resteront plus à fignoler que le recueil de chroniques du Rêveur solidaire et les pensées de Prends garde à la douceur, la suite de mes Lectures du monde et tant d’autres sujets d’amusement dont mon cœur essoufflé ne voudra peut-être plus entendre parler pas plus tard que tout à l’heure… -
Prends garde à la douceur
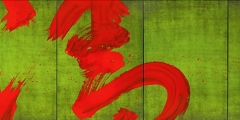 (Pensées de l'aube, XIII)De l’allégresse. – Cela me reprend tous les matins, après le coup de noir de plus en plus noir, c’est plus fort que moi, c’est l’ivresse de retrouver tout ça qui va et qui ne va pas, non mais c’est pas vrai: j’y crois pas, ça pulse et ça ruisselle et ça chante - c’est pour ainsi dire l’opéra du monde au point qu’on se sent tout con d’être si joyeux…De l’obstination. – C’est dans la lenteur de la peinture qu’on entre vraiment dans le temps de la langue, je veux dire : dans la maison de la langue et les chambres reliées par autant de ruelles et de rues et de ponts et de voix s’appelant et se répondant par-dessus les murs et par-dessus les langues, - mais entrez donc sans frapper, nous avons tout le temps, juste que je trouve de quoi écrire…D'une fausse évidence.– Je ne suis bien qu’avec toi, mais la plupart du temps je n’y pense même pas, je me crois seul, je crains ton indifférence, je n’ose te déranger, tu as beau dire que tu t’impatientais de me retrouver : je me suis fait à tant d’absence de tous et à tant de distance de tous entre eux, loin des places et des conversations – et dans l’oubli de tant d’heures partagées j’allais me faire, sans toi, à cette prétendue fatalité de la foule esseulée…Peinture: Fabienne Verdier.
(Pensées de l'aube, XIII)De l’allégresse. – Cela me reprend tous les matins, après le coup de noir de plus en plus noir, c’est plus fort que moi, c’est l’ivresse de retrouver tout ça qui va et qui ne va pas, non mais c’est pas vrai: j’y crois pas, ça pulse et ça ruisselle et ça chante - c’est pour ainsi dire l’opéra du monde au point qu’on se sent tout con d’être si joyeux…De l’obstination. – C’est dans la lenteur de la peinture qu’on entre vraiment dans le temps de la langue, je veux dire : dans la maison de la langue et les chambres reliées par autant de ruelles et de rues et de ponts et de voix s’appelant et se répondant par-dessus les murs et par-dessus les langues, - mais entrez donc sans frapper, nous avons tout le temps, juste que je trouve de quoi écrire…D'une fausse évidence.– Je ne suis bien qu’avec toi, mais la plupart du temps je n’y pense même pas, je me crois seul, je crains ton indifférence, je n’ose te déranger, tu as beau dire que tu t’impatientais de me retrouver : je me suis fait à tant d’absence de tous et à tant de distance de tous entre eux, loin des places et des conversations – et dans l’oubli de tant d’heures partagées j’allais me faire, sans toi, à cette prétendue fatalité de la foule esseulée…Peinture: Fabienne Verdier. -
La fièvre au corps du texte
 (Le Temps accordé, Lectures du monde VII, 2023)A la Maison bleue, ce jeudi 2 février. - C’est cela, me suis-je souvent dit à propos de la littérature de langue française, et autant sinon plus des lettres romandes: que cela manque de corps...« Faut que ça bande ! », nous lança un soir l’ancien chef d’orchestre Victor Desarzens que nos amis Dimitrijevic avaient accueilli pour passer d’une année à l’autre. Trônant dans un fauteuil comme un nain dans un nuage, tenant de chacune de ses mains celles de nos adorables compagnes (ma Lady L. d’un côté et la douce de Dimitri de l’autre), il en était venu à cette exclamation phallique sans craindre de choquer nos anges aux pieds ancrés dans la réalité glébeuse, après un tour d’horizon de notre littérature manquant selon lui - et nous en étions pleinement d’accord - de « fruit » et de « bête », ou plus largement dit : de « tonne musicale » et de génie vocal, sauf chez un Cingria qu’il avait en affection admirative - Charle Albert dont chaque phrase exulte d’érotisme verbal sans qu’il ne soit jamais question chez lui de cul ou de cœur à la manière des feuilletons...
(Le Temps accordé, Lectures du monde VII, 2023)A la Maison bleue, ce jeudi 2 février. - C’est cela, me suis-je souvent dit à propos de la littérature de langue française, et autant sinon plus des lettres romandes: que cela manque de corps...« Faut que ça bande ! », nous lança un soir l’ancien chef d’orchestre Victor Desarzens que nos amis Dimitrijevic avaient accueilli pour passer d’une année à l’autre. Trônant dans un fauteuil comme un nain dans un nuage, tenant de chacune de ses mains celles de nos adorables compagnes (ma Lady L. d’un côté et la douce de Dimitri de l’autre), il en était venu à cette exclamation phallique sans craindre de choquer nos anges aux pieds ancrés dans la réalité glébeuse, après un tour d’horizon de notre littérature manquant selon lui - et nous en étions pleinement d’accord - de « fruit » et de « bête », ou plus largement dit : de « tonne musicale » et de génie vocal, sauf chez un Cingria qu’il avait en affection admirative - Charle Albert dont chaque phrase exulte d’érotisme verbal sans qu’il ne soit jamais question chez lui de cul ou de cœur à la manière des feuilletons...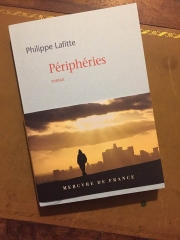 Je repensais hier soir à ce fameux réveillon en lisant le dernier roman de Philippe Lafitte, immédiatement physique et à tous les sens du terme: descriptif illico avec le jeune protagoniste, torse nu en plein hiver, s’imposant son exercice culturiste solitaire dans un décor nocturne de périphériques zébrant la nuit de phares, et tout de suite on y est, tout de suite on est dans la Zone avec ce Virgile de vingt ans et sa tribu de Roms en constants déplacements et en butte à tous les rejets , autant qu’aux conflits internes ou externes liés, notamment, aux divers trafics qui font survivre les uns et les autres par la bande.Un lieu symbolique du roman est la Salle, ou les corps s’exercent en commun, sans larguer leurs dissensions, devenant parfois chasse gardée ou zone interdite. Le corps y est roi.Mais le corps est aussi et surtout, ici, musique mélodique et rythmique de la langue, source aussi d’immédiate beauté dans sa chatoyante et percutante plasticité visuelle.Oui, cela bande, sans qu’il y soit question de sexe explicite : les mots caracolent et s’accolent, scintillent et détonent, se font tour à tour caresses et bastons, tendresses et percussions de baffes ou de battes.Or revenant ce matin au récit de Virgile et de Nuri son rival teigneux, lequel tient sa sœur Yasmine sous sa férule tyrannique, je retrouve aussi mon corps de lecteur décati effroyablement tousseux ces jours, scié en deux par d’irrépressibles quintes sans pouvoir cracher tout ça : expectorer cette boule spasmodique de nerfs et de glaires alors que nos jeunes zonards se font les pires crosses, comme partout où il y a de l’hommerie, pendant que Yasmine, par la bande - c’est le mot juste là encore -, va chercher sa propre liberté loin de son frère phallo-bigot, etc
Je repensais hier soir à ce fameux réveillon en lisant le dernier roman de Philippe Lafitte, immédiatement physique et à tous les sens du terme: descriptif illico avec le jeune protagoniste, torse nu en plein hiver, s’imposant son exercice culturiste solitaire dans un décor nocturne de périphériques zébrant la nuit de phares, et tout de suite on y est, tout de suite on est dans la Zone avec ce Virgile de vingt ans et sa tribu de Roms en constants déplacements et en butte à tous les rejets , autant qu’aux conflits internes ou externes liés, notamment, aux divers trafics qui font survivre les uns et les autres par la bande.Un lieu symbolique du roman est la Salle, ou les corps s’exercent en commun, sans larguer leurs dissensions, devenant parfois chasse gardée ou zone interdite. Le corps y est roi.Mais le corps est aussi et surtout, ici, musique mélodique et rythmique de la langue, source aussi d’immédiate beauté dans sa chatoyante et percutante plasticité visuelle.Oui, cela bande, sans qu’il y soit question de sexe explicite : les mots caracolent et s’accolent, scintillent et détonent, se font tour à tour caresses et bastons, tendresses et percussions de baffes ou de battes.Or revenant ce matin au récit de Virgile et de Nuri son rival teigneux, lequel tient sa sœur Yasmine sous sa férule tyrannique, je retrouve aussi mon corps de lecteur décati effroyablement tousseux ces jours, scié en deux par d’irrépressibles quintes sans pouvoir cracher tout ça : expectorer cette boule spasmodique de nerfs et de glaires alors que nos jeunes zonards se font les pires crosses, comme partout où il y a de l’hommerie, pendant que Yasmine, par la bande - c’est le mot juste là encore -, va chercher sa propre liberté loin de son frère phallo-bigot, etc -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube XII)De la bienveillance. – À ces petits crevés des fonds de classes mieux vaut ne pas trop montrer qu’on les aime plus que les futurs gagnants bien peignés du premier rang, mais c’est à eux qu’on réservera le plus de soi s’ils le demandent, ces chiens pelés qui n’ont reçu que des coups ou même pas ça : qui n’ont même pas qui que ce soit pour les empêcher de se déprécier...De la Qualité.– C’est en effet à toi de choisir entre ne pas savoir et savoir, rester dans le vague ou donner aux choses un nom et un nouveau souffle, les colorier ou leur demander ce qu’elles ont à te dire, les humer et les renvoyer au ciel comme des oiseaux bagués, enfin tu sais bien, quoi, tu n’en ferais pas une affaire douteuse s’il s’agissait de course chronométrée ou de progrès au Nintendo, tu sais très bien enfin que c’est bon pour tout le monde…De la page blanche.– Et maintenant vous allez cesser de me bassiner avec votre semblant d’angoisse, il n’y a qu’à vous secouer, ce n’est pas plus compliqué : secouez l’Arbre qu’il y a en vous et le monde tombera à vos pieds comme une pluie de fruits mûrs que vous n’aurez qu’à ramasser - une dame poète dit quelque part que «les mots ont des dorures de cétoine, des pigments de truite arc-en–ciel », elle dit aussi que «sous leurs masses immobiles vibre la vie», et aussi qu’«il suffit de les soulever, un à un, avec précaution, comme on lève les pierres au fond de la rivière pour voir apparaître ce qu’on ignorait», alors basta…Des parfums.– Ce serait comme une chambre noire dans laquelle il suffirait de fermer les yeux pour revoir tout ce que tu as humé dans la maison pleine d’odeurs chaudes de l’enfance, au milieu du jardin de l’enfance saturé de couleurs entêtantes, dans le pays sacré de l’enfance où ça sentait bon les ruisseaux et les étangs et les torrents et les lacs et l'océan des nuits parfumées de l’enfance…Photo: Robert Doisneau.
(Pensées de l'aube XII)De la bienveillance. – À ces petits crevés des fonds de classes mieux vaut ne pas trop montrer qu’on les aime plus que les futurs gagnants bien peignés du premier rang, mais c’est à eux qu’on réservera le plus de soi s’ils le demandent, ces chiens pelés qui n’ont reçu que des coups ou même pas ça : qui n’ont même pas qui que ce soit pour les empêcher de se déprécier...De la Qualité.– C’est en effet à toi de choisir entre ne pas savoir et savoir, rester dans le vague ou donner aux choses un nom et un nouveau souffle, les colorier ou leur demander ce qu’elles ont à te dire, les humer et les renvoyer au ciel comme des oiseaux bagués, enfin tu sais bien, quoi, tu n’en ferais pas une affaire douteuse s’il s’agissait de course chronométrée ou de progrès au Nintendo, tu sais très bien enfin que c’est bon pour tout le monde…De la page blanche.– Et maintenant vous allez cesser de me bassiner avec votre semblant d’angoisse, il n’y a qu’à vous secouer, ce n’est pas plus compliqué : secouez l’Arbre qu’il y a en vous et le monde tombera à vos pieds comme une pluie de fruits mûrs que vous n’aurez qu’à ramasser - une dame poète dit quelque part que «les mots ont des dorures de cétoine, des pigments de truite arc-en–ciel », elle dit aussi que «sous leurs masses immobiles vibre la vie», et aussi qu’«il suffit de les soulever, un à un, avec précaution, comme on lève les pierres au fond de la rivière pour voir apparaître ce qu’on ignorait», alors basta…Des parfums.– Ce serait comme une chambre noire dans laquelle il suffirait de fermer les yeux pour revoir tout ce que tu as humé dans la maison pleine d’odeurs chaudes de l’enfance, au milieu du jardin de l’enfance saturé de couleurs entêtantes, dans le pays sacré de l’enfance où ça sentait bon les ruisseaux et les étangs et les torrents et les lacs et l'océan des nuits parfumées de l’enfance…Photo: Robert Doisneau. -
Roses de l'exil
 La maison s’était referméeet l’ombre sans un motavait ravalé tout sanglot,refoulant durement sa douceuret ne leur laissant là-basque ces douleurs d’un tempsque le temps fait passer,comme la trace de pas effacés...Mais tant d’années et de lieux plus tard,seuls dans la nuit des villesIls restent à sourireà ces îles et ces garesqu’ils ont trouvées et perduesDe bars en avenuesau fil de tant d’autres exils ...Et parfois, le parfum des rosesaffleurant leurs nuits solitaires,ils revoient sous le lierrela maison fermée, éperduede regrets revenus,par leurs souvenirs étoilés,dans la douce lumière des choses...Aquarelle: Thierry Vernet
La maison s’était referméeet l’ombre sans un motavait ravalé tout sanglot,refoulant durement sa douceuret ne leur laissant là-basque ces douleurs d’un tempsque le temps fait passer,comme la trace de pas effacés...Mais tant d’années et de lieux plus tard,seuls dans la nuit des villesIls restent à sourireà ces îles et ces garesqu’ils ont trouvées et perduesDe bars en avenuesau fil de tant d’autres exils ...Et parfois, le parfum des rosesaffleurant leurs nuits solitaires,ils revoient sous le lierrela maison fermée, éperduede regrets revenus,par leurs souvenirs étoilés,dans la douce lumière des choses...Aquarelle: Thierry Vernet -
Pourquoi Davel l'illuminé reste un irrécupérable
 Seul contre le Souverain bernois dont il taxe l’occupation d’injustice et d’oppression, Davel reste aujourd’hui une figure sacrificielle quasi christique, en principe irrécupérable, et qui l’est presque forcément, sauf par l’art et la poésie, la beauté,l’émotion et la réflexion en phase avec la recherche historique. L’opéra de Christian Favre , sur un livret de René Zahnd et dans une mise en scène de Gianni Schneider, qui célèbre la destinée tragique du visionnaire, a suscité l’immédiat enthousiasme du public , à la fois par ses qualités musicales propres, sa réalisation scénique magistrale et l’aura du personnage.Seul. C’est le premier mot que Jean David Abraham Davel, enchaîné, adresse à l’inquisiteur de Wattenwyl venu l’interroger dans son cachot : j’ai agi seul, je suis seul responsable. Et cela, plus que tout, est insupportable au représentant du Souverain impatient d’identifier des complices et toute une sédition cantonale ou peut-être plus générale. Mais rien à faire, et même sous la torture, forçant le respect de celui qui le soumet à la question, le major débarqué à Lausanne le 31 mars 1723 a la tête de six cents hommes armés de fusils sans munitions (!) et ne se doutant pas de la teneur réelle de l’opération, revendique la seule responsabilité de son acte à la fois inspiré et insensé qu’on pourrait dire le contraire d’une agression terroriste puisque lui seul, invoquant bel et bien son Dieu, sera l’unique victime expiatoire.Avec la candeur d’une âme pure, Davel a pensé que ce qui le révoltait, qui provoquait autour de lui la colère des gens, allait rallier ceux-ci en nombre avec l’aval des autorités de souche vaudoise, lesquelles commencent par le flatter avant de le lâcher. Le major de Crousaz, notable soucieux de son seul intérêt et parfait collabo avant la lettre, sera le Judas de l’affaire en ne cessant de jouer l’homme raisonnable à la façon suavement débonnaire des faux-culs à la vaudoise...Dans la foulée, quelques mots hautement significatifs de sa morgue aristocratique (et qu’on pourrait évidemment entendre dans la bouche des dirigeants de partout à travers les siècles) expriment son mépris paternaliste du bon peuple : « Les Vaudois ne sont -Ils pas plus heureux soumis ? Peuple de chuchoteurs, de petits comploteurs, d’experts en médisance » déclare De Crousaz après l’arrestation de son compagnon d’armes .«Ce peuple mérite -t-il la liberté que tu tenais tant à lui offrir ? »Et le librettiste d’entrouvrir un abîme dans le personnage qui se défend d’être un félon : « Et ne me dis pas traître ! Je sais ma juste place : au service d’un maître. Le pouvoir et la fortune sont de bons médecins pour les plaies qui béent tout au fond de moi »...Tout cela étant chanté par le superbe ténor Christophe Berry, qui n’en sera pas moins hué au rappel final pour son rôle évidemment très ingrat...À ses côtés, l’on ne manque ra de saluer, dans la grand et bel équipage local et international réuni par le capitaine de vaisseau Éric Vigier, le puissant et non moins émouvant Davel de Regis Mengus, le non moins excellent De Wattenwyl de François Lis modulant en acteur deux scènes relevant de l’humour noir, et la belle inconnue d’Alexandra Dobros-Rodriguez, notamment - et n’oublions pas les musiciens de l’OCL galvanisé par Daniel Kawka et les choristes grands et petits...Réhabiliter Davel ? Autant refaire le procès du Christ...Des voix bien intentionnées, à la veille du tricentenaire de la mort de Davel, se sont fait entendre afin que celui-ci soit réhabilité. Nos bonnes consciences en seraient dorlotées, mais comment ne pas voir que la condamnation du major n’est pas que le fait des autorités de l’époque mais de tout un peuple consentant ?« Nous avons laissé faire », écrira Ramuz. Et c’est un moment fort de l’opéra que celui de la profération du chœur, aux costumes mêlant les époques et aux chanteuses et chanteurs faisant front sur scène et martelant: "Le poing tranché, la tête coupée !"Cela dit , taxer de récupération opportuniste ceux qui voudraient réhabiliter Davel relève d’un autre forme de récupération, alors que le sacrifice de Davel participe d'un réalité échappant à toute logique judiciaire ou bonnement humaine. On est ici du coté des fols en Christ qui prennent les injonctions de l'Evangile au pied de la lettre, au dam de toutes les cléricatures.Davel, au demeurant, est conscient du conflit de fidélités auquel il est confronté, sachant qu’il est lui-même nourri et honoré par l’occupant bernois qui oppresse les siens.«Où est ta vraie loyauté ? » se demande-t-il avant de conclure en wokiste avant la lettre: « Mais n’est-ce pas le devoir de celui qui voit clair d’ouvrir les yeux de ceux qui dorment ou qui se cachent ? Assez d’hypocrisie, de mauvaises habitudes ! Assez de scandales et d’injustices honteuses ! L’heure du réveil à sonné ! »Le cher homme a-t-il vraiment tenu ces mots que lui prête le librettiste ? Disons que la substance y est.Et le caractère angélique de la Belle inconnue a-t-il le moindre fondement historique ? Question de pieds-plats, qu’on trouve ailleurs que chez les Vaudois, à propos de la Béatrice de Dante ou des monologues de sainte Jeanne au cinéma...Ce qui nous ramène à ce thème équivoque de la récupération morale ou politique, propre à toutes les idéologies, de la figure du bouc émissaire.Davel fut-il un révolutionnaire au sens où nous l’entendons aujourd’hui, englobant Robespierre, Lénine et Che Guevara ? Évidemment pas, même si les termes , extrêmement fermes et sévères de son Manifeste lu par lui seul aux conseillers lausannois, pendant que ses hommes faisaient le pied de grue autour de la cathédrale, relèvent d’un défi bonnement révolutionnaire.Le hic, c’est que cet officier de haut rang, supposé en connaître un bout en matière de tactique et de stratégie, n’a rien fait pour assurer ses arrières et bénéficier du soutien de quiconque, seul une fois encore à rêver debout tout en montrant un extraordinaire courage.Or ce même dissident se fait, jusque sur l’échafaud, le défenseur ardent d’un ordre, sinon établi, du moins rétabli, soumis aux valeurs fondamentales; et les historiens nous ont appris depuis lors qu’il n’était pas sans alliés potentiels, jusqu’ à l’avoyer bernois Steiger trouvant, dans le fameux Manifeste, bien des arguments recevables. Pourtant l'essentiel est là, qui le distingue des sans-culotte: malgré la pertinence de son intransigeance, Davel refuse le moindre acte de violence.Le vert Raphaël Mahaim, dans sa défense d’une réhabilitation, compare sa révolte à celle d’Antigone devant Créon, et Félicien Monnier, président de la Ligue Vaudois, de conclure son plaidoyer contre la réhabilitation en ces termes aussi défendables que ceux de son contradicteur : « Se dégage ainsi une étrange combinaison entre la puissance de l’affirmation politique de Davel et l’immense retenue humaine et personnelle de son geste »...Je tire ces citations de l’indispensable numéro spécial de la revue historique Passé simple, distribuée à la sortie de l’opéra en renfort du programme déjà bien étoffé, et l’on passe alors de l’interprétation artistique aux lumières croisées éclairant la destinée du Major , incessamment récupéré par les uns et les autres et leur échappant en fin de compte- comme tout récit consacré à la figure du bouc émissaire (un René Girard a tout dit à ce propos) et à ses avatars historiques ou mythiques.Reste aussi l’échappée vers le haut, de l’interprétation. Reste ici cette très belle œuvre collective en mémoire d’un homme seul...Christian Favre. Davel. Opéra de Lausanne, jusqu'au dimanche 5 février.
Seul contre le Souverain bernois dont il taxe l’occupation d’injustice et d’oppression, Davel reste aujourd’hui une figure sacrificielle quasi christique, en principe irrécupérable, et qui l’est presque forcément, sauf par l’art et la poésie, la beauté,l’émotion et la réflexion en phase avec la recherche historique. L’opéra de Christian Favre , sur un livret de René Zahnd et dans une mise en scène de Gianni Schneider, qui célèbre la destinée tragique du visionnaire, a suscité l’immédiat enthousiasme du public , à la fois par ses qualités musicales propres, sa réalisation scénique magistrale et l’aura du personnage.Seul. C’est le premier mot que Jean David Abraham Davel, enchaîné, adresse à l’inquisiteur de Wattenwyl venu l’interroger dans son cachot : j’ai agi seul, je suis seul responsable. Et cela, plus que tout, est insupportable au représentant du Souverain impatient d’identifier des complices et toute une sédition cantonale ou peut-être plus générale. Mais rien à faire, et même sous la torture, forçant le respect de celui qui le soumet à la question, le major débarqué à Lausanne le 31 mars 1723 a la tête de six cents hommes armés de fusils sans munitions (!) et ne se doutant pas de la teneur réelle de l’opération, revendique la seule responsabilité de son acte à la fois inspiré et insensé qu’on pourrait dire le contraire d’une agression terroriste puisque lui seul, invoquant bel et bien son Dieu, sera l’unique victime expiatoire.Avec la candeur d’une âme pure, Davel a pensé que ce qui le révoltait, qui provoquait autour de lui la colère des gens, allait rallier ceux-ci en nombre avec l’aval des autorités de souche vaudoise, lesquelles commencent par le flatter avant de le lâcher. Le major de Crousaz, notable soucieux de son seul intérêt et parfait collabo avant la lettre, sera le Judas de l’affaire en ne cessant de jouer l’homme raisonnable à la façon suavement débonnaire des faux-culs à la vaudoise...Dans la foulée, quelques mots hautement significatifs de sa morgue aristocratique (et qu’on pourrait évidemment entendre dans la bouche des dirigeants de partout à travers les siècles) expriment son mépris paternaliste du bon peuple : « Les Vaudois ne sont -Ils pas plus heureux soumis ? Peuple de chuchoteurs, de petits comploteurs, d’experts en médisance » déclare De Crousaz après l’arrestation de son compagnon d’armes .«Ce peuple mérite -t-il la liberté que tu tenais tant à lui offrir ? »Et le librettiste d’entrouvrir un abîme dans le personnage qui se défend d’être un félon : « Et ne me dis pas traître ! Je sais ma juste place : au service d’un maître. Le pouvoir et la fortune sont de bons médecins pour les plaies qui béent tout au fond de moi »...Tout cela étant chanté par le superbe ténor Christophe Berry, qui n’en sera pas moins hué au rappel final pour son rôle évidemment très ingrat...À ses côtés, l’on ne manque ra de saluer, dans la grand et bel équipage local et international réuni par le capitaine de vaisseau Éric Vigier, le puissant et non moins émouvant Davel de Regis Mengus, le non moins excellent De Wattenwyl de François Lis modulant en acteur deux scènes relevant de l’humour noir, et la belle inconnue d’Alexandra Dobros-Rodriguez, notamment - et n’oublions pas les musiciens de l’OCL galvanisé par Daniel Kawka et les choristes grands et petits...Réhabiliter Davel ? Autant refaire le procès du Christ...Des voix bien intentionnées, à la veille du tricentenaire de la mort de Davel, se sont fait entendre afin que celui-ci soit réhabilité. Nos bonnes consciences en seraient dorlotées, mais comment ne pas voir que la condamnation du major n’est pas que le fait des autorités de l’époque mais de tout un peuple consentant ?« Nous avons laissé faire », écrira Ramuz. Et c’est un moment fort de l’opéra que celui de la profération du chœur, aux costumes mêlant les époques et aux chanteuses et chanteurs faisant front sur scène et martelant: "Le poing tranché, la tête coupée !"Cela dit , taxer de récupération opportuniste ceux qui voudraient réhabiliter Davel relève d’un autre forme de récupération, alors que le sacrifice de Davel participe d'un réalité échappant à toute logique judiciaire ou bonnement humaine. On est ici du coté des fols en Christ qui prennent les injonctions de l'Evangile au pied de la lettre, au dam de toutes les cléricatures.Davel, au demeurant, est conscient du conflit de fidélités auquel il est confronté, sachant qu’il est lui-même nourri et honoré par l’occupant bernois qui oppresse les siens.«Où est ta vraie loyauté ? » se demande-t-il avant de conclure en wokiste avant la lettre: « Mais n’est-ce pas le devoir de celui qui voit clair d’ouvrir les yeux de ceux qui dorment ou qui se cachent ? Assez d’hypocrisie, de mauvaises habitudes ! Assez de scandales et d’injustices honteuses ! L’heure du réveil à sonné ! »Le cher homme a-t-il vraiment tenu ces mots que lui prête le librettiste ? Disons que la substance y est.Et le caractère angélique de la Belle inconnue a-t-il le moindre fondement historique ? Question de pieds-plats, qu’on trouve ailleurs que chez les Vaudois, à propos de la Béatrice de Dante ou des monologues de sainte Jeanne au cinéma...Ce qui nous ramène à ce thème équivoque de la récupération morale ou politique, propre à toutes les idéologies, de la figure du bouc émissaire.Davel fut-il un révolutionnaire au sens où nous l’entendons aujourd’hui, englobant Robespierre, Lénine et Che Guevara ? Évidemment pas, même si les termes , extrêmement fermes et sévères de son Manifeste lu par lui seul aux conseillers lausannois, pendant que ses hommes faisaient le pied de grue autour de la cathédrale, relèvent d’un défi bonnement révolutionnaire.Le hic, c’est que cet officier de haut rang, supposé en connaître un bout en matière de tactique et de stratégie, n’a rien fait pour assurer ses arrières et bénéficier du soutien de quiconque, seul une fois encore à rêver debout tout en montrant un extraordinaire courage.Or ce même dissident se fait, jusque sur l’échafaud, le défenseur ardent d’un ordre, sinon établi, du moins rétabli, soumis aux valeurs fondamentales; et les historiens nous ont appris depuis lors qu’il n’était pas sans alliés potentiels, jusqu’ à l’avoyer bernois Steiger trouvant, dans le fameux Manifeste, bien des arguments recevables. Pourtant l'essentiel est là, qui le distingue des sans-culotte: malgré la pertinence de son intransigeance, Davel refuse le moindre acte de violence.Le vert Raphaël Mahaim, dans sa défense d’une réhabilitation, compare sa révolte à celle d’Antigone devant Créon, et Félicien Monnier, président de la Ligue Vaudois, de conclure son plaidoyer contre la réhabilitation en ces termes aussi défendables que ceux de son contradicteur : « Se dégage ainsi une étrange combinaison entre la puissance de l’affirmation politique de Davel et l’immense retenue humaine et personnelle de son geste »...Je tire ces citations de l’indispensable numéro spécial de la revue historique Passé simple, distribuée à la sortie de l’opéra en renfort du programme déjà bien étoffé, et l’on passe alors de l’interprétation artistique aux lumières croisées éclairant la destinée du Major , incessamment récupéré par les uns et les autres et leur échappant en fin de compte- comme tout récit consacré à la figure du bouc émissaire (un René Girard a tout dit à ce propos) et à ses avatars historiques ou mythiques.Reste aussi l’échappée vers le haut, de l’interprétation. Reste ici cette très belle œuvre collective en mémoire d’un homme seul...Christian Favre. Davel. Opéra de Lausanne, jusqu'au dimanche 5 février. -
Prends garde à la douceur
(Pensées de l'aube, X)De l’attente.– Je n’attends pas de toi le moindre compliment, tes signes de congratulation ne sont pas une réponse, tes hymnes de félicitation tu peux te les garder autant que tes révérences si tu ne t’engages pas à parler à ton tour, car c’est cela que j’attends de toi, mon ami (e), ce n’est pas que nous nous félicitions de nous féliciter, ce n’est pas que tu me trouves ceci ou que je t’estime cela – ce qui seul compte est que tes questions répondent à La Question à laquelle j’ai tenté de répondre, et que tu vives de la lettre que je t’envoie comme je vivrai de la tienne, non pas en échos d’échos mais à se dévoiler l’un l’autre tout en se lâchant sans lâcher du regard La Chose qui seule compte…Des égards. – Nous n’avons pas besoin de grades, mais de regards, nous n’avons pas besoin d’être regardés, mais nous avons besoin d’égards et de vous en montrer sans relever vos grades, nous ne serions pas à l’Armée ni à la parade de l’Administration : nous serions au Café des Amis et nous parlerions simplement de la vie qui va, à ton regard je répondrai par les égards dus à ton rang de personne, mon regard te serait comme une élection sans autre signe que mon attention, à parler sans considération de nos âges et qualités, nations ou confessions, nous nous entendrions enfin…Du miracle.– Ce n’est pas que tu n’attendais rien, car tout en toi n’est qu’attente, ce n’est pas que tu n’espérais plus ni ne désirais plus : c’est que c’est apparu tu ne sais comment, que c’était là comme au premier matin du monde, là comme un arbre ou un torrent, frais comme l’eau tombée du ciel, beau comme un daim dans la lumière diaprée de l’aube, doux et léger comme la main du petit dernier que tu emmènes à sa première école, bon comme le pain sans rien, beau comme les vieux parents s’occupant des enfants de leurs enfants - enfin ce que tu veux qui te fait vraiment du bien, et à eux…Peinture: Thierry Vernet. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, IX)Du premier rire. – On ne s’y attendait pas : on avait oublié, parfois on ne se doutait même pas de ce que c’est qu’un enfant qui éclate de rire pour la première fois, plus banal tu meurs mais nous en avons pleuré sur le moment, à vrai dire l’enfant qui rit pour la première fois recrée le monde à lui seul, c’est avant le clown au cirque de la vie : l’initial étonnement, la pochette surprise…De ce qui renaît. – Pour spéculer sur l’Après c’est chacun pour soi, je ne sais pas, et saura-t-on jamais ce qui se trame réellement à l’instant ou dans un autre temps que nous pressentons, ou pas, mais ce que nous avons sous les yeux, ce qui s’offre et à tous, ce matin, don d’un Dieu gracieux immédiat et prodigue, don du prodigue enfant de la nuit qui ne se lasse pas au matin de te sauter au cou pour te rappeler qui tu es et qui tu aimes, et tout revit alors, tout retrouve son nom, tout est béni de l’ici présent...De l’attention. – Il ne sera pas de vraie vie sans prendre le temps de s’arrêter, rien de bon ne se fera sans observation – car «observer c’est aimer» disait ce poète qui y prenait tout son temps sur les sentiers buissonniers – rien de bien ne sortira de cette agitation distraite et de cette précipitation sans autre suite qu’un ensuite précipité vers sa propre répétition…Peinture JLK: Le Grammont à l'aube.
(Pensées de l'aube, IX)Du premier rire. – On ne s’y attendait pas : on avait oublié, parfois on ne se doutait même pas de ce que c’est qu’un enfant qui éclate de rire pour la première fois, plus banal tu meurs mais nous en avons pleuré sur le moment, à vrai dire l’enfant qui rit pour la première fois recrée le monde à lui seul, c’est avant le clown au cirque de la vie : l’initial étonnement, la pochette surprise…De ce qui renaît. – Pour spéculer sur l’Après c’est chacun pour soi, je ne sais pas, et saura-t-on jamais ce qui se trame réellement à l’instant ou dans un autre temps que nous pressentons, ou pas, mais ce que nous avons sous les yeux, ce qui s’offre et à tous, ce matin, don d’un Dieu gracieux immédiat et prodigue, don du prodigue enfant de la nuit qui ne se lasse pas au matin de te sauter au cou pour te rappeler qui tu es et qui tu aimes, et tout revit alors, tout retrouve son nom, tout est béni de l’ici présent...De l’attention. – Il ne sera pas de vraie vie sans prendre le temps de s’arrêter, rien de bon ne se fera sans observation – car «observer c’est aimer» disait ce poète qui y prenait tout son temps sur les sentiers buissonniers – rien de bien ne sortira de cette agitation distraite et de cette précipitation sans autre suite qu’un ensuite précipité vers sa propre répétition…Peinture JLK: Le Grammont à l'aube. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, VIII)De la consolation.– Ne vous en faites pas, leur dit-on maintenant, vos maisons en ruines, vous allez les reconstruire : vous aurez l’argent. Ne pleurez pas, vos écoles et vos mosquées, vous allez les bâtir plus belles qu’avant : l’argent peut tout. Cessez de vous lamenter, votre prison, vous allez en relever les murs avec notre argent. Et quant à vos enfants, vous n’avez qu’à en refaire : cela ne coûte rien…De l’imprescriptible. – Ce qui est un crime ou pas, c’est notre Tribunal qui en décide, et vous n’en avez pas. Ce qui est un crime, c’est le Livre qui en décide - notre Livre et pas le vôtre. Ce qui s’oublie ou pas, c’est notre Mémoire qui en décide, alors qu’on vous oublie déjà…De la honte.– Ils nous ont dit : La Paix Maintenant. Mais maintenant on sait que ce sera plus tard seulement : pour maintenant ils n’ont rien dit. Ils nous ont dit : et pensez-vous seulement au Darfour ? Vous rappelez-vous la Shoah ? Alors nous avons baissé la tête. Nous n’osons pas nous rappeler. Nous rappeler Sabra et Chatila nous fait honte. Vous rappeler 100 civils fusillés pour un soldat tué vous honore mais nous fait honte. Nous mélangeons tout, excusez-nous : nos morts n’ont rien à voir avec les vôtres : 1300 des nôtres pour treize des vôtres doivent être le prix de votre paix. Nous avons honte, Monsieur l’écrivain qui nous promettez La Paix Maintenant, de vous déranger...Du premier chant.– Le ciel s’annonce en beauté par ces notes claires qui égrènent partout la même allégresse comme neuve depuis mille fois mille ans sur le même arbre d’où jaillit cet invisible chant de rien du tout qui nous remplit partout et toujours du même premier émerveillement...Aquarelle JLK: Intimité.
(Pensées de l'aube, VIII)De la consolation.– Ne vous en faites pas, leur dit-on maintenant, vos maisons en ruines, vous allez les reconstruire : vous aurez l’argent. Ne pleurez pas, vos écoles et vos mosquées, vous allez les bâtir plus belles qu’avant : l’argent peut tout. Cessez de vous lamenter, votre prison, vous allez en relever les murs avec notre argent. Et quant à vos enfants, vous n’avez qu’à en refaire : cela ne coûte rien…De l’imprescriptible. – Ce qui est un crime ou pas, c’est notre Tribunal qui en décide, et vous n’en avez pas. Ce qui est un crime, c’est le Livre qui en décide - notre Livre et pas le vôtre. Ce qui s’oublie ou pas, c’est notre Mémoire qui en décide, alors qu’on vous oublie déjà…De la honte.– Ils nous ont dit : La Paix Maintenant. Mais maintenant on sait que ce sera plus tard seulement : pour maintenant ils n’ont rien dit. Ils nous ont dit : et pensez-vous seulement au Darfour ? Vous rappelez-vous la Shoah ? Alors nous avons baissé la tête. Nous n’osons pas nous rappeler. Nous rappeler Sabra et Chatila nous fait honte. Vous rappeler 100 civils fusillés pour un soldat tué vous honore mais nous fait honte. Nous mélangeons tout, excusez-nous : nos morts n’ont rien à voir avec les vôtres : 1300 des nôtres pour treize des vôtres doivent être le prix de votre paix. Nous avons honte, Monsieur l’écrivain qui nous promettez La Paix Maintenant, de vous déranger...Du premier chant.– Le ciel s’annonce en beauté par ces notes claires qui égrènent partout la même allégresse comme neuve depuis mille fois mille ans sur le même arbre d’où jaillit cet invisible chant de rien du tout qui nous remplit partout et toujours du même premier émerveillement...Aquarelle JLK: Intimité. -
Et maintenant prenons des nouvelles de la route...
 (Le Temps accordé, Lectures du monde 2023)Ce mercredi 25 janvier.- Une angoisse inhabituelle vous oppresse ce matin dès l’éveil, que vous ne vous expliquez pas, puis vous vous rappelez que la seconde de vos filles entrera ce soir à la clinique, où son troisième accouchement est programmé demain matin, d’où la sourde angoisse.Et que ressent-elle ce matin de son côté ? Et son «compagnon», comme on dit aujourd’hui au lieu de dire son époux ou le futur père ou simplement Gary ? Gary est-il angoissé ce matin ou bien est-ce prématuré pour un garçon si pragmatique ? Et les petits ? C’est le plus grand des deux petits, sauf erreur, qui vous a fait rire un jour, vers ses trois ans, en déclarant soudain, singeant son père : « Allons, restons pragmatiques ! ».Morts de rire, MDR, mais l’angoisse vous tenaille encore après un premier café, et vous vous rappelez alors l’effroi , où plus exactement le mélange de joie et d’effroi qui a marqué la venue au monde de votre premier enfant , un matin de novembre d’il y a un peu plus de quarante ans de ça, ce matin même où vous avez conçu pour la première fois que vous étiez mortel...Vous vous rappelez maintenant que le Coran dit qu’Allah a créé l’homme à partir d’un caillot. Le bébé écarlate est une boule de sang qu’Allah a humectée avant de souffler dedans. Tout comme le clown gonfle quelques ballons de baudruche qu’il tord en un clin d’œil pour les transformer en lapin, en chien ou en girafe.Leonard de Vinci raconte son premier souvenir: « J’étais dans mon berceau lorsqu’un milan s’est approché de moi, m’a ouvert la bouche de sa queue et donné plusieurs coups de queue à l’intérieur des lèvres. » Annie Dillard, qui cite ce passage des carnets de Leonardo, précise: « Le milan européen, long d’une soixantaine de centimètres, à une queue extrêmement fourchue. Il s’élève dans les airs à la manière des hirondelles puis il plonge comme un aigle pour fondre sur les reptiles ;il se nourrit également de cadavres ».Et Dillard avait aussi relevé ces mots du poète E.M. Forster: «Nous avançons entre deux ténèbres. Les deux seules entités capables de nous éclairer, le bébé et le cadavre, n’en ont pas la possibilité ».Au matin du 15 décembre 2021, je me suis réveillé le front contre celui de la mère morte de nos deux filles dont la seconde mettra demain au monde son troisième enfant de sexe féminin, ainsi que l’a révélé l’échographie. Moi qui suis si romantique je l’écris froidement ce matin parce que c’est vrai: j’ai dormi à côté d’un cadavre vu que la levée du corps ne pouvait se faire la veille à une heure si tardive, et j’ai vraiment dormi, même si cela paraît presque monstrueux de dormir dans le même lit d’une morte bien-aimée - j’ai dormi cette nuit-là du sommeil sans rêves du nouveau-né, et maintenant nous prenons des nouvelles de la route...Nabilla, la star de la télé-réalité dont nous suivons tous les jours, sur Instagram, les faits et gestes « au quotidien », avec tous les détails relatifs à ses nouvelles trouvailles en matière de maquillage ou son plat préféré du jour, Nabilla qui a plus de 2 millions de followers sur Instagram (surtout des filles mais aussi des mecs soyons justes) , Nabilla le reconnaît haut et fort dans sa dernière «punchline »: qu’Instagram est sa base et là elle se lâche carrément : « si je ne suis pas sur Insta, c’est comme si j’étais morte »...Et après les dernières nouvelles de la route, nous retrouvons Sarah notre envoyée spéciale sur le front des opérations en Ukraine...Dessin: Julie K.
(Le Temps accordé, Lectures du monde 2023)Ce mercredi 25 janvier.- Une angoisse inhabituelle vous oppresse ce matin dès l’éveil, que vous ne vous expliquez pas, puis vous vous rappelez que la seconde de vos filles entrera ce soir à la clinique, où son troisième accouchement est programmé demain matin, d’où la sourde angoisse.Et que ressent-elle ce matin de son côté ? Et son «compagnon», comme on dit aujourd’hui au lieu de dire son époux ou le futur père ou simplement Gary ? Gary est-il angoissé ce matin ou bien est-ce prématuré pour un garçon si pragmatique ? Et les petits ? C’est le plus grand des deux petits, sauf erreur, qui vous a fait rire un jour, vers ses trois ans, en déclarant soudain, singeant son père : « Allons, restons pragmatiques ! ».Morts de rire, MDR, mais l’angoisse vous tenaille encore après un premier café, et vous vous rappelez alors l’effroi , où plus exactement le mélange de joie et d’effroi qui a marqué la venue au monde de votre premier enfant , un matin de novembre d’il y a un peu plus de quarante ans de ça, ce matin même où vous avez conçu pour la première fois que vous étiez mortel...Vous vous rappelez maintenant que le Coran dit qu’Allah a créé l’homme à partir d’un caillot. Le bébé écarlate est une boule de sang qu’Allah a humectée avant de souffler dedans. Tout comme le clown gonfle quelques ballons de baudruche qu’il tord en un clin d’œil pour les transformer en lapin, en chien ou en girafe.Leonard de Vinci raconte son premier souvenir: « J’étais dans mon berceau lorsqu’un milan s’est approché de moi, m’a ouvert la bouche de sa queue et donné plusieurs coups de queue à l’intérieur des lèvres. » Annie Dillard, qui cite ce passage des carnets de Leonardo, précise: « Le milan européen, long d’une soixantaine de centimètres, à une queue extrêmement fourchue. Il s’élève dans les airs à la manière des hirondelles puis il plonge comme un aigle pour fondre sur les reptiles ;il se nourrit également de cadavres ».Et Dillard avait aussi relevé ces mots du poète E.M. Forster: «Nous avançons entre deux ténèbres. Les deux seules entités capables de nous éclairer, le bébé et le cadavre, n’en ont pas la possibilité ».Au matin du 15 décembre 2021, je me suis réveillé le front contre celui de la mère morte de nos deux filles dont la seconde mettra demain au monde son troisième enfant de sexe féminin, ainsi que l’a révélé l’échographie. Moi qui suis si romantique je l’écris froidement ce matin parce que c’est vrai: j’ai dormi à côté d’un cadavre vu que la levée du corps ne pouvait se faire la veille à une heure si tardive, et j’ai vraiment dormi, même si cela paraît presque monstrueux de dormir dans le même lit d’une morte bien-aimée - j’ai dormi cette nuit-là du sommeil sans rêves du nouveau-né, et maintenant nous prenons des nouvelles de la route...Nabilla, la star de la télé-réalité dont nous suivons tous les jours, sur Instagram, les faits et gestes « au quotidien », avec tous les détails relatifs à ses nouvelles trouvailles en matière de maquillage ou son plat préféré du jour, Nabilla qui a plus de 2 millions de followers sur Instagram (surtout des filles mais aussi des mecs soyons justes) , Nabilla le reconnaît haut et fort dans sa dernière «punchline »: qu’Instagram est sa base et là elle se lâche carrément : « si je ne suis pas sur Insta, c’est comme si j’étais morte »...Et après les dernières nouvelles de la route, nous retrouvons Sarah notre envoyée spéciale sur le front des opérations en Ukraine...Dessin: Julie K. -
Quoi de neuf les paumés ?
 (Le Temps accordé - Lectures du monde 2023)Ce lundi 23 janvier.- Pendant que l’ami Claude Frochaux n’en finit plus de ressasser son constat selon lequel plus rien de significatif ne se ferait en matière de culture, d'arts et de littérature dans nos pays , et ce depuis 68 à peu près, que la fête est finie et qu’il n’y a plus d’œuvres conséquentes à découvrir, je continue pour ma part à parier pour la surprise et mon inextinguible curiosité me vaut toujours quelques découvertes ici et là même si, relisant ces jours Le docteur Faustus de Thomas Mann et les Portraits de femmes de Pietro Citati, je mesure lucidement l’abîme qui sépare un grand roman ou une approche critique créatrice du magma de productions moyennes proliférant dans la « dissociété » actuelle où tout le monde écrit et applaudit à ce qui est écrit, que n’importe qui pourrait écrire, robots y compris...Il y a de la Schadenfreude dans le lamento de l’ami Frochaux, autant que dans l’empressement de tant de beaux esprits à conclure à la décadence, et ce n’est pas par aveuglement ou béant optimisme que je m’inscris en faux contre cette idéologie de l’Après-nous-le-déluge : c’est au vu des faits et de manière égotiste et clinique à la fois, après deux accidents sur la route et en montagne, sept opérations qui m’ont valu autant de bonnes heures de lecture à l’hosto ou a casa, un cancer momentanément sous contrôle après 155 séances d’accélérateur linéaire, deux infarctus et j’en passe même si je tousse beaucoup ces jours - et fuck the desease : contre ceux qui pensaient il y a des décennies déjà que le roman était mort, je reprends la crâne réponse de Soljenitsyne qui leur balançait que tant que l’homme vivrait le roman vivra lui aussi !Dimitri aussi avait tendance à tirer l’échelle derrière lui, comme Régis Debray ou Godard et tous ceux qui ont connu et vécu de grandes heures grâce aux arts ou à la littérature, soudain confrontés à la platitude satisfaite de la culture de masse, mais c’est justement à l’insatisfaction chronique de Dimitri que je pensais hier soir après avoir achevé la lecture de La Fabrique du corps humain de Jérémie André, quand le patron de L'Âge d'Homme écrivait, dans La Gazette littéraire de je ne sais plus quelle année (disons entre 1977 et 1979) qu’il manquait, au roman romand, un Zola.En d’autres termes : que la littérature romande ne disait à peu près rien de la vie réelle, banalement matérielle des gens, de la société réelle avec ses conflits de classes, de la réalité quotidienne des métiers, des gens au travail ou des gens à l’hôpital - alors même que nos écrivains dissertaient sur les question de l’engagement et du rapport de la littérature avec les masses, surtout soucieux des états d'âme (Ah, l'Âme romande !) de tel prof névrosé ou de tel pasteur frustré.C’est Dimitri lui-même, au mitan de ma vingtaine , qui m’a conseillé de lire la série des Hommes de bonne volonté de Jules Romains et les romans « durs » de Simenon - deux auteurs particulièrement mal vus des littéraires en ces années 60-70 où l’on passait du Nouveau Roman littérairement correct à la déconstruction structuralisante puis au postmodernisme sociologisant.
(Le Temps accordé - Lectures du monde 2023)Ce lundi 23 janvier.- Pendant que l’ami Claude Frochaux n’en finit plus de ressasser son constat selon lequel plus rien de significatif ne se ferait en matière de culture, d'arts et de littérature dans nos pays , et ce depuis 68 à peu près, que la fête est finie et qu’il n’y a plus d’œuvres conséquentes à découvrir, je continue pour ma part à parier pour la surprise et mon inextinguible curiosité me vaut toujours quelques découvertes ici et là même si, relisant ces jours Le docteur Faustus de Thomas Mann et les Portraits de femmes de Pietro Citati, je mesure lucidement l’abîme qui sépare un grand roman ou une approche critique créatrice du magma de productions moyennes proliférant dans la « dissociété » actuelle où tout le monde écrit et applaudit à ce qui est écrit, que n’importe qui pourrait écrire, robots y compris...Il y a de la Schadenfreude dans le lamento de l’ami Frochaux, autant que dans l’empressement de tant de beaux esprits à conclure à la décadence, et ce n’est pas par aveuglement ou béant optimisme que je m’inscris en faux contre cette idéologie de l’Après-nous-le-déluge : c’est au vu des faits et de manière égotiste et clinique à la fois, après deux accidents sur la route et en montagne, sept opérations qui m’ont valu autant de bonnes heures de lecture à l’hosto ou a casa, un cancer momentanément sous contrôle après 155 séances d’accélérateur linéaire, deux infarctus et j’en passe même si je tousse beaucoup ces jours - et fuck the desease : contre ceux qui pensaient il y a des décennies déjà que le roman était mort, je reprends la crâne réponse de Soljenitsyne qui leur balançait que tant que l’homme vivrait le roman vivra lui aussi !Dimitri aussi avait tendance à tirer l’échelle derrière lui, comme Régis Debray ou Godard et tous ceux qui ont connu et vécu de grandes heures grâce aux arts ou à la littérature, soudain confrontés à la platitude satisfaite de la culture de masse, mais c’est justement à l’insatisfaction chronique de Dimitri que je pensais hier soir après avoir achevé la lecture de La Fabrique du corps humain de Jérémie André, quand le patron de L'Âge d'Homme écrivait, dans La Gazette littéraire de je ne sais plus quelle année (disons entre 1977 et 1979) qu’il manquait, au roman romand, un Zola.En d’autres termes : que la littérature romande ne disait à peu près rien de la vie réelle, banalement matérielle des gens, de la société réelle avec ses conflits de classes, de la réalité quotidienne des métiers, des gens au travail ou des gens à l’hôpital - alors même que nos écrivains dissertaient sur les question de l’engagement et du rapport de la littérature avec les masses, surtout soucieux des états d'âme (Ah, l'Âme romande !) de tel prof névrosé ou de tel pasteur frustré.C’est Dimitri lui-même, au mitan de ma vingtaine , qui m’a conseillé de lire la série des Hommes de bonne volonté de Jules Romains et les romans « durs » de Simenon - deux auteurs particulièrement mal vus des littéraires en ces années 60-70 où l’on passait du Nouveau Roman littérairement correct à la déconstruction structuralisante puis au postmodernisme sociologisant. Mais quoi de Zola dans le petit roman de Jérémie André ? Je dirais : le regard du médecin, au premier et au second degré. Je dirais aussi : l’attention aux aspects variés d’un métier, comme elle est omniprésente chez un Simenon et absolument absente des soucis de Dostoievski (chacun son job), et aux choses elles-mêmes que nous font côtoyer ledit métier, et l’attention non moins vive aux mots, tournures de langage et autres expressions propres aux personnages observés, ici dans une nouvelle société déjà quadrillée par le regard et l’écriture mimétique de Michel Houellebecq.C’est entendu : comparer la fine analyse des comportements de trois semi-paumés de la société actuelle évoquant l’hospice occidental de Limonov, et la machinerie énorme des romans de Zola, n’a qu’un sens indicatif, comme le regard de médecin de Jérémie André, soucieusement clinique, peut rappeler le réalisme conséquent d’un Tchekhov ou d’un Céline, autres docteurs avérés et plumitifs de haute volée.Jérémie André enfile ses gants d’écrivain débutant avec cette sorte de réserve un peu cérémonieuse que nous savons au chirurgien et qui va se transformer en gestes plus hardis et plus précis au moment de l’action; et la même précision maniaque, le même formalisme, le même souci des processus et des protocoles se retrouvent chez les trois protagonistes de La Fabrication du corps humain, à savoir: Dominique le jeune médecin, Anna l’employée-formatrice de la franchise de fast-food Brother Burger, et Jean-Pierre le gérant local de celle-ci qu’on pourrait dire l’entrepreneur type en train de théoriser le-top de l’entrepreneuriat épanouissant pour tous, carrément tip-top.Jérémie André ne pratique pas la satire, enfin pas tout à fait. Son ironie n’en est pas moins proche du sarcasme, comme lorsque Dominique constate que, désormais, à l’hôpital, on soigne les ordinateurs avec plus d’application que les patients, comme Anna constate que les friteuses de son restau demandent autant sinon plus de soins que les clients. Et Jean-Pierre de penser et d’agir comme un robot de gestion, enfin presque, puisque son humanité subsiste en lui sous forme de jalousie archaïque ou de compulsion woke quand il considère son employé noir...Je suis curieux de découvrir les commentaires marquant la réception publique et critique de ce premier roman , qui pourrait se limiter au brillant exercice de fabrication ou fonder une œuvre à plus grandes largeurs - on verra bien si la folie indispensable à l’écrivain authentique bouscule demain la sage technique du praticien ...
Mais quoi de Zola dans le petit roman de Jérémie André ? Je dirais : le regard du médecin, au premier et au second degré. Je dirais aussi : l’attention aux aspects variés d’un métier, comme elle est omniprésente chez un Simenon et absolument absente des soucis de Dostoievski (chacun son job), et aux choses elles-mêmes que nous font côtoyer ledit métier, et l’attention non moins vive aux mots, tournures de langage et autres expressions propres aux personnages observés, ici dans une nouvelle société déjà quadrillée par le regard et l’écriture mimétique de Michel Houellebecq.C’est entendu : comparer la fine analyse des comportements de trois semi-paumés de la société actuelle évoquant l’hospice occidental de Limonov, et la machinerie énorme des romans de Zola, n’a qu’un sens indicatif, comme le regard de médecin de Jérémie André, soucieusement clinique, peut rappeler le réalisme conséquent d’un Tchekhov ou d’un Céline, autres docteurs avérés et plumitifs de haute volée.Jérémie André enfile ses gants d’écrivain débutant avec cette sorte de réserve un peu cérémonieuse que nous savons au chirurgien et qui va se transformer en gestes plus hardis et plus précis au moment de l’action; et la même précision maniaque, le même formalisme, le même souci des processus et des protocoles se retrouvent chez les trois protagonistes de La Fabrication du corps humain, à savoir: Dominique le jeune médecin, Anna l’employée-formatrice de la franchise de fast-food Brother Burger, et Jean-Pierre le gérant local de celle-ci qu’on pourrait dire l’entrepreneur type en train de théoriser le-top de l’entrepreneuriat épanouissant pour tous, carrément tip-top.Jérémie André ne pratique pas la satire, enfin pas tout à fait. Son ironie n’en est pas moins proche du sarcasme, comme lorsque Dominique constate que, désormais, à l’hôpital, on soigne les ordinateurs avec plus d’application que les patients, comme Anna constate que les friteuses de son restau demandent autant sinon plus de soins que les clients. Et Jean-Pierre de penser et d’agir comme un robot de gestion, enfin presque, puisque son humanité subsiste en lui sous forme de jalousie archaïque ou de compulsion woke quand il considère son employé noir...Je suis curieux de découvrir les commentaires marquant la réception publique et critique de ce premier roman , qui pourrait se limiter au brillant exercice de fabrication ou fonder une œuvre à plus grandes largeurs - on verra bien si la folie indispensable à l’écrivain authentique bouscule demain la sage technique du praticien ... -
Prends garde à la douceur (5)
(Pensées de l'aube, V)De cette réminiscence. – Si la rose de l’aube se défroisse c’est que tu l’as rêvé, c’est ton désir d’aube qui fait monter les couleurs, ton souvenir à venir de jours meilleurs, ton haleine venue d’un autre souffle, ton malheur de n’être pas digne de ce qui sera, ton bonheur d’attendre de nouveau tous les jours en te rappelant ce parfum d’avant l’aube qui t’attend.De la survie.– J’ai mal au monde, se dit le dormeur éveillé, sans savoir à qui il le dit, mais la pensée se répand et suscite des échos, des mains se trouvent dans la nuit, les médias parlent de trêve et déjà s’inquiètent de savoir qui a battu qui dans l’odieux combat, les morts ne sont pas encore arrachés aux gravats, les morts ne sont pas encore pleurés et rendus à la terre que les analystes analysent qui a gagné dans l’odieux combat, et le froid s’ajoute au froid, mais le dormeur éveillé dit à la nuit que les morts survivent…De la vile lucidité.– Ils dénoncent ce qu'ils disent des alibis, toute pensée émue, tout geste ému, toute action émue ils les dénoncent comme nuls et non avenus, car ils voient plus loin, la Raison voit toujours plus loin que le cœur, jamais ils ne seront dupes, jamais on ne la leur fera, disent-ils en dénonçant les pleureuses, comme ils les appellent pour mieux les démasquer - mais ce ne sont pas des masques qu’ils arrachent : ce sont des visages...De nos pauvres mots. – Mais aussi tu te dis: de ta pitié, qu’en ont-ils à faire ? Les chars se retirent des décombres en écrasant un peu plus ceux qui y sont ensevelis et tu devrais faire ton sac, départ immédiat pour là-bas, mais qui s’occupera du chien et des oiseaux ? Et que fera-t-elle sans toi ? Et toi qui ne sait même pas construire un mur, juste bon à aligner quelques mots - juste ces quelques mots pour ne pas désespérer: courage aux survivants…Peinture: Edvard Munch. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, IV)De l’offrande. – Je me réveille à hauteur de source, j’ai refait le plein d’énergie, sous la cloche d’azur je tinterai tout à l’heure comme l’oiseau, puis je descendrai par les villages aux villes polluées et là-bas j’ajouterai ma pureté à l’impureté, je vous donnerai ce qui m’a été donné les yeux fermés.De l’absence.– Je n’aime pas que tu ne sois pas là, je n’aime pas avoir pour écho que ton silence, je n’aime pas cet oreiller que ta tête n’a pas martelé du chaos de tes songes, je n’aime pas cet ordre froid de ton absence que nous sommes deux à ne pas aimer, me dit ton premier SMS de là-bas.De l’espérance.– Tu me dis, toi le désespéré, que mes pleurs sont inutiles, et tout est inutile alors, toute pensée comme l’aile d’un chant, tout esquisse d’un geste inutilement bon, toute ébauche d’un sourire inutilement offert, ne donnons plus rien, ne pleurons plus, soyons lucides, soyons froids, soyons utiles comme le couteau du bourreau.
(Pensées de l'aube, IV)De l’offrande. – Je me réveille à hauteur de source, j’ai refait le plein d’énergie, sous la cloche d’azur je tinterai tout à l’heure comme l’oiseau, puis je descendrai par les villages aux villes polluées et là-bas j’ajouterai ma pureté à l’impureté, je vous donnerai ce qui m’a été donné les yeux fermés.De l’absence.– Je n’aime pas que tu ne sois pas là, je n’aime pas avoir pour écho que ton silence, je n’aime pas cet oreiller que ta tête n’a pas martelé du chaos de tes songes, je n’aime pas cet ordre froid de ton absence que nous sommes deux à ne pas aimer, me dit ton premier SMS de là-bas.De l’espérance.– Tu me dis, toi le désespéré, que mes pleurs sont inutiles, et tout est inutile alors, toute pensée comme l’aile d’un chant, tout esquisse d’un geste inutilement bon, toute ébauche d’un sourire inutilement offert, ne donnons plus rien, ne pleurons plus, soyons lucides, soyons froids, soyons utiles comme le couteau du bourreau. -
Pour mieux comprendre le wokisme, tâchons donc de le « déconstruire »...
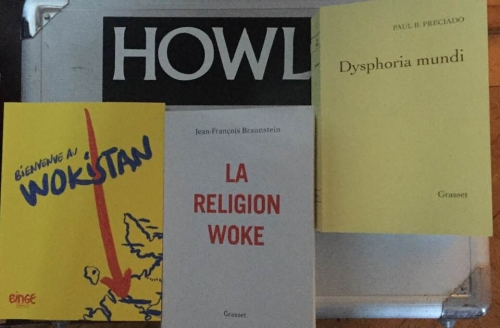
Un essai très documenté à coloration polémique, La religion woke, de Jean François Braunstein ; Dysphoria mundi, le nouveau pavé du « trans » Paul B. Preciado, figure en vue du wokisme ; et Bienvenue au Wokistan, recueil à dominante néoféministe rassemblant les textes d’une trentaine d’activistes multisexes: autant d’approches d’une mouvance idéologique jugée délétère par les uns, vécue par d’autres comme une protestation libératrice.
Jean-Louis KUFFER
« Stay woke ! », s’écrie la conscience blessée devant l’atrocité de ce qui est, et je me le rappelle tous les matins en prenant des nouvelles du monde nous arrivant au même instant de partout, et je me dis que ça ne devrait pas être, comme je me le suis dit enfant à la découverte d’un premier oiseau mort dans notre jardin, de même que je me le suis dit l’an dernier après qu’un jeune flic paniqué de nos régions eut flingué un Noir au comportement inquiétant, et comme je me le dis ce matin en prenant des nouvelles d’Ukraine et de partout : « Reste éveillé ! »
Hier soir encore, l’atrocité du monde m’est revenue avec les épisodes insoutenables de telle série coréenne (Juvénile justice, sur Netflix) consacrée aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants devenant parfois de monstrueux délinquants, et l’inventaire des calamités imputables à ce que Montaigne appelait « l’hommerie » se trouvait une fois de plus ressassé, enfants et femmes battus, viols et violences à n’en plus finir, et j’entendais la voix de ma conscience meurtrie me répéter : «reste éveillé ! »
Serais-je donc un wokiste ? Mais de quel droit pourrais-je m’approprier cette appellation, issue des mouvements de protestation noirs tels les BlackLiveMatters ? Et vous qui rejetez le wokisme, comment l’entendez-vous ? Êtes-vous raciste, sexiste, défenseur acharné du patriarcat ? De quoi parlons-nous ? Ne serait-ce pas le moment de «déconstruire» les discours relatifs au wokisme ?
C’est entendu : le verbe « déconstruire » fait un peu langue de bois universitaire, mais en l’occurrence le procédé serait bien celui-là : à savoir décortiquer les éléments d’un discours qui prête à confusion et tâcher d’en reconstituer un énoncé plus intelligible. Autrement dit: écouter ou lire ce que disent les wokistes au lieu de couper court (genre pauvre-mec-casse-toi-point-barre) comme pas mal d’entre eux procèdent d’ailleurs avec le mâle blanc violeur potentiel et increvablement colonialiste, donc raciste et quelque part crypto-fasciste, etc.
Cette idée conciliatrice m’est venue à la lecture, surtout, de deux livres également intéressants quoique opposés dans beaucoup de leurs positions, qui pratiquent chacun à sa façon ladite « déconstruction ». À savoir : Dysphoria mundi de Paul B. Praciado, et La religion woke de Jean-François Braunstein.
Un « trans » à deux faces
De la « déconstruction », le nouveau pavé de Paul B. Preciado, disciple d’ailleurs de l’inventeur du concept littéraire que fut Jacques Derrida, est à l'évidence un parangon, voué qu’il se veut, entre autres, à l'analyse critique des faits et discours liés à la gestion « biopolitique »des crises sanitaires les plus caractéristiques de notre temps, des années sida aux années covid.
Se défendant du complotisme, autant que de l’esprit binaire, Preciado ne voit pas moins, à la suite de Michel Foucault, ou de Susan Sontag pour le cancer, un lien direct voire « logique » entre maladie et société, virus et pouvoir ou, plus précisément, entre la pandémie récente et le système capitaliste qu’il qualifie de pétro-sexo-raciste. Cela pour le cadre idéologique de son discours majoritairement « trans », de visé quasi dystopique. Mais l’ouvrage de Preciado se module aussi en « poème » beaucoup plus personnel, où celui qui a vécu le confinement, comme nous tous, multiplie les observations par-delà les généralisations de l’idéologue impatient de voir les trans, queer, femmes violée et autres victimes accomplir une nouvelle révolution mondiale, etc. D’où la nécessité, pour le lecteur ou la « lecteurice » (ce néologisme est de Preciado lui-même), de «déconstruire» à son tour sa réception du texte aux niveaux de discours contrastés disons: du militant hyperdocumenté aux argumentations aussi sophistiquées que tendancieuses, et de l’écrivain tripalement impliqué, punkoïde de ton et de style, et non sans réel attrait.
De son côté, le prof de philo émérite de la Sorbonne Jean-Francois Braunstein s’emploie lui aussi à « déconstruire » les discours même du wokisme dont il scrute les tenants blacks américains, liés à la rue, et les aboutissants idéologiques largement relayés par l’université américaine, dont les théories font figure de nouveaux dogmes et suscitent passions et scissions, exclusions et excisions de langage.
Qui a raison et qui a tort ? A qui le Bonus et le Malus, pour parler binaire, alors que Preciado autant que Braunstein prétendent chacun dépasser le binarisme ? Loin de moi l’idée de les renvoyer dos à dos ni non plus de concilier ce que je sais inconciliable. Mais briser là ou choisir ? Sûrement pas : mon expérience personnelle m’en empêche, et ce sera ma façon là encore de « déconstruire » ma lecture de ces deux «frères humains» que de confronter leurs écrits à la complexité de la vie, à commencer par la mienne (je parle au nom de tout lecteur de bonne foi et de bon sens), en oubliant ( !) que je suis une sorte de résidu vieillissant de mâle blanc portant sur lui «l’arme du viol »...
Colères contre colères, mais après ?
Souvenir perso : ce soir de 1979 où, revenant bouleversé d’une réunion de son groupe révolutionnaire LGBT avant la lettre, mon ami Ted me raconte comment filles et garçons, lesbiennes et gays, en sont venus aux cris et aux mains après que Léa (prénom fictif) eut lancé à Théo que toute discussion était impossible avec un mec portant sur lui « l’arme du viol »...
C’était il y a plus de quarante ans, et voici, peu avant son suicide, ce que me répondit mon ami Roland Jaccard lorsque j’évoquai, seul à sa table, la détresse d’une jeune fille de mon entourage séquestrée et violée par le compagnon dont elle était décidée à se séparer: que bien entendu elle l’avait voulu... Alors chacune et chacun d’y aller de son anecdote, entre le « tous violeurs » et le « toutes menteuses »…
Or c’est justement à la table de Roland Jaccard, au restau japonais Chez Yushi, à Paris, que j’ai rencontré Jean-Francois Braunstein, avant de lire La philosophie devenue folle, saisissant aperçu des nouvelles théories du genre et de la race dans les universités américaines, où il aussi question, en termes vifs, de Beatriz Preciado devenue Paul, déjà très répandu dans les médias parisiens en nouvel apôtre du wokisme, et signant aujourd’hui Dysphoria mundi.
Le terme de wokisme, au moment de ma rencontre avec Braunstein, en 2018, n'était pas encore courant, mais La religion wokiste s'inscrit dans le droit fil de l'ouvrage précédent, avec le même souffle polémique explicite.
Car la colère des wokistes, que Braunstein reconnaît d'ailleurs légitime « à la base », soulève la sienne aussi par ses excès, voire ses délires, quitte à lui faire voir parfois du wokisme partout; et de même suis-je disposé à partager pas mal des colères de Preciado, en déplorant ses généralisations souvent abusives.
Une religion, vraiment ?
J’ai quelques réserves, à vrai dire, par rapport au terme de religion appliqué au wokisme par Braunstein, mais c’est lui-même qui nous apprend que la notion a été introduite par le prof de linguistique John McWorther, un de ces Noirs opposés au wokisme dans l’antiracisme aveugle duquel ils voient une menace d’infantilisation des Blacks – le titre du dernier ouvrage de McWorther étant d’ailleurs explicite: Le racisme woke. Comment une nouvelle religion a trahi l’Amérique noire...
Si le wokisme relève de la mouvance idéologique, comme avant lui le politiquement correct, ou le New Age «vintage », plus que de la religion – faute de toute transcendance invoquée et de tout pardon accordé -, il a bel et bien des aspects religieux dans ses rites et ses codes verbaux, son moralisme et son esprit grégaire, mais avec un refus des données naturelles qui le distingue pour le moins des grandes traditions spirituelles. Refus de la filiation, refus de la différenciation biologique des sexes, refus de la simple réalité « tombant sous le sens »…
« Religion des fragiles » marquée par l’effacement du corps et la neutralisation des femmes en tant que telles (trans en bisbille avec les lesbiennes et les féministes « classiques », comme on le voit chez Preciado), mais aussi par la dénonciation essentialiste du racisme blanc, la lutte contre la Science « viriliste » et la mise en doute des Lumières, le wokisme, comme le premier christianisme selon Tertullien (« Je crois parce que c’est absurde ») a cela de particulier qu’il échappe à tout débat rationnel et séduit même les pontes universitaires ou politiques.
Jean-François Braunstein accumule ainsi les exemples de consentement aberrants aux thèses wokistes les plus extrêmes, jusqu’aux plus hautes autorités (il cite la Royal Society de Nouvelle-Zélande cautionnant des thèses créationnistes pour des motifs strictement opportunistes), dans un contexte rappelant évidemment l’opposition de l’Église romaine aux avancées de la Science...
Son indignation de professeur spécialiste de la philosophie des sciences et de l’histoire de la médecine, inquiet de voir les thèses les plus farfelues défendues par certains de ses collègues (en matière de biologie mais aussi de mathématiques), fait écho aux plus vives réactions, notamment de scientifiques venus des pays de l’Est qui se rappellent les ravages de l’idéologie dans le champ de la Science. Marx parlait de la religion comme de l’opium du peuple ? Mais si c’était plutôt, ici, la drogue de certaines «élites» et de leurs disciples ignares ?
Pour détendre un peu l’atmosphère, après mes lectures de Braunstein et Preciado, je me suis amusé à lire aussi les textes, où la débilité démagogique jouxte des arguments parfois recevables, du recueil très militant intitulé Bienvenue au Wokistan, où l’on trouve notamment l’injonction d’une certaine Pauline Harmange, qualifiée de « globe-trotteuse des masculinités fragiles», à détester les hommes en leur opposant la plus totale misandrie. Prête à considérer désormais les hommes comme un groupe homogène ou une classe sociale, elle y va de son appel à l’épuration de cette infâme créature qu'est le mâle blanc selon elle.
« Rien, rien ne vous est dû ! », nous balance-t-elle sans une once d'humour, « il va falloir commencer à mériter »... Et ce que je me demande, alors, c'est si nos amies féministes ont vraiment mérité d'être représentées par une agitée sexiste de cet acabit ?
L’éveil reste à « déconstruire »…
Déconstruire l’idéologie woke ? Voyez alors, aussi, par où elle passe comment elles se répand, et le recueil de Bienvenue au Wokistan, édition sur papier de podcasts, en est un bon exemple. Dès le début du wokisme, la rue et le rap, mais surtout les réseaux sociaux, nouveaux moyens de diffusion des opinions de meute, ont proliféré. Y a-t-il de quoi s’en inquiéter ? Jean-François Braunstein l’affirme, quitte parfois à pousser le bouchon trop loin en affirmant que Facebbok ou Netflix de viennent des vecteurs du wokisme…
Du moins restons éveillés, mais sans esprit de vengeance et sans cette propension actuelle à se réclamer de la souffrance des autres pour établir sa vertu à bon compte. Répondre à la haine par la haine, ne voir partout qu'abus et noirceur, faire de l'Occident seul ou du seul mâle blanc des monstres n’est-il pas, en fin de compte, la meilleure façon d'ajouter à la confusion et au chaos, etc.
Jean-François Braunstein. La religion woke. Grasset, 280p.
Paul B. Preciado. Dysphoria mundi. Grasset, 590p.
Bienvenue au Wokistan. Collectif. Binge Audio Editions, 2022, 175p.
-
Prends garde à la douceur
(Pensées de l'aube, I)De la joie. - Il y a en moi une joie que rien ne peut altérer : telle est ma vérité première et dernière, ma lumière dans les ténèbres. C’est dans cette pensée, qui est plutôt un sentiment, une sensation diffuse et précise à la fois, que je me réveille tous les matins.De l’Un. – Ma conviction profonde est qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’une seule Vérité, mais que cela n’exclut pas tous les dieux et toutes les vérités : que cela les inclut.Du noir. – Plus vient l’âge et plus noir est le noir d’avant l’aube, comme un état rejoignant l’avant et l’après, à la fois accablant et vrai, mais d’une vérité noire et sans fond qui reprend bientôt forme tandis qu’un sol se forme et qu’un corps se forme, et des odeurs viennent, et des saveurs, et la joie renaît - et cet afflux de nouveaux projets.Peinture JLK: Toscane rêvée. -
Ceux qui desservent leur cause
 (Le Temps accordé - Lectures du monde VII, 2023)A la Maison bleue, ce dimanche 15 janvier .- Je me suis imposé la lecture de centaines de pages, ces derniers temps, relatives à cette nouvelle mouvance idéologique sectaire qu’on appelle le wokisme, sans cesser de lire des livres de plus naturelle prédilection (le magnifique recueil des Portraits de femmes de Pietro Citati, son autre formidable essai intitulé Le mal absolu, La mort d’Elise de Marcel Jouhandeau et Le pas de la demi-lune de David Bosc), tout en peinant chaque jour une heure sur mon apprentissage du hangueul - comme on appelle la langue coréenne - et en regardant diverses séries parfois plus intéressantes qu’un tas de livres-qui-cartonnent, et je me dis ce matin que c’est ma paresse naturelle, ma débonnaireté et mon increvable curiosité qui m’empêchent de prendre tout ça trop au sérieux et de conserver mon équilibre personnel et mon indépendance d'esprit.Je lisais hier soir, dans La religion woke de Jean-François Braunstein, les pages très détaillées consacrées au rejet de la science « viriliste» par ceux et celles qui jettent le discrédit sur la biologie et même sur les mathématiques, estimées intrinsèquement androcentristes, et je me suis rappelé les méfaits du biologiste soviétique Lyssenko dans les années 30 du siècle passé, en guerre contre la science bourgeoise au nom de la science prolétarienne (sic) et promettant quatre récoltes par an au camarade Staline qui fit déporter ou fusilier les scientifiques doutant de ces absurdités.
(Le Temps accordé - Lectures du monde VII, 2023)A la Maison bleue, ce dimanche 15 janvier .- Je me suis imposé la lecture de centaines de pages, ces derniers temps, relatives à cette nouvelle mouvance idéologique sectaire qu’on appelle le wokisme, sans cesser de lire des livres de plus naturelle prédilection (le magnifique recueil des Portraits de femmes de Pietro Citati, son autre formidable essai intitulé Le mal absolu, La mort d’Elise de Marcel Jouhandeau et Le pas de la demi-lune de David Bosc), tout en peinant chaque jour une heure sur mon apprentissage du hangueul - comme on appelle la langue coréenne - et en regardant diverses séries parfois plus intéressantes qu’un tas de livres-qui-cartonnent, et je me dis ce matin que c’est ma paresse naturelle, ma débonnaireté et mon increvable curiosité qui m’empêchent de prendre tout ça trop au sérieux et de conserver mon équilibre personnel et mon indépendance d'esprit.Je lisais hier soir, dans La religion woke de Jean-François Braunstein, les pages très détaillées consacrées au rejet de la science « viriliste» par ceux et celles qui jettent le discrédit sur la biologie et même sur les mathématiques, estimées intrinsèquement androcentristes, et je me suis rappelé les méfaits du biologiste soviétique Lyssenko dans les années 30 du siècle passé, en guerre contre la science bourgeoise au nom de la science prolétarienne (sic) et promettant quatre récoltes par an au camarade Staline qui fit déporter ou fusilier les scientifiques doutant de ces absurdités. Jean-François Braunstein a le mérite d’accumuler beaucoup d’exemples de nouveaux consentement aberrants aux thèses wokistes les plus extrêmes, jusqu’aux plus hautes autorités politiques ou académiques (il cite l’incroyable soumission de la Royal Society de Nouvelle Zélande cautionnant des thèses créationnistes pour des motifs strictement opportunistes) dans un contexte rappelant évidemment l’opposition de l’Eglise romaine aux avancées de la Science...Moi qui ne connais rien à celle -ci, nul en maths mais peu fier de l’être (alors que devrais l’être au contraire selon celles et ceux qui estiment que l’exigence d’une réponse unique à un problème est une preuve de condescendance...), et qui défends les délires révélateurs de la poésie, je ne puis qu’être humilié par la stupidité des attaque visant la rationalité en tant que telle, la rigueur scientifique, le respect des preuves et la considération honnête du réel et des lois de la nature.J’ai quelques réserves par rapport au terme de religion appliqué au wokisme par Braunstein, mais c’est grâce à celui-ci que nous apprenons que la notion a été introduite par le prof de linguistique John McWorther, un de ces Noirs opposés au wokisme dans l’antiracisme aveugle duquel ils voient une menace d’infantilisation des Blacks. Titre du dernier ouvrage de McWorther: Le racisme woke. Comment une nouvelle religion a trahi l’Amérique noire...Pour détendre l’atmosphère, je me suis amusé à lire aussi les textes, où la débilité démagogique jouxte des arguments tout à fait recevables, du recueil très militant intitulé Bienvenue au Wokistan, ou l’on trouve notamment l’injonction d’une certaine Pauline Harmange, qualifiée de globe-trotteuse des masculinités fragiles (sic), à détester les hommes en leur opposant la plus totale misandrie.Toute prête à considérer désormais les hommes comme un groupe homogène ou une classe sociale, elle y va de son appel à l’épuration de cette infâme créature qu'est l'homme selon elle.« Rien, rien ne vous est dû ! », nous balance-t-elle sans une once d'humour, « il va falloir commencer à mériter »... et ce que je me demande alors, c'est si nos amies féministes ont vraiment mérité d'être représentées par une idiote sexiste de cet acabit ?
Jean-François Braunstein a le mérite d’accumuler beaucoup d’exemples de nouveaux consentement aberrants aux thèses wokistes les plus extrêmes, jusqu’aux plus hautes autorités politiques ou académiques (il cite l’incroyable soumission de la Royal Society de Nouvelle Zélande cautionnant des thèses créationnistes pour des motifs strictement opportunistes) dans un contexte rappelant évidemment l’opposition de l’Eglise romaine aux avancées de la Science...Moi qui ne connais rien à celle -ci, nul en maths mais peu fier de l’être (alors que devrais l’être au contraire selon celles et ceux qui estiment que l’exigence d’une réponse unique à un problème est une preuve de condescendance...), et qui défends les délires révélateurs de la poésie, je ne puis qu’être humilié par la stupidité des attaque visant la rationalité en tant que telle, la rigueur scientifique, le respect des preuves et la considération honnête du réel et des lois de la nature.J’ai quelques réserves par rapport au terme de religion appliqué au wokisme par Braunstein, mais c’est grâce à celui-ci que nous apprenons que la notion a été introduite par le prof de linguistique John McWorther, un de ces Noirs opposés au wokisme dans l’antiracisme aveugle duquel ils voient une menace d’infantilisation des Blacks. Titre du dernier ouvrage de McWorther: Le racisme woke. Comment une nouvelle religion a trahi l’Amérique noire...Pour détendre l’atmosphère, je me suis amusé à lire aussi les textes, où la débilité démagogique jouxte des arguments tout à fait recevables, du recueil très militant intitulé Bienvenue au Wokistan, ou l’on trouve notamment l’injonction d’une certaine Pauline Harmange, qualifiée de globe-trotteuse des masculinités fragiles (sic), à détester les hommes en leur opposant la plus totale misandrie.Toute prête à considérer désormais les hommes comme un groupe homogène ou une classe sociale, elle y va de son appel à l’épuration de cette infâme créature qu'est l'homme selon elle.« Rien, rien ne vous est dû ! », nous balance-t-elle sans une once d'humour, « il va falloir commencer à mériter »... et ce que je me demande alors, c'est si nos amies féministes ont vraiment mérité d'être représentées par une idiote sexiste de cet acabit ? -
Transes verbicides
(Le Temps accordé - lectures du monde 2023)Ce vendredi 13 janvier.- Nous avons passé de la langue de bois à la langue de coton, me disait la romancière Cookie Allez il y a une vingtaine d’années de ça, quand un balayeur de rue était devenu un technicien de surface et qu’un cul-de-jatte se retrouvait identifié en tant que personne à mobilité réduite.Chère Cookie ! Se doutait-elle qu’un prénom comme le sien, aujourd’hui , serait convoité par maintes « personnes avec utérus», selon la nouvelle terminologie qui estime le terme de «femme» discriminant voire transphobe, alors que les personnes dotées d’un membre à « tissu érectile mâle » opteraient plutôt pour les prénoms d’Océan ou de Fluide... Non je ne délire pas: je continue de lire, sans rire, les pages de La religion woke, de Jean-François Braunstein, consacrées à la disparition du terme restrictif de «femme» et à la guerre sororicide des féministes et des lesbiennes contre les trans, où l’on touche au fond de la question par ce qu’on pourrait dire l’excision de la langue courante visant à un nouveau négationnisme : à savoir le déni de la réalité par l’imaginaire et la seule autorité en la matière qu’est la conscience. Celle-ci me dit que je suis femme au dam de ma paire de couilles, donc je suis femme - point barre.Aucun problème n’est-ce pas ? Sauf si les femmes fières de l’être ou préférant leurs semblables aux mecs couillus et aux trans qui le restent dans les vestiaires et sur les stades de la Performance, voire dans les prisons de femmes, faussent le jeu en cumulant les atouts.Braunstein ne polémique pas dans le vide : il multiplie les exemples, surtout anglo-saxons, de cette nouvelle guerre picrocholine (au secours Rabelais !) où l’on voit des autorités sanitaires ou politiques réviser le langage courant pour ne pas discriminer telle ou telle minorité, à commencer par les trans.Le pénis rebaptisé « tissu érectile mâle » n’est pas une invention malveillante: c’est l’expression de remplacement proposé par le doyen d’une faculté de médecine américaine à une urologue , laquelle l’envoya heureusement paître, alors qu’à l’université de Californie telle campagne de prévention du cancer du col de l’utérus ne s’adresse pas explicitement aux femmes (nos sœurs dites women) mais aux « personne ayant un col de l’utérus »)...Ce qui m’amène ce matin à éviter de penser à notre seconde fille comme à une « mère » en voie prochaine d’accoucher d’une petite fille (l’échographie n’est qu’un détail de l’histoire) , mais à une « parente donnant naissance » et peut-être en mesure de nourrir le nouveau «sujet neutre» au « lait parental », avant l'assignation d'un sexe ouvert à toute révision.Vous vous inquiétez, comme la romancière mal pensante Joanne Rowling, mère présumée du petit Harry Potter, de ce qu’on enferme désormais certains ex-violeurs devenus trans tout en gardant sur eux «l’outil du viol» dans des prisons de femmes, au point de tweeter à la manière d’Orwell: « La guerre c’est la paix. La Liberté c’est l’esclavage. L’ignorance c’est la force. L’individu avec pénis qui vous a violée est un femme» ? Inquiétude justifiée, vu le haro vengeur de la meute sur Rowling !Et ça ira si loin qu’aux tweets de celle-ci un trans homme devenu femme et accepté en tant que telle dans une compétition d’arts martiaux mixtes, se vante d’avoir massacré deux femmes, déclarées transphobes, au moment même où les fédérations sportives ouvrent les compétitions sportives féminines aux hommes s’auto-identifiant comme femmes sans aucun critère physiologique.Ce qui fait dire à Linda Blade, ancienne championne et entraîneuse: « La recommandation d’ouvrir le sport féminin à des mâles est sans doute, quelque soit l’intention, la décision la plus misogyne dans l'histoire du sport. En effet statistiquement, les athlètes masculins sont 40 o/o plus lourds, 15 o/o plus rapides, 30 o/o plus puissants, et 25 a 50 o/o plus forts que leurs homologues féminins indépendamment de quelque intervention hormonale».De la langue de coton, l’on aura passé ainsi à l’algorithme inclusif de la novlangue des zombies sympas, fusionnés en système binaire numérique par le dernier avatar autoproclamé scientifique de la théorie des fluides, etc.Jean-François Braunstein, La religion woke. Grasset, 2022.
Non je ne délire pas: je continue de lire, sans rire, les pages de La religion woke, de Jean-François Braunstein, consacrées à la disparition du terme restrictif de «femme» et à la guerre sororicide des féministes et des lesbiennes contre les trans, où l’on touche au fond de la question par ce qu’on pourrait dire l’excision de la langue courante visant à un nouveau négationnisme : à savoir le déni de la réalité par l’imaginaire et la seule autorité en la matière qu’est la conscience. Celle-ci me dit que je suis femme au dam de ma paire de couilles, donc je suis femme - point barre.Aucun problème n’est-ce pas ? Sauf si les femmes fières de l’être ou préférant leurs semblables aux mecs couillus et aux trans qui le restent dans les vestiaires et sur les stades de la Performance, voire dans les prisons de femmes, faussent le jeu en cumulant les atouts.Braunstein ne polémique pas dans le vide : il multiplie les exemples, surtout anglo-saxons, de cette nouvelle guerre picrocholine (au secours Rabelais !) où l’on voit des autorités sanitaires ou politiques réviser le langage courant pour ne pas discriminer telle ou telle minorité, à commencer par les trans.Le pénis rebaptisé « tissu érectile mâle » n’est pas une invention malveillante: c’est l’expression de remplacement proposé par le doyen d’une faculté de médecine américaine à une urologue , laquelle l’envoya heureusement paître, alors qu’à l’université de Californie telle campagne de prévention du cancer du col de l’utérus ne s’adresse pas explicitement aux femmes (nos sœurs dites women) mais aux « personne ayant un col de l’utérus »)...Ce qui m’amène ce matin à éviter de penser à notre seconde fille comme à une « mère » en voie prochaine d’accoucher d’une petite fille (l’échographie n’est qu’un détail de l’histoire) , mais à une « parente donnant naissance » et peut-être en mesure de nourrir le nouveau «sujet neutre» au « lait parental », avant l'assignation d'un sexe ouvert à toute révision.Vous vous inquiétez, comme la romancière mal pensante Joanne Rowling, mère présumée du petit Harry Potter, de ce qu’on enferme désormais certains ex-violeurs devenus trans tout en gardant sur eux «l’outil du viol» dans des prisons de femmes, au point de tweeter à la manière d’Orwell: « La guerre c’est la paix. La Liberté c’est l’esclavage. L’ignorance c’est la force. L’individu avec pénis qui vous a violée est un femme» ? Inquiétude justifiée, vu le haro vengeur de la meute sur Rowling !Et ça ira si loin qu’aux tweets de celle-ci un trans homme devenu femme et accepté en tant que telle dans une compétition d’arts martiaux mixtes, se vante d’avoir massacré deux femmes, déclarées transphobes, au moment même où les fédérations sportives ouvrent les compétitions sportives féminines aux hommes s’auto-identifiant comme femmes sans aucun critère physiologique.Ce qui fait dire à Linda Blade, ancienne championne et entraîneuse: « La recommandation d’ouvrir le sport féminin à des mâles est sans doute, quelque soit l’intention, la décision la plus misogyne dans l'histoire du sport. En effet statistiquement, les athlètes masculins sont 40 o/o plus lourds, 15 o/o plus rapides, 30 o/o plus puissants, et 25 a 50 o/o plus forts que leurs homologues féminins indépendamment de quelque intervention hormonale».De la langue de coton, l’on aura passé ainsi à l’algorithme inclusif de la novlangue des zombies sympas, fusionnés en système binaire numérique par le dernier avatar autoproclamé scientifique de la théorie des fluides, etc.Jean-François Braunstein, La religion woke. Grasset, 2022. -
Retournez les fusils !
 (Le Temps accordé - Lectures du monde 2023)A la Maison bleue, ce jeudi 12 janvier. - À vingt ans, l’injonction me semblait aller de soi, et tous mes camarades progressistes le répétaient en meute au nom des damnés de la terre: que c’était l’heure des brasiers et le moment de retourner les fusils.La vision des chiens de garde de la pensée bourgeoise incarnée par les mandarins de l’Université ne faisait qu’exacerber notre rage d’anges exterminateurs. Le camarade Paul Nizan, auteur précisément du pamphlet intitulé Les chiens de garde, avait écrit ces mots qui me semblaient l’expression même de ma conscience malheureuse: « J’avais 20 ans et je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel âge de la vie ».Puis ce fut Mai 68 et les fusils retournés, le même genre de sentences solennelles émaillant les murs de nos chambres d’étudiants angéliques se prenant pour des démons, et telle nuit, à la Sorbonne occupée, dans le tourbillon des discours enflammés comme des torchères de rhétorique, les groupes de discussion se transformant bientôt en sous-groupes divisés annonçant toutes les scissions, les divisions et les révisions, les cris des militants et des militantes déjà furieuses de n’être pas entendues, il m'a semblé que tout ce qui était vociféré se détachait déjà de la réalité, avec, dans la bouche, le poids de cette langue de bois qui n’était que la grimace du langage bourgeoi; j’avais vingt ans et un an et comme un premier dégoût physique de toute idéologie m’était venu cette nuit-là à la Sorbonne où les anges se déchaînaient.Des anges de ce temps-là et des années qui ont suivi, un mâle blanc venu de l’Est, un certain Milan Kundera, une espèce de dissident, avait brossé le portrait dans son Livre du rire et de l’oubli, et le relisant je me suis retrouvé aujourd’hui au milieu des mêmes anges, plus désincarnés encore que leurs aînés et non moins péremptoires.Un demi-siècle après nos vingt ans, à treize jours de la naissance d’une petite fille dont l’avenir ne sera pas pire, je le crois, que celui d’un enfant de 1923, j’essaie de me représenter ce que ressens « la mère », « notre fille » , sans y parvenir évidemment faute de la moindre incarnation, mon seul droit étant de me taire.Et de même ai-je envie de dire ce matin, à toutes les femmes qui n’ont pas enfanté , de mesurer ce qu’elles disent à ce propos.Et qu’on ne me chante pas que c’est un « petit ange » qui nous viendra...Ces réflexions paraîtront d’une banalité affligeante aux sachants qui travaillent les sujets de l’identité maternitaire, mais je les emmerde, ou plus exactement : je vais les écouter et déconstruire leurs théories pour retourner mon fusil de la manière la plus tranquille et souriante en mon pacifisme de vieil ange aux articulations grinçantes et à peu près à bout de souffle : je vous aime et vous emmerde.Vous croyez me tenir, ou même me blesser (vous allez me sortir la freudaine de la « blessure narcissique ») en me traitant de mâle blanc forcément raciste et colonialiste quelque part, mais vous tombez mal car je le pense aussi : je suis quelque part tout ça et bien pire: je l’écris autant que je m’obstine à lire toutes sortes de livres juste bons à brûler sur vos bûchers virtuels ou réels.Retourner les fusils , en fin de compte, me semble une démarche à relancer de manière pacifique en continuant de «déconstruire» les systèmes par le jeu du décentrage ironique ou mieux: de l’humour.Lorsque le marquis de Sade retourne les fusils du dogmatisme catholique dans son théâtre évoquant une messe sodomite, comme Jean Genet a sa façon, ils inspirent évidemment des activistes plus directs et moins géniaux, mais pour ma part je trouve plus de hardiesse non conformiste chez un Marcel Aymé et plus d’humanité lucide chez un Tchekhov qu’il serait évidemment grotesque de réduire au statut de mâle blanc alors qu’il s’est montré plus réellement actif, en termes d’enseignement ou de liberté d’esprit, que tant de révolutionnaires prêcheurs, entre rues et salons.A propos de fusil , l’ange que j’étais a vingt ans, s’efforçant de manier cet engin à l’exercice militaire, n’a jamais pensé qu’il pourrait tuer réellement quelqu’un, ne trouvant pas plus réel l’Ennemi supposé et désigné de l’époque - le Rouge.Or notre problème est sûrement là dans les grandes largeurs occidentales, alors même que les armes parlent « a côté de chez nous »: ce déni de réalité qui est le propre des anges excluant «cela simplement qui est », sexes floutés et genres indifférenciés dans le transhumain voué au compost...Par conséquent ce matin je retourne mon fusil de papier et tire un coup de bonne humeur en apprenant que mes petits-fils ont repris l’école et s’en réjouissent - où l’on voit que la chair est faible...Dessin: Matthias Rihs.
(Le Temps accordé - Lectures du monde 2023)A la Maison bleue, ce jeudi 12 janvier. - À vingt ans, l’injonction me semblait aller de soi, et tous mes camarades progressistes le répétaient en meute au nom des damnés de la terre: que c’était l’heure des brasiers et le moment de retourner les fusils.La vision des chiens de garde de la pensée bourgeoise incarnée par les mandarins de l’Université ne faisait qu’exacerber notre rage d’anges exterminateurs. Le camarade Paul Nizan, auteur précisément du pamphlet intitulé Les chiens de garde, avait écrit ces mots qui me semblaient l’expression même de ma conscience malheureuse: « J’avais 20 ans et je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel âge de la vie ».Puis ce fut Mai 68 et les fusils retournés, le même genre de sentences solennelles émaillant les murs de nos chambres d’étudiants angéliques se prenant pour des démons, et telle nuit, à la Sorbonne occupée, dans le tourbillon des discours enflammés comme des torchères de rhétorique, les groupes de discussion se transformant bientôt en sous-groupes divisés annonçant toutes les scissions, les divisions et les révisions, les cris des militants et des militantes déjà furieuses de n’être pas entendues, il m'a semblé que tout ce qui était vociféré se détachait déjà de la réalité, avec, dans la bouche, le poids de cette langue de bois qui n’était que la grimace du langage bourgeoi; j’avais vingt ans et un an et comme un premier dégoût physique de toute idéologie m’était venu cette nuit-là à la Sorbonne où les anges se déchaînaient.Des anges de ce temps-là et des années qui ont suivi, un mâle blanc venu de l’Est, un certain Milan Kundera, une espèce de dissident, avait brossé le portrait dans son Livre du rire et de l’oubli, et le relisant je me suis retrouvé aujourd’hui au milieu des mêmes anges, plus désincarnés encore que leurs aînés et non moins péremptoires.Un demi-siècle après nos vingt ans, à treize jours de la naissance d’une petite fille dont l’avenir ne sera pas pire, je le crois, que celui d’un enfant de 1923, j’essaie de me représenter ce que ressens « la mère », « notre fille » , sans y parvenir évidemment faute de la moindre incarnation, mon seul droit étant de me taire.Et de même ai-je envie de dire ce matin, à toutes les femmes qui n’ont pas enfanté , de mesurer ce qu’elles disent à ce propos.Et qu’on ne me chante pas que c’est un « petit ange » qui nous viendra...Ces réflexions paraîtront d’une banalité affligeante aux sachants qui travaillent les sujets de l’identité maternitaire, mais je les emmerde, ou plus exactement : je vais les écouter et déconstruire leurs théories pour retourner mon fusil de la manière la plus tranquille et souriante en mon pacifisme de vieil ange aux articulations grinçantes et à peu près à bout de souffle : je vous aime et vous emmerde.Vous croyez me tenir, ou même me blesser (vous allez me sortir la freudaine de la « blessure narcissique ») en me traitant de mâle blanc forcément raciste et colonialiste quelque part, mais vous tombez mal car je le pense aussi : je suis quelque part tout ça et bien pire: je l’écris autant que je m’obstine à lire toutes sortes de livres juste bons à brûler sur vos bûchers virtuels ou réels.Retourner les fusils , en fin de compte, me semble une démarche à relancer de manière pacifique en continuant de «déconstruire» les systèmes par le jeu du décentrage ironique ou mieux: de l’humour.Lorsque le marquis de Sade retourne les fusils du dogmatisme catholique dans son théâtre évoquant une messe sodomite, comme Jean Genet a sa façon, ils inspirent évidemment des activistes plus directs et moins géniaux, mais pour ma part je trouve plus de hardiesse non conformiste chez un Marcel Aymé et plus d’humanité lucide chez un Tchekhov qu’il serait évidemment grotesque de réduire au statut de mâle blanc alors qu’il s’est montré plus réellement actif, en termes d’enseignement ou de liberté d’esprit, que tant de révolutionnaires prêcheurs, entre rues et salons.A propos de fusil , l’ange que j’étais a vingt ans, s’efforçant de manier cet engin à l’exercice militaire, n’a jamais pensé qu’il pourrait tuer réellement quelqu’un, ne trouvant pas plus réel l’Ennemi supposé et désigné de l’époque - le Rouge.Or notre problème est sûrement là dans les grandes largeurs occidentales, alors même que les armes parlent « a côté de chez nous »: ce déni de réalité qui est le propre des anges excluant «cela simplement qui est », sexes floutés et genres indifférenciés dans le transhumain voué au compost...Par conséquent ce matin je retourne mon fusil de papier et tire un coup de bonne humeur en apprenant que mes petits-fils ont repris l’école et s’en réjouissent - où l’on voit que la chair est faible...Dessin: Matthias Rihs. -
Lecture de White, de Bret Easton Ellis - feuilleton.

L'exergue:
« La société sert d’intermédiaire entre, d’une part, une moralité intolérablement stricte et, d’autre part, une permissivité dangereusement anarchique, en vertu d’un accord tacite grâce auquel nous sommes autorisés à enfreindre les règles de la moralité la plus stricte, à condition de le faire calmement, discrètement. L’hypocrisie est le lubrifiant qui permet à la société de fonctionner de façon agréable… »
Janet Malcolm Le Journaliste et l’Assassin.

1. J’aborde ce matin (2 mai 2019, 8h.) la lecture de White, dernier livre paru ce jour même en langue française mais déjà pas mal conchié par les médias américains, de Bret Easton Ellis. Je m’y colle sans le moindre préjugé et lui consacrerai une heure de lecture par jour, pas une de plus. Je viens de relire Moins que zéro, premier roman de BEE paru en 1985, et c’est sous l’éclairage californien - entre atonie psychique et anorexie physique, déprime de surface et détresse plus profonde, sexe sans amour et surf existentiel – marquant ce tableau d’époque d’une fraction de la «dissociété» nord-américaine, que j’entreprends, à l’autre bout de cette œuvre-symptôme comparable à celle d’un Michel Houellebecq, la lecture de cette espèce de confession morcelée, marquée illico par une sorte de dégoût latent envers l’environnement actuel et plus précisément les réseaux sociaux où l’auteur, soit dit en passant, s’est énormément répandu cette dernière décennie, n’écrivant plus que sous la forme de podcasts et de tweets…

2. C’est ainsi un zombie, mais combien lucide, parmi d’autres qui attaque lesdits réseaux sociaux multipliant à n’en plus finir «leurs opinions et leurs jugements inconsidérés, leurs préoccupations insensées, avec la certitude inébranlable d’avoir raison». BEE dit aussitôt sa colère et son angoisse à l’idée d’être attaqué à la moindre formulation d’une opinion non conforme, déclarée WRONG par la meute et qu’il estime «impensable dix ans plus tôt.
3. En témoin de l’époque il parle du présent à l’imparfait : «Les peureux prétendaient capter instantanément la complexion entière d’un individu dans un tweet insolent, déplaisant, et ils en étaient indignés ; des gens étaient attaqués et virés des « listes d’amis » (…) La culture dans son ensemble paraissait encourager la parole, mais les réseaux sociaux s’étaient transformés en piège, et ce qu’ils voulaient, véritablement, c’était se débarrasser de l’individu.

4. Or ces premières lignes me rappellent aussitôt la censure brutale subie récemment par mon ami Roland Jaccard de la part de GOOGLE, appliquée à toutes ses vidéos postée sur YOUTUBE, supprimées d’un jour à l’autre sans la moindre explication. Ce que Bret Easton Ellis résume à sa façon en affirmant, à la fin de son préambule qu’ «en fin de compte le silence et la soumission étaient ce que voulait la machine».
5. Le début du récit de White, lu hier soir en alternance avec les premiers chapitres de Tumulte et spectres du peintre polonais Joseph Czapski, me revient ce matin (vendredi 3 mai, 9h 37) en me rappelant à la fois le premier épisode de la série Under the Dome de Stephen King vu l’autre soir sur Netflix. Le même Stephen King a d’ailleurs marqué le jeune BEE lecteur, autant que les films d’horreur dans lesquels il a trouvé la force compulsive d’affronter son esseulement de jeune garçon laissé à lui-même par des parents aussi absents que ceux du protagoniste de Moins que zéro.
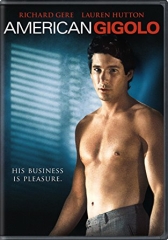
Des morts-vivants, pas loin des figures effrayantes de nos contes pour enfants, afin de mieux s’acclimater à l’angoisse latente planant sur les collines et canyons de Hollywood, avant de passer à l’âge adulte avec American gigolo, reflet d’une nouvelle forme de narcissisme plus ou moins gay avec l’apparition de l’homme-objet sous les traits de Richard Gere : tel est, notamment, la courbe du transit existentiel du jeune auteur qui, entre seize et vingt ans, va donner une forme littéraire à ses désarrois sous le titre de Less than zero.
6. Lire en même temps White, de l’auteur-culte vieillissant mais hypermnésique et toujours d’attaque, et le témoignage de Czapski sur la sortie de l’armée Anders et de milliers de civils polonais de l’Union soviétique, en 1945, avant l’exode de ceux-ci en Afrique ou en Inde, constitue un excellent exercice de grand écart , tout à fait approprié au temps schizoïde que nous vivons...
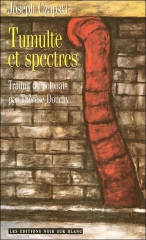
7. En 1985, donc quarante ans après que Czapski traversait les déserts d’Iran, d’Irak et de Cisjordanie, dont il détailles merveilleusement les couleurs très changeantes, paraît donc Moins que zéro, qui devient best-seller en quelques mois à la surprise de l’auteur (qui a à peine passé la vingtaine) et de son éditeur Simon & Schuster qui n’a fait un premier tirage « que » de 5000 exemplaires. Or à quoi tient le succès de ce tableau plutôt déprimant de la jeunesse dorée et plus ou moins camée du L.A. des années 70-80 ? Probablement au décalque avarié, mais toujours glamour, d’un rêve américain continuant de nourrir les fantasmes…
8. D’autant plus intéressante, alors, la suite de White, où l’auteur se rappelle la cuisante épreuve qu’a été la découverte de ce que les studios de Hollywood ont fait de son livre, en édulcorant et caviardant tous les aspects jugés déplaisants des personnages et de situations, jugés trop «durs» ou carrément «inappropriés», comme la déprime récurrente et la bisexualité de Clay, le protagoniste, et les relations souvent glauques liant les autres personnages. Résultat : un produit lisse et flatteur, belle image tissée de clichés, mais sans rapport avec le roman.
9. L’empreinte du faux, titre éloquent d’un roman de Patricia Highsmith, autre observatrice acérée du cauchemar climatisé à l’américaine, conviendrait parfaitement, aussi, au récit de BEE, et notamment, dès la parution de son premier roman, par une expérience qu’il rapporte plus de trente ans après….
Sa notoriété soudaine lui vaut, en effet, d’attirer l’attention de Tina Brown, patronne du fameux Vanity fair , qui lui propose de tirer le portrait, si possible au vitriol, du jeune acteur Judd Nelson qui l’a horripilée dans le dernier film de Joel Schumacher, St Elmo's fire. Un jeune auteur taillant un costard à un non moins jeune comédien jugé trop arrogant : le scoop.

Or faisant connaissance avec Judd Nelson, Bret le trouve à la fois intelligent et très sympathique, au point que les deux compères imaginent une parade au portrait «assassin » espéré. Ainsi BEE propose-t-il à Vanity fair, en complicité avec l’acteur, un panorama des lieux supposés hyper-branchés où traîne la jeune garde hollywoodienne, de quoi snober les snobs new yorkais. Mais le tableau est hyper-bidon, la rédactrice en chef tombe dans le panneau et en voudra plus tard au méchant BEE… C’est du moins du Bret Easton Ellis tout craché, qui, dans American Psycho, se retournera de la même façon contre «son» milieu, lequel le maudira pour cela même.
10. Bret Easton Ellis n’a rien d’un intellectuel académique, pas plus politiquement correct avant la lettre qu’après, mais il a l’intelligence vive de l’instinctif hypersensible et la rage de l’enfant déçu. Très tôt, en outre, il va vivre avec les acteurs (être acteur est le sous-titre d’un de ses chapitres) d’abord en spectateur puis en professionnel concerné, tant par son implication dans le milieu du cinéma que, plus récemment, en tant que réalisateur de podcasts à succès, où ses rapports avec les acteurs et autres célébrités qu’il interroge font l’objet de nouvelles réflexions pertinentes. Comme il le relève, notamment, les réseaux sociaux ont fait de nous tous des «acteurs» virtuels, avec une relance narcissique qui vire souvent au délire ou à l’agressivité.
11. Mondanité à l’américaine que ce récit coupant court à toute fiction conventionnelle, ou commentaire de has been comparable aux «dictées» du Simenon retiré de toute création romanesque ? Ni l’un ni l’autre, ou alors la comparaison serait plus opportune avec les propos d’un Gore Vidal, dans Faits et fictions, entre autres observations d’un «enfant terrible» de deux générations antérieures…
 12. Dès son installation à New York, dans un immeuble où crèche aussi un certain Tom Cruise, le nouvel auteur à succès BEE pense sérieusement à s’«insérer» dans le milieu des gens qui «comptent» de la Grande Pomme, et c’est à la même époque qu’il commence à prendre des notes pour un roman dont le protagoniste serait un yuppie de Manhattan, vivant dans ce même monde que Bret lui-même découvre non sans fascination.Or ce que nous apprenons dans la foulée, c’est qu’un dîner dans un restau chic, avec quelques jeunes loups de son âge dont l’hystérie matérialiste et l’esprit de compétition lui paraissent de véritables tueurs, est à l’origine de sa décision de faire de son protagoniste un serial killer sans savoir si celui-ci tuera « pour de vrai » ou seulement en imagination.13. En lisant American psycho, j’avais évidemment remarqué, comme tout lecteur (ou lectrice) attentifs, qu’après avoir massacré une (ou plusieurs ?) femme(s) dans sa chambre à coucher, Pat Bateman, le lendemain, apporte ses draps supposément encore trempés de sang dans une laverie dont les employés (Chinois il me semble) ne font pas mine de remarquer quoi que ce soit. L’explication reste elle-même ambivalente et pour ainsi dire «à choix», soit que Bateman n’ait assassiné qu’en imagination, et que ses draps sont restés plus immaculés que sa conscience; soit que les employés de la laverie en aient vu d’autres en ce drôle de monde et que des draps trempés de sang fassent partie du «décor»…14. La (re) lecture attentive de Moins que zéro, un peu plus de trente ans après sa parution, illustre mieux, à la lumière des observations rétrospectives de White, les tenants émotionnels et «nerveux» du regard de BEE (l’auteur) modulé par la sensibilité catastrophique de Clay (son personnages principal), beaucoup plus poreux et fragile, mais aussi plus «personnel» que sa mère et ses sœurs, dont l’indifférence blasée ou la curiosité vorace de pures consommatrices, devant le «spectacle» du monde, en disent long sur le désert affectif et intellectuel dans lequel «tout ça » se passe. Ainsi de l’effet produit, sur Clay seulement, par la vision nocturne d’une voiture en feu, flanquée de la conductrice mexicaine et de ses enfants, qui fait saliver ses sœurs de curiosité malsaine alors que lui-même, hanté par cette vision, va s’imaginer toute la nuit durant qu’un môme est resté dans les flammes.15. Sous son apparence glacée et plus ou moins glamour, évoquant parfois la peinture apparemment si superficielle d’un David Hockney, Moins que zéro vibre de sensibilité exacerbée - parfois secouée de sarcasmes assourdis -, et touche à une forme de poésie lancinante, notamment dans ses séquences en italique marquant le contrepoint du récit en «à-plats», pour investir réellement la profondeur des sentiments.
12. Dès son installation à New York, dans un immeuble où crèche aussi un certain Tom Cruise, le nouvel auteur à succès BEE pense sérieusement à s’«insérer» dans le milieu des gens qui «comptent» de la Grande Pomme, et c’est à la même époque qu’il commence à prendre des notes pour un roman dont le protagoniste serait un yuppie de Manhattan, vivant dans ce même monde que Bret lui-même découvre non sans fascination.Or ce que nous apprenons dans la foulée, c’est qu’un dîner dans un restau chic, avec quelques jeunes loups de son âge dont l’hystérie matérialiste et l’esprit de compétition lui paraissent de véritables tueurs, est à l’origine de sa décision de faire de son protagoniste un serial killer sans savoir si celui-ci tuera « pour de vrai » ou seulement en imagination.13. En lisant American psycho, j’avais évidemment remarqué, comme tout lecteur (ou lectrice) attentifs, qu’après avoir massacré une (ou plusieurs ?) femme(s) dans sa chambre à coucher, Pat Bateman, le lendemain, apporte ses draps supposément encore trempés de sang dans une laverie dont les employés (Chinois il me semble) ne font pas mine de remarquer quoi que ce soit. L’explication reste elle-même ambivalente et pour ainsi dire «à choix», soit que Bateman n’ait assassiné qu’en imagination, et que ses draps sont restés plus immaculés que sa conscience; soit que les employés de la laverie en aient vu d’autres en ce drôle de monde et que des draps trempés de sang fassent partie du «décor»…14. La (re) lecture attentive de Moins que zéro, un peu plus de trente ans après sa parution, illustre mieux, à la lumière des observations rétrospectives de White, les tenants émotionnels et «nerveux» du regard de BEE (l’auteur) modulé par la sensibilité catastrophique de Clay (son personnages principal), beaucoup plus poreux et fragile, mais aussi plus «personnel» que sa mère et ses sœurs, dont l’indifférence blasée ou la curiosité vorace de pures consommatrices, devant le «spectacle» du monde, en disent long sur le désert affectif et intellectuel dans lequel «tout ça » se passe. Ainsi de l’effet produit, sur Clay seulement, par la vision nocturne d’une voiture en feu, flanquée de la conductrice mexicaine et de ses enfants, qui fait saliver ses sœurs de curiosité malsaine alors que lui-même, hanté par cette vision, va s’imaginer toute la nuit durant qu’un môme est resté dans les flammes.15. Sous son apparence glacée et plus ou moins glamour, évoquant parfois la peinture apparemment si superficielle d’un David Hockney, Moins que zéro vibre de sensibilité exacerbée - parfois secouée de sarcasmes assourdis -, et touche à une forme de poésie lancinante, notamment dans ses séquences en italique marquant le contrepoint du récit en «à-plats», pour investir réellement la profondeur des sentiments. 16. Cette notion d’investissement - non du tout au sens économique courant supposant un «retour» lucratif, mais en tant qu’implication réelle d’un sujet pensant et souffrant au milieu des objets accumulés en chaos – fonde une réflexion conséquente de Bret Easton Ellis sur la disparition, au passage (notamment) de l’analogique au numérique, des obstacles à surmonter que représentaient, pour satisfaire un désir ou un plaisir, la difficulté d’accès ou la rareté, l’attente et l’effort, aujourd’hui supprimés d’un clic, qu’il s’agisse d’un livre qu’on allait chercher en musardant en librairie, désormais accessible en moins d’une minute par Amazon et Kindle, ou d’une image érotique dans un magazine trouvé sous le lit du grand frère, aujourd’hui multipliée par des millions de scènes pornographiques dont l’industrie, soit dit en passant, constitue un fleuron de l’économie californienne.Est-ce dire que BEE «dénonce» Amazon ou la porno banalisée ? Pas même : il constate. Il constate l’effondrement de la notion même de désir et la disparition du charme de l’attente, le déficit « humain» qui découle de la vaporisation des relations en 3D au profit des prétendues «amitiés» nouées sur Facebook – pour ne prendre que cet exemple -, le plus souvent factices ou même toxiques, etc.
16. Cette notion d’investissement - non du tout au sens économique courant supposant un «retour» lucratif, mais en tant qu’implication réelle d’un sujet pensant et souffrant au milieu des objets accumulés en chaos – fonde une réflexion conséquente de Bret Easton Ellis sur la disparition, au passage (notamment) de l’analogique au numérique, des obstacles à surmonter que représentaient, pour satisfaire un désir ou un plaisir, la difficulté d’accès ou la rareté, l’attente et l’effort, aujourd’hui supprimés d’un clic, qu’il s’agisse d’un livre qu’on allait chercher en musardant en librairie, désormais accessible en moins d’une minute par Amazon et Kindle, ou d’une image érotique dans un magazine trouvé sous le lit du grand frère, aujourd’hui multipliée par des millions de scènes pornographiques dont l’industrie, soit dit en passant, constitue un fleuron de l’économie californienne.Est-ce dire que BEE «dénonce» Amazon ou la porno banalisée ? Pas même : il constate. Il constate l’effondrement de la notion même de désir et la disparition du charme de l’attente, le déficit « humain» qui découle de la vaporisation des relations en 3D au profit des prétendues «amitiés» nouées sur Facebook – pour ne prendre que cet exemple -, le plus souvent factices ou même toxiques, etc.17. Plus on avance dans la lecture de White, comme ce matin sous la neige à 1111m au-dessus de la mer (5 mai, 11h.16), et plus on perçoit le malaise de l’écrivain, qui a toujours refusé d’être classé en fonction de ses préférences sexuelles, sans les cacher pour autant, mais excédé par la victimisation de plus en plus insistante, et de plus en plus hypocrite selon lui, qui entoure, notamment, les homos et les noirs. Qu’une star du sport black& male fasse son coming out au dam de l’image qu’on se fait des cracks de son espèce, et voici que les médias, pleins de compréhension simulée, d’empathie ostentatoire voire de sympathie du style « on compatit », se penchent sur son cas manifestant quel courage, et s’adressent à lui comme s’il s’agissait d’un petit garçon de six ans que la vilaine sorcière Homophobia menace, n’est-ce pas…
18. BEE parle beaucoup de cinéma dans White, et avec une pertinence de vrai connaisseur à qui on ne la fait pas, qui sait faire la part du contenu latent d’un film et de sa qualité artistique. Ainsi compare-t-il, à propos de la façon d’aborder, à Hollywood, les thèmes de l’homosexualité et du racisme, le film Moonlight, qui a fait un tabac en tant que portrait « poignant » d’un jeune homo noir malmené par tous et dont l’image finale gomme complètement les éventuels défauts personnels et, ô horreur, ses désirs réels.


Comme toute prise en compte sérieuse du contenu réel de Moins que zéro dans son adaptation au cinéma, évoquant une société complètement pourrie par l’argent et un protagoniste flottant entre les sexes et les substances, Moonlight évacue toute complexité , chez son pauvre noir homo forcément victime de la méchante société, pour faire mieux pleurer dans les chaumières vertueuses. A contrario, BEE cite un film un peu moins élaboré, du point de vue formel, intitulé King Cobra (visible sur Netflix) et qui met en scène deux bandes rivales de «hardeurs» gays vedettes de films pornos, dans une ambiance sexy au possible, avant que leur rapacité ne les pousse au crime – au risque de jeter une ombre « inappropriée sur la communauté LGBT. Et BEE de relever l’évidence : que cette violence n’est pas le fait de l’homosexualité mais de la très banale application de la loi de la jungle capitaliste.

19. Très intéressantes, aussi, les observations de Bret Easton Ellis sur son dédoublement, à un moment donné, quand il est devenu célèbre et qu’il découvrait jour après jour dans les médias, les faits et gestes rapportés de son personnage public. On voit cela aussi dans Moins que Zero, quand telle jeune fille prend des nouvelles de sa mère, actrice hollywoodienne au amants nomades, par les paparazzi. Ainsi le Bret «privé» se découvre-t-il un double «public», comme il y a un Tom « jeune » et un Cruise «adulte », avec les images de soi renvoyées à l’expéditeur plus ou moins capable d’humour. En choisissant de s’« insérer », BEE devait savoir qu’il prendrait des risques, et il les a pris parfois à son corps défendant, comme lorsqu’il tombe amoureux de tel ou tel acteur «casté» pour le film tiré de Zombies, alors même qu’on lui a dit que ce genre de « plans » était déconseillé.
20. Bien entendu, les milieux concernés (les médias, le cinéma, les influenceurs littéraires, etc.) estimeront vertueusement que Bret Easton Ellis, dans White, crache dans la soupe. Encore heureux qu’il «pèse» plus, économiquement parlant, qu’un Roland Jaccard postant ses vidéos jugées inappropriées sur YOUTUBE, pour ne pas se faire virer de TWITTER ou de FACEBOOK. Mais il n’en raconte pas moins ses tribulations avec une association de défense des gays au sigle de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), dont il fait d’ailleurs partie, qui renonce à l’inviter à une de ses rencontres après qu’il a lancé deux ou trois tweets jugés « inappropriés »...
21. Je lis White en même temps que le PDF d’un livre en préparation de mon ami congolais Bona Mangangu, artiste et écrivain établi à Sheffield, que j’ai rencontré par le truchement de mon blog et dont le récit évoque, dans sa première partie, les sentiments éprouvés par son double «romanesque» débarquant, à Munich, dans une auberge où, au petit déjeuner, se déploie un véritable festin rabelaisien, qui le met mal à l’aise. Le livre est intitulé Maurice porteur de foi, allusion à la peinture de Grünewald figurant la rencontre de saint Erasme et de Saint Maurice le «moricaud» de la légion thébaine.
Or le narrateur, noir et hypersensible, observe les bâfreurs bavarois et leurs hôtes nordiques en se rappelant les banquets des peintres flamands, tout en évaluant ce qui fait différer les bons vivants de la Renaissance des petits-bourgeois «libéraux» en goguette, sans se poser en juge pour autant. Artiste et témoin: c'est ce qu'on pourrait dire, aussi, de Bret Easton Ellis...
- Lorsque Bret Easton Ellis a fait lire, à son amant de l’époque (un brillant avocat sorti de Princeton et qui n’avait pas encore fait son coming out, pas plus que BEE d’ailleurs) le premier état de son nouveau roman achevé, American psycho, pour s’entendre dire cela simplement : « Tu vas avoir des ennuis ». Et quand il lui demanda un peu naïvement : « Avec qui ? », son ami lui répondit : « Tout le monde ». Et de fait, après que Simon & Schuster eut annoncé la parution du livre, prêt à l’édition, pour la fin de l’année, le scandale provoqué à l’interne dans la grande maison new yorkaise, la fit renoncer à la publication du roman, reprise peu après par un autre grand éditeur. Or ce qu’il y avait de nouveau dans cette autocensure éditoriale annonçait, selon BEE, un tournant « idéologique » qui allait plomber la société américaine entière, et dont on a ou voir l’effet collatéral récent quand la maison Gallimard a renoncé à publier le dernier roman de Martin Amis jugé «choquant» dans son approche d’un camp de la mort nazi. Pour ma part, j’ai lu ces deux romans et n’y trouve rien à censurer, et je me demande alors si je devrais «consulter», et puis non, et puis flûte.
- Ce que raconte BEE à propos de ses démêlés avec le GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation),alors même que la défense des gays cointre l’homophobie lui semble aller de soi, c’est un glissement vers la pensée unique qu’il taxe, maladroitement me semble-t-il, de tentation « fasciste ».
«Ce que GLAAD contribue à renforcer, c’est la réduction des gays à des bébés hypersensibles, ostensiblement couvés et protégés – pas très loin des attaques hideuses contre les gays en Russie, dans le monde musulman, en Chine ou en Inde, pour ne nommer que quelques pays, mais pour rester à l’intérieur de la même sensibilité culturelle. GLAAD était au centre incandescent de la création de l’elfe magique, modèle gentillet d’une absurde élévation morale – une victime avec de gros pectoraux, on espère – et avait souvent applaudi aux stéréotypes que nous avions vu défiler dans des films homos embarrassants et des séries rétro dégradantes, en les déclarant « positifs » simplement parce qu’ils étaient, euh, gay ».
Ceci dit, le terme de « fasciste », appliqué au nouveau conformisme de la political correctness,me semble inadéquat et reproduire, symétriquement, la même accusation faite à ceux qui refusent d’obtempérer. Le « fascisme » est évidemment autre chose, et le vocabulaire doit être révisé sous peine de confusion à n’en plus finir.
- Breat Easton Ellis a parfaitement raison, en revanche, de pointer une nouvelle tendance à dénoncer le « crime de pensée », qui va désormais s’appliquer à la littérature en général dès lors qu’elle menace l’intégrité angélique de chaque « elfe » lecteur (ou lectrice). L’Index est une vieille institution, qui permettait, dans l’optique catholique, de séparer le bon grain et l’ivraie en matière de lecture, et sans doute American psycho l’eût-il mérité. Mais quand la société dite «civile», supposée libérale et démocratique, flottant aux States entre bigoterie et cynisme mercantile, haute civilité et semi-barbarie consumériste, se prend pour la Nouvelle Eglise, quelque chose, euh, cloche, pour parler comme BEE…
- Nous n’avons pas attendu White,sans doute, pour nous mettre à réfléchir sur les méfaits du nouveau conformisme plus ou moins «totalitaire» dans sa prétendue « radicalité », sinon «fasciste», et le Juif homo conservateur Allan Bloom a montré le chemin, avec L’Âme désarmée, qui vient d’ailleurs de reparaître, autant qu’en France un Philippe Muray qu’on pourrait dire un gauchiste de droite ou un anarchiste frotté de culture classique, et dont je relis Moderne contre moderneavec reconnaissance rétrospective. Mais ce qui est intéressant, avec BEE, c’est qu’il est immergé dans le monstre numérique, et que c’est de là qu’il parle. Bret l’ironiste n’est pas un grand intellectuel ni un profond moraliste, mais c’est un type qui aime la liberté et les nuances de la vie, qui ne se définit pas a priori par ses goûts sexuels ou culinaires, et que l’obsession nouvelle de l’évaluation, à coups de « like », inquiète à juste titre. De fait, la nouvelle «culture» du like est à considérer sérieusement. Qu’est ce que cette société de caniches attendant à tout moment un biscuit ? Ne vous transforme-vous pas en abruti en attendant qu’on vous « like », pour ne pas dire qu’on vous « lick », au sens du léchage de cul le plus trivial ? Et qu’est-ce que cette société qui vous demande votre avis dès que vous achetez une boussole par Amazon ou le dernier roman de Michael Connelly par Kindle ? Notre identité nouvelle, à part le fait que nous soyons blanc ou jaune, beur ou black, se réduira-t-elle bientôt à nos goûts caractérisés, classés et jugés, de clients potentiels du Grand Marché ? La question se pose aux Ricains autant qu’aux Chinetoques, aux lecteurs de Simone de Beauvoir autant qu’aux couturières vegan, etc.
(À suivre…)
ELLIS, Bret Easton. White - édition française (French Edition) . Groupe Robert Laffont. Édition du Kindle.
-
Comme il pleure en notre coeur
 Je sais que tu es dans mes larmes,mais je fais comme sirien ne pouvait me désarmer -tu es ma force aussi…Je ne sais où tu es parti,me disait-elle parfoisquand j’allais seul là-bas dans la nuità l’écoute de je ne sais quoiqu’elle aimait lire entre les mots -les mots indéfinisque je lui murmurais ensuite…Tu es la vague qui me soulève,dans l’air comme allégéet toi la mer où je me perds,aux rives oubliées,disiez-vous en écho…Dis-moi quelque chose ce soir,que j’entende ta voixjuste ta voix des beaux matins,dans le noir du chagrin…(Peinture: Edvard Munch)
Je sais que tu es dans mes larmes,mais je fais comme sirien ne pouvait me désarmer -tu es ma force aussi…Je ne sais où tu es parti,me disait-elle parfoisquand j’allais seul là-bas dans la nuità l’écoute de je ne sais quoiqu’elle aimait lire entre les mots -les mots indéfinisque je lui murmurais ensuite…Tu es la vague qui me soulève,dans l’air comme allégéet toi la mer où je me perds,aux rives oubliées,disiez-vous en écho…Dis-moi quelque chose ce soir,que j’entende ta voixjuste ta voix des beaux matins,dans le noir du chagrin…(Peinture: Edvard Munch)




