
En mémoire de la petite L.
«Ne vous laissez plus
aller au cercueil»
(Antonin Artaud)
Ce fut une époque, maman, où nous avions tous deux envie de mourir Luciana et moi.
Je ne voulais pas t’inquiéter alors, et c’est pourquoi je me suis contenté de te dire, à ce Noël, que j’étais stressé par mon job et plus encore par mon roman en panne lorsque tu m’as fait remarquer que j’avais l’air triste.
Je n’avais pas seulement l’air triste, à ce moment-là: j’avais envie de me foutre en l’air. Je n’en avais aucune raison, mais je ne désirais rien tant qu’en finir, et Luciana, sans que je ne m’en doute à vrai dire, n’aspirait à rien d’autre sans plus de raison que moi.
Je répète que nous n’avions aucun motif, ni l’un ni l’autre, de nourrir ces noires pensées. Car nous avions tout, c’est entendu: nous étions de ces gens dont on dit qu’ils ont tout. Luciana m’aimait et j’aimais Luciana. Nous avions de belles enfants frayant déjà loin de nous et nous nous trouvions cependant encore, selon ton expression, sur le versant soleilleux de la vie.
Luciana venait de prendre un nouveau départ dans son activité professionnelle, elle passait désormais deux jours par semaine à l’université où elle avait décidé de poursuivre certaines études, et pour ma part je ne pouvais me plaindre de mon travail au Quotidien où j’étais employé au titre de rédacteur. Nos deux salaires nous permettaient de mener notre barque à notre aise, nous nous plaisions à notre balcon en forêt de la Cité des Oiseaux, à un jet de pierre de ta maison, et passions nos fins de semaine en notre datcha surplombant le Haut Lac que nous rallions à bord de la Honda CRV 4x4 bleu métallisé qui nous assimile à la middle class d’un des pays les plus nantis de l’hémisphère nord. Bref, quel motif aurions-nous eu de nous lamenter alors qu’il y a tant de calamités de par le monde ? Et comment même aurais-je osé te dire que j’avais envie, ce Noël-là, de me flinguer, quand il y avait tellement d’années que tu endurais ta vie d’esseulée et que tu t’y cramponnais ?
Tu m’aurais compris, sans doute, si je t’avais parlé de notre peine à supporter le temps pourri de ce novembre de fin de siècle et de millénaire - cela tu l’aurais compris. Tu comprends mieux que tout ce qui concerne la météo. Tu m’agaces même, souvent, avec tes histoires de temps plus ou moins super, selon ton expression.
Je n’ai rien à te dire cependant du foutu temps de ce novembre 2000, j’entends le temps physique de ce maudit novembre, le temps atmosphérique de ce putain de novembre 2000 durant lequel il a dû sûrement faire beau et pas beau - mais encore, savoir quelle sorte de beau, quand il est de si douces grisailles de novembre.
De fait, ce n’était pas le froid physique ni la pluie ou le brouillard qui nous tuaient, Luciana et moi: c’était simplement novembre, ce novembre-là en elle et en moi, qui nous anéantissait soudain.
Il y a comme ça des mois où tout meurt, mais novembre 2000 fut pire que tous à mes yeux, et les causes en sont mêlées: il y avait nous et nos corps pleins d’âme secoués par la cinquantaine, il y avait l’horreur absolue frappant Bruno et Marie, il y avait d’autres choses encore, il y avait mes virées avec le Gitan qui tournaient parfois au combat de gladiateurs, enfin il y avait le fracas du monde.
Bruno m’avait téléphoné le 7 au soir pour me dire que la petite, c’était maintenant sûr, ne survivrait pas à son calvaire. Sa voix n’était qu’un souffle et je m’étais dit qu’il cédait peut-être au découragement après tant de mois de hauts et de bas, puis j’ai vraiment entendu sa voix, qui était ce qu’on appelle une voix blanche, et c’est par cette voix que j’ai compris que tout était fini: que les faits ne laissaient plus aucun doute, que la maladie était repartie de plus belle après le dernier semblant de rémission, que 70% de la moëlle épinière de l’enfant étaient atteints et que ce n’était plus qu’une question de semaines, il paraissait même douteux qu’elle puisse encore voir les lumières des fêtes, et c’est avec la même voix blanche que j’ai continué, à mon tour, de parler à notre ami.
Luciana s’est rapprochée quand elle m’a vu les yeux pleins de larmes, elle s’est assise à côté de moi et je l’ai vue dans sa beauté lasse, j’ai senti en moi se former le mot de délivrance mais j’en avais presque honte et je me suis retenu de le prononcer alors que, pour ta part, tu l’avais répété à chaque fois que je t’avais parlé de la paralysie à vie de la petite, en femme qui a les pieds sur terre et qui perd tout doucement la mémoire.
Bruno se taisait mais je savais qu’il ne pleurait pas, muré qu’il était avec Marie dans leur bloc de douleur, je pensais délivrance et pourtant je lui ai dit quelque chose comme vivez bien maintenant avec elle jusqu’au dernier souffle, je ne sais qui parlait à ma place alors que j’eusse aimé m’enfoncer dans un puits de silence, et Luciana et Marie se sont parlé avec la même voix blanche que Bruno et moi, mais le lendemain matin, me réveillant à cinq heures et me figurant cloué dans un lit-cage entouré de tout un arsenal d’appareils, je me suis retenu de hurler en imaginant ce qui se passait à l’instant même dans le corps et dans la tête de la petite et toute la journée, ensuite, je me suis retenu d’insulter les gens. Ce qui comptait, ce matin-là, c’était de donner le change le temps de mes vacations en ville. Car il allait de soi, et Luciana l’avait autant à coeur, que pas un instant le quidam ne devait soupçonner nos états d’âme.
A l’aube de ce même jour nous avions, avec Luciana, fait l’inventaire du désastre sans penser plus à la petite. Nous n’en avions qu’à nos tristes peaux. Allongés les yeux mi-clos, avant même que de bouger et en nous demandant lequel se lèverait le premier pour la corvée de café (je me sentais prêt à la laisser se dévouer pour une fois), chacun de nous refaisait le constat implacable: il a maintenant comme un bréchet de dindon, elle a le cheveux ce matin en roide filasse, on lui voit derrière du blanc de crâne entre ses mèches d’Absalon, elle doit retenir de l’eau depuis quelque temps, ses pectoraux fameux ont un peu fondu en nichons de matrone, elle a toujours de beaux seins et pourtant ça pendouille - mais qu’il est émouvant, mais qu’elle est adorable, ce genre de choses.
Luciana s’inquiétait de mes longs soupirs. Quelques mois plus tôt nous avions craint pour ses reins, mais à présent c’étaient les miens qui la préoccupaient, mes reins et ses angoisses, mes reins et mes artères, car les soupirs venaient d’une sourde oppression des poumons liée aux artères sûrement, cholestérol et compagnie, la crasse poison de ces âges - et quand je me concentre je perçois très bien: je sens du dehors à fleur de nerfs et je me figure en même temps dans le rôle investigateur de la microcaméra fureteuse à loupiote qui remonte le courant de mon Amazone intérieure, et là je vois tout comme au cinéma, je vois les traces d’alcool et de viande rouge, je vois les tas de lipides livides en monticules le long des rivages, je vois les parois scarifiées, les parois goudronnées et les moches fissures dans la tuyauterie, on se croirait dans le train fantôme, on entend un grondement continu de fleuve ténébreux et c’est affreux ce que ça sent le sang, ah mais je vais défaillir, faut que je sorte de là, et quand j’en sors en ouvrant les yeux je me sens tout près d’être plus mal encore, et je vois Luciana toute pâle, à croire que c’est elle qui va maintenant tourner de l’oeil.
Avez-vous connu ces tribulations toi et lui ? Vous êtes-vous senti vieillir ? Cela a-t-il jamais été un thème de conversation entre vous ? Et au fait de quoi parliez-vous à ce présumé tournant de la vie ? De quoi parliez-vous par exemple, en novembre 1966, à l’approche de tes cinquante ans ?
Souvent je me suis demandé de quoi vous parliez. Souvent je me demande de quoi parlent les gens. Souvent je m’approche un peu des gens en essayant d’imaginer des vies à partir de leurs bribes de conversation. Souvent je me suis reproché de n’y voir que des banalités. Souvent je me dis aussi que le plus que vous vous êtes confiés l’un à l’autre ne passait peut-être pas par les mots.
Ensuite tout alla de mal en pis durant cette journée où la pensée de la petite et mes difficultés de respirer me firent jouer ma scène d’agonisant à la rédaction.
Déjà je traînais la patte en me dirigeant vers l’abribus du quartier. Les journaux du matin m’avaient accablé, dont j’avais pris connaissance au bar jouxtant le Centre Com.
Il y avait treize convois funèbres ce jour-là, dont celui de l’artiste abstrait Cordier, que j’avais rencontré et à la mémoire duquel les siens avaient cité ces paroles d’Elan-Noir, le voyant de la nation sioux: «La vie de l’homme est dans un cercle de l’enfance jusqu’à l’enfance et ainsi en est-il pour chaque chose où le pouvoir se meut. Nos tipis étaient ronds comme les nids des oiseaux et toujours disposés en cercle, le cercle de la nation, le nid de nombreux nids où le Grand Esprit nous destinait à couver nos enfants.»
En tout autre temps, ces propos ragaillardissants sur la couvée des enfants m’auraient égayé, mais je n’avais pas, ce matin-là, le moindre humour durable.
Un autre faire-part de l’institution L’Espérance nous informait qu’une Madame Piolet était décédée dans sa 89e année, que saluait le groupe Flamants avec ces mots encourageants: «Dans la pénombre de la nuit, une douce lumière surgit et me remplit de grâce».
Ailleurs encore il était écrit: «La mort n’est pas l’obscurité, c’est la lampe qui s’éteint quand le jour se lève».
Or décidément pas plus que la douce lumière, la lampe n’éclairait mon obscur canyon.
Pour le reste il était question des intempéries en série de ce début novembre, on annonçait de nouveaux massacres en Algérie et trois adolescents palestiniens avaient été abattus dans la bande de Gaza, le volume des échanges financiers était à la baisse en attendant la désignation du nouveau président américain, les plongeurs russes avaient abandonné les derniers marins enfermés dans les entrailles du Koursk et le supplément Emplois (1046 offres) du Quotidien établissait que les Old Timers, les quinquas et autres seniors qui cherchaient un nouveau débouché devaient s’interroger au préalable sur leurs potentialités.
Bref, tout m’apparaissait, ce matin-là, sous son jour le plus désolant; et ça ne s’est guère arrangé par la suite, tandis que le trolleybus m’emmenait en bringueballant vers le centre ville où se dresse le building du journal.
La conférence de rédaction m’acheva, que je feignis de suivre avec la plus vive attention tandis que des vertiges me brouillaient la vue. Le rédacteur en chef avait revêtu son fin costume des jours de représentation sociale à déjeuners qui n’en finissent pas, et je le plaignais sincèrement en mon for intérieur. La seule idée de siéger en conférence me desséchait la gorge, la perspective du moindre repas d’affaires me paralysait cependant que, très maître de lui, tantôt tout miel et tantôt poussant ses griffes, il passait en revue le journal de la veille avant de détailler celui du lendemain.
Or, je me sentais perdre prise. Tout à coup la dérision des événements prenait, à mes yeux, des airs de fantasmagorie.
En temps ordinaire, le fait qu’on ne pût départager deux candidats à la présidence de la plus grande puissance du monde m’aurait fait ricaner, mais ce jour-là pareille farce me semblait confiner à la même triste démence que cet autre Américain symbolisait, dont on annonçait qu’il passerait en justice pour avoir mordu son chien à deux reprises.
Tu me disais souvent, toi aussi, que le monde te paraissait devenu fou. Tu prétendais que quelque chose avait changé, et peut-être également dans l’équilibre des saisons. Tu retrouvais de moins en moins tes repères. Tu te disais parfois lasse de tout ça, et comme je te comprenais à ce moment-là, moi qui m’ingéniais d’habitude à te rassurer en arguant que le monde avait toujours été ce fatras du meilleur et du pire.
Autour de la table, cependant, mes confrères de la rédaction ne montraient aucune espèce de décontenancement: l’actualité défilait et chacun s’efforçait d’en dégager les faits saillants qu’il aurait à traiter.
Mais quel sens tout cela pouvait-il bien avoir ? Pourquoi le chef de l’économique portait-il ce jour-là ce gilet de soie jaune ? Et qu’avait éprouvé chacune et chacun, ce matin, à son éveil ou devant son miroir ? Comment chacune et chacun se considéraient-ils devant leur image? Combien d’entre nous auraient-ils supporté de partager la vie d’un enfant paralysé à vie ? Combien d’entre nous priaient-ils, et comment ?
J’en étais là de mes divagations quand je constatai que tout le monde s’était levé, ce que je fis à mon tour non sans vaciller et me traiter aussitôt de flanelle, puis de rester planté là en redoutant le prochain effondrement.
Quelques instants plus tard, à mon arrivée dans le bureau de Javier, alias El Jefito, j’affichai la mine du vaincu en me disant empêché d’assurer une heure de plus ce jour-là. Or, le Jefito m’avait vu tout à l’heure. Plus même, il en rajoutait dans le genre Souci de l’Autre en multipliant les égards que je me figurai, tout aussitôt, lié à mon état de rebut. Et moi de l’encourager alors sous cape: c’est cela mon garçon, enfonce-le de tes sourires, ce type-là t’a bien assez seriné que tu pourrais être son rejeton, roule-lui tes regards d’ourson compatissant, montre que tu gères ces situations sans recourir à la maintenance ou aux ressources humaines, de toute façon le dinosaure ne s’accrochera plus longtemps, place à la jeune garde.
Et moi de le remercier bien bas, puis de lui promettre d’être sage avant de tituber en direction de la sortie des artistes, et de me prendre tant à mon jeu que me voici me représenter des caillots en déroute et de la sténose larvée, enfin voilà le tourniquet de verre du building qui m’avale et me rejette sur l’avenue, il fait un froid de novembre à se tapir dans un antre et j’entends encore la voix du Jefito qui me recommande de ne pas voir que le noir du Nada...
D’habitude c’était moi qui t’incitait à positiver, et tu ne te doutes pas en quelle horreur j’avais ce mot d’ordre, mais ce matin fameux, à quelques pas de là, c’est précisément à ce piège-là que je me fais prendre: alors que je regagne pâlement mes pénates, après la comédie au journal: tout à coup, à la devanture d’un kiosque de la place Saint-François, ce Magazine de l’Homme Nouveau, à l’effigie de je ne sais quel abruti de muscu, me jette à la face que le temps est venu de faire ma Révision Moteur.
Cela se sous-intitule Bien vivre au masculin, du genre de publication que jamais, tu t’en doutes, je n’aurai même remarquée jusque-là. Mais à l’instant les titres me scotchent: Natation sport total - Déchaînez vos orgasmes - Spécial glisse - Votre santé en 2001 - L’autoroute de vos artères.
Tout cela VOUS concerne, m’assène-t-on sur papier glacé. Ainsi, malgré mes velléités de lâcher la rampe je m’accroche. J’achète dans la foulée. Je me roule la chose en douce sous l’aisselle de crainte un peu idiote d’être repéré, puis je regagne mon repaire et je lis, pendant une heure d’affilée je lis et je lis.
Je n’ai pas vu trace, dans tout le magazine, d’aucun type de plus de trente ans et pourtant j’ai tâché de m’identifier, je me suis dit qu’il fallait croire au miracle, je ne voulais pas admettre, il ne serait pas dit qu’on nous ait liquidés si facilement Luciana et moi.
Je me suis efforcé d’être interpellé par le dossier Santé/Forme. J’ai relevé en passant qu’une haleine de coyote pouvait être combattue par la cure d’artichaut et qu’en novembre la lampe Bright Light de Philips était indiquée pour la thérapie de lumière que nécessitait la lutte contre les excès de sécrétion de mélatonine. J’ai pris en compte les conclusions du technicien de l’orgasme à propos de ce qu’il comparait à la mise à feu d’une bombe nucléaire à deux ogives. J’ai même entrepris mon examen de conscience à la lecture de la rubrique Leçon de sagesse, où il m’était demandé si j’avais déposé mon ego et si j’en faisais assez pour apprivoiser la mort et sonder mon univers intérieur, faute de quoi je n’avais qu’à glisser, dans le lecteur de mon Mac, le CD de La Légende du prophète et de l’assassin, disponible aux éditions Wanadoo.
Je m’étais cru assez fort pour relever ces défis et pourtant, contre toute attente, plus les solutions à tous les dysfonctionnements imaginables se multipliaient sur papier lisse et plus je me sentais rejeté de cette arène où s’exhibaient les rutilantes machines des corps juvéniles.
A cet instant-là, pour dire vrai, je n’avais plus la moindre envie d’être en forme ni de retrouver non plus une Luciana drainée ou liftée, mais je n’osais trop l’affirmer. Je ressentais une lassitude qui me privait de toute réaction en dépit d’une constante augmentation de ma lucidité, comme si la conscience de plus en plus aiguë de ce qui suscitait ma révolte me paralysait à mesure.
A quoi bon ? me disais-je. Tout n’est-il pas joué d’avance et voué à la poussière ? A quoi bon décrier cette nouvelle folie de la performance ? A quoi bon résister au Nouvel Homme ?
Et je me repliais dans ma rêverie solitaire en t’imaginant là-haut, dans le quartier de notre enfance, le regard flottant dans l’entrelacs de vieilles branches du chêne rescapé de toutes les mises en coupe des promoteurs.
Je rêvais aussi bien d’être cet arbre sans âge et qu’on me regarde avec amitié comme, à l’instant, je regardais les bouleaux entre les murs, là-bas, de l’autre côté de l’avenue, en train de se dépouiller de leurs feuilles.
Chaque année plus vivement je ressentais ce bonheur de la beauté mourante de l’automne, mais la pensée que tout cela renaîtrait me rappelait à la fois le sort inéluctable de la petite et je sentais en moi s’inscrire les mots plus jamais dont un dimanche soir de printemps, après les heures à veiller ton compagnon, notre père, nous avions tous perçu en nous la déchirure - il y aurait d’autres novembre mais tout ce que je voyais à l’instant de ma fenêtre, cette rue, ces gens, ce bitume, ces arbres entre ces murs, tout ce décor si banalement réel se trouvait comme oblitéré par ce plus jamais.
Et puis un jour, je ne sais comment, nous sommes revenus à la vie Luciana et moi.
Cela ne s’est pas fait moins inexplicablement que notre plongée dans le noir, et chaque fois que j’y resonge c’est pour revivre en même temps les derniers instants que je passai un jour de décembre auprès de la petite, devant laquelle je me suis soudain senti aussi démuni qu’un enfant sans expérience alors qu’elle, dans son regard joyeux et si présent, dans un éclat de rire qui la secoua à un moment donné malgré sa complète paralysie, dans le clignement de ses paupières et cette espèce de lumière irradiant son visage, m’a paru soudain incarner la vie même.
Quelques jours plus tard, comme pour lui dire ma reconnaissance, je lui apportai un cheval ailé.
N’était-ce pas cruel d’offrir Pégase à un enfant qui ne pourrait que le voir posé là ou voler par d’autres mains ?
Je ne pensais qu’à ses yeux de l’autre jour, mais la petite n’allait pas bien lorsque je lui fis remettre son cadeau par Bruno, qui sourit de pauvre ravissement à sa place - oui la petite y avait rêvé, et son petit frère jouerait avec...
Les jours passaient de cette fin d’année où nous remontions la pente. Nous étions occupés par nos affaires de grands. Nous étions même suroccupés. Nous nous disions surchargés. Surbookés. S’il m’arrivait de le prétendre moi aussi je n’en croyais pas un mot. Souvent, moi qui étais censé le consoler, je demandais l’aide de l’ange du cabanon, ou je prenais la main de Luciana sans mot dire.
Un soir Bruno m’appela pour me dire que la petite se mourait doucement. Mais quel cri, quelle longue plainte retenue, quel tourment de chaque instant cela signifiait-il... Or il en fut ainsi jusqu’à fin décembre.
Et cette nuit où l’ombre triomphe de la lumière, cette nuit-là la petite s’en alla.
J’ai retrouvé mon ange sur cette prairie, un après-midi d’après la Noël, dans la peau d’un bambin qui gambadait autour d’une tombe.
Il y avait là la foule grave, la foule tendre, la foule incrédule, la foule accablée, la foule des visages comme éclairés de l’intérieur qu’on ne voit qu’aux enterrements d’enfants.
L’ange du cabanon me disait: mais regarde-les, s’ils sont beaux, et je pensais à toi qui n’a plus personne que ton ange à toi, et je serrais la main de Luciana et nos belles enfants étaient là qui se retenaient de pleurer.
Je me suis rappelé toute la mélancolie de l’existence que modulait, en litanie, l’air de violon des Adieux à la turque que m’avait révélé mon ami le Gitan sur un 78 tours de l’époque ottomane, une fin d’après-midi d’il y a quelques années.
La mère et le père étaient là tout au bord de l’abîme.
Le petit frère de la petite dansait, là-bas, dans la lumière de la vie.
La Désirade, août 2001

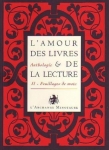



 En lisant Cavalier seul de Jérôme Garcin et Vous dansez de Marie Nimier
En lisant Cavalier seul de Jérôme Garcin et Vous dansez de Marie Nimier Ce qu’il y a de super, avec le Réseau, c’est qu’on est à la fois tout le monde et personne. T’as pas besoin de mettre un masque. A la limite, même si tu scannes ton portrait t’es pas obligé que ce soit le tien. T’es derrière ton écran et t’as pas de comptes à rendre; en tout cas tant que tu débloques pas t’as pas de comptes à rendre. Moi par exemple, après la mort de Raoul, ça m’a drôlement apporté. Parce que, pendant des jours, ça a été encore plus galère que de son vivant. Déjà que ça avait pas toujours été évident quand je l’avais sur les bras, surtout à la fin avec tout le sang qu’il crachait, mais enfin j’avais l’impression d’exister, même si je savais maintenant que je lui devais pas la vie je lui donnais volontiers tout ce qu’il fallait dans l’urgence , je faisais des heures sup pour éponger ses méfaits et gestes les plus graves, comme il disait, je l’avais adopté même s’il était pas celui que je croyais - l’autre je m’en foutais bien à présent: c’était quand même pour Raoul que j’avais fini par voter après l’avoir bien agoni pour ce qu’il nous avait fait endurer, au point de souhaiter qu’il disparaisse et qu’on n’en parle plus.
Ce qu’il y a de super, avec le Réseau, c’est qu’on est à la fois tout le monde et personne. T’as pas besoin de mettre un masque. A la limite, même si tu scannes ton portrait t’es pas obligé que ce soit le tien. T’es derrière ton écran et t’as pas de comptes à rendre; en tout cas tant que tu débloques pas t’as pas de comptes à rendre. Moi par exemple, après la mort de Raoul, ça m’a drôlement apporté. Parce que, pendant des jours, ça a été encore plus galère que de son vivant. Déjà que ça avait pas toujours été évident quand je l’avais sur les bras, surtout à la fin avec tout le sang qu’il crachait, mais enfin j’avais l’impression d’exister, même si je savais maintenant que je lui devais pas la vie je lui donnais volontiers tout ce qu’il fallait dans l’urgence , je faisais des heures sup pour éponger ses méfaits et gestes les plus graves, comme il disait, je l’avais adopté même s’il était pas celui que je croyais - l’autre je m’en foutais bien à présent: c’était quand même pour Raoul que j’avais fini par voter après l’avoir bien agoni pour ce qu’il nous avait fait endurer, au point de souhaiter qu’il disparaisse et qu’on n’en parle plus.







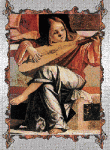 la Comédienne, ç’a été sa fille Anna, notre filleule à l’Amie de la Comédienne (elle aussi actrice de théâtre, l’une des meilleures que je connaisse avec la Comédienne) et à moi, quand elle s’est assise, petite, avec sa guitare, et a commencé à nous jouer son Menuet d’un Anonyme.
la Comédienne, ç’a été sa fille Anna, notre filleule à l’Amie de la Comédienne (elle aussi actrice de théâtre, l’une des meilleures que je connaisse avec la Comédienne) et à moi, quand elle s’est assise, petite, avec sa guitare, et a commencé à nous jouer son Menuet d’un Anonyme.

 un réseau tissant sa maille recoupée par le filet de ses mails amicaux round the world…
un réseau tissant sa maille recoupée par le filet de ses mails amicaux round the world…
 Bret Easton Ellis et la lettre à la petite cousine
Bret Easton Ellis et la lettre à la petite cousine











